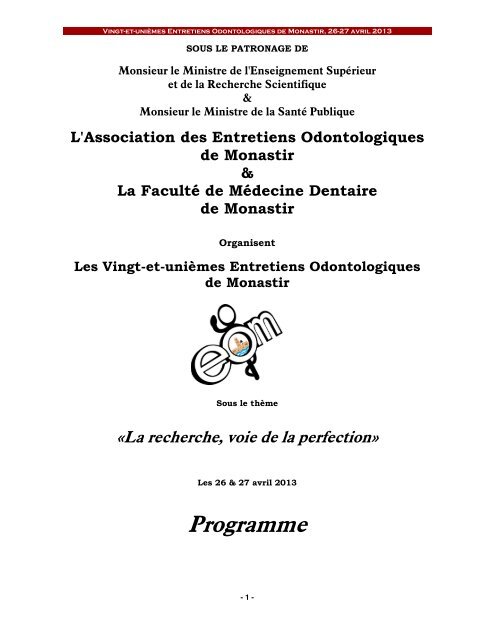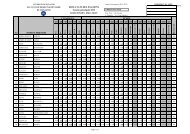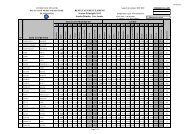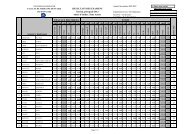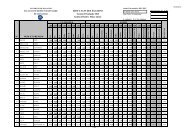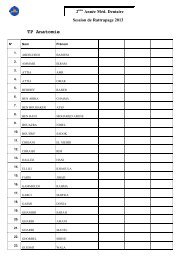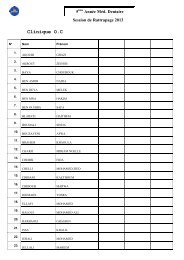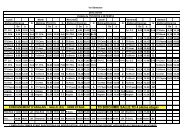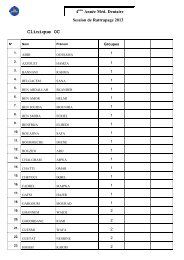Programme - Faculté de Medecine Dentaire de Monastir
Programme - Faculté de Medecine Dentaire de Monastir
Programme - Faculté de Medecine Dentaire de Monastir
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
SOUS LE PATRONAGE DE<br />
Monsieur le Ministre <strong>de</strong> l'Enseignement Supérieur<br />
et <strong>de</strong> la Recherche Scientifique<br />
&<br />
Monsieur le Ministre <strong>de</strong> la Santé Publique<br />
L'Association <strong>de</strong>s Entretiens Odontologiques<br />
<strong>de</strong> <strong>Monastir</strong><br />
&<br />
La Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Monastir</strong><br />
Organisent<br />
Les Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques<br />
<strong>de</strong> <strong>Monastir</strong><br />
Sous le thème<br />
«La recherche, voie <strong>de</strong> la perfection»<br />
Les 26 & 27 avril 2013<br />
<strong>Programme</strong><br />
- 1 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Association <strong>de</strong>s Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong> <br />
Bureau Directeur<br />
Prési<strong>de</strong>nt:<br />
Secrétaire Général:<br />
Trésorier:<br />
Membres:<br />
Ali Ben Rahma<br />
Hager Hentati<br />
Walid Ghorbel<br />
Med Sémir Belkhir<br />
Narjess Hassen<br />
Rym Bibi<br />
Imène Ben Afia<br />
Jamila Jaouadi<br />
A<strong>de</strong>l Amor<br />
Mail to: aeom.fmdm@gmail.com<br />
COMITE D'HONNEUR <br />
Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'Université <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong><br />
Monsieur le Directeur Régional <strong>de</strong> la Santé Publique <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong><br />
Madame la Prési<strong>de</strong>nte du Conseil National <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins Dentistes <strong>de</strong> Tunisie<br />
Messieurs les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s Conseils Régionaux <strong>de</strong> l'Ordre <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins Dentistes<br />
Messieurs les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s Sociétés Scientifiques, Associations et Amicales <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>Dentaire</strong><br />
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins Dentistes Hospitalo-<br />
Universitaires.<br />
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat National <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins, Mé<strong>de</strong>cins Dentistes et<br />
Pharmaciens Hospitalo-Universitaires.<br />
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins Dentistes Hospitaliers.<br />
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat National <strong>de</strong>s Mé<strong>de</strong>cins Dentistes <strong>de</strong> Libre<br />
Pratique.<br />
- 2 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
COMITE D'ORGANISATION <br />
Prési<strong>de</strong>nts d'honneur:<br />
Mongi Beïzig Mongi Majdoub Ab<strong>de</strong>laziz Kennou Khaled Bouraoui<br />
Med Sémir Belkhir Ab<strong>de</strong>llatif Abid Hachemi Bouslama Ali Ben Rahma<br />
Mounir Chérif Féthi Maâtouk Lotfi Bhouri Badiâa Jemmali<br />
Mounir Trabelsi Med Habib Hamdi Ridha M'barek<br />
Prési<strong>de</strong>nt:<br />
Ab<strong>de</strong>llatif Boughzala<br />
Trésorier:<br />
Walid Ghorbel<br />
Comité Scientifique:<br />
MS. Belkhir B. Jemmali H. Hajjami S. Sahtout H. Chraïef<br />
N. Zokkar N. Aguir I. Gasmi Z. Nouira C. Belkhir<br />
H. Triki H. Hentati M. Trabelsi J. Selmi L. Guezguez<br />
M.S. Khalfi A. Baâziz S. Bou<strong>de</strong>gga N. Khedher M.A. Bouzidi<br />
Comité <strong>de</strong> Laboratoires:<br />
L. Guezguez, L. Berrezouga, R. Chebbi<br />
Comité <strong>de</strong> l'audiovisuel et du déroulement <strong>de</strong>s séances:<br />
F. Maâtouk T. Ben Alaya H. Hentati M.S. Khalfi M. Benzarti<br />
Comité d'Accueil:<br />
Z. Baccouche, A. Ben Amor, W. Hasni, I. Farhat<br />
Membres:<br />
A. Adli A. Amor A. Ben Moussa A. Boughzala A. Chokri<br />
A. El Yemni A. Fekih A. Kassab A. Khabou A. Oueslati<br />
A. Zaghbani B. Harzallah B. Mogaâdi C. Baccouche D. Hadyaoui<br />
D. Kammoun E. El Golli F. Ben Abdallah F. Khémiss F. Masmoudi<br />
H. Bacha H. Benzarti H. Ellafi H. Ghédira H. Hrizi<br />
H. Jegham I. Ben Afia I. Blouza I. Chaâbani I. Dallel<br />
I. Farhat I. Ghaddab I. Gharbi I. Jamazi I. Kallel<br />
J. Jaouadi J. Saâfi K. Chebbi K. Masmoudi K. Souid<br />
L. Chékir L. Oualha M. Ben Khélifa M. Denguezli M. Dhidah<br />
M. Omezzine M.A. Chemli M.B. Khattèche M.M. Chebil N. Ben Mansour<br />
N. Douki N. Frih N. Hassen N. Mghirbi N. Taktak<br />
R. Bibi R. Jbir R. Zakhama S. Abid S. Ammar<br />
S. Bagga S. Ben Rejeb S. Benhamroun S. Boukottaya S. Dabbou Fékih<br />
S. Ghoul S. Hajjaji S. Marouane S. Sallem S. Sioud<br />
S. Tobji S. Touzi S. Turki S. Zouiten T. Zmantar<br />
Secrétariat:<br />
Jamila Hassine, Mokhtar Sghaïer<br />
- 3 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Jeudi 25 avril 2013<br />
Journée Précongrès<br />
«Prévention <strong>de</strong>s infections associées aux soins»<br />
Animée par le Dr Patrick Bonne<br />
Matinée<br />
09h00 - 09h45: La sécurité pour l'équipe soignante et les patients<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: M. Majdoub, A. Abid, A. Boughzala, L. Berrezouga<br />
10h00 - 10h45: Organisation et bio-nettoyage <strong>de</strong>s locaux<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: R. M'barek, J. Selmi, A. Ben Amor, N. Frih<br />
11h00 - 11h30: Pause café<br />
11h30 - 12h15: La chaîne <strong>de</strong> stérilisation<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: M. Trabelsi, T. Ben Alaya, N. Douki, S. Turki<br />
Après-Midi<br />
15h00 - 17h00: La traçabilité<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: M. Chérif, B. Jemmali, F. Ben Amor, M.B. Khattèche<br />
17h00 - 19h00:<br />
«Séminaire Young podium»<br />
Welcome: 17 p.m<br />
Chairs: A. Ben Rahma, L. Bhouri, L. Berrezouga, MS. Khalfi, K. Masmoudi<br />
First oral poster session: 17:10 p.m-17:55 p.m<br />
Chairs: F. Ben Amor, MS. Khalfi, S. Tobji, N. Aguir, H. Hentati, D. Hadyaoui<br />
1. Collaboration between orthodontics and prosthesis.<br />
May Y, Mabrouk H, Ben Salem A, Jemmali F, Zinelabidine A, Boughzala A.<br />
2. Immediate temporary prosthesis impact on periodontal and endodontic tissues: clinical and<br />
radiological study.<br />
Khiari A, Dalenda H, Guesmi I, Nouira Z, Chérif M.<br />
3. Odontogenic cutaeous fistula: a case report.<br />
Turki A, Amri M, Ben Khlifa M.<br />
4. Current all-ceramic systems.<br />
Chebil M, Omezzine M, Nouira Z, Guesmi I, Hadyaoui D, Chérif M.<br />
- 4 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
5. Why do teeth fracture<br />
Jmaa M, Besbes A, Rahmani R, Berrezouga L, Baccouche Z, Bhouri L, Belkhir MS.<br />
6. Management of an impacted mandibular canine associated with an odontoma.<br />
Ben Messaoud N, Hentati H, Ben Ali R, Chokri A, Sioud S, Selmi J.<br />
7. Study of the needs in orthodontic surgery.<br />
Sdiri D, Dallel I, Tobji S, Ben Amor A.<br />
8. Granulomatous cheilitis.<br />
Moussaoui E, Ben Messaoud N, Bel Hadj Hassine M, Hamdi MH.<br />
9. Management of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) using a new oral appliance: case<br />
report.<br />
Ben Salem Saied A, Mabrouk H, May Y, Jemmali F, Zinelabidine A, Boughzala A.<br />
10. Endodontic flare-ups: a prospective study of inci<strong>de</strong>nce and related factors.<br />
Annabi MB, Aguir N, Radadi F, Belkhir MS.<br />
Discussion: 17:55 p.m-18:05 p.m<br />
Second oral poster session: 18:05 p.m-18:50 p.m<br />
Chairs: L. Bhouri, L. Berrezouga, T. Ben Alaya, S. Sioud, A. Chokri, K. Chebbi<br />
11. Bonding of inlay-onlay realized by e.max CAD System.<br />
Adli A, Nouira Z, Gasmi I, Hadyaoui D, Saâfi J, Harzallah B, Chérif M.<br />
12. Dental trauma complications.<br />
Mabrouk R, Besbes E, Zorgui NH, Berrezouga L, Bhouri L, Belkhir MS.<br />
13. Smile rehabilitation after a previous esthetic failure: a case report.<br />
Gazbar R, Hadyaoui D, Daouahi N, Gasmi I, Nouira Z, Saâfi J, Harzallah B, Chérif M.<br />
14. Mandibular metastasis: a report of an adrenal neuroblastoma case.<br />
Bel Hadj Hassine M, Sioud S, Ayachi S, Berriri S, Chokri A, Selmi J.<br />
15. Repair of perforating internal resorption with Mineral Trioxi<strong>de</strong> Aggregate: a case report.<br />
Ab<strong>de</strong>lmoumen E, Zouiten S, Boughzala A.<br />
16. Assessment of the anteroposterieur and vertical chin position in i<strong>de</strong>al young adult.<br />
Mabrouk H.<br />
17. Extensive periapical cyst in the maxillary sinus: a case report.<br />
Bouguezzi A, Souid K, Hasni W, Ben Ali R, Zaghbani A, Bou<strong>de</strong>gga S, Boughzala A.<br />
18. Oral actinomycosis: think about !<br />
Zorgui NH, Besbes E, Berrezouga L, Belkhir MS.<br />
19. Management of an innervated impacted mesio<strong>de</strong>ns.<br />
Ben Ali R, Hentati H, Ben Messaoud N, Chokri A, Sioud S, Selmi J.<br />
20. Effect of fiber reinforced resin posts on the success of all-ceramic restorations.<br />
Grati M, Hadyaoui D, Daouahi N, Sâafi J, Harzallah B, Chérif M.<br />
21. Simultaneous sinus lift and implant placement.<br />
Ben Amara H, Amouri H, Nasri W, Ben Abdallah S.<br />
Discussion: 18:50 p.m-19: p.m<br />
Prize for the best communication<br />
Closure and presentation of certificates<br />
- 5 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Vendredi 26 avril 2013: Matinée<br />
08h45-09h00:<br />
Allocution d'ouverture<br />
Conférences: Amphi B<br />
09h00-10h00:<br />
Traitement précoce <strong>de</strong>s anomalies transversales et rôle <strong>de</strong>s fonctions.<br />
A<strong>de</strong>l Ben Amor (<strong>Monastir</strong>)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: A. Ben Rahma, M. Majdoub, S. Tobji<br />
10h00-10h45:<br />
Vingt ans d'implantologie en Tunisie<br />
Ali Ouertani (Tunis)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: K. Bouraoui, M. Trabelsi, F. Ben Amor<br />
11h00-11h45:<br />
Class II management: functional and fixed appliances.<br />
Mohamed Ali Shaweesh (Tripoli)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: H. Ghédira, M.S. Khalfi, R. Limaïem<br />
12h00-13h00:<br />
Evolutions <strong>de</strong>s séquences canalaires vers l'instrument unique en rotation continue.<br />
Yann-Loïg Turpin (Rennes)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: H. Ben Ghénaïa, N. Douki, S. Zouiten<br />
10h00-12h00<br />
Amphi A:<br />
Séminaires<br />
Odontologie Conservatrice & Endodontie<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: S. Sahtout, T. Ben M'barek, M. Hamdane<br />
10h00-10h20: Adhésion à l'émail fluorotique: silorane versus résine composite.<br />
C. Belkhir, A. Karmandi, R. Mabrouk, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
10h25-10h35: Comment gérer les acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> parcours au cours du traitement endodontique <br />
A. Oueslati, N. Aguir, J. Ben Ammar, MS. Belkhir<br />
10h40-10h50: Les fractures radiculaires: Quel traitement Quel pronostic<br />
I. Kallel, S. Bagga, N. Douki<br />
10h55-11h05: Le traitement endodontique en une seule séance: <strong>de</strong> l'abstrait au concret.<br />
A. Ben Mansour, N. Aguir, A. Nouri, MS. Belkhir<br />
11h05-11h15: L'irrigation endodontique: Quelle séquence choisir <br />
A. Kikly, E. Hidoussi, S. Sahtout, S. Belkhir<br />
11h15-11h25: Détermination <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> travail en endodontie<br />
E. Hidoussi, A. Kikly, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
11h30-11h40: Calcium hydroxi<strong>de</strong>: A magic tool if used wisely.<br />
NH. Zorgui, S. Bagga, N. Douki<br />
11h45-11h55: Approche thérapeutique <strong>de</strong>s lésions cervicales: enquête auprès<br />
<strong>de</strong> 88 mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes<br />
S. Jaâfoura, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
- 6 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Vendredi 26 avril 2013: Matinée<br />
10h00-12h00<br />
Amphi C:<br />
Séminaires<br />
Prothèse Conjointe<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: M. Beïzig, H. Hajjami, H. Ellafi<br />
10h00-10h15: Les prothèse fixées esthétiques: le meilleur choix clinique.<br />
Z. Nouira, I. Gasmi, M. Omezzine, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
10h15-10h30: La <strong>de</strong>ntisterie numérique en prothèse fixée.<br />
I. Gasmi, Z. Nouira, D. Hadyaoui, M. Omezzine, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
10h30-10h45: Comparaison <strong>de</strong>s empreintes globales en prothèse fixée.<br />
M. Omezzine, Z. Nouira, I. Gasmi, M. Barkaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
10h45-11h00: Rationaliser les soins prothétiques fixés en fonction <strong>de</strong>s cas variés:<br />
gage <strong>de</strong> réussite du traitement.<br />
D. Hadyaoui, M. Barkaoui, R. Gazbar, Z. Nouira, I. Gasmi, S. Guizani, J. Saâfi,<br />
B. Harzallah, M. Chérif<br />
11h05-11h20: Choix <strong>de</strong>s restaurations corono-radiculaires en prothèse fixée.<br />
S. Touzi, Z. Nouira, I. Gasmi, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
11h20-11h35: Intérêt <strong>de</strong>s wax-up dans le rétablissement <strong>de</strong>s plans d'occlusion en prothèse fixée.<br />
N. Mghirbi, I. Gasmi, S. Hajjaji, Z. Nouira, H. Abdallah, H. Hajjami, A. Boughzala<br />
11h40-11h55: Prothèse fixée: vers une thérapeutique non invasive.<br />
S. Hajjaji, Z. Nouira, N. Mghirbi, I. Gasmi, H. Hajjami, A. Boughzala<br />
10h00 - 12h00: Ateliers 1, 2, 3 & 4<br />
Atelier 1: Incisions et sutures<br />
L. Guezguez et al.<br />
Atelier 2: Les mini-implants et la réhabilitation prothétique<br />
N. Hassen, A. Amor, R. Oualha, I. Ksibi<br />
Atelier 3: La prothèse supra-radiculaire et supra-implantaire à complément <strong>de</strong><br />
rétention (barre <strong>de</strong> conjonction et attachements axiaux)<br />
Service <strong>de</strong> PPA <strong>Monastir</strong><br />
Atelier 4: Mise en forme canalaire par le système "Reciproc ® "File"<br />
Service O.C. , Service <strong>de</strong> M.D. Sahloul en collaboration avec la Société Sirona<br />
- 7 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Vendredi 26 avril 2013: Matinée<br />
10h00-12h00:<br />
Première Session Posters<br />
Mé<strong>de</strong>cine et Chirurgie Buccales<br />
Jury A: 10h00 - 11h00: L. Oualha, W. Ghorbel, M. Khayat<br />
A1. Double réimplantation <strong>de</strong>ntaire: bonne évolution malgré les facteurs <strong>de</strong> mauvais pronostic (A<br />
propos d'un cas).<br />
W. Hasni, M. Ben Jemaa, A. Zaghbani, K. Souid, R. Belkacem Chebil, R. Ayachi,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
A2. Cas original <strong>de</strong> pansinusite aiguë d'origine <strong>de</strong>ntaire.<br />
K. Souid, A. Bouguezzi, W. Hasni, R. Belkacem-Chebil, R. Ayachi, A. Zaghbani,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
A3. Dent surnuméraire à localisation exceptionnelle.<br />
M. Bel Haj Hassine, H. Hentati, A. Chokri, N. Ben Messaoud, S. Sioud, J. Selmi<br />
A4. Kyste épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong>: à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
R. Ben Ali, S. Sioud, M. Bel Haj Hassine, N. Ben Messaoud, A. Chokri, H. Hentati, J. Selmi<br />
A5. Prise en charge d'un granulome périphérique à cellules géantes récidivant.<br />
N. Ben Messaoud, A. Chokri, H. Hentati, M. Bel Haj Hassine, S. Sioud, J. Selmi<br />
Jury B: 11h00 - 12h00: I. Blouza, C. Dahdouh, M. Skan<strong>de</strong>r<br />
B1. Infection d'origine <strong>de</strong>ntaire révélatrice d'une dysplasie cémonto-osseuse. A propos d'un cas.<br />
I. Hachicha, L. Masmoudi, I. Babbou, M. Hafdhi, R. Ayedi<br />
B2. L'éruption <strong>de</strong>s odontomes complexes: A propos d'un cas clinique.<br />
G. Krichen, I. Blouza, A. Bouzaien, MB. Khattech<br />
B3. Fluori<strong>de</strong> osseous dysplasias: From diagnosis to treatment. A report of three cases.<br />
D. Touil, L. Oualha, E. Moussaoui, S. Klai, N. Douki<br />
B4. Epulis: Approche diagnostique, démarche thérapeutique.<br />
S. Kalai, D. Touil, E. Moussaoui, S. Lili, L. Oualha, N. Douki<br />
B5. Image ostéolytique mandibulaire chez un greffé rénal: à propos d'un cas.<br />
A. Turki, H. Skhiri, T. Ben Alaya, M. Ben Khelifa<br />
Jury C: 10h00 - 11h00: S. Sioud, A. Zaghbani, S. Ben Dhia<br />
C1. L'histiocytose langerhansienne: à propos d'un cas.<br />
R. Belkacem Chebil, W. Hasni, K. Souid, A. Zaghbani, A. Ayachi, S. Mestiri, S. Bou<strong>de</strong>gga,<br />
A. Boughzala<br />
C2. Carcinome épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> du vestibule jugal maxillaire: à propos d'un cas.<br />
R. Ayachi, W. Hasni, S. Ayachi, K. Souid, A. Zaghbani, R. Belkacem Chebil, B. Sriha,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
C3. Evaluation du rapport entre les <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> sagesse mandibulaires et le nerf alvéolaire inférieur:<br />
étu<strong>de</strong> clinique comparative entre panoramique et tomo<strong>de</strong>nsitométrie.<br />
F. Nassiba, L. Lazrak, Z. Abidine, M. Baite<br />
C4. Abcès enkysté du vestibule maxillaire: à propos d'un cas.<br />
A. Rouis, A. Chokri, S. Sioud, N. Ben Messaoud, H. Hentati, J. Selmi<br />
C5. Le risque infectieux en stomatologie: causes et prévention<br />
H. Ferjani<br />
- 8 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Orthodontie<br />
Jury D: 11h00 - 12h00: S. Tobji, A. El Yemni, I. Ben Zahra<br />
D1. La céphalométrie tridimensionnelle: révolution ou simple évolution <br />
F. Jemmali, Y. May, A. Ben Salem Saied, H. Mabrouk, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
D2. Décisions thérapeutiques en présence <strong>de</strong> premières molaires délabrées chez les sujets<br />
jeunes: à propos d'un cas.<br />
H. Mabrouk, A. Ben Salem Saied, F. Jemmali, Y. May, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
D3. Traitement orthopédique <strong>de</strong> la Cl II squelettique:à propos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
Y. May, H. Mabrouk, F. Jemmali, A. Ben Salem Saied, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
D4. Le système Damon: à propos d'un cas clinique.<br />
A. Ben Salem Saied, F. Jemmali, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
D5. Apical root resorption in patients wearing orthodontic appliances.<br />
L. Lazrak, L. Ousehal, F. Elquars<br />
Vendredi 26 avril 2013: Après-midi<br />
Conférences: Amphi B<br />
14h30-15h30:<br />
La marsupialisation <strong>de</strong>s kystes et <strong>de</strong>s tumeurs bénignes <strong>de</strong>s maxillaires, est-elle <strong>de</strong> retour <br />
Hajer Hentati (<strong>Monastir</strong>)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: J. Selmi, S. Bou<strong>de</strong>gga, R. Cheniti<br />
15h45-16h30:<br />
Esthétique : Clé <strong>de</strong> succès en prothèse fixée.<br />
Hélène Haddad (Beyrouth)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: M. Chérif, A. Kennou, N. Laâribi<br />
15h45-17h45:<br />
Amphi A:<br />
Séminaires<br />
Orthodontie & Mé<strong>de</strong>cine et Chirurgie Buccales<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: MB. Khattèche, M. Ben Khelifa, N. Khedher<br />
15h45-16h00: Le timing <strong>de</strong> la rééducation <strong>de</strong> la déglutition atypique.<br />
A. Zinelabidine, H. Mabrouk, A. Boughzala<br />
16h00-16h15: Les traitements <strong>de</strong>s classe III: <strong>de</strong> l'interception à la chirurgie.<br />
I. Dallel, S. Ben Rejeb, N. Khdher, S. Tobji, A. Ben Amor<br />
16h15-16h30: Traitement orthodontique rapi<strong>de</strong> : apport <strong>de</strong> la corticotomie alvéolaire.<br />
S. Ben Rejeb, I. Dallel, N. Khedher, S. Tobji, A. Ben Amor<br />
16h30-16h45: Les extractions sous anticoagulants oraux au cabinet <strong>de</strong>ntaire.<br />
W. Hasni, A. Zaghbani, K. Souid, R. Ayachi, R. Belkacem Chebil, S. Bou<strong>de</strong>gga,<br />
A. Boughzala<br />
16h45-17h00: Cas rares <strong>de</strong> kystes multiples <strong>de</strong>s maxillaires.<br />
K. Souid, A. Slama, W. Hasni, R. Belkacem Chebil, A. Zaghbani, S. Bou<strong>de</strong>gga,<br />
A. Boughzala<br />
17h00-17h15: Fistule cutanée d'origine <strong>de</strong>ntaire.<br />
A. Chokri, H. Hentati, M. Bel Haj Hassine, N. Ben Messaoud, S. Sioud, J. Selmi<br />
17h15-17h30: Effet <strong>de</strong>s faibles doses <strong>de</strong> rayons X: Etu<strong>de</strong> expérimentales sur la souris<br />
en gestation.<br />
I. Chaâbani, F. Khemiss, B. Sriha, T. Ben Alaya<br />
17h30-17h45: Quelle relation existe-t-il entre l'asthme et les lésions bucco-<strong>de</strong>ntaires <br />
M. Denguezli, M. Khemiss, F. Khemiss, M. Dhidah<br />
- 9 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Amphi C:<br />
Prothèse Amovible<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: MA. Bouzidi, L. Mansour, H. Bouachour<br />
15h45-15h55: Perturbation <strong>de</strong> la DVO: Etiologie et moyens <strong>de</strong> diagnostic.<br />
H. Triki, N. Taktak, N. Hassen, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
16h00-16h10: Peut-on varier la DVO Critères <strong>de</strong> décision.<br />
S. Ammar, I. Farhat, B. Mogaâdi, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
16h15-16h25: Les moyens <strong>de</strong> rétabmissement <strong>de</strong> la DVO.<br />
B. Mogaâdi, I. Ouni, S. Bouraoui, S. Bekri, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
16h30-16h40: La supraclusie chez l'é<strong>de</strong>nté partiel: spécificités et modalités thérapeutiques.<br />
I. Farhat, B. Mogaâdi, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
16h45-16h55: Gestion <strong>de</strong> la dualité tissulaire <strong>de</strong>s é<strong>de</strong>ntements terminaux en PPA.<br />
N. Hassen, H. Triki, L. Mansour, N. Douki<br />
17h00-17h10: Divisions vélopalatines non opérées ou séquellaires chez l'adulte:approche<br />
fondamentale et thérapeutique en prothèse maxillo-faciale.<br />
K. Chebbi, K. Masmoudi, A. Ben Abdallah, J. Jaouadi, H. Chraief, MA. Bouzidi,<br />
A. B. Rahma, M. Majdoub<br />
17h15-17h25: Essayage et remontage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts en prothèse complète.<br />
J. Jaouadi, A. Ben Abdallah, K. Chebbi, H. Chraïef, A. Ben Rahma, M. Majdoub<br />
17h30-17h40: Attachement axial, barre d'ancrage: Quand et comment <br />
R. Bibi, S. Bekri, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
15h45-17h45:<br />
Deuxième Session Posters<br />
Parodontologie<br />
Jury E: 15h45 - 17h00: L. Guezguez, H. Hentati, R. Gargouri<br />
E1. La greffe épithélio-conjonctive.<br />
O. Ouelhazi, H. Ben Amara, S. Ben Abdallah, R. M'barek<br />
E2. Approche thérapeutique <strong>de</strong>s hypertrophies gingivales d'origine medicamenteuse.<br />
S. Ben Tanfous, N. Khouildi, R. Masmoudi, H. Amouri, L. Guezguez<br />
E3. L'élongation coronaire chirurgicale: Approches thérapeutiques et limites.<br />
N. Khouildi, L. Guezguez<br />
E4. Les implants au niveau du secteur postérieur.<br />
H. Ben Amara, H. Amouri, R. Masmoudi, R. M'barek<br />
E5. Applications cliniques <strong>de</strong> la piézochirurgie.<br />
H. Amouri, W. Nasri, S. Ben Tanfous, R. M'barek<br />
E6. Le lambeau <strong>de</strong> préservation papillaire en chirurgie osseuse parodontale.<br />
W. Nasri, O. Ouelhazi, N. Khouildi, R. M'barek<br />
E7. Les aminobisphosphonates par voie locale: Quel intérêt dans la thérapeutique parodontale <br />
T. Mechergui, L. Guezguez<br />
E8. Traitement <strong>de</strong>s parodontolyses: apport <strong>de</strong> l'orthodontie.<br />
H. Jegham, W. Bechraoui, Z. Khadhar, S. Nahali, I. Blouza, S. Turki, MB. Khattèche<br />
- 10 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Prothèse Fixée<br />
Jury F: 15h45 - 16h45: I. Gasmi, M. Omezzine, S. Touzi<br />
F1. A direct build up of a monobloc crown: illustrated by a clinical situation.<br />
A. Khiari, D. Hadyaoui, Z. Nouira, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
F2. Comment réussir l'empreinte globale sans guidage unitaire <br />
N. Daouahi, R. Gazbar, I. Gasmi, Z. Nouira, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
F3. Evaluation du taux <strong>de</strong> survie <strong>de</strong>s bridges collés réalisés entre 2010 et 2012 au service <strong>de</strong><br />
Prothèse Conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca.<br />
N. El Mesbahi, A. Bennani, M. Hamza, A. Bigou<br />
F4. Les <strong>de</strong>nts dépulpées en prothèse fixée: quand conserver, quand extraire <br />
N. Chérif, I. Gasmi, Z. Nouira, N. Oueslati, B. Douss, M. Chérif<br />
F5. Evaluation qualitative <strong>de</strong>s Reconstitutions Corono-Radiculaires Foulées réalisées entre avril<br />
2010 et avril 2012 au service <strong>de</strong> Prothèse Conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca, Maroc.<br />
A. Chafii, A. Bennani, M. Hamza, A. Bigou, A. Andoh<br />
F6. L'enregistrement <strong>de</strong> l'occlusion par la technique F.G.P.<br />
A. Ben Moussa, R. Dakhli, Z. Nouira, I. Gasmi, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Jury G: 16h45 - 17h45: Z. Nouira, D. Hadyaoui, A. Amor<br />
G1. La restauration esthétique d'une <strong>de</strong>nt riziforme par la facette collée.<br />
R. Gazbar, I. Gasmi, Z. Nouira, M. Barkaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
G2. Les restaurations partielles en céramique réalisés avec la CFAO sur <strong>de</strong>nts postérieures:<br />
à propos d'un cas clinique<br />
M. Grati, I. Gasmi, Z. Nouira, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
G3. Etu<strong>de</strong> ultrastructurale <strong>de</strong>s alliages Ni-Cr utilisés en prothèse conjointe<br />
A. Bennani, M. Amine, A. Chafii, S. Eladioui<br />
G4. Traitement multidisciplinaire pour le remplacement <strong>de</strong> le centrale absente: à propos d'un cas<br />
clinique.<br />
M. Ajlani, M. Barkaoui, D. Hadyaoui, Z. Nouira, I. Gasmi, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
G5. Bridge céramo-céramique au niveau postérieur: à propos d'un cas clinique.<br />
M. Barkaoui, M. Chebil, Z. Nouira, I. Gasmi, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
15h45 - 17h45: Ateliers 5 & 6<br />
Atelier 5: Mise en forme par l'instrumentation «One Shape»<br />
Service d'Odontologie Conservatrice en collaboration avec la Société I.M.S<br />
Atelier 6: Technique <strong>de</strong> blanchiment par le système «Zoom»<br />
Service <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> Sahloul et Service d'O.C. en collaboration avec la Société<br />
Sirona<br />
Conférence: Amphi B<br />
17h45-18h45:<br />
Les nouveaux bracketts autoligaturants et les fils à mémoire <strong>de</strong> forme, modalités d'utilisation.<br />
Francis Bassigny (Paris)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: A. Ben Amor, R. Ben Zineb, H. Bouslama<br />
- 11 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Samedi 27 avril 2013: Matinée<br />
Conférences: Amphi B<br />
08h30-09h30:<br />
La <strong>de</strong>ntisterie durable: traiter les lésions profon<strong>de</strong>s en conservant la vitalité pulpaire.<br />
Jean-Jacques Lasfargues (Paris)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: L. Bhouri, N. Zokkar, C. Belkhir<br />
09h45-10h30:<br />
Approche conservatrice pour restaurer la <strong>de</strong>nt dépulpée.<br />
Saïda Sahtout (<strong>Monastir</strong>)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: M. Dhidah, L. Berrezouga, Z. Baccouche<br />
10h30-11h15:<br />
Etu<strong>de</strong> au MEB <strong>de</strong> l'efficacité <strong>de</strong> l'élimination <strong>de</strong> la smear layer <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux systèmes <strong>de</strong> préparation<br />
canalaire: l'Endo Express et le Protaper.<br />
Najet Aguir (<strong>Monastir</strong>)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: S. Ghoul, C. Baccouche, K. Essayem<br />
11h30-12h30:<br />
Confection prothétique par le système CFAO.<br />
Imad Ghandour (Allemagne)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: B. Harzallah, H. Hajjami, H. Chraïef, I. Ben Afia<br />
10h30-12h30:<br />
Amphi A:<br />
Séminaires<br />
Odontologie Pédiatrique<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: A. Abid, F. Maâtouk, B. Jemmali<br />
10h30-10h45: Maladie cœliaque et manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires.<br />
I. Gharbi, L. Laâdhar, K. Tlili, N. Gharbi, M. Dami, J. Zaroui, I. Jamazi, MA. Chemli,<br />
S. Khouja, B. Jemmali<br />
10h45-11h00: Bruxisme et troubles respiratoires chroniques chez l'enfant: à propos d'une enquête<br />
épidémiologique.<br />
R. Chebbi, M. Khemiss, I. Chafaï, M. Dhidah<br />
11h00-11h15: Allaitement et santé bucco-<strong>de</strong>ntaire.<br />
MA. Chemli, I. Jamazi, M. Dami, I. Gharbi, S. Khouja, N. Gharbi, B. Jemmali<br />
11h20-11h30: Anémie <strong>de</strong> Fanconi, maladie: à propos d'un cas clinique.<br />
I. Jazi, D. Jarrar, F. Chouchène, M. Zouari, Y. Elelmi, A. Baâziz, F. Masmoudi,<br />
F. Maâtouk, H. Ghédira, A. Abid<br />
11h35-11h45: La dysplasie anhidrotique ecto<strong>de</strong>rmique chez l'enfant.<br />
Y. Elelmi, H. Triki, I. Mahmoudi, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz,<br />
F. Maâtouk, H. Ghédira, A. Abid<br />
11h50-12h00: Epulis à cellules géantes chez l'enfant: à propos d'un cas.<br />
I. Mahmoudi, H. Hamdi, Y. Elelmi, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz,<br />
H. Ghédira, F. Maâtouk, A. Abid<br />
12h05-12h20: Assessment of oral health knowledge in children with type 1 diabetes mellitus.<br />
A. Abulwefa, Al Hafian, A. Sabkha<br />
- 12 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Samedi 27 avril 2013: Matinée<br />
10h30-12h30:<br />
Séminaires<br />
Amphi C:<br />
Parodontologie & Implantologie<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> Séance: L. Guezguez, T. Ben Alaya<br />
10h30-10h45: La greffe <strong>de</strong> conjonctif enfoui autour <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts et <strong>de</strong>s implants.<br />
S. Ben Abdallah, H. Amouri, R. Masmoudi, R. M'barek<br />
10h50-11h05: Remplacement <strong>de</strong> l'incisive centrale maxillaire par <strong>de</strong> la prothèse implanto-portée.<br />
W. Nasri, S. Ben Abdallah, H. Ben Amara, R. M'barek<br />
11h10-10h25: Gestion préopératoire <strong>de</strong>s lésions osseuses péri-implantaires.<br />
H. Amouri, O. Ouelhazi, N. Khouildi, R. M'barek<br />
11h30-11h45: Comparaison du résultat esthétique: implant immédiat vs implant différé.<br />
H. Ben Amara, W. Nasri, S. Ben Tanfous, R. M'barek<br />
11h50-12h05: Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'association <strong>de</strong>s parodontites au psoriasis et ses complications.<br />
O. Zouiten, Ph. Doucet, M. Gosset<br />
12h10-12h25: Les essais cliniques.<br />
M. Khemiss, R. Chebbi, M. Dhidah<br />
10h30-12h30:<br />
Troisième Session Posters<br />
Prothèse Amovible<br />
Jury H: 10h30 - 11h30: I. Ben Afia, R. Bibi, J. Jaouadi<br />
H1. Intérêt <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> l'occlusion en phase d'étu<strong>de</strong> en PPA.<br />
J. Ben Mustapha, S. Bouraoui, S. Ammar, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
H2. Insuffisance <strong>de</strong> la hauteur prothétique, quelles sont les solutions adoptées A propos d'un<br />
cas<br />
I. Ouni, S. Bekri, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
H3. Rendre le sourire aux patients atteints d'amélogenèse imparfaite.<br />
I. Saddouri, B. Mogaâdi, S. Ammar, N. Taktak, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
H4. Traitement <strong>de</strong> la classe I <strong>de</strong> Kennedy associée à une abrasion par la prothèse composite: à<br />
propos d'un cas clinique.<br />
R. Oualha, N. Hassen, A. Amor, A. Achour, N. Douki<br />
H5. Choix <strong>de</strong>s extractions <strong>de</strong>ntaires en prothèse partielle amovible.<br />
A. Labidi, B. Mogaâdi, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Jury I: 11h30 - 12h30: S. Marouène, H. Triki, N. Taktak<br />
I1. Réhabilitation prothétique d'un é<strong>de</strong>nté partiel présentant une abrasion généralisée<br />
S. Bouraoui, C. Baccouche, R. Bibi, L. Ajina, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
I2. Les couronnes fraisées anticipées.<br />
S. Bekri, I. Ouni, H. Triki, R. Bibi, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
I3. Hyperplasies et prothèse complète: chirurgie ou mise en condition tissulaire <br />
I. Chouaïeb, J. Jaouadi, K. Masmoudi, I. Ben Jemâa, M. Sellami, K. Chebbi, H. Chraïef,<br />
MA. Bouzidi, M. Majdoub<br />
I4. Les doléances médiates en prothèse complète amovible.<br />
I. Ben Jmâa, A. Ben Abdallah, J. Jaouadi, K. Chebbi, M. Majdoub<br />
I5. Insuffisance <strong>de</strong> l'espace prothétique disponible: conduite à tenir<br />
M. Sellami, J. Jaouadi, K. Masmoudi, H. Chraïef, O. Ben Romdhane, M. Majdoub<br />
- 13 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> Communautaire<br />
Jury J: 10h30 - 11h30: M.S. Khalfi, C. Baccouche, K. Sahnoun<br />
J1. Les orthèses d'avancée mandibulaire: moyens <strong>de</strong> traitement du syndrome d'apnée du<br />
sommeil.<br />
M. Khemiss, R. Chebbi, M. Dhidah<br />
J2. Audit <strong>de</strong>s pratiques d'hygiène en milieu <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>ntaires dans la région <strong>de</strong> Bizerte.<br />
S. Arfaoui, R. Hamza, H. Kammoun, F. Maâtouk<br />
J3. Perception et évaluation <strong>de</strong>s connaissances en biostatistiques et <strong>de</strong> la compréhension <strong>de</strong>s<br />
résultats <strong>de</strong>s articles scientifiques chez les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca.<br />
Z. Abidine, Z. Seghier, F. Bourzgui, M.O. Bennani<br />
J4. Solutions proposées aux étudiants <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong> pour<br />
gérer leur stress.<br />
T. El Ouni, R. Chebbi, M. Khemiss, M. Dhidah<br />
J5. Validation <strong>de</strong> la version française du Dental Environment Stress questionnaire (DES) auprès<br />
<strong>de</strong>s étudiants <strong>de</strong> la Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> <strong>de</strong> Casablanca.<br />
M. Bellamine, Z. Bentahar, Z. Seghier, C. Nabet, JN. Vergnes<br />
Jury K: 11h30 - 12h30: N. Frih, N. Hassen, D. Kammoun<br />
K1. Dents surnuméraires: Aspects clinique et approche thérapeutique.<br />
A. Mliki, K. Mziou, A. Amri, S. Boukhris<br />
K2. Prise en charge <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> nombre: A propos <strong>de</strong> quelques cas<br />
I. Jebli, R. Ben Gabsia<br />
K3. Le mésio<strong>de</strong>ns: Importance du diagnostic précoce.<br />
K. Mziou, A. Mliki, A. Amri, S. Boukhris<br />
K4. Exercice pluridisciplinaire versus exercice par service cloisonné: Proposition au CCTD.<br />
F.E. Amzyl, F.Z. Mahdoud, M. Hamza, A. Bennani<br />
K5. Prévalence <strong>de</strong>s symptômes <strong>de</strong>s désordres cranio-mandibulaires dans une population entre<br />
19 et 35 ans. Casablanca - Maroc<br />
F.E. Boucetta, F.E. Amzyl, E. Jouhadi, A. Andoh<br />
10h30-12h30: Ateliers 7 & 8:<br />
Atelier 7: Reconstitutions corono-radiculaires fibrées<br />
Service O.C. en collaboration avec la Société 3M Espe<br />
Atelier 8: Compétence dans le choix <strong>de</strong> la couleur en <strong>de</strong>ntisterie: Importance <strong>de</strong> la<br />
colorimétrie dans la pratique quotidienne et son impact sur un enseignement académique<br />
ciblé.<br />
Hélène Haddad et le Service <strong>de</strong> Prothèse Conjointe en collaboration avec la Société I.M.S<br />
- 14 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Samedi 27 avril 2013: Après-midi<br />
Conférences: Amphi B<br />
14h00-15h00:<br />
Les implants sous-périostés: historique, buts et procédures.<br />
Jean-Paul Davidas (Paris)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: R. M'barek, H. Khochtali, M. Félhi<br />
15h00-16h00:<br />
Importance <strong>de</strong>s piliers en implantologie<br />
Jean-Clau<strong>de</strong> Fournier (Paris)<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: L. Guezguez, S. Turki, A. Belkhodja<br />
Atelier - Démonstration: Nouvel Amphi<br />
16h00-18h00:<br />
Confection en direct sur patient d'une prothèse par le système CFAO - Sirona CEREC<br />
Premium<br />
En collaboration avec la Société Sirona<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> séance: B. Harzallah, H. Hajjami, H. Chraïef, J. Saâfi<br />
15h00-17h00: Atelier 9:<br />
Atelier 9: Mise en forme canalaire par le système Tilos<br />
Service d'O.C. en collaboration avec la Société Sphère Médico-<strong>Dentaire</strong> & Ultra<strong>de</strong>nt<br />
15h00-17h00:<br />
Quatrième Session Posters<br />
Odontologie Conservatrice & Endodontie<br />
Jury L: 15h00 - 16h00: Z. Baccouche, D. Kammoun, S. Lakhoua<br />
L1. La réparation <strong>de</strong>s restaurations antérieures en résine composites, comment s'y prendre <br />
A. Oueslati, N. Aguir, R. Mabrouk, L. Bhouri, MS. Belkhir<br />
L2. Hypominéralisation <strong>de</strong>s incisives (MIH): éventualités thérapeutiques: à propos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas.<br />
I. Echerni, N. Aguir, W. Houidi, L. Ben Krima, MS. Belkhir<br />
L3. Restauration coronaire fibrée <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt dépulpée.<br />
A. Kikly, E. Hidoussi, J. Ben Ammar, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
L4. Approche clinique <strong>de</strong> la stratification antérieure <strong>de</strong>s résines composites.<br />
E. Hidoussi, A. Kikly, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
L5. Amelogenesis Imperfecta and kidney <strong>de</strong>ficiency.<br />
N.H. Zorgui, H. Féki, S. Bagga, N. Douki<br />
- 15 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Samedi 27 avril 2013: Après-midi<br />
Jury M: 16h00 - 17h00: N. Aguir, S. Bagga, F. Mahjoub<br />
M1. Closure of anterior distemas using direct resin composite technique: case report.<br />
R. Mabrouk, N. Aguir, MS. Belkhir<br />
M2. : Les fistules cutanées d'origine endodontique: A propos d'un cas clinique.<br />
E. Ab<strong>de</strong>lmoumen, S. Zouiten, A. Boughzala<br />
M3. La fracture instrumentale en endodontie: un défi quotidien.<br />
J. Ben Ammar, N. Aguir, MS. Belkhir<br />
M4. Les facettes composites par technique directe: Utilisation chez un enfant présentant une<br />
amélogenèse imparfaite.<br />
H. Féki, H. Ben Rejeb, I. Kallel, S. Bagga, N. Douki<br />
M5. Dental treatments in patients un<strong>de</strong>rgoing radiotherapy for head and neck cancer<br />
E. Besbes, NH. Zorgui, R. Mabrouk, L. Berrezouga, L. Bhouri, MS. Belkhir<br />
M6. L'obturation canalaire par le système B.<br />
I. Landolsi, A. Kikly, C. Belkhir, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
Odontologie Pédiatrique & Prévention<br />
Jury N: 15h00 - 16h00: A. Baâziz, J. Bouslama, H. Dhaoui<br />
N1. Les anomalies <strong>de</strong> forme: gémination et évagination.<br />
A. Béji, I. Mahmoudi, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz, H. Ghédira, F. Maâtouk,<br />
A. Abid<br />
N2. «Odonto-hypophosphatasie», une forme <strong>de</strong> l'hypophosphatasie: à propos d'un cas clinique.<br />
D. Jarrar, I. Jazi, A. Béji, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz, F. Maâtouk, H. Ghédira,<br />
A. Abid<br />
N3. Le lymphome <strong>de</strong> Burkitt: A propos d'un cas clinique.<br />
F. Chouchène, Y. Elelmi, I. Mahmoudi, D. Jarrar, I. Jazi , F. Masmoudi, A. Baâziz,<br />
H. Ghédira, F. Maâtouk, A. Abid<br />
N4. Découverte <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts surnuméraires chez un enfant consultant pour une surinfection<br />
kystique: Conduite à tenir.<br />
L. Masmoudi, I. Hachicha, M. Hafdhi, I. Babbou, R. Ayadi<br />
N5. Mieux connaître ses facteurs <strong>de</strong> risque pour mieux prévenir la carie <strong>de</strong>ntaire.<br />
A. Dridi, Z. Bennour, S. Benkhoud, A. Annabi, M. Jrad<br />
Jury O: 16h00 - 17h00: F. Maâtouk, F. Masmoudi, I. Gharbi<br />
O1. L'hypominéralisation molaire et incisive: à propos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
M. Aïssa-Larousse, R. Ben Gabsia, E. Tourki<br />
O2. La prise en charge <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong>ntaires chez l'enfant<br />
S. Gassara, K. Mziou<br />
O3. Manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Fanconi: A propos d'un cas.<br />
R. Ben Gabsia, M. Aïssa-Larousse, I. Jebli<br />
O4. Dents natales et néonatales: conduite à tenir.<br />
M. Dami, N. Gharbi, I. Jamazi, MA. Chemli, I. Gharbi, B. Jemmali<br />
O5. La prophylaxie en odontologie pédiatrique.<br />
N. Gharbi, M. Dami, I. Jamazi, MA. Chemli, I. Gharbi, B. Jemmali<br />
- 16 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Résumés<br />
«Conférences»<br />
A<strong>de</strong>l Ben Amor (<strong>Monastir</strong>)<br />
Traitement précoce <strong>de</strong>s anomalies transversales et rôle <strong>de</strong>s fonctions<br />
Les anomalies du sens transversal représentent la part oubliée <strong>de</strong>s anomalies orthodontiques.<br />
Pourtant, il s’agit souvent d’un problème fonctionnel qui sera à l’origine d’un hypodéveloppement<br />
dont les conséquences non traités iront en s’aggravant.<br />
Il apparait donc urgent d’instaurer une démocratisation <strong>de</strong> leurs thérapeutiques précoces tout en<br />
soulignant le bon suivi médical <strong>de</strong> la réhabilitation <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> la sphère oro-faciale à l’heure<br />
où l’in<strong>de</strong>x est pointé sur les répercussions du syndrome <strong>de</strong> l’apnée du sommeil <strong>de</strong> plus en plus<br />
relié aux thérapeutiques orthodontiques.<br />
Nous insistons également sur les différentes approches thérapeutiques permettant <strong>de</strong> corriger ces<br />
malocclusions ainsi que sur les voies <strong>de</strong> recherches qui permettront à court terme <strong>de</strong> faciliter leur<br />
guérison.<br />
Ali Ouertani (Tunis)<br />
Vingt ans d'implantologie en Tunisie<br />
L’implantologie a commencé en 1992-93 en Tunisie grâce à l’initiative <strong>de</strong> quelques praticiens<br />
ouverts aux techniques nouvelles, mo<strong>de</strong>rnistes et attachés au développement <strong>de</strong> notre profession.<br />
Ainsi nous avons suivi les « <strong>de</strong>rnières données <strong>de</strong> la science », tout comme cela était pratiqué<br />
partout dans le mon<strong>de</strong>. La science n’ayant pas <strong>de</strong> limites, les praticiens tunisiens ont développés<br />
leurs connaissances grâce à <strong>de</strong>s study groups, aux séminaires et aux congrès multiples.<br />
Ma communication permettra <strong>de</strong> voir les tout premiers cas que nous avons implantés et qui, Dieu<br />
merci, tiennent toujours aussi bien. Implants unitaires, prothèse plurale sur implants, prothèses<br />
totales sur implants… Les cas se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons développé nos<br />
traitement en inscrivant cet apport <strong>de</strong> l’implantologie dans un cadre d’omnipratique pour une<br />
démocratisation <strong>de</strong> cette technique chirurgicale et prothétique. La présentation montrera le choix<br />
<strong>de</strong>s cas cliniques, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces cas, le choix <strong>de</strong>s solutions prothétiques et la réhabilitation dans<br />
son ensemble dans le but du confort <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s. Le recul <strong>de</strong> plusieurs années nous permet <strong>de</strong><br />
faire <strong>de</strong>s constatations que j’estime très utiles et bonnes à partager.<br />
Mohamed Ali Shaweesh (Tripoli)<br />
Class II management: functional and fixed appliances<br />
In this presentation, the management of skeletal class II malocclusion will be discussed, using the<br />
current up-to-date methods and the importance of careful case selection will be highlighted.<br />
The Twin Block appliance utilise the functional mechanism of the natural <strong>de</strong>ntition, the occlusal<br />
inclined plane, to harness the forces of occlusion and musculture to correct the existing<br />
malocclusion. It represents a fundamental transition from a one-piece appliance, which restricts<br />
normal function to a twin appliance that promotes it.<br />
The aim of this presentation is to provi<strong>de</strong> a gui<strong>de</strong> with regard to the construction of the most<br />
commonly used Twin Block appliance <strong>de</strong>sign, its’ mo<strong>de</strong> of action, and clinical management.<br />
Patients shown in this presentation were followed throughout their orthodontic treatment in both<br />
functional and fixed appliance stages.<br />
- 17 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Yann-Loïg Turpin (Rennes)<br />
Evolutions <strong>de</strong>s séquences canalaires vers l'instrument unique en rotation continue<br />
La préparation canalaire, étape clef du traitement endodontique, a été considérablement<br />
améliorée par l’utilisation d’instruments mécanisée en Nickel Titane. Cependant la souplesse<br />
considérable <strong>de</strong> cet alliage s’accompagne d’un risque important <strong>de</strong> fracture instrumentale. Ce<br />
risque est maitrisé par l’usage <strong>de</strong> séquences canalaires mettant en jeu un nombre important<br />
d’instruments, presque toujours utilisés en crown down. Ces séquences canalaires complexes<br />
permettent <strong>de</strong> réduire le risque <strong>de</strong> fracture et <strong>de</strong> répondre aux objectifs biologiques. Elles sont par<br />
contre difficilement compatibles avec une ergonomie simple, et le nombre important d’instrument<br />
utilisés augmente le coût <strong>de</strong>s techniques, ce qui incite à réutiliser chaque instrument <strong>de</strong><br />
nombreuse fois.<br />
Les concepts instrumentaux récents permettent <strong>de</strong> réduire les contraintes exercées et donc<br />
d’obtenir <strong>de</strong>s séquences canalaires plus courtes. Ainsi le Revo-S® est le premier instrument à<br />
présenter une section asymétrique, et est utilisé en une séquence <strong>de</strong> base, en crown down à<br />
seulement 3 instruments, il permet d’obtenir une préparation apicale en 25/100ièmes et en conicité<br />
apicale <strong>de</strong> 6%.<br />
Récemment ont été développés <strong>de</strong>s instruments qui permettent la préparation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
trajectoire avec un seul instrument. La réduction <strong>de</strong>s contraintes sur l’instrument peut se faire <strong>de</strong><br />
différentes manières, pour certains il s’agit d’un mouvement réciproque imposé à l’instrument par<br />
un moteur spécifique. Le One Shape® est lui le premier instrument unique en rotation continue, il<br />
peut être utilisé sur un simple contre angle réducteur endodontique. La réduction <strong>de</strong>s contraintes<br />
et l’utilisation en rotation continue sont possibles grâce à une section variable le long <strong>de</strong><br />
l’instrument. La dynamique instrumentale reste en crown down et permet comme précé<strong>de</strong>mment<br />
d’obtenir une préparation apicale en 25/100èmes et en conicité apicale <strong>de</strong> 6%.<br />
Ce concept <strong>de</strong> préparation canalaire avec un seul instrument, permet d’améliorer<br />
considérablement l’ergonomie ainsi que l’hygiène, en s’affranchissant du nettoyage et <strong>de</strong> la<br />
stérilisation d’instruments qui <strong>de</strong>viennent à usage unique.<br />
Les séquences canalaires <strong>de</strong>s instruments seront expliquées, et les avantages ergonomiques,<br />
mécaniques et biologiques <strong>de</strong> chaque instrument seront discutés, notamment en comparaison<br />
d’autre systèmes actuels.<br />
Hajer Hentati (<strong>Monastir</strong>)<br />
La marsupialisation <strong>de</strong>s kystes et <strong>de</strong>s tumeurs bénignes <strong>de</strong>s maxillaires, est-elle <strong>de</strong> retour <br />
Les kystes <strong>de</strong>s maxillaires sont <strong>de</strong>s lésions intraosseuses, odontogènes et non odontogènes,<br />
caractérisés par la présence d’une enveloppe épithéliale et d’un contenu liqui<strong>de</strong> ou semi-liqui<strong>de</strong>.<br />
Les tumeurs bénignes <strong>de</strong>s maxillaires sont très variées et sont également classées en<br />
odontogènes et non odontogènes.<br />
Ces lésions présentent <strong>de</strong>s différences sur les plans étiopathogénique, diagnostique et évolutif,<br />
mais présentent <strong>de</strong>s points communs, dont celui <strong>de</strong> requérir un traitement chirurgical. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
peut être <strong>de</strong> type énucléation ou exérèse, conservatrice ou radicale, selon la réflexion<br />
diagnostique.<br />
Cette attitu<strong>de</strong> thérapeutique présente l’inconvénient <strong>de</strong> provoquer un délabrement osseux<br />
important avec, parfois la perte <strong>de</strong> germes <strong>de</strong>ntaires chez l’enfant.<br />
La décompression est une technique qui vise à diminuer la pression à l’intérieur du kyste ou <strong>de</strong> la<br />
tumeur. Elle est obtenue par la réalisation d’une ouverture dans le kyste. La marsupialisation<br />
implique <strong>de</strong> convertir le kyste en une poche.<br />
Décompression et marsupialisation, préconisées, dès la fin du 19è siècle par Partsch, est<br />
actuellement <strong>de</strong> retour avec <strong>de</strong> nombreuses publications concernant le traitement <strong>de</strong>s kystes et<br />
<strong>de</strong>s tumeurs bénignes <strong>de</strong>s maxillaires par cette technique dite conservatrice.<br />
- 18 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Hélène Haddad (Beyrouth)<br />
Esthétique : Clef <strong>de</strong> succès en prothèse fixée<br />
L'esthétique est une exigence primordiale à satisfaire lors <strong>de</strong> la réalisation d'une prothèse fixée. Le<br />
succès esthétique d'une restauration est intimement lié à la correcte reproduction <strong>de</strong> la forme, <strong>de</strong><br />
la texture, <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong> surface et <strong>de</strong> la couleur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt naturelle.<br />
La détermination <strong>de</strong> la couleur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt à restaurer par le praticien au cabinet <strong>de</strong>ntaire, la<br />
communication <strong>de</strong>s données au technicien <strong>de</strong> prothèse et son exacte reproduction ont toujours été<br />
un problème complexe et un défi difficile à relever.<br />
La détermination visuelle <strong>de</strong> la couleur utilisant les teintiers est largement répandue dans la<br />
pratique quotidienne en <strong>de</strong>ntisterie. Cette métho<strong>de</strong> subjective est sous l'influence <strong>de</strong> la lumière<br />
ambiante, <strong>de</strong> l'œil <strong>de</strong> l'observateur et du champ chromatique du teintier. Ces trois facteurs ont un<br />
rôle prépondérant dans la détermination <strong>de</strong> la couleur et influencent les chances <strong>de</strong> succès <strong>de</strong> la<br />
procédure. De nouveaux moyens sont actuellement disponibles et permettent la détermination<br />
numérique <strong>de</strong> la couleur grâce à l'utilisation <strong>de</strong> spectrophotomètres <strong>de</strong>ntaires.<br />
Quelle procédure adopter pour une sélection optimale <strong>de</strong> la couleur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts dans la pratique<br />
quotidienne en <strong>de</strong>ntisterie Les spectrophotomètres <strong>de</strong>ntaires sont-ils les outils du futur en<br />
<strong>de</strong>ntisterie <br />
Francis Bassigny (Paris)<br />
Les nouveaux bracketts autoligaturants et les fils à mémoire <strong>de</strong> forme, modalités d'utilisation<br />
1. Evolution <strong>de</strong>s techniques multibagues<br />
2. Les nouveaux bracketts auto-ligaturants: Speed, Damon, Dentsply, (Innovation) Mobilock 1980,<br />
Activa1986,<br />
Pourquoi <strong>de</strong>s brackets autoligaturants Le collage, le positionnement, lamise en place <strong>de</strong>s arcs,<br />
ouverture , fermeture,<br />
Blocage <strong>de</strong> la longueur d’arca<strong>de</strong> -avantage , inconvénient<br />
3.Les fils à mémoire <strong>de</strong> forme<br />
- La section <strong>de</strong>s arcs<br />
- La pose <strong>de</strong>s arcs<br />
- Le blocage distal<br />
- Le changement <strong>de</strong> phase au froid<br />
- Quelques exemples d’utilisation<br />
4. Bref aperçu <strong>de</strong>s ancrage osseux<br />
Najet Aguir (<strong>Monastir</strong>)<br />
Etu<strong>de</strong> au MEB <strong>de</strong> l'efficacité <strong>de</strong> l'élimination <strong>de</strong> la smear layer <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
systèmes <strong>de</strong> préparation canalaire: l'Endo Express et le Protaper<br />
L'action <strong>de</strong> raclage <strong>de</strong> la paroi canalaire par les instruments endodontiques au cours <strong>de</strong> la<br />
préparation endo canalaire aboutit à la formation <strong>de</strong> débris superficiels <strong>de</strong> consistance<br />
poussiéreuse et <strong>de</strong> smear layer composée d'une couche amorphe <strong>de</strong> débris organiques et<br />
inorganiques et <strong>de</strong> microorganismes. Cette couche infectée compactée contre les parois<br />
canalaires s'oppose à une action antimicrobienne efficace <strong>de</strong>s produits d'irrigation et <strong>de</strong>s<br />
médicaments intra canalaires et à l'étanchéité recherchée par une obturation canalaire<br />
tridimensionnelle .<br />
L'élimination <strong>de</strong>s débris et <strong>de</strong> la smear layer du système endodontique est <strong>de</strong>puis longtemps une<br />
priorité en endodontie. Plusieurs travaux ont été réalisés dans le but d'évaluer et d'optimiser<br />
l'efficacité <strong>de</strong>s instruments endodontiques et <strong>de</strong>s produits d'irrigation dans l'élimination <strong>de</strong> la smear<br />
layer<br />
Le but <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> comparer, par l'intermédiaire du microscope électronique à balayage,<br />
l'efficacité d l'élimination <strong>de</strong> débris résiduels et <strong>de</strong> smear layer sur les parois canalaires après<br />
préparation canalaire avec <strong>de</strong>ux systèmes: l'Endo Express et le Protaper.<br />
- 19 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
«Communications orales»<br />
Séminaire Odontologie Conservatrice & Endodontie<br />
Adhésion à l'émail fluorotique: silorane versus résine composite.<br />
C. Belkhir, A. Karmandi, R. Mabrouk, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
La fluorose <strong>de</strong>ntaire est une hypo minéralisation <strong>de</strong> l'émail liée à une incorporation trop importante<br />
<strong>de</strong> fluorures lors <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> la couronne. Elle est essentiellement due à une perturbation <strong>de</strong><br />
la phase tardive <strong>de</strong> la minéralisation <strong>de</strong> l'émail. Sur le plan histologique, l'émail fluorotique est<br />
cassant, poreux et plus dur que l'émail normal. Cette caractéristique micro structurale rend le<br />
collage <strong>de</strong> la résine composite au niveau <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>nts, une étape délicate et particulière.<br />
Dans ce travail nous allons présenter et discuter une étu<strong>de</strong> comparative ; réalisée au stéréo<br />
microscope.<br />
Au niveau <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, nous nous proposons:<br />
• d'évaluer la qualité <strong>de</strong> l'adhésion <strong>de</strong>s siloranes au niveau <strong>de</strong> l'émail modérément fluorotique<br />
après thermocyclage et infiltration au bleu <strong>de</strong> méthylène.<br />
• <strong>de</strong> comparer l'étanchéité <strong>de</strong>s restaurations coronaires au composite micro hybri<strong>de</strong> avec<br />
celles en silorane.<br />
Comment gérer les acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> parcours au cours du traitement endodontique <br />
A. Oueslati, N. Aguir, J. Ben Ammar, MS. Belkhir<br />
L'endodontie en pratique quotidienne est une discipline sujette à <strong>de</strong> nombreuses embûches. L'acte<br />
endodontique n'est jamais simple, le canal droit est chose rare et même si... la difficulté peut<br />
exister; du diagnostic à l'obturation, l'erreur est possible.<br />
Dans notre travail nous nous sommes intéressés aux acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> parcours susceptibles <strong>de</strong><br />
survenir au cours du traitement endodontique (perforation, butée, bouchons <strong>de</strong>ntinaire, fracture<br />
instrumentale…).<br />
Les questions dont nous avons essayé <strong>de</strong> répondre à travers ce travail: quelles sont les causes <strong>de</strong><br />
ces acci<strong>de</strong>nts et ceci pour les éviter, quels sont leurs impacts sur le pronostic du traitement<br />
endodontique comment gérer <strong>de</strong> tels acci<strong>de</strong>nts <br />
Notre travail sera illustré par <strong>de</strong>s cas cliniques variés réalisés au service d'Odontologie<br />
Conservatrice et Endodontie à la Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>.<br />
Les fractures radiculaires: Quel traitement Quel pronostic<br />
I. Kallel, S. Bagga, N. Douki<br />
Les fractures radiculaires représentent entre 0,5 et 7% <strong>de</strong>s traumatismes en <strong>de</strong>nture permanente<br />
et 2 à 4% en <strong>de</strong>nture temporaire On les observe généralement suite à un choc horizontal chez les<br />
sujets entre 11 et 20 ans et <strong>de</strong> façon plus fréquente sur les incisives centrales maxillaires.<br />
Plusieurs étu<strong>de</strong>s ont montré que l'inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s fractures du tiers moyen est le double <strong>de</strong> celles<br />
du tiers apical et que moins <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong> ces fractures siègent au tiers coronaire.<br />
Le traitement relève le plus <strong>de</strong> controverses bibliographiques en rapport avec les décisions <strong>de</strong><br />
réduction et <strong>de</strong> contention, les modalités <strong>de</strong> traitement endodontique, les soins parodontaux et<br />
orthodontiques complémentaires et en rapport avec l'établissement <strong>de</strong> pronostic.<br />
- 20 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
La guérison <strong>de</strong>s fractures radiculaires est complexe, car le traumatisme intéresse le tissu pulpaire<br />
et les tissus environnants (parodonte et os). Elle s'effectue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux façons: par la formation <strong>de</strong><br />
tissu calcifié ou par l'interposition <strong>de</strong> tissu conjonctif. En l'absence <strong>de</strong> guérison, on observe la<br />
formation d'un tissu <strong>de</strong> granulation entre les <strong>de</strong>ux fragments.<br />
Dans ce travail, nous allons essayer <strong>de</strong> présenter quelque cas <strong>de</strong> fractures radiculaires,<br />
d'argumenter notre choix thérapeutique, et d'en tirer une charte <strong>de</strong> prise en charge.<br />
Le traitement endodontique en une seule séance: <strong>de</strong> l'abstrait au concret.<br />
A. Ben Mansour, N. Aguir, A. Nouri, MS. Belkhir<br />
Il persiste dans la littérature une controverse sur la pertinence <strong>de</strong> terminer le traitement dans la<br />
même séance ou <strong>de</strong> différer l'obturation afin <strong>de</strong> compléter la désinfection du système<br />
endodontique en utilisant une médication temporaire.<br />
Si plusieurs étu<strong>de</strong>s ten<strong>de</strong>nt à montrer que la désinfection est effectivement meilleure dans le<br />
traitement en 2 séances, les répercussions cliniques en terme <strong>de</strong> succès thérapeutique à moyen<br />
terme sont loin d'être évi<strong>de</strong>ntes.<br />
Dans cette communication, nous proposons <strong>de</strong> faire le point sur les éléments cliniques,<br />
biologiques et physiologiques à prendre en considération pour définir si un traitement d'une <strong>de</strong>nt<br />
infectée peut ou doit être réalisé en un temps sans influencer le pronostic.<br />
Les évolutions technologiques tant sur les instruments <strong>de</strong> mise en forme que <strong>de</strong>s techniques<br />
d'obturation, ont rendu le traitement en une séance techniquement faisable. L'apparition <strong>de</strong><br />
nouveaux instruments utilisés en réciprocité: WaveOne (Dentsply-Maillefer), Reciproc (Dentsply-<br />
VDW) ou en rotation continue (One Shape (Micro Mega) vont encore faciliter et diminuer<br />
considérablement la durée <strong>de</strong> la phase d'instrumentation. Ces différents instruments seront<br />
présentés ainsi que leur protocoles d'utilisation<br />
Etant donné que l'objectif principal du traitement consiste à désinfecter le canal et l'obturer , et que<br />
les étu<strong>de</strong>s menées au microscope électronique à balayage (MEB) montrent qu'il persiste <strong>de</strong>s<br />
zones non atteintes par ces instruments et que leur efficacité n'est pas totale, l'irrigation doit jouer<br />
un rôle indéniable afin d'optimiser la désinfection .<br />
De nombreux systèmes sont proposés ; la lime SAF la Self Adjusting File® (SAF, ReDent-Nova)<br />
qui se présente sous la forme d'un tube creux animé d'un mouvement <strong>de</strong> vibration longitudinal<br />
d'une amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,4 mm. Utilisée en combinaison avec une solution d'EDTA, elle permet une<br />
bonne élimination <strong>de</strong> la smear layer et <strong>de</strong> débarrasser les parois canalaires <strong>de</strong>s débris et <strong>de</strong>s<br />
bactéries organisées sous forme <strong>de</strong> biofilm optimisant le succès <strong>de</strong> la thérapeutique endodontique.<br />
L'irrigation endodontique: Quelle séquence choisir <br />
A. Kikly, E. Hidoussi, S. Sahtout, S. Belkhir<br />
Introduction:<br />
Lors d'un traitement endodontique, les irrégularités et complexités anatomiques non préparées au<br />
cours <strong>de</strong> la mise en forme canalaire représentent un risque <strong>de</strong> recontamination bactérienne,<br />
source d'infection à l'origine d'échecs thérapeutiques. De nos jours il existe différentes solutions<br />
antibactériennes et chélatantes disponibles, induisant une désinfection bactérienne et l'obtention<br />
d'un canal propre, dépourvu <strong>de</strong> smear layer et <strong>de</strong> débris liés à l'action mécanique permettant ainsi<br />
le succès endodontique.<br />
Objectifs:<br />
1. Présenter les différentes solutions et protocoles d'irrigation disponibles ainsi que les<br />
précautions d'emploi d'un irrigant.<br />
- 21 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
2. Proposer une séquence simplifiée d'irrigation en fonction <strong>de</strong> la situation clinique.<br />
Il est actuellement démontré que l'irrigation doit être décomposée en <strong>de</strong>ux étapes, pendant la mise<br />
en forme, sa principale fonction est d'éliminer par lavage les débris au fur et à mesure qu'ils sont<br />
produits par l'instrumentation, à la fin <strong>de</strong> la mise en forme, une séquence d'irrigation finale est<br />
indispensable afin d'éliminer les débris résiduels, <strong>de</strong> dissoudre l'enduit pariétal <strong>de</strong> boue <strong>de</strong>ntinaire<br />
et enfin <strong>de</strong> pouvoir désinfecter réellement le système canalaire.<br />
À travers cette présentation nous <strong>de</strong>vons mettre l'accent sur les notions suivantes:<br />
• Le nettoyage est indissociable <strong>de</strong> la mise en forme canalaire.<br />
• Effet <strong>de</strong> la conicité canalaire du diamètre apical sur un nettoyage optimal <strong>de</strong>s parois<br />
canalaires à la fin <strong>de</strong> la préparation.<br />
• Le résultat doit être maintenu par une obturation canalaire tridimensionnelle et étanche.<br />
Détermination <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> travail en endodontie<br />
E. Hidoussi, A. Kikly, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
La détermination <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> travail est une étape fondamentale pour la réussite du<br />
traitement endodontique. Différentes techniques sont proposées pour sa mesure.<br />
La technique radiologique n'offre pas toujours une représentation fidèle <strong>de</strong> l'anatomie apicale. La<br />
position <strong>de</strong> la constriction apicale par rapport au foramen apical et à l'apex radiographique varie<br />
considérablement.<br />
La métho<strong>de</strong> électronique consiste à utiliser un localisateur d'apex afin <strong>de</strong> déterminer avec<br />
précision la position du foramen apical.<br />
Les objectifs <strong>de</strong> notre travail sont <strong>de</strong>:<br />
1. Montrer l'intérêt <strong>de</strong> l'utilisation d'un localisateur d'apex <strong>de</strong> <strong>de</strong>rnière génération dans la<br />
détermination <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> travail<br />
2. Présenter à travers <strong>de</strong>s cas cliniques les recommandations à respecter pour déterminer <strong>de</strong><br />
manière fiable la LT au cours <strong>de</strong> la mise en forme canalaire.<br />
La combinaison entre la radiographie et le localisateur d'apex s'avère intéressante d'une part pour<br />
diminuer la radiation et d'autre part pour pallier les défauts <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux dispositifs pour un résultat<br />
final satisfaisant. Le localisateur d'apex est un outil indispensable pour la détermination <strong>de</strong> LT en<br />
endodontie surtout en présence <strong>de</strong> canaux courbes.<br />
Calcium hydroxi<strong>de</strong>: A magic tool if used wisely.<br />
NH. Zorgui, S. Bagga, N. Douki<br />
Background: Calcium hydroxi<strong>de</strong> was originally introduced to the field of endodontics by Herman in<br />
1930 as a pulp-capping agent, but its uses today are wi<strong>de</strong>spread in endodontic therapy. It is the<br />
most commonly used dressing for treatment of the vital pulp. It also plays a major role as an intervisit<br />
dressing in the disinfection of the root canal system. The characteristics of calcium hydroxi<strong>de</strong><br />
come from its ionic dissociation into calcium and hydroxyl ions. However its action can be modified<br />
by the type of vehicle used to carry the compound and the clinical situation.<br />
Aim: make informed judgments about which formulations of calcium hydroxi<strong>de</strong> should be used for<br />
specific endodontic procedures.<br />
Cases presentation: In an interactive way, clinical cases will be presented un<strong>de</strong>r the form of<br />
quizzes to get audience responses than correct clinical attitu<strong>de</strong> will be provi<strong>de</strong>d along with<br />
scientific proof to help audience establish gui<strong>de</strong>lines for each clinical situation. For each clinical<br />
situation a<strong>de</strong>quate vehicle type along with intracanalar dressing period will be discussed.<br />
Conclusion: The site of action of hydroxyl ions of calcium hydroxi<strong>de</strong> inclu<strong>de</strong>s the enzymes in the<br />
- 22 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
cytoplasmic membrane. This medication has a large scope of action, and therefore is effective on a<br />
wi<strong>de</strong> range of micro-organisms; regardless their metabolic capability.This makes it a magic tool but<br />
when used wisely.<br />
Approche thérapeutique <strong>de</strong>s lésions cervicales: enquête auprès <strong>de</strong> 88 mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes<br />
S. Jaâfoura, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
Introduction: Les lésions cervicales sont <strong>de</strong>venues <strong>de</strong> plus en plus courantes vu l'augmentation<br />
<strong>de</strong> l'espérance <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> la conscience <strong>de</strong> la population vis-à-vis <strong>de</strong> l'importance <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts. Leur<br />
siège particulier au niveau du collet <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt ainsi que leur étiologie multifactorielle marquent leur<br />
spécificité. Quel peut être alors leur approche thérapeutique <br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: Il s'agit d'une enquête épidémiologique, <strong>de</strong>scriptive, réalisée auprès <strong>de</strong> 88<br />
praticiens du secteur privé exerçant à <strong>Monastir</strong>, Mahdia et Sousse.<br />
Nous avons utilisé une fiche d'enquête comportant quatre rubriques: les données démographiques<br />
et personnelles caractéristiques <strong>de</strong>s praticiens, le matériau <strong>de</strong> choix pour la restauration <strong>de</strong>s<br />
lésions cervicales, le suivi d'une formation continue en relation avec ce sujet, suivi et nature <strong>de</strong><br />
complications.<br />
Le traitement statistique <strong>de</strong>s données a été effectué sur le logiciel «SPSS 15.0».<br />
Résultats: L'âge moyen <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes est <strong>de</strong> 38,9 ans avec <strong>de</strong>s extrêmes <strong>de</strong> 27 et 64<br />
ans. 32,2% <strong>de</strong> notre échantillon exercent <strong>de</strong>puis moins <strong>de</strong> cinq ans alors que 67,8% exercent<br />
<strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> cinq ans.<br />
60% <strong>de</strong>s praticiens varient le matériau <strong>de</strong> restauration selon que les lésions cervicales soient<br />
d'usure ou d'origine carieuse. 45,6% <strong>de</strong>s praticiens choisissent l'amalgame par défaut <strong>de</strong>s moyens<br />
<strong>de</strong>s patients, 23,3% le font par inertie et 31,1% ne l'utilise pas. 41,1% <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes<br />
utilisent la résine composite micro-hybri<strong>de</strong>, seulement 3,3% utilisent la résine composite flui<strong>de</strong><br />
alors que 54.4% utilisent les <strong>de</strong>ux. Le système adhésif M&R est choisi dans 73.3%, alors que le<br />
système adhésif auto-mordançant est utilisé par 11.1% <strong>de</strong>s praticiens. Ces <strong>de</strong>ux systèmes sont<br />
utilisés par un même mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste dans 14.4%. Uniquement 14,4% <strong>de</strong>s praticiens optent pour<br />
une protection <strong>de</strong> surface. 66,7% n'ont pas participé à un congrès ou un séminaire sur ce sujet.<br />
20% ont participé et ont acquis un plus, alors que 13,3% n'ont pas acquis un plus.<br />
Uniquement 48,9% exigent un suivi <strong>de</strong> tels cas.<br />
Discussion: L'approche thérapeutique <strong>de</strong>s lésions cervicales est méconnue par les mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>ntistes quelque soit l'âge. Même la connaissance <strong>de</strong>s variétés <strong>de</strong> matériaux <strong>de</strong> restauration<br />
aujourd'hui disponibles sur le marché n'est pas évi<strong>de</strong>nte. Il sera souhaitable <strong>de</strong> mieux approfondir<br />
l'enseignement <strong>de</strong> ce thème dans le cursus déjà ; ainsi qu'au niveau <strong>de</strong>s congrès et <strong>de</strong>s<br />
séminaires <strong>de</strong> formation.<br />
Séminaire Prothèse Conjointe<br />
Les prothèse fixées esthétiques: le meilleur choix clinique.<br />
Z. Nouira, I. Gasmi, M. Omezzine, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Notre profession a connu cette <strong>de</strong>rnière décennie <strong>de</strong>s améliorations voire <strong>de</strong>s bouleversements en<br />
matière <strong>de</strong> prothèses esthétiques.<br />
Ces progrès résultent <strong>de</strong> l'amélioration <strong>de</strong>s matériaux mais également du développement d'une<br />
véritable méthodologie d'élaboration du plan <strong>de</strong> traitement souvent interdisciplinaire.<br />
En effet, la réussite d'un traitement esthétique est étroitement liée à la coopération du patient et<br />
doit absolument respecter une certaine chronologie:<br />
• écoute <strong>de</strong>s désirs du patient,<br />
• analyse <strong>de</strong> la situation clinique,<br />
• diagnostic esthétique en collaboration avec le clinicien, le céramiste, le parodontologiste,<br />
l'orthodontiste.<br />
La prise en charge du patient doit donc respecter, les différentes étapes du traitement, afin<br />
d'optimiser les performances <strong>de</strong> ces nouveaux matériaux.<br />
Dans ce contexte, ce travail s'intéressera à la démarche clinique qu'il faut suivre chaque fois qu'on<br />
- 23 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
indique une prothèse esthétique qu'elle soit antérieure ou postérieure, unitaire ou plurale.<br />
La <strong>de</strong>ntisterie numérique en prothèse fixée.<br />
I. Gasmi, Z. Nouira, D. Hadyaoui, M. Omezzine, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
La mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire est entrée dans une ère nouvelle, numérique, où la technologie <strong>de</strong>vient<br />
omniprésente à tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> notre exercice professionnel et tout particulièrement en<br />
prothèse et en implantologie.<br />
La conception et fabrication assistée par ordinateur a élevé le niveau esthétique et biologique <strong>de</strong>s<br />
restaurations prothétiques grâce aux propriétés optiques <strong>de</strong> matériaux utilisés (oxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> Zirconium<br />
et oxy<strong>de</strong> d'Alumine), à leur résistance et aux nombreuses possibilités offertes par les scanners<br />
(mécaniques et optiques) et les logiciels 3D.<br />
La CFAO, CAD-CAM en anglais, constitue une vraie révolution en <strong>de</strong>ntisterie tant dans nos<br />
cabinets que dans les laboratoires <strong>de</strong> prothèse.<br />
Chaque processus aboutit à la création d'un fichier électronique et la possibilité <strong>de</strong> créer<br />
«virtuellement» tout ou partie <strong>de</strong>s prothèses sur l'ordinateur grâce à <strong>de</strong>s logiciels spécifiques.<br />
Comparaison <strong>de</strong>s empreintes globales en prothèse fixée.<br />
M. Omezzine, Z. Nouira, I. Gasmi, M. Barkaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
L'empreinte est le premier maillon <strong>de</strong> la chaîne prothétique. Les empreintes traditionnelles en<br />
prothèse conventionnelle et implanto-portée ont évolué ces <strong>de</strong>rnières années, avec l'apparition<br />
<strong>de</strong>s auto-mélangeurs et nouveaux matériaux. Les empreintes doivent être conduites avec une<br />
extrême rigueur pour minimiser au maximum les sources d'imprécision.<br />
L'empreinte optique connaît aujourd'hui un champ d'application en pleine expansion, initialement<br />
réservée à la prothèse conjointe unitaire, elle est maintenant également utilisée en prothèse<br />
plurale et en prothèse implanto-portée. Les empreintes optiques ont suivi <strong>de</strong>ux voies: l'empreinte<br />
sur modèles (issue <strong>de</strong> l'empreinte classique) à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> scanners <strong>de</strong> laboratoire et l'empreinte<br />
intra-buccale par <strong>de</strong>s caméras dites intra-buccales.<br />
Rationaliser les soins prothétiques fixés en fonction <strong>de</strong>s cas variés:<br />
gage <strong>de</strong> réussite du traitement.<br />
D. Hadyaoui, M. Barkaoui, R. Gazbar, Z. Nouira, I. Gasmi, S. Guizani,<br />
J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
La prise en charge <strong>de</strong>s patients en prothèse fixée nécessite une gran<strong>de</strong> rigueur <strong>de</strong> la part du<br />
praticien ainsi que <strong>de</strong>s connaissances approfondies <strong>de</strong>s propriétés du matériel et matériaux<br />
utilisés tout ceci pour atteindre un objectif unique qui est la longévité da la prothèse fixée.<br />
Pour garantir la réussite du traitement prothétique le praticien doit adopter la bonne démarche en<br />
se basant sur son expérience clinique mais chaque étape n'est pas dépourvue <strong>de</strong> difficultés en<br />
partant <strong>de</strong> l'anesthésie jusqu'à la mise en place définitive <strong>de</strong> la prothèse.<br />
Les variétés <strong>de</strong> situations cliniques impose une gestion immédiate et tardive <strong>de</strong>s facteurs<br />
prothétiques tels que l'intégration esthétique et fonctionnelle <strong>de</strong> la prothèse, ainsi que les facteurs<br />
généraux entrant en rapport avec la réaction physiologique du patient puisque notre métier est<br />
médicalisé…<br />
Choix <strong>de</strong>s restaurations corono-radiculaires en prothèse fixée.<br />
S. Touzi, Z. Nouira, I. Gasmi, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Les restaurations corono-radiculaires en prothèse fixée peuvent être soit <strong>de</strong>s prothèses à double<br />
étage soit <strong>de</strong>s prothèses à un seul étage.<br />
Le choix du type <strong>de</strong> restauration corono-radiculaire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts délabrées est<br />
Porté, tant que le cas clinique le permet, vers les reconstitutions à double étage, mais on ait<br />
parfois amenés à réaliser <strong>de</strong>s couronnes monolithiques.<br />
Nous présentons à travers ce travail différents cas cliniques permettant <strong>de</strong> montrer les critères à<br />
prendre en considération et <strong>de</strong> discuter le choix adéquat pour chaque cas en passant par les<br />
différents types <strong>de</strong> restaurations corono-radiculaires monoblocs et aussi à double étage.<br />
- 24 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Intérêt <strong>de</strong>s wax-up dans le rétablissement <strong>de</strong>s plans d'occlusion en prothèse fixée.<br />
N. Mghirbi, I. Gasmi, S. Hajjaji, Z. Nouira, H. Abdallah, H. Hajjami, A. Boughzala<br />
Pour restaurer une fonction occlusale harmonieuse, le clinicien peut avoir recours séparément,<br />
voire simultanément, aux diverses expressions <strong>de</strong> la prothèse, qu'elle soit fixée conventionnelle,<br />
amovible ou supra-implantaire. Quels que soient les moyens retenus, la démarche analytique d'un<br />
nouveau cas prothétique reste analogue. Elle s'appuie sur la même logique, basée sur l'analyse<br />
rigoureuse et systématique <strong>de</strong>s quatre grands paramètres <strong>de</strong> l'équilibre occlusal: la dimension<br />
verticale, la relation intermaxillaire, le plan d'occlusion et le concept occlusal.<br />
Le succès du traitement avec prothèse fixée dépend du diagnostic et surtout <strong>de</strong> la planification du<br />
traitement par le prosthodontiste en collaboration avec le technicien <strong>de</strong> laboratoire qui va<br />
matérialiser le projet prothétique par <strong>de</strong>s maquettes en cire au niveau du montage d'étu<strong>de</strong>.<br />
La construction <strong>de</strong> ces maquettes, réalisées par la métho<strong>de</strong> du wax-up ou technique <strong>de</strong> la cire<br />
ajoutée, représente une étape fondamentale du plan <strong>de</strong> traitement prothétique. Le wax-up permet<br />
l'étu<strong>de</strong>, un gain en précision et le respect <strong>de</strong>s différents éléments responsables <strong>de</strong> l'harmonie du<br />
système manducateur. Le wax-up trouve aussi son indication dans le traitement implantaire<br />
servant <strong>de</strong> gui<strong>de</strong> radiologique qui sera utilisé comme gui<strong>de</strong> chirurgical.<br />
Notre travail vise à mettre en valeur l'intérêt <strong>de</strong>s maquettes en cire dans le traitement <strong>de</strong>s<br />
perturbations du plan d'occlusion par la prothèse fixée.<br />
Prothèse fixée: vers une thérapeutique non invasive.<br />
S. Hajjaji, Z. Nouira, N. Mghirbi, I. Gasmi, H. Hajjami, A. Boughzala<br />
Dans le cadre d'une reconstruction prothétique <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> étendue, le choix <strong>de</strong> la dimension<br />
verticale d'occlusion (DVO) est souvent évoqué comme la question centrale. De nombreux<br />
arguments sont fréquemment avancés pour justifier <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong> la DVO aussi bien dans<br />
le sens <strong>de</strong> l'augmentation que <strong>de</strong> la diminution: <strong>de</strong>s raisons mécaniques (rétention, espace<br />
prothétique, bras <strong>de</strong> levier corono-radiculaire), esthétiques (profil, ri<strong>de</strong>s), neuromusculaires<br />
(posture <strong>de</strong> repos, puissance musculaire) et même articulaire (décompression).<br />
Dans ces conditions, comment vérifier que la DVO envisagée sera en harmonie avec tous les<br />
déterminants anatomiques, neurophysiologiques Quels sont les critères objectifs qui<br />
permettraient <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r d'augmenter ou <strong>de</strong> diminuer la DVO <br />
Séminaire Orthodontie & Mé<strong>de</strong>cine et Chirurgie Buccales<br />
Le timing <strong>de</strong> la rééducation <strong>de</strong> la déglutition atypique.<br />
A. Zinelabidine, H. Mabrouk, A. Boughzala<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> déglutition présente <strong>de</strong> nos jours un intérêt majeur dans le diagnostic<br />
précoce et étiologique <strong>de</strong>s malocclusions <strong>de</strong>ntaires.<br />
De nouvelles approches thérapeutiques seront abordées qui concernent la fonction <strong>de</strong> déglutition<br />
par rééducation active et passive durant les différentes étapes <strong>de</strong> prise en charge (avant, au cours<br />
et après le traitement orthodontique).<br />
Ces propos seront illustrés par une iconographie <strong>de</strong> cas cliniques.<br />
Les traitements <strong>de</strong>s classe III: <strong>de</strong> l'interception à la chirurgie.<br />
I. Dallel, S. Ben Rejeb, N. Khdher, S. Tobji, A. Ben Amor<br />
Les traitements <strong>de</strong>s classes III peuvent s'étendre <strong>de</strong> la procédure la plus simple: Le traitement<br />
orthopédique par masque <strong>de</strong> Delaire pour <strong>de</strong>s patients en cours <strong>de</strong> croissance ou un traitement<br />
orthodontique avec perte d'ancrage maxillaire volontaire à <strong>de</strong>s procédures chirurgicoorthodontiques<br />
beaucoup plus compliquées. Le diagnostic, le sens clinique du praticien sont<br />
indispensables pour établir le plan <strong>de</strong> traitement adéquat pour chaque cas.<br />
Les extractions sous anticoagulants oraux au cabinet <strong>de</strong>ntaire.<br />
W. Hasni, A. Zaghbani, K. Souid, R. Ayachi, R. Belkacem Chebil, S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
- 25 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Les AVK constituent une médication efficace pour la prévention et le traitement <strong>de</strong>s phénomènes<br />
thromboemboliques. En revanche, ils peuvent engendrer <strong>de</strong>s complications hémorragiques en per<br />
et post opératoire lors <strong>de</strong>s extractions <strong>de</strong>ntaires. L'arrêt <strong>de</strong> la thérapie anticoagulante avant l'acte<br />
<strong>de</strong>ntaire expose le patient à <strong>de</strong> sérieux problèmes vasculaires associés à une morbidité élevée.<br />
Il est maintenant bien clair que <strong>de</strong>s mesures simples, peu coûteuses, permettent d'offrir une prise<br />
en charge efficace comportant encore moins <strong>de</strong> risque que l'arrêt ou la modification du traitement<br />
anticoagulant.<br />
En majorité <strong>de</strong>s cas, le contrôle <strong>de</strong> l'hémostase est assuré en première intention par <strong>de</strong>s<br />
techniques locales avec <strong>de</strong>s moyens physiques, en <strong>de</strong>uxième intention les moyens<br />
pharmacologiques viendront consoli<strong>de</strong>r l'hémostase physique. En cabinet <strong>de</strong>ntaire Il est établi que<br />
le chirurgien <strong>de</strong>ntiste doit tenir compte <strong>de</strong>s recommandations actuelles relatives à ce type <strong>de</strong><br />
patient et maintenir un état d'hypocoagulabilité compatible avec son affection. Le Dentiste en<br />
cabinet, ne doit pas ainsi procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s modifications du traitement AVK avant un acte chirurgical<br />
sans risque hémorragique ou à risque hémorragique modéré, si l'INR est stable et inférieur à 3.<br />
Une coordination complète entre chirurgien <strong>de</strong>ntiste et cardiologue durant toute la durée <strong>de</strong> la<br />
prise en charge du patient, reste nécessaire.<br />
Cas rares <strong>de</strong> kystes multiples <strong>de</strong>s maxillaires.<br />
K. Souid, A. Slama, W. Hasni, R. Belkacem Chebil, A. Zaghbani, S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
Les kystes <strong>de</strong>s maxillaires sont <strong>de</strong>s lésions bénignes qui diffèrent par leurs mécanismes<br />
étiopathogéniques. Leur symptomatologie clinique est assez fruste et leur découverte est souvent<br />
fortuite à l'occasion d'un examen radiologique. Ce <strong>de</strong>rnier permet <strong>de</strong> relever quelques<br />
particularités inhérentes à certaines lésions kystiques mais ne permet en aucun cas <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r le<br />
diagnostic. On est désormais unanimes sur le fait que l'examen anatomopathologique est l'examen<br />
clé pour signer le diagnostic.<br />
Les lésions isolées sont les plus décrites dans la littérature à l'opposé <strong>de</strong>s lésions multiples qui<br />
restent rares. Les kystes multiples sont le plus souvent l'apanage <strong>de</strong>s contextes syndromiques en<br />
l'occurrence le syndrome <strong>de</strong> Gorlin pour les kératokystes odontogéniques, mais <strong>de</strong>s cas non<br />
syndromiques sont possibles.<br />
On rapporte <strong>de</strong>ux cas rares <strong>de</strong> kystes radiculaires multiples non syndromiques ainsi qu'un cas<br />
original <strong>de</strong> syndrome <strong>de</strong> Gorlin familial.<br />
Fistule cutanée d'origine <strong>de</strong>ntaire.<br />
A. Chokri, H. Hentati, M. Bel Haj Hassine, N. Ben Messaoud, S. Sioud, J. Selmi<br />
Les complications infectieuses locales et locorégionales d'origines <strong>de</strong>ntaires sont très fréquentes.<br />
Elles font suite à une mortification pulpaire ou à <strong>de</strong>s infections périodontales.<br />
Défaut <strong>de</strong> traitement, on aboutit assez souvent à <strong>de</strong>s séquelles particulières représentées par <strong>de</strong>s<br />
fistules muqueuses, facilement repérables, ou <strong>de</strong>s fistules cutanées qui posent assez souvent un<br />
problème diagnostic. En effet, la <strong>de</strong>nt causale est habituellement asymptomatique, insistant le<br />
patient à consulter un <strong>de</strong>rmatologue pour résoudre un problème esthétique facial, tout en niant son<br />
problème <strong>de</strong>ntaire, ce qui aboutit à un échec <strong>de</strong> traitement.<br />
Le traitement d'une fistule cutanée d'origine <strong>de</strong>ntaire doit passer obligatoirement par une étape <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong> sa porte d'entrée. Une prise en charge adaptée à la cause permet <strong>de</strong> réduire les<br />
désagréments esthétiques et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>structions tissulaires inefficaces et irréversibles.<br />
Effet <strong>de</strong>s faibles doses <strong>de</strong> rayons X: Etu<strong>de</strong> expérimentales sur la souris en gestation.<br />
I. Chaâbani, F. Khemiss, B. Sriha, T. Ben Alaya<br />
Intérêt: Etudier l'effet <strong>de</strong> faibles doses <strong>de</strong> rayons x sur le fœtus <strong>de</strong> la souris gestante<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>: Deux groupes <strong>de</strong> souris gestantes (n8) ont été exposés aux rayons x à<br />
partir d'un appareil <strong>de</strong> radiologie <strong>de</strong>ntaire. Le premier groupe a été irradié le 11 ème jour <strong>de</strong> la<br />
gestation avec les doses <strong>de</strong> 0,2 mGy et 0,3 mGy, alors que le second groupe a été irradié le 18<br />
ème jour <strong>de</strong> la gestation avec les mêmes doses. Quatre souris gestantes n'ayant reçues aucune<br />
irradiation ont été utilisées comme groupe témoin.<br />
Les colonnes vertébrales et les maxillaires <strong>de</strong>s souriceaux obtenus après mise bas ont étés<br />
- 26 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
prélevés, fixés et colorés pour l'étu<strong>de</strong> histologique <strong>de</strong> la moelle osseuse en ayant recours à la<br />
microscopie optique<br />
Résultats: L'analyse histologique <strong>de</strong>s différentes coupes aussi bien chez les groupes témoins que<br />
chez les groupes traités ne révèle aucune anomalie structurale. Cependant <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> la<br />
richesse médullaire sont détectées au niveau <strong>de</strong>s différentes coupes <strong>de</strong>s colonnes vertébrales et<br />
<strong>de</strong>s maxillaires <strong>de</strong>s souriceaux exposés aux rayons x.<br />
Analyse et discussion: Les résultats enregistrés sont en accord avec la littérature et affirment<br />
que les fœtus <strong>de</strong>s mammifères sont très sensibles surtout aux fortes doses <strong>de</strong> rayons x et que la<br />
nature et la sensibilité <strong>de</strong>s effets induits dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la dose <strong>de</strong> rayon x et du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
développement lors <strong>de</strong> l'irradiation.<br />
Dans notre étu<strong>de</strong>, les doses utilisées (0,2 mGy et 0,3 mGy) sont l'équivalent <strong>de</strong> 20 clichés rétroalvéolaires<br />
pour 0,2mGy et 30 clichés pour 0,3 mGy, avec <strong>de</strong>s constantes radiologiques<br />
maximales, ces doses pratiquement impossibles à atteindre lors d'un examen radiologique <strong>de</strong><br />
routine n'ont abouti qu'à <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> la richesse médullaire sans aucune modification<br />
structurale.<br />
Ainsi et en cas <strong>de</strong> besoin, le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste doit savoir rassurer la femme enceinte et la<br />
convaincre <strong>de</strong> l'innocuité <strong>de</strong> cet examen pour éviter stress et anxiété tout au long <strong>de</strong> la grossesse,<br />
l'usage du tablier <strong>de</strong> plomb n'a vraiment d'effet que <strong>de</strong> réconforter davantage la patiente.<br />
Quelle relation existe-t-il entre l'asthme et les lésions bucco-<strong>de</strong>ntaires <br />
M. Denguezli, M. Khemiss, F. Khemiss, M. Dhidah<br />
L'asthme, maladie inflammatoire chronique <strong>de</strong>s voies respiratoires, est défini par une gêne<br />
bronchique à l'expiration. De par sa prévalence, cette maladie constitue désormais un problème <strong>de</strong><br />
santé publique. Ses symptômes - dyspnée, oppression thoracique, sibilants mais aussi toux -<br />
volontiers nocturnes, cè<strong>de</strong>nt spontanément ou sous l'effet du traitement. La crise d'asthme est<br />
définie par un accès paroxystique <strong>de</strong> durée brève. La prise en charge <strong>de</strong> ce trouble repose sur<br />
l'association efficace entre <strong>de</strong>s bêta2-mimétiques et une corticothérapie systémique. Ces<br />
traitements sont administrés sous forme <strong>de</strong> particules inhalées en utilisant différentes formes<br />
d'inhalateurs et <strong>de</strong> nébuliseurs. Les effets <strong>de</strong> ces médicaments sur la santé bucco-<strong>de</strong>ntaire ont<br />
récemment fait l'objet <strong>de</strong> vifs débats entre les odontologistes. En effet, <strong>de</strong> nombreux auteurs ont<br />
montré que les asthmatiques sous traitement sont prédisposés à différentes pathologies bucco<strong>de</strong>ntaires<br />
comme les lésions <strong>de</strong>ntaires, les maladies parodontales, les malocclusions, les<br />
candidoses et les halitoses. Il est, par conséquent, nécessaire <strong>de</strong> définir et <strong>de</strong> cerner les<br />
conséquences bucco-<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> cette maladie et <strong>de</strong> son traitement, afin <strong>de</strong> déterminer, le plus<br />
précocement possible, les groupes à risque et d'établir les mesures <strong>de</strong> prévention adéquates.<br />
Ce travail <strong>de</strong> recherche a permis, grâce à une revue approfondie <strong>de</strong> la littérature, <strong>de</strong> mettre en<br />
évi<strong>de</strong>nce la corrélation entre asthme et santé bucco-<strong>de</strong>ntaire et d'estimer la prévalence <strong>de</strong><br />
l'atteinte bucco-<strong>de</strong>ntaire chez le patient asthmatique. La présente étu<strong>de</strong> propose également<br />
diverses mesures pour contrer ces problèmes <strong>de</strong> santé bucco-<strong>de</strong>ntaire liés à l'asthme.<br />
Séminaire Prothèse Amovible<br />
Perturbation <strong>de</strong> la DVO: Etiologie et moyens <strong>de</strong> diagnostic.<br />
H. Triki, N. Taktak, N. Hassen, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Les origines <strong>de</strong> la perturbation <strong>de</strong> la DVO sont multiples pouvant être dues à une restauration<br />
inadéquate ou, souvent, à une conjonction <strong>de</strong> phénomènes liés au vieillissement <strong>de</strong>s structures<br />
<strong>de</strong>ntaires naturelles et <strong>de</strong>s structures prothétiques artificielles.<br />
Les répercussions <strong>de</strong> cette perturbation sont d'ordre esthétique, fonctionnel, voire même<br />
pathologique. L'installation <strong>de</strong> ce phénomène étant lente et progressive, parfois sans que le patient<br />
n'en ressente les signes précurseurs. C'est pourquoi, il est <strong>de</strong> notre <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> savoir détecter ses<br />
signes précurseurs pour mieux intervenir.<br />
Peut-on varier la DVO Critères <strong>de</strong> décision.<br />
S. Ammar, I. Farhat, B. Mogaâdi, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
- 27 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Dans le cadre d'une reconstruction prothétique <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> étendue, le choix <strong>de</strong> la dimension<br />
verticale d'occlusion (DVO) est souvent évoqué comme la question centrale. De nombreux<br />
arguments sont fréquemment avancés pour justifier <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong> la DVO aussi bien dans<br />
le sens <strong>de</strong> l'augmentation que <strong>de</strong> la diminution: <strong>de</strong>s raisons mécaniques (rétention, espace<br />
prothétique, bras <strong>de</strong> levier corono-radiculaire), esthétiques (profil, ri<strong>de</strong>s), neuromusculaires<br />
(posture <strong>de</strong> repos, puissance musculaire) et même articulaire (décompression).<br />
Dans ces conditions, comment vérifier que la DVO envisagée sera en harmonie avec tous les<br />
déterminants anatomiques, neurophysiologiques Quels sont les critères objectifs qui<br />
permettraient <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r d'augmenter ou <strong>de</strong> diminuer la DVO <br />
Les moyens <strong>de</strong> rétabmissement <strong>de</strong> la DVO.<br />
B. Mogaâdi, I. Ouni, S. Bouraoui, S. Bekri, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Une perte importante <strong>de</strong> dimension verticale d'occlusion en raison d'influences mécaniques,<br />
chimiques ou traumatiques, voire par une combinaison <strong>de</strong> ces facteurs, représente toujours une<br />
situation difficile à gérer .<br />
Cette diminution <strong>de</strong> la DVO contribue fréquemment à <strong>de</strong>s troubles fonctionnels mais surtout<br />
esthétiques imposant le rétablissement immédiat<br />
La détermination d'une dimension verticale d'occlusion (DVO) correcte constitue une étape<br />
importante mais difficile du traitement prothétique. Le rétablissement d'une DVO fonctionnelle et<br />
esthétique peut être garanti par différents moyens thérapeutiques.<br />
La supraclusie chez l'é<strong>de</strong>nté partiel: spécificités et modalités thérapeutiques.<br />
I. Farhat, B. Mogaâdi, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Les modalités <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> la supraclusie prennent en considération la croissance facial, l'âge<br />
du patient, la sévérité <strong>de</strong> la malocclusion et la compensation <strong>de</strong>ntaire qui s'en suit. Généralement<br />
la prise en charge <strong>de</strong> ces patients est orthodontique.<br />
Ce traitement <strong>de</strong>vient d'autant plus complexe quand il s'agit d' un é<strong>de</strong>nté partiel, souvent âgé, dont<br />
le traitement orthodontique sera épargné suite à la perte <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts.<br />
Un abord prothétique peut être envisagé pour ces patients é<strong>de</strong>ntés partiaux. En effet, le choix <strong>de</strong>s<br />
références occlusales dans le sens sagittal et vertical sera orienté vers ce qu'on appelle une<br />
occlusion thérapeutique définie au préalable lors <strong>de</strong> la phase d'étu<strong>de</strong> du cas.<br />
A travers une illustration clinique, nous allons exposer l'aspect anatomo-physiologique et<br />
thérapeutique <strong>de</strong> la supraclusion chez les é<strong>de</strong>ntés partiaux.<br />
Gestion <strong>de</strong> la dualité tissulaire <strong>de</strong>s é<strong>de</strong>ntements terminaux en PPA.<br />
N. Hassen, H. Triki, L. Mansour, N. Douki<br />
Les objectifs thérapeutiques <strong>de</strong> la prothèse partielle amovible sont immuables: le rétablissement<br />
<strong>de</strong>s fonctions altérées par la perte <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts et la préservation <strong>de</strong>s structures anatomiques<br />
résiduelles accueillant l'appareillage artificiel.<br />
Le caractère amovible <strong>de</strong> la PPA et la dualité <strong>de</strong> comportement biomécanique du support<br />
prothétique sont autant <strong>de</strong> paramètres qui peuvent compromettre les résultats.<br />
La gestion <strong>de</strong> cette particularité est primordiale dans le traitement <strong>de</strong>s é<strong>de</strong>ntements terminaux afin<br />
d'optimiser l'intégration <strong>de</strong> la restauration.<br />
Vu l'impossibilité <strong>de</strong> suppression du caractère dual du lit prothétique, le respect <strong>de</strong>s grands<br />
principes régissant la conception et la réalisation prothétique doit particulièrement tenir compte <strong>de</strong>s<br />
problèmes générés par la différence <strong>de</strong> dépressibilité afin d'optimiser l'intégration <strong>de</strong> la prothèse.<br />
Dans ce travail nous exposerons les moyens prothétiques conventionnels <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la dualité<br />
tissulaire et on va mettre en lumière l'intérêt <strong>de</strong> port <strong>de</strong> la prothèse provisoire <strong>de</strong> mise en condition<br />
tissulaire à travers une étu<strong>de</strong> expérimentale réalisée sur <strong>de</strong>s patients pris en charge au service <strong>de</strong><br />
prothèse partielle amovible.<br />
Divisions vélopalatines non opérées ou séquellaires chez l'adulte:approche<br />
fondamentale et thérapeutique en prothèse maxillo-faciale.<br />
K. Chebbi, K. Masmoudi, A. Ben Abdallah, J. Jaouadi, H. Chraief, MA. Bouzidi,<br />
- 28 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
A. Ben Rahma, M. Majdoub<br />
La pise en charge <strong>de</strong>s divisions vélopalatines s'effectue actuellement dés la naissance et se base<br />
sur un protocole thérapeutique multidisciplinaire. Le traitement prothétique chez l'adulte présente<br />
une activité qui tend à diminuer grâce aux progrès <strong>de</strong>s techniques chirurgicales. La prothèse<br />
vélopalatine conserve cependant <strong>de</strong>s indications chez les patients porteurs <strong>de</strong> fentes n'ayant<br />
jamais été opérées ou encore en cas d'insuffisances ou échecs chirurgicaux. Les prothèses<br />
vélopalatines sont constituées <strong>de</strong> dispositifs obturateurs placés et maintenus en bonne position<br />
entre le cavum et l'orophraynx ,reliés à une plaque palatine.<br />
Essayage et remontage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts en prothèse complète.<br />
J. Jaouadi, A. Ben Abdallah, K. Chebbi, H. Chraïef, A. Ben Rahma, M. Majdoub<br />
Au cours <strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> l'essayage du montage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts artificielles, on peut trouver différentes<br />
erreurs nous amenant au remontage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts.<br />
Cela peut être dû à une erreur d'occlusion dans le sens vertical ou horizontal, ou une erreur<br />
d'orientation du plan d'occlusion.<br />
Dans tous les cas, on procè<strong>de</strong> à un réenregistrement <strong>de</strong> l'occlusion après dépose <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts<br />
montées sur cire qui sera suivi d'un remontage.<br />
Des fois le remontage intervient après polymérisation <strong>de</strong> la prothèse, dans ce cas il faut déposer<br />
les <strong>de</strong>nts avec soins pour ne pas perforer la base prothétique sinon on sera amené à réaliser une<br />
empreinte sous pression occlusale après remontage sur cire pour pouvoir reprendre la base<br />
perforée.<br />
Attachement axial, barre d'ancrage: Quand et comment <br />
R. Bibi, S. Bekri, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
L'idée <strong>de</strong> conserver les racines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières <strong>de</strong>nts sur l'arca<strong>de</strong> est intéressante à plus d'un titre.<br />
En effet, utilisées sans attachement, les racines préviennent la résorption osseuse, si on les utilise<br />
avec <strong>de</strong>s attachements, les racines procurent une rétention efficace et améliorent également<br />
l'esthétique.<br />
Dans ce travail, nous nous proposons <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>ux types d'attachements, à savoir<br />
l'attachement axial et la barre d'ancrage, et <strong>de</strong> discuter les critères qui nous gui<strong>de</strong>nt vers<br />
l'utilisation <strong>de</strong> l'un ou l'autre en fonction <strong>de</strong> la situation clinique.<br />
Séminaire Odontologie Pédiatrique<br />
Maladie cœliaque et manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires.<br />
I. Gharbi, L. Laâdhar, K. Tlili, N. Gharbi, M. Dami, J. Zaroui, I. Jamazi,<br />
MA. Chemli, S. Khouja, B. Jemmali<br />
La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune induite par un antigène alimentaire, la<br />
gliadine. Le diagnostic et le traitement précoce <strong>de</strong> cette maladie est important pour prévenir<br />
d'éventuelles évolutions néoplasiques et complications <strong>de</strong> la maladie. Dans un Souci <strong>de</strong> dépistage<br />
précoce nous nous sommes intéressées au rôle que peut avoir la mé<strong>de</strong>cin Dentiste.<br />
Nous avons réalisé une enquête épidémiologique à l'Hôpital La Rabta dans le service<br />
d'odontologie pédiatrique et le service d'immunologie:<br />
Objectifs: étudier la corrélation entre la maladie cœliaque et les manifestations bucco<strong>de</strong>ntaires et<br />
évaluer ces <strong>de</strong>rniers comme moyen <strong>de</strong> diagnostic précoce <strong>de</strong> la maladie.<br />
Matériels et métho<strong>de</strong>s: notre étu<strong>de</strong> a intéressé 2 échantillons. Le premier a compté les enfants<br />
cœliaques auxquels nous avons effectué un examen bucco-<strong>de</strong>ntaire. Le <strong>de</strong>uxième échantillon a<br />
intéressé les patients ayant <strong>de</strong>s manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires cités dans la littérature comme<br />
ayant un rapport avec la maladie cœliaque (hypoplasie, opacité….)<br />
Résultats et conclusion: les résultats <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> ont confirmé qu'il existe une corrélation<br />
entre la maladie cœliaque et les anomalies <strong>de</strong> l'email mais nous ne pouvons affirmer que les<br />
manifestations bucco<strong>de</strong>ntaires soient un moyen <strong>de</strong> diagnostic précoce.<br />
- 29 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Bruxisme et troubles respiratoires chroniques chez l'enfant:<br />
à propos d'une enquête épidémiologique.<br />
R. Chebbi, M. Khemiss, I. Chafaï, M. Dhidah<br />
Introduction: L'inci<strong>de</strong>nce du bruxisme chez l'enfant varie <strong>de</strong> 5 à 81% selon les auteurs. Dans la<br />
littérature, <strong>de</strong> nombreuses théories ont été avancées pour expliquer l'apparition <strong>de</strong> cette<br />
parafonction chez l'enfant et les recherches actuelles s'orientent vers une étiologie en rapport avec<br />
<strong>de</strong>s troubles respiratoires chroniques. Notre travail cherche, à travers une étu<strong>de</strong> épidémiologique<br />
menée auprès <strong>de</strong> 260 enfants, à déterminer la prévalence et les caractéristiques du bruxisme chez<br />
<strong>de</strong>s enfants atteints <strong>de</strong> troubles respiratoires comparativement à un groupe témoin.<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: Une enquête prospective est menée auprès d'une population <strong>de</strong> 260<br />
enfants consultant au service <strong>de</strong> pédiatrie <strong>de</strong> l'hôpital Hédi Chaker <strong>de</strong> Sfax pour <strong>de</strong>s troubles<br />
respiratoires et au service <strong>de</strong> stomatologie du centre <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> santé <strong>de</strong> base <strong>de</strong> Sfax.<br />
Résultats: Le bruxisme concerne 28,1% <strong>de</strong> la population étudiée avec une inci<strong>de</strong>nce 1,5 fois plus<br />
chez l'échantillon d'enfants ayant <strong>de</strong>s troubles respiratoires chroniques par rapport à celui témoin.<br />
Le bruxisme du sommeil est plus fréquent que celui d'éveil.<br />
Conclusion: Le bruxisme chez l'enfant est le plus souvent lié à <strong>de</strong>s troubles respiratoires à un<br />
sta<strong>de</strong> sévère, d'où l'intérêt <strong>de</strong> dépister à temps ces troubles favorisant le bruxisme, d'autant plus<br />
que cette parafonction, une fois installée est difficile à contrer, même quand l'étiologie respiratoire<br />
est traitée.<br />
Allaitement et santé bucco-<strong>de</strong>ntaire.<br />
MA. Chemli, I. Jamazi, M. Dami, I. Gharbi, S. Khouja, N. Gharbi, B. Jemmali<br />
L'alimentation <strong>de</strong>s nouveau-nés passe essentiellement par l'allaitement qui intervient à un moment<br />
<strong>de</strong> très forte croissance. De nos jours, la plupart <strong>de</strong>s nourrissons sont plus longtemps allaités au<br />
biberon qu'au sein.<br />
Quelles sont les différances entre ces <strong>de</strong>ux types d'allaitement Quel est l'impact <strong>de</strong> l'utilisation du<br />
biberon sur la croissance et la santé bucco-<strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong>s enfants<br />
Les auteurs se proposent <strong>de</strong> répondre dans cette communication à ces questions, et <strong>de</strong> parler du<br />
rôle du mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste, qui doit être le promoteur <strong>de</strong> l'allaitement maternel et <strong>de</strong> ses bénéfices,<br />
en passant un message si simple et si important «favoriser l'allaitement maternel pour une meilleur<br />
santé bucco-<strong>de</strong>ntaire et générale»<br />
Anémie <strong>de</strong> Fanconi, maladie: à propos d'un cas clinique.<br />
I. Jazi, D. Jarrar, F. Chouchène, M. Zouari, Y. Elelmi, A. Baâziz, F. Masmoudi,<br />
F. Maâtouk, H. Ghédira, A. Abid<br />
L'anémie <strong>de</strong> Fanconi est due à un trouble génétique rare (1/350 000 naissances). Elle fait partie d'un tableau<br />
pancytopénique:diminution <strong>de</strong>s trois lignées sanguines.<br />
Cette maladie comporte <strong>de</strong>s anomalies osseuses, rénales ,cardiaques, cutanée, un retard staturo_pondéral<br />
et une dysmorphie faciale<br />
Sur le plan buccal, on peut noter <strong>de</strong>s dyschromies <strong>de</strong>ntaires et une alvéolyse diffuse.<br />
Dans ce travail nous présenterons le cas d'un patient âgé <strong>de</strong> 11 ans atteint <strong>de</strong> l'anémie <strong>de</strong> Fanconi qui nous<br />
a consulté au service d'odontologie pédiatrique à la clinique <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong> pour <strong>de</strong>s<br />
soins <strong>de</strong>ntaires.<br />
L'examen endobuccal montre une inflammation gingivale généralisée et <strong>de</strong>s caries multiples.<br />
Une collaboration étroite avec le pédiatre était nécessaire avant tout traitement vu les risques infectieux et<br />
hémorragique que présente le patient.<br />
La dysplasie anhidrotique ecto<strong>de</strong>rmique chez l'enfant.<br />
Y. Elelmi, H. Triki, I. Mahmoudi, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz,<br />
F. Maâtouk, H. Ghédira, A. Abid<br />
La dysplasie ecto<strong>de</strong>rmique anhidrotique est une maladie génétique rare liée au chromosome X qui<br />
s'exprime selon une tria<strong>de</strong> <strong>de</strong> symptômes, hypotrichose, hypohidrose et hypodontie. L'hypodontie<br />
pose <strong>de</strong> nombreux problèmes <strong>de</strong> croissance, d'alimentation, <strong>de</strong> communication aux enfants<br />
- 30 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
atteints. Elle pose aussi <strong>de</strong>s problèmes majeurs d'adaptabilité <strong>de</strong>s prothèses <strong>de</strong>ntaires conventionnelles.<br />
Dans ce travail nous allons présenter un cas clinique et l'attitu<strong>de</strong> thérapeutique approprié à ce cas.<br />
Epulis à cellules géantes chez l'enfant: à propos d'un cas.<br />
I. Mahmoudi, H. Hamdi, Y. Elelmi, F. Chouchène, F. Masmoudi,<br />
A. Baâziz, H. Ghédira, F. Maâtouk, A. Abid<br />
L'épulis est une lésion pseudo-tumorale hyperplasique circonscrite <strong>de</strong> la gencive, c'est la tumeur la<br />
plus répandue parmi les tumeurs bénignes <strong>de</strong> la muqueuse buccale <strong>de</strong> l'enfant, ses étiologies sont<br />
très diverses et souvent intriquées avec un processus inflammatoire.<br />
Cette lésion peut apparaître en n'importe quel point <strong>de</strong> l'arca<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntaire mais on l'observe<br />
beaucoup plus couramment à la partie antérieure, elle se présente sous différentes formes<br />
histologiques: épulis inflammatoire, épulis fibreux, épulis vasculaire et épulis à cellules géantes.<br />
Le traitement <strong>de</strong> l'épulis consiste en une excision chirurgicale <strong>de</strong> la lésion, et un suivi régulier du<br />
patient dans le but <strong>de</strong> prévenir tout risque <strong>de</strong> récidive.<br />
Nous montrons à travers un cas d'épulis à cellules géantes chez une fille <strong>de</strong> 6 ans, suivi dans le<br />
service d'Odontologie Pédiatrique <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, les démarches diagnostiques et thérapeutiques<br />
établies après un examen clinique, radiologique et histologique.<br />
Assessment of oral health knowledge in children with type 1 diabetes mellitus.<br />
A. Abulwefa, Al Hafian, A. Sabkha<br />
The aim of this study was to obtain information about oral health knowledge in children with Type 1<br />
Diabetes Mellitus (T1DM).<br />
A <strong>de</strong>scriptive cross-sectional study was conducted between Mars 2010 and December 2010 at the<br />
Combined Dental Clinic, Service of Faculty of Dental Medicine and Oral Surgery, Tripoli University-<br />
Libya. The study sample consisted of 30 T1DM children and 60 age-matched non-diabetics<br />
recruited during routine outpatient treatment. As much as 54% of the diabetic children and 37% of<br />
the non-diabetic children were males with mean age of 11.7 years, respectively. The mean<br />
duration of the T1DM was of 4.5 ± 0.8 years. Using a semi-structured questionnaire with multiplechoice<br />
closed questions. The collected data were about the reason for the last visit to the <strong>de</strong>ntist,<br />
reason for not visiting the <strong>de</strong>ntist, oral hygiene habits, gingival bleeding, rating of oral health and if<br />
the child was enrolled in any of an oral health educational program. The questions were answered<br />
by the children un<strong>de</strong>r parental supervision.<br />
As much as 60% of the diabetics vs. 51% subjects had visited the <strong>de</strong>ntist within the previous 12<br />
months. Almost half of the diabetic and non-diabetic children brushed their teeth three times a day.<br />
Toothpaste was used by 97% of the diabetics and 94% of non-diabetics. Tooth brushing was<br />
consistently less frequent among boys than among girls. Use of <strong>de</strong>ntal floss and mouth washing is<br />
still very rare. A total of 30% of the diabetics vs. 41% of non-diabetics had gingival bleeding. Girls<br />
ten<strong>de</strong>d to have gingival bleeding. Dental treatment was almost always provi<strong>de</strong>d at a public health<br />
service facility (59% of diabetics and 85% of non-diabetics). The <strong>de</strong>ntist was aware of the T1DM in<br />
74% of the cases. None of subjects had ever been enrolled in an oral health educational program.<br />
Conclusion: although the diabetic children seemed to have better information regarding oral<br />
hygiene than the control children, efforts must be continued to improve the ability of the health care<br />
staff to achieve excellent oral health education programs.<br />
Séminaire Parodontologie & Implantologie<br />
La greffe <strong>de</strong> conjonctif enfoui autour <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts et <strong>de</strong>s implants.<br />
S. Ben Abdallah, H. Amouri, R. Masmoudi, R. M'barek<br />
Par définition, la dénomination «greffe <strong>de</strong> conjonctif enfouie» comprend l'ensemble <strong>de</strong>s techniques<br />
<strong>de</strong> chirurgie muco-gingivales faisant intervenir un greffon <strong>de</strong> tissu conjonctif placé entre la<br />
muqueuse et le périoste ou entre le périoste et l'os. De nos jours, la greffe conjonctive enfouie<br />
- 31 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
semble être la technique <strong>de</strong> référence pour le traitement <strong>de</strong>s récessions parodontales. Elle<br />
possè<strong>de</strong> le meilleur potentiel <strong>de</strong> recouvrement avec <strong>de</strong>s résultats stables dans le temps. En<br />
implantologie, la satisfaction esthétique globale est fortement dépendante <strong>de</strong> l'aspect <strong>de</strong>s tissus<br />
mous environnants. L'aménagement <strong>de</strong>s tissus mous est une étape essentielle dans la recherche<br />
<strong>de</strong> l'esthétique. Le greffon conjonctif, inspiré <strong>de</strong> la chirurgie parodontale, a été aussi décrit en<br />
implantologie afin d'optimiser la qualité et le volume <strong>de</strong>s tissus péri-implantaires.<br />
Le but <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> faire le point sur toutes les applications <strong>de</strong> la greffe conjonctive enfouie<br />
à travers <strong>de</strong>s cas cliniques traités au sein <strong>de</strong> notre service.<br />
Remplacement <strong>de</strong> l'incisive centrale maxillaire par <strong>de</strong> la prothèse implanto-portée.<br />
W. Nasri, S. Ben Abdallah, H. Ben Amara, R. M'barek<br />
L'incisive centrale, au cœur du sourire, joue un rôle majeur dans la composition <strong>de</strong>ntaire.<br />
Pour pouvoir être considérées comme une véritable alternative, les prothèses implanto-portées<br />
doivent être au moins comparables en termes <strong>de</strong> résultat esthétique aux couronnes et bridges<br />
conventionnels. L'intégration prothétique d'une incisive centrale maxillaire est toujours un défi pour<br />
le praticien car elle est tributaire du positionnement tridimensionnel <strong>de</strong> l'implant en positions<br />
optimales fonctionnelle et esthétique, procédure difficile à exécuter vue la complexité<br />
l'environnement anatomique <strong>de</strong> l'incisive centrale (proximité et dimension du canal naso-palatin, la<br />
finesse ou l'absence <strong>de</strong> la corticale externe ainsi que la perte osseuse horizontale et verticale…).<br />
Le succès esthétique <strong>de</strong>s implants <strong>de</strong>ntaires dans la zone incisive maxillaire nécessite une<br />
connaissance <strong>de</strong>s différents concepts et techniques. En fonction <strong>de</strong> la situation clinique, le moment<br />
et les techniques d'implantation, d'augmentation diffèrent. Dans ce contexte, le résultat esthétique<br />
ne peut être obtenu par hasard, une planification préopératoire minutieuse, l'augmentation <strong>de</strong>s<br />
tissus durs et mous péri-implantaires, et l'attention aux détails <strong>de</strong>s techniques chirurgicales et<br />
prothétiques sont <strong>de</strong>s domaines qui doivent être abordés lors du traitement <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong>s incisives<br />
centrales maxillaires.<br />
Gestion préopératoire <strong>de</strong>s lésions osseuses péri-implantaires.<br />
H. Amouri, O. Ouelhazi, N. Khouildi, R. M'barek<br />
La mise en place <strong>de</strong>s implants est possible en présence d'une hauteur et d'une largeur osseuse<br />
suffisante, mais la présence <strong>de</strong> résorption osseuse combinée aux exigences fonctionnelles et<br />
esthétiques peut parfois aboutir à une déhiscence, une fenestration ou d'autres défauts osseux<br />
péri-implantaire qui répon<strong>de</strong>nt à plusieurs classifications et qui nécessitent le recours à <strong>de</strong>s<br />
techniques <strong>de</strong> reconstructions osseuses diverses.<br />
Depuis la mise au point <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> régénération tissulaire et osseuse guidée, la gestion<br />
<strong>de</strong>s défauts osseux simultanément à l'implantation est <strong>de</strong>venue possible et couramment<br />
envisageable. Le principe <strong>de</strong> la régénération osseuse est fondé sur l'utilisation <strong>de</strong> membranes<br />
formant une barrière évitant la compétition avec d'autres tissus durant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> remo<strong>de</strong>lage<br />
tissulaire.<br />
Deux exemples <strong>de</strong> cas sont présentés à titre d'illustration <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> défaut osseux périimplantaire<br />
le plus fréquemment rencontrées ainsi que <strong>de</strong> leur traitement.<br />
Comparaison du résultat esthétique: implant immédiat vs implant différé.<br />
H. Ben Amara, W. Nasri, S. Ben Tanfous, R. M'barek<br />
Les performances du traitement implantaire ont été évaluées en termes d'ostéointégration, <strong>de</strong>puis<br />
qu'Alberktsson et Zarb ont postulé les critères <strong>de</strong> succès en 1986. L'ostéointégration, toutefois, ne<br />
soulève aujourd'hui plus <strong>de</strong> débat tant celle-ci est prévisible.<br />
Face à l'intérêt grandissant que génère l'esthétique lorsqu'il est question <strong>de</strong> réhabiliter le secteur<br />
antérieur en particulier au maxillaire, le mimétisme <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts adjacentes est <strong>de</strong>venu une règle à<br />
laquelle la prothèse implanto-portée doit répondre.<br />
Aujourd'hui l'esthétique fait partie intégrante <strong>de</strong>s standards d'évaluation qu'offre une restauration<br />
implantaire. Longtemps considérée comme subjective, les efforts consentis envers un jugement<br />
scientifique <strong>de</strong> l'esthétique <strong>de</strong>s restaurations implanto-portées ont induit l'éclosion <strong>de</strong> plusieurs<br />
in<strong>de</strong>x d'évaluation plus ou moins objectifs.<br />
Le choix entre les diverses protocoles qui s'offrent au clinicien est inéluctablement déterminé,<br />
- 32 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
entre autres, par le résultat esthétique lorsqu'une restauration par la prothèse implanto-portée est<br />
envisagée.<br />
Nous essayerons d'exposer, dans ce travail, les outils à la disposition du clinicien pour un<br />
jugement esthétique objectif. Puis nous comparerons esthétiquement le résultat qu'offrent l'implant<br />
immédiat et l'implant différé.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'association <strong>de</strong>s parodontites au psoriasis et ses complications.<br />
O. Zouiten, Ph. Doucet, M. Gosset<br />
Introduction: Le psoriasis est une <strong>de</strong>rmatose érythémato-squameuse chronique fréquente <strong>de</strong><br />
cause inconnue. Cette maladie inflammatoire se caractérise par <strong>de</strong>s plaques rouges cutanées et la<br />
formation <strong>de</strong> squasmes. Le psoriasis peut se compliquer par l'évolution en forme purulente ou le<br />
développement d'un rhumatisme. Il est associé à <strong>de</strong>s comorbidités, ce qui peut être lié à un terrain<br />
inflammatoire particulier <strong>de</strong>s patients. De plus, <strong>de</strong>s pathologies inflammatoires telles que la<br />
parodontite, pourraient favoriser l'initiation et l'évolution du psoriasis.<br />
Objectif: L'objectif <strong>de</strong> notre travail est, par une analyse bibliographique réalisée sur Pubmed,<br />
d'étudier l'existence d'une association entre la parodontite et le psoriasis et ses complications.<br />
Nous avons i<strong>de</strong>ntifié 6 étu<strong>de</strong>s cliniques portant sur le lien entre psorisasis et la parodontite.<br />
Résultats: Les résultats <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s sont contradictoires. Une étu<strong>de</strong> cas-témoins sur les 6<br />
sélectionnées au total ne trouve pas d'association entre psoriasis et parodontite. Cependant, les<br />
autres étu<strong>de</strong>s ten<strong>de</strong>nt à démontrer un lien. Une étu<strong>de</strong> cas témoins menée sur 200 patients trouve<br />
une corrélation statistique significative (OR=3.329). De plus, une alvéolyse significativement plus<br />
importante et un nombre significativement plus élevé <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts manquantes ont été observés chez<br />
les patients atteints <strong>de</strong> psoriasis dans une autre étu<strong>de</strong> cas témoins sur 300 patients. Enfin, une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cohorte menée sur 230.730 patients trouve un risque accru <strong>de</strong> psoriasis chez les patients<br />
développant une parodontite (1,52) et ce risque est atténué après traitement chirurgical <strong>de</strong> la<br />
parodontite (1,26).<br />
Conclusion: Une association entre la parodontite et le psoriasis semble exister mais nous <strong>de</strong>vons<br />
rester pru<strong>de</strong>nts car les étu<strong>de</strong>s sont peu nombreuses. De nouvelles étu<strong>de</strong>s cliniques prospectives<br />
<strong>de</strong> cohorte sont nécessaires pour démontrer une association et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s cliniques et<br />
expérimentales pour en cerner les mécanismes.<br />
Les essais cliniques.<br />
M. Khemiss, R. Chebbi, M. Dhidah<br />
L'essai clinique est une étu<strong>de</strong> scientifique réalisée en thérapeutique médicale humaine pour<br />
évaluer l'efficacité et la tolérance d'une métho<strong>de</strong> diagnostique ou d'un traitement. Ces étu<strong>de</strong>s sont<br />
souvent effectuées après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s expérimentales précliniques pour confirmer leur pertinence et<br />
leur sécurité.<br />
La fiabilité <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s, qui nécessitent la collaboration <strong>de</strong> plusieurs intervenants, repose sur<br />
une métho<strong>de</strong> scientifique rigoureuse afin <strong>de</strong> limiter tout biais, toute erreur <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s données<br />
ou d'interprétation <strong>de</strong>s résultats. Ces résultats, une fois publiés, servent à établir le dossier<br />
permettant <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r l'utilisation du produit auprès <strong>de</strong>s instances nationales ou internationales.<br />
Ce travail se propose <strong>de</strong> décrire les essais cliniques, notamment en Tunisie, les étapes <strong>de</strong> leur<br />
réalisation ainsi que les règles éthiques à respecter. En effet, pour mener à bien ces essais il faut<br />
être conscient du fait qu'ils sont régis, partout dans le mon<strong>de</strong>, par <strong>de</strong>s textes juridiques stricts qui<br />
obéissent aux principes <strong>de</strong> l'éthique internationale. La sécurité et l'intérêt <strong>de</strong>s personnes, qui se<br />
prêtent à cette recherche biomédicale, doit toujours primer sur les intérêts <strong>de</strong> la science et <strong>de</strong> la<br />
société.<br />
- 33 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Résumés<br />
«Communications affichées»<br />
Mé<strong>de</strong>cine et Chirurgie Buccales<br />
A1. Double réimplantation <strong>de</strong>ntaire: bonne évolution malgré les facteurs <strong>de</strong> mauvais<br />
pronostic (A propos d'un cas).<br />
W. Hasni, M. Ben Jemaa, A. Zaghbani, K. Souid, R. Belkacem Chebil, R. Ayachi,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
Très nombreux travaux scientifiques nous permettent actuellement <strong>de</strong> mieux comprendre les<br />
critères <strong>de</strong> réussite et les causes d'échec <strong>de</strong>s réimplantations, immédiate ou différée, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts<br />
luxées acci<strong>de</strong>ntellement. Le temps écoulé hors <strong>de</strong> l'alvéole et le milieu <strong>de</strong> conservation influencent<br />
hautement le pronostic. Ainsi un temps extra oral court et un milieu <strong>de</strong> conservation adéquat<br />
augmentent la chance <strong>de</strong> réussite <strong>de</strong> la réimplantation. Mais si ces <strong>de</strong>ux conditions ne sont pas<br />
remplies, faut t-il quand même tenter cette manipulation Certains pensent que Le bénéfice <strong>de</strong> ce<br />
geste doit toujours être accordé au patient, plutôt que <strong>de</strong> perdre la <strong>de</strong>nt purement et simplement.<br />
En effet, malgré le risque d''ankylose et <strong>de</strong> résorption radiculaire, la réimplantation va permettre <strong>de</strong><br />
reculer l'échéance prothétique à un âge où la croissance est terminée avec un gain d'os nouveau<br />
et création d'un site implantable.<br />
Nous présentons un cas d'une double réimplantation <strong>de</strong>ntaire chez une jeune patiente <strong>de</strong> 14 ans<br />
ayant subi la luxation complète <strong>de</strong> la canine et la première prémolaire mandibulaire gauche.<br />
Malgré plusieurs facteurs <strong>de</strong> mauvais pronostic au départ (temps extra oral long, milieu <strong>de</strong><br />
conservation inadéquat, mauvaise hygiène), mous avons tenté la réimplantation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>nts<br />
luxées. L'évolution à 7 mois semble être bonne.<br />
A2. Cas original <strong>de</strong> pansinusite aiguë d'origine <strong>de</strong>ntaire.<br />
K. Souid, A. Bouguezzi, W. Hasni, R. Belkacem-Chebil, R. Ayachi, A. Zaghbani,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
La pansinusite aigue d'origine <strong>de</strong>ntaire est une pathologie rare. L'unilatéralité et la présence d'une<br />
<strong>de</strong>nt antrale nécrosée semblent être les maitres symptômes et le diagnostic se base sur un<br />
examen clinique minutieux et surtout sur l'examen tomo<strong>de</strong>nsitométrique qui permettra <strong>de</strong> définir<br />
l'extension <strong>de</strong> l'infection, <strong>de</strong> déterminer la causalité <strong>de</strong>ntaire et d'orienter le traitement. La prise en<br />
charge doit être rapi<strong>de</strong> afin d'éviter <strong>de</strong>s complications orbitaires et endocrâniennes.<br />
On rapporte un cas original <strong>de</strong> sinusite maxillaire aigue d'origine <strong>de</strong>ntaire extensive vers les sinus<br />
éthmoïdaux homolatéraux, l'orbite et les sinus frontal et sphénoïdal. L'évolution a été favorable<br />
sous un drainage sinusien et transcanalaire correcte et sous antibiothérapie parentérale à large<br />
spectre.<br />
A3. Dent surnuméraire à localisation exceptionnelle.<br />
M. Bel Haj Hassine, H. Hentati, A. Chokri, N. Ben Messaoud, S. Sioud, J. Selmi<br />
Les <strong>de</strong>nts surnuméraires se définissent comme étant <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong>ntaires supplémentaires en<br />
plus <strong>de</strong>s 20 <strong>de</strong>nts temporaires et 32 définitives pouvant apparaitre isolément ou dans le cadre <strong>de</strong><br />
maladies ou syndromes. Elles peuvent être uniques, multiples, uni ou bilatérales. Une forme<br />
particulière se rencontre au niveau <strong>de</strong> la partie antéro-centrale <strong>de</strong> la mandibule ou du maxillaire<br />
appelée communément mésio<strong>de</strong>ns. Ces <strong>de</strong>nts peuvent rester silencieuses cliniquement et sont<br />
diagnostiquées fortuitement lors d'un examen radiologique <strong>de</strong> routine comme elles peuvent être<br />
responsables <strong>de</strong> complications d'où le besoin <strong>de</strong> les prendre en charge immédiatement.<br />
L'examen radiologique revêt une importance capitale dans l'évaluation <strong>de</strong> la position et les<br />
rapports <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts surnuméraires avec les structures voisines.<br />
Dans notre travail, on se propose <strong>de</strong> présenter un cas d'une <strong>de</strong>nt surnuméraire dont la localisation<br />
est inhabituelle chez un jeune patient.<br />
- 34 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
A4. Kyste épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong>: à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
R. Ben Ali, S. Sioud, M. Bel Haj Hassine, N. Ben Messaoud, A. Chokri, H. Hentati, J. Selmi<br />
«Un kyste est une cavité pathologique qui présente un continu liqui<strong>de</strong>, semi-liqui<strong>de</strong> ou aérique et<br />
qui n'est pas crée par l'accumulation <strong>de</strong> pus. Il est bordé par un épithélium qui peut être soit<br />
continu soit discontinu».<br />
On distingue les kystes d'origine <strong>de</strong>ntaire (<strong>de</strong> loin les plus fréquents) et les kystes d'origine non<br />
<strong>de</strong>ntaire. Les Kystes épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong>s (ou kératokystes) dérivent <strong>de</strong>s restes épithéliaux <strong>de</strong> la lame<br />
<strong>de</strong>ntaire. Le kératokyste est habituellement unifocal au niveau <strong>de</strong>s maxillaires, cependant, on peut<br />
trouver <strong>de</strong>s kystes épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong>s multiples qui rentrent dans le cadre <strong>de</strong> la naevomatose basocellulaire.<br />
La parakératosique est la variété histologique la plus fréquente, mais il peut être <strong>de</strong> type<br />
orthokératinisé. Le risque <strong>de</strong> récidive est plus marqué pour les parakératosiques.<br />
A partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques suivis dans le service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et chirurgie buccales à la clinique<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, nous allons détailler les manifestations cliniques, radiologiques,<br />
histologiques <strong>de</strong>s kystes épi<strong>de</strong>rmoi<strong>de</strong>s tout en insistant sur les modalités thérapeutiques.<br />
A5. Prise en charge d'un granulome périphérique à cellules géantes récidivant.<br />
N. Ben Messaoud, A. Chokri, H. Hentati, M. Bel Haj Hassine, S. Sioud, J. Selmi<br />
L'épulis à cellules géantes ou granulome périphérique à cellules géantes est une pseudotumeur <strong>de</strong><br />
la muqueuse buccale; sa localisation préférentielle est la gencive. Il s'agit plutôt <strong>de</strong> réaction<br />
tissulaire à <strong>de</strong>s irritations locales (plaque bactérienne, tartre, obturation coronaire défectueuse…)<br />
que <strong>de</strong> vraie néoplasie.<br />
Cliniquement c'est une lésion circonscrite, pédiculée ou sessile, <strong>de</strong> coloration rouge foncée,<br />
hémorragique et souvent ulcérée. Cet aspect peut poser un problème <strong>de</strong> diagnostic différentiel et<br />
l'examen anatomopathologique est incontournable pour poser le diagnostic final.<br />
Dans ce travail, on se propose <strong>de</strong> présenter un cas récidivant d'épulis à cellules géantes suivi au<br />
service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et chirurgie buccale <strong>de</strong> la clinique universitaire <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, tout en insistant<br />
sur les modalités thérapeutiques et les investigations complémentaires.<br />
B1. Infection d'origine <strong>de</strong>ntaire révélatrice d'une dysplasie cémonto-osseuse:<br />
A propos d'un cas.<br />
I. Hachicha, L. Masmoudi, I. Babbou, M. Hafdhi, R. Ayedi<br />
La dysplasie cémonto-osseuse (DCO) est un processus dysplasique spécifique <strong>de</strong>s maxillaires,<br />
classé selon l'OMS parmi les tumeurs et pseudotumeurs non odontogéniques bénignes <strong>de</strong>s<br />
maxillaires. C'est une lésion généralement asymptomatique mais qui peut être découverte à la<br />
suite d'une infection surajoutée, une ulcération traumatique,… La nature dysplasique <strong>de</strong> l'os le<br />
rend plus susceptible à l'infection et à la survenue d'ostéite.<br />
Nous rapportons dans ce travail le cas d'une patiente qui consulte pour la mobilité d'une molaire<br />
mandibulaire avec douleur et tuméfaction. L'examen clinique montre une infection en rapport avec<br />
cette <strong>de</strong>nt cariée. L'examen <strong>de</strong> la radiographie panoramique retrouve <strong>de</strong>s images mixtes<br />
s'étendant sur toute la mandibule, un aspect qui a été mieux exploré par un examen TDM. Le<br />
diagnostic d'une DCO était fortement suspecté. Le traitement antibiotique suivi <strong>de</strong> l'extraction <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>nt avec curetage appuyé à permis <strong>de</strong> soulager la patiente et <strong>de</strong> confirmer le diagnostic <strong>de</strong> DCO<br />
par l'examen histologique du tissu retiré.<br />
Un contrôle clinique et radiologique après 6 mois montre une cicatrisation muqueuse et osseuse.<br />
B2. L'éruption <strong>de</strong>s odontomes complexes: A propos d'un cas clinique.<br />
G. Krichen, I. Blouza, A. Bouzaien, MB. Khattech<br />
Les odontomes sont <strong>de</strong>s tumeurs odontogéniques bénignes fréquemment rencontrées.<br />
Ils sont généralement asymptomatiques et souvent associés à <strong>de</strong>s troubles d'éruption <strong>de</strong>ntaire.<br />
Ils sont souvent diagnostiqués fortuitement suite à un examen radiologique <strong>de</strong> routine.<br />
Leurs éruptions en bouche est rare et peut être associées à <strong>de</strong>s phénomènes inflammatoires.<br />
Dans ce travail, nous rapportons un cas d'un odontome complexe mandibulaire en éruption en<br />
rapport avec la <strong>de</strong>uxième molaire incluse chez un jeune patient <strong>de</strong> 22 ans.<br />
- 35 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
B3. Fluori<strong>de</strong> osseous dysplasias: From diagnosis to treatment. A report of three cases.<br />
D. Touil, L. Oualha, E. Moussaoui, S. Klai, N. Douki<br />
Fluori<strong>de</strong> osseous dysplasias are rare benign osteofibrous lesions of a non-neoplastic nature of the<br />
maxillae.<br />
FOD are usually asymptomatic; they are often discovered fortuitously during a routine radiological<br />
examination. However, a focal infection could occur and the lesion therefore becomes symptomatic<br />
manifesting through pain, pus, a fistula or even sequestration<br />
Observations:<br />
The authors report three clinical cases of fluori<strong>de</strong> osseous dysplasias in Tunisian women. They<br />
tried, through the three cases, to highlight the clinical and radiological characteristics, the<br />
histopathology of this lesion as well as the differential diagnosis and the treatment of the possible<br />
complications.<br />
Discussion:<br />
The clinical, radiological and histological characteristics are without particularities in relation to the<br />
literature. However, although the therapeutic attitu<strong>de</strong> responds to the conventional modalities, they<br />
often remain subject to the personal judgement of the practitioner and the patient's requirements.<br />
B4. Epulis: Approche diagnostique, démarche thérapeutique.<br />
S. Kalai, D. Touil, E. Moussaoui, S. Lili, L. Oualha, N. Douki<br />
L'épulis est une formation nodulaire <strong>de</strong> la gencive, c'est une pseudo-tumeur d'étiologie<br />
essentiellement irritative locale. Le diagnostic est essentiellement clinique, complété par un<br />
examen radiologique, cependant, l'étu<strong>de</strong> anatomopathologique permet <strong>de</strong> confirmer le diagnostic<br />
et d'apprécier l'aspect exact. Le traitement est essentiellement chirurgical; cependant il <strong>de</strong>vra être<br />
précédé par un détartrage surfaçage radiculaire voire un curetage <strong>de</strong> la zone péri lésionnelle pour<br />
diminuer l'inflammation.<br />
Dans ce travail, nous allons présenter les cas d'épulis les plus fréquemment rencontrés dans notre<br />
service.<br />
B5. Image ostéolytique mandibulaire chez un greffé rénal: à propos d'un cas.<br />
A. Turki, H. Skh iri, T. Ben Alaya, M. Ben Khelifa<br />
L'insuffisance rénale chronique à un sta<strong>de</strong> avancé s'accompagne le plus souvent d'une<br />
hyperparathyroïdie qui peut être responsable d'une déminéralisation osseuse diffuse. Les tumeurs<br />
brunes représentent une complication relativement rare mais sévère <strong>de</strong> cette hyperparathyroïdie<br />
secondaire (HPTS).<br />
Devant toute lésion d'allure kystique chez un insuffisant rénal chronique le diagnostic <strong>de</strong> tumeur<br />
brune peut être méconnu en cas d'hyperparathyroïdie asymptomatique d'autant plus que cette<br />
lésion présente le même aspect clinique que la tumeur vrai à cellules géantes, le granulome<br />
réparateur à cellules géantes et le kyste solitaire.<br />
Radiologiquement, la tumeur brune se manifeste par une ostéolyse non spécifique pouvant<br />
prendre plusieurs aspects, dont le plus commun est celui d'une lyse osseuse à limites non<br />
précises entraînant une soufflure <strong>de</strong>s corticales voire leur rupture.<br />
L'imagerie est d'apport précieux pour le diagnostic et le suivi, elle permet également d'établir le<br />
diagnostic étiologique en décelant le nodule parathyroïdien.<br />
L'association <strong>de</strong>s données clinique, radiographique et biologique (bilan phosphocalcique et dosage<br />
<strong>de</strong> la parathormone) permet d'évoquer le diagnostic.<br />
C1. L'histiocytose langerhansienne: à propos d'un cas.<br />
R. Belkacem Chebil, W. Hasni, K. Souid, A. Zaghbani, A. Ayachi, S. Mestiri,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
L'histiocytose langerhansienne est une prolifération oligo clonale <strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> langerhans qui se<br />
développe chez l'enfant et l'adulte jeune avec une inci<strong>de</strong>nce estimée chez l'enfant à 1/200 000<br />
cas/an. Le spectre clinique est très étendu allant <strong>de</strong> l'atteinte osseuse unique à la forme grave<br />
multiviscérale avec dysfonctionnement d'organes vitaux. La prise en charge thérapeutique est<br />
- 36 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
encore controversée. Les formes localisées ne nécessitent le plus souvent qu'une prise en charge<br />
limitée alors que certaines formes graves résistent au traitement chimiothérapique institué.<br />
Dans ce travail, à travers un cas clinique suivi au service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire du CHU Farhat<br />
Hached <strong>de</strong> sousse, on se propose <strong>de</strong> présenter le tableau clinique d'une forme polyostotique<br />
d'histiocytose langerhansienne chez un garçon <strong>de</strong> 21 ans ainsi ainsi que le rôle du mé<strong>de</strong>cin<br />
<strong>de</strong>ntiste dans le diagnostic et la prise en charge.<br />
C2. Carcinome épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> du vestibule jugal maxillaire: à propos d'un cas.<br />
R. Ayachi, W. Hasni, S. Ayachi, K. Souid, A. Zaghbani, R. Belkacem Chebil, B. Sriha,<br />
S. Bou<strong>de</strong>gga, A. Boughzala<br />
Malgré le développement <strong>de</strong> nouvelles approches thérapeutiques, le taux <strong>de</strong> survie <strong>de</strong>s patients<br />
atteints d'un carcinome épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cavité buccale ne s'est guère amélioré au cours <strong>de</strong>s<br />
trois <strong>de</strong>rnières décennies. La raison est simple: 70% <strong>de</strong>s cancers <strong>de</strong> la cavité buccales sont<br />
diagnostiqués à un sta<strong>de</strong> avancé (T3 et T4 selon la classification internationale TNM). Aussi, seul<br />
un dépistage précoce peut contribuer à améliorer le pronostic du cancer buccal. Et cet objectif ne<br />
saurait être réalisé sans la participation active du mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste à qui il lui incombe le premier<br />
rôle dans la lutte contre cette maladie. Or ce rôle n'est malheureusement pas souvent accompli.<br />
Ceci est surtout attribué à un défaut d'expertise dans la reconnaissance <strong>de</strong>s lésions suspectes<br />
(Cancers au sta<strong>de</strong> précoces, Transformation <strong>de</strong>s lésions potentiellement malignes…) mais aussi à<br />
une réticence et difficultés à pratiquer une biopsie. Nous rapportons un cas d'un carcinome<br />
épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> du vestibule jugal, diagnostiqué relativement tard chez une patiente qui consultait un<br />
mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste durant toute la pério<strong>de</strong> d'évolution <strong>de</strong> son cancer.<br />
C3. Evaluation du rapport entre les <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> sagesse mandibulaires et le nerf alvéolaire<br />
inférieur: étu<strong>de</strong> clinique comparative entre panoramique et tomo<strong>de</strong>nsitométrie.<br />
F. Nassiba, L. Lazrak, Z. Abidine, M. Baite<br />
Objectif: Répondre à la question: est-ce que les radiographies rétro alvéolaires et panoramiques<br />
seules peuvent être suffisantes pour déterminer exactement les rapports <strong>de</strong>s racines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
sagesse mandibulaire avec le nerf alvéolaire inferieur<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: L'échantillon comprenait 48 <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> sagesse enclavées ou incluses <strong>de</strong> 29<br />
patients adressés au service <strong>de</strong> radiologie pour un rapport entre les <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> sagesse<br />
mandibulaire et le nerf alvéolaire inférieur. Chaque patient avait une radiographie panoramique et<br />
un <strong>de</strong>ntascan ou panoramique et cone beam. Les variables prédictives étaient la distance entre la<br />
troisième molaire et le canal mandibulaire, et les données selon les critères <strong>de</strong> Rood. Les variables<br />
<strong>de</strong> résultats étaient l'absence <strong>de</strong> cortication entre la troisième molaire et le canal sur l'image<br />
tomo<strong>de</strong>nsitométrique.<br />
Résultats: Dans cette étu<strong>de</strong>, la distance <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt du canal <strong>de</strong>ntaire inférieur et la présence <strong>de</strong>s<br />
critères <strong>de</strong> Rood principalement l'interruption <strong>de</strong> la ligne blanche, étaient liés à l'absence <strong>de</strong><br />
corticalisation entre la <strong>de</strong>nt et le canal <strong>de</strong>ntaire inférieur.<br />
Discussion et Conclusion: La radiographie panoramique permet <strong>de</strong> prédire la position du nerf<br />
par rapport aux racines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> sagesse inférieures mais elle reste insuffisante; un examen<br />
tomo<strong>de</strong>nsitométrique est nécessaire pour évaluer ce rapport avec précision.<br />
C4. Abcès enkysté du vestibule maxillaire: à propos d'un cas.<br />
A. Rouis, A. Chokri, S. Sioud, N. Ben Messaoud, H. Hentati, J. Selmi<br />
Les Parodontites apicales chroniques, lésions inflammatoires du parodonte profond,<br />
principalement péri-radiculaire, font suite à une infection bactérienne <strong>de</strong> l'endodonte. La réaction<br />
tissulaire à l'irritation intra-canalaire continue aboutit à l'encapsulation <strong>de</strong> l'infiltrat inflammatoire<br />
riche en macrophages et en lymphocytes par un tissu conjonctif collagénique.<br />
L'évolution <strong>de</strong>s lésions péri-apicales chroniques est habituellement endo-osseuse aboutissant à la<br />
formation <strong>de</strong> kystes inflammatoires.<br />
À travers se travail, on se propose <strong>de</strong> présenter un cas, où l'évolution <strong>de</strong> l'inflammation périapicale<br />
chronique était exceptionnelle, avec formation d'un nodule mobile du vestibule gauche qui<br />
a pris confusion avec un fibrome ou un fibro-lipome. Le diagnostic <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong> est posé par un<br />
- 37 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
examen anatomopathologique qui a révélé un abcès enkysté du vestibule en rapport avec une<br />
prémolaire nécrosée.<br />
C5. Le risque infectieux en stomatologie: causes et prévention<br />
H. Ferjani<br />
Introduction:<br />
Le risque <strong>de</strong> transmission d'agents infectieux est un risque permanent qui concerne l'ensemble<br />
<strong>de</strong>s germes véhiculés par le sang ou les liqui<strong>de</strong>s biologiques.la protection du personnel soignant<br />
<strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts d'exposition au sang reposent sur <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> prévention techniques et<br />
médicales et surtout sur la formation et l'information.<br />
But:<br />
L'objectif <strong>de</strong> notre travail est <strong>de</strong> présenter les premiers résultats suite à une enquête instituée dans<br />
le service <strong>de</strong> stomatologie <strong>de</strong> Zaghouan dans la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 02 ans sur toute l'équipe<br />
pluridisciplinaire médicale et paramédicale (4 <strong>de</strong>ntistes-2 ai<strong>de</strong>s-soignants) concernant l'hygiène.<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s:<br />
Ce travail a été mené <strong>de</strong> façon prospective, étalant sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 02 ans (2010-2012)<br />
Résultats:<br />
D'après cet étu<strong>de</strong> ,on a constaté que les acci<strong>de</strong>nts d'exposition <strong>de</strong> sang en milieux <strong>de</strong> soins<br />
restent encore fréquents et leur prévention doit rester l'objectif prioritaire dans les établissements<br />
<strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> prévention .la surveillance biologique <strong>de</strong> la personne exposée ainsi qu'une<br />
prophylaxie doivent être mis en retard .<br />
Conclusion:<br />
Pour protéger le personnel <strong>de</strong> santé, le chef d'établissement en concertation avec le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong><br />
travail et le CSST doit définir une stratégie <strong>de</strong> prévention stratégie intégrée dans une démarche<br />
d'amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail repose sur:<br />
• la vaccination du personnel soignant<br />
• le respect <strong>de</strong>s précautions générales d'hygiène<br />
• l'utilisation rationnelle d'un matériel adapté<br />
• la mise en place d'un dispositif <strong>de</strong> prise en charge <strong>de</strong>s AES<br />
L'interprétation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> surveillance.<br />
Orthodontie<br />
D1. La céphalométrie tridimensionnelle: révolution ou simple évolution <br />
F. Jemmali, Y. May, A. Ben Salem Saied, H. Mabrouk, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
L'imagerie <strong>de</strong> projection, principe initial <strong>de</strong> l'image radiologique, réduit un volume anatomique 3D<br />
en une image plane 2D. Le souci <strong>de</strong> la troisième dimension axiale a conduit, par <strong>de</strong>s procédés<br />
toujours plus performants et plus complexes à une imagerie 3D.<br />
En Orthopédie <strong>de</strong>nto-faciale, bien que l'imagerie soit un complément d'une évaluation clinique<br />
rigoureuse ; elle est indispensable pour poser un diagnostic squelettique et pour juger le pronostic<br />
thérapeutique. L'application du scanner en odontostomatologie n'était utilisée que pour<br />
l'implantologie. Ce n'est que dans les années 90 que le scanner a permis au Dr. Jacques Treil <strong>de</strong><br />
proposer une métho<strong>de</strong> d'évaluation céphalométrique tridimensionnelle.<br />
Nous présenterons dans ce travail, un aperçu <strong>de</strong>s avantages <strong>de</strong> la céphalométrie 3D ainsi que ses<br />
inconvénients. Nous tenterons également d'évaluer l'apport <strong>de</strong> l'imagerie 3D en Orthopédie <strong>de</strong>ntofaciale.<br />
Est-ce que celle-ci constitue un simple plus dans notre panel <strong>de</strong> moyens diagnostic ou estelle<br />
au contraire une substitution inévitable à l'analyse céphalométrique 2D traditionnelle.<br />
D2. Décisions thérapeutiques en présence <strong>de</strong> premières molaires délabrées chez les<br />
sujets jeunes: à propos d'un cas.<br />
H. Mabrouk, A. Ben Salem Saied, F. Jemmali, Y. May, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
La première molaire permanente, considérée comme la clé <strong>de</strong> l'occlusion par Edward H. Angle est<br />
la <strong>de</strong>nt permanente la plus affectée par la maladie carieuse chez l'enfant et l'adolescent. Par<br />
- 38 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
ailleurs, l'augmentation <strong>de</strong> la prévalence <strong>de</strong>s hypo-minéralisations incisives- molaire (MIH),<br />
équivalentes à un défaut <strong>de</strong> structure <strong>de</strong> l'émail d'origine systémique, rend ces <strong>de</strong>nts plus<br />
sensibles à la carie.<br />
Au niveau <strong>de</strong>s molaires permanentes, l'émail mou, poreux, crayeux et très fragile. Il est à l'origine<br />
d'un rapi<strong>de</strong> et sévères délabrement <strong>de</strong>s premières molaires permanentes affectées<br />
L'objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> préciser l'attitu<strong>de</strong> thérapeutique <strong>de</strong>s orthodontistes dans les cas <strong>de</strong><br />
molaires délabrées chez <strong>de</strong>s enfants et <strong>de</strong>s adolescents.<br />
D3. Traitement orthopédique <strong>de</strong> la Cl II squelettique:à propos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
Y. May, H. Mabrouk, F. Jemmali, A. Ben Salem Saied, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
La classe II est une dysmorphose <strong>de</strong> la dimension antéro-postérieure, caractérisée par une arca<strong>de</strong><br />
inférieure en relation distale par rapport à l'arca<strong>de</strong> supérieure.<br />
Cette dysmorphose a différentes étiologies soit:<br />
• une rétromandibulie;<br />
• une promaxilie;<br />
• l'association <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux.<br />
Un diagnostic complet est donc nécessaire pour pouvoir cibler l'étiologie et indiquer le traitement<br />
le plus adéquat pour chaque patient.<br />
Dans ce travail on va s'interesser aux modalités thérapeutiques <strong>de</strong> la cl II squelettique pendant la<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong> démontrer les actions orthopédiques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux activateurs qui<br />
sont:l'activateur d'Andresen et l'activateur <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Chabre à partir du <strong>de</strong>ux cas cliniques traités<br />
et suivis au service d'orthodontie à CHU Farhat Hached à Sousse.<br />
D4. Le système Damon: à propos d'un cas clinique.<br />
A. Ben Salem Saied, F. Jemmali, A. El Yemni, A. Boughzala<br />
Dans le but d'améliorer la rapidité et l'efficacité du traitement orthodontique, mais également, le<br />
confort et la facilité d'utilisation du praticien, plusieurs nouvelles générations <strong>de</strong> brackets ont vu la<br />
lumière.<br />
Les brackets Damon représentent l'une <strong>de</strong>s pistes d'évolution et d'amélioration <strong>de</strong>s dispositifs<br />
multibagues classiques.<br />
Dwight Damon, a développé son propre système avec ses différentes générations associant ses<br />
brackets auto-ligaturants avec <strong>de</strong>s arcs dits « High Tech » tout en donnant la priorité à la plus<br />
faible friction associée à <strong>de</strong>s forces réduites. Cette approche, outre les facilités techniques qu'elle<br />
apporte, semble permettre <strong>de</strong> limiter considérablement les extractions, <strong>de</strong> traiter <strong>de</strong>s patients au<br />
parodonte très fragile, et d'obtenir <strong>de</strong>s résultats plus facilement et dans <strong>de</strong>s durées plus courtes.<br />
Dans ce travail, nous allons présenter cette nouvelle technique à traves un cas clinique en<br />
précisant ses indications ainsi que ses limites.<br />
D5. Apical root resorption in patients wearing orthodontic appliances.<br />
L. Lazrak, L. Ousehal, F. Elquars<br />
The aim of our study was to evaluate the inci<strong>de</strong>nce of orthodontically induced root resorption<br />
during the tooth alignment and levelling phase, and to assess the impact of the variables age, sex<br />
and <strong>de</strong>gree and direction of incisor displacement. We studied a consulting population at the<br />
<strong>de</strong>ntofacial orthopaedics unit of the <strong>de</strong>ntal consultation and treatment centre (CCTD), Casablanca.<br />
Our sample was composed of 30 exposed cases and 30 non-exposed cases, followed up for a<br />
period of 8 months. A survey document was drawn up for data collection, and retro-alveolar<br />
radiographic imaging was used to evaluate resorption. Our results showed that the patients<br />
receiving orthodontic treatment all <strong>de</strong>veloped minor root resorptions during the alignment and<br />
levelling phase in the incisor group. We found that the central incisors un<strong>de</strong>rwent greater<br />
resorption than the lateral incisors.<br />
- 39 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Parodontologie<br />
E1. La greffe épithélio-conjonctive.<br />
O. Ouelhazi, H. Ben Amara, S. Ben Abdallah, R. M'barek<br />
Décrite par Björne en 1963, la greffe épithélio-conjonctive est une <strong>de</strong>s techniques princeps <strong>de</strong> la<br />
chirurgie plastique parodontale. Elle permet <strong>de</strong> traiter bon nombre d'indications <strong>de</strong> chirurgie mucogingivale<br />
comme l'augmentation <strong>de</strong> tissu kératinisé et le recouvrement radiculaire. Cette technique<br />
consiste en la mise en place au niveau <strong>de</strong> la zone à traiter d'un greffon épithélio-conjonctif prélevé<br />
le plus souvent du palais.<br />
Notre objectif est <strong>de</strong> démontrer l'application clinique <strong>de</strong> cette technique à travers <strong>de</strong>s cas cliniques<br />
traités au sein <strong>de</strong> notre service.<br />
E2. Approche thérapeutique <strong>de</strong>s hypertrophies gingivales d'origine medicamenteuse.<br />
S. Ben Tanfous, N. Khouildi, R. Masmoudi, H. Amouri, L. Guezguez<br />
L'augmentation pathologique du volume gingival est fréquemment observée.<br />
Outre l'étiologie bactérienne, traumatique et tumorale, certains agents pharmacologiques ont été<br />
clairement associés à une telle augmentation. Ces agents comprennent essentiellement la<br />
ciclosporine A , la phénytoïne et la niphédipine.<br />
A l'heure actuelle, l'instauration d'une hygiène rigoureuse et l'élimination <strong>de</strong> facteurs étiologiques<br />
semblent être les seuls moyens pour faire face à cette pathologie. Face à cet accroissement , le<br />
praticien doit instauré un programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> plaque rigoureux et réaliser le traitement<br />
étiologique et intervenir chirurgicalement pour eliminer le volume gingivale et faciliter ainsi<br />
l'hygiènne du patient. En cas <strong>de</strong> récidive il est possible <strong>de</strong> ré-intervenir.<br />
E3. L'élongation coronaire chirurgicale: Approches thérapeutiques et limites.<br />
N. Khouildi, L. Guezguez<br />
L'élongation coronaire est une chirurgie parodontale qui vise l'allongement <strong>de</strong> la couronne clinique<br />
en vue <strong>de</strong> réaliser une restauration conservatrice ou prothétique, <strong>de</strong> corriger un sourire dit gingival<br />
et d'harmoniser les contours gingivaux asymétriques.<br />
Ces objectifs ne seront pas atteints qu'en tenant compte d'un certain nombre <strong>de</strong> paramètres<br />
cliniques (qualité et quantité <strong>de</strong> la gencive kératinisée, espace biologique, examen du sourire) et<br />
radiologiques (le rapport couronne / racine , espace chirurgical préprothétique, la forme <strong>de</strong>s<br />
racines, les éventuelles proximités radiculaires) qui a leur tour conditionnent le choix <strong>de</strong> la<br />
technique chirurgicale utilisée.<br />
E4. Les implants au niveau du secteur postérieur.<br />
H. Ben Amara, H. Amouri, R. Masmoudi, R. M'barek<br />
Dans les secteurs postérieurs, là où l'inci<strong>de</strong>nce esthétique <strong>de</strong>s traitements est limitée, les solutions<br />
aux problèmes d'é<strong>de</strong>ntements utilisant <strong>de</strong>s implants représentent sûrement le meilleur choix. En<br />
offrant aux patients un confort indiscutable, les implants permettent <strong>de</strong> rétablir efficacement une<br />
fonction postérieure sans altérer la santé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts naturelles résiduelles.<br />
Toutefois, le maxillaire postérieur présente <strong>de</strong>s problèmes spécifiques pour la mise en place<br />
d'implants <strong>de</strong>ntaires. D'une part, la faible qualité osseuse fréquemment rencontrée dans cette<br />
région, et d'autre part l'insuffisance <strong>de</strong> la masse osseuse disponible liée au volume du sinus et à<br />
l'atrophie maxillaire, ont rendu le succès à long terme moins favorable par rapport à d'autre<br />
régions. Durant les trois décennies précé<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong>s procédures chirurgicales ont été développées<br />
dans l'objectif d'augmenter localement le volume osseux, rendant ainsi possible la mise en place<br />
d'implant standards. Si l'efficacité <strong>de</strong> ces techniques n'est plus aujourd'hui à démontrer,<br />
néanmoins, celles-ci alourdissent considérablement les traitements. La question qui se pose est <strong>de</strong><br />
savoir si d'autres solutions comme la mise en place d'implants courts ou d'implants tubérositaires<br />
sont acceptables.<br />
Nous essayerons <strong>de</strong> montrer, à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> quelques cas cliniques, les diverses situations<br />
- 40 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
rencontrées au niveau secteur postérieur et l'attitu<strong>de</strong> adoptées en vue d'une restauration par la<br />
prothèse implanto-portée.<br />
E5. Applications cliniques <strong>de</strong> la piézochirurgie.<br />
H. Amouri, W. Nasri, S. Ben Tanfous, R. M'barek<br />
La piézochirugie a été décrite dès 1981, par Horton et al. et fut récemment perfectionnée et<br />
adaptée par Vercelotti en 2000.<br />
Grâce aux microvibrations d'inserts à fréquence ultrasonique, le bistouri ultrasonore est capable <strong>de</strong><br />
découper avec précision les tissus durs et faciliter le clivage <strong>de</strong>s interfaces soli<strong>de</strong>s, permettant<br />
ainsi <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s ostéoplasties et <strong>de</strong>s ostéotomies avec une gran<strong>de</strong> précision.<br />
Grâce à sa vaste gamme d'inserts, cette technique permet d'élargir les indications <strong>de</strong> la chirurgie<br />
osseuse, simplifier les protocoles chirurgicaux et améliorer la prédictibilité <strong>de</strong>s résultats.<br />
Comme pour tout outil, il est important d'en définir les avantages et les inconvénients, <strong>de</strong> lui définir<br />
un champ d'application raisonnable afin <strong>de</strong> profiter pleinement <strong>de</strong> ses atouts sans se heurter à ses<br />
limites.<br />
E6. Le lambeau <strong>de</strong> préservation papillaire en chirurgie osseuse parodontale.<br />
W. Nasri, O. Ouelhazi, N. Khouildi, R. M'barek<br />
En présence <strong>de</strong> poches parodontales résiduelles, la réévaluation qui suit la thérapeutique initiale<br />
va déterminer l'attitu<strong>de</strong> du praticien. Plusieurs attitu<strong>de</strong>s chirurgicales peuvent être définies<br />
permettant un accès direct au parodonte profond, mais la récession gingivale qui s'en suit reste<br />
l'inconvénient majeur <strong>de</strong> ces techniques et elle est le plus souvent accentuée au niveau <strong>de</strong>s<br />
papilles inter<strong>de</strong>ntaires zones où l'inflammation et l'œdème sont les plus marqués.<br />
A fin <strong>de</strong> remédier à cet inconvénient <strong>de</strong> nombreuses techniques chirurgicales se sont développées<br />
afin <strong>de</strong> préserver au mieux l'esthétique gingivale. La préservation <strong>de</strong>s tissus inter<strong>de</strong>ntaires lors <strong>de</strong><br />
la réalisation <strong>de</strong> lambeaux muco-périostés est particulièrement importante.<br />
Le lambeau esthétique d'accès (Genon et Ben<strong>de</strong>r, 1984), proposé essentiellement pour <strong>de</strong>s fins<br />
esthétiques puis son arsenal thérapeutique s'est élargie aux secteurs postérieurs surtout en<br />
association avec <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> régénération tissulaire guidée, ainsi que le lambeau <strong>de</strong><br />
préservation papillaire (Takei et col. , 1985) <strong>de</strong>ux techniques qui ont été proposées afin <strong>de</strong><br />
préserver les tissus mous, y compris le tissu inter<strong>de</strong>ntaire et le tissu <strong>de</strong> granulation présent sur la<br />
face interne du lambeau. Elles incorporent l'ensemble <strong>de</strong> la papille dans l'un <strong>de</strong>s volets au moyen<br />
d'incisions horizontale à la base <strong>de</strong> la papille et intrasulculaire pour rompre l'attache du tissu<br />
conjonctif. Elles ont pour but d'améliorer l'aspect esthétique post-opératoire en conservant le<br />
maximum <strong>de</strong> tissu inter<strong>de</strong>ntaire, d'empêcher la formation <strong>de</strong> cratères inter<strong>de</strong>ntaires lors <strong>de</strong> la<br />
cicatrisation et <strong>de</strong> garantir l'herméticité lors <strong>de</strong> chirurgies additives (avec matériaux <strong>de</strong> greffe ou <strong>de</strong><br />
comblement).<br />
E7. Les aminobisphosphonates par voie locale: Quel intérêt dans la thérapeutique<br />
parodontale <br />
T. Mechergui, L. Guezguez<br />
Les bisphosphosnates sont bien connues <strong>de</strong>s chirurgiens-<strong>de</strong>ntistes surtout pour leurs<br />
complications, principalement l'ostéonécrose <strong>de</strong>s maxillaires.<br />
Alors que leur activité anti-ostéoclastique pourrait être utilisée en pratique odontologique,<br />
notamment dans le traitement <strong>de</strong>s maladies parodontales, la prévention <strong>de</strong> la récidive en<br />
orthodontie, le traitement <strong>de</strong>s résorptions radiculaires inflammatoires ou dans le cadre d'une<br />
réhabilitation implanto-portée.<br />
L'objectif <strong>de</strong> ce travail est donc <strong>de</strong> dévoiler l'impact <strong>de</strong> ces molécules plus précisément les<br />
aminobisphosphonates sur le remo<strong>de</strong>lage osseux <strong>de</strong> la sphère orale et leurs potentielles<br />
applications par voie locale particulièrement en parodontologie.<br />
Les résultats <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s dans ce domaine ont permis <strong>de</strong> conclure un effet favorable, bénéfique et<br />
intéressant pour leurs indications thérapeutiques futures en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire.<br />
- 41 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
E8. Traitement <strong>de</strong>s parodontolyses: apport <strong>de</strong> l'orthodontie.<br />
H. Jegham, W. Bechraoui, Z. Khadhar, S. Nahali, I. Blouza, S. Turki, MB. Khattèche<br />
Face à <strong>de</strong>s cas complexes <strong>de</strong> parodontite avec perte d'ancrage importante, migrations<br />
secondaires et parafonctions, il est nécessaire d'envisager un traitement pluridisciplinaire dont les<br />
maîtres d'œuvre seront la parodontie et l'orthodontie. Une évaluation précise lors <strong>de</strong> l'examen<br />
clinique initial permettra d'apprécier la coopération du patient et <strong>de</strong> définir les objectifs du<br />
traitement.<br />
Les résultats à long terme seront fonction d'une maintenance drastique à intervalles réguliers.<br />
Prothèse Fixée<br />
F1. A direct build up of a monobloc crown: illustrated by a clinical situation.<br />
A. Khiari, D. Hadyaoui, Z. Nouira, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Usually, monobloc crowns are obtained after an indirect impression which provi<strong>de</strong>s to the<br />
prosthesist informations allowing him to sculpture the wax pattern and then cast it. The crown<br />
obtained will be tried in the oral cavity. This method is not out of imprecisions and aggressions on<br />
periodontal tissues ... A direct and possible sculpture by duralay plastic can give better results and<br />
precisions, since the crown will be built up by the practitioner. And this avoids periodontal<br />
aggressions by the compression of impression materials.... Through a clinical case we proved that<br />
this method is precise and simple and offers many advantages. Even if duralay resin can shrink,<br />
this disadvantage can be avoi<strong>de</strong>d by casting the pattern immediately after the sculpture.<br />
F2. Comment réussir l'empreinte globale sans guidage unitaire <br />
N. Daouahi, R. Gazbar, I. Gasmi, Z. Nouira, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
L'empreinte <strong>de</strong>s préparations en prothèse fixée est une étape <strong>de</strong> communication essentielle entre<br />
le travail réalisé en clinique et l'élaboration <strong>de</strong> la prothèse d'usage au laboratoire. De sa qualité<br />
dépend la fidélité du modèle <strong>de</strong> travail sur lequel seront ajustés les éléments prothétiques. On peut<br />
considérer qu'une empreinte a été réussie lorsque la pièce prothétique est parfaitement ajustée<br />
sur les préparations et que la stabilité du parodonte marginal est préservée.<br />
La réussite d'une empreinte en prothèse fixée nécessite d'abord une préparation particulière puis<br />
une parfaite maitrise <strong>de</strong> toutes les séquences <strong>de</strong>puis l'analyse du terrain jusqu'à sa réalisation<br />
proprement dite.<br />
Chaque praticien qui connait les indications et les exigences <strong>de</strong>s différentes techniques doit être<br />
capable <strong>de</strong> faire le choix gagnant pour réussir ses empreintes. Deux gran<strong>de</strong>s familles d'empreintes<br />
globales peuvent être réalisées en prothèse fixée; dans ce travail on va s'intéresser aux<br />
empreintes globales sans guidage unitaire.<br />
F3. Evaluation du taux <strong>de</strong> survie <strong>de</strong>s bridges collés réalisés entre 2010 et 2012<br />
au service <strong>de</strong> Prothèse Conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca.<br />
N. El Mesbahi, A. Bennani, M. Hamza, A. Bigou<br />
Objectifs: Le remplacement d'une <strong>de</strong>nt absente par le bridge collé est une solution esthétique non<br />
invasive dans les situations où le bridge conventionnel scellé est jugé trop mutilant ou quand<br />
l'emploi <strong>de</strong> l'implant est contre-indiqué.<br />
Différents facteurs comme la rigueur <strong>de</strong> l'indication, <strong>de</strong> la conception, <strong>de</strong> la réalisation et du collage<br />
constituent <strong>de</strong>s facteurs essentiels <strong>de</strong> réussite du bridge collé. Néanmoins, le recours à ces<br />
bridges collés reste très souvent marginal en pratique quotidienne.<br />
Notre étu<strong>de</strong> est une étu<strong>de</strong> longitudinale tendant à évaluer le taux <strong>de</strong> survie <strong>de</strong>s bridges collés<br />
réalisés sur <strong>de</strong>ux ans au sein du service <strong>de</strong> prothèse conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca.<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: 55 bridges collés ont été réalisé chez 50 patients entre avril 2010 et juillet<br />
2012 au service <strong>de</strong> prothèse conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca.<br />
Résultats: Durant la pério<strong>de</strong> d'observation, 3 bridges collés ont présenté <strong>de</strong>s décollements<br />
partiels et 4 d'entre eux un décollement total. Trois autres piliers <strong>de</strong> bridges ont présenté <strong>de</strong>s<br />
pulpites irréversibles.<br />
Conclusion: L'analyse <strong>de</strong> nos résultats permettra d'améliorer les performances <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
- 42 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
bridge au sein du service <strong>de</strong> prothèse conjointe et ainsi d'augmenter sa longévité par le respect<br />
<strong>de</strong>s différents paramètres cliniques.<br />
F4. Les <strong>de</strong>nts dépulpées en prothèse fixée: quand conserver, quand extraire <br />
N. Chérif, I. Gasmi, Z. Nouira, N. Oueslati, B. Douss, M. Chérif<br />
Dans sa pratique quotidienne, le clinicien est en permanence confronté à <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> décision<br />
cliniques au sein <strong>de</strong> chaque discipline <strong>de</strong> la <strong>de</strong>ntisterie. La décision <strong>de</strong> la conservation ou <strong>de</strong><br />
l'extraction d'une <strong>de</strong>nt est complexe à prendre car elle fait entrer en jeu <strong>de</strong>s évaluations<br />
pronostiques multidisciplinaires incluant notamment l'endodontie et la parodontologie. Sur<br />
parodonte sain, dans le cadre <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt dépulpée ou à dépulper qui peut être restaurée,<br />
l'endodontie est au cœur du problème. En présence d'une maladie parodontale, notre capacité à<br />
traiter l'ensemble <strong>de</strong> la surface radiculaire contaminée et à recréer un environnement parodontal<br />
maintenable dans un état <strong>de</strong> santé dicte le pronostic du traitement. Les limites <strong>de</strong> nos possibilités<br />
<strong>de</strong> traitement seront présentées. L'implantologie permet aujourd'hui un mimétisme remarquable<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts naturelles.<br />
F5. Evaluation qualitative <strong>de</strong>s Reconstitutions Corono-Radiculaires Foulées réalisées<br />
entre avril 2010 et avril 2012 au service <strong>de</strong> Prothèse Conjointe du CCTD <strong>de</strong><br />
Casablanca, Maroc.<br />
A. Chafii, A. Bennani, M. Hamza, A. Bigou, A. Andoh<br />
Objectifs: Une reconstitution corono-radiculaire est nécessaire lorsque le délabrement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt<br />
dépulpée est important. Elle a pour objectifs d'assurer la rétention <strong>de</strong> la restauration coronaire, <strong>de</strong><br />
renforcer la cohésion corono-radiculaire et d'assurer la pérennité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt sur l'arca<strong>de</strong>, sur le<br />
plan biologique et structurel.<br />
Les RCR coulées sont toujours considérées comme le gold-standard pour la restauration <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>nts dépulpées sévèrement endommagées. Toutefois, On leur reconnaît certains inconvénients<br />
que les RCR foulées réalisées à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> tenons en fibres renforcées (PRF) permettent d'éviter<br />
lorsque l'indication <strong>de</strong> celles-ci est posée.<br />
La présente étu<strong>de</strong> est une étu<strong>de</strong> longitudinale prospective qui se propose d'évaluer le taux <strong>de</strong><br />
survie <strong>de</strong>s RCR foulées réalisées sur <strong>de</strong>ux ans au service <strong>de</strong> Prothèse Conjointe du CCTD <strong>de</strong><br />
Casablanca, Maroc.<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: 22 RCR foulées ont été réalisées chez 17 patients entre avril 2010 et avril<br />
2012 au service <strong>de</strong> prothèse conjointe du CCTD <strong>de</strong> Casablanca, Maroc.<br />
Résultats: Durant la pério<strong>de</strong> d'observation, variant entre 9 et 33 mois, une seule RCR foulée a<br />
présenté un décollement partiel après 6 mois <strong>de</strong> collage. Le reste <strong>de</strong>s RCRF a montré une bonne<br />
résistance et une bonne viabilité en bouche quelque soit le secteur concerné.<br />
Conclusion: L'analyse <strong>de</strong> nos résultats permet <strong>de</strong> conclure, dans les limites <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>, que le<br />
respect <strong>de</strong>s différents paramètres cliniques, <strong>de</strong> l'indication et du protocole rigoureux <strong>de</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong>s RCR foulées améliore les performances <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> reconstitution et augmente ainsi leur<br />
taux <strong>de</strong> survie en bouche.<br />
F6. L'enregistrement <strong>de</strong> l'occlusion par la technique F.G.P.<br />
A. Ben Moussa, R. Dakhli, Z. Nouira, I. Gasmi, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
C'est par une démarche différente que la technique FGP (fonctionnaly generated path) conduit à<br />
l'harmonie occlusale <strong>de</strong>s reconstitutions prothétiques. Plutôt que d'avoir recours à un articulateur<br />
pour simuler la cinétique mandibulaire, cette métho<strong>de</strong> exploite un enregistrement intra-oral <strong>de</strong>s<br />
trajets <strong>de</strong>s pointes cuspidiennes au cours <strong>de</strong> la "fonction mandibulaire".<br />
Cette technique trouve son indication dans l'élaboration d'éléments unitaires simples ou <strong>de</strong> faible<br />
étendue.<br />
De la cire est fixée sur la face occlusale <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt préparée, le patient serre en PIM, et à partir <strong>de</strong><br />
cette position effectue tous les déplacements mandibulaires.<br />
la technique F.G.P permet d'enregistrer <strong>de</strong>s rapports d'occlusion statiques et dynamiques d'une<br />
façon simple, facile et rapi<strong>de</strong> à réaliser.<br />
Par un enregistrement intra-buccal <strong>de</strong>s trajectoires mandibulaires, elle permet aussi la réalisation<br />
- 43 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
<strong>de</strong> restaurations prothétiques fixées avec une précision inégalée et parfaitement adaptée aux<br />
relations occlusales statiques et dynamiques.<br />
G1. La restauration esthétique d'une <strong>de</strong>nt riziforme par la facette collée.<br />
R. Gazbar, I. Gasmi, Z. Nouira, M. Barkaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Les facettes pelliculaires <strong>de</strong> céramique permettent tout à la fois un respect biologique élevé, une<br />
économie tissulaire importante et <strong>de</strong>s qualités esthétiques jusqu'à présent inégalées. Les facettes<br />
sans préparation s'inscrivent le plus souvent dans <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> compromis où le patient insatisfait<br />
<strong>de</strong> son aspect esthétique ne peut pour autant envisager un long traitement orthodontique. Ces<br />
facettes sont réalisées en surcontour vestibulaire, elles compensent <strong>de</strong>s malpositions ou <strong>de</strong>s<br />
anomalies <strong>de</strong>ntaires morphologiques. Leur validation s'établit à la suite <strong>de</strong> la réalisation d'un<br />
masque préprothétique qui préfigure la restauration finale. Les facettes sans préparation<br />
constituent <strong>de</strong>s cas particuliers d'indications relativement rares et ne doivent évi<strong>de</strong>mment pas se<br />
généraliser à la réalisation <strong>de</strong> tous les cas <strong>de</strong> facettes pelliculaires.<br />
G2. Les restaurations partielles en céramique réalisés avec la CFAO sur <strong>de</strong>nts<br />
postérieures: à propos d'un cas clinique<br />
M. Grati, I. Gasmi, Z. Nouira, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Les restaurations indirectes en céramique sur <strong>de</strong>nts pulpées dans le secteur postérieur doivent<br />
répondre aux enjeux esthétiques et fonctionnels dans un contexte biomécanique spécifique.<br />
Contrairement aux <strong>de</strong>nts antérieures, ces restaurations sont soumises à <strong>de</strong>s contraintes<br />
occlusales intenses qui conditionnent le choix du praticien en termes du type <strong>de</strong> la préparation, du<br />
choix du matériau et <strong>de</strong>s techniques d'assemblage.<br />
Dans ce travail, notre intérêt sera attribué à leurs indications, particularités <strong>de</strong> conception et aux<br />
facteurs déterminant le choix du système tout céramique.<br />
Notre illustration clinique portera sur la réalisation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux inlay-onlays sur la 46 et la 47 vitales<br />
présentant <strong>de</strong>s tendinites moyennes occluso-proximales.<br />
G3. Etu<strong>de</strong> ultrastructurale <strong>de</strong>s alliages Ni-Cr utilisés en prothèse conjointe<br />
A. Bennani, M. Amine, A. Chafii, S. Eladioui<br />
Les alliages Ni-Cr utilisés en prothèse fixée, présentent d'excellentes propriétés mécaniques,<br />
toutefois ils ont une inertie chimique et électrochimique qui dépend <strong>de</strong> leur composition et leur<br />
microstructure.<br />
L'objectif <strong>de</strong> notre travail est d'étudier l'ultrastructure <strong>de</strong> l'alliage Ni-Cr exposé à une corrosion libre<br />
ainsi qu'une analyse chimique <strong>de</strong> surface en fonction <strong>de</strong> sa composition.<br />
Pour cela, cinq électro<strong>de</strong>s en alliages Ni-Cr ont été préparées au laboratoire <strong>de</strong> prothèse en<br />
variant leur composition. Une analyse <strong>de</strong> l'ultrastructure <strong>de</strong>s échantillons au microscope<br />
électronique à balayage M.E.B. a été effectuée ainsi qu'une analyse chimique <strong>de</strong> leurs spectres.<br />
Avant toute manipulation, l'analyse au MEB <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> 5 (100% métal neuf), montre un état <strong>de</strong><br />
surface altéré. L'électro<strong>de</strong> 3 (75% métal neuf) présente également un état <strong>de</strong> surface acci<strong>de</strong>nté.<br />
Après une semaine en corrosion libre dans une solution <strong>de</strong> Meyer à pH= 6.5, l'électro<strong>de</strong> 5 montre<br />
une corrosion généralisée intergranulaire et par piqûres. L'électro<strong>de</strong> 3 (75% métal neuf), une<br />
semaine après immersion dans une solution <strong>de</strong> Ringer à pH = 7.9, montre une corrosion<br />
généralisée intergranulaire et par piqûres.<br />
Après essai électrochimique dans une solution <strong>de</strong> Ringer à pH= 5, l'électro<strong>de</strong> 1 (100% métal<br />
récupéré) montre au MEB, une structure très acci<strong>de</strong>ntée avec une corrosion par crevasse<br />
importante.<br />
L'analyse chimique <strong>de</strong> surface <strong>de</strong>s spectres <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> 3 et <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> 5 ne montre pas <strong>de</strong><br />
pics correspondant à <strong>de</strong>s impuretés. Les <strong>de</strong>ux spectres sont presque similaires.<br />
La composition et les conditions <strong>de</strong> mise en forme <strong>de</strong> l'alliage Ni-Cr ont une influence sur sa<br />
microstructure et par la même occasion sur son comportement électrochimique.<br />
- 44 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
G4. Traitement multidisciplinaire pour le remplacement <strong>de</strong> le centrale absente:<br />
à propos d'un cas clinique.<br />
M. Ajlani, M. Barkaoui, D. Hadyaoui, Z. Nouira, I. Gasmi, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
Au niveau <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts antérieures, l'objectif esthétique prime sur la fonction, et bien que les<br />
restaurations céramo-métalliques restent une option <strong>de</strong> choix surtout sur le plan mécanique, il faut<br />
reconnaitre que les nouvelles techniques céramo-céramiques peuvent allier l'esthétique à cet<br />
avantage.<br />
Nous proposons, dans ce travail, une solution élégante et facile à réaliser qui consiste en la<br />
réalisation d'une restauration céramo-céramique antérieure en exploitant une canine incluse pour<br />
remplacer une incisive centrale absente chez une patiente âgée <strong>de</strong> 21 ans.<br />
G5. Bridge céramo-céramique au niveau postérieur: à propos d'un cas clinique.<br />
M. Barkaoui, M. Chebil, Z. Nouira, I. Gasmi, D. Hadyaoui, J. Saâfi, B. Harzallah, M. Chérif<br />
L'information <strong>de</strong>s patients à propos <strong>de</strong> l'esthétique et <strong>de</strong> la biocompatibilité augmente leur intérêt<br />
pour les solutions céramo-céramiques.<br />
Le développement <strong>de</strong>s infrastructures en zircone s'est produit grâce à l'avènement <strong>de</strong>s systèmes<br />
CAO/CFAO et évolué à gran<strong>de</strong> vitesse. Ce matériau <strong>de</strong> haute résistance mécanique, très<br />
innovant, permet <strong>de</strong> répondre à <strong>de</strong> nombreuse indications, antérieure et postérieure, unitaire et<br />
pleurale, <strong>de</strong> petite et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> étendue.<br />
Le recul clinique <strong>de</strong>s prothèses céramo-céramiques commence à être suffisant pour en permettre<br />
l'application en pratique quotidienne <strong>de</strong> façon sûre, en respectant leurs indications.<br />
Il <strong>de</strong>vient urgent pour les praticiens et les prothésistes <strong>de</strong> se familiariser avec ces nouvelles<br />
techniques. Le tout céramique <strong>de</strong>viendra <strong>de</strong> façon incontournable la prothèse fixée <strong>de</strong> <strong>de</strong>main,<br />
réponse à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> grandissante <strong>de</strong> nos patients.<br />
Même si les machines ont un rôle très important dans la conception et la réalisation <strong>de</strong>s prothèses<br />
céramo-céramiques, le praticien et le prothésiste ont un rôle prépondérant.<br />
Prothèse Amovible<br />
H1. Intérêt <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> l'occlusion en phase d'étu<strong>de</strong> en PPA.<br />
J. Ben Mustapha, S. Bouraoui, S. Ammar, R. Bibi, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Indispensable à la prise <strong>de</strong> décision prothétique, l'enregistrement <strong>de</strong> l'occlusion en phase d'étu<strong>de</strong><br />
est un examen qui vient compléter l'observation clinique. Il permet d'analyser les rapports<br />
mandibulo-maxillaires et les paramètres occlusaux présentant souvent <strong>de</strong>s perturbations en cas<br />
d'é<strong>de</strong>ntement.<br />
Il permet également <strong>de</strong> voir la faisabilité du projet prothétique en réalisant les wax up et le<br />
montage directeur.<br />
A travers <strong>de</strong>s cas cliniques, nous essayerons <strong>de</strong> montrer l'intérêt <strong>de</strong> cet enregistrement et ses<br />
apports dans la décision et l'élaboration thérapeutique.<br />
H2. Insuffisance <strong>de</strong> la hauteur prothétique, quelles sont les solutions adoptées <br />
A propos d'un cas<br />
I. Ouni, S. Bekri, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
L'insuffisance <strong>de</strong> l'espace prothétique disponible est parmi les situations les plus difficile à gérer<br />
malgré les différentes procédures qu'on peut les utilisées pour surmonter ce problème, entre autre<br />
l'augmentation <strong>de</strong> la DVO, les coronoplasties, les <strong>de</strong>nts scupltées, la chirurgie ostéo-muqueuse...<br />
Dans ce travail on va présenter à travers un cas clinique quelques procédures utilisées pour<br />
aménager un espace prothétique favorable à la réalisation <strong>de</strong> la prothèse.<br />
- 45 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
H3. Rendre le sourire aux patients atteints d'amélogenèse imparfaite.<br />
I. Saddouri, B. Mogaâdi, S. Ammar, N. Taktak, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
L'amélogenèse imparfaite, anomalie <strong>de</strong> structure, est souvent associée à un retard d´éruption et à<br />
<strong>de</strong>s inclusions multiples formant ainsi un syndrome congénital à caractère familial héréditaire.<br />
L'altération esthétique peut être très importante et très préjudiciable avec <strong>de</strong>s répercussions<br />
psychologiques non négligeables. De ce fait les restaurations esthétiques revêtent une importance<br />
particulière pour une meilleure intégration sociale <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> ce syndrome.<br />
Dans ce travail, nous présentons les différentes solutions thérapeutiques esthétiques à travers <strong>de</strong>s<br />
cas cliniques.<br />
H4. Traitement <strong>de</strong> la classe I <strong>de</strong> Kennedy associée à une abrasion par la prothèse<br />
composite: à propos d'un cas clinique.<br />
R. Oualha, N. Hassen, A. Amor, A. Achour, N. Douki<br />
Chez l'é<strong>de</strong>nté partiel <strong>de</strong> Classe I <strong>de</strong> Kennedy où il ne persiste sur l'arca<strong>de</strong> que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts<br />
antérieures, on assiste à un phénomène <strong>de</strong> surcharge fonctionnelle. Cette surcharge s'explique<br />
par une occlusion en protrusion recherchant un calage antérieur et un transfert <strong>de</strong>s forces<br />
masticatrices au niveau antérieur.<br />
Le résultat <strong>de</strong> cette surcharge serait, dans le cas d'un parodonte résistant, une abrasion localisée<br />
au niveau incisivo-canin qui peut être accompagnée d'une diminution <strong>de</strong> la dimension verticale<br />
d'occlusion (DVO) avec tendance à la propulsion mandibulaire.<br />
La réhabilitation prothétique dans ces cas se fait par la prothèse composite qui consiste à<br />
redonner ne morphologie correcte aux <strong>de</strong>nts abrasées par la prothèse fixée et sur laquelle sera<br />
intégrée la prothèse amovible remplaçant les <strong>de</strong>nts absentes<br />
On essayera, à travers ce travail, <strong>de</strong> présenter les objectifs du traitement, et <strong>de</strong> détailler les étapes<br />
<strong>de</strong> réalisation prothétique et son intégration esthétique et fonctionnelle.<br />
H5. Choix <strong>de</strong>s extractions <strong>de</strong>ntaires en prothèse partielle amovible<br />
A. Labidi, B. Mogaâdi, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Lors <strong>de</strong> la réalisation d'une prothèse partielle amovible, on est souvent confronté au dilemme<br />
d'extraire ou <strong>de</strong> conserver <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts.<br />
Face à cette hésitation, certaines considérations, aussi bien prothétiques que pathologiques,<br />
doivent être prises en compte.<br />
A travers ce travail, nous allons présenter les indications d'extraction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts lors <strong>de</strong> la prise en<br />
charge <strong>de</strong>s patients é<strong>de</strong>ntés partiels.<br />
I1. Réhabilitation prothétique d'un é<strong>de</strong>nté partiel présentant une abrasion généralisée<br />
S. Bouraoui, C. Baccouche, R. Bibi, L. Ajina, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Traditionnellement, le terme abrasion est utilisé pour décrire une perte pathologique <strong>de</strong>s tissus<br />
<strong>de</strong>ntaires d'origine non carieuse. Cette perte pose un problème lorsque le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction<br />
<strong>de</strong>s tissus <strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong>vient excessif et provoque <strong>de</strong>s doléances d'ordre fonctionnel et esthétique.<br />
La restauration par prothèse partielle amovible a toujours été confrontée à <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong><br />
conception et <strong>de</strong> réalisation, liées à son amovibilité et à la dualité tissulaire <strong>de</strong>s structures d'appui.<br />
Lorsqu'elle est associée à <strong>de</strong>s abrasions, le tableau clinique est plus sombre et le traitement est<br />
plus complexe.<br />
A travers un cas clinique présentant un é<strong>de</strong>ntement partiel avec <strong>de</strong>s abrasions généralisées, une<br />
altération <strong>de</strong>s courbes fonctionnelles et du plan d'occlusion, une conservation <strong>de</strong> la DVO et<br />
diminution <strong>de</strong> la HOPU, nous proposons une réhabilitation occluso-prothétique par une prothèse<br />
composite maxillaire et mandibulaire pour un résultat thérapeutique optimal.<br />
- 46 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
I2. Les couronnes fraisées anticipées.<br />
S. Bekri, I. Ouni, H. Triki, R. Bibi, I. Farhat, L. Mansour, M. Trabelsi<br />
Les couronnes fraisées anticipées sont <strong>de</strong>s éléments prothétiques conjoints dont les fraisages sont<br />
recouverts <strong>de</strong> résine ; elles sont réalisées lorsque la prothèse adjointe partielle est prévue à terme.<br />
Au cours <strong>de</strong> ce travail, on va présenter les particularités <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> restauration prothétique à<br />
travers un cas clinique.<br />
I3. Hyperplasies et prothèse complète: chirurgie ou mise en condition tissulaire <br />
I. Chouaïeb, J. Jaouadi, K. Masmoudi, I. Ben Jemâa, M. Sellami, K. Chebbi, H. Chraïef,<br />
MA. Bouzidi, M. Majdoub<br />
Les hyperplasies sont <strong>de</strong>s formations fibreuses majoritairement dues au port d'une prothèse <strong>de</strong><br />
conception erronée aboutissant à un collapsus osseux non suivi <strong>de</strong> remaniement muqueux.<br />
Une dimension verticale surévaluée, ou une sur extension <strong>de</strong>s bords prothétiques favorisent<br />
l'apparition <strong>de</strong> ces développements muqueux.<br />
Ces excroissances nécessitent une prise en charge particulière impliquant dans certains cas la<br />
mise en condition tissulaire, dans d'autres cas plus avancés la chirurgie ou voire même les <strong>de</strong>ux.<br />
Comment le praticien doit- il gérer ces problèmes d'hyperplasie <br />
I4. Les doléances médiates en prothèse complète amovible.<br />
I. Ben Jmâa, A. Ben Abdallah, J. Jaouadi, K. Chebbi, M. Majdoub<br />
Le succès final en prothèse totale dépend non seulement <strong>de</strong> la parfaite maîtrise du côté<br />
prothétique, mais aussi <strong>de</strong> l'acceptation ou du refus psychologique <strong>de</strong> la prothèse par le patient,<br />
car une prothèse même parfaite <strong>de</strong>meure considérée comme un corps étrangers.<br />
Dans ce travail nous avons abordé les différentes doléances objectives et subjectives, rencontrées<br />
selon la chronologie <strong>de</strong> leur apparition dans les séances qui suivent la mise en bouche <strong>de</strong>s<br />
prothèses. Puis nous avons recherché et détaillé les causes pour fournir un aménagement sinon<br />
un remè<strong>de</strong>.<br />
I5. Insuffisance <strong>de</strong> l'espace prothétique disponible: conduite à tenir<br />
M. Sellami, J. Jaouadi, K. Masmoudi, H. Chraïef, O. Ben Romdhane, M. Majdoub<br />
L'espace prothétique disponible est la mi-distance entre 2 crêtes é<strong>de</strong>ntées antagonistes, c'est<br />
l'espace dans lequel viendra s'inscrire la prothèse et doit être suffisant pour recevoir la résine et<br />
les <strong>de</strong>nts prothétiques.<br />
Dans les cas ou cet espace se trouve réduit, on peut avoir recours à <strong>de</strong>s solutions prothétiques en<br />
intervenant sur l'épaisseur <strong>de</strong> la résine et la morphologie <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts, sans pour autant empiéter sur<br />
l'aspect biomécanique et esthétique <strong>de</strong> la restauration prothétique.<br />
Ce travail vise a solutionner le problème d'insuffisance d'espace inter crêtes sans faire appel a la<br />
chirurgie.<br />
Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> Communautaire<br />
J1. Les orthèses d'avancée mandibulaire: moyens <strong>de</strong> traitement du syndrome<br />
d'apnée du sommeil.<br />
M. Khemiss, R. Chebbi, M. Dhidah<br />
«Le syndrome d'apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par un arrêt du flux<br />
respiratoire (apnée) ou sa diminution (hypopnée)». Il s'agit d'une pathologie <strong>de</strong> plus en plus<br />
fréquente ce qui en fait un problème majeur <strong>de</strong> santé publique. Le diagnostic repose sur la<br />
confrontation <strong>de</strong> signes cliniques et d'enregistrements polygraphiques.<br />
Les orthèses d'avancée mandibulaire sont proposées pour compléter ou remédier aux<br />
inconvénients <strong>de</strong> la ventilation par pression positive continue, traitement <strong>de</strong> référence du syndrome<br />
d'apnée du sommeil actuellement.<br />
- 47 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Ce travail se propose <strong>de</strong> présenter les situations cliniques pour lesquelles ces gouttières ont<br />
montré un effet positif. D'autre part, on va comparer les avantages et les inconvénients <strong>de</strong>s<br />
différentes familles <strong>de</strong> gouttières proposées aux patients et ce dans le but d'orienter au mieux le<br />
choix <strong>de</strong>s praticiens prescripteurs, bien que la gouttière idéale pour traiter le syndrome d'apnée du<br />
sommeil n'existe toujours pas.<br />
J2. Audit <strong>de</strong>s pratiques d'hygiène en milieu <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>ntaires dans la région <strong>de</strong> Bizerte.<br />
S. Arfaoui, R. Hamza, H. Kammoun, F. Maâtouk<br />
Introduction: Le contrôle du risque infectieux en milieu <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>ntaires doit être une priorité<br />
institutionnelle, c'est une obligation déontologique, morale et juridique <strong>de</strong> prodiguer <strong>de</strong>s soins dans<br />
<strong>de</strong> bonnes conditions d'hygiène <strong>de</strong> manière à réduire le risque infectieux. Notre objectif est<br />
d'appréhen<strong>de</strong>r la perception <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Bizerte <strong>de</strong>s risques infectieux<br />
associés aux soins et d'évaluer leurs pratiques.<br />
Matériel et métho<strong>de</strong>s: nous avons réalisé un audit <strong>de</strong>s pratiques dans les unités <strong>de</strong> soins<br />
<strong>de</strong>ntaires publiques et les cabinets <strong>de</strong>ntaires privés <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Bizerte, Il a été procédé par<br />
observation et entretien et une grille conçue pour les besoins <strong>de</strong> l'audit a servi <strong>de</strong> support <strong>de</strong><br />
recueil <strong>de</strong>s données .Le logiciel Epi-Info Version 6.04 a été utilisé pour la saisie et l'analyse <strong>de</strong>s<br />
données.<br />
Résultats: L'audit <strong>de</strong>s pratiques a été conduit au niveau <strong>de</strong> 16 unités <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>ntaires publiques<br />
et 46 cabinets <strong>de</strong>ntaires privés. Le taux global <strong>de</strong> conformité moyen <strong>de</strong> toute la rubrique "Pratiques<br />
d'hygiène" est <strong>de</strong> 44,5% avec <strong>de</strong>s extrêmes <strong>de</strong> 3,4% et 76,6%.<br />
Recommandations - Conclusion: Tenant compte <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, la première <strong>de</strong><br />
son genre à notre connaissance dans la région <strong>de</strong> Bizerte, nous avons soumis aux responsables<br />
régionaux <strong>de</strong> la santé <strong>de</strong>s recommandations en vue d'améliorer la situation en matière d'hygiène<br />
et <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong>ntaires dans la région.<br />
J3. Perception et évaluation <strong>de</strong>s connaissances en biostatistiques et <strong>de</strong> la<br />
compréhension <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s articles scientifiques chez les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes<br />
<strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca.<br />
Z. Abidine, Z. Seghier, F. Bourzgui, M.O. Bennani<br />
Contexte: La principale source <strong>de</strong>s nouvelles connaissances pour les mé<strong>de</strong>cins, sont les résultats<br />
<strong>de</strong> la recherche médicale publiés dans <strong>de</strong>s revues scientifiques professionnelles. On sait peu au<br />
sujet <strong>de</strong> la compréhension <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s statistiques et <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s articles scientifiques<br />
parmi les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> Casablanca, Maroc.<br />
Objectif: Evaluer le niveau <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong>s analyses biostatistiques et <strong>de</strong> la<br />
compréhension <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s articles scientifiques chez les mé<strong>de</strong>cins internes, rési<strong>de</strong>nts,<br />
spécialistes et les professeures <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca, Maroc.<br />
Schémas et population <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>: Notre enquête a porté sur l'ensemble <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins internes,<br />
rési<strong>de</strong>nts, spécialistes ainsi que l'ensemble du corps professoral <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca, Maroc.<br />
Critère <strong>de</strong> jugement principal: Le pourcentage <strong>de</strong>s bonnes réponses sur le test à choix multiples<br />
sur les connaissances en biostatistiques.<br />
Résultats: 79 participants ont répondu à notre questionnaire, 94% <strong>de</strong>s participants étaient<br />
d'accord ou complètement d'accord sur la nécessité <strong>de</strong> connaître les statistiques pour une lecture<br />
intelligente <strong>de</strong> la littérature médicale. 90% d'entre eux voudraient apprendre plus <strong>de</strong> biostatistiques<br />
et seulement 5% ne faisaient pas confiance aux statistiques. La moyenne du pourcentage <strong>de</strong><br />
réponse correcte par personne était <strong>de</strong> 19,4 %. Le pourcentage <strong>de</strong> réponse le plus important était<br />
enregistré pour la connaissance <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s cas-témoins 38,27% [IC 95%, 27,69-49,74]. Le<br />
pourcentage le moins important était <strong>de</strong> 2,47% [IC 95%, 0,30-8,64] <strong>de</strong>s participants capables<br />
d'i<strong>de</strong>ntifier une régression <strong>de</strong> Cox. Les années d'étu<strong>de</strong>s après l'obtention du doctorat en mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong>ntaire et le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s participants étaient significativement corrélées aux connaissances en<br />
biostatistiques.<br />
Discussion et Conclusion: Le niveau faible <strong>de</strong>s connaissances en biostatistiques et le besoin <strong>de</strong><br />
développer les programmes <strong>de</strong> résidanat dans ce domaine afin <strong>de</strong> satisfaire les besoins <strong>de</strong>s<br />
- 48 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
mé<strong>de</strong>cins en matière <strong>de</strong> recherche étaient les principales conclusions <strong>de</strong> cette évaluation.<br />
L'implication <strong>de</strong> ces résultats dans la pratique <strong>de</strong> l'Odontologie Basée sur les Preuves (EBD) à la<br />
faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca sera discutée.<br />
J4. Solutions proposées aux étudiants <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire<br />
<strong>de</strong> <strong>Monastir</strong> pour gérer leur stress.<br />
T. El Ouni, R. Chebbi, M. Khemiss, M. Dhidah<br />
L'étudiant en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire est considéré travailler dans un environnement stressant ce qui<br />
peut altérer sa santé physique et mentale et par conséquent son ren<strong>de</strong>ment académique.<br />
Cette présentation propose les résultats d'une enquête épidémiologique menée auprès <strong>de</strong>s<br />
étudiants <strong>de</strong> 4ème et 5ème année <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, où nous avons<br />
proposé aux étudiants un questionnaire regroupant <strong>de</strong>s solutions susceptibles d'alléger ou<br />
soulager leur stress.<br />
Ces solutions proposées sont réparties en quatre dimensions, intéressant «la faculté et son<br />
organisation», «l'enseignement et les examens», «la clinique <strong>de</strong>ntaire» et enfin «la vie <strong>de</strong> l'étudiant<br />
en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s».<br />
Les solutions retenues par la majorité <strong>de</strong>s étudiants sont: la nécessité d'avoir un affichage adéquat<br />
en temps et en endroit (note, annulation <strong>de</strong> cours, changement d'emploi…), la fourniture <strong>de</strong><br />
polycopiés <strong>de</strong> cours et <strong>de</strong> supports numériques avant les séances, l'aménagement <strong>de</strong>s services<br />
cliniques pour les adapter aux besoins et l'amélioration <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong>s cités universitaires.<br />
Par ailleurs, d'autres solutions ont été proposées par les étudiants.<br />
J5. Validation <strong>de</strong> la version française du Dental Environment Stress Questionnaire (DES)<br />
auprès <strong>de</strong>s étudiants <strong>de</strong> la Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> <strong>de</strong> Casablanca.<br />
M. Bellamine, Z. Bentahar, Z. Seghier, C. Nabet, JN. Vergnes<br />
Le stress chez les étudiants en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire a fait l'objet d'étu<strong>de</strong>s sérieuses <strong>de</strong>puis les<br />
années 1970; l'initiative d'évaluation du stress dans notre contexte marocain est une première. Le<br />
Dental Environment Stress (DES) constitue l'outil <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> stress; toutefois, le<br />
DES, dans sa version originale <strong>de</strong> Garbee et al. (1980) est en langue anglaise.<br />
Objectif: Traduire en langue française le DES, étudier sa fiabilité et tester la validité <strong>de</strong> sa<br />
structure factorielle.<br />
Métho<strong>de</strong>s: La traduction <strong>de</strong>s 38items du questionnaire et l'adaptation a été obtenue en utilisant la<br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> traduction contre-traduction qui a permis d'obtenir un consensus entre la version<br />
originale et traduite. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> validation impliquait 161 étudiants <strong>de</strong>s 4éme et 5éme années (âge<br />
moyen 21,97 ans ± 0,93) <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> Casablanca. Les mesures <strong>de</strong> la<br />
cohérence interne ainsi qu'une analyse en composante principale ont été réalisé.<br />
Résultats: la cohérence interne était bonne avec <strong>de</strong>s coefficients α supérieurs à 0,6; exception<br />
faite <strong>de</strong> la dimension relative à l'i<strong>de</strong>ntité professionnelle, où α est <strong>de</strong> 0,51. Le coefficient α <strong>de</strong><br />
Cronbach du score global du DES est <strong>de</strong> 0,8. L'analyse factorielle supporte une structure à 4<br />
facteurs au lieu d'une structure à 5 facteurs, tel que dans la version originale.<br />
Conclusion: dans sa version française, le DES a révélé <strong>de</strong>s propriétés psychométriques<br />
satisfaisantes s'accordant avec la version en Anglais. Finalement, cet outil serait très pertinent<br />
pour les recherches futures dans le domaine du stress en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire dans un échantillon<br />
francophone.<br />
Mots clés: Etudiants en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire, stress, DES questionnaire, validation.<br />
K1. Dents surnuméraires: Aspects clinique et approche thérapeutique.<br />
A. Mliki, K. Mziou, A. Amri, S. Boukhris<br />
La <strong>de</strong>nt surnuméraire est une anomalie <strong>de</strong> nombre, plus fréquente en <strong>de</strong>nture permanente qu'en<br />
<strong>de</strong>nture temporaire. Elle se situe la plupart du temps dans la région incisive du maxillaire<br />
supérieur. La <strong>de</strong>nt surnuméraire revêt une gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong> formes. Elle peut se manifester <strong>de</strong><br />
différentes façons: <strong>de</strong> la plus évi<strong>de</strong>nte (<strong>de</strong>nt sur l'arca<strong>de</strong>) à la moins soupçonnée (<strong>de</strong>nt incluse).<br />
Très souvent, elle fera l'objet d'une découverte fortuite à la radiographie.<br />
Les radiographies prises sous plusieurs inci<strong>de</strong>nces sont <strong>de</strong>s documents indispensables à<br />
- 49 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
l'établissement d'un diagnostic puis à la prise d'une décision thérapeutique qui peut soit être<br />
l'abstention thérapeutique, soit l'extraction suivie, dans certains cas, d'un traitement orthodontique.<br />
K2. Prise en charge <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> nombre: A propos <strong>de</strong> quelques cas<br />
I. Jebli, R. Ben Gabsia<br />
La prise en charge <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong>ntaires doit être la plus précoce possible afin d'intercepter les<br />
complications <strong>de</strong>ntaires et malocclusions pouvant résulter <strong>de</strong> telles anomalies. Elle comportera<br />
<strong>de</strong>s solutions thérapeutiques adaptées à chaque situation afin d'accompagner la croissance<br />
jusqu'à l'âge adulte, où le recours à l'implantologie et <strong>de</strong>s solutions prothétiques définitives pourra<br />
être envisagé. Ainsi l'objectif est <strong>de</strong> préserver le capital <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> l'enfant tout en préservant les<br />
options prothétiques futures. Comment faire un choix avisé <strong>de</strong>s examens radiologiques<br />
nécessaires à l'établissement du diagnostic et du plan <strong>de</strong> traitement L'approche thérapeutique<br />
<strong>de</strong>s cas d'anomalies <strong>de</strong> nombre implique une coordination <strong>de</strong>s traitements orthodontiques,<br />
chirurgicaux et prothétiques.<br />
K3. Le mésio<strong>de</strong>ns: Importance du diagnostic précoce.<br />
K. Mziou, A. Mliki, A. Amri, S. Boukhris<br />
Les mesio<strong>de</strong>ns sont les <strong>de</strong>nts surnuméraires les plus courantes. Le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste <strong>de</strong>vrait en<br />
connaître les signes et les symptômes, ainsi que les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitement adéquates.<br />
Dans ce travail, nous décrivons les différentes formes <strong>de</strong> mesio<strong>de</strong>ns ainsi que les moyens <strong>de</strong><br />
diagnostic clinique et radiologique correspondants et nous insistons en particulier sur l'importance<br />
du diagnostic précoce.<br />
Les mesio<strong>de</strong>ns peuvent entraîner une éruption retardée ou ectopique <strong>de</strong>s incisives permanentes,<br />
ce qui altère davantage l'occlusion et l'esthétique.<br />
Le diagnostic précoce est donc très important. Il minimise le traitement et évite l'apparition <strong>de</strong><br />
problèmes connexes. L'extraction du mesio<strong>de</strong>ns dans les premiers sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la <strong>de</strong>ntition mixte<br />
peut faciliter l'éruption spontanée et l'alignement <strong>de</strong>s incisives, tout en réduisant les interventions,<br />
la perte d'espace et la déviation médiane.<br />
K4. Exercice pluridisciplinaire versus exercice par service cloisonné:<br />
Proposition au CCTD.<br />
F.E. Amzyl, F.Z. Mahdoud, M. Hamza, A. Bennani<br />
Une formation clinique <strong>de</strong>vrait mettre l'accent sur les informations essentielles et les<br />
compétences qui sont immédiatement utilisables pour la prestation <strong>de</strong> services <strong>de</strong> haute qualité.<br />
Une telle formation implique le transfert aux stagiaires <strong>de</strong>s connaissances, <strong>de</strong>s comportements et<br />
<strong>de</strong>s compétences voulus par un formateur clinique expert.<br />
L'objectif <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est d'évaluer la formation clinique du Centre <strong>de</strong> Consultations et<br />
Traitements <strong>Dentaire</strong>s (CCTD) au CHU Ibn Rochd <strong>de</strong> Casablanca.<br />
A travers notre enquête <strong>de</strong>scriptive transversale, on a interrogé 106 lauréats <strong>de</strong> la Faculté<br />
<strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> <strong>de</strong> Casablanca (FMDC): Des étudiants en instance <strong>de</strong> thèse <strong>de</strong> l'année<br />
2010-2011, <strong>de</strong>s internes et rési<strong>de</strong>nts du CCTD en exercice pendant l'année 2010-2011 et <strong>de</strong>s<br />
praticiens du secteur libéral <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Casablanca installés entre l'année 2005 et 2010.<br />
Parmi les résultats les plus importants:<br />
79.3% <strong>de</strong>s lauréats constatent que la formation reçue au CCTD les a moyennement préparés à<br />
l'exercice libéral, seulement 35% <strong>de</strong>s lauréats adhèrent à une formation continue.<br />
A la lumière <strong>de</strong> notre travail sont apparus <strong>de</strong>s points forts qu'il faut capitaliser et <strong>de</strong>s points faibles<br />
qu'il faut corriger, suite auxquels un plan d'action, basé sur l'apprentissage par résolution <strong>de</strong><br />
problème et l'enseignement pluridisciplinaire, a été proposé à la direction du CCTD.<br />
K5. Prévalence <strong>de</strong>s symptômes <strong>de</strong>s désordres cranio-mandibulaires dans une population<br />
entre 19 et 35 ans. Casablanca - Maroc<br />
F.E. Boucetta, F.E. Amzyl, E. Jouhadi, A. Andoh<br />
Un désordre cranio-mandibulaire (DCM) est l'expression symptomatique d'une myoarthropathie <strong>de</strong><br />
- 50 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
l'appareil manducateur. Ce terme englobe <strong>de</strong>s anomalies anatomiques, histologiques et<br />
fonctionnelles du système musculaire et/ou articulaire, ainsi que les structures associées qui<br />
s'accompagne <strong>de</strong> signes cliniques et <strong>de</strong> symptômes très variés.<br />
Beaucoup d'étu<strong>de</strong>s épidémiologiques se sont intéressées aux DCM et ce sur le plan mondial. Or,<br />
malgré la littérature abondante qui traite <strong>de</strong>s DCM, ils restent sujets à <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s controverses.<br />
Cette étu<strong>de</strong> vient alors pour relever la prévalence <strong>de</strong>s DCM dans une population d'adultes jeunes<br />
marocains consultant ou traitant au centre <strong>de</strong> consultation et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>ntaires du CHU Ibn<br />
Rochd à Casablanca. Cette enquête épidémiologique a ainsi pour objectif principal <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s<br />
résultats sur les symptômes les plus évoqués et les étiologies les plus incriminées pour pouvoir les<br />
exploiter après dans d'autres étu<strong>de</strong>s afin d'établir un diagnostic précis, un protocole <strong>de</strong> traitement<br />
et dans les meilleurs <strong>de</strong>s cas prévenir ces symptômes. Ces résultats qui, comparés et intégrés aux<br />
données <strong>de</strong> la littérature, peuvent être utiles pour créer une base <strong>de</strong> données nationale <strong>de</strong><br />
référence ainsi que mondiale et permettre une comparaison <strong>de</strong>s résultats sur le plan international.<br />
Le travail mené est une enquête <strong>de</strong> type transversale à visée <strong>de</strong>scriptive et analytique, menée<br />
entre 2009 et 2011, réalisée sous forme <strong>de</strong> questionnaire auprès <strong>de</strong> 70 patients (49 femmes et 21<br />
hommes) dont l'âge varie entre 19 et 35 ans.<br />
• Cette prévalence était <strong>de</strong> 71,4% pour le nombre total <strong>de</strong> la population.<br />
• Ce pourcentage diminuait avec l'âge pour marquer 72% chez les patients entre 19 et 26ans<br />
et 30% chez la population entre 27 et 35 ans.<br />
• Les symptômes rapportés par les patients se présentaient sous forme <strong>de</strong> bruits articulaires<br />
dans 31,4% <strong>de</strong>s cas, <strong>de</strong> douleurs chez 10% <strong>de</strong>s patients, <strong>de</strong> rai<strong>de</strong>ur/fatigue musculaire dans<br />
7,14% <strong>de</strong>s cas et <strong>de</strong> troubles <strong>de</strong> mouvement mandibulaire chez 5,71% <strong>de</strong> la population.<br />
• Les symptômes relevés à travers l'examen clinique (appelés autrement signes cliniques <strong>de</strong><br />
DCM) marquaient un pourcentage <strong>de</strong> 44,28% pour les troubles <strong>de</strong> mouvement mandibulaire,<br />
18,57% <strong>de</strong> sensibilité à la palpation <strong>de</strong>s muscles masticateurs, 11,43% <strong>de</strong> bruits articulaires,<br />
10% <strong>de</strong> douleur et 5,71% <strong>de</strong> sensibilité à la palpation <strong>de</strong>s ATM.<br />
• Aucune différence n'a été enregistrée entre les <strong>de</strong>ux sexes (71,4%). Cependant, la<br />
prévalence <strong>de</strong> la douleur était plus marquée chez les femmes (14,9%) que chez les hommes<br />
(0%).<br />
• Les étudiants se présentaient parmi les catégories socioprofessionnelles les plus touchées<br />
avec un pourcentage <strong>de</strong> 72,4%.<br />
• L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> risque en rapport avec les DCM a révélé qu'aucun <strong>de</strong>s facteurs<br />
étudiés n'est significativement lié aux DCM sauf le facteur génétique pour lequel une<br />
corrélation positive a été retrouvée.<br />
La recherche actuelle a fourni <strong>de</strong>s résultats très utiles pour les références nationales et<br />
internationales. Toutefois, d'autres investigations sont nécessaires afin <strong>de</strong> définir la prévalence <strong>de</strong>s<br />
symptômes les plus évoqués et d'éluci<strong>de</strong>r les facteurs étiologique influençant l'apparition <strong>de</strong> ces<br />
symptômes à travers le mon<strong>de</strong>.<br />
Odontologie Conservatrice & Endodontie<br />
L1. La réparation <strong>de</strong>s restaurations antérieures en résine composites, comment s'y<br />
prendre <br />
A. Oueslati, N. Aguir, R. Mabrouk, L. Bhouri, MS. Belkhir<br />
La détérioration d'anciennes restaurations antérieures à base <strong>de</strong> résine composite est un motif <strong>de</strong><br />
consultation très fréquent en <strong>de</strong>ntisterie restauratrice . La reprise <strong>de</strong> carie à l'interface<br />
<strong>de</strong>nt/restauration, la fracture <strong>de</strong> la restauration, un changement progressif <strong>de</strong> la teinte, une<br />
restauration mono-couche qui manque <strong>de</strong> translucidité sont autant <strong>de</strong> causes qui incitent <strong>de</strong>s<br />
patients soucieux à consulter. Deux options thérapeutiques existent soit que la restauration doit<br />
être complètement remplacée, ou qu'elle peut être réparée. Les restaurations reproduisant<br />
convenablement la forme <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt à restaurer et présentant un défaut <strong>de</strong> teinte ,une infiltration<br />
marginale peuvent ne pas être reprises mais réparées.<br />
La réparation <strong>de</strong> restaurations en résine composite exige une procédure adhésive adapté et une<br />
technique rigoureuse . A ce propos, certains auteurs recomman<strong>de</strong>nt l'usage d'adhésif MR3( gold<br />
standard); Dans un soucis <strong>de</strong> simplification un adhésif MR2 peut être aussi performant.<br />
Il a été démontré qu'un que les systèmes adhésifs automordançants sont plus susceptibles<br />
- 51 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
d'entraîner <strong>de</strong>s colorations marginales et que même l'utilisation d'un mordançage préalable à<br />
l'adhésif Auto mordançant n'a pas conclu à l'amélioration <strong>de</strong> l'adaptation marginale et à la<br />
diminution <strong>de</strong>s colorations marginales.<br />
Les résidus <strong>de</strong> solvant dans l'adhésif peuvent perturber la polymérisation provoquant <strong>de</strong>s<br />
porosités. La persistance <strong>de</strong> couche trop épaisse d'adhésif sera plu sensible à la détérioration du<br />
joint .Un séchage diffus et progressif est donc indispensable. Il facilite l'évaporation du solvant et<br />
diminue l'épaisseur <strong>de</strong> la couche adhésive. La stratification anatomique du composite doit<br />
permettre <strong>de</strong> placer un dégradé <strong>de</strong> teintes Dentines et d' émail recouvrant le biseau qui constitue<br />
la zone <strong>de</strong> transition entre l'émail et la restauration.<br />
L2. Hypominéralisation <strong>de</strong>s incisives (MIH): éventualités thérapeutiques: à propos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux cas.<br />
I. Echerni, N. Aguir, W. Houidi, L. Ben Krima, MS. Belkhir<br />
Dans le cadre du syndrome MIH: Hypominéralisation <strong>de</strong>s incisives et <strong>de</strong>s molaires définitives, les<br />
<strong>de</strong>nts atteintes présentent différentes colorations selon l'intensité <strong>de</strong> l'atteinte. Cette pathologie<br />
entraine <strong>de</strong> multiples répercussions esthétiques et fonctionnelles (hypersensibilité, lésions<br />
carieuses ...) et constitue une cause fréquente <strong>de</strong> consultation. Au niveau <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts antérieures,<br />
les lésions se traduisent généralement par <strong>de</strong>s tâches opaques touchant <strong>de</strong>s zones plus au moins<br />
étendues.<br />
Pour traiter ces tâches, les techniques les plus utilisées sont la microabrasion amélaire pour les<br />
lésions peu sévères et la restauration à la résine composite pour les lésions profon<strong>de</strong>s avec ou<br />
sans pertes <strong>de</strong> substances. D'autres techniques dites plus sécurisantes ont été proposées ces<br />
<strong>de</strong>rnières années dans <strong>de</strong>s tentatives individuelles. Certains auteurs parlent <strong>de</strong> la possibilité<br />
d'utiliser la résine infiltrante pour masquer les opacités. D'autres ont proposé la combinaison du<br />
peroxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbami<strong>de</strong> à 20 % et du GC tooth mousse (phosphopepti<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la caseïnephosphate<br />
<strong>de</strong> calcium amorphe) utilisée sur une longue pério<strong>de</strong> (5 mois). Mais pour standardiser<br />
ces techniques, beaucoup d'investigations restent nécessaires.<br />
Dans ce travail, <strong>de</strong>ux alternatives thérapeutiques seront décrites et illustrées à travers <strong>de</strong>ux cas<br />
cliniques.<br />
L3. Restauration coronaire fibrée <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt dépulpée.<br />
A. Kikly, E. Hidoussi, J. Ben Ammar, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
Introduction: La <strong>de</strong>nt dépulpée présente fréquemment une perte tissulaire importante nécessitant<br />
l'emploi d'un ancrage radiculaire pour la rétention du matériau <strong>de</strong> restauration. Grâce à<br />
l'amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s systèmes adhésifs, ces restaurations, associant un tenon<br />
fibré (fibres <strong>de</strong> verre ou <strong>de</strong> quartz) et une résine composite, apparaissent comme une alternative<br />
intéressante lorsque l'indication est bien posée.<br />
Objctif: L'objectif <strong>de</strong> ce travail est d'illustrer, à travers <strong>de</strong>ux cas cliniques les différentes étapes<br />
cliniques d'une restauration corono-radiculaire fibrée en mettant l'accent sur les précautions à<br />
respecter pour un collage réussi.<br />
Observation:<br />
• Ces restaurations fibrées nécessitent l'emploi <strong>de</strong> la digue pour optimiser le collage<br />
• La longueur du tenon doit être choisie en fonction <strong>de</strong> l'anatomie canalaire (avant la courbure).<br />
• Une restauration corono-radiculaire fibrée permet une économie tissulaire ou le collage permet<br />
d'obtenir un joint étanche et présente l'avantage <strong>de</strong> former une entité homogène. Cela permet<br />
un renforcement <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong>ntaires restantes et une répartition <strong>de</strong>s contraintes à<br />
l'ensemble <strong>de</strong> l'organe <strong>de</strong>ntaire, plus favorable à une meilleure résistance à la fracture.<br />
• Ce type <strong>de</strong> restauration repousse plus loin les restaurations prothétiques conventionnelles qui<br />
resteront <strong>de</strong>s solutions ultérieures.<br />
Conclusion:<br />
Les reconstitutions fibrées s'inscrivent dans le cadre <strong>de</strong> la <strong>de</strong>ntisterie conservatrice adhésive, plus<br />
respectueuse <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong>ntaires résiduelles ou le collage est optimisé par une isolation<br />
parfaite (mise en place <strong>de</strong> la digue) ainsi qu'une visualisation <strong>de</strong>s structures collées.<br />
- 52 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
L4. Approche clinique <strong>de</strong> la stratification antérieure <strong>de</strong>s résines composites.<br />
E. Hidoussi, A. Kikly, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
Introduction: Les restaurations antérieures directes en résine composite par la technique <strong>de</strong><br />
stratification ont connu un développement important ces <strong>de</strong>rnières années en raison <strong>de</strong> progrès<br />
importants au niveau <strong>de</strong>s propriétés mécaniques mais surtout optiques <strong>de</strong>s résines composites.<br />
Objectif: Le but <strong>de</strong> notre travail est d'illustrer à travers quelques cas cliniques le protocole<br />
opératoire <strong>de</strong> la stratification antérieure <strong>de</strong>s résines composites.<br />
Observations cliniques:<br />
• La restauration nécessite la mise en place d'un champ opératoire (digue) en dégageant<br />
toutes les <strong>de</strong>nts antérieures.<br />
• La réussite <strong>de</strong> cette technique se base essentiellement sur une bonne lecture <strong>de</strong> la<br />
macrogéographie et sur la détermination <strong>de</strong>s 5 dimensions <strong>de</strong> la couleur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt<br />
(chromaticité, luminosité, les intensifs, les opalescents et les caractérisations.<br />
• Le support <strong>de</strong> la stratification est une clef en silicone qui permet la réalisation d'un mur<br />
palatin avec une résine composite <strong>de</strong> teinte émail<br />
• Cette technique propose <strong>de</strong> reconstituer le corps <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt avec <strong>de</strong>s masses <strong>de</strong>ntines plus<br />
ou moins opaques et <strong>de</strong> modifier la luminosité et la saturation avec un émail plus ou moins<br />
transluci<strong>de</strong> en améliorant l'opalescence.<br />
Conclusion:<br />
Cette technique permet <strong>de</strong> reproduire la morphologie <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt tout en garantissant un résultat<br />
esthétique reproduisant l'aspect d'une <strong>de</strong>nt naturelle.<br />
L5. Amelogenesis Imperfecta and kidney <strong>de</strong>ficiency.<br />
N.H. Zorgui, H. Féki, S. Bagga, N. Douki<br />
Background: Amelogenesis imperfecta (AI) is a diverse group of hereditary disor<strong>de</strong>rs that<br />
primarily affect the quantity, structure, and composition of enamel .The inheritance pattern of AI<br />
may be autosomal dominant, autosomal recessive, or X-linked . According to the Witkop<br />
classification system, there are four main forms of AI: type I hypoplastic enamel, type II<br />
hypomatured enamel, type III hypocalcified enamel, and type IV hypomatured-hypoplastic enamel<br />
with taurodontism . Clinical presentation of AI varies consi<strong>de</strong>rably among the different AI types.As<br />
a genomic induced condition,AI may be associated with morphologic and/or biochemical changes<br />
elsewhere in the body.kidney's problems are the most common general condition associated to AI.<br />
Case Observation:<br />
8 years-old boy, kidney-transplanted with type IV AI consulted for multiple teeth restorations.<br />
Physical observation:<br />
8 year old boy with dwarfism rickets, normal weight, slightly hyperactive and normal skin color.<br />
Intra-oral examination:<br />
Mixed <strong>de</strong>ntition with generalized AI with areas of <strong>de</strong>fect in enamel thickness<br />
Treatment plan: Adhesive restorations of all teeth to <strong>de</strong>lay tooth structure further loss till the time<br />
when prosthetic restorations can be applied especially to molars.<br />
Conclusion: AI treatment is always a challenge due to tooth structure <strong>de</strong>fects but it becomes<br />
har<strong>de</strong>r when <strong>de</strong>aling with young children with infectious risk such as our case.<br />
M1. Closure of anterior distemas using direct resin composite technique: case report.<br />
R. Mabrouk, N. Aguir, MS. Belkhir<br />
Aims: This paper reports a case of diastemas closure in anterior teeth that was successfully<br />
treated by direct resin composite technique.<br />
One of the challenges in clinical esthetic <strong>de</strong>ntistry is closing anterior diastemas without creating<br />
'black triangles' between the teeth. The success of a restorative treatment in anterior teeth<br />
<strong>de</strong>pends on the esthetic integration between soft and hard tissues. Restorations inclu<strong>de</strong> two<br />
techniques: bilateral and unilateral techniques. The choice between these techniques <strong>de</strong>pends<br />
- 53 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
principally of esthetic <strong>de</strong>mand of the clinical situation. Usually lateral diastemas could be restored<br />
with the unilateral technique. However, in some cases of large diastemas, bilateral technique<br />
should be indicated for an optimal esthetic result.<br />
M2. Les fistules cutanées d'origine endodontique: A propos d'un cas clinique.<br />
E. Ab<strong>de</strong>lmoumen, S. Zouiten, A. Boughzala<br />
Les fistules cutanées d'origine endodontique sont relativement rares. Elles forment un trajet<br />
sinueux qui s'étend du foyer d'infection <strong>de</strong>ntaire à la face ou au cou.<br />
En fait, ce trajet va suivre le chemin <strong>de</strong> faible résistance pour s'extérioriser et la localisation<br />
dépend <strong>de</strong> la proximité <strong>de</strong> l'apex <strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> l'os cortical et aux insertions musculaires, <strong>de</strong> la<br />
longueur <strong>de</strong> la racine et <strong>de</strong> la morphologie du maxillaire affecté.<br />
Plusieurs étiologies peuvent être à l'origine <strong>de</strong> ces fistules:<br />
• l'abcès péri apical chronique, suite à la nécrose pulpaire constituant la principale étiologie.<br />
• la dégénérescence pulpaire due au traumatisme<br />
• les pathologies parodontales, l'actinomycose....<br />
A travers un cas clinique, nous allons évoquer les éléments diagnostiques et discuter l'attitu<strong>de</strong><br />
thérapeutique non chirurgicale <strong>de</strong>s fistules cutanées d'origine <strong>de</strong>ntaire.<br />
M3. La fracture instrumentale en endodontie: un défi quotidien.<br />
J. Ben Ammar, N. Aguir, MS. Belkhir<br />
Introduction: Lors <strong>de</strong> la préparation canalaire le risque <strong>de</strong> fracture instrumentale est toujours<br />
présent. La présence d'un bris d'instrument risque <strong>de</strong> compromettre la réussite <strong>de</strong> notre traitement.<br />
La possibilité <strong>de</strong> l'extraction d'un instrument fracturé dépend <strong>de</strong> plusieurs facteurs dont les<br />
principaux sont:<br />
• l'anatomie radiculaire (longueur, courbure, épaisseur <strong>de</strong>ntinaire)<br />
• la longueur, le diamètre et la position du fragment.<br />
• Etape <strong>de</strong> la mise en forme atteinte lors <strong>de</strong> la séparation du fragment.<br />
Objectifs: Présenter à travers <strong>de</strong>ux cas cliniques, différentes possibilités <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la fracture<br />
instrumentale en endodontie.<br />
Observation: La fracture instrumentale survenant dans les portions rectilignes <strong>de</strong>s canaux évoque<br />
plutôt <strong>de</strong>s fractures en torsion où le vissage est prépondérant ; ceci est dû le plus souvent à une<br />
contrainte coronaire qui doit être éliminée en utilisant un forêt <strong>de</strong> Gates animé d'un mouvement <strong>de</strong><br />
brossage <strong>de</strong> bas en haut en s'appuyant sur la paroi anti-courbure et qui justifie aussi la libération<br />
du fragment <strong>de</strong>s parois latérales pour faciliter son extraction; L'accès direct et rectiligne au<br />
fragment et le passage à côté <strong>de</strong> celui-ci sont <strong>de</strong>ux préalables indispensables à toute procédure.<br />
La technique consiste à localiser le fragment, à dégager ses lames manuellement <strong>de</strong>s contraintes<br />
<strong>de</strong>ntinaires et à créer une gorge périphérique à l'ai<strong>de</strong> d'un insert ultrasonore utilisé dans le sens<br />
anti-horaire. Cette manœuvre peut aboutir, à elle seule, à l'évacuation du bris d'instrument. En cas<br />
d'échec, elle améliore le pronostic du retrait <strong>de</strong> celui ci grâce à différents systèmes <strong>de</strong> préhension<br />
(Masseran ® , Endo Rescue ® ).<br />
En cas d'impossibilité <strong>de</strong> retrait <strong>de</strong> bris et si la perméabilité apicale est assurée on peut terminer<br />
notre préparation canalaire et obturer le canal tout en enrobant le fragment fracturé dans la gutta.<br />
Ceci n'affecte pas le pronostic <strong>de</strong> notre traitement.<br />
M4. Les facettes composites par technique directe: Utilisation chez un enfant<br />
présentant une amélogenèse imparfaite.<br />
H. Féki, H. Ben Rejeb, I. Kallel, S. Bagga, N. Douki<br />
L'amélogenèse imparfaite est une anomalie <strong>de</strong> structure qui touche l'émail et dont les<br />
répercussions sont multiples: esthétiques, fonctionnelles et psychologiques ; sa prise en charge<br />
chez l'enfant est pluridisciplinaire.<br />
Dans une société qui développe l'importance du paraître, un tel sourire constitue un handicap sur<br />
le plan social et les préjudices psychologiques qui en résultent sont ravageantes, la restauration du<br />
sourire s'impose alors dès le jeune âge.<br />
- 54 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Pour la restauration <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts antérieures, différentes solutions thérapeutiques sont à notre<br />
disposition en fonction du cas clinique.<br />
Chez un enfant, dont le parodonte est immature, les restaurations composites, facilement<br />
réalisables et réadaptables, trouvent tout leurs intérêts.<br />
Le but <strong>de</strong> ce travail est d'illustrer à travers un cas clinique la restauration du sourire par <strong>de</strong>s<br />
facettes en composite par technique directe, nous soulignerons les étapes clés pour avoir un<br />
résultat le plus prédictible possible, tout en respectant les critères biologiques, mécaniques,<br />
fonctionnels et esthétiques.<br />
M5. Dental treatments in patients un<strong>de</strong>rgoing radiotherapy for head and neck cancer<br />
E. Besbes, NH. Zorgui, R. Mabrouk, L. Berrezouga, L. Bhouri, MS. Belkhir<br />
Background: Radiotherapy-induced damage in the oral mucosa is the result of the <strong>de</strong>leterious<br />
effects of radiation, not only on the oral mucosa itself but also on the skin, adjacent salivary glands,<br />
bone, <strong>de</strong>ntition, and masticatory apparatus.<br />
Aim: To perform <strong>de</strong>ntal treatments and evaluate their efficiency in patients irradiated for head and<br />
neck cancer.<br />
Patients studied: Fifteen patients, 9 men and 6 women, aged from 18 to 66 years old were<br />
referred for restorative and endodontic treatments. Ten patients had been already irradiated and 5<br />
were treated before radiotherapy. All patients were followed between 3 and 8 years.<br />
Results: Four patients suffered from xerostomia, 3 from trismus and one from maxillary diffused<br />
osteonecrosis. Among 60 cavities performed, 45 % were restored with composite resin. Thirty<br />
teeth were treated endodontically. Two patients had osteonecrosis after maxillary <strong>de</strong>ntal extraction<br />
and 2 others had complete <strong>de</strong>ntal extractions. All <strong>de</strong>ntate patients use daily application of fluori<strong>de</strong><br />
gel.<br />
Conclusion: Management of irradiated patients with head and neck cancer is challenging and<br />
require a multidisciplinary team. Conservative treatments should be consi<strong>de</strong>red whenever it is<br />
possible.<br />
M6. L'obturation canalaire par le système B.<br />
I. Landolsi, A. Kikly, C. Belkhir, S. Sahtout, MS. Belkhir<br />
Introduction: Le système B, proposé par Buchanan, simplifie le compactage vertical à chaud<br />
proposé par Schil<strong>de</strong>r en restant fidèle aux principes <strong>de</strong> base <strong>de</strong> la technique verticale (choix et<br />
ajustage du maitre cône).<br />
L'objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> présenter, à travers <strong>de</strong>s cas cliniques, le protocole opératoire <strong>de</strong><br />
l'obturation canalaire par le système B ainsi que ses particularités par rapport aux autres<br />
techniques.<br />
Observations: Le maître-cône non standardisé ou <strong>de</strong> conicité majorée doit être bien adapté (tests<br />
tactile et radiologique).<br />
La première phase corono-apicale (<strong>de</strong>scente) assure l'obturation du tiers apical en utilisant le<br />
fouloir adapté et le système B.<br />
La <strong>de</strong>uxième phase apico-coronaire (remontée) assure l'obturation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers coronaires en<br />
utilisant une alternance réchauffement <strong>de</strong> gutta par le heat-carrier et compactage par <strong>de</strong>s fouloirs<br />
verticaux manuels <strong>de</strong> taille croissante.<br />
Discussion: Cette technique assure une excellente distribution tridimensionnelle du matériau<br />
d'obturation surtout lorsqu'elle est associée à une injection <strong>de</strong> gutta.<br />
La phase <strong>de</strong> <strong>de</strong>scente est rapi<strong>de</strong> permettant l'obturation du tiers apical (canal et ramifications).<br />
Conclusion: La technique <strong>de</strong> compactage en vague permet un gain <strong>de</strong> temps considérable. De<br />
plus la température constante du "heat carrier" permet d'obtenir un ramollissement uniforme et sur<br />
toute la longueur du maître cône.<br />
- 55 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Odontologie Pédiatrique & Prévention<br />
O1. Les anomalies <strong>de</strong> forme: gémination et évagination.<br />
A. Béji, I. Mahmoudi, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz, H. Ghédira, F. Maâtouk, A.<br />
Abid<br />
Les anomalies <strong>de</strong> forme sont <strong>de</strong>s dysmorphies touchant aussi bien les <strong>de</strong>nts temporaires que<br />
permanentes.<br />
La conduite à tenir face à ces anomalies dépend <strong>de</strong> plusieurs facteurs tels que le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> la<br />
dysmorphie, la valeur intrinsèque et extrinsèque <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt ainsi que la gêne fonctionnelle et<br />
esthétique.<br />
Nous illustrons notre travail par <strong>de</strong>ux cas cliniques traités dans le service d'Odontologie<br />
Pédiatrique <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>: un cas <strong>de</strong> gémination et un cas d'évagination.<br />
O2. «Odonto-hypophosphatasie», une forme <strong>de</strong> l'hypophosphatasie: à propos d'un cas<br />
clinique.<br />
D. Jarrar, I. Jazi, A. Béji, F. Chouchène, F. Masmoudi, A. Baâziz, F. Maâtouk,<br />
H. Ghédira, A. Abid<br />
L'hypophosphatasie est une maladie héréditaire rare due au déficit ou à l'absence d'activité <strong>de</strong> la<br />
phosphatase alcaline non tissu-spécifique (TNSALP). Elle affecte la minéralisation osseuse et<br />
<strong>de</strong>ntaire et présente une variabilité clinique très importante.<br />
Dans sa forme odontologique appelée aussi « odontophosphatasie», la maladie se traduit par la<br />
chute prématurée <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts et les dosages <strong>de</strong> la phosphatase alcaline chez les patients ne sont<br />
pas toujours abaissés.<br />
Dans ce travail, nous présenterons le cas du patient Rayen. E.A. qui nous à consulté à l'âge <strong>de</strong> 4<br />
ans au service d'odontologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong> pour perte prématuré <strong>de</strong> ses incisives<br />
temporaires sans cause apparente.<br />
L'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen radiologique, et les examens complémentaires nous<br />
ont menés au diagnostic <strong>de</strong> l'odontophosphatasie.<br />
La prise en charge du patient a comporté, <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> caries et une réhabilitation prothétique par<br />
<strong>de</strong>s prothèses partielles amovibles.<br />
Le patient est actuellement âgé <strong>de</strong> 7 ans, et son suivi clinique et radiologique doit être régulier<br />
(tout les quatre mois). A l'âge adulte la pose d'implants pourrait être envisagée.<br />
O3. Le lymphome <strong>de</strong> Burkitt: A propos d'un cas clinique.<br />
F. Chouchène, Y. Elelmi, I. Mahmoudi, D. Jarrar, I. Jazi , F. Masmoudi, A. Baâziz,<br />
H. Ghédira, F. Maâtouk, A. Abid<br />
Le Lymphome <strong>de</strong> Burkitt (LB) est un lymphome malin non hodgkinien (LMNH).<br />
Il s'agit d' une tumeur qui provient <strong>de</strong> l'évolution maligne et <strong>de</strong> la prolifération <strong>de</strong> cellules<br />
lymphoï<strong>de</strong>s <strong>de</strong> type B.<br />
Parmi les étiologies probables les facteurs climatique, viral, parasitaire et chromosomique ont été<br />
évoqués.<br />
Il s'agit <strong>de</strong> la tumeur à la croissance la plus rapi<strong>de</strong> avec un temps <strong>de</strong> doublement cellulaire compris<br />
entre 1 et 2 jours.<br />
C'est la tumeur enfantine la plus courante en Afrique. On le retrouve essentiellement chez les<br />
enfants africains avec un pic <strong>de</strong> fréquence entre 6 et 7 ans, cette maladie touche plus souvent les<br />
garçons que les filles.<br />
Les patients présentant le lymphome <strong>de</strong> Burkitt nécessitent une prise en charge spéciale et<br />
plusieurs précautions sont nécessaires.<br />
Dans ce travail nous proposons <strong>de</strong> vous présenter un cas d'un jeune garçon âgé <strong>de</strong> 11 ans qui<br />
s'est présenté à notre service pour un assainissement <strong>de</strong> la cavité buccale avant la radiothérapie.<br />
- 56 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
O4. Découverte <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts surnuméraires chez un enfant consultant pour une surinfection<br />
kystique: Conduite à tenir.<br />
L. Masmoudi, I. Hachicha, M. Hafdhi, I. Babbou, R. Ayadi<br />
Les <strong>de</strong>nts surnuméraires sont généralement d'origine syndromique (syndrome <strong>de</strong> dysplasie cleidocrânienne,<br />
syndrome <strong>de</strong> Gardner…). Celles non associées à un syndrome sont très rares et leur<br />
découverte est, dans la plupart du temps, fortuite lors d'un examen radiologique.<br />
Dans notre travail, nous rapportons un cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts surnuméraires non syndromique chez un<br />
enfant âgé <strong>de</strong> 13 ans consultant pour une cellulite labiale supérieure en rapport avec l'incisive<br />
centrale maxillaire gauche (21) nécrosée suite à un ancien traumatisme.<br />
L'examen clinique a montré un retard d'éruption <strong>de</strong> l'incisive centrale maxillaire supérieure<br />
droite (11). La radio panoramique a révélé une image kystique en rapport avec la 21, une <strong>de</strong>nt<br />
surnuméraire qui empêche l'éruption <strong>de</strong> la 11 et d'autres <strong>de</strong>nts surnuméraires au niveau <strong>de</strong>s<br />
régions prémolaires.<br />
L'attitu<strong>de</strong> thérapeutique a consisté à l'ouverture <strong>de</strong> la 21 associée à une antibiothérapie curative,<br />
l'énucléation du kyste apical après un traitement endodontique <strong>de</strong> la 21, l'extraction <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt<br />
surnuméraire en rapport avec la 11 et le guidage <strong>de</strong> l'éruption <strong>de</strong> la 11 par <strong>de</strong>s meulages sélectifs.<br />
Un contrôle clinique et radiologique étroit a été envisagé.<br />
Ainsi, à travers ce travail, nous insistons sur le rôle du mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>ntiste omnipraticien dans le<br />
dépistage <strong>de</strong> ses lésions, la prise en charge précoce et la collaboration avec les spécialistes pour<br />
éviter <strong>de</strong>s traitements plus lourds.<br />
O5. Mieux connaître ses facteurs <strong>de</strong> risque pour mieux prévenir la carie <strong>de</strong>ntaire.<br />
A. Dridi, Z. Bennour, S. Benkhoud, A. Annabi, M. Jrad<br />
La carie <strong>de</strong>ntaire est une affection due à l'altération <strong>de</strong> l'émail et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>ntine d'une <strong>de</strong>nt<br />
aboutissant à la formation <strong>de</strong> cavité. Certes, la mauvaise hygiène bucco<strong>de</strong>ntaire et les mauvaises<br />
habitu<strong>de</strong>s alimentaires sont les principaux facteurs étiologiques.<br />
Cependant, la santé générale, le niveau socio-économique, les anomalies et les mal positions<br />
<strong>de</strong>ntaires, la salive et beaucoup d'autres facteurs <strong>de</strong> risque sont <strong>de</strong>s déterminants importants.<br />
Donc, la susceptibilité à la survenue <strong>de</strong> la carie et à sa progression est influencée par une<br />
interaction complexe <strong>de</strong> ces facteurs.<br />
Ce travail consiste à analyser les résultats d'une étu<strong>de</strong> statistique menée auprès <strong>de</strong> 483 enfants et<br />
jeunes, entre 1 et18 ans, vue lors d'une journée ouverte <strong>de</strong> dépistage <strong>de</strong> la carie <strong>de</strong>ntaire. Le but<br />
<strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est d'évaluer la prévalence <strong>de</strong> la carie et l'impact <strong>de</strong>s différents facteurs <strong>de</strong> risque.<br />
Les parents ont répondu à un questionnaire détaillé portant sur: l'état général, les niveaux culturel<br />
et socioéconomique, les habitu<strong>de</strong>s alimentaires, le brossage et la fréquence <strong>de</strong> visite chez le<br />
<strong>de</strong>ntiste. Puis <strong>de</strong>s internes en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>ntaire ont pratiqué un examen clinique précis et ont<br />
évalué les facteurs <strong>de</strong> risque directes et indirectes: examen <strong>de</strong> la salive, la respiration, la<br />
déglutition, l'occlusion, les anomalies <strong>de</strong>ntaires, les récessions, les restaurations<br />
défectueuses. ..etc. Enfin, quatre mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>ntistes omnipraticiens ont fait la motivation qui était<br />
individuelle pour chaque cas, visant ses facteurs <strong>de</strong> risques.<br />
L'âge moyen est 8.7, et la prévalence <strong>de</strong> la carie est 43%. Chez les enfants <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 10 ans la<br />
corrélation la plus importante a été observée entre la carie et le régime alimentaire et la plaque<br />
bactérienne. Chez les autres, une corrélation significative a été observée entre la carie et la<br />
métho<strong>de</strong> et la fréquence <strong>de</strong> brossage. D'autres corrélations moins importantes ont été constatées<br />
comme celle avec le niveau socioéconomique, la respiration buccale, la succion du pouce et la mal<br />
position <strong>de</strong>ntaire.<br />
Ainsi, la prévention a dépassé la motivation à l'hygiène et la correction du régime alimentaire pour<br />
viser tous les facteurs <strong>de</strong> risque. En fait, l'évaluation <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers est le garant d'un parfais état<br />
<strong>de</strong> santé bucco-<strong>de</strong>ntaire.<br />
O1. L'hypominéralisation molaire et incisive: à propos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas cliniques.<br />
M. Aïssa-Larousse, R. Ben Gabsia, E. Tourki<br />
L'Hypominéralisation Molaire et Incisive (HMI) est une anomalie <strong>de</strong> la structure amélaire d'origine<br />
systémique, ce défaut <strong>de</strong> l'email peut toucher une à quatre molaires permanentes associée ou non<br />
- 57 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
à une ou plusieurs incisives permanentes.<br />
Ces anomalies amélaires correspon<strong>de</strong>nt à une altération <strong>de</strong> la minéralisation <strong>de</strong> l'email survenant<br />
principalement au cours <strong>de</strong> la première enfance(0 à 4ans) mais la nature <strong>de</strong> ces<br />
trouble n'est pas clairement définie<br />
Il n'existe pas <strong>de</strong>s concepts thérapeutiques généraux et stricts, le praticien rencontre plusieurs<br />
difficultés à savoir la difficulté <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong> l'enfant , les limites <strong>de</strong> la préparation , le<br />
choix du matériaux d'obturation et surtout en cas d'extraction .<br />
Le dépistage précoce et la prise en charge <strong>de</strong> l'enfant est primordial pour limiter les pertes <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>nts et leurs conséquences<br />
Dans ce travail, on vas illustrer <strong>de</strong>ux cas cliniques qui sont venus consulter à notre service<br />
d'Akouda.<br />
O2. La prise en charge <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong>ntaires chez l'enfant<br />
S. Gassara, K. Mziou<br />
La prise en charge <strong>de</strong>s enfants consultant en urgence occupe une place grandissante dans<br />
l'exercice <strong>de</strong> tout chirurgien <strong>de</strong>ntiste. Cette consultation exige <strong>de</strong> celui-ci une gran<strong>de</strong> attention et<br />
vigilance pas toujours facile à définir et donc à gérer.<br />
Afin d'étudier <strong>de</strong> plus prés les situations d'urgences <strong>de</strong>ntaires les plus souvent rencontrées chez<br />
l'enfant et les attitu<strong>de</strong>s adoptées, nous avons mené au service stomatologie <strong>de</strong> c.s.B Riadh <strong>de</strong><br />
Sousse une enquête rétrospective <strong>de</strong>scriptive sur les dossiers d'enfants consultants entre janvier<br />
2011 et janvier 2012 et dont l'âge est inferieur à 15 ans.<br />
Ce travail nous a permis <strong>de</strong> relever les résultats suivants:<br />
• Les situations <strong>de</strong>s urgences les plus rencontrées les infections (30.2%) suivies <strong>de</strong><br />
traumatismes (29.3%)<br />
• En <strong>de</strong>nture temporaire ce sont les infections qui prédominent, alors qu'en <strong>de</strong>nture<br />
permanente, ce sont les traumatismes.<br />
• Les acci<strong>de</strong>nts traumatiques les plus retrouvés en <strong>de</strong>nture temporaires sont luxations (36%)<br />
contre les fractures coronaires (42%) en <strong>de</strong>nture permanente.<br />
Face aux résultats <strong>de</strong> notre enquête, nous pouvons dire que la consultation pédodontique en<br />
urgence se fait tardivement ; et que plusieurs efforts doivent être ménagés pour promouvoir la<br />
qualité <strong>de</strong>s soins.<br />
O3. Manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Fanconi: A propos d'un cas.<br />
R. Ben Gabsia, M. Aïssa-Larousse, I. Jebli<br />
La maladie <strong>de</strong> Fanconi est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive,<br />
caractérisée par <strong>de</strong>s malformations dont les plus fréquentes atteignent la face avec microcéphalie,<br />
les pouces, la peau , le rein et le cœur. La gravité <strong>de</strong> la maladie est liée à l'atteinte hématologique<br />
caractérisée par l'évolution vers une aplasie médullaire progressive et parfois vers une<br />
myélodysplasie ou un cancer.<br />
Selon la littérature, les manifestations bucco-<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Fanconi sont variables à<br />
savoir: <strong>de</strong>ntine pauvrement calcifiée ; émail parfois hypoplasié, chambre pulpaire anormalement<br />
étendu<br />
Il s'agit d'une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>scriptive d'un cas clinique qui s'est présenté à notre service <strong>de</strong> stomatologie<br />
le 06/01/2010 pour soins <strong>de</strong>ntaires.<br />
Le but <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> décrire le cas et d'adapter nos soins selon les données cliniques,<br />
radiologiques et biologiques du cas.<br />
L'examen bucco-<strong>de</strong>ntaire montre:<br />
• une microdontie: <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts petites très fragiles;<br />
• une amelogenèse imparfaite: <strong>de</strong>nts transluci<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coloration brunâtre;<br />
• <strong>de</strong>s pulpes volumineuses anormalement étendues;<br />
• <strong>de</strong>s Caries <strong>de</strong>ntaires et <strong>de</strong>s bouts <strong>de</strong> racines;<br />
• la persistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts temporaires.<br />
- 58 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
O4. Dents natales et néonatales: conduite à tenir.<br />
M. Dami, N. Gharbi, I. Jamazi, MA. Chemli, I. Gharbi, B. Jemmali<br />
Dans <strong>de</strong> nombreuses cultures, les <strong>de</strong>nts natales et néonatales étaient associées à <strong>de</strong>s croyances<br />
superstitieuses.<br />
Aujourd'hui encore, elles sont source d'inquiétu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> frustration chez les parents.<br />
Face à cette situation une bonne évaluation <strong>de</strong>s risques ainsi qu'une démarche diagnostique<br />
codifiée sont garantes <strong>de</strong> la réussite thérapeutique.<br />
Nous présentons, dans ce travail, un cas familial <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts natales.<br />
O5. La prophylaxie en odontologie pédiatrique.<br />
N. Gharbi, M. Dami, I. Jamazi, MA. Chemli, I. Gharbi, B. Jemmali<br />
La prophylaxie, un axe important <strong>de</strong> l'odontologie pédiatrique, permet l'amélioration du niveau <strong>de</strong><br />
conscience <strong>de</strong>s parents par la compliance et le suivi.<br />
Notre rôle est <strong>de</strong> motiver à la régularité <strong>de</strong> prise en charge qui comprend les hygiènes bucco<strong>de</strong>ntaire<br />
et alimentaire, ainsi que l'évaluation <strong>de</strong> l'état bucco-<strong>de</strong>ntaire conséquent.<br />
Nous allons essayer au cours <strong>de</strong> ce travail, d'éluci<strong>de</strong>r les procédés prophylactiques à savoir:<br />
l'usage <strong>de</strong> révélateurs <strong>de</strong> plaque, les tests salivaires… en les illustrant par <strong>de</strong>s exemples réalisés<br />
au service Hospitalo-universitaire <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Dentaire</strong> du CHU La Rabta.<br />
- 59 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Nous remercions particulièrement:<br />
Monsieur le Ministre <strong>de</strong> l'Enseignement Supérieur<br />
et <strong>de</strong> la Recherche Scientifique<br />
Monsieur le Ministre <strong>de</strong> la Santé Publique<br />
Ainsi que les Sociétés et Laboratoires suivants:<br />
• Actualités Médicales<br />
• Adwya<br />
• A.I.D.S<br />
• Alpha Pharma<br />
• Baby World<br />
• BYOS<br />
• Cercina<br />
• Colgate Palmolive<br />
• D.E.X<br />
• Dental Concept<br />
• Distrimed<br />
• Equinox Pharma<br />
• GL Système<br />
• GSK<br />
• HB Pharma - Pierre Fabre<br />
• I 2 S<br />
• I.M.S<br />
• Inter Teknika<br />
• Médical Ad-Tech<br />
• Médis<br />
• Med-Pro Tunisia<br />
• M.H.D<br />
• MOAD - Invisalign<br />
• MSI Sirona<br />
• New-Med<br />
• New-Vision<br />
• Oral-B<br />
• OrthoDental Tunisie<br />
• Pharmamed<br />
• Pimos<br />
• Promes<br />
• Promosciences<br />
• Segeho<br />
• Siphat<br />
• Sphère Médico-<strong>Dentaire</strong><br />
• Star Med<br />
• Teriak<br />
• Toyota<br />
• Tunisie Repco<br />
• Univers Médical<br />
• UPSA<br />
• ZENIT<br />
• Ziness<br />
- 60 -
Vingt-et-unièmes Entretiens Odontologiques <strong>de</strong> <strong>Monastir</strong>, 26-27 avril 2013<br />
Informations Générales<br />
«Hébergement»<br />
Prix par nuitée & par personne<br />
Hôtel Sentido Rosa Beach **** <strong>de</strong> Luxe<br />
Tél.: (+216) 73.520.088 - Fax: 73.520.089<br />
• LPD: Chambre single 75 DT<br />
• LPD: Chambre double 130 DT<br />
• DP: Chambre single 90 DT<br />
• DP: Chambre double 160 DT<br />
Hôtel El Habib <strong>Monastir</strong> ****<br />
Tél.: (+216) 73.466.750 - Fax: 73.466.751<br />
• LPD 42 DT + 10 Suppl. Single<br />
• Demi-Pension 50 DT + 10 Suppl. Single<br />
Hôtel Skanès Sérail ****<br />
Tél.: (+216) 73.52.02.40 - Fax: 73.52.02.34<br />
• LPD: 30 DT PAX/J + 10 DT Suppl. Single<br />
• Demi-Pension: 40 DT PAX/J + 10 DT Suppl. Single<br />
• 3ème personne: 30% Réduction<br />
Hôtel Thalassa <strong>Monastir</strong> *****<br />
Tél.: (+216) 73.520.520 - Fax: 73.520.511<br />
• Chambre single en LPD 86 DT<br />
• Chambre double en LPD 122 DT<br />
• Dîner buffet: 36 DT/PAX<br />
«Inscriptions»<br />
Praticiens:<br />
Rési<strong>de</strong>nts - Internes:<br />
Ateliers:<br />
100 DT<br />
30 DT<br />
30 DT par atelier<br />
Pour tout renseignement, contacter:<br />
Mme Jamila Hassine: (+216) 26.86.87.77<br />
Mr Mokhtar Sghaïer: (+216) 50.56.48.54 & 98.56.48.54<br />
Email: aeom.fmdm@gmail.com<br />
- 61 -