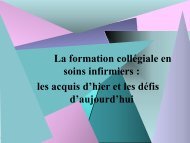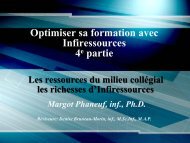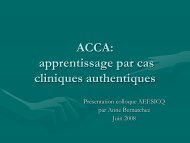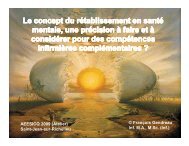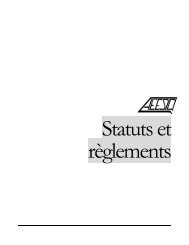Les recommandations canadiennes en soins des plaies et ... - aeesicq
Les recommandations canadiennes en soins des plaies et ... - aeesicq
Les recommandations canadiennes en soins des plaies et ... - aeesicq
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong><br />
<strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> <strong>en</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>plaies</strong> <strong>et</strong> la loi 90<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Juin 2009<br />
Juin 2009<br />
Objectifs de la prés<strong>en</strong>tation<br />
• Cibler les priorités d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
• Déterminer <strong>des</strong> objectifs communs<br />
d’appr<strong>en</strong>tissage<br />
• Échanger sur la formation actuelle <strong>en</strong><br />
<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
• Uniformiser l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>soins</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Plan de la prés<strong>en</strong>tation<br />
• Statistiques <strong>et</strong> mise <strong>en</strong> contexte<br />
• Élém<strong>en</strong>ts de la Loi 90<br />
• <strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>soins</strong> de <strong>plaies</strong><br />
• Le plan thérapeutique<br />
• <strong>Les</strong> priorités d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
• L’outil S.M.A.T.<br />
• Réflexions sur la formation collégiale <strong>en</strong><br />
<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
• Nouveautés <strong>en</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
1
Types de <strong>plaies</strong><br />
Plaie sur insuffisance veineuse<br />
Plaie de pression d’un pied arthritique<br />
Plaie du pied diabétique avec MVAP<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Plaie artérielle<br />
Statistiques (ulcères de pression)<br />
• 60% <strong>des</strong> <strong>plaies</strong> de pression survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />
au cours d’un séjour dans un<br />
établissem<strong>en</strong>t de courte durée<br />
• La plus forte incid<strong>en</strong>ce aux <strong>soins</strong> int<strong>en</strong>sifs<br />
• 70% chez les personnes âgées de plus de<br />
70 ans<br />
• 15-30% chez les personnes souffrant d’un<br />
handicap neurologique (traumatisme<br />
médullaire)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Statistiques (ulcères veineux)<br />
• 300 000 canadi<strong>en</strong>s développeront un ulcère<br />
veineux<br />
• 50% auront un ulcère chronique avec problèmes<br />
récurr<strong>en</strong>ts sur une période de 10 ans<br />
• 30% auront une 4ème récurr<strong>en</strong>ce<br />
• 15-20% ne guériront pas avant 2 ans<br />
• Prédominance de 62% chez les femmes<br />
• Tx de 4 semaines:192 personnes = $1 000 000<br />
<strong>en</strong> <strong>soins</strong> infirmiers <strong>et</strong> $260 000 <strong>en</strong> matériel de<br />
<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
2
Statistiques (ulcères diabétiques)<br />
• Au Québec, il y a près de ½ million de<br />
diabétiques.<br />
• <strong>Les</strong> diabétiques prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t 15 fois plus de<br />
risques de développer un ulcère de jambe que<br />
les non-diabétiques, condition qui les prédispose<br />
à l’amputation.<br />
ti<br />
• 15 % <strong>des</strong> diabétiques développeront un ulcère.<br />
• 85 % <strong>des</strong> amputations sont précédées<br />
d’ulcères de pied.<br />
• De 50 à 60 % <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts amputés d’un membre<br />
inférieur subiront une amputation du membre<br />
opposé dans les 3 à 5 années suivant la première<br />
amputation.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Statistiques (ulcères artériels)<br />
• Une revue Cochrane estime que 25% de<br />
tous les ulcères <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
sont d’origine artérielle.<br />
• Le pot<strong>en</strong>tiel de cicatrisation est<br />
directem<strong>en</strong>t relié au rétablissem<strong>en</strong>t de la<br />
perfusion artérielle.<br />
• Un diagnostic précoce <strong>et</strong> de bonnes<br />
interv<strong>en</strong>tions établies dès le début sont<br />
primordiaux pour le traitem<strong>en</strong>t rapide de<br />
c<strong>et</strong>te condition progressive.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
La MVAP<br />
• La maladie vasculaire artérielle périphérique<br />
(MVAP) est une maladie chronique qui altère la<br />
circulation artérielle <strong>et</strong> contribue au<br />
développem<strong>en</strong>t de l’insuffisance artérielle.<br />
• <strong>Les</strong> facteurs étiologiques sont similaires à ceux<br />
de la maladie ischémique i du cœur, mais plutôt<br />
que de provoquer un infarctus, il <strong>en</strong> résultera un<br />
ulcère artériel puisque la MVAP agit au niveau <strong>des</strong><br />
membres inférieurs (Lewis, 2001).<br />
• La préval<strong>en</strong>ce de la MVAP dans la population est<br />
de 2.5% parmi les individus de 60 ans <strong>et</strong> moins,<br />
de 8.3% pour les 60-6969 ans <strong>et</strong> de 18.8% chez les<br />
78 ans <strong>et</strong> plus (Hirsch <strong>et</strong> al., 2005).<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
3
La MVAP<br />
• La MVAP affecte plus de 8 millions de<br />
personnes aux Etats-Unis (Calianno &<br />
Holton, 2007).<br />
• La majorité <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts atteints de MVAP<br />
ne sont pas diagnostiqués <strong>et</strong> parmi ceux<br />
qui le sont, <strong>en</strong>viron 50% sont<br />
asymptomatiques (Pilon & Lanthier, 2003).<br />
• Le diagnostic de la MVAP est souv<strong>en</strong>t<br />
négligé parce que les pati<strong>en</strong>ts <strong>et</strong> les<br />
interv<strong>en</strong>ants connaiss<strong>en</strong>t mal c<strong>et</strong>te<br />
maladie (Sieggre<strong>en</strong> & Kline, 2004)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Évaluation vasculaire<br />
• L’indice tibio-brachial brachial (ITB) ou cheville-<br />
bras (IPCB) perm<strong>et</strong> de poser le diagnostic<br />
de la MVAP symptomatique ou<br />
asymptomatique<br />
• Perm<strong>et</strong> de savoir si mon débit sanguin est<br />
suffisant pour une guérison<br />
• Évitera plusieurs amputations <strong>en</strong> nous<br />
indiquant si la cicatrisation de la plaie<br />
devra se faire <strong>en</strong> milieu humide ou sec<br />
• Att<strong>en</strong>tion aux faux-positifs<br />
• Valeurs normales: 0.8-1.2<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
La mesure de l’indice tibiobrachial<br />
(ITB)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Nous avons 2 ITB<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
4
Pouls périphériques<br />
• 37% <strong>des</strong> personnes avec un pouls<br />
perçu avait un indice tibio-brachial brachial<br />
réduit<br />
• L’abs<strong>en</strong>ce ne dénote pas<br />
nécessairem<strong>en</strong>t l’insuffisance<br />
artérielle <strong>et</strong> inversem<strong>en</strong>t la prés<strong>en</strong>ce<br />
n’indique pas nécessairem<strong>en</strong>t un bon<br />
débit artériel<br />
(5-10% pédieuse, 15% post-tibiale tibiale )<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
La loi 90<br />
Activités liées au traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>plaies</strong> <strong>et</strong><br />
aux altérations de la peau <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
tégum<strong>en</strong>ts.<br />
http://www.oiiq.org/uploads/publications/autres_pu<br />
blications/Guide_application_loi90.pdf.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Activités liées au traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>plaies</strong> <strong>et</strong><br />
aux altérations de la peau <strong>et</strong> <strong>des</strong> tégum<strong>en</strong>ts<br />
• L’infirmière peut déterminer le plan de traitem<strong>en</strong>t<br />
infirmier lié aux <strong>plaies</strong> <strong>et</strong> aux altérations de la<br />
peau <strong>et</strong> <strong>des</strong> tégum<strong>en</strong>ts, sans ordonnance<br />
individuelle ni collective.<br />
• La loi 90 confère à l’infirmière une plus grande<br />
autonomie<br />
• La loi 90 confirme l’exercice infirmier dans les<br />
<strong>soins</strong> de pieds<br />
• La contribution spécifique de l’infirmière réside<br />
principalem<strong>en</strong>t dans l’évaluation <strong>et</strong> dans les<br />
mesures prév<strong>en</strong>tives liées aux facteurs de risque<br />
<strong>et</strong> le traitem<strong>en</strong>t local <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
• L’approche interdisciplinaire<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
5
10 principes à suivre pour<br />
déterminer un plan de traitem<strong>en</strong>t<br />
1. S’assurer d’avoir les connaissances <strong>et</strong> les<br />
habil<strong>et</strong>és nécessaires (appliquer les <strong>soins</strong><br />
<strong>et</strong> traitem<strong>en</strong>ts requis par la condition du<br />
cli<strong>en</strong>t ce qui inclut le débridem<strong>en</strong>t, les<br />
produits <strong>et</strong> les pansem<strong>en</strong>ts à utiliser)<br />
2. Baser sa pratique sur les résultats<br />
probants<br />
3. T<strong>en</strong>ir compte de la complexité de la plaie<br />
4. S’assurer de connaître le diagnostic<br />
médical lié à l’origine de la plaie (les<br />
ulcères <strong>des</strong> membres inférieurs)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
10 principes à suivre pour<br />
déterminer un plan de traitem<strong>en</strong>t<br />
5. Connaître les indications <strong>et</strong> contre-<br />
indications cliniques aux <strong>soins</strong> <strong>et</strong><br />
traitem<strong>en</strong>ts prévus<br />
6. Obt<strong>en</strong>ir une ordonnance médicale pour<br />
un ag<strong>en</strong>t médicam<strong>en</strong>teux<br />
7. Se reporter à la liste <strong>en</strong> vigueur dans<br />
l’établissem<strong>en</strong>t ou utiliser les<br />
médicam<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> v<strong>en</strong>te libre <strong>en</strong> pratique<br />
privée<br />
8. Aviser le médecin traitant de l’évolution<br />
de la plaie<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
10 principes à suivre pour<br />
déterminer un plan de traitem<strong>en</strong>t<br />
9. Consulter d’autres professionnels<br />
de la santé<br />
10. Respecter les règles de <strong>soins</strong><br />
infirmiers <strong>en</strong> vigueur dans<br />
l’établissem<strong>en</strong>t pouvant préciser les<br />
<strong>recommandations</strong> cliniques<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
6
18 implications sans ordonnance<br />
1. Évalue la condition du cli<strong>en</strong>t (ATCD,<br />
exam<strong>en</strong> clinique, ITB, échelles de risque)<br />
‣ Afin de déterminer les facteurs étiologiques de<br />
la plaie (intrinsèques, extrinsèques)<br />
2. Évalue l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t du cli<strong>en</strong>t<br />
3. Évalue la douleur<br />
4. Évalue la plaie (Wagner, Beebes,<br />
NPUAP,règle de 9, <strong>et</strong>c.)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
18 implications sans ordonnance<br />
5. Évalue les avantages <strong>et</strong> les risques <strong>des</strong> mesures<br />
prév<strong>en</strong>tives<br />
6. Détermine les mesures d’asepsie requises<br />
(technique propre ou stérile)<br />
7. Procède au n<strong>et</strong>toyage de la plaie<br />
8. Décide de procéder au débridem<strong>en</strong>t après<br />
l’évaluation du pot<strong>en</strong>tiel de cicatrisation<br />
(autolytique, chirurgical conservateur,<br />
mécanique…)<br />
9. Décide de procéder à la scarification<br />
10. Connaît les contre-indications au débridem<strong>en</strong>t<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
18 implications sans ordonnance<br />
11. Détermine les produits <strong>et</strong> les pansem<strong>en</strong>ts à<br />
utiliser selon l’évaluation initiale de la plaie<br />
12. Détermine la surveillance requise <strong>et</strong> la<br />
fréqu<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> évaluations<br />
13. Évalue l’efficacité <strong>des</strong> mesures prév<strong>en</strong>tives <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> mesures de traitem<strong>en</strong>t appliquées<br />
14. Détermine la stratégie <strong>et</strong> les élém<strong>en</strong>ts<br />
d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t au cli<strong>en</strong>t<br />
15. Ajuste le plan de traitem<strong>en</strong>t infirmier<br />
16. Enlève les sutures <strong>et</strong> les agrafes selon le type<br />
de plaie <strong>et</strong> son évolution<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
7
18 implications sans ordonnance<br />
11. Consulte d’autres professionnels de<br />
la santé<br />
12. Consigne au dossier toutes les<br />
données pertin<strong>en</strong>tes relatives aux<br />
<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
10 implications avec ordonnance<br />
individuelle ou collective<br />
1. Utiliser certains médicam<strong>en</strong>ts dans le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>plaies</strong><br />
2. Administrer <strong>des</strong> médicam<strong>en</strong>ts (analgésiques<br />
systémiques <strong>et</strong> locaux, antibiothérapie)<br />
3. Demander certaines analyses de laboratoire<br />
4. Procéder à une culture<br />
5. Demander une évaluation vasculaire par<br />
photopléthysmographie ou une radiographie<br />
6. Enlever les drains, les mèches, les sutures <strong>et</strong><br />
les agrafes<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
10 implications avec ordonnance<br />
individuelle ou collective<br />
7. Débrider les <strong>plaies</strong> dont les<br />
structures sous-jac<strong>en</strong>tes sont<br />
exposées, les brûlures du 3 <strong>et</strong><br />
4ème degré, l’hyperkératose<br />
8. Cautériser une plaie avec du nitrate<br />
d’arg<strong>en</strong>t<br />
9. Appliquer les bandages de<br />
compression<br />
10. Appliquer les thérapies adjuvantes<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
8
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong>:<br />
• La préparation du lit de la plaie<br />
• Prév<strong>en</strong>tion <strong>et</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères de pression<br />
• Prév<strong>en</strong>tion <strong>et</strong> traitem<strong>en</strong>t de l’ulcère veineux de la<br />
jambe<br />
• Prév<strong>en</strong>tion <strong>et</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères du pied<br />
diabétique<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> 12 <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour<br />
la préparation du lit de la plaie<br />
Id<strong>en</strong>tifier <strong>et</strong> traiter la cause<br />
1. Évaluer la probabilité de guérison du pati<strong>en</strong>t. La<br />
circulation sanguine doit être suffisante <strong>et</strong> les<br />
autres facteurs importants de l’hôte doiv<strong>en</strong>t être<br />
optimisés pour favoriser la guérison.<br />
2. Diagnostiquer <strong>et</strong> corriger ou modifier la cause<br />
traitable <strong>des</strong> lésions tissulaires<br />
Aborder les be<strong>soins</strong> particuliers du pati<strong>en</strong>t<br />
3. Évaluer <strong>et</strong> favoriser la prise <strong>en</strong> charge <strong>des</strong><br />
be<strong>soins</strong> particuliers du pati<strong>en</strong>t pour perm<strong>et</strong>tre la<br />
guérison. (Douleur <strong>et</strong> qualité de vie)<br />
4. Fournir éducation <strong>et</strong> souti<strong>en</strong> afin d’améliorer la<br />
fidélité au plan de traitem<strong>en</strong>t.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> 12 <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour<br />
la préparation du lit de la plaie<br />
Procurer un soin local de la plaie<br />
5. Évaluer <strong>et</strong> faire le suivi de la plaie <strong>et</strong> de ses<br />
caractéristiques physiques (emplacem<strong>en</strong>t <strong>et</strong><br />
mesure)<br />
6. Débrider les <strong>plaies</strong> curables, pour r<strong>et</strong>irer le tissu<br />
non-viable, contaminé ou infecté(chirurgical,<br />
autolytique, <strong>en</strong>zymatique,mécanique <strong>et</strong> larvaire)<br />
7. N<strong>et</strong>toyer les <strong>plaies</strong> avec <strong>des</strong> solutions de faible<br />
toxicité(comme une solution saline physiologique<br />
ou de l’eau). L’emploi de solutions antiseptiques<br />
topiques doit être réservé aux <strong>plaies</strong> incurables<br />
ou à celles dont la charge bactéri<strong>en</strong>ne locale est<br />
une plus grande préoccupation que la stimulation<br />
de la cicatrisation.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
9
<strong>Les</strong> 12 <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour<br />
la préparation du lit de la plaie<br />
8. Évaluer <strong>et</strong> traiter la plaie pour une charge<br />
bactéri<strong>en</strong>ne accrue ou une infection.<br />
(Distinguer d’une inflammation persistante<br />
d’origine non bactéri<strong>en</strong>ne).<br />
9. Choisir un pansem<strong>en</strong>t approprié aux be<strong>soins</strong><br />
de la plaie, du pati<strong>en</strong>t <strong>et</strong> du soignant ou au<br />
contexte clinique.<br />
10. Évaluer la vitesse de cicatrisation escomptée.<br />
Si sous optimale réévaluer selon les<br />
<strong>recommandations</strong> 1 à 9.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> 12 <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour<br />
la préparation du lit de la plaie<br />
Fournir un souti<strong>en</strong> organisationnel<br />
11. Utiliser <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts actifs pour les <strong>plaies</strong> (ag<strong>en</strong>ts<br />
biologiques, greffes de peau, traitem<strong>en</strong>ts d’appoint)<br />
lorsque les autres facteurs ont été corrigés <strong>et</strong> que la<br />
guérison n’évolue toujours pas.<br />
12. Pour de meilleurs résultats, l’éducation <strong>et</strong> les données<br />
cliniques doiv<strong>en</strong>t être rattachées à <strong>des</strong> équipes<br />
interprofessionnelles avec la coopération <strong>des</strong> systèmes<br />
de santé.<br />
R. Gary Sibbald, Heather, L.,Orsted, Patricia Coutts,<br />
David H. Keast. (2006)<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères de pression<br />
Id<strong>en</strong>tifier <strong>et</strong> traiter la cause<br />
1. Faire un anamnèse <strong>et</strong> un exam<strong>en</strong> physique<br />
ciblé du pati<strong>en</strong>t pour déterminer l’état de<br />
santé général <strong>et</strong> les facteurs de risque qui<br />
peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>traîner la formation d’ulcères de<br />
pression ou qui peuv<strong>en</strong>t affecter la<br />
guérison d’ulcères existants.<br />
2. Évaluer <strong>et</strong> modifier les situations où la<br />
pression peut augm<strong>en</strong>ter<br />
3. Maximiser l’état nutritionnel<br />
4. Maîtriser l’humidité <strong>et</strong> l’incontin<strong>en</strong>ce.<br />
5. Maximiser l’activité <strong>et</strong> la mobilité, <strong>et</strong><br />
réduire ou éliminer la friction <strong>et</strong> le<br />
cisaillem<strong>en</strong>t.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
10
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères de pression<br />
Aborder les be<strong>soins</strong> particuliers du pati<strong>en</strong>t<br />
6. Évaluer <strong>et</strong> soulager la douleur<br />
7. Évaluer les be<strong>soins</strong> psychosociaux <strong>et</strong> y répondre<br />
Procurer un soin locale de la plaie<br />
8. Évaluer le stade de la plaie <strong>et</strong> la traiter. Procurer un<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t optimal compatible avec les principes de<br />
la préparation du lit de la plaie.<br />
9. Introduire <strong>des</strong> modalités d’appoint ou <strong>des</strong> pansem<strong>en</strong>ts<br />
biologiquem<strong>en</strong>t actifs au besoin<br />
10. Envisager une interv<strong>en</strong>tion chirurgicale pour les ulcères<br />
profonds qui ne guériss<strong>en</strong>t pas (stade III <strong>et</strong> IV).<br />
Fournir un souti<strong>en</strong> organisationnel<br />
11. M<strong>et</strong>tre sur pied une équipe multidisciplinaire pouvant<br />
répondre plus spécifiquem<strong>en</strong>t aux be<strong>soins</strong> du pati<strong>en</strong>t.<br />
12. Éduquer les pati<strong>en</strong>ts <strong>et</strong> les soignants au suj<strong>et</strong> de la<br />
prév<strong>en</strong>tion <strong>et</strong> du traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères de pression.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères veineux<br />
Id<strong>en</strong>tifier <strong>et</strong> traiter la cause<br />
1. Obt<strong>en</strong>ir une anamnèse complète pour<br />
déterminer les caractéristiques veineuses <strong>et</strong><br />
éliminer d’autres diagnostics. Évaluer la<br />
douleur <strong>et</strong> id<strong>en</strong>tifier les facteurs systémiques <strong>et</strong><br />
locaux qui peuv<strong>en</strong>t gêner la cicatrisation <strong>des</strong><br />
<strong>plaies</strong>.<br />
2. Faire une évaluation physique. Cela compr<strong>en</strong>d<br />
une évaluation bilatérale <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs de même qu’un test de l’indice<br />
tibiobrachial (IPTB) chez tous les pati<strong>en</strong>ts qui<br />
ont <strong>des</strong> ulcères veineux pour aider à éliminer la<br />
prés<strong>en</strong>ce d’une maladie artérielle<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères veineux<br />
3. Déterminer la/les causes de l’insuffisance<br />
veineuse chronique (IVC) selon l’étiologie :<br />
anomalie valvulaire (reflux), obstruction ou<br />
insuffisance de la pompe du moll<strong>et</strong>.<br />
4. Recourir à un traitem<strong>en</strong>t de compression<br />
approprié<br />
5. Administrer un traitem<strong>en</strong>t médical si indiqué<br />
pour l’IVC (thrombose superficielle ou profonde,<br />
fibrose ligneuse)<br />
6. Envisager un traitem<strong>en</strong>t chirurgical s’il existe<br />
une maladie veineuse superficielle ou <strong>des</strong><br />
veines perforantes <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce d’une maladie<br />
profonde ét<strong>en</strong>due.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
11
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères veineux<br />
Aborder les be<strong>soins</strong> particuliers du pati<strong>en</strong>t<br />
7. Communiquer avec le pati<strong>en</strong>t, sa famille <strong>et</strong> ses<br />
soignants pour établir <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes réalistes<br />
face à la guérison <strong>et</strong> procurer <strong>des</strong><br />
r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts sur les <strong>soins</strong> <strong>et</strong> la gestion de la<br />
maladie veineuse. La prés<strong>en</strong>ce ou l’abs<strong>en</strong>ce<br />
d’un système de souti<strong>en</strong> social est importante<br />
pour le traitem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> la prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> ulcères<br />
de jambe.<br />
Procurer un soin local de la plaie<br />
8. Évaluer la plaie<br />
9. Procurer un soin local de la plaie: optimiser le<br />
milieu local de cicatrisation de la plaie par le<br />
débridem<strong>en</strong>t, l’équilibre bactéri<strong>en</strong> <strong>et</strong> l’équilibre<br />
hydrique. Envisager <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts d’appoint<br />
appropriés.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères veineux<br />
10. Consulter les disciplines appropriées<br />
pour maximiser <strong>et</strong> personnaliser le<br />
plan de traitem<strong>en</strong>t pour s’attaquer aux<br />
facteurs <strong>et</strong> aux co-facteurs qui<br />
peuv<strong>en</strong>t affecter la cicatrisation (p.ex.,<br />
mobilité <strong>et</strong> nutrition).<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères du pied diabétique<br />
IDENTIFIER ET TRAITER LA CAUSE<br />
1. Faire une anamnèse complète pour déterminer l’état<br />
de santé général, la maîtrise du diabète <strong>et</strong> ses<br />
complications, les cofacteurs pouvant occasionner la<br />
dégradation de la peau ou affecter la guérison d’un<br />
ulcère.<br />
2. Effectuer une évaluation physique complète qui<br />
compr<strong>en</strong>d: l’état vasculaire, les difformités osseuses<br />
ou structurelles (<strong>et</strong> les chaussures), <strong>et</strong> la s<strong>en</strong>sation.<br />
3. Classer les diabétiques dans une catégorie de risque<br />
pour perm<strong>et</strong>tre la coordination du traitem<strong>en</strong>t.<br />
4. Modifier les facteurs qui caus<strong>en</strong>t la dégradation de la<br />
peau <strong>et</strong>3ou qui influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t la cicatrisation <strong>et</strong> faire<br />
<strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de consultation auprès de l’équipe<br />
pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> compl<strong>et</strong>s.<br />
5. Procurer un soulagem<strong>en</strong>t de la pression s’il y a perte<br />
de s<strong>en</strong>sation protectrice.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
12
<strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong> pour le<br />
traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> ulcères du pied diabétique<br />
ABORDER LES BESOINS PARTICULIERS DU PATIENT<br />
6. Fournir une éducation personnalisée adaptée aux<br />
be<strong>soins</strong> <strong>et</strong> à la catégorie de risque du pati<strong>en</strong>t<br />
PROCURER UN SOIN LOCAL DE LA PLAIE<br />
7. Évaluer les ulcérations plantaires du diabétique<br />
8. Procurer un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t optimal pour la plaie:<br />
débridem<strong>en</strong>t, équilibre hydrique, maîtrise de<br />
l’infection.<br />
9. Déterminer l’efficacité <strong>des</strong> interv<strong>en</strong>tions, ré-évaluer évaluer si<br />
la cicatrisation n’évolue pas à la vitesse escomptée<br />
10. Envisager l’utilisation d’ag<strong>en</strong>ts biologiques <strong>et</strong> de<br />
traitem<strong>en</strong>ts d’appoint.<br />
FOURNIR UN SOUTIEN ORGANISATIONNEL<br />
11. M<strong>et</strong>tre sur pied, former <strong>et</strong> habiliter une équipe à<br />
travailler avec les diabétiques.<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Priorités pédagogiques <strong>en</strong> <strong>soins</strong> de<br />
<strong>plaies</strong><br />
• Évaluer le pot<strong>en</strong>tiel de cicatrisation<br />
• Différ<strong>en</strong>cier les types de <strong>plaies</strong><br />
• Connaître le processus de cicatrisation<br />
• Différ<strong>en</strong>cier la contamination, la<br />
colonisation, la colonisation critique,<br />
l’infection, l’infection systémique <strong>et</strong><br />
l’inflammation.<br />
• Connaître les catégories de pansem<strong>en</strong>ts<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
L’outil S.M.A.T.<br />
• Outil d’évaluation de la maladie<br />
vasculaire artérielle périphérique<br />
(MVAP) <strong>des</strong> membres inférieurs,<br />
incluant la mesure de l’indice<br />
tibiobrachial (ITB) avant d’initier un<br />
soin de <strong>plaies</strong>.<br />
• Outil de Suivi de la MVAP<br />
Avant de<br />
Traiter<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
13
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
Le plan thérapeutique<br />
• Le plan de traitem<strong>en</strong>t infirmier d’un cli<strong>en</strong>t<br />
à risque ou porteur d’une plaie ou d’une<br />
altération de la peau <strong>et</strong> <strong>des</strong> tégum<strong>en</strong>ts<br />
compr<strong>en</strong>d:<br />
1. <strong>Les</strong> mesures prév<strong>en</strong>tives<br />
2. <strong>Les</strong> mesures de traitem<strong>en</strong>t<br />
3. <strong>Les</strong> mesures d’asepsie requises<br />
4. <strong>Les</strong> mesures visant à soulager la douleur<br />
5. <strong>Les</strong> élém<strong>en</strong>ts de surveillance <strong>et</strong> la fréqu<strong>en</strong>ce <strong>des</strong><br />
évaluations<br />
6. <strong>Les</strong> élém<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t au cli<strong>en</strong>t<br />
7. <strong>Les</strong> consultations ou les référ<strong>en</strong>ces à d’autres<br />
professionnels de la santé<br />
8. La référ<strong>en</strong>ce à une ordonnance individuelle ou à une<br />
ordonnance collective<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
À v<strong>en</strong>ir<br />
• <strong>Les</strong> <strong>recommandations</strong> <strong>canadi<strong>en</strong>nes</strong><br />
sur les <strong>plaies</strong> chirurgicales<br />
• Formation <strong>en</strong> ligne de l’ACSP<br />
• Le Congrès canadi<strong>en</strong> annuel de<br />
l’Association canadi<strong>en</strong>ne du soin de<br />
<strong>plaies</strong> à Québec du 29 octobre au 1er<br />
novembre 2009<br />
Juin 2009 AEESIQ<br />
Maryse Beaumier M.Sc.Inf.<br />
14