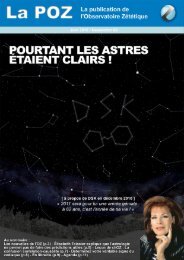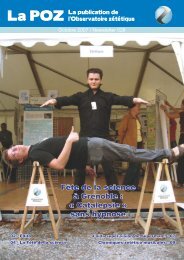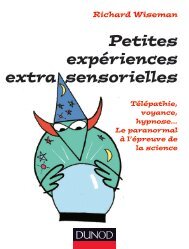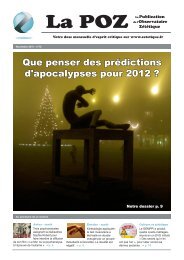Petite histoire fraternelle, blanche et universelle - Observatoire ...
Petite histoire fraternelle, blanche et universelle - Observatoire ...
Petite histoire fraternelle, blanche et universelle - Observatoire ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Psychoz<br />
difficile. Des souvenirs plutôt tristes <strong>et</strong><br />
peu agréables. Rappelons alors que<br />
ce n’était pas forcement mieux avant,<br />
c’était simplement avant !<br />
Je propose souvent c<strong>et</strong>te citation<br />
attribuée à Socrate afin de relativiser ce<br />
fameux c’était mieux avant notamment<br />
dans l’éducation : « Notre jeunesse est<br />
mal élevée. Elle se moque de l’autorité<br />
<strong>et</strong> n’a aucune espèce de respect pour<br />
les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui<br />
ne se lèvent pas quand un vieillard<br />
entre dans une pièce. Ils répondent<br />
à leurs parents <strong>et</strong> bavardent au lieu<br />
de travailler. Ils sont tout simplement<br />
mauvais. ». S’ils étaient déjà jugés<br />
comme tel il y a 2400 ans alors soyons<br />
heureux que cela ne soit pas pire<br />
maintenant.<br />
Nicolas Gaillard<br />
référence antérieure familière est donc<br />
renforcée : c’était mieux avant !<br />
L’allégation « c’était mieux avant »<br />
résulte donc généralement d’un biais<br />
cognitif, c’est-à-dire d’une erreur<br />
dans la perception d’une situation<br />
donnée, successive d’une faille ou<br />
d’une faiblesse dans le traitement des<br />
informations disponibles face à c<strong>et</strong>te<br />
situation. C’est notre perception positif<br />
« d’avant » fortement influencée par les<br />
biais cognitif comme l’eff<strong>et</strong> du rappel<br />
positif <strong>et</strong> celui de simple exposition qui<br />
vient gommer les aspects négatifs.<br />
D’où la nécessité dans la démarche<br />
visée par la zététique d’avoir une idée<br />
du contexte dans laquelle s’inscrit une<br />
affirmation <strong>et</strong> tenter de s’approcher<br />
d’une perception la plus objective<br />
possible. La psychologie sociale m<strong>et</strong><br />
en lumière les mécanismes en dehors<br />
du champ de conscience qui peuvent<br />
nous tromper <strong>et</strong> entraver dans c<strong>et</strong>te<br />
démarche.<br />
Pour en revenir à l’enchantement<br />
des descriptions de la grande école<br />
républicaine de Marcel Pagnol, je<br />
discutais récemment avec mon père de<br />
sa scolarité dans les années cinquante.<br />
C’est bien sûr l’image idyllique : la<br />
place du « respect » pour l’adulte, les<br />
p<strong>et</strong>its déjeuners <strong>et</strong> les goûters, les<br />
blouses, l’absence de discrimination, le<br />
souci d’égalité, les jeux de récréation,<br />
le poêle à bois qu’il fallait remplir,<br />
mais surtout l’école buissonnière <strong>et</strong><br />
la découverte des premiers émois<br />
amoureux.<br />
Mais ses souvenirs sont finalement<br />
d’avantage ancrés dans la réalité d’un<br />
contexte qui apparaît moins rigolo : une<br />
exigence constante de travail, pas le<br />
droit d’être avec les filles, les punitions<br />
le soir, le r<strong>et</strong>our dans la neige, les quatre<br />
kilomètres quatre fois par jour, les<br />
pleurs lors des interrogations d’<strong>histoire</strong>,<br />
les leçons de morale, les craies dans<br />
la figure, voire les gifles quand il était<br />
dissipé, les bagarres dans la cour, les<br />
brimades parce qu’il était rouquin. Mais<br />
surtout l’odeur insupportable de l’encre<br />
<strong>et</strong> du kraft bleu, qui lui rappelle à jamais<br />
la rentrée des classes : un moment très<br />
Notes :<br />
[1] : Je conseille vivement de lire la suite<br />
de l’extrait sur l’argument d’historicité.<br />
[2] : En 1968, Zajonc a établi un<br />
protocole où il soum<strong>et</strong> à un échantillon<br />
de personnes une série de mots soidisant<br />
turcs, dont ils ne connaissaient<br />
pas la signification. On leur demande<br />
ensuite pour chaque mot s’ils y voient<br />
plutôt quelque chose de négatif ou<br />
de positif. Les mots présentés 25 fois<br />
étaient estimés porteur d’une dimension<br />
positive, alors que ceux présentés<br />
qu’une ou deux fois étaient jugés<br />
particulièrement peu sympathiques.<br />
[3] : C’est vrai jusqu’à un certain point,<br />
car les répétitions incessantes d’un<br />
même stimulus finissent à terme par<br />
avoir des eff<strong>et</strong>s négatifs.<br />
References :<br />
Serge Ciccotti (2007), 150 p<strong>et</strong>ites<br />
expériences de psychologie pour<br />
mieux comprendre nos semblables,<br />
Dunod, p121-126.<br />
Jean-Léon Beauvois <strong>et</strong> al (1995),<br />
Relation humaine, groupe <strong>et</strong> influence<br />
sociale, PUF, p62-64.<br />
Richard Walker (2003), in Collin<br />
Allen (2008), How memory is biased<br />
toward positive emotional memories,<br />
except for those with mild depression,<br />
Psychology Today.<br />
NL 036 - Juin 2008<br />
13