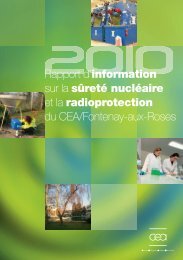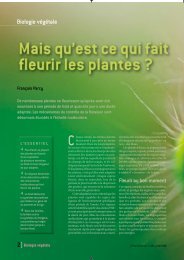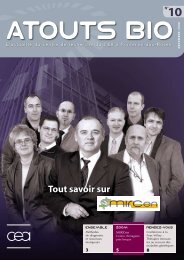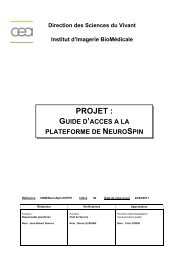TRAVAILLEURSL’INDISPENSABLERADIOPROTECTIONBiO’actif I <strong>HORS</strong> SÉRIE I SEPTEMBRE 20118Protéger et soigner. Des biomarqueurs aux traitements,les équipes de la DSV travaillent à l’amélioration de la protection<strong>des</strong> travailleurs et de leur prise en charge en cas de contamination.Au-delà <strong>des</strong> accidents graves, la question<strong>des</strong> risques liés à l’exposition auxrayonnements ionisants se pose auquotidien pour les salariés de la filièrenucléaire, comme en médecine nucléaireou en radiothérapie. Si tout est fait pourdiminuer le risque, celui-ci demeure et doitêtre pris en compte. La radioprotection,c’est-à-dire la protection <strong>des</strong> travailleurscontre les risques liés à l’usage derayonnements ionisants, est très stricte,réglementée et associée à un suivi médicalprofessionnel important et adapté. Carla nature <strong>du</strong> risque varie selon le postede travail. Ainsi, dans les ateliers de fabricationou de retraitement <strong>du</strong> combustible nucléaire,les travailleurs peuvent être exposés à<strong>des</strong> gaz, <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> poussièrescontenant <strong>des</strong> éléments radioactifs.On parle alors de contamination. « C’estl’un <strong>des</strong> risques sur lesquels travaillentles chercheurs de la DSV. Ils s’attachenten particulier à mieux comprendre commentune contamination par les •actini<strong>des</strong>se propage dans l’organisme, commentelle est éliminée et quelles sont les relationsentre doses et effets. Des informationsindispensables pour mieux estimer le risqueet adapter les mesures de radioprotection »,explique Florence Ménétrier, responsable dela cellule d’expertise Prositon. « Le deuxièmeobjectif <strong>des</strong> chercheurs est de donneraux médecins <strong>des</strong> éléments de réponseaux questions qu’ils se posent au cas parcas : Dois-je traiter ? Avec quel protocole ?Quand puis-je arrêter le traitement ? »AMÉLIORER LARADIOPROTECTIONUn •millisievert (mSv) par an pour lapopulation ; 20 par an pour les travailleurs ;et jusqu’à 250 ponctuellement pourle personnel d’intervention de la centralede Fukushima. Ce sont les doses maximalesacceptées, en fonction <strong>des</strong> situationsd’exposition. Fixées réglementairement, ellessont définies à partir de recommandationsélaborées par la Commission internationalede protection radiologique (CIPR ; cf. p.4) ens’appuyant sur l’ensemble <strong>des</strong> informationsacquises par la communauté scientifique.« À l’iRCM, nous menons <strong>des</strong> recherchesafin d’améliorer les modèles biocinétiquesde contamination par les actini<strong>des</strong> surlesquels s’appuie la CIPR », explique OlivierGrémy. « Les modèles biocinétiques ont pourobjectif de prévoir le comportement dechaque radionucléide dans le corps humain,depuis son entrée jusqu’à son élimination.Nous avons donc développé <strong>des</strong> modèlesexpérimentaux pour suivre chez l’animalle devenir <strong>du</strong> plutonium et de l’américiumnotamment, ceci après différentes formesde contamination : pulmonaire ou parblessure. Nous regardons aussi lesconsé quences de ces contaminations,particulièrement en termes de cancer ».Avec ces modèles, les chercheurs évaluentl’effet de nombreux paramètres, notammentphysicochimiques et anatomiques. Ils ontainsi montré que, pour une même dosede radionucléide, le risque de développerun cancer pulmonaire est trois fois plusélevé avec de l’oxyde de neptunium qu’avecde l’oxyde de plutonium qui se répartitde façon beaucoup moins homogènedans les poumons. « Cela démontre queconnaître la dose ne suffit pas et qu’il fautprendre en compte sa répartition dansles tissus pour mieux estimer la probabilitéde développement d’un cancer », soulignele chercheur. Une autre question se poseimmédiatement : que se passe-t-il encas de contamination par un mélanged’actini<strong>des</strong> ? « Nous nous attachonsà décrypter le comportement <strong>des</strong> actini<strong>des</strong>lorsqu’ils sont mélangés, comme c’est© P.Dumas/<strong>CEA</strong>Chaîne pour les étu<strong>des</strong> de rechercheet développement sur les procédés de fabrication<strong>des</strong> combustibles au plutonium (<strong>CEA</strong> Cadarache).
TRAVAILLEURSDESPROTÉINESqui fixentl’uranium© <strong>CEA</strong>© P.Dumas/<strong>CEA</strong>Observation par microscopie confocalede l’uranyle (en rouge) dans une cellule rénale.Notre originalité,c’est d’allier rechercheexpérimentale surl’animal et modélisationinformatique.le cas dans le combustible •Mox utilisédans certains réacteurs nucléaires. C’estparticulièrement important pour adapterla radioprotection <strong>des</strong> personnes quifabriquent ce combustible », expliqueOlivier Grémy. À partir de leurs résultatsexpérimentaux les chercheurs de l’iRCMdéveloppent et ajustent <strong>des</strong> modèlesinformatiques. « Notre originalité, c’estd’allier recherche expérimentale sur l’animalet modélisation informatique », soulignePaul Fritsch. « Et ces modèles nous lestransposons à ce qui se passe chez l’Homme.Actuellement, les doses limites définiespar la CIPR tiennent compte <strong>des</strong> risquespour différentes catégories de personnes.Avec cette démarche, nous augmentons lesparamètres pris en compte avec pour objectifde pouvoir évaluer la situation indivi<strong>du</strong>elle. »À LA RECHERCHEDE BIOMARQUEURSLa première chose à faire en cas <strong>des</strong>uspicion de contamination accidentelle,c’est de la vérifier et d’en évaluer le niveau.Pas si simple ! À l’heure actuelle, le testutilisé consiste à détecter la quantité deradionucléi<strong>des</strong> dans les urines.« Ce dosage indispensable est toutefoisinsuffisant », affirme Odette Prat,de l’iBEB. « Les médecins <strong>du</strong> travail ontbesoin d’avoir un test qui leur permettenon seulement de connaître le niveaude la contamination mais aussi d’enprévoir les conséquences pathologiquespotentielles pour le travailleur. Nous avonsmis en évidence, par toxicogénomique,un biomarqueur qui pourrait les y aiderdans le cas d’une contamination parl’uranium : l’ostéopontine, une protéineimpliquée dans la minéralisation osseuse.Découpage de spots de protéines à partir d’ungel d’électrophorèse bidimensionelle pourleur identification en spectrométrie de masse.© P.Dumas/<strong>CEA</strong>« À l’iBEB, nous cherchonsà identifier les cibles moléculairesde l’uranium pour comprendreles mécanismes de sa toxicité etdéterminer ses sites de fixation.Cette démarche est essentielle dansla conception de décorporants »,explique Claude Vidaud. Deuxapproches complémentaires sontutilisées. La première consisteà isoler <strong>des</strong> protéines ciblespotentielles de l’uranium à partirde flui<strong>des</strong> biologiques par <strong>des</strong>techniques biochimiques. « Nousen avons identifié 53 ! Un testrapide basé sur un immunodosagede l’uranyle, forme prédominantede l’uranium en milieu aqueux,a permis de quantifier leur affinité »,ajoute la chercheuse. La seconde,basée sur un outil de modélisationdéveloppé par son collègue OlivierPible, a permis de proposer <strong>des</strong>protéines candidates. L’une d’elles,la C-reactive protein, présente apriori les caractéristiques structuralesnécessaires. « Les expériences ontconfirmé qu’elle fixe l’uranium100 fois plus efficacement quele calcium qu’elle utilise dansles conditions physiologiques »,souligne Claude Vidaud. « Il fautmaintenant tester leur efficacitéen milieu complexe pour tenircompte <strong>des</strong> compétitions avecd’autres molécules biologiques maisaussi avec les métaux endogènesde l’organisme. C’est essentiel pourtrouver les molécules candidatesà une utilisation en décorporation »,précise Agnès Hagège.BiO’actif I <strong>HORS</strong> SÉRIE I SEPTEMBRE 20119