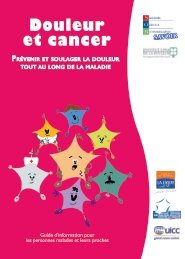La lettre de l'institut Upsa de la douleur - 9
La lettre de l'institut Upsa de la douleur - 9
La lettre de l'institut Upsa de la douleur - 9
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AINS et inhibiteurs sélectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> COXÉvaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong>sélectivité <strong>de</strong>s AINS pour<strong>la</strong> COX-1 et <strong>la</strong> COX-2<strong>La</strong> sélectivité COX-1 ou COX-2 estd é t e rminée à partir <strong>de</strong> diff é rents modèlesemployant <strong>de</strong>s enzymes purifiées ourecombinantes <strong>de</strong> cellules d’origine animaleou humaine homogénéisées oue n t i è res (Mea<strong>de</strong> et coll., 1993, Mitchellet coll., 1994, Pairet et coll., 1998).Le premier modèle développé a utilisé<strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> l’aorte <strong>de</strong> bovins pourtester l’activité <strong>de</strong>s AINS sur <strong>la</strong> COX-1et <strong>de</strong>s macrophages <strong>de</strong> souris stimulésau LPS pour évaluer l’activité <strong>de</strong>s AINSsur <strong>la</strong> COX-2 (Mitchell et coll., 1994).<strong>La</strong> sélectivité <strong>de</strong> l’AINS testé est déterminéeselon le rapport <strong>de</strong>s IC50 sur les<strong>de</strong>ux isoenzymes (concentration <strong>de</strong>l’AINS qui diminue l’activité <strong>de</strong> l’enzyme<strong>de</strong> 50 %). Un rapport inférieur à 1indique une inhibition préférentielle <strong>de</strong><strong>la</strong> COX-2 par rapport à <strong>la</strong> COX-1. Lemodèle utilisant du sang humain se rapproche <strong>de</strong>s conditions physiologiqueset pharmacologiques rencontrées ensituation clinique (Patrigani et coll.,1994). D’autres modèles ex vivo utilisentdu sang <strong>de</strong> donneurs sains qui ontreçu <strong>de</strong>s AINS à doses thérapeutiquependant plusieurs jours ou semaines(Cipollone et coll., 1995; Stichtenoth etcoll., 1997). Cette approche perm e td’étudier l’AINS à l’équilibre et tientcompte <strong>de</strong> <strong>la</strong> liaison aux protéines et<strong>de</strong>s facteurs physico-chimiques qui aff e c-tent le transport transmembranaire ,puisque seule <strong>la</strong> fraction non liée <strong>de</strong>l’AINS traverse les membranes <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>quettesou <strong>de</strong>s monocytes.Il n’y a pas actuellement <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>expérimentale uniformément validéep e rmettant une comparaison directe <strong>de</strong>sdonnées. Les modèles ne sont pass t a n d a rdisés et les comparaisons s’avèrentdonc délicates, expliquant <strong>la</strong>variabilité <strong>de</strong>s observations et les résultatsapparemment contradictoires publiés( Vane et coll., 1996). Diff é rents paramè t res jouent un rôle prépondérant dans<strong>la</strong> variabilité observée, tels que <strong>la</strong> sourc e<strong>de</strong> l’enzyme, sa quantité présente dansle système, <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> l’inhibiteur (réversible,irréversible) et le temps <strong>de</strong>préincubation <strong>de</strong> l’AINS avec l’enzyme.Cependant, les résultats convergent pourc o n f i rmer que <strong>la</strong> sélectivité <strong>de</strong>s AINSpour les COX n’est jamais absolue etqu’en général les AINS c<strong>la</strong>ssiques sont<strong>de</strong>s inhibiteurs plus puissants <strong>de</strong> <strong>la</strong>COX-1 que <strong>de</strong> <strong>la</strong> COX-2 (Battistini etcoll., 1994).Le rapport <strong>de</strong> sélectivité COX-1 surCOX-2 pourrait déterminer <strong>la</strong> pro b a b i l i t éIN C I D E N C E D E R É A C T I O N S I N D É S I R A B L E S S É R I E U S E S P O U R100 000 P R E S C R I P T I O N S D’AINS E T R I S Q U E S R E L AT I F S D E S A I N SA U N I V E A U G A S T R O-I N T E S T I N A L (D’A P R È S BAT E M A N, 1994)CSM 1986 Garcia-Rodriguez 1994 <strong>La</strong>ngmann 1994Inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s réactions Odds ratio (risque) Odds ratioindésirables sérieusespour 100000 prescriptionsIbuprofène 1.3 2.9 2Diclofénac 3.9 3.9 4.2Naproxène 4.1 3.1 9.1Indométhacine 6.3 11.3Piroxicam 11 18 13.7Tableau 2d ’ e ffet indésirables (Cashman, 1996).<strong>La</strong> mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s 2 isoenzymes<strong>de</strong> <strong>la</strong> COX permettrait ainsi d’expliquerune variation dans <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong> survenue<strong>de</strong>s effets indésirable en fonction<strong>de</strong>s molécules malgré un mécanismed’action et un profil d’effets indésirablescommuns (Mitchell et coll., 1994).L’inhibition <strong>de</strong> l’isoforme COX-2 inductibleexpliquerait l’effet anti-inf<strong>la</strong>mmatoire<strong>de</strong>s AINS alors que celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> COX-1serait responsable <strong>de</strong>s effets indésirablesgastriques, rénaux et p<strong>la</strong>quettaires (Va n e ,1 9 9 8 ) .<strong>La</strong> sélectivité <strong>de</strong>s AINSc<strong>la</strong>ssiques et leur sécuritéE n v i ron 15 à 20 % <strong>de</strong>s patients quireçoivent <strong>de</strong>s AINS développent unetoxicité gastro-intestinale, dont 1 à 3 %d ’ h é m o ragies ou <strong>de</strong> perforations digestivesmenaçant <strong>la</strong> vie (Gabriel et coll.,1991, Tannenbaum et coll., 1996). Cese ffets gastro-intestinaux sont multifactorielset incluent, outre l’effet lié àl’inhibition <strong>de</strong> <strong>la</strong> synthèse <strong>de</strong>s pro s t a-g<strong>la</strong>ndines gastro-intestinales, une actiond i recte d’irritation locale. D’autre part ,<strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> risques tels qu’un âgesupérieur à 60 ans, une co-médication<strong>de</strong> glucocorticoï<strong>de</strong>s et/ou d’anticoagu<strong>la</strong>ntsoraux, ainsi qu’un antécé<strong>de</strong>ntd’événement gastro-intestinal jouent unrôle (Gabriel et coll., 1991). Des étu<strong>de</strong>scas-contrôles ainsi que l’analyse <strong>de</strong>sr a p p o rts spontanés montrent que lerisque <strong>de</strong> toxicité gastro-intestinale varieen fonction <strong>de</strong> l’AINS (CSM, 1986 ;G a rcia-Rodriguez, 1994, 1998 ;<strong>La</strong>ngman et coll., 1994) (voir tableau 2).<strong>La</strong> comparaison directe entre <strong>la</strong> sélectivitéCOX-2 <strong>de</strong>s AINS in vitro etl’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s ulcérations gastriqueset <strong>de</strong>s saignements gastro - i n t e s t i n a u xm o n t re que ceux qui ont un rapport <strong>de</strong>sélectivité simi<strong>la</strong>ire pour <strong>la</strong> COX-1 et <strong>la</strong>COX-2 comme le diclofénac et len a p roxène, off re un risque inférieurd’entraîner <strong>de</strong>s troubles gastro - i n t e s t i-naux, que les molécules plus sélectivespour <strong>la</strong> COX-1 (piroxicam). To u t e f o i sles données sur l’ibuprofène ne confirmentpas cette règle : en eff e t ,l ’ i b u p rofène, qui semble être un AINSre<strong>la</strong>tivement sûr en pratique clinique,présente une inhibition préfére n t i e l l em a rquée sur <strong>la</strong> COX-1 in vitro. Ainsiles tentatives <strong>de</strong> mettre en re<strong>la</strong>tion <strong>la</strong>toxicité et <strong>la</strong> sélectivité <strong>de</strong>s AINS disponibles<strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses annéesn’ont guère été concluantes. Une <strong>de</strong>sraisons essentielles en est un rapport<strong>de</strong> sélectivité insuffisant pour envisagerdans <strong>la</strong> pratique clinique l’inhibition isolée<strong>de</strong> <strong>la</strong> COX-2. Cette appare n t ed i s c o rdance semble aussi résulter dufait que ces étu<strong>de</strong>s ne tiennent pascompte <strong>de</strong> <strong>la</strong> posologie. Lorsque l’ibuprofène est utilisé à <strong>de</strong>s dosess u p é r i e u res à 1500mg/j, le risque d’inci<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> troubles gastro - i n t e s t i n a u xest plus élevé (Garcia-Rodriguez et coll.,1994, 1998).L’ a u t re organe cible <strong>de</strong>s AINS <strong>de</strong>meurele rein. L’inci<strong>de</strong>nce globale <strong>de</strong>s eff e t sindésirables rénaux après utilisationd’AINS est <strong>de</strong> 5 % et s’élève à 20 %chez les patients à risque (ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s âgéset/ou connus pour une pert u r b a t i o nhémodynamique d’origine card i o v a s-c u l a i re, rénale, hépatique ou volémique).Les principaux effets indésirables sont<strong>la</strong> rétention hydrosodée et l’insuff i s a n c erénale aiguë. Le mécanisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> rétentionhydrosodée est complexe (vascu<strong>la</strong>ireet tubu<strong>la</strong>ire) et touche 3 à 5 % <strong>de</strong>spatients. L’ i n s u ffisance rénale surv i e n tchez 0,5 à 1 % <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s sous AINS,notamment ceux dont le flux rénalrésiduel est dépendant <strong>de</strong> l’effet vasodi<strong>la</strong>tateur<strong>de</strong>s prostag<strong>la</strong>ndines. Les y n d rome néphrotique et <strong>la</strong> néphriteinterstitielle sont beaucoup plus rare s ,touchant 0,01 à 0,02 % <strong>de</strong>s patientsexposés. Enfin, bien que les nécro s e sp a p i l l a i res et <strong>la</strong> « n é p h ropathie analgé s i q u e » soient plus rares, ce sont les3