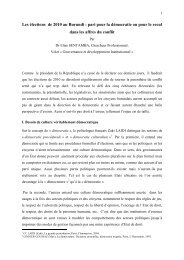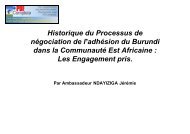La problématique de commercialisation du sucre ... - Idecburundi.org
La problématique de commercialisation du sucre ... - Idecburundi.org
La problématique de commercialisation du sucre ... - Idecburundi.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> au BurundiDr Ephrem NIYONGABO *Intro<strong>du</strong>ction<strong>La</strong> pénurie <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> au Burundi est <strong>de</strong>venue très préoccupante, si bien que le gouvernementenvisage <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à la Communauté Est Africaine (EAC) l'autorisation d'importer <strong>du</strong><strong>sucre</strong> complémentaire à celui qui est pro<strong>du</strong>it localement 1 . En effet, le Burundi est membre <strong>de</strong>l'EAC <strong>de</strong>puis 2007 et est donc soumis au protocole <strong>de</strong> l'Union Douanière <strong>de</strong> l’EAC. S’ilimporte sans autorisation, les importateurs pourraient payer 100% <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> douane, ce quiélèverait le prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> importé. Avec autorisation, il y a application d’un tarif ré<strong>du</strong>it.Toutefois, la société paraétatique qui est la seule pro<strong>du</strong>ctrice <strong>de</strong> <strong>sucre</strong>, à savoir la SOSUMO,ne cesse d’affirmer pro<strong>du</strong>ire et mettre sur le marché une quantité suffisante pour toute lapopulation burundaise. Selon elle, il se pose un problème <strong>de</strong> distribution et <strong>de</strong> spéculation surcette <strong>de</strong>nrée si bien que le prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> qui est officiellement <strong>de</strong> 1 500 FBu par kg (1,2 $US)s'achète aujourd'hui jusqu'à 2 500 FBu (1,98$US) sur un marché illégal. A côté <strong>de</strong>mécanismes transitoires, tels que la supervision <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> distribution et <strong>de</strong> vente <strong>du</strong><strong>sucre</strong> dans le pays, le gouvernement avait annoncé la mise en place d’un mécanisme structurelconsistant en une politique <strong>de</strong> libéralisation <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> <strong>de</strong>puis début2007. Il était atten<strong>du</strong> que la libération <strong>du</strong> prix résorbe cette pénurie.Mais la pénurie persistante rend compte <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> ces mécanismes. C’est la raison pourlaquelle cet article se propose <strong>de</strong> contribuer à la compréhension <strong>de</strong> la problématique <strong>de</strong><strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> au Burundi. Il sera structuré autour <strong>de</strong> trois parties. <strong>La</strong> premièrepartie abor<strong>de</strong> l’approche microéconomique d’un marché en termes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. <strong>La</strong><strong>de</strong>uxième partie conceptualise cette analyse autour <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> burundais etnotamment sur la base <strong>de</strong>s éléments d’une étu<strong>de</strong> diagnostique sur les effets <strong>de</strong> la libéralisation* Dr Ephrem NIYONGABO est chercheur professionnel à l’IDEC, volet « Promotion <strong>du</strong> Secteur Privé,Intégration Economique et Politiques Commerciales » (adresse : eniyongabo@i<strong>de</strong>cburundi.<strong>org</strong>).1 Déclaration <strong>de</strong> la ministre burundaise ayant le commerce dans ses attributions quand elle répondait auxquestions orales <strong>de</strong>s députés à l'Assemblée Nationale le 17/11/2011 (www.arib.info, « Sucre: le Burundi va<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à l'EAC une autorisation d'importation »).1
<strong>de</strong> ce marché. <strong>La</strong> troisième partie est consacrée à l’état <strong>de</strong>s lieux actuel, avant <strong>de</strong> déboucher à<strong>de</strong>s recommandations.1. Approche microéconomique d’un marché en termes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> 2L’économie est divisée en <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s branches, à savoir la microéconomie et lamacroéconomie. <strong>La</strong> microéconomie traite <strong>du</strong> comportement d’unités ou d’agentséconomiques indivi<strong>du</strong>els, qui comprennent les consommateurs, les travailleurs, lesinvestisseurs, les propriétaires terriens, et les chefs d’entreprises, soit tous les agents jouant unrôle dans le fonctionnement d’une économie. Elle explique comment et pourquoi ces unitésprennent <strong>de</strong>s décisions économiques, et s’occupe aussi <strong>de</strong> la manière dont les agentsinteragissent pour former <strong>de</strong>s unités plus gran<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s marchés et <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries. En étudiant lecomportement et les interactions <strong>de</strong>s entreprises indivi<strong>du</strong>elles et <strong>de</strong>s consommateurs, lamicroéconomie montre comment les secteurs d’activités et <strong>de</strong>s marchés fonctionnent etévoluent, et comment ils réagissent aux politiques publiques et aux conditions économiques.Quant à la macroéconomie, elle traite <strong>de</strong> quantités économiques agrégées, telles que le niveauet le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction, les taux d’intérêt, le chômage et l’inflation. Mais lesfrontières entre la microéconomie et la macroéconomie sont <strong>de</strong> plus en plus floues ces<strong>de</strong>rnières années. <strong>La</strong> raison en est que la macroéconomie s’est engagée dans l’analyse <strong>de</strong>smarchés, comme les marchés <strong>de</strong>s biens et services, <strong>du</strong> travail et <strong>de</strong>s obligations. Pour saisir lefonctionnement <strong>de</strong> ces marchés, il faut analyser le comportement <strong>de</strong>s entreprises, <strong>de</strong>sconsommateurs, <strong>de</strong>s travailleurs, et <strong>de</strong>s investisseurs qui en font partie. <strong>La</strong> majeure partie <strong>de</strong>la macroéconomie s’intéresse <strong>de</strong> plus en plus aux fon<strong>de</strong>ments microéconomiques <strong>de</strong>sphénomènes économiques globaux. De ce fait, elle constitue une extension <strong>de</strong> l’analysemicroéconomique.2 Les développements qui suivent s’inspirent <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ouvrages <strong>de</strong> référence en microéconomie. D’abord,PINDYCK Robert et RUBINFELD Daniel (2009), Microeconomics, 7 th Edition, Pearson E<strong>du</strong>cation Inc./PrenticeHall, adapté en français par SOLLOGOUB Michel (2009), Microéconomie, 7 ème Edition, Pearce E<strong>du</strong>cationFrance, Paris. Ensuite, une tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> : Economics. Principles and Policy, Canadian Edition ;Microeconomics <strong>de</strong> BAUMOL, W.J., BLINDER, A.S., SCARTH, W.M. (1986), tra<strong>du</strong>it par LESSARD Michel(1986), L’Economique. Principes et Politiques : Micro-économie, Edition Etu<strong>de</strong>s Vivantes, Québec, Canada.2
Une approche microéconomique s’avère dès lors appropriée pour notre problématique portantsur le fonctionnement <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> burundais. L’une <strong>de</strong>s meilleures façons <strong>de</strong> montrerla pertinence <strong>de</strong> cette approche est <strong>de</strong> commencer par exposer les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong>la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, lesquels ai<strong>de</strong>nt à comprendre le mécanisme <strong>du</strong> marché ainsi que lesconséquences <strong>de</strong>s contraintes à ce mécanisme.1.1. Analyse en termes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>L’analyse en termes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est un outil puissant applicable à une gran<strong>de</strong>diversité <strong>de</strong> phénomènes économiques 3 , notamment (i) la compréhension <strong>de</strong> l’effet <strong>de</strong>l’évolution <strong>de</strong>s conditions économiques mondiales sur les prix <strong>de</strong> marché et sur lapro<strong>du</strong>ction ; (ii) l’évaluation <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong>s contrôles <strong>de</strong>s prix par l’Etat, ou <strong>de</strong>s effets <strong>du</strong>salaire minimum, <strong>du</strong> soutien <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>s subventions à la pro<strong>du</strong>ction ; (iii) l’estimation <strong>de</strong>l’influence <strong>de</strong>s taxes, <strong>de</strong>s subventions, <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> douane, <strong>de</strong>s quotas d’importation sur lesconsommateurs et les pro<strong>du</strong>cteurs.Les courbes <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sont utilisées pour décrire le mécanisme <strong>de</strong> marché.En l’absence d’intervention <strong>de</strong> l’Etat par le contrôle <strong>de</strong>s prix ou par toute autre politique <strong>de</strong>régulation, l’interaction <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> con<strong>du</strong>it à un équilibre et détermine ainsi leprix <strong>de</strong> marché et la quantité totale pro<strong>du</strong>ite. Les variations dans le temps <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>squantités dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la façon dont l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> réagissent aux autres variableséconomiques. Les courbes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ai<strong>de</strong>nt à analyser une série <strong>de</strong> phénomènes,telle que les pénuries sur certains marchés, l’influence <strong>de</strong> l’annonce <strong>de</strong>s politiques publiqueset <strong>de</strong> la prédiction <strong>de</strong>s conditions économiques futures sur les marchés bien avant que cespolitiques et ces conditions ne soient mises en œuvre ou réalisées.<strong>La</strong> courbe d’offre représente la quantité <strong>de</strong> biens qu’un pro<strong>du</strong>cteur est disposé à vendre pourun certain prix, tous les autres facteurs susceptibles d’influencer la quantité offerte restantconstants. Sa pente est positive ; en d’autres termes, plus le prix est élevé, plus les entreprisesvont pro<strong>du</strong>ire et vendre. Toutefois, d’autres variables peuvent influencer les quantités offertes,notamment les coûts <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, les salaires, les charges d’intérêt et le coût <strong>de</strong>s matières3 PINDYCK, R, RUBINFELD, D. (2009), Op.Cit.3
premières. <strong>La</strong> courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> montre les quantités <strong>de</strong> biens que les consommateurs sontdisposés à acheter quand le prix unitaire change. Sa pente est négative ; autrement dit, lesconsommateurs sont disposés à acheter davantage d’un bien lorsque son prix diminue.Néanmoins, les quantités <strong>de</strong>mandées peuvent aussi dépendre d’autres variables, comme leprix d’autres biens, mais surtout le revenu.1.2. Le mécanisme <strong>de</strong> marchéEn examinant ensemble les courbes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, l’équilibre est obtenu à un niveau<strong>de</strong> prix et quantité d’équilibre où les <strong>de</strong>ux courbes se croisent. Le mécanisme <strong>de</strong> marché est latendance qu’ont les prix, dans un marché sans entraves, à se modifier jusqu’à ce qu’il y aitéquilibre, c'est-à-dire jusqu’à ce que la quantité offerte et la quantité <strong>de</strong>mandée soient égales.Il se peut que l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne soient pas toujours en équilibre, et certains marchés neparviennent pas rapi<strong>de</strong>ment à l’équilibre quand les conditions changent brusquement.Cependant, la tendance est à l’équilibre <strong>de</strong>s marchés.Quand le prix initial est au <strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> prix d’équilibre, les pro<strong>du</strong>cteurs vont tenter <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ireet vendre <strong>de</strong>s quantités plus importantes que celles que les consommateurs sont disposés àacheter. Il en résultera un excès d’offre ou excé<strong>de</strong>nt, situation dans laquelle la quantité offerteest supérieure à la quantité <strong>de</strong>mandée. Afin <strong>de</strong> vendre ce surplus, ou au moins d’empêcherqu’il n’augmente, les pro<strong>du</strong>cteurs commenceront à baisser les prix. Par la suite, la quantité<strong>de</strong>mandée augmente à mesure que les prix baissent, et la quantité offerte diminue jusqu’à ceque le prix d’équilibre soit atteint.On se trouverait dans une situation inverse si le prix initial était inférieur au prix d’équilibre.Une pénurie, c'est-à-dire une situation dans laquelle la quantité <strong>de</strong>mandée est supérieure à laquantité offerte apparaîtrait, et les consommateurs ne pourraient pas acheter les quantitéssouhaitées. Cela entraînerait une pression à la hausse sur les prix car les consommateurstenteraient <strong>de</strong> renchérir pour acheter les quantités disponibles et les pro<strong>du</strong>cteurs réagiraient enélevant les prix et en augmentant la pro<strong>du</strong>ction. A nouveau, le prix finirait par atteindre le prixd’équilibre.4
Toutefois, le modèle d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> n’est utilisé que dans certaines conditions. Eneffet, ce modèle suppose que pour chaque prix considéré, une quantité sera pro<strong>du</strong>ite etven<strong>du</strong>e. Cette hypothèse n’est valable que lorsque, au moins dans les gran<strong>de</strong>s lignes, lemarché est concurrentiel. On entend par là que les ven<strong>de</strong>urs et les acheteurs ont un faiblepouvoir <strong>de</strong> marché, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas indivi<strong>du</strong>ellement la capacité d’influersignificativement sur le prix <strong>de</strong> marché. Si à l’inverse l’offre est contrôlée par un uniquepro<strong>du</strong>cteur, c'est-à-dire un monopole (ce modèle est également limité dans le cas d’unmonopsone), il n’y a plus <strong>de</strong> relation univoque simple entre le prix et la quantité.Nous nous intéressons au monopole, d’autant que c’est la situation <strong>de</strong> la SOSUMO. Unmonopole étant le seul pro<strong>du</strong>cteur d’un pro<strong>du</strong>it spécifique, la courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à laquelle ilfait face est la courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> marché. <strong>La</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> marché fait correspondre le prix<strong>du</strong> bien à la quantité que le monopole offre. Le monopole peut profiter <strong>de</strong> ce contrôle sur leprix, et le prix et les quantités qui maximisent alors le profit diffèrent <strong>de</strong> ceux prévalant sur unmarché concurrentiel. Le comportement <strong>du</strong> monopole dépend <strong>de</strong> la pente et <strong>de</strong> la position <strong>de</strong>la courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Selon la manière dont se déplace la courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, il peut êtredans l’intérêt <strong>du</strong> monopole <strong>de</strong> conserver la quantité fixée mais <strong>de</strong> changer le prix ou <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>rle prix fixe et <strong>de</strong> changer la quantité.En général, la quantité offerte par le monopole est inférieure à la quantité offerte sur unmarché concurrentiel et le prix est supérieur. Cette situation impose un coût à la société, carun nombre moins élevé <strong>de</strong> consommateurs achètent le bien, et ce, à un prix plus élevé. Lessituations <strong>de</strong> monopole pur sont rares, mais sur <strong>de</strong> nombreux marchés, un nombre limitéd’entreprises sont en concurrence. Ces entreprises sont en mesure d’affecter le prix etd’imposer un prix supérieur au coût marginal (l’égalisation <strong>du</strong> coût marginal à la recettemarginale est la règle <strong>de</strong> maximisation <strong>du</strong> profit <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur, qu’il s’agisse d’un marchéconcurrentiel ou non).1.3. Contraintes imposées au mécanisme <strong>du</strong> marché : cas <strong>du</strong> prix plafondLe jeu <strong>du</strong> marché libre a souvent indisposé les gouvernements, qui s’en prennent souvent à la« main invisible ». Les gouvernements ont souvent cherché à augmenter ou à baisser les prix<strong>de</strong> certains biens, sous prétexte que les prix étaient trop bas ou trop élevés, ou à intervenir5
sous d’autres formes telles que le contrôle <strong>du</strong> taux <strong>de</strong> change, l’imposition <strong>de</strong> taxes ou l’octroi<strong>de</strong> subventions. Nous nous intéressons au prix plafond, parce que cette pratique prévaut sur lemarché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> burundais.Toutefois, le marché est redoutablement capable <strong>de</strong> résister à ceux qui tentent <strong>de</strong> contrecarrerson fonctionnement. Toutes les décisions prises dans le but <strong>de</strong> fixer un prix plafond ont étésuivies d’une chaîne <strong>de</strong> conséquences 4 . Une première conséquence est qu’il se pro<strong>du</strong>it unepénurie persistante <strong>de</strong>s biens visés par le contrôle <strong>de</strong>s prix. Pour ce prix plus bas, lespro<strong>du</strong>cteurs, particulièrement ceux qui ont <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction élevés, vont pro<strong>du</strong>iremoins, et la quantité offerte va baisser. D’autre part, les consommateurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rontdavantage pour ce prix plus bas, auquel ils aimeraient acheter la quantité pro<strong>du</strong>ite. <strong>La</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> est supérieure à l’offre. Pour suppléer au système <strong>de</strong> distribution découlant <strong>de</strong>smécanismes <strong>de</strong> prix, les autorités doivent mettre au point diverses formules transitoires etsouvent inefficaces, comme le rationnement. Un exemple beaucoup cité est celui <strong>du</strong> contrôle<strong>de</strong>s prix d’essence aux Etats-Unis, en 1979, qui avait donné lieu à <strong>de</strong> longues files d’attente àl’entrée <strong>de</strong>s stations-service.Une <strong>de</strong>uxième conséquence est qu’un marché illégal ou un « marché noir » se met en place envue <strong>de</strong> distribuer <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its visés par les restrictions. Il y aura toujours <strong>de</strong>s indivi<strong>du</strong>s quiacceptent <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s risques pour satisfaire illégalement la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, quand lesmécanismes légaux se révèlent insuffisants. Une troisième conséquence est que les prix <strong>du</strong>marché noir sont presque toujours plus élevés que ceux qui auraient cours sur un marché libre.Ceux qui prennent le risque <strong>de</strong> mener <strong>de</strong>s activités illégales s’atten<strong>de</strong>nt à une importantecompensation. Une quatrième conséquence est qu’une partie substantielle <strong>du</strong> prix <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>itsvisés par les restrictions vont enrichir les agents <strong>du</strong> marché noir au lieu <strong>de</strong> revenir à unfabricant, à un pro<strong>du</strong>cteur, à un distributeur ou à <strong>de</strong>s investisseurs.Cette situation est illustrée par le contrôle <strong>de</strong>s loyers à New York. Comme l’indiquent Baumolet al. (1986) 5 , New York est la seule gran<strong>de</strong> ville en Amérique <strong>du</strong> nord à avoir mis en vigueur<strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s loyers <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième guerre mondiale. L’objectif d’un4 PINDYCK, R, RUBINFELD, D. (2009), Op.Cit. ; BAUMOL, W.J., BLINDER, A.S., SCARTH, W.M. (1986),Op.Cit.5 BAUMOL, W.J., BLINDER, A.S., SCARTH, W.M. (1986), Op.Cit.6
Loyer (en dollars par mois)tel contrôle était <strong>de</strong> protéger les locataires contre <strong>de</strong>s loyers excessifs. Cependant, la plupart<strong>de</strong>s économistes s’accor<strong>de</strong>nt qu’une telle mesure ne sert ni la ville ni la population, et qu’àlong terme, presque tout le mon<strong>de</strong> y perd.Cet argument est appuyé sur l’analyse <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à partir <strong>du</strong> graphique 1, surlequel DD est la courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et OO, la courbe d’offre. En l’absence <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong>contrôle, l’équilibre <strong>de</strong>vrait s’établir en un point E, qui correspond à 3 millions d’unités <strong>de</strong>logement et un loyer <strong>de</strong> 600 $US par mois. Dans le cadre d’un programme efficace <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong>s loyers, le prix plafond <strong>de</strong>vrait être inférieur à 600$. A un prix plafond plus bas,par exemple, 350$, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> logements atteindrait 3,5 millions d’unités (point B) alorsque l’offre baisserait à 2,5 millions d’unités (point C). Ainsi, on constate une pénurie d’unmillion <strong>de</strong> logements, concrétisant ainsi la notion théorique <strong>de</strong> « pénurie » par un taux <strong>de</strong>vacance <strong>de</strong>ux fois plus faible que la moyenne nationale <strong>de</strong>s Etats-Unis.Graphique 1. Graphique <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> logementsDO600Loyer<strong>du</strong> marchéE350r0Prix plafond<strong>de</strong>locationOCBD02,533,5Source : Baumol et al., 1986, p.74Nombre d’habitations (en millions)Comme cela a été souligné tantôt, le modèle d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est plus adapté pour unmarché et moins pour un marché monopolistique à l’instar <strong>de</strong> la position <strong>de</strong> la SOSUMO dansla pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>. Néanmoins, il pourrait s’appliquer au niveau <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong><strong>de</strong> cette <strong>de</strong>nrée.7
Pour revenir au contrôle <strong>de</strong>s loyers, celui-ci a donné naissance, dans tous les quartiers <strong>de</strong> laville, à un marché noir très actif, et <strong>de</strong>s moyens divers ont été imaginés pour hausser le prix <strong>de</strong>location <strong>de</strong>s appartements assujettis au contrôle, tels que <strong>de</strong>s pots <strong>de</strong> vin et le « dépôt sur laclé» 6 . <strong>La</strong> baisse <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> logements s’explique par un certain nombre <strong>de</strong> facteurs.D’abord, certains propriétaires, découragés par la faiblesse <strong>de</strong>s loyers, ont transformé leursimmeubles rési<strong>de</strong>ntiels en édifices à bureaux ou les ont consacrés à d’autres usages. Ensuite,d’autres ont négligé ou même cessé totalement d’entretenir leurs propriétés. En effet, enraison <strong>de</strong> la pénurie créée par le programme <strong>de</strong> contrôle, ils n’éprouvaient aucune difficulté àlouer les logements délabrés ou insalubres. Enfin, bon nombre <strong>de</strong> propriétaires ont décidéd’abandonner leurs immeubles plutôt que <strong>de</strong> payer <strong>de</strong>s taxes et factures <strong>de</strong> chauffage tropélevés.Compte tenu <strong>de</strong> ces effets adverses, on peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pourquoi <strong>de</strong> tels programmespersistent. Baumol et ses collaborateurs avancent notamment le manque <strong>de</strong> compréhension<strong>de</strong>s problèmes qui découlent <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> contrôle, <strong>de</strong>s considérations politiciennes, <strong>de</strong>savantages générés pour certains. Ainsi, certains locataires New Yorkais ne payaient qu’unefraction <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> location qui prévaut sur un marché concurrentiel. De manière générale, lafixation d’un prix plafond ou plancher donne naissance à un regroupement <strong>de</strong> personnes quiont tout intérêt à maintenir <strong>de</strong> tels règlements, en raison <strong>de</strong>s avantages qu’elles en retirent. Cespersonnes se servent <strong>de</strong> leur influence politique afin <strong>de</strong> protéger leurs privilèges. C’estnotamment ce qui explique la difficulté d’abolir <strong>de</strong>s programmes visant à contrôler les prix.2. Conceptualisation <strong>de</strong> l’approche autour <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> burundais: élémentsd’une étu<strong>de</strong> diagnostiqueCette partie s’appuie sur une étu<strong>de</strong> effectuée en 2007 sur la stratégie <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> lafilière <strong>sucre</strong> (Tollens et al, 2007) 7 . En 2007, le marché national était déficitaire d’au moins5000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> brun, et il était atten<strong>du</strong> que ce <strong>de</strong> déficit augmente avec la croissanceéconomique liée à la stabilisation progressive <strong>de</strong> la situation politique. Jusqu’en août 2007,6 Que l’aspirant locataire verse afin d’avoir accès plus rapi<strong>de</strong>ment à un logement libre ou encore achat obligatoireet à prix fort, par l’éventuel locataire, d’un mobilier sans valeur.7 TOLLENS, E., DONDERS, B., SAUMTALLY, S. (2007), Diagnostique <strong>de</strong> la compétitivité <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong>développement <strong>de</strong> la filière <strong>sucre</strong> au Burundi, PAGE/IDA, Bujumbura.8
c’est une Commission Interministérielle qui étudiait le marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> et fixait les prix, àtravers une ordonnance ministérielle, en fonction <strong>de</strong> plusieurs paramètres, dont le prix <strong>de</strong>revient. De janvier 2006 au 7 août 2007, le prix <strong>de</strong> détail <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> a été fixé à 750 FBU, soitenviron 0.68 $US par kg (US$ 682/tonne), et le prix <strong>de</strong> gros était fixé à 32 111 FBU par sac<strong>de</strong> 50 kg (soit US$ 584/tonne).En fixant les prix au niveau <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> gros et <strong>de</strong> détail, les marges commercialesétaient également fixées, ce qui ne laissait pas <strong>de</strong> liberté pour <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> promotion oupour une politique commerciale, qui n'avait alors pas <strong>de</strong> sens. En effet, le marché nationaln’était pas entièrement satisfait et on trouvait rarement <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> présent ouvertement dans lesmagasins. Un programme <strong>de</strong> vente couvrait toute l'année, mois par mois, et province parprovince, et une quantité totale <strong>de</strong> 1 446 tonnes par mois était mise sur le marché. Jusque là, iln'y a que peu d'exportations officielles (tableau 1). Alors que les exportations clan<strong>de</strong>stinesétaient jugées peu importantes, il y actuellement un soupçon d’exportations frau<strong>du</strong>leusesimportantes 8 .Tableau 1 : Pro<strong>du</strong>ction, importations, exportations et consommation apparente <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>.Pro<strong>du</strong>ction(P)Importations (M)Exportations(X)Consommationapparente(P+M-X)Population totaleKgparpersonne2001 18 186 1 447 2 910 16 723 6 499 653 2,572002 17 661 1 616 4 858 14 419 6 656 071 2,172003 20 268 4 573 3 163 21 678 6 838 764 3,172004 20 152 3 127 8 378 14 901 7 039 534 2,122005 19 058 930 2 050 17 938 7 251 424 2,472006 18 147 5 687 1 000 22 834 7 474 363 3,052007 20 213 6 209 2 000 24 422 7 707 781 3,162008 18 233 6 137 2 500 21 870 7 943 385 2,752009 14 314 5 901 3 000 17 215 8 170 853 2,112010 18 937 13 564 n.a. 8 382 8492011 20 501 6 472 (janvier-août) n.a.Source: Tollens et al (2007), Op.Cit. ; BRB (2011), Statistiques, www.brb.bi (consulté le 27/12/2011) ;World Bank (2011), World Development Indicators 2010 (consulté le 27/12/2011).8 «Pénurie <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> à cause <strong>de</strong>s exportations frau<strong>du</strong>leuses », publié sur www.iwacu-burundi.<strong>org</strong> le 23/11/2011.9
Dès le 7 août 2007, tout a changé. L’arrêté 124/VP/12 <strong>du</strong> 07 août 2007 relatif à la<strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> arrête dans son article 1 que la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> estlibéralisée 9 . Dans le cadre <strong>de</strong> cette libéralisation, la SOSUMO a décidé d’augmenter le prix audétail à 1000 FBu par kg. <strong>La</strong> conséquence immédiate a été que peu <strong>de</strong> grossistes étaientencore intéressés à acheter à la SOSUMO, que la consommation <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> avait diminué etqu’on trouvait alors un peu partout <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> à <strong>de</strong>s prix variables oscillant autour <strong>de</strong> 1 000 FBupar kg au détail sur les marchés et dans les magasins. Selon l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Tollens et al (2007) 10 ,la libération <strong>du</strong> prix allait con<strong>du</strong>ire à un équilibre entre l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Et même si onn’observait pas encore <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> brun importé au détail dans les magasins au Burundi, cela ne<strong>de</strong>vrait être qu’une question <strong>de</strong> temps. Pour ces auteurs, le marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> se trouvait doncdans une pério<strong>de</strong> transitoire entre un régime entièrement régulé par l'Etat et une société d'Etatet un régime complètement libéralisé. <strong>La</strong> libéralisation allait permettre d’éviter les pénuries<strong>de</strong> <strong>sucre</strong>, et le prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> suivrait <strong>de</strong> plus près les prix <strong>du</strong> marché mondial.Aussi, l’étu<strong>de</strong> tablait sur la force <strong>de</strong> la SOSUMO <strong>de</strong> faire face à la concurrence <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>importé et donc <strong>de</strong> rationaliser son outil <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction et chercher <strong>de</strong> nouvelles opportunitéspour assurer sa croissance. Néanmoins, elle avait relevé aussi <strong>de</strong>s faiblesses dans le système<strong>de</strong> distribution. D’abord, la pério<strong>de</strong> transitoire allait prendre <strong>du</strong> temps, et mêmes lesimportateurs, au début, auraient tendance à aligner les prix à ceux <strong>de</strong> la SOSUMO, vu le poids<strong>de</strong> celle-ci. Ensuite, les prix <strong>de</strong> gros et <strong>de</strong> détail allaient fluctuer plus qu’avant et unepolitique sociale (<strong>du</strong> <strong>sucre</strong> bon marché à la portée <strong>de</strong> tous, y compris les plus pauvres), neserait plus possible, sauf s’il y a intervention directe <strong>de</strong> l’Etat en leur faveur par une politiqueciblée (mais il n’est pas prouvé que les plus pauvres avaient accès au <strong>sucre</strong> au prix garanti).Enfin, le système <strong>de</strong> distribution ne serait efficace qu’en présence d’une concurrence effectiveavec le <strong>sucre</strong> importé. Pour cela, il faudrait qu’il y ait <strong>de</strong>s importateurs <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> sur le marchéburundais qui mènent une politique <strong>de</strong> distribution efficace.Six mois à un an après la libéralisation, s’il n’y avait pas émergence d’importateurs <strong>de</strong> <strong>sucre</strong>,autrement dit si le monopole <strong>de</strong> la SOSUMO se maintenait, il y aurait eu un certain « échec <strong>de</strong>marché » et il faudrait une intervention publique pour favoriser l’émergence <strong>de</strong> la9 Arrêté n°124/VP/2007 <strong>du</strong> 07/Août/2007 relatif à la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>, Deuxième Vice- Prési<strong>de</strong>nce.10 TOLLENS, E., DONDERS, B., SAUMTALLY, S. (2007), Op. Cit.10
concurrence, en partie à partir <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> importé qui ferait concurrence au <strong>sucre</strong> pro<strong>du</strong>itlocalement.3. Quel est l’état <strong>de</strong>s lieux actuel ?Un peu plus <strong>de</strong> trois ans après l’annonce <strong>de</strong> la libéralisation <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>,la pénurie <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>nrée s’est au contraire accentuée, <strong>de</strong>venant une préoccupation ausomment <strong>de</strong> l’Etat 11 , ce malgré l’augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction à la SOSUMO 12 . En effet, lapro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> qui était <strong>de</strong> 14 137 tonnes en 2009 est passée à 18 937 tonnes en 2010 età 20 501 tonnes en 2011 (tableau 1). Néanmoins, la population continue <strong>de</strong> se lamenter <strong>de</strong> lapénurie <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> et par conséquent d’un prix exorbitant, au moment où la SOSUMO metactuellement sur le marché 1 528 tonnes 13 <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> par mois contre 1 446 tonnes en 2007.Parmi les facteurs pouvant expliquer pourquoi la libéralisation <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong><strong>sucre</strong> n’est par arrivée à résorber cette pénurie, nous proposons les limites liées à laconception même <strong>de</strong> cette politique, la persistance <strong>du</strong> contrôle <strong>de</strong>s prix et la situation sur lemarché régional.3.1. Les limites <strong>de</strong> la conception <strong>de</strong> libéralisation <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong><strong>La</strong> libéralisation <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> <strong>de</strong>vrait ai<strong>de</strong>r, entre autres, à faire émerger<strong>de</strong>s importateurs <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> afin <strong>de</strong> mettre le <strong>sucre</strong> <strong>de</strong> la SOSUMO en concurrence avec le <strong>sucre</strong>importé (Tollens et al., 2007) 14 . Le tableau 1 indique que les quantités importées ontlégèrement augmenté après la libéralisation. Cependant, comme avant la libéralisation, cesimportations restent essentiellement le fait <strong>de</strong> la BRARUDI pour sa pro<strong>du</strong>ction.Selon un entretien que nous avons eu avec un haut cadre <strong>du</strong> ministère ayant le commerce etl’in<strong>du</strong>strie dans ses attributions, il n’y a pas eu émergence d’importateurs. En effet, <strong>de</strong>s11 «Le Deuxième Vice- Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République recomman<strong>de</strong> la vigilance, la rigueur et le respect <strong>de</strong> la loidans la distribution et la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> pro<strong>du</strong>it par la SOSUMO », publié sur le site <strong>de</strong> laprési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la république www.presi<strong>de</strong>nce.bi le 15/11/2012.12 « Pénurie <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> au Burundi malgré une hausse <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction locale », publié sur www.arib.info le26/12/2012.13 « <strong>La</strong> SOSUMO augmente sa pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 45% en 2 ans et ses bénéfices <strong>de</strong> 255% », publié surwww.iwacu-burundi.<strong>org</strong> le 27/12/2012.14 TOLLENS, E., DONDERS, B., SAUMTALLY, S. (2007), Op.Cit.11
premières tentatives d’importation ont eu lieu en 2009. Les importateurs ont obtenu <strong>de</strong> fauxcertificats d’origine, permettant <strong>de</strong> faire entrer <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> indien très moins cher mais soi-disantétait d’origine ougandaise, ce qui a mis à mal la situation commerciale et financière <strong>de</strong> laSOSUMO.Par conséquent, l’Etat fait tout pour inhiber l’émergence <strong>de</strong> la concurrence en vue <strong>de</strong> protégerla SOSUMO qui, conformément même aux missions essentielles <strong>de</strong>s entreprises publiques,est chargée d’une dimension sociale importante, à savoir la satisfaction <strong>de</strong> besoins sociauxfondamentaux à moindre coût entre autres 15 . Cela témoigne <strong>de</strong>s limites dans la conceptionmême <strong>de</strong> cette libéralisation. De plus, la libéralisation d’un marché ne peut être effective quesi elle est liée à la privatisation <strong>de</strong>s entreprises publiques opérant sur ce marché. En d’autrestermes, la libéralisation n’arrivera probablement à favoriser la concurrence que si elles’accompagne d’une réglementation décourageant les pratiques anticoncurrentielles 16 . C’estdans cette optique qu’on peut interpréter l’argument <strong>du</strong> risque <strong>de</strong> prédation, qui implique lapossibilité qu’une entreprise publique, <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> l’appui financier dont il bénéficie <strong>de</strong> la part<strong>de</strong> l’Etat, soit à même d’adopter <strong>de</strong>s pratiques propres à décourager les nouveaux arrivants,par exemple, en ramenant les prix au niveau voire en <strong>de</strong>ssous <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> revient. Dans cetteperspective, la libéralisation a peu <strong>de</strong> chance d’être pleinement efficace sans privatisation.L’intensification <strong>de</strong> la concurrence peut être limitée par un certain nombre <strong>de</strong> facteurs, parmilesquels on peut souligner l’importance <strong>de</strong>s entreprises en situation <strong>de</strong> monopole naturel 17 ,peu sensible à la concurrence. Aussi, il se peut que la concurrence ne soit pas appropriée sil’entreprise en situation <strong>de</strong> monopole subventionne ses activités déficitaires au moyen <strong>de</strong>sbénéfices provenant <strong>de</strong>s actions rentables. Or, si on se réfère au programme <strong>de</strong> privatisation<strong>du</strong> service chargé <strong>de</strong>s entreprises publiques (SCEP), la SUSOMO ne figure pas parmi lesentreprises à privatiser en priorité. Ceci est en partie dû à la relativement bonne santéfinancière par rapport à l’ensemble <strong>de</strong>s entreprises publiques. Il se pose donc la question <strong>de</strong>savoir si on peut libéraliser la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> sans privatiser la SOSUMO.15 NIYONGABO, E. (forthcoming), « Bilans <strong>de</strong> la privatisation en Afrique subsaharienne. Leçons et perspectivespour le Burundi », RIDEC.16 HEMMING, R., MANSOOR, A.M. (1986), Privatisation <strong>de</strong>s entreprises publiques, FMI, Département <strong>de</strong>sFinances Publiques, Washington DC.17 Dans la théorie économique, une branche d'activité est en situation <strong>de</strong> monopole naturel lorsque les économiesd'échelle y sont très fortes. Cette situation se présente le plus souvent lorsque l'activité <strong>de</strong> la branche est fondéesur l'utilisation d'un réseau au coût très élevé, ce qui tend à donner un avantage déterminant à l’entreprisedominante puis, après disparition <strong>de</strong>s concurrents, con<strong>du</strong>it à une situation <strong>de</strong> monopole.12
4.2. Persistance <strong>du</strong> contrôle <strong>de</strong>s prixDans la suite <strong>du</strong> point précé<strong>de</strong>nt, on peut argumenter qu’il persiste une pratique <strong>de</strong> contrôle <strong>du</strong>prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>. En effet, « le <strong>sucre</strong> fait partie <strong>de</strong>s rares pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> large consommation encoresubventionnés par l’Etat au Burundi et quand on en trouve sur le marché local, ces <strong>de</strong>rnierstemps, il faut débourser parfois le double <strong>du</strong> prix autorisé » 18 . On peut considérer que lasubvention étatique intervient à travers la fixation <strong>de</strong>s prix par la SOSUMO, contrairement àl’argument <strong>de</strong> Tollens et al soutenant que cette fixation ne serait qu’une impression liée aufait que la SOSUMO fixe encore ses prix au gros et au détail.Le marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> burundais a les caractéristiques que nous avons soulignées au point 1.3comme conséquences <strong>du</strong> contrôle <strong>de</strong>s prix. Aussi, les prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> dans les pays voisins sontplus élevés que celui <strong>du</strong> Burundi, contribuant à expliquer les exportations frau<strong>du</strong>leuses. Pourles autorités politiques, le relèvement <strong>du</strong> prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> à un niveau proche <strong>du</strong> prix pratiquédans la sous-région éliminerait la spéculation et les frau<strong>de</strong>s, mais cela aurait aussi <strong>de</strong>sconséquences négatives, entre autres sur le prix au consommateur. Ce qui, selon un rapport <strong>de</strong>la commission chargée d’analyser la problématique <strong>de</strong> la distribution et <strong>de</strong> la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong><strong>sucre</strong> SOSUMO, serait difficile à expliquer pour une entreprise majoritairement étatique.3.3. Changements économiques mondiaux et situation <strong>du</strong> marché régional<strong>La</strong> pénurie <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> se fait aussi sentir actuellement sur le marché mondial. Le Brésil qui estces <strong>de</strong>rniers temps le premier pays pro<strong>du</strong>cteur consacre une partie <strong>de</strong> sa pro<strong>du</strong>ction à lafabrication <strong>de</strong> l’éthanol, tandis que les pays <strong>de</strong> l’Union Européenne connaissent une baisse <strong>de</strong>la pro<strong>du</strong>ction suite à la réforme <strong>de</strong> la régulation <strong>du</strong> marché sucrier 19 . En effet, une réformedécidée en 2005 implique notamment l'abolition à terme (2015) <strong>de</strong>s quotas aux pro<strong>du</strong>cteurs ;un prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> en Europe aligné sur le prix <strong>du</strong> marché mondial et donc une ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>sprix aux pro<strong>du</strong>cteurs; un régime <strong>de</strong> restructuration <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> encourageant <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>cteurs à18 « Pénurie <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> au Burundi malgré une hausse <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction locale », publié sur www.arib.info le26/12/2012.19 TOLLENS, E., DONDERS, B., SAUMTALLY, S. (2007) (2007), Op.Cit.13
quitter le secteur, à fermer <strong>de</strong>s usines non compétitives et <strong>de</strong>s suppressions <strong>de</strong> quotas afin <strong>de</strong>garantir l'équilibre <strong>du</strong> marché après une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition.L’évolution <strong>de</strong>s conditions économiques mondiales exerce un effet sur les prix <strong>de</strong> marché etsur la pro<strong>du</strong>ction. Cette pénurie sur le marché mondial n’est donc pas effet le marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>dans les pays proches <strong>du</strong> Burundi où la situation est déjà fortement déficitaire. En effet, selonl’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Tollens et al, la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> dans la zone EAC est autour <strong>de</strong> 940.000tonnes, pour une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,22 millions <strong>de</strong> tonnes. Les importations sont donc <strong>de</strong> l'ordre<strong>de</strong> 280.000 tonnes, dont 60% pour le Kenya.Ainsi, la consommation annuelle est <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 15 000 à 20 000 tonnes par an au Rwanda,alors que sa seule usine pro<strong>du</strong>it 4000 tonnes à 5 000 tonnes par an. Les coûts <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ctionsont relativement élevés, le <strong>sucre</strong> s’y vend donc cher, pratiquement le triple <strong>du</strong> prix <strong>du</strong>marché mondial. Les prix au Rwanda, au détail et au gros, sont le double <strong>de</strong> ceux <strong>du</strong> Burundi.En Tanzanie, la pro<strong>du</strong>ction totale <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> en 2006 était <strong>de</strong> 224 000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> brun,mais ce pays reste un importateur net <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 100 000 à 120 000 tonnes par an.<strong>La</strong> RDC, avec ses 60 millions d'habitants, est un marché potentiel très important, surtout lesprovinces <strong>du</strong> Nord et Sud Kivu proches <strong>du</strong> Burundi. Ce pays n'a qu'une seule usine <strong>de</strong>pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> en fonction, qui pro<strong>du</strong>it environs 70 000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> brun. Il importeactuellement plus que 100 000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> par an. Les centres urbains proches <strong>du</strong> Burundi(Uvira, Bukavu et Goma) représentent un marché <strong>de</strong> 10 000 à 12 000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> par an.Le Kenya est un grand pro<strong>du</strong>cteur et consommateur <strong>de</strong> <strong>sucre</strong>, avec une consommation <strong>de</strong> 700000 tonnes par an et une pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> 500 000 tonnes. Le coût <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction y est élevé, le<strong>sucre</strong> s’y vend au prix fort. Le pays est un grand importateur net. Néanmoins, l’importation àpartir <strong>du</strong> Burundi paraît difficile en raison <strong>de</strong>s coûts prohibitifs <strong>du</strong> transport par camion àtravers le Rwanda et l'Ouganda, comparé à l'importation <strong>du</strong> marché mondial.L'Ouganda pro<strong>du</strong>it 160 000 à 170 000 tonnes par an, mais la consommation annuelle dépasseles 200 000 tonnes. Il importe donc à peu près 40 000 tonnes <strong>de</strong> <strong>sucre</strong>. C’est donc unimportateur net important <strong>de</strong> <strong>sucre</strong>, mais les coûts <strong>de</strong> transport par camion entre Bujumbura etKampala étant prohibitifs, les importations se font sur le marché mondial.14
De manière générale, les pays proches <strong>du</strong> Burundi enregistrent <strong>de</strong>s déficits importants dans lapro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>sucre</strong>, tout en pratiquant <strong>de</strong>s prix forts élevés par rapport à ceux <strong>du</strong> Burundi,s’élevant à 4$ le kg au Kenya, 3,5$ en Tanzanie et 2,8$ au Rwanda 20 . Le Burundi ne pouvantexporter officiellement le <strong>sucre</strong> étant donné que le marché national est déjà déficitaire, etqu’en plus les prix sont contrôlés, on peut facilement imaginer que le <strong>sucre</strong> s’exporteclan<strong>de</strong>stinement vers certains pays voisins, notamment l’Est <strong>de</strong> la RDC, le Rwanda et laTanzanie.Conclusion et recommandationsDans cet article, nous avons cherché à contribuer à la compréhension <strong>de</strong> la problématique <strong>de</strong>pénurie <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> au Burundi. Une approche microéconomique en termes d’analyse <strong>de</strong> l’offreet <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a permis <strong>de</strong> cerner les effets <strong>de</strong> la structure monopolistique d’un marché.Celui-ci con<strong>du</strong>it à l’offre d’une quantité inférieure et à pratiquer un prix supérieur par rapportà une quantité et un prix qu’aurait permis un marché concurrentiel. De tels effets <strong>de</strong>vraientfaire l’objet d’une analyse approfondie au niveau <strong>de</strong> la SOSUMO. L’approchemicroéconomique a aussi permis d’étudier les effets <strong>du</strong> contrôle <strong>de</strong>s prix, et notamment leprix plafonds. Ces effets concernent en l’occurrence la pénurie résistante <strong>de</strong>s biens visés par lecontrôle <strong>de</strong>s prix, la mise en place d’un marché noir en vue <strong>de</strong> distribuer <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its viséspar les restrictions, la pratique par ce marché <strong>de</strong> prix plus élevés que ceux qui auraient courssur un marché libre, et l’enrichissement <strong>de</strong>s agents <strong>du</strong> marché noir plutôt que <strong>de</strong>sinvestisseurs. L’application <strong>de</strong> cette remarque sur la <strong>commercialisation</strong> <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> au Burundicontribue à expliquer la pénurie <strong>de</strong> ce pro<strong>du</strong>it et l’importance <strong>de</strong>s exportations frau<strong>du</strong>leusespour profiter <strong>de</strong>s prix élevés dans <strong>de</strong>s pays frontaliers.L’annonce <strong>de</strong> la libéralisation <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> visait alors à résorber cette pénurie, <strong>de</strong> parnotamment l’émergence <strong>de</strong> l’importation <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> pour concurrencer le <strong>sucre</strong> <strong>de</strong> la SOSUMO,mais cette concurrence n’a pas émergé. Parmi les raisons pouvant expliquer cela, on peutconsidérer que l’Etat est moins enthousiaste à l’idée <strong>de</strong> confronter la SOSUMO à la20 « Pénurie <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> à cause <strong>de</strong>s exportations frau<strong>du</strong>leuses », publié sur le www.iwacu-burundi.<strong>org</strong> le28/12/2011.15
concurrence étrangère. Ainsi, selon l’entretien que nous avons eu avec un haut cadre <strong>du</strong>ministère ayant le commerce et l’in<strong>du</strong>strie dans ses attributions, <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> a été importé en2008 mais a été enfermé à la douane dans <strong>de</strong>s conditions irrégulières. Ce qui <strong>de</strong>vrait d’ailleursfaire l’objet d’un procès entre l’Etat et ceux qui avaient initié ces importations. En plus, cettelibéralisation a été conçue très légèrement, notamment en n’étant pas associée à laprivatisation <strong>de</strong> la SOSUMO.Quelques recommandations peuvent alors être formulées en perspectives. Une premièrerecommandation, qui rejoint les gran<strong>de</strong>s lignes d’une proposition déjà formulée par Tollenset al., est d’accroître la compétitivité et la pro<strong>du</strong>ction tirer profit <strong>de</strong>s opportunités offertes parun vaste marché régional tout en augmentant l’offre sur le marché national. Selon unecorrespondance que la direction générale a adressée au cabinet <strong>de</strong> la ministre ayant lecommerce et l’in<strong>du</strong>strie dans ses attributions, cela nécessite un appel public <strong>de</strong> fonds sur lemarché national et international, pour un plan d’investissement s’élevant à 44 411 334 Euros,dont 29 620 167 euros pour l’investissement dans la SOSUMO, 4 306 112 Euros pourl’acquisition <strong>de</strong>s équipements agricoles, 10 485 035 pour l’aménagement <strong>de</strong>s terres etl’irrigation. Aussi, 4 900 000 $US sont nécessaires pour la distillerie.Une <strong>de</strong>uxième recommandation est d’approfondir la conception <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong>libéralisation <strong>du</strong> secteur. Cela impliquerait notamment que celle-ci soit liée à la privatisation<strong>de</strong> la SOSUMO. En effet, en dépit <strong>de</strong> la relativement bonne situation financière <strong>de</strong> laSOSUMO, les recherches sur la libéralisation-privatisation permettent <strong>de</strong> comprendrefacilement les inefficacités <strong>de</strong>s entreprises publiques en raison notamment <strong>de</strong>s interférencespolitiques dans la gestion. Pour la SOSUMO, en 2010, cette entreprise a fait objet <strong>de</strong>malversations importantes 21 . Quand ces malversations ont été révélées, l’opinion publique futpréoccupée <strong>du</strong> risque <strong>de</strong> faillite <strong>de</strong> cette entreprise et soupçonnait <strong>de</strong>s accointances entre sadirection générale et certaines hautes autorités dans sa gestion. Les principaux dirigeants <strong>de</strong>l’entreprise ont finalement été relevés <strong>de</strong> leurs fonctions et ont même atterri à la prison. L’Etat<strong>de</strong>vrait donc envisager <strong>de</strong> se retirer progressivement pendant que la SOSUMO présenteencore <strong>de</strong> meilleures perspectives pour intéresser <strong>de</strong>s repreneurs potentiels. Une réflexionapprofondie sur la libéralisation-privatisation <strong>de</strong>vrait aussi ai<strong>de</strong>r l’entreprise à se préparerprogressivement à faire face à la confronter à la concurrence. Cette recommandation ne laisse21 NSPECTION GENERALE DE L’ETAT (2010), Rapport sur la malversation à la SOSUMO, Bujumbura16
pas entendre que les privés seront plus nationalistes que la SOSUMO, mais s’appuie surl’hypothèse évoquée précé<strong>de</strong>mment, selon laquelle la libéralisation <strong>de</strong>vrait susciterl’importation <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> pour compléter et faire concurrence au <strong>sucre</strong> pro<strong>du</strong>it par la SOSUMO.Une troisième recommandation, sous forme <strong>de</strong> piste <strong>de</strong> réflexion, consiste en interrogation <strong>de</strong>savoir si on ne <strong>de</strong>vrait pas officialiser l’exportation <strong>de</strong> <strong>sucre</strong> et importer <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> moins cher.D’un côté, le <strong>sucre</strong> burundais fait objet d’exportations frau<strong>du</strong>leuses sur <strong>de</strong>s marchés où lesprix sont élevés, et enrichit uniquement les auteurs <strong>de</strong> ces exportations. D’un autre côté, <strong>du</strong><strong>sucre</strong> moins cher peut être importé sur le marché burundais, comme en témoignent lestentatives d’importer <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> soulignées tantôt en 2008 et 2009. C’est dans d’ailleurs en lareplaçant dans cette réflexion qu’on peut essayer <strong>de</strong> comprendre la volonté <strong>du</strong> gouvernement<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à l’EAC l'autorisation d'importer <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> complémentaire à celui qui est pro<strong>du</strong>itlocalement. En effet, les prix <strong>du</strong> <strong>sucre</strong> sur les marchés <strong>de</strong>s autres pays <strong>de</strong> l’EAC étant plusélevés que celui <strong>de</strong> la SOSUMO sur le marché burundais, le Burundi ne peut pas, en toutelogique, importer le <strong>sucre</strong> <strong>de</strong> ces pays pour ensuite le mettre en concurrence avec le <strong>sucre</strong>SOSUMO moins cher mais pourrait importer à partir d’autres pays hors <strong>de</strong> l’EAC.17
Normalisation, contrôle <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et services et contrepoids <strong>du</strong> secteurinformelLe contexte et position <strong>du</strong> problèmeParGervais NDUWIMANA, Chercheur ProfessionnelVolet « Statistique »Il nous apparaît souvent <strong>de</strong> constater que la sensibilisation à la pratique <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>normalisation et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la qualité 1 dans notre pays est insuffisante. On peut mêmepenser qu’elle est absente eu égard à leur niveau d’implication et <strong>de</strong>s enjeux dans tous lesdomaines <strong>de</strong> la vie, à savoir l’in<strong>du</strong>strie, le commerce, la santé publique, la sécurité publique,la protection <strong>de</strong> l’environnement, etc. Actuellement les défis <strong>du</strong> secteur <strong>de</strong> la normalisationsont très énormes pour le Burundi en particulier en ce qui concerne le contrôle <strong>de</strong> la qualité etla création <strong>de</strong>s normes nationales. Les défis dont il est question prioritairement se trouventêtre le processus d’intégration <strong>du</strong> Burundi dans l’économie mondiale et sous régional maisaussi le poids <strong>du</strong> secteur informel dans les structures économiques. <strong>La</strong> prolifération <strong>du</strong> secteurinformel au Burundi présente un risque énorme pour l’économie burundaise que très peu <strong>de</strong>gens s’en ren<strong>de</strong>nt compte. Dans cette note <strong>de</strong> veille, nous avons donc pensé qu’il faut menerune petite réflexion sur le secteur informel qui se présente en contrepoids <strong>de</strong> la dynamique <strong>de</strong>normalisation et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its fabriqués et consommés localement etaussi susceptible d’être ven<strong>du</strong> à l’extérieur <strong>du</strong> pays.Définition et cadre conceptuel<strong>La</strong> normalisation ne date pas d’aujourd’hui. Elle procè<strong>de</strong> d’une tendance naturelle <strong>de</strong>l’homme à s’<strong>org</strong>aniser et trouver <strong>de</strong>s solutions à ses problèmes. Au fil <strong>de</strong>s temps, l’homme amis au point <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s techniques pour assurer sa sécurité, améliorer la pro<strong>du</strong>ctivitéet la qualité <strong>de</strong>s biens et pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> consommation et d’exportation, protéger sonenvironnement, etc. Aujourd’hui, la normalisation est un outil et un processus essentiels àtous les niveaux <strong>de</strong> l’entreprise, provincial, national, régional et mondial. Elle fait l’objet <strong>de</strong>1 Le contrôle <strong>de</strong> la qualité élémentaire se trouve être, la métrologie. Cette notion est plus connue sous l’application <strong>de</strong>sactivités <strong>de</strong>s poids et mesures. Elle se définit comme l’ensemble <strong>de</strong>s théories et pratiques qui permettent d’effectuer <strong>de</strong>smesures et d’avoir une confiance suffisante dans leurs résultats ; cela va <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> mesures les plus courants commela balance et le mètre ruban utilisés dans les marchés, boutiques, etc. aux instruments les plus sophistiqués employés dans lesin<strong>du</strong>stries et les centres <strong>de</strong> recherche. Quant à la normalisation, elle regroupe l’ensemble <strong>de</strong>s activités qui consistent àélaborer les normes, les diffuser et les appliquer.18
gran<strong>de</strong>s <strong>org</strong>anisations internationales comme ISO (Organisation internationale <strong>de</strong>normalisation), par exemple. Tous les pays développés et émergeants disposent d’<strong>org</strong>anismesnationaux <strong>de</strong> normalisation qui participent à <strong>de</strong> nombreuses activités <strong>org</strong>anisées tous les joursà l’échelle mondiale. Aujourd’hui, la normalisation est considérée comme un <strong>de</strong>s piliers quisoutiennent la croissance <strong>de</strong>s pays émergeant et en transition.Selon, (François-Xavier et al, 2006), la normalisation 2 touche aujourd’hui la plupart <strong>de</strong>sdomaines d’activité économique, <strong>de</strong>s nouvelles technologies <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> lacommunication au management <strong>de</strong> la qualité, en passant par les territoires ou les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong>pro<strong>du</strong>ction agricole, ou les objets aussi usuels que les chariots <strong>de</strong> supermarché. De fait, si lanormalisation passe souvent pour un travail obscur et complexe engageant les quelques initiés<strong>de</strong>s domaines concernés, elle n’en <strong>de</strong>meure pas moins un véritable enjeu <strong>de</strong>s relationséconomiques mondiales. Normaliser est <strong>de</strong>venu une activité fondamentalement internationale.Les politiques <strong>de</strong> normalisation mettent en relation une multitu<strong>de</strong> d’acteurs publics et privés:<strong>org</strong>anisations internationales, administrations nationales, agences, centres <strong>de</strong> recherches,entreprises, associations, etc.Par ailleurs, dans les pays en développement, l'économie informelle peut représenter une partimportante <strong>du</strong> revenu <strong>de</strong>s ménages mais aussi une proportion particulièrement élevé <strong>du</strong> PIBcomme on le verra plus loin pour le cas <strong>du</strong> Burundi. Il n'est toutefois pas aisé <strong>de</strong> mesurerl'économie informelle et les revenus qu'elle génère <strong>de</strong> façon. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s experts quis’occupent <strong>du</strong> secteur informel et <strong>de</strong>s statisticiens en charge <strong>de</strong> la mesure <strong>du</strong> secteur informel,c’est un domaine très mal appréhendé, avec quelques fois <strong>de</strong>s connotations péjoratives et <strong>de</strong>sdéfinitions disparates.Encadré 1 : Définir l’économie informelleLe Système <strong>de</strong> Comptabilité Nationale (SCN) reprend à son compte (voir Nations Unies (1993) § 4.159) ladéfinition donnée en janvier 1993 par l’Organisation internationale <strong>du</strong> Travail (OIT) sur le « secteur informel »(ILO, 1993). On y trouve, en particulier, les points suivants :« Le secteur informel peut être décrit, d'une façon générale, comme un ensemble d'unités pro<strong>du</strong>isant <strong>de</strong>s biensou <strong>de</strong>s services en vue – principalement – <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>s revenus pour les personnes concernées...Les unités <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> secteur informel présentent les caractéristiques particulières <strong>de</strong>s entreprisesindivi<strong>du</strong>elles... Le concept <strong>de</strong>s activités <strong>du</strong> secteur informel <strong>de</strong>vrait être différencié <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>l'économie dissimulée ou souterraine. « Dans le secteur institutionnel <strong>de</strong>s ménages, le secteur informelcomprend : i) les entreprises informelles <strong>de</strong> personnes travaillant pour leur propre compte ; et ii) la composanteadditionnelle <strong>de</strong>s entreprises d'employeurs informels ».« Les entreprises informelles <strong>de</strong> personnes travaillant pour leur propre compte peuvent inclure, selon lescirconstances nationales, ou toutes les entreprises <strong>de</strong> personnes travaillant pour leur propre compte ou2 François-Xavier Dudouet, Delphine Mercier, Antoine Vion (2006), Politiques internationales <strong>de</strong> normalisation quelquesjalons pour la recherche empirique, in l’OpesC n°6, Mai 200619
seulement celles qui ne sont pas enregistrées selon <strong>de</strong>s formes spécifiques <strong>de</strong> la législation nationale ». « Lesentreprises d'employeurs informels peuvent être définies, compte tenu <strong>de</strong>s circonstances nationales,selon l'un ou plusieurs <strong>de</strong>s critères suivants :i) taille <strong>de</strong>s unités inférieures à un niveau déterminé d'emploi ;ii) non enregistrement <strong>de</strong> l'entreprise ou <strong>de</strong> ses salariés. »« Les entreprises indivi<strong>du</strong>elles qui exercent exclusivement <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction non marchan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vraientêtre exclues <strong>du</strong> champ <strong>du</strong> secteur informel aux fins <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong> l'emploi dans le secteur informel ».Il résulte très clairement <strong>de</strong> ces quelques textes que le secteur informel est composé d’établissementsappartenant à <strong>de</strong>s entreprises indivi<strong>du</strong>elles relevant <strong>du</strong> secteur institutionnel <strong>de</strong>s ménages. Pour une analyseplus complète <strong>de</strong> l’économie informelle, et <strong>de</strong> sa prise en compte en comptabilité nationale, on peut aussi sereporter à Séruzier (1996b) chapitre 9.2. 3En faisant référence aux enjeux <strong>de</strong> la normalisation et contrôle <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, oncomprend dès lors que plus l’économie informelle <strong>de</strong>vient prépondérante, la normalisation<strong>de</strong>vient difficile voir impossible. <strong>La</strong> conséquence immédiate est que l’économie sera moinsintégrée et moins compétitive au niveau mondial et sous régional et en plus la qualité <strong>de</strong>spro<strong>du</strong>its consommés ne sera pas assurée. Ceci est exactement la situation actuelle <strong>du</strong>Burundi.Pourquoi la normalisation et le contrôle <strong>de</strong> la qualité‣ Au niveau internationalL’internationalisation <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s marchés financiers, ainsi que les transformations<strong>de</strong> l’univers concurrentiel subies par les entreprises, se chargent aujourd’hui <strong>de</strong> démontrerl’utilité <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> gestion normalisés, tels que les normes ISO, IFRS, etautres. Les entreprises à travers le mon<strong>de</strong> œuvraient suivant <strong>de</strong>s processus et <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong>gestion qui répondaient à leurs exigences internes et/ou externes. Aujourd’hui les exigencesen matière <strong>de</strong> qualité, <strong>de</strong> transparence financière, <strong>de</strong> comparabilité <strong>de</strong>s états comptables,etc.… ne cessent <strong>de</strong> s’accroître. En revanche, l’adoption accrue <strong>de</strong>s normes par lacommunauté internationale ne vise qu’à répondre à ces exigences. Ce phénomène pratiqué parun nombre d’entreprises <strong>de</strong> plus en plus croissant à travers le mon<strong>de</strong> a entraîné d’importantsbouleversements sur le plan culturel, car la connaissance <strong>de</strong>s normes est indispensable à lacompréhension <strong>de</strong> leur mise en place 4 .<strong>La</strong> normalisation internationale renvoie à un problème fondamental <strong>de</strong> l’<strong>org</strong>anisation sociale :« ce choix entre l’ordre et la liberté ». En effet, c’est l’objet commun visant la facilitation <strong>de</strong>s3 Michel S. (2007), “ <strong>La</strong> mesure <strong>de</strong> l'économie informelle et sa contribution aux comptes <strong>de</strong>s ménages ” STATECO, No. 98,pp. 36-50.4 Jamil Arida, <strong>La</strong> pratique <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> gestion normalisés — Facteurs d’adoption Le cas <strong>de</strong>s normes ISO, IFRS dansl’in<strong>du</strong>strie20
échanges et la transparence <strong>de</strong>s marchés qui est actuellement mis en avant, ce qui constitue laclé <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong>s normes. Cette pratique <strong>de</strong>s normes intervient comme un outilinstitutionnel spécifiquement créé par la communauté pour encourager les échanges et la librecirculation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its. <strong>La</strong> dimension institutionnelle <strong>du</strong> phénomène s’exprime égalementpar l’intervention <strong>de</strong> la puissance publique, ainsi que par l’émergence <strong>de</strong> nouveaux dispositifslégislatifs et réglementaires. L’un <strong>de</strong>s exemples les plus manifestes est certainement celui <strong>de</strong>snouvelles normes comptables IFRS que les entreprises cotées doivent adopter. Ce qui précè<strong>de</strong>explique le fait que le rôle <strong>de</strong>s Etats est <strong>de</strong>venu majeur dans l’explication <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong>smodèles institutionnalisés 5 .‣ Au niveau régional (EAC)<strong>La</strong> circulation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its au sein <strong>de</strong>s espaces régionaux répond à la logique <strong>de</strong>s relations <strong>de</strong>ses échanges très anciens réalisés au sein <strong>de</strong> réseaux commerciaux à relations personnalisées.Cet état <strong>de</strong> fait limite en quelque sorte le recours aux normes et au contrôle <strong>de</strong> la qualité.Pour mo<strong>de</strong>rniser les relations économiques et commerciales, les espaces sous régionales danslesquels le Burundi est partie prenant se sont inscrit dans le processus d’amélioration <strong>de</strong>srelations <strong>de</strong> partenariat basées sur la compétitive <strong>de</strong> économies <strong>de</strong>s pays membres. Mais lacommunauté <strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong> l’Est apparaît comme la plus dynamique et au sein <strong>de</strong>laquelle, le Burundi semble avoir investi plus d’énergies. Le développement <strong>du</strong> commercemondial à un rythme soutenu et le travail <strong>de</strong> l’Organisation mondiale <strong>du</strong> commerce (OMC) et<strong>de</strong>s autres <strong>org</strong>anisations multilatérales concernées contraint les pays/les CER à s’ajuster pourgarantir la compétitivité <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its commerciaux. Or, actuellement dans le mon<strong>de</strong>, lapromotion et la création <strong>de</strong>s normes et le contrôle <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus unélément déterminant au niveau <strong>de</strong>s transactions internationales.C’est ainsi qu’au sein <strong>de</strong> la CEA, les <strong>org</strong>anismes nationaux <strong>de</strong> normalisation s’activent pourréfléchir ensemble afin <strong>de</strong> s’ajuster au niveau <strong>de</strong>s standards internationaux relatifs auxprincipaux pro<strong>du</strong>its et services qui entrent dans le commerce international.‣ Au niveau national (Burundi)5 Jamil Arida, <strong>La</strong> pratique <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> gestion normalisés — Facteurs d’adoption Le cas <strong>de</strong>s normes ISO, IFRS dansl’in<strong>du</strong>strie21
Au Burundi, la culture <strong>de</strong> normalisation et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la qualité est relativement récente.Le Bureau burundais <strong>de</strong> normalisation et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la qualité (BBN) existe il y a à peinevingt ans (Le décret-loi n° 1/17 <strong>du</strong> 7 mai 1992 portant création d’un bureau <strong>de</strong> normalisation et <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong> la qualité 6 .) dont plus <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> a été caractérisée par unesituation <strong>de</strong> guerre civile. Cela témoigne en réalité <strong>du</strong> déficit <strong>de</strong> performance et <strong>du</strong> manque <strong>de</strong>dynamisme <strong>de</strong> ce secteur.Mais ces <strong>de</strong>rnières années les changements multiples et <strong>de</strong>s avancées technologique qui sesont développés dans le domaine <strong>de</strong> la normalisation et la récente adhésion <strong>du</strong> Burundi à laCommunauté Est-Africaine en 2007 a con<strong>du</strong>it le BBN à sentir le besoin <strong>de</strong> se mo<strong>de</strong>rniser.L’une <strong>de</strong>s innovations fondamentales est l’adoption d’une Loi portant système national <strong>de</strong>normalisation, métrologie, assurance <strong>de</strong> la qualité et essais. Cet instrument est la base <strong>de</strong>sperspectives en matière <strong>de</strong> compétitivité économique et <strong>de</strong> protection sociale.Les fonctions <strong>du</strong> Bureau <strong>de</strong>s normes Burundi sont les suivants 7 :promouvoir la normalisation dans l'in<strong>du</strong>strie et le commerce<strong>de</strong> préparer ou <strong>de</strong> modifier les spécifications et co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pratiquepromouvoir l'assurance qualité et gestionprocé<strong>de</strong>r sur la métrologie <strong>de</strong>s tests<strong>de</strong> créer et <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à la gestion <strong>de</strong> la marque <strong>de</strong> certificationcoordonner les comités, les laboratoires et autres services dans le domaine <strong>de</strong> lanormalisation et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la qualitéreprésenter l'intérêt national dans le domaine <strong>de</strong> la normalisation et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> laqualitéJusqu’aujourd’hui les principaux pro<strong>du</strong>its certifiés par BBN sont les pro<strong>du</strong>its agricoles (fruitset légumes), Miel, l'huile <strong>de</strong> palme et le coton, Jus <strong>de</strong> passion, l'eau minérale, <strong>La</strong>it et Thé. Unesimple lecture <strong>de</strong> ces pro<strong>du</strong>its démontre à suffisance que le chemin est encore long au momentoù l’ISTEEBU collecte les prix sur plus <strong>de</strong> six cent pro<strong>du</strong>its commercialisés sur les marchésburundais.<strong>La</strong> normalisation et le contexte <strong>de</strong> l’économie informelle au Burundi6 www.senat .bi7 http://www.eac-quality.net/the-sqmt-community/national-bodies/burundi-bbn.html22
Connaître l’économie informelle figure en bonne place parmi les nombreux défis que pose lamesure macro-économique dans les pays en voie <strong>de</strong> développement. Et il ne s’agit passeulement <strong>de</strong> mesurer son niveau et son évolution, comme contribution au PIB et à lacroissance économique locale. Il importe aussi <strong>de</strong> situer la place qu’elle occupe et le rôlequ’elle joue dans l’appareil pro<strong>du</strong>ctif <strong>du</strong> pays 8 .Entrave à la normalisation au Burundi : poids <strong>du</strong> secteur informelPour survivre et se développer aujourd’hui dans le contexte <strong>de</strong> compétitivité, la normalisationdoit être intégrée comme fonction essentielle dans toutes les entreprises en général et lesecteur informel en particulier, tous secteurs d’activités confon<strong>du</strong>s. De nos jours, les activités<strong>du</strong> secteur informel représentent 88% <strong>du</strong> PIB et leur impact sur l’économie est trèsdéterminant. Un système <strong>de</strong> normalisation digne <strong>de</strong> ce nom constitue un moyen d’intégrationprogressive <strong>de</strong> l’économie informelle dans le système formel et con<strong>du</strong>it à renforcer uneéconomie. Des pays comme la Chine, le Brésil, l’In<strong>de</strong>, la RSA et la Corée <strong>du</strong> Sud l’ontexpérimenté comme stratégie <strong>de</strong> développement <strong>du</strong>rable et accor<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s subventions trèsimportantes aux <strong>org</strong>anismes qui évoluent dans ce domaine 9 . Le Burundi fait face au doubledéfi <strong>de</strong> l’intégration <strong>de</strong> l’économie informelle et <strong>de</strong> la compétitivité <strong>de</strong> ses pro<strong>du</strong>its et servicesau sein <strong>de</strong>s espaces d’intégration économique. Il faut redynamiser les activités <strong>de</strong>normalisation.8 Michel Séruzier, <strong>La</strong> mesure <strong>de</strong> l'économie informelle et sa contribution aux comptes <strong>de</strong>s ménages, inSTATECO, No989 http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=3583023
‣ Renforcer la capacité <strong>du</strong> BBN à répondre aux enjeux économiques en élaborant <strong>de</strong>snormes qui <strong>de</strong>vancent les besoins <strong>du</strong> marché et <strong>de</strong> la société,‣ Fournir et promouvoir les Normes internationales en tant qu’outils au service <strong>du</strong>progrès technologique, <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong>s processus et <strong>du</strong> transfert <strong>de</strong> technologies,‣ Renforcer la coopération avec les communautés économiques régionales et les<strong>org</strong>anismes régionaux <strong>de</strong> normalisation,26
importants. Mais cela n’empêche pas d’esquisser une définition aussi minimaliste quepossible, histoire d’avoir le même enten<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s faits.Après avoir défini ce que c’est théoriquement la « société civile », nous allonsanalyser ce qu’elle en est et comment elle est perçue au Burundi.1.1. Brève définition <strong>du</strong> concept « société civile »L’acception mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> la société civile trouve en effet son origine lointaine chez Alexis<strong>de</strong> Tocqueville, notamment dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » 1 .Pendant que cet auteur effectuait une vaste enquête sur le système carcéral aux Etats-Unis en1830 en effet, il est étonné par une quasi-absence <strong>de</strong> l’Etat dans la régulation <strong>de</strong> la viequotidienne <strong>de</strong>s citoyens. Ceux-ci recourent d’abord et avant tout à eux-mêmes, avecles moyens qui sont à leur portée, indivi<strong>du</strong>ellement et surtout collectivement.Bref, les associations communales sont à la démocratie ce que l’école primaire est à lascience, selon Alexis <strong>de</strong> Tocqueville.Autrement dit, qui dit « société civile » suppose non seulement que les citoyens aientconscience <strong>de</strong> leurs problèmes et s’<strong>org</strong>anisent pour les résoudre avec les moyens à leurportée, mais aussi qu’ils puissent se défendre contre les abus <strong>de</strong> l’Etat. <strong>La</strong> société civile nepeut alors que se penser par rapport à l’Etat, dans la mesure où elle ne dépend pas <strong>de</strong> ce<strong>de</strong>rnier ni en termes <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong> fonctionnement ni en termes <strong>org</strong>anisationnels d’une part,et qu’elle peut même être opposée aux pouvoirs publics en cas d’abus <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> ces<strong>de</strong>rniers d’autre part.En simplifiant les choses et pour être concret, on peut dire que la société civile compren<strong>de</strong>ntre autres :Le citoyen, pris indivi<strong>du</strong>ellement <strong>de</strong> par sa capacité à défendre ses intérêts notammenten faisant appel à l’appareil judiciaire, à désigner et influencer les dirigeants via son voted’une part, pris collectivement <strong>de</strong> par sa capacité à se regrouper avec d’autres pourdéfendre les intérêts partagés ou imposer une vision <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> commune d’autre part.C’est ici que se distinguent le citoyen dans la mesure où il ne resterait pas indifférentquant à la manière dont il est gouverné d’un côté, et, <strong>de</strong> l’autre côté, l’administré ou le1 Voir le chapitre IX : TOCQUEVILLE (A.), De la démocratie en Amérique, Paris, Garnier-Flammarion, 1981.28
simple usager qui consomme les services <strong>de</strong> l’Etat tels qu’ils sont et ne dit mot sur ce qu’ils<strong>de</strong>vraient/pourraient être.Les groupes d’intérêts(ou <strong>de</strong> pression) : il s’agit <strong>de</strong>s <strong>org</strong>anisations dont l’objectif est<strong>de</strong> défendre les intérêts qu’elles prennent en charge, souvent en pesant <strong>de</strong> tout leur poids sur leGouvernement pour qu’il prenne <strong>de</strong>s décisions qui leur soient favorables, qui répon<strong>de</strong>nt auxproblèmes qui sont leurs. Les groupes d’intérêt peuvent se distinguer en <strong>de</strong>ux catégories.D’une part, les <strong>org</strong>anisations à vocation globale : « l’objectif <strong>de</strong> ces groupes est <strong>de</strong>prendre en charge les intérêts d’une catégorie particulière <strong>de</strong> la populationdont l’existence sociologique est déjà i<strong>de</strong>ntifiée : les ouvriers, les cadres, les paysans,les femmes, les jeunes, etc. la défense <strong>de</strong>s intérêts porte sur l’ensemble <strong>de</strong>sattentes <strong>de</strong> la population ciblée, d’où l’obligation <strong>de</strong> ces <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong>procé<strong>de</strong>r à un travail <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s afin <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s revendicationscohérentes » 2 . C’est ici que l’on placerait les différents syndicats <strong>de</strong>stravailleurs, les associations <strong>de</strong> femmes regroupées dans le CAFOB, lesassociations <strong>de</strong> jeunes, etc.D’autre part, les <strong>org</strong>anisations à vocation spécialisée : elles « se font les porte-paroled’une cause spécifique autour <strong>de</strong> laquelle vont se rassembler librement lessympathisants. Ceux-ci peuvent venir <strong>de</strong>s horizons sociaux et culturels divers, mais ilsse reconnaissent par la volonté <strong>de</strong> défendre un intérêt commun et circonscrit,souvent extérieur à leur condition » 3 . Ici peuvent se classer les associationscomme la Ligue Iteka, Observatoire pour l’Action Gouvernementale (OAG),Observatoire pour la Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques(OLUCOME), Association Burundaise pour la Protection <strong>de</strong>s Droits Humains et <strong>de</strong>sPersonnes Détenues (APRODH), l’Association <strong>de</strong> lutte contre le génoci<strong>de</strong> ( ACGénoci<strong>de</strong> Cirimoso), etc.2 HASTINGS (M.), Abor<strong>de</strong>r la science politique, Paris, Seuil, 1996, p.103 Ibid.29
Les médias privés dans mesure où ils tirent souvent le voile sur « ce qui ne va pas»et attirent par-là l’attention <strong>de</strong> l’opinion publique et partant <strong>du</strong> Gouvernement. En mêmetemps, ils informent/forment les citoyens, lesquels <strong>de</strong>viennent plus regardants et donc plusexigeants à l’égard <strong>de</strong>s gouvernants. A ce sujet, on peut reconnaître le rôle à la fois «d’é<strong>du</strong>cateur » et « <strong>de</strong> watchdog » <strong>de</strong>s médias en général et <strong>de</strong>s médias privés en particulier.En donnant <strong>de</strong>s informations sur la vie politique et sociale d’un Etat en effet, les médiassocialisent in<strong>du</strong>bitablement la population sur ce qui convient et ce qui ne convient pas.Les églises aussi diverses que variées dans la mesure où non seulement leur <strong>org</strong>anisation nerelève pas <strong>de</strong> l’Etat mais aussi dans ce sens qu’elles participent à la socialisation <strong>de</strong> leursouailles. Bien plus, dès lors qu’elles peuvent se positionner par rapport à telle ou telle autreaction publique, elles n’agissent pas moins dans la structuration <strong>de</strong> certains problèmeséligibles à l’agenda politique en fonction <strong>de</strong>s dogmes. On l’a vu dans les pays occi<strong>de</strong>ntauxcomme la France où la question d’Interruption Volontaire <strong>de</strong> la Grossesse (IVG) a divisé lescitoyens en fonction <strong>de</strong> leurs croyances religieuses dans les années soixante-dix.Le moins que l’on puisse dire est que la « société civile » comprend <strong>de</strong>s acteurs ou<strong>org</strong>anisations qui ont en commun la caractéristique <strong>de</strong> ne pas relever <strong>de</strong>s pouvoirs publics.Bien enten<strong>du</strong>, il convient faire remarquer que la société civile est née et s’est enracinée enOcci<strong>de</strong>nt après la révolution in<strong>du</strong>strielle. Une fois que la classe moyenne s’est développée eneffet, la prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s problèmes dont n’étaient pas enclins à s’occuper les pouvoirspublics a poussé les citoyens à davantage s’<strong>org</strong>aniser pour défendre leurs intérêts. Aussi s’enest-il suivi la naissance <strong>de</strong>s syndicats, <strong>de</strong>s <strong>org</strong>anisations et associations portant sur <strong>de</strong>s thèmesaussi divers que variés, avec l’objectif <strong>de</strong> convaincre l’opinion publique <strong>de</strong> la pertinence <strong>de</strong>leur position et par-là amener les pouvoirs publics à se saisir <strong>du</strong> problème. Tout le combat esten quelque sorte <strong>de</strong> transformer une question auparavant banale en une préoccupationsociétale pour ainsi la faire accé<strong>de</strong>r à l’agenda politique. Par la suite, c’est tout le travail <strong>de</strong>structuration et <strong>de</strong> persuasion par autant <strong>de</strong> voies et moyens que possibles (via les médias, lesétu<strong>de</strong>s financées à cet effet, la pression sur les parlementaires, etc.) afin d’obtenir <strong>du</strong>Gouvernement une décision allant dans le sens souhaité par le groupe d’intérêt oul’<strong>org</strong>anisation en question.1.2.Interaction entre Gouvernement-Société civile, simple principe <strong>de</strong> démocratie30
L’interaction entre le Gouvernement et les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la Société civile est un passageobligé dans tout système démocratique. Dès lors que pour être légitime et gar<strong>de</strong>r sa légitimitéle Gouvernement se doit <strong>de</strong> répondre aux problèmes perçus comme tels par les citoyens etpuisque ces <strong>de</strong>rniers sont répartis en plusieurs <strong>org</strong>anisations défendant plusieurs intérêtssouvent contradictoires alors que les moyens <strong>de</strong> l’Etat pour y répondre avec satisfaction<strong>de</strong>meurent limités, l’interaction entre l’Etat et la Société civile se révèle incontournable pourtrouver une alternative la moins mauvaise possible faute <strong>de</strong> solution idéale. Il faut dire que <strong>de</strong>par les intérêts qu’elles prennent en charge, les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile sont àl’origine <strong>de</strong>s politiques publiques. Pour ne partir que <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> David EASTON, on peutdire que le « système politique » (ici le Gouvernement) reçoit les « inputs » (les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ssociales <strong>de</strong> tous ordres) <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types d’<strong>org</strong>anisation : les partis politiques qui cherchent àconquérir (quand ils sont encore à l’opposition) ou à conserver (lorsqu’ils sont au pouvoir) lepouvoir politique d’une part, et les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile en qualité <strong>de</strong> groupesd’intérêt d’autre part 4 . Cette « boîte noire » (le Gouvernement) doit alors les traiter pourpro<strong>du</strong>ire les « outputs » (réponses sociales ou solutions aux problèmes posés). Mais tout nes’arrête pas là : ces mêmes « outputs » font l’objet <strong>de</strong> rétroaction (« feedbacks »)positivement lorsque les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s sociales sont satisfaites (d’où soutiens) ou négativementlorsque les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s sociales ne sont pas tout satisfaites (d’où exigences). S’ensuivent alors<strong>de</strong> nouvelles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s sociales à intro<strong>du</strong>ire dans la « boîte noire » (Gouvernement) et ainsi<strong>de</strong> suite, à tel point que le processus « inputs - black box -outputs -feedbacks » <strong>de</strong>vient unesorte <strong>de</strong> spirale sans fin qui ressemble étrangement à l’histoire <strong>de</strong> l’œuf et <strong>de</strong> la poule.Cela dit, il convient <strong>de</strong> préciser que dans tout ce processus le fil con<strong>du</strong>cteur <strong>de</strong>meurel’accountability (le fait pour le Gouvernement <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s comptes aux citoyens). A partir<strong>du</strong> moment où la déception <strong>de</strong>s citoyens impliquent le non-renouvellement <strong>du</strong> mandat <strong>de</strong>sgouvernants (Gouvernement, Assemblée nationale) auquel cas le parti au pouvoir court lerisque <strong>de</strong> perdre les élections suivantes et surtout lorsque tous les inter-acteurs en sontconscients <strong>de</strong> par l’expérience démocratique, le Gouvernement ne peut que travailler pourconserver la légitimité. En revanche lorsque la satisfaction <strong>de</strong>s citoyens rime avec lerenouvellement <strong>de</strong> la confiance et ce faisant la conservation <strong>du</strong> pouvoir par le parti auxaffaires, il en découle <strong>de</strong>s soutiens. C’est ce jeu politique qu’exploitent tous les acteurs <strong>de</strong> la4 Puisqu’il est question ici <strong>de</strong> « société civile », nous limiterons notre analyse aux seuls éléments <strong>de</strong> la sociétécivile tels définis plus haut.31
démocratie en général et ceux <strong>de</strong> la société civile en particulier, en ce qui nous concerne.Notons en outre qu’en plus <strong>du</strong> simple jeu démocratique in<strong>du</strong>it par l’accountability existe aussil’Etat <strong>de</strong> droit dans la mesure où les citoyens lésés sont enclins, même indivi<strong>du</strong>ellement, àattaquer les gouvernants <strong>de</strong>vant les instances judiciaires, ce qui, à force d’être répété au coursd’un mandat politique donné, aboutit au risque <strong>de</strong> délégitimation <strong>du</strong> parti au pouvoir et partantà la perte <strong>de</strong>s élections suivantes.C’est précisément dans ce système d’équilibre <strong>de</strong>s pouvoirs qu’œuvrent les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong>la société civile. Prenons pour exemples quelques cas tels les groupes d’intérêt, les médias.Un groupe d’intérêt prenant en charge un intérêt donné fera feu <strong>de</strong> tout bois pour convaincrela population ciblée <strong>de</strong> la pertinence <strong>de</strong> sa cause. Et le Gouvernement y répondra soit enprouvant l’insuffisance <strong>de</strong> moyens pour répondre aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en présence au regard <strong>de</strong>s<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s concurrentes à prioriser, soit en prouvant à l’opinion que <strong>de</strong> telles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s nesont pas pertinentes. S’il s’agit d’un syndicat par exemple, la non-satisfaction répétitivepourrait con<strong>du</strong>ire à la grève, si <strong>du</strong> moins les dommages encourus par la population sonttellement élevés que la légitimité <strong>du</strong> Gouvernement peut être entamée. Mais le Gouvernementn’est pas non plus désarmé puisqu’il ne manque pas d’experts pour conseiller la décision laplus pertinente à prendre. Bref, on comprend que la transparence est un <strong>de</strong>s principauxéléments <strong>du</strong> puzzle dans la mesure où elle permet aux citoyens <strong>de</strong> juger d’eux-mêmes, ce quifait que toute revendication <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s groupes d’intérêt comme les syndicats n’acquiertpas nécessairement leur aval. Dans le même ordre d’idées, ils peuvent apprécier la pertinence<strong>de</strong> la décision gouvernementale.Quant aux médias, leur « quatrième pouvoir » est connu en démocratie. En épinglant lescomportements irréguliers <strong>de</strong>s acteurs politiques et <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> l’Etat, en menant <strong>de</strong>sinvestigations sur <strong>de</strong>s situations malencontreuses dont ne s’occupent pas les pouvoirs publics,les médias ne <strong>de</strong>viennent pas moins l’œil et l’oreille <strong>de</strong> l’opinion publique et partant unesorte <strong>de</strong> « chiens <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> » 5 gênants pour le Gouvernement. On sait combien les scandalespolitiques constituent, à la suite <strong>de</strong>s révélations par <strong>de</strong>s médias, <strong>de</strong> véritables orages quirenversent <strong>de</strong>s gouvernements via <strong>de</strong>s démissions fracassantes, sans parler <strong>de</strong>s5 Pour plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>tails, cf. CORONEL (S-S.), « The Media as Watchdog », Harvard Kennedy School-World BankWorkshop, 29-31 Mai 2008, pp.1-18p.32
ouleversements politiques où <strong>de</strong>s partis <strong>de</strong> l’opposition en viennent à balayer rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>spartis au pouvoir par le biais <strong>de</strong>s votes-sanctions.Au total, c’est tout un processus culturel <strong>de</strong> contre-pouvoirs qui a « civilisé les mœurspolitiques » 6 à travers l’interaction entre l’Etat et les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile. C’estprécisément ici que rési<strong>de</strong> le concept <strong>de</strong> « bonne gouvernance » 7 , auquel recourentaujourd’hui les <strong>org</strong>anisations tant nationales qu’internationales, en particulier les bailleurs <strong>de</strong>fonds. Comme l’écrit Jean-Pierre Gaudin en effet, «… avec la reconnaissance <strong>de</strong> cesinterlocuteurs mis tous sur le même pied que l’Etat, acteurs locaux par la grâce <strong>de</strong> ladécentralisation, opérateurs privés par le concours <strong>du</strong> libéralisme économique, acteursassociatifs par l’appel à la citoyenneté, les dispositifs décisionnels semblent <strong>de</strong>venus plusfragmentés et plus multicentrés qu’il y a une génération» 8 .Pas <strong>de</strong> commentaire sur le faitque l’Etat n’est plus habilité à dicter son « vrai » <strong>du</strong> haut <strong>du</strong> pié<strong>de</strong>stal comme <strong>du</strong> temps <strong>de</strong>l’Etat Léviathan.2. Quid <strong>du</strong> Burundi ?Après avoir brossé le tableau <strong>de</strong> ce que <strong>de</strong>vrait être la société civile dans les pays où ladémocratie a eu le temps <strong>de</strong> s’enraciner, il est convenable <strong>de</strong> voir en quoi elle consiste auBurundi.2.1. Société civile dans un environnement sociopolitique peu favorableComme nous l’avons mentionné plus haut, la « société civile » s’est développée et s’estenracinée d’abord en Occi<strong>de</strong>nt. Elle n’a été « importée » à proprement parler en Afriquequ’au cours <strong>de</strong>s années quatre-vingt-dix lors <strong>de</strong> la vague <strong>de</strong> démocratisation <strong>de</strong>s institutionspolitiques qui a suivi la chute <strong>du</strong> Mur <strong>de</strong> Berlin, l’effritement <strong>de</strong> l’Union Soviétique ainsi quela fameuse conférence <strong>de</strong> la Baule. Avant cette époque la société civile était impensable dansla mesure où les régimes monopartisans qui ont régné sur la quasi-totalité <strong>de</strong>s pays africainsn’acceptaient aucune voix discordante par rapport au discours officiel.6 Pour faire nôtre l’intitulé <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Norbert ELIAS : ELIAS (Norbert), <strong>La</strong> civilisation <strong>de</strong>s mœurs, Paris,Calmann-Levy, 19737 Plus <strong>de</strong> détails, voir : GAUDIN (Jean-Pierre), Qu’est-ce que la gouvernance ? Paris, Presses <strong>de</strong> Science Po,1999.8 Ibid, p.1233
Le Burundi ne sera pas en reste. On sait que <strong>de</strong>puis l’indépendance la démocratie proclamée<strong>du</strong> bout <strong>de</strong>s lèvres a eu <strong>du</strong> mal à survivre à l’assassinat <strong>du</strong> Premier Ministre Rwagasore ; cequi a abouti à la suppression <strong>du</strong> multipartisme en 1966. Le parti UPRONA rapi<strong>de</strong>ment instituécomme parti-Etat e pouvait pas admettre d’<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile telles les groupesd’intérêt, surtout que les Burundais n’avaient même pas cette culture politique <strong>de</strong> factureocci<strong>de</strong>ntale. Il n’est donc pas étonnant que les soi-disant <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile <strong>de</strong>sannées soixante aux années quatre-vingt-dix aient été fondamentalement <strong>de</strong>s instruments <strong>du</strong>pouvoir en place au lieu d’être ses contrepoids :« …les <strong>org</strong>anisations qui auraient dû relever<strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière [la société civile] s’avéraient en réalité <strong>de</strong>s instruments <strong>du</strong> parti unique,lequel avait le monopole <strong>de</strong> définir et <strong>de</strong> dire le « vrai ». Il suffit, pour s’en convaincre, <strong>de</strong>penser aux fameux « mouvements intégrés » <strong>de</strong> l’ancien parti unique tels l’Union <strong>de</strong>sTravailleurs <strong>du</strong> Burundi (UTB), l’Union <strong>de</strong>s Femmes Burundaises (UFB), JeunesseRévolutionnaire Rwagasore (JRR), etc. L’UTB par exemple était théoriquement une<strong>org</strong>anisation syndicale, donc un groupe <strong>de</strong> pression, mais elle jouait le relais <strong>du</strong> parti uniqueau sein <strong>de</strong>s travailleurs. Il en allait <strong>de</strong> même pour l’UFB et la JRR qui théoriquementconstituaient <strong>de</strong>s groupes d’intérêt mais qui n’étaient que <strong>de</strong>s tremplins <strong>de</strong> légitimation <strong>de</strong>srégimes tour à tour autoproclamés. Cela s’explique d’autant plus que ces <strong>org</strong>anisations-làétaient mises sur pied à l’instigation <strong>du</strong> pouvoir central. Elles ne pouvaient donc opérer quedans son « référentiel », c’est-à-dire dans la vision <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> sous-tendant la politique <strong>du</strong>gouvernement et ses actions au sein <strong>de</strong>s secteurs divers et variés » 9 .Et si <strong>de</strong> véritables <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile ont enfin vu le jour au cours <strong>de</strong>s annéesquatre-vingt-dix en Afrique en général et au Burundi en particulier, il n’en <strong>de</strong>meure pasmoins que leur efficacité laisse à désirer pour <strong>de</strong>s raisons indépendantes <strong>de</strong> leur volonté. Ainsion a observé par exemple <strong>de</strong>s associations telles le Collectif <strong>de</strong>s Associations Féminines <strong>du</strong>Burundi (CAFOB) défendant l’égalité <strong>de</strong>s genres et luttant contre les violences basées sur legenre, les ligues <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne humaine ITEKA et SONERA, le Forum pour leRenforcement <strong>de</strong> la Société Civile (FORSC) regroupant une multitu<strong>de</strong> d’associations,l’Association Burundaise <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong>s Droits Humains (APRODH), l’Observatoire <strong>de</strong>Lutte Contre la Corruption et les Malversations Economiques (OLUCOME), l’Observatoire9 SENTAMBA (E.), Etu<strong>de</strong> sur la gouvernance au Burundi, op. cit. p.2834
<strong>de</strong> l’Action Gouvernementale (OAG), etc. Ces <strong>org</strong>anisations n’ont cessé d’alerter les médiassur les problèmes <strong>de</strong> « mauvaise gouvernance » dont étaient présumés responsables certainsagents <strong>de</strong> l’Etat. Dans le même ordre d’idées, les radios privées telles Isanganiro, la RadioPublique Africaine (RPA), Bonesha FM, etc. ainsi que la Télévision privée Télé-Renaissancen’ont cessé <strong>de</strong> relayer les cas <strong>de</strong> mauvaise gestion en général et les cas <strong>de</strong> violation <strong>de</strong>s droits<strong>de</strong> la personne humaines en particulier. Les cas <strong>de</strong>s assassinats <strong>de</strong> Muyinga, <strong>de</strong> BujumburaRural, <strong>de</strong> Gatumba, d’Ernest MANIRUMVA 10 , etc. dont les enquêtes chaque fois promisespar les autorités gouvernementales n’ont presque jamais abouti d’une part, les incarcérationsabusives suivies <strong>de</strong> torture souvent à l’issue <strong>de</strong>s montages politiciens d’autre part n’ont cessé<strong>de</strong> faire la chronique avant <strong>de</strong> tomber <strong>de</strong>s les oubliettes.L’explication que l’on peut donner va dans <strong>de</strong>ux directions. D’un côté, les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> lasociété civile ne sont efficaces qu’aussi longtemps que les citoyens considèrent les causesdéfen<strong>du</strong>es comme les leurs. Dans cette perspective, la pression sur le Gouvernement vient<strong>de</strong>s citoyens qui peuvent se mobiliser et faire une marche-manifestation ébranlant la légitimité<strong>du</strong> Gouvernement. Or dans les pays ayant une longue tradition d’autoritarisme, lespopulations en général et les populations rurales en particulier <strong>de</strong>meurent indifférentes, lesystème NIMBY 11 prenant le <strong>de</strong>ssus. De l’autre côté, les gouvernants peuvent bien comptersur la mémoire courte <strong>de</strong> la population : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s populations urbaines instruites fortminoritaires en termes d’électorat, la majorité <strong>de</strong>s électeurs est composée <strong>de</strong> populationsrurales aspirées par <strong>de</strong>s préoccupations autres que démocratiques ou relatives au respect <strong>de</strong>sdroits humains. Rappelons que même en Occi<strong>de</strong>nt il a fallu l’émergence et l’affermissement<strong>de</strong> la classe moyenne consciente que pour relever les défis auxquels est confronté un pays lepassage par la démocratie est incontournable. Tel est loin d’être le cas dans les pays en voie<strong>de</strong> développement en général et les pays sortant d’une longue guerre civile comme le Burundien particulier.2.2. Etat aux relents autoritairesOn ne peut parler d’efficacité <strong>de</strong>s <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile que dans unenvironnement démocratique stricto sensu, c’est-à-dire dans un cadre où le Gouvernement est10 Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’OLUCOME11 Not In My Back Yard, c’est-dire : Aussi longtemps que je ne suis pas concerné, ce n’est pas si grave que ça !Bien enten<strong>du</strong>, <strong>de</strong>main ou plus tard, ce peut être le tour à soi-même, à un membre <strong>de</strong> sa famille, etc.35
éceptif <strong>de</strong>s critiques et <strong>de</strong>s contributions <strong>de</strong>s différentes parties prenantes <strong>de</strong> façon proactivedans la mesure où il veut mener <strong>de</strong>s politiques efficientes d’une part, et <strong>de</strong> façon quasiobligée dans la mesure où la non-prise en compte <strong>de</strong> telles critiques a toutes chances <strong>de</strong>con<strong>du</strong>ire à l’effritement <strong>de</strong> la légitimité politique d’autre part. Ici on a affaire à <strong>de</strong>sgouvernements « responsables » dans le sens anglo-saxon d’accountability 12 .Tel est loin d’être le cas dans les Etats autoritaires où le Gouvernement fait tout pour penser etimposer son « vrai ». Pour les pays africains en effet, la démocratie est tellement « jeune »que les comportements <strong>de</strong>s dirigeants n’ont pas encore eu le temps <strong>de</strong> se « démocratiser ». Ilfaut dire qu’une bonne vingtaine d’années (<strong>de</strong>puis les années 1990) s’avère d’autant pluscourte que même le paradigme <strong>de</strong> la démocratie libérale a davantage été une imposition parles puissances occi<strong>de</strong>ntales qu’une réponse aux besoins internes <strong>de</strong>s peuples africains. Pourreprendre la leçon <strong>de</strong> morale <strong>du</strong> roman <strong>de</strong> LAMPEDUSA 13 , tout se fait comme s’il s’agissait<strong>de</strong> « tout changer pour rester pareil », c’est-dire en<strong>du</strong>ire <strong>de</strong> « vernis » démocratique un corpssubstantiellement autoritaire. En d’autres termes,la plupart <strong>de</strong> régimes africainsproclameraient la démocratie <strong>du</strong> bout <strong>de</strong>s lèvres en <strong>org</strong>anisant certes <strong>de</strong>s électionsrégulièrement (démocratie procé<strong>du</strong>rale) mais en conservant en même temps le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>gestion autoritaire 14 .S’agissant <strong>de</strong>s pays « post-conflit » comme le Burundi, les choses se compliquent davantage.Ici l’autoritarisme consubstantiel aux régimes autoproclamés à l’issue <strong>de</strong>s coups d’Etatmilitaires qui ont régné sur le pays trois décennies <strong>du</strong>rant s’alimente à la fois <strong>de</strong> reflexespropres au maquis d’une part et <strong>de</strong> comportements « pathologiques » propres aux guerresciviles (qui méconnaissent la ligne <strong>de</strong> démarcation entre le licite et l’illicite) d’autre part. Et lecomble est qu’à force <strong>de</strong> s’étendre dans la <strong>du</strong>rée et dans pratiquement toutes les couches <strong>de</strong> la12 Pour plus <strong>de</strong> détails, lire mon papier : SENTAMBA (Elias), 2010, « L’Etat burundais dans l’EAC : assezmo<strong>de</strong>rnisé pour tirer profit <strong>de</strong> la Communauté ? », in Revue <strong>de</strong> l’IDEC, Vol.3, N°6.13 LAMPEDUSA (Giusepe Tomasi), Le Guépard, Paris, Ed. Seuil, Col « Points », 2006.14 C’est ici que Zaki <strong>La</strong>ïdi distingue la « démocratie procé<strong>du</strong>rale » (juste le fait d’<strong>org</strong>aniser régulièrement lesélections sans changer fondamentalement la nature autoritaire <strong>de</strong>s régimes) <strong>de</strong> la « démocratie culturaliste »(le comportement démocratique par essence auquel sont parvenus les régimes occi<strong>de</strong>ntaux où la démocraties’est bien enracinée). Pour plus <strong>de</strong> détails lire avec intérêt : ZAKI (<strong>La</strong>ïdi), <strong>La</strong> Gran<strong>de</strong> perturbation, Paris, Ed.Flammarion, 2006.36
population, tout ce palimpseste <strong>de</strong> mauvais aloi en vient à constituer un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong>comportement paradoxalement perçu comme « normal ».Dans cette perspective, les gouvernants digèrent d’autant moins les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la sociétécivile que leurs points <strong>de</strong> vue contredisent la ligne autoritaire <strong>du</strong> régime. Aussi a-t-on vu lesjournalistes issus <strong>de</strong>s radios privées en train d’être traînés <strong>de</strong>vant les tribunaux pour avoirsoulevé les cas <strong>de</strong> mauvais comportement <strong>de</strong> tel ou tel autre responsable politicoadministratif,les défenseurs <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne humaine être convoqués <strong>de</strong>vant laJustice pour avoir dénoncé les plans <strong>de</strong> torture ou carrément d’élimination physique <strong>de</strong>smembres <strong>de</strong>s partis politiques d’opposition, <strong>de</strong>s responsables d’<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la sociétécivile faire l’objet <strong>de</strong> filature par les agents <strong>du</strong> Service National <strong>de</strong> Renseignement, etc. Quiplus est, les gouvernants n’hésitent pas <strong>de</strong> recourir à <strong>de</strong>s montages <strong>de</strong> toutes pièces pourmettre la main sur <strong>de</strong>s opposants <strong>de</strong> taille ou sur <strong>de</strong>s personnalités fort gênantes <strong>de</strong> par lespositions fermes par rapport à la mauvaise gestion <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong> l’Etat, le tout visant àimposer un discours unique. Et lorsque <strong>de</strong>s cas aussi horribles que scandaleux éclatent à laface <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> comme les <strong>de</strong>s assassinats <strong>de</strong> Muyinga, la torture <strong>de</strong> l’ancien Vice-Prési<strong>de</strong>ntAlphonse KADEGE, l’assassinat d’Ernest MANIRUMVA, le carnage <strong>de</strong> Gatumba, la bavurepolicière <strong>du</strong> campus Mutanga, etc. l’instrumentalisation <strong>de</strong> la Justice <strong>de</strong>vient un palliatif pourbiaiser le cours <strong>de</strong>s affaires. Du coup les enquêtes vite promises par les autorités <strong>de</strong>viennentinterminables s’elles ne font pas l’impasse sur certains présumés auteurs <strong>de</strong> crimes pourtanttour à tour cités dans les différents procès judiciaires.Or, on l’oublie trop souvent, la plupart d’<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile telles les groupesd’intérêt comme la Ligue ITEKA, l’APRODH, les médias privés, etc. mettent en exergue cescas pour la simple raison que leur raison d’être en tant que groupe d’intérêt est précisément<strong>de</strong> déceler et combattre « ce qui ne va pas ». Elles ne soulèvent ces cas que parce qu’ils sontlà. Et le Gouvernement qui est responsable <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> la res publica sur tout le territoirenational <strong>de</strong>vrait faire en sorte que cela n’arrive plus. Ce faisant, il prêterait moins le flanc àla critique.3. Conclusion & recommandationsAu regard faits et gestes que nous avons analysés dans la présente note <strong>de</strong> veille, il convient<strong>de</strong> dégager un certain nombre <strong>de</strong> leçons et ainsi formuler quelques recommandations.3.1. Conclusion37
Si le principe <strong>de</strong> « bonne gouvernance », c’est-à-dire l’interaction permanente entre l’Etat, lasociété civile et le secteur privé, constitue l’épine dorsale <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s Etatsdémocratiques, la plupart d’Etats africains en général et l’Etat burundais en particulier ontencore un long chemin à parcourir. Et pour cause, l’émergence d’une multitu<strong>de</strong>d’<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la Société civile dans les années quatre-vingt-dix en même temps que« l’instauration formelle » <strong>de</strong> la démocratie et ce avant la naissance d’une culturedémocratique au sein <strong>de</strong> toutes les couches <strong>de</strong> la population pouvait être comparée à quelquesgouttes <strong>de</strong> démocratie dans un océan d’autoritarisme. Et quand nous parlons d’océand’autoritarisme, nous pensons à une culture politique partagée : c’est dire que si les opposantsd’aujourd’hui critiquent à juste titre les reflexes autoritaires <strong>du</strong> régime en place, rien ne ditque si <strong>de</strong>main ils avaient la chance d’être aux affaires ils n’agiraient pas exactement <strong>de</strong> lamême manière. Tel n’est pas le cas pour les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile : ne visant pas laconquête <strong>du</strong> pouvoir, elles sont enclines à être davantage utiles pour tous : pour le pouvoirdans la mesure où la sonnette d’alarme qu’elles tirent en cas <strong>de</strong> mauvaise gestion <strong>de</strong> toutesnatures rappelle que la « ligne jaune » tend à être franchie d’une part, dans la mesure où ellesé<strong>du</strong>quent la population sur la ligne <strong>de</strong> démarcation entre ce qui est permis et ce qui ne l’estpas d’autre part. Or, c’est à travers une interaction pacifiée entre le pouvoir et ces<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile que <strong>de</strong>vra se construire une culture citoyenne, une culturedémocratique ; laquelle in<strong>du</strong>ira une résolution pacifique <strong>de</strong>s conflits, puisque les conflits sontinhérents à toute société humaine.C’est au moins pour protéger son image que le Gouvernement se <strong>de</strong>vrait <strong>de</strong> voir les<strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile non comme <strong>de</strong>s adversaires ou <strong>de</strong>s acteurs servant les partispolitiques <strong>de</strong> l’opposition mais comme <strong>de</strong>s partenaires. <strong>La</strong> raison est qu’en général ellespointent le doigt sinon sur <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> mauvaise gestion <strong>du</strong> moins sur les insuffisances <strong>du</strong>pouvoir. Dans ce cas, il suffirait que ce <strong>de</strong>rnier démontre à l’opinion publique en quoi lescritiques ne sont pas fondées (et il ne <strong>de</strong>vrait pas manquer d’experts en communication pourcela) ou qu’il reconnaisse ses points faibles et s’engager à rectifier le tir. Sinon voulue ou pas,l’interaction entre l’Etat et la société civile ne <strong>de</strong>meure pas moins une réalité aussi longtempsque, dépendant <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds aussi bilatéraux que multilatéraux, <strong>de</strong>s conditionnalitésà son financement ne tient pas moins en compte <strong>de</strong> la mauvaise gestion que la société civilereproche au pouvoir.38
3.2. Quelques recommandationsAu terme <strong>de</strong> cette note, il convient <strong>de</strong> formuler quelques recommandations :‣ Au Gouvernement :1° Prendre les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile non pour <strong>de</strong>s adversaires politiques ou <strong>de</strong>sopposants mais pour <strong>de</strong>s partenaires. En pointant <strong>du</strong> doigt sur « ce qui ne va pas », ce n’estpas moins un clin d’œil aux gestionnaires <strong>de</strong> l’Etat ;2°Développer une communication convaincante : chaque fois que les <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> lasociété civile dénoncent tel ou tel acte <strong>de</strong> mauvaise gestion, le Gouvernement <strong>de</strong>vrait yrépondre <strong>de</strong>s preuves à l’appui ; ce qui rentre dans la ligne <strong>de</strong> transparence censée être lasienne par ailleurs ;3° Redresser les insuffisances sur lesquelles s’appuient les critiques <strong>de</strong>s <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> lasociété civile et, chemin faisant, améliorer la « bonne gouvernance ». Et ce sera par-là quemême la culture démocratique en sortira renforcée ; ce qui, <strong>de</strong> fil en aiguille, in<strong>du</strong>ira unesociété aussi pacifiée que policée.4° Avoir comme cheval <strong>de</strong> bataille l’Etat <strong>de</strong> droit : rien n’assure plus <strong>de</strong> légitimité que lerespect <strong>de</strong> la loi, une loi qui soit la même pour tout le mon<strong>de</strong>, qu’elle protège ou qu’ellepunisse. Bien enten<strong>du</strong> cela requiert un préalable : la séparation <strong>de</strong>s pouvoirs, laquelle supposeelle-même l’indépendance <strong>de</strong> la magistrature.‣ Aux <strong>org</strong>anisations <strong>de</strong> la société civile :1° De mener, chacune en ce qui la concerne, <strong>de</strong>s critiques constructives afin <strong>de</strong> faire un clind’œil au Gouvernement chaque fois que <strong>de</strong> besoin.2° De respecter la loi, chacune dans son domaine, dans la formulation <strong>de</strong>s critiques à adresserau Gouvernement.‣ A la communauté internationale :De prêter main-forte au Gouvernement et à la Société civile en direction <strong>du</strong> respect <strong>de</strong>sdroits humains, <strong>de</strong> l’Etat <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> la bonne gouvernance.______________39
Le déficit en assainissement dans la ville <strong>de</strong> BujumburaParHonoré AHISHAKIYE *Intro<strong>du</strong>ctionEn 2009, un habitant sur trois dans la ville <strong>de</strong> Bujumbura n’avait pas accès à un systèmed’assainissement amélioré 46 . Les progrès sont restés minuscules. Les taux <strong>de</strong> couverture neprogressent pas. Sans accroissement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’éten<strong>du</strong>e et <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong>s programmesd’assainissement, l’Objectif <strong>du</strong> Millénaire pour le Développement (OMD) assigné pour 2015ne pourra pas être atteint.Selon le Rapport Mondial sur le Développement Humain 2006 47 , sans assainissement <strong>de</strong>base, les bienfaits <strong>de</strong> l’accès à l’eau salubre sont ré<strong>du</strong>its, et les inégalités en matière <strong>de</strong> santé,genre ou autres, associées à un déficit en assainissement, sapent systématiquement les progrèsdans les domaines <strong>de</strong> l’é<strong>du</strong>cation, <strong>de</strong> la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la pauvreté et <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> richesse.Un meilleur assainissement peut prémunir les gens, notamment les enfants, contre lesproblèmes <strong>de</strong> santé. Il peut tirer les populations <strong>de</strong> l’indigence, ré<strong>du</strong>ire les risques etvulnérabilités qui perpétuent les cycles <strong>de</strong> la pauvreté. Il peut augmenter la pro<strong>du</strong>ctivité, doperla croissance économique et créer <strong>de</strong>s emplois.En effet, la réalisation <strong>de</strong>s OMD relatifs à l’eau et à l’assainissement n’est pas qu’une simplequestion <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> dignité.Selon le PNUD (2009) 48 , les faits montrent qu’elleprovoquerait un bond en avant majeur <strong>du</strong> développement humain : l’eau et l’assainissementsont essentiels pour réaliser tous les OMD, les investissements dans l’approvisionnement en* Honoré AHISHAKIYE est Chercheur Professionnel à l’Institut <strong>de</strong> Développement Economique (IDEC), voletSocio-économie et Développement Humain.46 Source: Ministère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s Mines (2011), Taux d’utilisation en eau potable Mairie <strong>de</strong>Bujumbura, Milieu Urbain.47 PNUD (2006), Rapport Mondial sur le Développement Humain 2006, p.111.48 PNUD (2009), Evaluation sectorielle <strong>de</strong> pays : gouvernance, promotion et lea<strong>de</strong>rship en matière d’eau,d’assainissement et d’hygiène, Madgascar, One United Nations Plaza, New York, New York, 10017, États-Unis,p.1.40
eau assurent un ren<strong>de</strong>ment économique moyen <strong>de</strong> 4,4 dollars par dollar investi, lesinvestissements dans l’assainissement assurent un ren<strong>de</strong>ment économique moyen <strong>de</strong> 9,1dollars par dollar investi et le développement humain est plus étroitement lié à l’accès à l’eauet à l’assainissement qu’à n’importe quel autre facteur <strong>de</strong> développement comme les dépenses<strong>de</strong> santé et d’é<strong>du</strong>cation et l’accès aux services énergétiques compris.Compte tenu <strong>de</strong>s besoins actuels et <strong>de</strong> l'accroissement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la population, la question <strong>de</strong>l'accès à une eau saine et à l'assainissement se pose avec acuité dans la ville <strong>de</strong> Bujumbura. Cepapier a pour objectif <strong>de</strong> se pencher sur l’impact <strong>du</strong> déficit en l’assainissement dans la ville <strong>de</strong>Bujumbura. <strong>La</strong> première section met en relief que l’accès à l’eau et à l’assainissement <strong>de</strong> baseest un droit humain. Le <strong>de</strong>uxième point montre le cadre institutionnel et légal <strong>de</strong> l’accès àl’eau potable et à l’assainissement au Burundi. Le troisième point dresse la situation actuelleen matière d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la ville <strong>de</strong> Bujumbura. Le papier setermine par une conclusion et <strong>de</strong>s recommandations <strong>de</strong> politiques.1. Eau et assainissement, un droit <strong>de</strong> l’homme1.1. Définition<strong>La</strong> définition <strong>de</strong> ce que nous entendons par « assainissement » peut varier considérablementd’un pays à l’autre. L’assainissement peut se référer à l’évacuation <strong>de</strong>s excrétas, à la gestion<strong>de</strong>s eaux usées, à la pollution in<strong>du</strong>strielle, aux déchets soli<strong>de</strong>s, à la gestion <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> pluieou encore au drainage. Les ODM mettent essentiellement l’accent sur <strong>de</strong>ux dimensions <strong>de</strong>l’assainissement qui sont directement liées à la santé publique : l’évacuation <strong>de</strong>s excrétas etla gestion <strong>de</strong>s eaux usées domestiques.Il existe bien <strong>de</strong>s définitions <strong>de</strong> l'assainissement, d'un « assainissement <strong>de</strong> base », d'un «assainissement amélioré », ou encore d'un « assainissement écologique » qui ont étéproposées par différentes institutions <strong>de</strong>s Nations Unies, comme le Conseil collaboratif pourl'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement (CCAEA), le Programme commun <strong>de</strong>surveillance (PCS) <strong>du</strong> Fond <strong>de</strong>s Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et <strong>de</strong> l'OrganisationMondiale <strong>de</strong> la Santé (OMS).41
Dans le cadre <strong>de</strong> ce papier, nous nous référons à la définition <strong>de</strong> COHRE, WATERAID, SDCet UN-HABITAT (2008) 49 qui, elle-même est une définition légèrement modifiée à partir <strong>de</strong>celle qui a été proposée par le Groupe <strong>de</strong> travail <strong>du</strong> Millénaire 50 « L'assainissement signifiel'accès et l'usage d'installations sanitaires pour le traitement <strong>de</strong>s excrétions et <strong>de</strong>s eaux uséesainsi que leurs services connexes, et ce, <strong>de</strong> manière à assurer le respect <strong>de</strong> l'intimité et <strong>de</strong> ladignité <strong>de</strong>s usagés, ainsi qu'un environnement propre et sain pour tous ».Cette définition a davantage une portée très vaste. <strong>La</strong> garantie d'installations sanitaires, ainsique leurs services connexes doivent inclure « la collecte, le transport, le traitement etl'élimination ou la réutilisation <strong>de</strong>s excrétions humaines et <strong>de</strong>s eaux usées mais aussi <strong>de</strong>sor<strong>du</strong>res ménagères ainsi que toute activité liée à la promotion <strong>de</strong> l'hygiène » 51 , et ce dans lerespect <strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong>s conditions environnementales <strong>de</strong> l'endroit.1.2. Le droit à l’eau et à l’assainissementLe 28 juillet 2010, une résolution reconnaissant un droit à l’accès à une eau potable salubre etpropre a été adoptée à l’Assemblée Générale <strong>de</strong> l’ONU. Le texte (A/RES/64/292) a reçu levote favorable <strong>de</strong> 122 pays, 41 se sont abstenus et aucun Etat ne s’y est opposé. Cetterésolution reconnait le droit à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit <strong>de</strong>l’Homme essentiel au plein exercice <strong>du</strong> droit à la vie et <strong>de</strong> tous les droits <strong>de</strong> l’Homme. Celasignifie que pour l'ONU, le droit à l'eau et à l'assainissement est contenu dans <strong>de</strong>s traitésrelatifs aux droits <strong>de</strong> l'homme et par conséquent est légalement obligatoire.Le droit <strong>de</strong> l’homme à l’eau et aux équipements sanitaires dépasse les ambitions <strong>de</strong>s ObjectifsDu Millénaire et ambitionne une validité universelle en se focalisant sur les groupes les plus49 COHRE, WaterAid, SDC et UN-HABITAT (2008), L'assainissement : un impératif pour les droits <strong>de</strong> l'homme,Génève, disponible aussi en ligne sur www.wateraid.<strong>org</strong>/documents/.../sanitation_longcopy_french.pdf, p.2.50 Accès et utilisation d'installations, <strong>de</strong> services d'évacuation <strong>de</strong>s excrétions et eaux usées, fournissant à la foisl'intimité et garantissant un cadre <strong>de</strong> vie propre et sain, que ce soit à la maison ou dans le voisinage immédiat<strong>de</strong>s usagers.51 Citation extraite <strong>de</strong> la définition <strong>de</strong> l'assainissement donnée par le Groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s Nations Unies surl'eau <strong>du</strong>rant l'année internationale <strong>de</strong> l'assainissement (2008).42
défavorisés <strong>de</strong> la population. D’après Catarina <strong>de</strong> Albuquerque 52 , expert indépendant auprès<strong>de</strong>s Nations Unies, ce droit n’inclut pas seulement un accès <strong>du</strong>rable à l’eau mais aussi qu’unequantité d’eau suffisante à l’usage personnel et ménager soit payable, accessible, acceptable et<strong>de</strong> qualité. Alors que 20 litres d’eau potable <strong>de</strong> bonne qualité est considéré comme leminimum vital, il faut entre 50 et 100 litres pour pouvoir garantir la réalisation complète <strong>de</strong> cedroit.Pour COHRE, WATERAID, SDC et UN-HABITAT (2008), dans l'assainissement, leproblème prioritaire est celui <strong>de</strong> l'élimination <strong>de</strong>s excréta humains (selles, urines) quivéhiculent <strong>de</strong> nombreux germes pathogènes : bactéries, virus, parasites, … Bien enten<strong>du</strong>, leslatrines convenablement conçues et utilisées constituent un maillon essentiel <strong>de</strong> la lutte contrele péril fécal et urinaire. Mais il faut aussi se préoccuper <strong>de</strong>s eaux usées, <strong>de</strong>s or<strong>du</strong>resdomestiques, <strong>de</strong>s déchets in<strong>du</strong>striels et médicamenteux.1.3. Obstacles à l’assainissementDans une série <strong>de</strong> trois projets <strong>de</strong> recherche sur les obstacles à la promotion <strong>de</strong>l’assainissement et <strong>de</strong> l’hygiène dans trois pays francophones d’Afrique sub-saharienne :Madagascar, Burkina Faso et la République Démocratique <strong>du</strong> Congo, 53 Alliance Chrétiennepour la Coopération Economique et le Développement Social (ACCEDES), OverseasDevelopment Institute (ODI), Programme <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong>s Soins <strong>de</strong> Santé Primaires enzones <strong>de</strong> santé rurales (PPSSP), Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika EtoMadagasikara (FFBBM) ou « Association <strong>de</strong>s églises baptistes bibliques malgaches » etTearfund (2007) ont inventorié les obstacles clef qui peuvent entraver le développement <strong>de</strong> lapolitique d’assainissement.52 Conseil <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme, Rapport <strong>de</strong> l’experte indépendante, Catarina <strong>de</strong> Albuquerque, chargéed’examiner la question <strong>de</strong>s obligations en rapport avec les droits <strong>de</strong> l’homme qui concernent l’accès à l’eaupotable et à l’assainissement, A/HRC/12/24, 1er juillet 200953 - ACCEDES, ODI Tearfund (2007), Assainissement et hygiène dans les pays en voie <strong>de</strong> développement :i<strong>de</strong>ntifier les obstacles et y apporter <strong>de</strong>s réponses. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas au Burkina Faso, Royaume uni.- PPSSP, ODI Tearfund (2007), Assainissement et hygiène dans les pays en voie <strong>de</strong> développement : i<strong>de</strong>ntifierles obstacles et y apporter <strong>de</strong>s réponses. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas en République Démocratique <strong>du</strong> Congo, Royaume uni- FFBBM, ODI et Tearfund (2007), Assainissement et hygiène dans les pays en voie <strong>de</strong> développement :i<strong>de</strong>ntifier les obstacles et y apporter <strong>de</strong>s réponses. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas à Madagascar, Royaume uni43
Ces obstacles se résument en ces points :- <strong>La</strong> définition insuffisante <strong>de</strong>s résultats atten<strong>du</strong>s <strong>de</strong>s facteurs spécifiques sur lesquels lapromotion <strong>de</strong> l'hygiène et l'assainissement <strong>de</strong>vrait influer ;- L'absence <strong>de</strong>s lignes directrices pour la promotion <strong>de</strong> l'hygiène et l'assainissement,permettant <strong>de</strong> coordonner les différentes démarches et métho<strong>de</strong>s ;- <strong>La</strong> capacité insuffisante notamment en ressources humaines à élaborer, appliquer etévaluer les programmes et activités <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong> l'hygiène et l'assainissement ;- L'insuffisance <strong>de</strong> la collaboration intra et intersectorielle ;- <strong>La</strong> faiblesse <strong>de</strong> l'investissement dans les services d'hygiène et d'assainissement ;- Les priorités <strong>de</strong>s bailleurs qui ne coïnci<strong>de</strong>nt pas exactement avec celles <strong>de</strong>s pays.- L'absence d'articulations adéquates entre la promotion <strong>de</strong> l'hygiène et l'assainissementet la prestation <strong>de</strong>s services d'hygiène et d'assainissement; etc.2. Le cadre légal et institutionnel <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement au Burundi2.1. Cadre légalLe cadre légal ayant une inci<strong>de</strong>nce directe ou indirecte avec la gestion <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>l’assainissement se compose <strong>de</strong> textes légaux relevant <strong>du</strong> droit interne et <strong>de</strong>s conventionsinternationales ratifiées par le Burundi.2.1.1. Les textes légaux <strong>du</strong> droit interneAu niveau <strong>du</strong> droit interne, plusieurs textes légaux sont disponibles pour infléchir lespratiques humaines menaçant l’eau et l’assainissement. Parmi eux, on peut citer les articlessuivants :- Texte déterminant les normes d’élimination <strong>de</strong>s or<strong>du</strong>res ménagères et <strong>de</strong> leur incinération(articles 14 et 15 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique),- Textes portant modalités <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment à l’égout <strong>de</strong> toute habitation ou établissementrejetant <strong>de</strong>s eaux usées obligatoire dans les agglomérations dotées d’un réseaud’assainissement collectif (art 63),- Textes réglementant la prévention et le contrôle <strong>de</strong> la pollution <strong>de</strong>s eaux (articles 80 et 82<strong>de</strong> la loi sur le domaine public hydraulique) et ceux fixant les conditions et modalités<strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s eaux usées, huiles usagées et autres déchets liqui<strong>de</strong>s provenant <strong>de</strong>s44
installations in<strong>du</strong>strie1les, commerciales, artisanales, agricoles ou d’élevage, avant leurélimination ou rejet (article 126 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1’Environnement),- Décret 100/241 <strong>du</strong> 31 Décembre 1992 portant réglementation <strong>de</strong> l’évacuation <strong>de</strong>s EauxUsées en milieu urbain.- législation en matière sanitaire au Burundi régie par le décret-loi n°1/16 <strong>du</strong> 17 mai 1982portant le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique. Ce texte comprend <strong>de</strong>s directives sur la gestion <strong>de</strong>sor<strong>du</strong>res ménagères mais ne donne aucune indication en ce qui concerne la gestion <strong>de</strong>s déchetsbiomédicaux. Le ministère chargé <strong>de</strong> la santé publique détermine toutes les normes d’hygièneauxquelles doivent répondre les établissements in<strong>du</strong>striels pour assurer la protection <strong>du</strong>voisinage contre les dangers et toutes les nuisances <strong>du</strong>es aux déchets soli<strong>de</strong>s, liqui<strong>de</strong>s etgazeux qui en seraient issus.Une analyse <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> loi en rapport avec l’assainissement révèle que <strong>de</strong>puisplusieurs décennies, la question <strong>de</strong> l’assainissement constitue un axe stratégique majeur <strong>de</strong>développement retenu par les plus hautes Autorités Politiques <strong>de</strong> la République <strong>du</strong> Burundi.Toutefois, une étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> Secrétariat Technique <strong>du</strong> PTPCE (2011) 54 a constaté une faibleapplication <strong>de</strong> ces textes et lois en vigueur. Les raisons <strong>de</strong> cette situation sont multiples :insuffisance, voire manque <strong>de</strong> moyens matériel, logistique, humains et financiers,dysfonctionnements institutionnels, multiplicité <strong>de</strong>s intervenants dans le sous secteur, faiblevolonté politique, etc.2.1.2. Les conventions internationales ratifiées par le BurundiSur le plan <strong>du</strong> droit international, le Burundi est partie prenante à plusieurs conventions ayant<strong>de</strong>s rapports directs avec l’eau et l’assainissement. On peut citer notamment :- la convention <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro <strong>du</strong> 5 juin 1992, sur la diversité biologique,- la convention sur le contrôle <strong>de</strong>s mouvements transfrontaliers <strong>de</strong> déchets dangereux et <strong>de</strong>leur élimination (convention <strong>de</strong> Bale, <strong>du</strong> 22 mars 1989)54 Secrétariat Technique <strong>du</strong> PTPCE (2011), Collecte et évacuation <strong>de</strong>s eaux pluviales <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong>Bujumbura : i<strong>de</strong>ntification d’un programme prioritaire et DAO d’une tranche d’urgence, Volume 1:Schéma directeur, Projet <strong>de</strong> Travaux Publics et <strong>de</strong> Gestion Urbaine (PTPGU), p.114.45
- la convention sur la Gestion Durable <strong>du</strong> lac Tanganyika, signé le 12 juin 2003 et dontl’objet est d’assurer la protection et la conservation <strong>de</strong> la diversité biologique etl’utilisation <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s ressources naturelles <strong>du</strong> lac et son environnement sur base d’unegestion intégrée et la coopération entre les Etats contractants.- le Cadre <strong>de</strong> Coopération <strong>de</strong>s pays <strong>du</strong> Bassin <strong>du</strong> Nil en date <strong>du</strong> 28 février 2011 et dontl’objet est <strong>de</strong> promouvoir un développement socio-économique <strong>de</strong>s populations <strong>du</strong> bassin àtravers une utilisation efficiente <strong>de</strong>s eaux <strong>du</strong> Nil et le partage équitable <strong>de</strong>s avantages à enéchoirSelon l’Académie <strong>de</strong> l’Eau (2009) 55 au Burundi, la Constitution (2005) abor<strong>de</strong> la question <strong>du</strong>droit à l’assainissement d’une manière indirecte à partir <strong>de</strong>s droits économiques et sociaux.«Les droits et <strong>de</strong>voirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle <strong>de</strong>sdroits <strong>de</strong> l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits <strong>de</strong> l’homme, la Charteafricaine <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong>s peuples, la Convention sur l’élimination <strong>de</strong> toutes lesformes <strong>de</strong> discrimination à l’égard <strong>de</strong>s femmes et la Convention relative aux droits <strong>de</strong> l’enfantfont partie intégrante <strong>de</strong> la Constitution <strong>de</strong> la République <strong>du</strong> Burundi » (Art.19). « Toutepersonne est fondée à obtenir la satisfaction <strong>de</strong>s droits économiques, sociaux et culturelsindispensables à sa dignité et au libre développement <strong>de</strong> sa personne, grâce à l’effort nationalet compte tenu <strong>de</strong>s ressources <strong>du</strong> pays » (Art.52).2.2. Cadre institutionnelLe ministère chargé <strong>de</strong> la santé publique détermine toutes les normes d’hygiène auxquellesdoivent répondre les établissements in<strong>du</strong>striels pour assurer la protection <strong>du</strong> voisinage contreles dangers et toutes les nuisances <strong>du</strong>es aux déchets soli<strong>de</strong>s, liqui<strong>de</strong>s et gazeux qui en seraientissus.En 2009, HAKIZIMANA et NIMPAGARITSE 56 ont pu relever les principaux Ministèresconcernés et habilités à intervenir dans le secteur <strong>de</strong> l’Eau et assainissement. Ces Ministèresétaient:55 Académie <strong>de</strong> l‟Eau (2009), Le droit à l’assainissement dans les législations nationales, Paris, France, p.293.56 HAKIZIMANA Go<strong>de</strong>froy et NIMPAGARITSE Didace Olivier (2009), Etu<strong>de</strong> sur le développement d’un cadrelégal et institutionnel <strong>du</strong> secteur <strong>de</strong> l’eau au Burundi, USAID, Bujumbura, pp.26-27.46
- Le Ministère <strong>de</strong> l’Eau, <strong>de</strong> l’Environnement, <strong>de</strong> l’Aménagement <strong>du</strong> Territoire et <strong>de</strong>l’Urbanisme (MEEATU);- Le Ministère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s Mines (MEM);- Le Ministère <strong>de</strong> l’Agriculture et <strong>de</strong> l’Elevage (MAE);- Le Ministère <strong>de</strong>s Travaux Publics et <strong>de</strong> l’Equipement (MTPE),- Le Ministère <strong>de</strong> la Santé Publique (MSP);- Le Ministère <strong>du</strong> Commerce, <strong>de</strong> l’In<strong>du</strong>strie et <strong>du</strong> Tourisme (MCIT);- Le Ministère <strong>de</strong>s Transports, Postes et Télécommunications (MTPT);- Le Ministère <strong>de</strong> la Décentralisation et <strong>du</strong> Développement Communal (MDDC);- Le Ministère <strong>de</strong>s Affaires <strong>de</strong> la Communauté Est-Africaine (MACEA),- Le Ministère <strong>de</strong> l’Enseignement Supérieur et <strong>de</strong> la Recherche Scientifique (MESRS)- Le Ministère <strong>de</strong> la Sécurité Publique (MISEP);- Le Ministère <strong>de</strong> la Planification et <strong>de</strong> la Reconstruction Nationale (MPRNEn plus <strong>de</strong> ces ministères, les SETEMU (Services Techniques Municipaux), chargé <strong>de</strong>l’assainissement urbain <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bujumbura, est sur la tutelle <strong>de</strong> la mairie.L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> HAKIZIMANA et NIMPAGARITSE (2009) a relevé les différentschevauchements entres les Ministères intervenant dans le secteur <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>l’assainissement ainsi que les problèmes <strong>de</strong> coordination. <strong>La</strong> gestion est alors entravée par <strong>de</strong>sobstacles majeurs qui peuvent notamment résulter, <strong>de</strong>:- soit d’une délimitation floue <strong>de</strong>s rôles et responsabilités <strong>de</strong>s différents intervenants,- soit <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> coordination inadaptés,- soit <strong>de</strong>s vi<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong>s chevauchements juridiques,- soit <strong>de</strong> l’incapacité à faire correspondre les responsabilités, l’autorité et les capacitésd’action et compétences, etc47
Vu le nombre d’intervenant dans le secteur <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, la définition et lacoordination <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>vient difficile. C’est ce que constatent HAKIZIMANA etNIMPAGARITSE 57 : « En présence, d’une si gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong> Ministères exerçant dans lesecteur <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, <strong>de</strong>s compétences qui s’entrecroisentet qui sont parfois même mal délimitées, il <strong>de</strong>vient difficile d’institutionnaliser lacoordination et la concertation pour une action harmonisée, cohérente et efficace ».Ce manque <strong>de</strong> coordination a un certain impact sur la politique d’assainissement. Pour ce quiest <strong>de</strong> l’urbanisation, il y a une absence d'une politique claire en matière d'assainissement dansla ville <strong>de</strong> Bujumbura, ce qui est également une évi<strong>de</strong>nce dans les autres villes <strong>de</strong>s chefs lieux<strong>de</strong> province. Cela est mis en relief par le fait que les réseaux d’égouts comme les systèmesd’évacuation <strong>de</strong>s eaux usées et d’élimination <strong>de</strong>s déchets soli<strong>de</strong>s sont insuffisants ou malentretenus.3. Etat <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement dans la ville <strong>de</strong> Bujumbura3.1. Accès à l’eau potableAu niveau <strong>de</strong> l’eau potable, <strong>de</strong>s efforts considérables ont été réalisés car 87% <strong>de</strong> la populationurbaine ont accès à une source d’eau potable. Même à ce niveau, cet effort doit être relativisépuisque ce ne sont que 47% <strong>de</strong> la population qui possè<strong>de</strong>nt un branchement privé. En effet, lenon accès à un branchement privé à une source d’eau aura <strong>de</strong>s répercussions surl’assainissement.Pour l’approvisionnement en eau <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bujumbura, la gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s eaux estcaptée dans le lac Tanganyika. Ce <strong>de</strong>nier est menacé par une pollution sans cesse croissantequi pourrait nécessiter <strong>de</strong>s coûts élevés <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> l’eau pour la rendre potable et parconséquent son prix <strong>de</strong> vente au consommateur <strong>de</strong>vra augmenter.57 HAKIZIMANA Go<strong>de</strong>froy et NIMPAGARITSE Didace Olivier (2009), Ibi<strong>de</strong>m, p.4148
Tableau n° 1 : Pourcentage <strong>de</strong> la population par type <strong>de</strong> source d’approvisionnement eneau 1Population2Source d'eau potableSource d'eau non potableAutresCommune Ménage PersonneprivéBorneFontainePuitsnonEau <strong>de</strong>SCEP 4 surfaceprotégé/SnA 3Ven<strong>de</strong>urprivé/voisin 5BranchementNonconnusButerere 6576 28371 3,3% 62% 26% 0% 2,4% 5,9% 0%Buyenzi 10130 47363 46% 38% 0% 0% 0,1% 16% 0%Bwiza 7878 37688 89% 2,7% 0% 0% 0% 8,4% 0,1%Cibitoke 10419 50899 58% 38% 0% 0% 0% 4,3% 0,1%Gihosha 6585 39503 56% 28% 0% 0% 9,9% 5,3% 0%Kamenge 11185 50070 21% 69% 0% 0% 0% 10% 0,1%Kanyosha 11498 59181 28% 38% 0% 0% 18% 16% 0,1%Kinama 10593 49776 16% 79% 0% 0% 1,0% 2,9% 0%Kinindo 3680 21920 98% 0,1% 0% 0% 0% 2,0% 0%Musaga 8008 43735 44% 380% 0% 0,1% 4,8% 12% 0,2%Ngagara 4248 30296 88% 0,7% 4% 0% 4% 2,7% 0,2%Nyakabiga 4400 20883 93% 4% 0% 0% 0% 3,0% 0%Rohero 2608 17481 82% 6,8% 0% 0% 5,8% 5,6% 0%TOTAL 97805 497166 47% 38% 1,8% 0% 4,2% 8,1% 0,1%1 Source: Inventaire National Eau et assainissement, Enquête ménages, 2009, MEM2 Source: Recensement 2008, ISTEEBU3 SnA: Source non Aménagée4 SCEP: Système <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s eaux Pluviales5 Remarque: L'eau d'un ven<strong>de</strong>ur privé ou d'un voisin n'est pas considérée comme une sourced'approvisionnement en eau potable car la qualité et la quantité <strong>de</strong> cette eau ne sont pasgaranties dans le tempsSource: Ministère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s Mines (2011), Taux d’utilisation en eau potableMairie <strong>de</strong> Bujumbura, Milieu Urbain.3.2. Accès à l’assainissement<strong>La</strong> ville <strong>de</strong> Bujumbura peut être découpée en <strong>de</strong>ux régions bien distinctes en fonction <strong>du</strong>niveau d'urbanisation constaté sur le terrain. Ce découpage est essentiellement basé sur le49
niveau d'aménagement <strong>de</strong> la voirie (voir figure 1). On distingue en effet une zone où la voirieest bien définie et l'habitat structuré. Cette zone peut être appelée « Zone Urbanisée ». Lereste <strong>du</strong> périmètre est appelé «Zone Non Urbanisée» (ZNU) et se caractérise par un habitatnon structuré (habitations spontanées) et une voirie non définie.Figure 1 : Périmètre urbain et non urbainSource : Secrétariat Technique <strong>du</strong> PTPCE (2011), Collecte et évacuation <strong>de</strong>s eaux pluviales<strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bujumbura : i<strong>de</strong>ntification d’un programme prioritaire et DAO d’une tranched’urgence, Volume 1: Schéma directeur, Projet <strong>de</strong> Travaux Publics et <strong>de</strong> Gestion Urbaine(PTPGU), p.17.Tous les quartiers comportent une partie non urbanisée et l’habitat spontané est la plupart <strong>de</strong>sfois proche d’une rivière qui se déverse dans le lac Tanganyika. Ce manque d’urbanisation <strong>de</strong>tous les quartiers a un impact négatif sur l’assainissement.50
Tableau n° 2 : Couverture en Assainissement <strong>de</strong> base – Mairie <strong>de</strong> Bujumbura (2009) 1 : Pourcentage <strong>de</strong> la population par typed’installation d’assainissement <strong>de</strong> baseCommuneMénageInstallation non adéquateWC <strong>La</strong>trine non Trousans améliorée nonracccouvertor<strong>de</strong>mentPersonnesInstallation adéquateCouverture WC raccordé à Ventilée Nonent <strong>de</strong> base 3assainissemventiléeEgoutFosseseptiqueFosseétancheNP 5 NP 6 NP 5 NP 6 NP 5 NP 6Pasd’installationAutres 7Buterere 6576 28371 5,9% 0,1% 1,6% 3,7% 0% 0%0,6%1,8%0,1% 27% 45% 6,8% 13% 0,1%Buyenzi 10130 47363 28% 1,3% 15% 11% 0%1,2%0,2%7,0%0,6%1,7% 60% 0,6%0,7% 0,1%Bwiza 7878 37688 52% 35% 15% 0,7% 0%0,1% 1% 18%0,4%1,6% 27% 0%0,3% 0%Cibitoke 10419 50899 18% 0,1% 16% 1,5% 0%0,3%0,1%2,2%0,4%4,6% 71% 1,4%1,7% 0%Gihosha 6585 39503 56% 0,3% 55% 0,9% 0%0,4% 0%0,3%0,3% 15% 25% 0,1%3,0% 0,2%Kamenge 11185 50070 9,7% 9,7% 7,6% 1,3%0,1%1,3%0,7%3,2%0,5% 12% 67% 2,7%3,6% 0,3%Kanyosha 11498 59181 22% 0% 21% 0,6% 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 32% 38% 0,6% 6,0 0,1%51
% % % % % %Kinama 10593 49776 6,4% 0% 5% 0,8% 0%0,3%0,7%1,2%0,2% 12% 73% 2,5%3,6% 0,8%Kinindo 3680 21920 99% 0% 99% 0,2% 0% 0%0,1% 0%0,3%0,3% 0,1% 0%0,1% 0%Musaga 8008 43735 28% 0% 27% 0,5% 0%0,2%0,4%0,4%0,5% 19% 48% 1,2%2,6% 0,1%Ngagara 4248 30296 90% 71% 18% 0,9% 0% 0%0,1%0,1%0,5%1,1% 2,5% 0,2%5,3% 0%Nyakabiga 4400 20883 70% 60% 8,4% 1,6% 0%0,1%0,2% 12%0,8%1,1% 15% 0%0,2% 0%Rohero 2608 17481 82% 14% 67% 0,6% 0% 0% 0%0,1%0,2%3,4% 10% 1,8%2,4% 0,1%0,1 0,4 0,4 3,3 0,4 12% 44% 1,4% 3,5 0,2%TOTAL 97805 497166 34% 9,1% 23% 1,8% % % % % %%1 Source : Inventaire National Eau et assainissement, Enquête ménages, 2009, MEM ; 2 Source : Recensement 2008, ISTEEBU ; 3 Remarque <strong>La</strong>couverture en assainissement <strong>de</strong> base est calculée comme étant la population qui utilise une installation adéquate non partagée ; 4 Les latrinesavec les caractéristiques suivantes ont été considérées comme améliorées Fosse étanche/ventilée, toiture avec toles/tuiles, murs en briquescuites/adobes, dalle en béton, 5 NP Non partagée avec d’autres ménages ; 6 P : partagée avec d’autres ménages ; 7 le type d’installation n’a pas étéspécifié pendant l’inventaire.Source : Ministère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s Mines (2011), Couverture en Assainissement <strong>de</strong> base – Mairie <strong>de</strong> Bujumbura, Milieu Urbain ; p.9.52
Contrairement à l’accès à l’eau potable, la couverture en assainissement est très faible. Letableau n° 2 montre que c’est la partie non urbanisée qui a une faible couverture enassainissement <strong>de</strong> base. Les quartiers <strong>de</strong> Buterere, Cibitoke, Kamenge, Kanyosha, Kinama etKinama manifestent <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> couverture extrêmement bas. En l’absence <strong>de</strong> ressourcessuffisantes ou <strong>de</strong> cadre institutionnel, ces quartiers ont rapi<strong>de</strong>ment connu une pleineexpansion non planifiée et <strong>de</strong>s habitations dépourvues <strong>de</strong> système d’assainissement. Letableau n° 2 met en relief que plus <strong>de</strong> 60% n’ont pas accès à <strong>de</strong>s installations sanitairesadéquates. Plus grave, 3,5% <strong>de</strong> la population <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bujumbura n’ont pas <strong>du</strong> toutd’installations sanitaires. Comme la population totale est <strong>de</strong> 497 166 habitants, ce pourcentagereprésente environ 17 000 personnes qui n’ont pas accès à <strong>de</strong>s installations sanitaires.Selon Coalition Eau 1 , la privation <strong>de</strong> simples toilettes ou d’une évacuation <strong>de</strong>s eaux uséesdomestiques, est une condition <strong>de</strong> vie indigne infligée aux plus démunis. En ce début <strong>de</strong> XXIième siècle, tous les humains <strong>de</strong>vraient pouvoir faire leurs besoins dans <strong>de</strong> véritables toilettes,se laver et vivre proprement. C’est une question <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong> la dignitéhumaine.Les déchets humains représentent une gran<strong>de</strong> source <strong>de</strong> pollution et <strong>de</strong> contamination <strong>de</strong>l’eau, et ils sont souvent responsables <strong>de</strong> divers problèmes <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> maladies comme ladiarrhée, la dysenterie et le choléra. Des services d’assainissement corrects sont doncétroitement liés à la santé et à la survie.Dans le quatrième message <strong>de</strong> l’année international <strong>de</strong> l’assainissement 2 ,il est fait remarquerque dans le contexte particulier <strong>de</strong> l’urbanisation, les eaux usées domestiques, les eauxd’égout et les déchets soli<strong>de</strong>s mal évacués représentent une série <strong>de</strong> préoccupations qui vont<strong>de</strong> leur tendance à fournir <strong>de</strong>s sites favorables à la propagation <strong>de</strong> vecteurs <strong>de</strong> maladiescontagieuses jusqu’à la façon dont ils contribuent à la pollution <strong>de</strong> l’air, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>s sols.1 Coalition Eau Vivre sans toilettes: une réalité pour 2,6 milliards d’humains, disponible sur www.coalitioneau.<strong>org</strong>/.../DD_m1_infowand_fr_92x240_080703_hs2 OMS (2008), Messages Clés <strong>de</strong> l’Année International d’assainissement : Message 4 –L’Assainissement Protègel’Environnement, disponible aussi sur www.sanitationyear2008.<strong>org</strong>, p .1.53
L’autre problème majeur est celui <strong>de</strong> la contamination <strong>de</strong> l’environnement. Le rejet sanstraitement <strong>de</strong>s eaux usées et <strong>de</strong>s excréments entraîne la pollution <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface (rivière,lac, mer) ou <strong>de</strong>s nappes phréatiques.Environ 88 pour cent <strong>de</strong> toutes les contaminations <strong>de</strong> diarrhée dans le mon<strong>de</strong> sont <strong>du</strong>es à unapprovisionnement en eau insalubre, à l’absence <strong>de</strong> pratiques d’hygiène saines et à <strong>de</strong>sdispositifs d’assainissement rudimentaires (Evans, 2005) 3 . Et le problème est d’une gran<strong>de</strong>ampleur : le nombre <strong>de</strong> ceux qui n’ont pas accès à l’assainissement est presque <strong>de</strong>ux fois plusélevé que ceux qui n’ont pas d’approvisionnement en eau (ONU, 2005) 4 . Exactement, c’est ceque les chiffres concernant la ville <strong>de</strong> Bujumbura montrent. En effet, 86,8% ont accès à l’eaupotable tandis que 34% seulement ont accès à l’assainissement amélioré.3.3. Les or<strong>du</strong>res ménagèresD’après le SP/REFES (2011) 5 , la ville <strong>de</strong> Bujumbura pro<strong>du</strong>it 135.085 m 3<strong>de</strong> déchetsménagers, mais les services techniques municipaux (SETEMU) ne collectent que 20% <strong>de</strong>sdéchets pro<strong>du</strong>its 6 . Enfin, les réseaux d'évacuation <strong>de</strong>s eaux usées sont vieux. <strong>La</strong> quantitéd'eau pro<strong>du</strong>ite dans la ville est estimée à 75 millions <strong>de</strong> m 3 /an, mais la capacité <strong>de</strong> collectepar le réseau d'égouts est seulement 11 millions <strong>de</strong> m 3 /an. C'est donc une faible proportion<strong>de</strong>s eaux collectées qui est traitée.Les Services Techniques Municipaux (SETEMU) <strong>de</strong> Bujumbura ont mis en place un système<strong>de</strong> ramassage hebdomadaire <strong>de</strong>s déchets par camions, mais cette collecte est souvent freinéepar le manque <strong>de</strong> carburant et d'entretien <strong>de</strong>s véhicules. Le volume <strong>de</strong>s déchets ménagers3 Evans B (2005) Securing Sanitation: The compelling case to address the crisis. Rapport pro<strong>du</strong>it par leStockholm International Water Institute (SIWI), en collaboration avec l’Organisation Mondiale <strong>de</strong> la Santé(OMS) et commissionné par le gouvernement <strong>de</strong> Norvège pour contribuer à la Commission pour undéveloppement <strong>du</strong>rable.4 Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies (2005) UN Millennium Project 2005. Health, Dignity, andDevelopment: what will it take? Rapport <strong>de</strong> la task force sur l’eau et l’assainissement, ONU,janvier 2005.5 SP/REFES (2011), Cadre Stratégique <strong>de</strong> Croissance et <strong>de</strong> luttre contre la Pauvreté (CSLPI 2007-2010) :Evaluation <strong>de</strong> la Performance et <strong>de</strong> l’Impact, Bujumbura, p.51.6 Les déchets in<strong>du</strong>striels sont estimés à 64.170 m3/an, chaque enterprise étant responsible <strong>de</strong> la gestion.54
générés dans la ville <strong>de</strong> Bujumbura est estimé à 135.085 m 3 par an et <strong>de</strong>vrait dépasser les210.000 m 3 à l'horizon 2015.Les or<strong>du</strong>res ménagères et les déchets soli<strong>de</strong>s entassés et non collectés forment <strong>de</strong> petitesmontagnes éparpillées dans tous les quartiers <strong>de</strong> la ville. Les SETEMU ne collectent que 20%<strong>de</strong>s déchets pro<strong>du</strong>its dans la ville et les déposent à la décharge publique <strong>de</strong> Buterere qui setrouve sur la périphérie <strong>de</strong> la ville.3.4. Les déchets in<strong>du</strong>strielsLe flux <strong>de</strong> toutes ces matières apportées par les affluents naturels et par les rejets directs dansles eaux <strong>du</strong> lac constitue une charge polluante très importante. Particulièrement pour lapollution in<strong>du</strong>strielle, on remarque que les in<strong>du</strong>stries burundaises ont été installéesavant que le volet environnement ne soit d'actualité et n'ont donc pas prévu <strong>de</strong>sinstallations <strong>de</strong> prétraitement, les rejets se font directement dans le milieu naturel 7 .Les eaux usées et les déchets in<strong>du</strong>striels qui sont rejetés sans traitement dans <strong>de</strong>s coursd’eau, polluent les sources d’approvisionnement en eau. En tant que source d'un élément aussivital, une attention particulière doit être portée sur les risques <strong>de</strong> pollution dans la zone où estsituée la prise d'eau. Le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> cette pollution influe directement sur la qualité <strong>de</strong> l'eaupotable. A titre d'exemple, le point <strong>de</strong> captage qui se trouvait à 700 m <strong>de</strong> la plage en 1981 aété déplacé à 3.500 m en 1984.4. Conclusion et recommandationsD’après Smet Henri (2009) 8 , dans les pays en développement, le droit à l’eau et àl’assainissement est souvent un droit reconnu en théorie mais pas toujours dans les faits. Lesdéclarations politiques sont transcrites progressivement, elles influent sur les plans d’action<strong>de</strong>s gouvernements, les dépenses publiques et aussi le contenu <strong>de</strong>s lois. <strong>La</strong> tra<strong>du</strong>ction concrète<strong>de</strong> l’accès à l’eau et à l’assainissement varie en fonction <strong>du</strong> <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> développement <strong>du</strong> payset <strong>du</strong> souci qu’il a <strong>de</strong> respecter ses engagements internationaux.7BAKEVYA Pierre, HAKIZIMANA Gabriel et BARANDEMAJE Denis, « Etablissements humains, villes, in<strong>du</strong>stries(Synthèse) », Lutte Contre la Pollution et Autres Mesures pour Proteger la Biodiversité <strong>du</strong> <strong>La</strong>c TanganyikaAnalyse Diagnostique Nationale – Burundi 07 - 11 Septembre 1998, Bujumbura, p.7.8 Smet Henri (2009), « Le droit à l’eau dans les pays <strong>du</strong> Sud », Altermon<strong>de</strong>s n°13, p.2.55
Dans le contexte burundais, l’analyse <strong>du</strong> cadre légal et institutionnel révèle que la loi interneet internationale existe mais que <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue institutionnel, il y a chevauchement entre lesdifférents intervenants et un manque <strong>de</strong> capacités humaines et financières. Il y a très peu <strong>de</strong>textes qui sont mis en vigueur actuellement et qui montrent l’engagement <strong>du</strong> Gouvernement<strong>du</strong> Burundi en matière d’eau et assainissement.Des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne l’accès à l’eau, par contre, enmatière d’assainissement, la ville <strong>de</strong> Bujumbura est encore à une faible couverture tant <strong>du</strong>point <strong>de</strong> vue que <strong>de</strong> la collecte <strong>de</strong>s eaux usées que <strong>de</strong> l’accès à une toilette améliorée. <strong>La</strong>cause principale est l’habitat spontané, phénomène qui engendre la création <strong>de</strong>s bidonvilles.Le manque <strong>de</strong> couverture en assainissement <strong>de</strong> base risque même <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire les effortsatteints au niveau <strong>de</strong> l’accès à l’eau potable par la contamination <strong>du</strong> lac Tanganyika, sourced’approvisionnement en eau potable. Pour cela, <strong>de</strong>s mesures doivent être prises dans lesmeilleurs délais pour assurer une bonne couverture en assainissement <strong>de</strong> base. Ce papierpropose ces quelques recommandations :- une politique d’urbanisation doit être mise en place et ré<strong>du</strong>ire l’occupation spontanée <strong>de</strong> lapériphérie urbaine ;- la population doit être conscientisée pour une meilleure couverture en assainissement <strong>de</strong>base ;- une politique et la stratégie nationale d’assainissement doit être envisagée » ;- l’aménagement <strong>de</strong> mécanismes <strong>de</strong> coordination efficaces reliant les différents<strong>org</strong>anismes impliqués dans la gestion <strong>de</strong>s ressources en eau et <strong>de</strong> l’assainissement doit êtrerepensé ;- attirer d’autres financements pour combler la faiblesse <strong>de</strong> l’assainissement <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong>Bujumbura ;- augmenter l'accès à un assainissement adéquat <strong>de</strong> 34% <strong>de</strong> 2009 à 72% en 2015 comme lepréconise le CSLP ;- aménager une station d'épuration <strong>de</strong>s eaux usées au sud <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bujumbura56
- installation obligatoire <strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> prétraitement au niveau <strong>de</strong> toutes les entreprisesin<strong>du</strong>strielles existantes et autoriser l'implantation <strong>de</strong>s nouvelles en fonction <strong>de</strong> leur capacités<strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s polluants émis.L’assainissement couvre un domaine trop vaste. Vu le manque <strong>de</strong> données sur le revenu <strong>de</strong>sménages, la question <strong>de</strong> la corrélation entre l’assainissement et le revenu n’a pas fait objet <strong>de</strong>cette étu<strong>de</strong> pour analyser le comportement <strong>de</strong> la population face au besoin d’assainissement.L’influence <strong>du</strong> revenu sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’assainissement mérite d’être analysée d’autant plusque ce sont les quartiers pauvres qui manquent les installations sanitaires.Volume 3, N°11. Novembre 201157