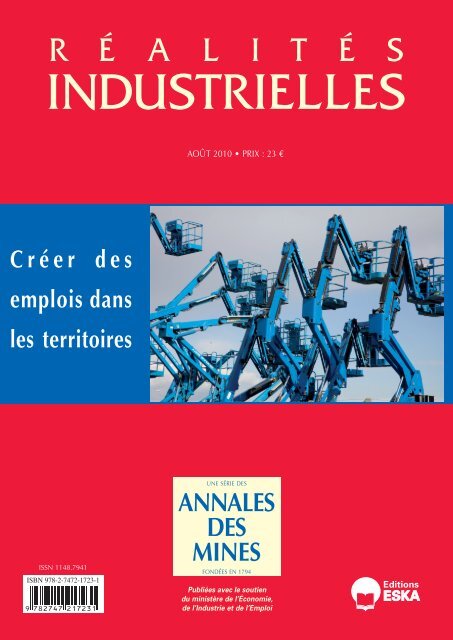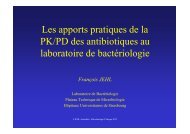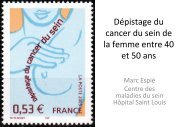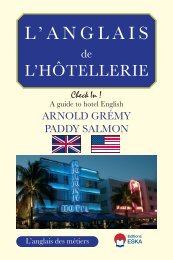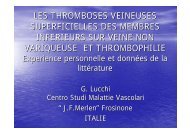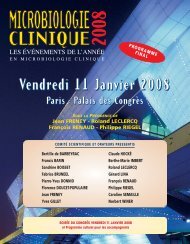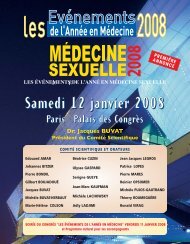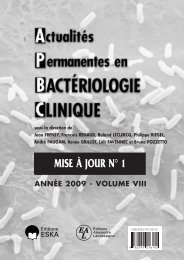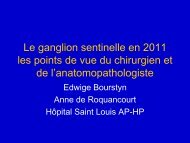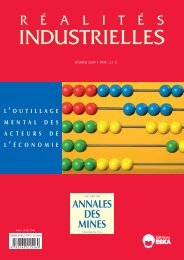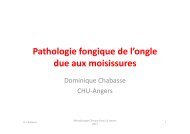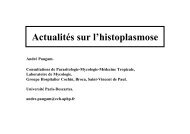R É A L I T É S
R É A L I T É S
R É A L I T É S
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
R <strong>É</strong> A L I T <strong>É</strong> SINDUSTRIELLESAOÛT 2010 • PRIX : 23 €Créer desemplois dansles territoiresISSN 1148.7941ISBN 978-2-7472-1723-1UNE S<strong>É</strong>RIE DESANNALESDESMINESFOND<strong>É</strong>ES EN 1794Publiées avec le soutiendu ministère de l’<strong>É</strong>conomie,de l’Industrie et de l’Emploi
<strong>É</strong>ditorialPierre CouveinhesLe numéro précédent de Réalités industrielles posait cette question : « Après la crisefinancière, un retour à l’économie réelle ? », la réponse étant oui, bien entendu. Dansmon éditorial, je soulignais que la bonne résistance de la France à la crise paraissaitrésulter d’un solide ancrage territorial, auquel étaient associées des sources de richesse queles statistiques ignorent dans une large mesure…Le présent numéro sur le thème « Créer des emplois dans les territoires » se situe dans lasuite logique du précédent. L’économie réelle, c’est être en mesure de produire des biens etdes services destinés à des marchés désormais mondialisés, c’est savoir développer et maîtriserles technologies utiles. Là est la seule source durable de prospérité pour un pays, sesterritoires et ses habitants.La France n’a-t-elle pas trop oublié son économie réelle au cours des dernières années,éblouie qu’elle était par cette économie de casino que l’on qualifiait de « virtuelle » ? Peutêtre! Mais un changement d’attitude s’est clairement dessiné depuis ce qu’il convient denommer «la crise ». Avec les « Etats généraux de l’industrie », l’attention se porte à nouveausur cette partie essentielle de l’économie réelle (mais pas la seule : n’oublions pas les services,le tourisme, l’agriculture). Et la création des Commissaires à la réindustrialisation témoigned’un regain d’intérêt pour l’enracinement des activités dans les différents territoires quiconstituent notre pays. Il s’agit là d’un point essentiel, car un ancrage local fort, dans lecadre d’un écosystème associant entreprises, établissements d’enseignement et organismesde recherche, est certainement la meilleure protection contre les délocalisations.Sept des dix Commissaires à la réindustrialisation actuellement en fonction ont contribuéà ce numéro. Leurs témoignages mettent en évidence la diversité des cas à traiter, mais aussila forte capacité d’adaptation des entreprises de notre pays et de leurs salariés. L’on voit ainsiune entreprise franc-comtoise de chaudronnerie se lancer dans la fabrication d’éoliennesrabattables, adaptées aux conditions climatiques des zones sujettes aux cyclones ; un sitepapetier normand envisager la production de biocarburants à partir des fibres cellulosiquesdu bois…Quels sont les principaux handicaps que doivent surmonter les entreprises de nos territoires? Le premier est certainement un déficit d’investissement qui perdure depuis de nombreusesannées, tant en ce qui concerne les équipements de production qu’en matière derecherche et de commercialisation. Pour y remédier, de multiples systèmes d’aidespubliques ont été mis en place, mais la complexité du dispositif laisse quelque peu perplexe…Un rôle important des Commissaires à la réindustrialisation semble être de faireR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 20101
AOÛT 2010 - 23,00 € ISSN 1148-7941R <strong>É</strong> A L I T <strong>É</strong> SINDUSTRIELLESUNE S<strong>É</strong>RIE DESANNALESDESMINESFOND<strong>É</strong>ES EN 1794Rédaction120, rue de Bercy - Télédoc 79775572 Paris Cedex 12Tél. : 01 53 18 52 68Fax : 01 53 18 52 72http://www.annales.orgPierre Couveinhes, rédacteur en chefGérard Comby, secrétaire général de la série« Réalités Industrielles »Martine Huet, assistante de la rédactionMarcel Charbonnier, lecteurComité de rédaction de la série« Réalités industrielles » :Michel Matheu, président,Pierre Amouyel,Grégoire Postel-Vinay,Claude Trink,Bruno SauvalleJean-Pierre DardayrolPierre CouveinhesMaquette conçue parTribord AmureIconographeChristine de ConinckFabrication :Marise Urbano - AGPA Editions4, rue Camélinat42000 Saint-<strong>É</strong>tienneTél. : 04 77 43 26 70Fax : 04 77 41 85 04e-mail : agpaedit@wanadoo.frAbonnements et ventesEditions ESKA12, rue du Quatre-Septembre75002 ParisTél. : 01 42 86 55 73Fax : 01 42 60 45 35Directeur de la publication :Serge KebabtchieffEditions ESKA SAau capital de 40 000 €Immatriculée au RC Paris325 600 751 000 26Un bulletin d’abonnement est encartédans ce numéro entre les pages 16 et 19.Vente au numéro par correspondanceet disponible dans les librairies suivantes :Presses Universitaires de France - PARIS ;Guillaume - ROUEN ; Petit - LIMOGES ;Marque-page - LE CREUSOT ;Privat, Rive-gauche - PERPIGNAN ;Transparence Ginestet - ALBI ;Forum - RENNES ;Mollat, Italique - BORDEAUX.PublicitéJ.-C. Michalondirecteur de la publicitéEspace Conseil et Communication2, rue Pierre de Ronsard78200 Mantes-la-JolieTél. : 01 30 33 93 57Fax : 01 30 33 93 58Table des annonceursAnnales des Mines : 2 e - 4 e de couverture et page 84CONEXPO-CON/AGG 2011 : 3 e de couvertureIllustration de couverture :Grues à louer, France.Photo © Richard Kalvar/MAGNUM PHOTOSS o m m a i r eCR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES1 <strong>É</strong>ditorialPierre Couveinhes5 IntroductionClaude Trink7 Les nouveaux outils de financement de l’industrie et leur mise en œuvre dansla Région Nord-Pas de CalaisFrançois Yoyotte14 Les Etats généraux de l’Industrie : un catalyseur pour la LorraineEric Pierrat19 Comment le département de l’Oise lutte contre la désindustrialisationClaude Trink29 Le FDR 35, fonds départemental de revitalisation de l’Ille-et-VilaineJacques Garau36 La restructuration industrielle dans la Vallée de l’ArveGérard Cascino43 La reconversion – réussie – d’une entreprise de Franche-Comté dans l’éolienGilles Cassotti49 Les possibilités de diversification : le cas d’un site papetier françaisPascal Clément, Jean-Jacques Bordes et Dominique Lachenal59 La recherche et l’enseignement supérieur, un enjeu de la bataille économiquedans les territoiresDaniel Fixari et Frédérique Pallez65 Les plateformes d’innovation : des facteurs de compétitivité des territoiresRomain Beaume et Vincent Susplugas70 Créer des emplois dans les territoires : quelques éléments de prospective desinvestissements industriels en FranceGilles Le Blanc
Hors dossier74 Les nanos : applications et enjeuxIlarion Pavel85 Résumés étrangersCe numéro est coordonné par Claude Trink
Introductionpar Claude TRINK*CR<strong>É</strong>ERDES EMPLOISDANS LESTERRITOIRESLors de son discours à Saint-Quentin (dans ledépartement de l’Aisne, en Picardie), le 24 mars2009, le Président Sarkozy a notamment déclaré :«Nous allons nommer des commissaires à la réindustrialisationdans chaque bassin d’emploi… Je veux descommissaires à la réindustrialisation qui auront lesmoyens de rassembler tous les moyens de l’Etat au servicede la réindustrialisation de vos bassins. »Ce discours a créé le concept de commissaire à la réindustrialisation,tout en mettant l’accent sur deuxpoints :• l’importance accordée au maintien et au développementd’activités industrielles en France ;• la nécessité d’une coordination, au niveau territorial,entre les multiples interventions des services de l’Etat.Le premier commissaire à la réindustrialisation a éténommé dès le 26 mars 2009, pour la région Picardie, etneuf autres commissaires ont été nommés, entre avril etjuin 2009, pour les régions suivantes :Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté,Lorraine, Midi-Pyrénées, Haute Normandie, Nord-Pasde Calais, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.Ces dix commissaires proviennent d’origines diverses :sous-préfets, ingénieurs (des corps des Mines ou desPonts, Eaux et Forêts), représentants de la Datar enrégion et un inspecteur du travail, tous ayant une expériencedu terrain. Tous ont eu à s’insérer dans le paysageadministratif régional et, nouveaux venus, ils ont étéplus ou moins bien accueillis par les Préfets.Cependant, tous ont témoigné la même ardeur à s’impliquerdans le développement économique de leur territoirerespectif en adaptant leur approche à son contextepolitique, économique et social, ainsi qu’aux jeux etaux enjeux de pouvoir auxquels ils se trouvent confrontés.Les regards croisés qui résultent des témoignages queprésentent ici sept de ces commissaires à la réindustrialisationdonnent des exemples concrets des différentesfacettes des actions menées en vue de favoriser la créationd’emplois industriels dans les territoires. A cespoints de vue de praticiens s’ajoutent les réflexions decinq spécialistes d’organismes centraux : trois professeursde Mines Paris Tech et deux hauts fonctionnairesde la Direction générale de la Compétitivité, del’Industrie et des Services (DGCIS) au ministère de l’industrie.Quatre approches différentes ont ainsi été développées :• l’organisation des relations entre tous les acteurs duterritoire et la mise en œuvre des procédures de financement,aussi bien au niveau d’une région (le Nord-Pasde-Calais,par François Yoyotte, la Lorraine, par EricPierrat) que d’un département (l’Oise, en Picardie, parmoi-même et l’Ille-et-Vilaine, en Bretagne, par JacquesGarau) ; il s’agit notamment de voir la manière dont setisse, à travers la gestion des financements tant traditionnelsque nouveaux (FNRT, FSI, FMEA, Médiationdu crédit, Médiation des relations clients-fournisseurs)ou dans la préparation des Etats généraux de l’Industrie,la trame du tissu économique local ;• les dispositifs destinés conjointement à soutenir lesfilières et à renforcer l’attractivité des territoires, avecl’exemple du décolletage dans la vallée de l’Arve (enSavoie, région Rhône-Alpes par Gérard Cascino ;• la reconversion d’activités d’une entreprise grâce à l’innovation,avec l’étude du cas d’une entreprise de lamécanique sur le marché de l’éolien (dans le départementdu Jura, en Franche-Comté, par Gilles Cassotti)et celle d’une papeterie (en Haute-Normandie, parPascal Clément) ;• les politiques nationales concernant, par exemple,le rôle joué par les universités et les organismes derecherche/formation dans le développement économiquelocal (étudiées par Frédérique Pallez et DanielFixari, de Mines ParisTech), les plateformes mutualiséesscientifiques et techniques (par Romain Beaumeet Vincent Suspluglas, de la DGCIS), la réflexionprospective concernant les investissements industrielsen France (par Gilles Le Blanc, de MinesParisTech).Présents sur le terrain, actifs au niveau local, plongésdans des actions concrètes et interlocuteurs de trèsnombreux intervenants (ministres, chefs d’entreprises,R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 5
INTRODUCTIONélus, fonctionnaires des services de l’Etat et des collectivités,représentants d’organismes économiques,financiers, consulaires ou scientifiques, de syndicatsprofessionnels ou de salariés, etc.), les commissaires àla réindustrialisation vivent la déclinaison dans les territoiresdes grands enjeux actuels (économiques, technologiqueset sociaux) et, plus largement, ceux del’évolution de la société dans son mode de création derichesses et d’emplois.déjà été le témoin, elle serait peut-être moins surprisepar les révolutions qui ne cessent et ne cesseront d’éclatersous ses yeux ; peut-être serait-elle aussi disposée àaccepter l’inévitable avec meilleure grâce et à renonceraux vains efforts qu’elle fait pour obliger un mondeentièrement nouveau à se plier aux règles et aux principesd’une civilisation dépassée. (1) »Aussi, sont-ils amenés à faire partager une réflexion duprésident de la première compagnie de chemin de fertranscontinentale américaine, Charles Francis AdamsJr, qui déclara, en 1868 :«Si la société actuelle se donnait, de temps en temps, lapeine de passer en revue les changements dont elle a* Ingénieur général des Mines, Conseil général de l’Industrie, del’Energie et des Technologies. Commissaire à la réindustrialisation de laPicardie.(1) Cité dans « Histoire des Américains » de Daniel Boorstin (ArmandColin).6R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Les nouveaux outilsde financementde l’industrie et leur miseen œuvre dans la RégionNord-Pas de CalaisDepuis l’automne 2008, la crise a amené l’Etat à forger de nouveauoutils d’intervention en faveur du tissu productif, en particulier endirection de l’industrie.Comment ces outils sont-ils mobilisés et appropriés au niveau régional?Après une présentation de la région Nord-Pas de Calais et de son systèmed’acteurs d’appui au développement économique, nous nous efforceronsd’appréhender la mise en œuvre pratique de ces nouveaux outils de financement.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar François YOYOTTE*UNE R<strong>É</strong>GION DE TRADITION INDUSTRIELLE QUISUBIT DE PLEIN FOUET LA CRISE, MAIS DONT LESACTEURS CROIENT EN L’AVENIR DE L’INDUSTRIERégion de tradition industrielle, le Nord-Pas de Calais avu son industrie profondément renouvelée dans lesannées 1970, avec la reconversion de son secteur minieret le développement industrialo-portuaire deDunkerque.En 2009, la région occupait le 4 e rang au niveau nationalen termes d’emploi industriel. La place des filièresde matériels de transport (automobile et ferroviaire) estessentielle, à côté des activités de quelques secteursmajeurs, comme la métallurgie, les produits minérauxet le textile.A la fin 2009, le Nord-Pas de Calais comptait4 022 000 habitants et disposait de quelque 966 000emplois privés marchands, ainsi répartis :• industrie : 226 000 emplois (dont 14 700 intérimaires),soit 23,4 % de l’emploi privé,• BTP : 95 000 emplois (dont 7 300 intérimaires),• tertiaire : 645 000 emplois (dont 11 500 intérimaires).Au cours de l’année 2009, 23 760 emplois ont été supprimés.Tous les secteurs d’activité ont été touchés, maisc’est l’industrie qui a payé une nouvelle fois le plus* Commissaire à la réindustrialisation.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 7
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESlourd tribut (industrie : - 4,9 %, soit près de 12 000emplois perdus ; BTP : - 2,8 % ; tertiaire : - 1,4 %)(voir la figure 1).Globalement, le Nord-Pas de Calais connaît un importantdéficit d’emplois, qui se manifeste par un tauxd’emploi très en-deçà du niveau national.Neuf zones d’emploi ont un taux de chômage supérieurà la moyenne régionale (12,6 %), elle-même sensiblementplus élevée que la moyenne de la France métropolitaine(9,1 %). Il s’agit :• du littoral : Calais, Boulogne, Dunkerque ;• de l’ancien bassin minier : Béthune, Lens, Douai etValenciennes (où l’industrie des matériels de transportautomobile et ferroviaire - est très présente) ;• de la partie méridionale du département du Nord :Cambrai et la vallée de la Sambre, autour de Maubeuge(voir la figure 2).Figure 1 : Pertes d’emplois salariés du secteurprivé dans la région Nord-Pas deCalais.Dans la région Nord-Pas de Calais, des acteurscroyant en l’avenir de l’industrieDe sa tradition industrielle, le Nord-Pas de Calais a héritéla volonté de maintenir des activités de productionprofondément renouvelées, s’appuyant sur des savoirfaire,et résolument orientées vers l’innovation (1), avecle soutien de ses sept pôles de compétitivité (2).(1) La stratégie régionale de l’innovation Nord-Pas de Calais a été approuvéeen décembre 2009 ; voir http://www.nordpasdecalais.fr/srde/telechargement/SRI/sri.pdf(43 pages).(2) Les 7 pôles de compétitivité sont : le Pôle I-Trans (matériels de transport),le Pôle Nutrition-Santé-Longévité, le PICOM (Pôle Industries duCOMmerce), le Pôle UP-TEX (nouveaux matériaux textiles), le PôleMAUD (Matériaux à Usage Domestique), le Pôle Aquimer (valorisationdes produits de la mer) et, enfin, depuis mai 2010, le Pôle TEAM(Technologies de l’Environnement Appliquées aux Matériaux).Figure 2 : Taux de chômagelocalisés par zone d’emploi.8R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
A l’occasion des Etats généraux de l’industrie (EGI), lerapport publié de la DIRECCTE intitulé « Les enjeuxde l’industrie Nord-Pas de Calais » (3) a servi de diagnosticaux ateliers régionaux qui se sont réunis endécembre 2009 et en janvier 2010.Ces ateliers régionaux des EGI ont formulé de nombreusespropositions qui alimenteront au cours des prochainsmois les réponses régionales aux appels à projetsdu programme des investissements d’avenir (4). Cespropositions contribueront, par ailleurs, à développerles politiques d’animation régionale des filières, à l’instarde celles déjà mises en œuvre dans l’automobile,avec l’Association Régionale de l’Industrie Automobile(Aria).Parmi les acteurs publics, il faut souligner le rôle del’Etat et de ses établissements financiers, mais aussicelui de la région Nord-Pas de Calais et de son réseaude correspondants :• L’Etat, représenté par le Préfet de région et son brasdroit le Secrétaire général aux affaires régionales, veilleà la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationaleset de celles de la Commission européenne dans ledomaine économique régional. Il dispose, depuis juin2009, d’un commissaire à la réindustrialisation, chargéde faciliter et de coordonner la mise en œuvre des politiquesde l’Etat en matière d’anticipation des difficultés,d’accompagnement des entreprises et de revitalisationéconomique, en lien étroit avec les directions des ministères(DATAR, DGCIS, DGEFP, …) et au contact desterritoires ;• Par leurs multiples contacts avec les entreprises, lesservices de l’Etat (DIRECCTE, Pôle Emploi, DRFiP)jouent un rôle essentiel sur le plan de la connaissancedes besoins en matière de développement technologiqueet industriel et de difficultés financières, ainsi quede contrôle des relations du travail, de formation et derecrutement ;• Dans le domaine financier, le réseau Banque deFrance a développé son rôle dans la médiation du créditdepuis l’automne 2008, à l’instar des directionsrégionales de la Caisse des Dépôts et d’Oséo, qui ontmis en place en 2009 un guichet PME-PMI pourl’orientation (et le suivi) des entreprises vers les outils definancement les plus appropriés, en liaison avec lesacteurs locaux du développement économique ;• Le Conseil régional est consacré dans son rôle de chefde file des aides des collectivités territoriales (5) depuisl’adoption, en 2005, d’un schéma régional de développementéconomique et sa prise de responsabilité dansla mise en œuvre du volet économique du contrat deprojet et du programme opérationnel du FEDER, avecl’appui de son bras armé financier, FINORPA (égalementun des opérateurs, parmi d’autres, des conventionsde revitalisation) ;• Les agences de développement : au niveau régional,Nord-France Experts (NFX), correspondant régionalde l’AFII (6) et, au niveau des grandes zones d’emploi,le réseau des agences de développement locales(Dunkerque Promotion, Calais Développement, Saint-Omer Développement, Cambrésis développement,APIM pour la promotion de l’agglomération lilloise).De longue date, ces acteurs savent travailler ensemble ;leur mobilisation exceptionnelle, depuis l’automne2008, a encore renforcé cette collaboration.DES OUTILS NOUVEAUX À COMBINER AVEC LESOUTILS EXISTANTS, NATIONAUX ET R<strong>É</strong>GIONAUXUn renouvellement des outils nationaux d’appui auxentreprisesLa crise a amené l’Etat à mettre en place un dispositifrenforcé en direction des entreprises, dans le cadre duplan de relance de l’automne 2008. Ce plan s’estnotamment traduit par un renforcement de la mobilisationdes réseaux de la Caisse des Dépôts et d’Oséo etpar un élargissement de la panoplie des interventionspubliques, avec de nouveaux régimes d’aides aux PME,en vigueur jusqu’à la fin 2010 (7). Récemment, ces dispositifsont été encore renforcés à la suite des Etatsgénéraux de l’Industrie (aides à la réindustrialisation,prêts « verts » bonifiés).Ces dispositifs complètent (ou perfectionnent) lesoutils antérieurs, qui continuent à jouer un rôle important.Ils constituent une large panoplie, dont ilconvient de mobiliser les aides à bon escient et ensynergie.Une partie de ces dispositifs est uniforme sur l’ensembledu territoire métropolitain, tandis que l’autreest modulée de façon à opérer une discrimination positiveen faveur de territoires plus fragiles : c’est l’objet durégime des aides à finalité régionale (AFR) 2007-2013,dont le zonage couvre au niveau national une populationde 9,33 millions d’habitants. Le Nord-Pas deCalais, avec un territoire éligible peuplé de 1,25 milliond’habitants, est, de loin, la principale région à bénéficierde ce zonage.C’est dans ce cadre qu’est mise en œuvre la primed’aménagement du territoire (PAT), qui permet de(3) « Les enjeux de l’industrie de la région Nord-Pas de Calais », 640pages, décembre 2009, publication DREAL (service développementindustriel et technologique) et DRTEFP, direction intégrée depuis janvier2010 au sein de la DIRECCTE.http://www.Nord-Pas de Calais.drire.gouv.fr/(4) Programme des investissements d’avenir, dont le dispositif est inspirédes conclusions du rapport « Investir pour l’avenir » d’Alain Juppé etMichel Rocard.(5) Les intercommunalités restent compétentes pour allouer aux entreprisesdes aides à l’immobilier d’entreprise.(6) L’Agence Française des Investissements Internationaux, créée en 2001,a pour mission la promotion, la prospection et l’accueil des investissementsinternationaux en France.(7) Aides compatibles d’un montant limité (ACML), Aides temporairessous forme de garantie, Aides temporaires en capital-investissement…FRANÇOIS YOYOTTER<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 9
QUELQUES EXEMPLES CONCRETSDans cette dernière partie, nous présenterons quelquesexemples de mobilisation des outils financiers dans larégion Nord-Pas de Calais, depuis mai 2009 (il s’agiradu FSI, du FMEA, de la combinaison des aides à l’investissementet, enfin, du FNRT).Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) est une sociétéanonyme constituée entre la CDC (51 %) et l’Etat(49 %), qui a pour vocation d’intervenir en capital,sous la forme d’investissements minoritaires en fondspropres (principalement) ou en quasi-fonds propres,pour une durée limitée (de l’ordre de 5 à 7ans), endirection de différents types d’entreprises :• des PME dotées d’un projet de croissance,• des entreprises de taille intermédiaire (ETI) disposantd’un potentiel de création de valeur ou présentes surdes secteurs en phase de mutation,• enfin, de grandes entreprises et des ETI jouant unrôle important dans leur secteur, dont la stabilisationdu capital permettrait de mieux réaliser un projet créateurde valeur.C’est ainsi que le FSI a investi (en juillet 2009) 2 millionsd’euros au capital de Meccano, célèbre PME dujouet sise à Calais, comptant 85 salariés et réalisant unchiffre d’affaires de 45 millions d’euros.Outre ses investissements directs, le FSI a développéune famille de fonds spécialisés, cofinancés avecd’autres acteurs économiques.Parmi eux, le Fonds de Modernisation desEquipementiers Automobiles (FMEA), géré par CDCEntreprises et doté de 600 millions d’euros, cofinancéspar Renault et PSA, investit dans des équipementiersde rang 1 ou plus, en ciblant des équipementiersrépondant aux critères ci-après :• il doit s’agir d’équipementiers « stratégiques » pourleurs clients (innovation, développements de véhiculeset d’organes, internationalisation),• qui soient capables de consolider les filières en réduisantles surcapacités structurelles, grâce notamment àleurs capacités de R&D dans le domaine automobile,• et qui soient en croissance, et donc qui aient besoinde fonds propres pour financer l’innovation et le développement.En juillet 2009, le FMEA a notamment investi, dans cecadre, 25 millions d’euros dans FSD-SNOP à l’occasionde sa reprise de plusieurs établissements de WagonAutomotive, une entreprise dont le site de Douai étaitmenacé ; cette intervention a permis de maintenir lesemplois de plus de 400 salariés (sur 466) et de lancerun programme de modernisation de l’usine comportantnotamment l’installation de nouvelles pressesd’emboutissage.En mars 2010, le FMEA annonçait « un co-investissementd’un montant de 17 millions d’euros dans la filialefrançaise de l’équipementier Agrati Spa, acteurmajeur de la fixation automobile en Europe, dans lecadre du rachat et de l’intégration de cinq des sept sitesde la société Acument France ». Agrati Spa, qui réalisaitdéjà un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros avantcette opération, sera l’actionnaire majoritaire, avec unapport de 18 millions d’euros et l’ambition d’un chiffred’affaires global de près de 300 millions d’euros àterme.Cette annonce était l’aboutissement d’un travail engagédès l’été 2009 avec les acteurs publics nationaux etrégionaux du Nord-Pas de Calais pour mener à sonterme ce projet de reprise des établissementsd’Acument France, à Fourmies et à Vieux-Condé,accompagné d’un véritable volet de modernisationindustrielle comportant de lourds investissements permettantd’améliorer la compétitivité de ces sites spécialisésdans la fabrication de vis, goujons, boulons etautres fixations de sécurité pour l’automobile.Dans le cadre de ce projet, Agrati Spa a l’ambition dedevenir un fournisseur important de PSA, avec lequelelle a conclu des accords commerciaux s’inscrivant dansla durée.Un programme d’investissement de 34 millions d’euros(M€) (dont 32 M€ dans le département du Nord)est engagé sur une période de trois ans : il permettra laréalisation d’un hub logistique à Vieux-Condé (près deValenciennes) et la modernisation des bâtiments, ainsique des équipements de production. L’objectif estd’améliorer la compétitivité du site, ce qui permettra lemaintien de 600 des 800 emplois d’Acument.L’action des partenaires publics se traduit par la mobilisationde l’ensemble des outils financiers, dans la limitedu plafond de 15 % du régime des aides à finalitérégionale (prime d’aménagement du territoire, prêtFNRT, Fonds spécial d’implantation Nord-Pas deCalais et aides de la communauté d’agglomération deValenciennes Métropole) ; il s’y ajoute l’intervention deBatixia, filiale régionale de la Caisse des Dépôts, pourla réalisation du hub logistique.Autre exemple, toujours dans l’industrie automobile :la mobilisation des aides à finalité régionale (PAT Etatet Fonds spécial d’implantation) autour des lourdsinvestissements de la Française de Mécanique, filiale, àparité, de Renault et de PSA à Douvrin (Pas-de-Calais)pour le déploiement de la construction d’un nouveaumoteur. A la suite de la réactivité du directeur généralde l’entreprise, l’Etat et le Conseil régional ont pu organisertrès rapidement le soutien à ce projet. PSA a puainsi annoncer en avril 2010 sa décision de confier à laFrançaise de Mécanique la production (à partir de2012) d’une série de 320 000 exemplaires de la versionturbo du nouveau moteur 3 cylindres de 1,2 litre. Ceprojet fera appel au laboratoire d’essais turbo duCRITT M2A, situé à proximité du site de la Françaisede Mécanique à Douvrin.Dans ces deux exemples, la combinaison des outilsfinanciers des acteurs publics est primordiale et laprime d’aménagement du territoire est déterminante,car elle marque l’engagement de l’Etat au côté de l’investisseur,auquel est par ailleurs apporté un appui entermes de recrutement et de formation.FRANÇOIS YOYOTTER<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 11
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES© Tom/ANDIA.fr«Autre exemple, toujours dans l’industrie automobile : la mobilisation des aides à finalité régionale autour des lourds investissementsde la Française de Mécanique à Douvrin, pour le déploiement de la construction d’un nouveau moteur ». Chaînede fabrication de moteurs à l’usine de la Française de Mécanique à Douvrin (Pas de Calais), filiale à parité de Renault et PSA.Le Fonds national de revitalisation des territoires (FNRT)est un outil récent, mis en œuvre dans le Nord-Pas deCalais sur quatre territoires déclarés éligibles au niveaunational en septembre 2009 :• Béthune-Bruay ;• Valenciennois-Douaisis (incluant une partie de l’arrondissementde Lens) ;• Cambrésis-Sambre-Avesnois ;• Calaisis.Un comité régional, présidé par délégation du Préfet derégion par le commissaire à la réindustrialisation, associela Direction régionale de la Caisse des Dépôts (quiassure le secrétariat), le Directeur régional d’Oséo,l’Etat (préfectures et DIRECCTE) (11) et le Conseilrégional.Les dossiers sont présentés par le sous-préfet concerné,pilote du groupe territorial (DIRECCTE, CCI), quifait établir par le réseau des développeurs locaux lesdocuments de présentation des projets. Le comité veilleà l’intérêt économique du projet pour le territoireconcerné et s’assure des conditions d’éligibilité, notammentdu fait qu’il remplit bien les conditions spécifiquesdu produit : l’entreprise impétrante doit être unePME cotée de 4 à 6 par la Banque de France, l’effetlevier du prêt sans garantie devant lui permettre debénéficier de prêts bancaires d’un montant en généralde deux fois supérieurs. L’assistance technique à la miseau point du projet (études, conseil,…) est, par ailleurs,subventionnable par l’Etat (en général, à hauteur de50 %).Après l’avis du comité régional, Oséo assure l’instructionfinancière du prêt sans garantie dont le montant vade 0,1 à 1 M€ par établissement de l’entreprise, soitpour un investissement, soit pour satisfaire à un besoinen fonds de roulement.Avec un recul de huit mois de fonctionnement, l’onpeut dire que, dans la région Nord-Pas de Calais, fortementtouchée par les mutations économiques, le systèmede prêts du FNRT, garanti par l’Etat et la Caisse desDépôts, correspond à un besoin pour les entreprisesfragiles implantées sur des territoires en cours de revitalisation.Sur les 29 dossiers ayant reçu l’avis favorabledu comité régional, tous relèvent du secteur industriel(PMI et TPE), à l’exception d’un seul projet situé enzone urbaine sensible. La dotation régionale de 11 M€sera rapidement utilisée puisque près de 7 M€ dedemandes de prêts ont déjà obtenu l’avis favorable ducomité régional.(11) La DIRECCTE est représentée par ses services en charge des mutationséconomiques (ex-DRTEFP) et du développement industriel et technologique(ex-DRIRE).12R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Région de tradition industrielle, le Nord-Pas deCalais entend conserver une industrie forte et ilmise fortement sur l’innovation et l’organisation deses principales filières pour faire face aux mutationséconomiques. La volonté des industriels et des organisationssyndicales s’est largement exprimée lorsdes ateliers régionaux des Etats Généraux del’Industrie organisés à Lille, durant l’hiver 2009-2010.La mobilisation conjointe des acteurs du soutien audéveloppement économique, l’appropriation rapide desnouveaux outils financiers et leur combinaison avec lesoutils déjà existants illustrent la réalité de l’appui réactifdes acteurs publics aux entreprises industrielles.FRANÇOIS YOYOTTER<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 13
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESLes <strong>É</strong>tats généraux del’Industrie : un catalyseurpour la LorraineDans la région Lorraine, la tenue des Etats généraux de l’Industrie aété accueillie de manière particulièrement favorable.par Eric PIERRAT*La tenue d’Etats généraux de l’Industrie (EGI) enFrance répond à la volonté du Président de laRépublique de ne pas laisser l’économie française(en particulier son industrie) poursuivre l’évolutionqu’elle connaît depuis environ vingt ans.Il s’agit par conséquent de marquer une rupture, afinque l’hémorragie des emplois industriels cesse, que laFrance regagne des parts de marché à l’export et quel’économie française produise plus de valeur ajoutée.Une des idées qui ont présidé à la décision de convoquerces Etats généraux était aussi de réunir la totalitédes acteurs de l’économie française afin de les amener àréfléchir ensemble aux problèmes rencontrés et auxsolutions qui pouvaient y être apportées, dans uncontexte qui n’est plus seulement national, mais auminimum européen et, de fait, mondial.Cette initiative a été très favorablement accueillie enLorraine, une région particulièrement représentativedes évolutions industrielles françaises, très ouverte surl’extérieur grâce à ses trois frontières (avec la Belgique,le Luxembourg et l’Allemagne) et, par là même, soucieusede s’insérer dans un contexte qui ne sauraitdemeurer « franco-français ».Mais, si cette initiative a été bien accueillie en Lorraine,c’est aussi parce que les acteurs lorrains, qui réfléchissentdepuis des années à ces thématiques, ont unebonne expérience des mutations industrielles. Depuisquarante ans, en effet, la réalité lorraine n’est faite quede mutations et de restructurations qu’il faut anticiper,gérer, et… digérer. Ajoutons à cela que, dès 2007, lesacteurs lorrains ont choisi d’œuvrer ensemble dans ledomaine des mutations économiques afin de mieuxarmer leur région pour l’avenir. A leurs yeux, cette initiativenationale était donc la bienvenue.LE TRAVAIL EFFECTU<strong>É</strong> EN LORRAINE DEPUIS 2007A PR<strong>É</strong>PAR<strong>É</strong> LA R<strong>É</strong>GION AUX ETATS G<strong>É</strong>N<strong>É</strong>RAUX DEL’INDUSTRIEEn novembre 2007, l’Etat et la région Lorraine cosignaientla Convention de Développement socio-économiquede la Lorraine par l’Anticipation des mutationsindustrielles, qui a la même durée de validité que leContrat de Projets Etat-Région, à savoir six ans (2007 à2013).Plusieurs mesures sont préconisées par cette convention.Tout d’abord, il s’agit de développer un travail deveille et d’anticipation des mutations économiques(notamment par le suivi des filières et des grandes entreprises,ainsi que par l’exploitation des résultats desréunions du Comité Départemental d’Examen des problèmesde Financement des entreprises, le Codefi).Du côté de l’emploi, il y a un engagement à mettre enœuvre tant la Gestion Prévisionnelle des Emplois etCompétences (GPEC) que les Engagements deDéveloppement de l’Emploi et des Compétences(Edec).En matière de réindustrialisation, l’engagement a étépris de mutualiser les conventions de revitalisation etd’y inclure davantage d’actions structurantes (parexemple, au profit de pôles de compétitivité).Des engagements financiers ont été pris entre l’Etat etle Conseil régional, cependant que tous les acteurssocio-économiques de la région Lorraine (parlementaires,Conseils généraux, chambres consulaires, représentantspatronaux et syndicaux, associations…) étaient* Commissaire à la réindustrialisation de la Lorraine.14R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
associés à l’instance dirigeante, l’Observatoire Régionaldes Mutations Economiques (Orme), qui décline lesgrandes orientations des décisions à prendre dans lecadre de la convention.Plusieurs projets ont pu être financés dans le cadre decette convention (tels que la création d’une pépinièred’entreprises ou la requalification d’un pôle industriel)et plusieurs projets d’Edec ont été menés à bien. Grâceà ce travail initié dès 2008, la Lorraine a pu mettre enavant son engagement et, en 2009, avec l’aide duContrôle Général Economique et Financier duMinistère de l’Economie et des Finances, elle a pu organiserà l’échelle de son territoire un séminaire consacréaux mutations économiques.Ce séminaire a été programmé sur sept journées,réparties tout au long de l’année 2009 et sur une partiede l’année 2010 : à deux journées inaugurales, àNancy (en juin 2009), ont succédé une journée (enjuillet) à Epinal, une journée (en septembre) à Bar-le-Duc et deux journées (en novembre) à Metz. Enfin,une journée conclusive a été organisée (en avril 2010)à Metz.Ces ateliers régionaux décentralisés dans les départementslorrains ont été largement ouverts à l’ensembledes personnes intéressées par le champ des mutationséconomiques : chefs d’entreprises, salariés, associatifs,institutionnels… ; chacun a pu s’exprimer et réagir auxinterventions des divers participants à ces journées.Les deux journées d’ouverture, à Nancy, ont permis deposer les termes du débat, de procéder à un bref rappelhistorique des mutations qu’a connues la Lorraine, deregarder la situation de ses voisins (Belgique,Luxembourg), de faire un focus sur l’innovation etd’étudier dans quelle mesure la région pourra passeraux productions de demain (comme, par exemple,celles de la chimie « verte »).A Epinal, la réflexion s’est concentrée sur l’analyse desdispositifs de revitalisation et de reclassement (Ateliersde Transition Professionnelle chez Kléber-Michelin,Contrat de Transition Professionnelle dans le bassinindustriel de Saint-Dié, Convention de ReclassementPersonnalisée…).A Bar-le-Duc, un point a été fait sur les initiatives innovantesen matière de GPEC récemment menées enLorraine.Enfin, à Metz, le dispositif sarrois d’anticipation desmutations économiques a été présenté, ainsi qu’un dispositifanglais, celui des learning reps (ce sont des représentantssyndicaux chargés d’identifier, au sein desentreprises, les besoins des salariés en compétences debase). De plus, les acteurs lorrains ont pu, lors de cesdeux journées messines, participer à quatreateliers autour des thèmes suivants : « Comment assurerle développement de l’économie de la connaissanceen Lorraine ? » ; « Quel avenir pour l’industrie, dans larégion ? » ; « Le développement de la Lorraine au seinde la grande région SarreLorLux » et, enfin,«Gouvernance et mise en réseau de l’anticipation desmutations économiques ».L’ensemble de ces travaux a été synthétisé lors de la dernièrejournée conclusive de ce séminaire, le 28 avril2010.LES ETATS G<strong>É</strong>N<strong>É</strong>RAUX DE L’INDUSTRIE VIENNENTPRENDRE APPUI SUR UNE DYNAMIQUE D<strong>É</strong>JÀENCLENCH<strong>É</strong>EEntre-temps (dès novembre 2009), les acteurs lorrainsont été invités à réfléchir à un ensemble de thèmes listésdans le cadre de la préparation des Etats généraux del’Industrie.A la demande du ministre de l’Industrie, les régionsfrançaises devaient, en effet, faire porter leur réflexionsur cinq thématiques transversales (Compétitivité etcroissance verte, Emploi et formation, Innovation etentreprenariat, Politiques de filières et accès au financement)et elles devaient choisir deux thématiques parmicinq thématiques sectorielles (Biens intermédiaires,Biens de consommation, Industries des transports,Santé, Technologie de l’information et de la communication).En Lorraine, tous ces secteurs ont été retenus. Eneffet, ils sont tous représentés dans la région et ilétait très important de donner à tous les industrielsla possibilité de s’exprimer, sans exclusive d’aucunesorte.C’est ainsi que la Lorraine a organisé ses travaux desEGI autour de dix groupes de travail. Le Commissaireà la réindustrialisation a animé certains d’entre eux, lesservices de l’Etat (Direccte, DRRT…) et les différentesChambres de Commerce et d’Industrie de Lorraineayant animé les autres.Après une première phase de diagnostic, les travaux desEGI en région Lorraine ont abouti à l’élaboration desoixante-cinq propositions, qui ont été transmises àParis à la fin du mois de janvier de cette année (2010)et présentées à l’ensemble des partenaires, à Metz, le 5février.Ce travail mené à son terme a donc fait suite à celui quiavait été effectué dans le cadre du Séminaire sur lesmutations économiques, qu’il a enrichi. Les deuxdémarches ayant été en partie concomitantes, il a étéconsidéré qu’il pouvait être intéressant de les rapprocher,car elles avaient de nombreux thèmes en commun.C’est ainsi qu’un groupe de travail s’est réuni plusieursfois, en janvier, février, mars et avril 2010 afinde dégager les points communs qui pouvaient êtreretirés de ces deux réflexions. Il a également utilisé,dans son analyse, des travaux menés en parallèle,comme l’élaboration de la Stratégie Régionaled’Innovation (SRI) et une enquête de l’AssociationRégionale de l’Amélioration des Conditions deTravail (Aract) menée par sa Direction en Lorraine,sur les attentes des acteurs lorrains vis-à-vis desmutations économiques.ERIC PIERRATR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 15
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES© Fred Marvaux/REA«A la demande du ministre de l’Industrie, les régions françaises devaient faire porter leur réflexion sur cinq thématiques transversales(Compétitivité et croissance verte, Emploi et formation, Innovation et entreprenariat, Politiques de filières et accèsau financement) et elles devaient choisir deux thématiques parmi cinq thématiques sectorielles (Biens intermédiaires, Biensde consommation, Industries des transports, Santé, Technologie de l’information et de la communication) ». ChristianEstrosi, ministre de l’Industrie, lors d’un déplacement en Moselle, le 7 juin 2010.DES SUITES CONCRÈTES AUX EGI APRÈSLE 4 MARS 2010Après le 4 mars 2010, date de la présentation des résultatsdes Etats généraux de l’Industrie par le Président dela République lors d’une allocution prononcée àMarignane, le groupe de travail lorrain s’est fortementinspiré des décisions prises dans ce cadre, et notammentde certaines des mesures annoncées par lePrésident.C’est ainsi que le 28 avril, date du séminaire régionalsur les mutations économiques, les résultats de ces travauxont été présentés à l’ensemble des acteurs lorrainsconcernés par la thématique de la réindustrialisation(services de l’Etat, Région, CESR, départements, organisationspatronales et syndicales, entreprises, associations…).Il a alors été proposé que la réflexion entamée dès leprintemps 2009 se poursuive sur des thématiques identifiéescomme prioritaires par le groupe de travail, nonpas que les autres thématiques potentielles eussentmanqué d’intérêt, mais il convenait, pour commencer,de se focaliser sur les thématiques prioritaires. Celles-cisont au nombre de trois :• 1) améliorer la lisibilité des dispositifs d’aides etl’orientation vers elles des PME de la Région ;• 2) identifier les filières stratégiques de la Lorraineet mettre en place des comités stratégiques associés,conformément aux préconisations de la 11 e mesure;• 3) enfin, développer la gestion prévisionnelle desemplois et des compétences (GPEC) au niveau des bassinsindustriels de la Lorraine.Le groupe de travail, qui a été à cette occasion rebaptiséComité de Liaison d’Anticipation des Mutations(CLAM), réunit des représentants de l’Etat, de laRégion, du CESR, des syndicats et du patronat ; il aréparti son activité entre trois sous-groupes, chacund’entre eux se consacrant à l’un des trois thèmes quenous avons énumérés.Ces trois sous-groupes se sont réunis dès le mois de juinafin de proposer au CLAM une stratégie d’implantationet de développement spécifique à chacune des troisthématiques.Cette stratégie sera présentée à l’ObservatoireRégional des Mutations Economiques (Orme) à l’automneprochain.Comme on le voit : en Lorraine, les Etats généraux del’Industrie ont renforcé la mobilisation d’énergies et decompétences qui étaient déjà sensibilisées.16R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Publié parANNALESDESMINESFondées en 1794Fondées en 1794, les Annales des Mines comptentparmi les plus anciennes publications économiques.Consacrées hier à l’industrie lourde,elles s’intéressent aujourd’hui à l’ensemble de l’activitéindustrielle en France et dans le monde, sousses aspects économiques, scientifiques, techniqueset socio-culturels.Des articles rédigés par les meilleurs spécialistesfrançais et étrangers, d’une lecture aisée,nourris d’expériences concrètes : les numéros desAnnales des Mines sont des documents qui fontréférence en matière d’industrie.Les Annales des Mines éditent trois séries complémentaires:Réalités Industrielles,Gérer & Comprendre,Responsabilité & Environnement.ABONNEZ-VOUSAUXANNALES DES MINESR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLESetG<strong>É</strong>RER & COMPRENDREetRESPONSABILIT<strong>É</strong>& ENVIRONNEMENTR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLESQuatre fois par an, cette série des Annales desMines fait le point sur un sujet technique, unsecteur économique ou un problème d’actualité.Chaque numéro, en une vingtaine d’articles, proposeune sélection d’informations concrètes, desanalyses approfondies, des connaissances à jourpour mieux apprécier les réalités du monde industriel.G<strong>É</strong>RER & COMPRENDREQuatre fois par an, cette série des Annales desMines pose un regard lucide, parfois critique,sur la gestion « au concret » des entreprises et desaffaires publiques. Gérer & Comprendre va au-delàdes idées reçues et présente au lecteur, non pas desrecettes, mais des faits, des expériences et des idéespour comprendre et mieux gérer.RESPONSABILIT<strong>É</strong> & ENVIRONNEMENTQuatre fois par an, cette série des Annales desMines propose de contribuer aux débats surles choix techniques qui engagent nos sociétés enmatière d’environnement et de risques industriels.Son ambition : ouvrir ses colonnes à toutes les opinionsqui s’inscrivent dans une démarche deconfrontation rigoureuse des idées. Son public :industries, associations, universitaires ou élus, ettous ceux qui s’intéressent aux grands enjeux denotre société.DEMANDE DESP<strong>É</strong>CIMEN
BULLETIN D’ABONNEMENTA retourner accompagné de votre règlementaux Editions ESKA12, rue du Quatre-Septembre - 75002 ParisTél. : 01 42 86 55 73 - Fax : 01 42 60 45 35Je m’abonne pour 2010 aux Annales des Mines :Réalités Industrielles + Responsabilité & Environnement8 numéros France Etrangerau tarif de :Particuliers ❑ 158 € ❑ 190 €Institutions ❑ 198 € ❑ 257 €Réalités Industrielles + Gérer & Comprendre+ Responsabilité & Environnement12 numéros France Etrangerau tarif de :Particuliers ❑ 202 € ❑ 255 €Institutions ❑ 299 € ❑ 357 €Nom ......................................................................................Fonction .................................................................................Organisme ..............................................................................Adresse .................................................................................................................................................................................Je joins :Réalités Industrielles4 numéros France Etrangerau tarif de :Particuliers ❑ 83 € ❑ 101 €Institutions ❑ 108 € ❑ 130 €Réalités Industrielles + Gérer & Comprendre8 numéros France Etrangerau tarif de :Particuliers ❑ 158 € ❑ 190 €Institutions ❑ 198 € ❑ 257 €❑ un chèque bancaire à l’ordre des Editions ESKA❑ un virement postal aux Editions ESKA,CCP PARIS 1667-494-Z❑ je souhaite recevoir une factureDEMANDE DE SP<strong>É</strong>CIMENA retourner à la rédaction des Annales des Mines120, rue de Bercy - Télédoc 797 - 75572 Paris Cedex 12Tél. : 01 53 18 52 68 - Fax : 01 53 18 52 72Je désire recevoir, dans la limite des stocksdisponibles, un numéro spécimen :❑ de la série Réalités Industrielles❑ de la série Gérer & Comprendre❑ de la série Responsabilité & EnvironnementPublié parANNALESDESMINESFondées en 1794Fondées en 1794, les Annales des Mines comptentparmi les plus anciennes publications économiques.Consacrées hier à l’industrie lourde,elles s’intéressent aujourd’hui à l’ensemble de l’activitéindustrielle en France et dans le monde, sousses aspects économiques, scientifiques, techniqueset socio-culturels.Des articles rédigés par les meilleurs spécialistesfrançais et étrangers, d’une lecture aisée,nourris d’expériences concrètes : les numéros desAnnales des Mines sont des documents qui fontréférence en matière d’industrie.Les Annales des Mines éditent trois séries complémentaires:Réalités Industrielles,Gérer & Comprendre,Responsabilité & Environnement.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLESQuatre fois par an, cette série des Annales desMines fait le point sur un sujet technique, unsecteur économique ou un problème d’actualité.Chaque numéro, en une vingtaine d’articles, proposeune sélection d’informations concrètes, desanalyses approfondies, des connaissances à jourpour mieux apprécier les réalités du monde industriel.G<strong>É</strong>RER & COMPRENDREQuatre fois par an, cette série des Annales desMines pose un regard lucide, parfois critique,sur la gestion « au concret » des entreprises et desaffaires publiques. Gérer & Comprendre va au-delàdes idées reçues et présente au lecteur, non pas desrecettes, mais des faits, des expériences et des idéespour comprendre et mieux gérer.RESPONSABILIT<strong>É</strong> & ENVIRONNEMENTQuatre fois par an, cette série des Annales desMines propose de contribuer aux débats surles choix techniques qui engagent nos sociétés enmatière d’environnement et de risques industriels.Son ambition : ouvrir ses colonnes à toutes les opinionsqui s’inscrivent dans une démarche deconfrontation rigoureuse des idées. Son public :industries, associations, universitaires ou élus, ettous ceux qui s’intéressent aux grands enjeux denotre société.Nom .............................................................................Fonction .......................................................................Organisme.....................................................................Adresse ...............................................................................................................................................................
Comment le départementde l’Oise lutte contrela désindustrialisationLe département de l’Oise a été très durement affecté par des fermeturesd’entreprises industrielles. Comment l’Oise lutte-t-elle contrecette désindustrialisation ? Qui sont les acteurs du développementéconomique local ? Quels sont les outils mis en œuvre ? Quel a étél’apport du Commissaire à l’industrialisation ? Telles sont les questionsauxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar Claude TRINK*L ’Oise est, avec la Somme et l’Aisne, un des troisdépartements constituant la région Picardie (1,9million d’habitants, dont 766 000 pour le départementde l’Oise). A lui seul, il représente la moitié dela valeur ajoutée industrielle de la Picardie et le poids del’emploi industriel y est supérieur à la moyenne nationale(29 % de l’emploi salarié privé en 2007, contremoins de 20% en France).En 2009, l’Oise a connu une très rapide hausse du tauxde chômage : de 7 % au 4 e trimestre 2007, ce taux estpassé à 7,5 % au 4 e trimestre 2008. L’évolution a étéensuite la suivante :8,5 % au 1 er trimestre 2009 ;9,3 % au 2 e trimestre ;9,4 % au 3 e trimestre.9,7 % au 4 e trimestre (11,4 % pour la Picardie ; 9,6 %pour la France).Entre le 4 e trimestre 2008 et le 4 e trimestre 2009, l’Oisea perdu 7 700 emplois dans le secteur marchand, essentiellementdans l’industrie et l’intérim, soit près de4,3 % des salariés du secteur.Le long de la vallée de l’Oise, la crise a détruit desemplois notamment dans les grands établissements,événements qui ont ponctué l’actualité régionale etnationale depuis 2008. La filière automobile est le premiersecteur touché : pneumatiques avec Continental(Clairoix), équipements intérieurs avec Faurecia(Méru), Rieter (trois sites dans l’Oise) ou Sodimatex(Crépy-en-Valois), équipements mécaniques avecRobert Bosch (Beauvais), ZF Sachs (au Mouy), … Lesautres secteurs industriels ne sont pas épargnés, commepar exemple, le matériel agricole avec Agco-Gima(Beauvais) ou la métallurgie avec Metalform(Novillers).Deux points faibles caractérisent l’Oise : un problèmerécurrent de niveau de qualifications et le fait que denombreuses entreprises soient des filiales de grandsgroupes (Saint-Gobain, Total, Valeo, Danone, LVMH),souvent étrangers (Continental, Unilever, Air Liquide,Johnson and Johnson, Nestlé, AGCO, Goss, Rieter,Atlas Copco), et dont les centres de décision sont situésà l’extérieur du département. Comme un grandnombre d’établissements relèvent du secteur de l’équipementautomobile, la crise qui s’est abattue en 2008 et2009 a conduit à la fermeture de nombreuses usines,dans certains cas pour permettre d’accroître la charged’usines des mêmes groupes, tant en France qu’àl’étranger.Dans quelques cas, ces fermetures ont été précédées pardes faits de violence destinées à mobiliser l’attentionnationale : cas de la destruction du poste de sécurité del’usine Continental qui s’est traduit par l’arrêt définitif deson activité ; saccage de la sous-préfecture de Compiègnepar des salariés de Continental ; menaces de faire sauterdes bonbonnes de gaz exercées par des salariés de l’usine* Ingénieur général des Mines, Commissaire à la réindustrialisation de laPicardie.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 19
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESSodimatex (groupe Trèves) à Crépy-en-Valois. En outre,la négociation de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)se fait de plus en plus dans le cadre de recours aux tribunaux,suscitant un phénomène de judiciarisation qui segénéralise sous la pression d’avocats spécialisés.C’est dans ce contexte que j’ai été nommé Commissaireà la réindustrialisation en charge de la Picardie le 26mars 2009, soit deux jours après un discours duPrésident Sarkozy (à Saint-Quentin, dans l’Aisne)annonçant la création de cette nouvelle responsabilitédans le paysage administratif français.UN <strong>É</strong>PARPILLEMENT ENTRE DE NOMBREUXACTEURS EN CHARGE DU D<strong>É</strong>VELOPPEMENT<strong>É</strong>CONOMIQUE QUI SE TRADUIT PAR UNEMOINDRE EFFICACIT<strong>É</strong>Le développement économique local, et donc la luttecontre la désindustrialisation, est conduit à travers lesinteractions d’un nombre significatif d’acteurs interlocuteursdes entreprises : collectivités, services de l’Etat,syndicats, organismes consulaires et professionnels,organismes de formation et de recherche.Les collectivités confèrent au département une structuremultipolaire avec, à chaque fois, un nouveau typed’organisation pour le développement économiqueLe département de l’Oise se caractérise par le fait que,n’ayant pas de centre, celui-ci est structuré autour detrois pôles économiques principaux : Beauvais, le cheflieudu département ; Compiègne ; Creil et le Sud-Oise ; chacun ayant ses caractéristiques propres et ayantmis en place une solution différente pour aborder laproblématique de son développement économique :• La Communauté d’agglomération du Beauvaisis(78 000 habitants), qui comprend Beauvais, chef-lieudu département (55 000 habitants), dispose d’un serviceéconomique de quelques personnes ;• L’agglomération de la Région de Compiègne (72 000habitants), autour de Compiègne (42 000 habitants),s’est dotée de services étoffés comptant près d’une centainede personnes (l’ARC) pour s’occuper du foncier,de l’aménagement (existence de plusieurs parcs d’activités),des services techniques et du développementéconomique ;• Le Sud-Oise (130 000 habitants) – qui comprendnotamment la communauté d’agglomération de Creil(72 000 habitants) – a opté pour la création, en févrierde cette année (2010), d’une Agence de développement: Sud-Oise Développement ;• en outre, quelques communautés de communes(telles que Noyon, Senlis, Méru ou Crépy-en-Valois)accueillent des zones industrielles.Au niveau des collectivités territoriales, le Conseil régionalde Picardie joue un rôle moteur de soutien au développementindustriel, notamment à travers une politiquede soutien à la recherche et aux entreprises dans desfilières qu’il juge prioritaires (aéronautique, ferroviaireavec le pôle mondial de compétitivité « I-Trans » partagéavec la Région Nord-Pas de Calais et, dans l’Oise, l’agroindustrie,à travers le pôle mondial de compétitivité«Industries et AgroRessources » (IAR), pôle commun àla Picardie et à la région Champagne-Ardenne). LeConseil régional peut aussi mobiliser à cet effet leConseil Régional Economique et Social et dispose d’uneAgence Régionale à l’Innovation. Par contre, il n’y a pasd’agence régionale économique, les interventions étantmenées activement et directement par le Conseil régionalet ses directions de l’économie et de la recherche ; ils’agit là d’une singularité ne constituant en rien un handicap,car cela évite l’existence d’institutions souvent trèspréoccupées à assurer leur propre pérennité.Un fonds de capital-risque régional, PicardieInvestissement, réunit des dotations provenant de laRégion et de partenaires financiers (Caisse des Dépôtset Consignations (CdC), Crédit Agricole, Caissed’Epargne, CIC) pour apporter des financements enfonds propres à différents stades de la vie de l’entreprise: amorçage, création, développement, transmission.De son côté, le Conseil général de l’Oise n’intervientque sur des volets sociaux ou d’infrastructures(Internet, zones industrielles).Les services de l’Etat sont principalement tournésvers la gestion des crises, le traitement desrestructurations et le soutien à l’emploiFace à des collectivités éparpillées, les services de l’Etat(Préfecture, Direction des Finances publiques (ex.Trésorier-Payeur général), Unité territoriale de laDireccte (ex-Direction du Travail et de la Formationprofessionnelle) présentent une démarche coordonnéeet rodée ; cependant, celle-ci est principalement tournéevers l’intervention dans le traitement des difficultésfinancières des entreprises (Codefi, Médiation du crédit)et la gestion des conflits sociaux. L’attention estdavantage portée sur la politique de l’emploi soustoutes ses formes que sur le développement des entreprises.La Préfecture entretient un dialogue avec les syndicatsde salariés à travers des réunions mensuelles avecles représentants départementaux des centrales syndicales,ces rencontres étant essentiellement consacréesaux évolutions de l’emploi.Le ministère de la Défense joue un rôle actif et originalLe ministère de la Défense – qui dispose d’un déléguérégional aux restructurations de défense, basé à Amiens20R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
– joue un rôle important dans le développement économiquelocal, car, à travers la Délégation aux restructurationsde défense (DAR), il accorde des financementssignificatifs aux collectivités affectées par desdéparts de régiments ou par des fermetures d’installationsmilitaires entraînant le départ de personnels, lanécessaire réaffectation des locaux et la réduction de laconsommation locale. Trois sites sont ainsi concernésdans l’Oise : Noyon, Compiègne et Senlis. Au total, 12millions d’euros vont être accordés par la DAR pour larevitalisation de ces trois sites.Des organismes consulaires et professionnels trèsprésents, mais tournés surtout vers les TPE et lesPMEUne seule Chambre de Commerce et d’Industrie (cellede l’Oise) couvre tout le département et propose tousles services d’une CCI, principalement les formalités, laformation, le soutien à la création et aux transmissionsd’entreprises. La Chambre des Métiers, très dynamique,promeut fortement l’artisanat et l’apprentissage.Avec la Chambre d’Agriculture, ces deux organismesforment une Interconsulaire qui intervient dansla gestion des conventions de revitalisation.Le MEDEF Oise a constitué un maillage d’entreprisesen relayant ses activités à travers six réseaux territoriauxd’entreprises : chacun de ces groupements est une associationpatronale qui regroupe et fédère sur son bassind’emploi des entreprises de toutes tailles et ce, toutesactivités confondues.Dans l’Oise, il existe donc six GroupementsInterprofessionnels d’Entreprises, implantés chacun surun bassin d’emploi :• Le GEAC (Groupement des Entreprises del’Arrondissement de la Région de Clermont) ;• Le GERC (Groupement des Entreprises de la Régionde Creil et du Sud de l’Oise) ;• Le GERCO (Groupement des Entreprises de laRégion de Compiègne) ;Photo : Implantation géographique des six groupementsinterprofessionnels.• Le GEV (Groupement des Entreprises du Valois) ;• Le GIN (Groupement Interentreprises duNoyonnais) ;• Le GIRB (Groupement Interentreprises de la Régionde Beauvais) (voir la photo ci-dessous).La présence de plusieurs centres de formation et derecherche industrielle, souvent de portée nationale,ne se traduit pas encore par des retombées localesen termes d’activités et d’emploisL’Oise accueille plusieurs organismes réputés au rayonnementnational :• Le Centre technique des industries mécaniques(CETIM) a son siège et plusieurs laboratoires et plateformestechnologiques à Senlis, où il occupe 412 personnes(sur un total de 700) ;• L’Institut national de l’environnement industriel etdes risques (INERIS), à Verneuil-en-Hallatte, près deCreil, compte environ 600 salariés ;• L’Université Technologique de Compiègne (UTC) aété créée en 1972 pour être un modèle nouveau d’universitéde technologie et d’école d’ingénieurs. Troisobjectifs justifiaient la création de cette université pilote:• alors que la technologie ne bénéficiait d’aucunereconnaissance, ni comme science fondamentale nicomme science appliquée, l’enseignement de la technologiedevient le pôle organisateur de l’UTC ;• l’enseignement et la gouvernance de cette universitéassocient étroitement les industriels ;• son campus a été intégré dans la ville de Compiègneet dans le monde économique afin de faciliter les relationset la compréhension mutuelles entre eux.Aujourd’hui, l’UTC occupe : 3 900 étudiants ingénieursUTC, 350 enseignants chercheurs, 250 étudiantsmasters et 300 étudiants docteurs.L’UTC favorise la création d’entreprises. A cet effet, ellebénéficie de l’existence d’une pépinière où se sont installéesdes entreprises créant des emplois. Notonscependant que le dynamisme de cette pépinière sembles’être essoufflé à partir du moment où elle a quitté lecampus pour s’installer sur l’autre rive de l’Oise (dans leParc technologique des Rives de l’Oise, qui comprend22 jeunes entreprises offrant 80 emplois). Un Centrede l’Innovation (budget d’investissement : 14 millionsd’euros, financé par la Région, l’ARC et le plan nationalde relance) est en cours de construction à l’UTCpour favoriser l’émergence de projets innovants, mais ilreste à s’assurer qu’un accompagnement humain, autravers de conseils stratégiques, juridiques, financiers,d’identification de marchés, d’organisation et de propriétéintellectuelle, soit effectivement mis en place à lahauteur des efforts consentis en matière de projetimmobilier et d’équipements techniques.L’UTC joue un rôle majeur dans les deux pôles de compétitivitémondiaux implantés en Picardie : Industries etCLAUDE TRINKR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 21
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES© Nicolas Tavernier/REA«L’Université Technologique de Compiègne (UTC) a été créée en 1972 pour être un modèle nouveau d’université de technologieet d’école d’ingénieurs ».Agro-Ressources (IAR) et i-Trans (Transports innovants :ce dernier, encore davantage présent dans la RégionNord-Pas de Calais, réunit les principaux acteurs del’industrie, de la recherche et de la formation dans ledomaine du ferroviaire et des systèmes de transportsterrestres innovants).Par contre, le pôle IAR est très actif en Picardie : il proposeune stratégie de valorisation industrielle complètedu végétal sur les différents plans alimentaire, énergétique,biomatériaux et biomolécules. Il développeactuellement un nouveau concept de bio-raffinerie àhaute qualité environnementale (HQE) intégrant lagestion des déchets (programme Pivert, à Compiègne).• L’Institut Polytechnique LaSalle, à Beauvais, est laplus ancienne école d’ingénieurs privée de France (ellea été fondée en 1854). Elle fait partie d’un réseau mondialde 1 500 écoles et de 70 universités privées LaSalle ;à Beauvais, elle accueille 1 500 étudiants dans les disciplinessuivantes : Agriculture, Alimentation et Santé,Géologie. Ses huit plateformes techniques commencentà héberger des entreprises en création qui souhaitentse développer au contact d’équipes scientifiques etbénéficier de l’accès à des équipements de technologiespivots.LaSalle Beauvais est aussi très impliqué dans lepôle IAR sur des programmes concernant l’amontvégétal et la première transformation.• Le CRITT (Centre Régional d’innovation et de transferttechnologique) Polymères, à Verneuil-en-Halatte,est un centre de transfert de technologie consacré à laplasturgie qui occupe 6 personnes.• PROMEO Formation : signalons l’importance, dansl’Oise, de ce centre de formation continue et de formationen alternance, rattaché à l’UIMM, comprenant260 collaborateurs permanents, 400 formateurs, 2 300entreprises partenaires et 15 000 stagiaires par an enformation continue, ainsi que 2 000 jeunes en formationen alternance.UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST ACCORD<strong>É</strong>EÀ LA MISE EN PLACE DE NOUVELLESINFRASTRUCTURES DE TRANSPORTUn des atouts de l’Oise est depuis toujours ses infrastructuresde communication : l’autoroute A1 Paris-Senlis- Compiègne-Lille, l’autoroute A16 Gennevilliers-Beauvais-Amiens et l’autoroute A29 Reims-Compiègne-Rouen. En outre, Beauvais dispose d’unaéroport international (l’Aéroport Paris-Beauvais-Tillé)qui est utilisé pour des vols low cost (assurés à hauteurde 72 % par la compagnie Ryanair) et qui occupe 400salariés ; c’est le 10 e aéroport français en termes de traficpassagers, avec 2,6 millions de passagers par an. LaCCI Oise, qui exploite cet aéroport en association avecVeolia Transport, souhaiterait le développer plus inten-22R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
sément (maintenance aéronautique, hôtellerie), maiselle se heurte aux réticences des riverains (vols de nuit).Deux grands projets font l’objet de grandes attentes enraison des importantes retombées économiquesescomptées :• Le canal Seine-Nord Europe, qui devrait se traduirepar des plateformes industrielles ou logistiques, aurisque d’un éparpillement et d’une concurrence interne(une plateforme installée à Noyon, deux dans laSomme : Nesle et Péronne, et une seule, dans le Nord-Pas de Calais, à Marquion) ; sans attendre, Compiègnecompte développer une plateforme multimodale surl’Oise, à Longueil-Sainte-Marie, à l’entrée du futurcanal ;• La liaison ferroviaire TGV Picardie-Roissy, qui est unbarreau d’une dizaine de kilomètres au Nord-Est duVal d’Oise, entre le réseau TGV de Roissy et la ligneclassique Paris-Creil-Amiens. Pour un coût de 255 millionsd’euros, ce barreau permettrait d’ouvrir des liaisonsTGV en Picardie, ainsi que des liaisons TER entrela Picardie et l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, cequi permettrait notamment un accès plus aisé, pour lestravailleurs de la zone de Creil, à la zone d’activités deRoissy ; ce projet (objectif 2020), qui se heurte àdiverses réticences, fait l’objet actuellement d’un débatpublic (voir http://www.debatpublic-roissypicardie.org).La mobilisation des collectivités sur ces infrastructuresfutures se fait d’une certaine manière au détrimentd’une action en faveur des implantations immédiatesd’entreprises. La leçon n’a pas encore été tirée dumanque de succès de la gare TGV Haute Picardie (qualifiéepar dérision « gare des betteraves ») implantée surla ligne TGV Paris-Lille à la hauteur de l’axe Amiens-Saint-Quentin, ni du très faible développement de lazone industrielle qui y est accolée.L’ABONDANCE DES PROC<strong>É</strong>DURES ET DESFINANCEMENTS NE SE TRADUIT PAS PAR UNER<strong>É</strong>INDUSTRIALISATION D’ENVERGUREL’Oise peut mobiliser toute une palette de dispositifsfinanciers pour accompagner la création d’emplois. Autout premier chef, nous mentionnerons la mise enplace de nombreuses conventions de revitalisationconclues avec les grandes entreprises qui se sontrestructurées. La mise en œuvre comprend toujours uncomité technique qui décide des aides apportées auxdossiers individuels d’entreprises, et un comité de suiviassociant les collectivités.Cependant, l’efficacité de ces dispositifs de revitalisationpeut être diversement appréciée.CLAUDE TRINK© Gilles Rolle/REA«Beauvais dispose d’un aéroport international (l’Aéroport Paris-Beauvais-Tillé) qui est utilisé pour des vols low cost et quioccupe 400 salariés ; c’est le 10 e aéroport français en termes de trafic passagers, avec 2,6 millions de passagers par an ».R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 23
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESUne concentration des moyens sur un seul dispositifgéré par l’InterconsulaireUn grand nombre de conventions ont été confiées à lagestion de l’Interconsulaire, une association entre laChambre de Commerce et d’Industrie (CCI) del’Oise, la Chambre des Métiers et la Chambred’Agriculture.A la fin avril 2010, l’Interconsulaire gère ainsi unensemble de sept fonds de revitalisation représentantau total un montant de 3,3 millions d’euros en vue del’accompagnement de la création de 925 emplois,chaque fonds ciblant un territoire précis dans le département.Les entreprises qui ont contribué à ces financements,des secteurs de la métallurgie, de l’équipementautomobile, de l’agroalimentaire… reflètent lephénomène de désindustrialisation qui affecte ledépartement : Faurecia, Vallourec, Candia, Yoplait,KME, KOHLER, ZF Sachs… En outre, trois autresconventions (en cours de signature) contribuerontpour 1,8 million d’euros supplémentaires.Ces fonds sont utilisés pour octroyer des subventions àla création d’emplois, en général de l’ordre de 3 000euros par emploi créé ; en outre, une subvention de3000 euros est accordée à la création d’une entreprise.Les dossiers sont examinés lors de réunions tenues tousles deux mois à la Préfecture sous la présidence duSecrétaire général et réunissant les services de l’administration,ceux de l’Interconsulaire et ceux de l’entreprisecontractante à la convention.Le bilan est mitigé : le dispositif fonctionne effectivement; il a approuvé 232 dossiers (sur 346 dossiers proposés); il a accompagné la création de 534 emplois enaccordant 1,7 million d’euros de subventions.Cependant, il s’agit de très petits dossiers, correspondanten moyenne à 2,25 emplois/dossier, ce qui reflètel’influence de la Chambre des Métiers, qui soutientavec vigueur les TPE : on constate un grand nombrede créations d’entreprises unipersonnelles, plus de lamoitié des dossiers correspondant à de l’artisanat.Davantage encore que la petite taille des dossiers, onpeut regretter que le dispositif fonctionne uniquementcomme un distributeur de primes à l’emploi (les subventionsne sont effectivement versées qu’après vérificationde l’existence du contrat de travail) intervenantpour des montants très limités, et non comme un outilde financement de l’entreprise : il n’y a pas d’analysesur les besoins financiers futurs de l’entreprise, ni desouci de mobiliser d’autres ressources pour l’entreprise.Récemment, de nouvelles orientations ont été adoptéespour améliorer le dispositif :• privilégier la création du 2 e emploi et au-delà par rapportà la création de l’emploi du créateur de l’entreprise,qui est aidé par ailleurs (PFIL, aide régionale) : à ceteffet, la prime est doublée pour la création du 2 e au 4 eemploi ;• créer une solidarité entre les territoires à l’intérieurdu département, en réservant 15 % du montant desnouvelles conventions à des projets pouvant être situésen dehors du territoire de la convention.En outre, l’Interconsulaire est en train d’envisager (àma demande) d’étoffer son dispositif, jusqu’à présentuniquement tourné vers l’octroi de subventions àl’emploi, en offrant une possibilité pour les dossierssignificatifs (à partir de la création de 5 emplois) demettre en place des prêts sans garantie.Cela permettrait, d’une part, de disposer d’une analysefinancière véritable de l’entreprise et de son projetet, d’autre part, d’assurer le bouclage du plan definancement de l’entreprise sur trois ans, en mobilisant,à côté du prêt sans garantie, des prêts bancairestraditionnels.L’aide apportée par la revitalisation se traduirait alorspar :• l’élaboration d’un plan de financement sur trois ans,recensant les besoins et les ressources ;• l’attribution d’un prêt sans garantie (financé par laconvention de revitalisation) ;• la mobilisation coordonnée des autres ressources :prêts bancaires classiques, subventions des collectivités.L’apport du prêt sans garantie exercerait alors un véritableeffet de levier (souvent d’un facteur variant de 1à 10) dans l’obtention de concours financiers pluslarges, ce que ne permet à elle seule la subvention àl’emploi créé.Remarquons enfin que l’attribution de prêts sansgarantie permet d’intervenir ex ante pour soutenir unprogramme de développement de l’entreprise (comportantla création d’emplois) en se projetant dansl’avenir et, non ex post, c’est-à-dire lorsque les emploisont déjà été créés ; un peu comme une récompense,comme c’est actuellement le cas avec les subventions àl’emploi.Ces orientations sont actuellement reprises dans ungroupe de travail national animé par la DATAR sur les« financements à effet de levier », auquel je participe.Les conventions mise en œuvre par des cabinetsprivés : le cas de ContinentalLa mise en œuvre de certaines conventions de revitalisationest confiée par les entreprises qui les financentà des cabinets privés : il en est ainsi de laconvention – une des plus importantes actuellementen France – conclue avec Continental, un an après lafermeture de l’usine ; d’un montant de 7,4 millionsd’euros, elle vise à accompagner la création de 1 098nouveaux emplois sur le territoire du Pays compiégnoisà travers l’attribution de subventions de l’ordrede 5 350 euros/emploi. En outre, elle intègre lanécessité de la mise en place d’un programme pourla reconversion du site de 15 hectares situé au bordde l’Oise. A côté des subventions, il est prévu l’attributionde prêts sans garantie.24R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
La Convention Vivendi et les prêts sans garantieL’Oise est en France un des quatorze territoires bénéficiairesdu dispositif de revitalisation Vivendi. Cetteentreprise prend, en effet, à sa charge, dans le cadred’une convention avec l’Etat correspondant à un« mécénat économique », la revitalisation de territoiressélectionnés par le ministre de l’Industrie. Vivendiconsacre entre 2,5 et 3 millions d’euros par territoirepour conduire, en liaison avec la Préfecture, un programmede revitalisation mené par un cabinet spécialisé(que Vivendi choisit). Un objectif chiffré de créationsd’emplois, sur une période de trois ans, est fixé àl’avance.L’Oise a été une première fois bénéficiaire de ce dispositifentre 2005 et 2008, avec un objectif de 300emplois. La mission a été confiée au cabinet Geris, quia fait approuver 52 dossiers comportant la création de534 emplois, dépassant donc largement l’objectif. Unbilan présenté en septembre 2009 (un an après la fin dela mission, par conséquent) a relevé qu’en dépit de lacrise, le nombre d’emplois créés et encore existants étaitde 519, ce qui témoigne de la solidité des dossiers proposés.Le 26 mai 2010, une nouvelle convention a été signéeavec Vivendi, prévoyant, à nouveau, un objectif de 300emplois ; le cabinet Geris a été choisi, après appeld’offres. Il a été bien spécifié que l’intervention de lamission Vivendi ne devait pas doublonner les conventionsde revitalisation financées par des entreprises enrestructuration (voir plus haut) et qu’elle devait seconcentrer sur les territoires dépourvus de conventionou sur des projets structurants nécessitant un montagefinancier approfondi.Le dispositif comporte une analyse financière desentreprises qui ont des programmes d’investissementcomportant des créations d’emplois afin de recenser lesbesoins et de monter un plan de financement sur troisans. Le dispositif accorde alors deux types d’aides :• une aide directe à l’emploi créé (sous la forme d’unprêt sans garantie transformable en subvention lorsquel’emploi est effectivement créé) cumulable avec les aidespubliques ;• un prêt sans garantie (le « prêt participatif de développement» mis en place par le Crédit Agricole Brie-Picardie ou par Oséo) à un taux privilégié, d’un montantpar entreprise compris entre 15 000 et 150 000euros, d’une durée de 5 à 7 ans, avec un différé d’amortissementde 6 mois à 2 ans.Ce dispositif a pour finalité de mobiliser des financementsbancaires classiques : l’attribution des prêts sansgarantie doit s’accompagner de l’octroi, par unebanque, d’un montant équivalent dans le cas d’uneentreprise en développement, ou d’un montant doubledans le cas d’une entreprise en création (ou créée depuismoins de trois ans).Le bilan financier de la première convention Vivendisur le département de l’Oise montre l’efficacité d’undispositif de revitalisation lorsque celui-ci intègre bientoutes les facettes (recherche et analyse des dossiers,ingénierie des financements pour répondre à l’ensembledes besoins, soutien à la création d’emplois).Ainsi, 131 projets ont été analysés, 59 projets ont étéagréés (création : 19 ; développement : 40). Sur les 52projets financés, 50 projets sont toujours actifs (lesdeux restants se sont soldés par un dépôt de bilan, dontles 12 salariés ont été repris, et un rachat d’entreprise).Les 52 dossiers financés correspondaient à 603 emploisprogrammés (à rapprocher de l’objectif de la mission de300 emplois) ; les programmes engagés se sont accompagnésde la création de 533 emplois pour un théoriquede 552 emplois ; les emplois maintenus 18 mois aprèsla fin de la mission étaient au nombre de 519.Sur le plan financier, 1,2 million d’euros de subventionsont été accordés sous forme de primes à l’emploiet 2,45 millions d’euros en prêts sans garantie (grâce àune contribution forfaitaire de Vivendi, de 600 k€) ; lemontant des prêts bancaires accordés en parallèle parles banques a été de 19,85 millions d’euros, pour unmontant d’investissements total de 34,5 millions d’euros.Cela conduit à un effet de levier (rapport entre les ressourcesmobilisées et les financements apportés parVivendi) de 13 par rapport au montant total des financementsmis en place, et de 19 sur les investissementsfinancés.Les conventions du Fonds National de Revitalisationdes Territoires (FNRT)Deux territoires de l’Oise (Beauvais et Sud-Oise) ontété retenus pour être éligibles aux prêts sans garantiedu Fonds national de revitalisation des territoires(FNRT), qui s’appliquent, en général, aux zonesdépourvues de convention de revitalisation. Ces prêtsd’un montant compris entre 100 000 et un milliond’euros, sont instruits et mis en place par Oséo, aprèsconsultation d’un comité technique regroupant lesservices administratifs. Là encore, les prêts du FNRTdoivent s’accompagner d’un financement pour unmontant correspondant au minimum au double desfinancements bancaires classiques.Un premier dossier a été approuvé, dans l’Oise, pourune entreprise de transport. Le prêt FNRT est venujouer un rôle de renforcement de la structure financièrede l’entreprise, très endettée, à travers des créditsbaux.Mais il n’y a pas eu, dans ce cas, de programmede création d’emplois.Restructurations de défense et SOFIREDLe ministère de la Défense met en œuvre, sur l’Oise,son programme d’accompagnement de la restructurationdes sites de défense.CLAUDE TRINKR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 25
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESCette démarche, très construite, passe par un travail, enliaison avec les collectivités concernées, de diagnosticterritorial, d’identification de programmes de développementet de fixation de priorités ; des cabinets spécialiséssont choisis pour conduire le diagnostic territorialet aider les collectivités à élaborer leurs programmesd’action.Au niveau territorial, tous les acteurs sont associés ausein d’un comité de site de la défense, présidé par lePréfet, afin d’élaborer un plan local de redynamisation(PLR), ou, pour les sites les plus touchés, un contrat deredynamisation de site de défense (CRSD).L’élaboration des programmes est maintenant trèsavancée dans l’Oise et les collectivités concernées ontdéfini leurs priorités :• Pour Noyon, ville où, aux aides prévues de la part duministère de la Défense s’ajoute un dispositif de franchisefiscale sur le site du quartier libéré par leRégiment du Tchad, le projet de contrat de redynamisationprévoit une contribution de 8 millions d’eurossur un ensemble de programmes représentantquelque 20 millions d’euros, autour de quatre axesprincipaux :- accroître l’offre d’enseignement et développer uninternat d’excellence ;- dynamiser le tissu économique en le repositionnantsur l’éco-conception ;- développer la recherche, l’innovation, l’expérimentationet la formation dans le secteur de l’éco-conception;- promouvoir les loisirs et le tourisme verts.• Pour Compiègne, un montant de 2,4 millions d’eurosviendra accompagner trois programmes prioritaires – évaluésà 4,8 millions d’euros – parmi dix analysés :- viabilisation du foncier pour accueillir le siège del’Office National des Forêts (ONF) dont le déménagement,de Paris à Compiègne avant la fin 2012 (300emplois), a fait l’objet d’une convention officielle avecles ministres concernés ;- développement de l’offre foncière d’accueil d’entreprisesindustrielles et logistiques sur un ancien site militaire;- reconversion d’un hangar militaire et création d’unpôle événementiel.• Il en va de même pour Senlis, où le projet de plan derestructuration de défense retient deux priorités etapportera 1,6 million d’euros sur 5,3 millions d’eurosd’investissements :- requalification et modernisation de la zone industrielle,vieillissante, située à la sortie de l’autoroute A1 ;- création d’une pépinière d’entreprises dédiées au secteurtertiaire, qui sera située sur le site militaire qui vaêtre libéré.Notons que ces crédits ne seront attribués que dans lecadre de cofinancements, ce qui oblige les collectivitésà identifier et à convaincre d’autres financeurs (Région,communautés, investisseurs immobiliers...). Jusqu’àprésent, seule la phase de l’élaboration technique desprogrammes d’action a été achevée.En outre, le ministère de la Défense a créé une sociétéfinancière, la SOFIRED, dotée de 45 millions d’euros,destinée à accorder, au terme d’une instruction que laSOFIRED mène elle-même, des prêts sans garantie àdes entreprises implantées sur les départements affectéspar des restructurations de défense (dont, en Picardie,l’Oise et l’Aisne). Ces prêts sont destinés à jouer le rôlede quasi-fonds propres et à favoriser la mobilisation desautres financements.L’originalité de la SOFIRED réside dans le fait qu’elleconsidère que l’accompagnement de l’entreprise n’estpas uniquement financier et qu’il est important de luiproposer, en parallèle, un dispositif d’accompagnementhumain par des consultants, dans les domaines où lechef d’entreprise estime avoir besoin d’une assistancespécialisée (organisation de la gestion ou de la production,système d’information, propriété intellectuelle,approche de nouveaux marchés…). Ce dispositif mixted’accompagnement (humain et financier) est appelé la«Sofibox ».Autres dispositifs d’interventionIl convient de mentionner les dispositifs d’accompagnementhumain et d’aides (prêts d’honneur comprisentre 1 500 et 10 000 euros) à la création d’entreprisesproposés par les plateformes d’initiative locale(« PFIL »). Ces PFIL sont soutenues par les collectivitéset l’Oise en compte trois pour être au plus près desentrepreneurs : Oise-Est Initiative, Oise-OuestInitiative et Oise-Sud.Les prestations apportées sont :• l’accueil du porteur de projet, et sa réorientation, lecas échéant ;• son accompagnement, à travers un diagnostic généraldu projet, qui passe par une évaluation des besoins etune analyse du projet, ainsi qu’à travers des conseilstechniques ;• un soutien financier : prêt à taux 0 %, sans garantieni caution personnelle, dont le but est de renforcer lesfonds propres et de faire effet levier avec le prêt bancaire;• le suivi, après la création de l’entreprise.En outre, le Conseil régional apporte aussi une subventionau créateur d’entreprise (programme dont l’applicationest suspendue depuis les élections régionales demars 2010).LA DIFFICILE <strong>É</strong>LABORATION DE STRAT<strong>É</strong>GIESTERRITORIALESLa structure multipolaire du département, commedécrite plus haut, et l’absence de rôle affirmé pour leConseil général sur le plan du développement économiqueconduisent à ce qu’il n’y ait pas une stratégie26R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
d’ensemble du département, mais plutôt des tentativesde stratégies locales élaborées au niveau de chaque collectivité(communauté d’agglomérations ou de communes,pays).Une approche stratégique est cependant nécessaire, enraison, d’une part, des mutations très fortes vers unedésindustrialisation sans apparition concomitante desources d’emplois de remplacement et, d’autre part, del’abondance des sources de financement aujourd’huidisponibles pour accompagner la création d’emplois.Le principal frein à la définition de stratégies et à samise en œuvre est la faiblesse des ressources humainesconsacrées à la réflexion, à la définition et à la mise enœuvre de programmes d’action tournés vers le développementdes territoires et des entreprises qui y sontimplantées. Cela concerne la prospection et l’identificationde projets, l’accueil de porteurs de projets, lemontage de dossiers avec la réponse aux cahiers descharges des entreprises (foncier, ressources humaines,financements), la participation aux processus de décision,le suivi de la concrétisation des projets.Les effectifs très limités existants consacrés à l’interfaceavec les aspects de développement des entreprises (distinctsde ceux des politiques d’emploi) interviennentprincipalement à travers la participation aux procéduresde mise en œuvre des financements, comme décritesplus haut.Ce volume limité de ressources humaines pour l’animationéconomique se vérifie au niveau des collectivités,des services de l’Etat (par exemple le pôle 3 E(Entreprises, Economie, Emploi) de la Direccte estconcentré au siège de la Région à Amiens : il est encours de constitution et n’a pas de représentant dansl’Oise), des organismes de recherche et formation (aussibien l’UTC que l’Institut LaSalle), des organismesconsulaires ou professionnels tournés vers les besoinsimmédiats et les intérêts de leurs adhérents. Le renforcementdu « capital humain » est indispensable pourtirer toute l’efficacité des ressources financières d’accompagnementéconomique disponibles aujourd’hui.Fort heureusement, on observe des orientations qui traduisentune évolution positive :• l’élaboration (imposée par le ministère de la Défense)de diagnostics économiques locaux et de propositions,conduits par des cabinets spécialisés, les collectivitésconcernées et les administrations dans le cadre desrestructurations de Défense (dans l’Oise, à Noyon, àCompiègne et à Senlis), a poussé à une réflexion stratégique;• l’Agglomération de Compiègne – qui s’est dotée deservices plus étoffés qu’ailleurs dans le département –cherche à tirer profit de la libération de sites militairespour développer une offre foncière et immobilière nouvellelui permettant, en s’appuyant sur l’UTC et sur lePôle de compétitivité « Industrie et Agro-Ressources »,de développer des filières industrielles (filière verte /bioénergies,cluster bois), d’attirer des sièges sociaux(comme pour l’ONF) et de développer le tourismed’affaires et de loisirs (château impérial, haras, forêt) ;• la communauté d’agglomération du Beauvaisisappuie un projet stratégique : l’Institut La Salle deBeauvais qui envisage à présent de créer une plateformetechnologique et scientifique tournée vers les traitementsde la biomasse par micro-onde, par l’ozone oupar méthanisation, et une pépinière technologique,pour accueillir des entreprises intéressées par ses programmeset ses équipes. A cet égard, elle compte s’appuyersur les expériences réussies des pépinières crééespar les universités LaSalle de Barcelone et de Madrid ;• le Sud-Oise vient de mettre en place une authentiqueagence de développement, distincte des services assurantla gestion administrative de la collectivité.Cette agence s’est rapidement dotée d’un directeur etde trois chargés de mission spécialisés.• des industriels du Sud-Oise (Montupet, Arcelor-Mittal, Cray Valley, des PME) ont constitué une associationpour mettre en oeuvre de manière partagée deséquipements lourds (tomographe, capacités de calculinformatique) ;• le CETIM met en œuvre auprès de quelques entreprisesdes actions collectives – avec financementspublics et privés de diagnostics et de réflexions stratégiquesdestinés à renforcer la flexibilité et la compétitivitédes entreprises (programme ACAMAS, jusqu’àprésent limité aux entreprises de la métallurgie et de lamécanique) ;• de même, ont été lancés autour de deux grandesentreprises des programmes collectifs visant à améliorerles relations clients-fournisseurs et à développer la réactivitédes PME travaillant en relation avec un donneurd’ordres important.LA CONTRIBUTION DU COMMISSAIREÀ LA R<strong>É</strong>INDUSTRIALISATIONFace à un univers aussi émietté, mon action deCommissaire à la réindustrialiation s’oriente selon troisaxes (les « 3P ») : personnes, projets, procédures.En premier lieu, il y a une véritable demande, de la partdes collectivités, de pouvoir échanger et présenter leursattentes et leurs projets. D’où l’importance d’aller à larencontre des acteurs : collectivités, entreprises, organisationsprofessionnelles et syndicales… On passe ainside relations formelles à la constitution de véritablesréseaux fondés sur la confiance entre personnes, laquellefavorise une accélération de la prise de décision.A côté des projets soumis au Commissaire, il y a ceuxqu’il impulse lui-même, et au bon déroulement desquelsil veille. Pour ma part, je me suis attaché aussi bien àfaire progresser la réflexion collective sur des filières stratégiques,telles le machinisme agricole ou l’éolien offshore en Picardie (Somme et Oise, principalement) enexaminant les retombées industrielles potentielles, qu’àidentifier et soutenir des projets exogènes susceptibles des’implanter et de générer à chaque fois un nombre significatifd’emplois, de l’ordre de 400 à 500 : comme leCLAUDE TRINKR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 27
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIREStraitement des pneus usagés, le recyclage de matériauxou l’implantation de centres d’appels.Enfin, il est nécessaire de veiller à un fonctionnementefficace des nombreuses procédures d’accompagnement: cela passe d’abord par la définition précise descahiers des charges des conventions de revitalisation,mais ensuite (et surtout au moment de l’examen desprojets bénéficiaires des aides), il convient de passerd’une approche limitée à l’attribution d’une prime àl’emploi à une approche visant à analyser et à apporterdes réponses aux différents besoins (financiers, maisaussi en ressources humaines, fonciers, en marchés, eninnovation) de l’entreprise.Une véritable dynamique de réindustrialisation nepeut se mettre en place qu’à travers une prise deconscience par tous les acteurs du fait qu’une entreprisen’est pas seulement une structure destinée àgénérer des contrats de travail, mais avant tout unacteur économique en permanente évolution,confronté aux marchés et à la concurrence, qui abesoin d’un environnement favorable apporté par lesautres acteurs du territoire et qui cherche à s’insérerdans des réseaux de relations fortes. Il sera alors possiblede passer d’une situation cumulant une collectiond’atouts et de faiblesses à un fonctionnement de« territoire performant ».28R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Le FDR 35,fonds départementalde revitalisationde l’Ille-et-VilaineLa fonction de Commissaire à la réindustrialisation consiste en uneprestation d’ingénierie au profit des entreprises et des territoiresdans le but de préserver et de créer de l’emploi. Ce rôle d’interfaceentre les entreprises, les partenaires sociaux, les élus et l’Etat luipermet de focaliser les savoir-faire en vue d’une intervention massiveet concomitante au profit de la compétitivité de l’industrie sur unterritoire donné.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar Jacques GARAU*La revitalisation correspond bien aux nécessités decette action, en mobilisant les acteurs économiquessur des projets locaux dans une zone d’emploi donnée,dans l’optique d’une véritable gestion prévisionnelledes emplois et des compétences, qui sont la véritableplus-value immatérielle de notre patrimoineindustriel.UN FONDEMENT JURIDIQUE QUI S’INSCRITDANS LA DUR<strong>É</strong>ELe comité interministériel d’aménagement et de développementdu territoire (CIADT) du 13 décembre2002, en établissant le principe d’égalité des chancesterritoriales, et celui du 26 mai 2003, en donnant lapriorité à la revitalisation des bassins d’emploi, ont fixéles grandes lignes de l’action de l’Etat en matière d’anticipationet d’accompagnement des mutations économiques.Ces missions ont été confiées à la DélégationInterministérielle à l’Aménagement du Territoire et àl’Attractivité Régionale (DATAR) par le CIADT du 14octobre 2005. Le Président de la République a créé lafonction de Commissaire à la réindustrialisation le 4mai 2009 et le ministre de l’Industrie, dans son discoursdu 18 mai 2010 sur la nouvelle politique industrielle dela France, a confié à ce dernier une mission visant à lamise en place d’une gestion prévisionnelle territorialedes emplois et des compétences (GTEC).Il s’agit donc bien, pour l’Etat, dans le cadre d’une politiqued’aménagement du territoire volontariste et continue,de mettre à disposition des moyens spécifiques etadaptés permettant de recréer des emplois essentiellementindustriels.La loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002crée, à son article 118, une obligation de revitalisationdans le but de responsabiliser les dirigeants d’entreprisesqui, en licenciant de manière parfois massive, mettenten danger l’économie d’un bassin d’emploi.La loi de Cohésion sociale du 18 janvier 2005 précise,quant à elle, dans son article 76, son champ d’applicationcodifié à l’article L.1233-84 et suivants du Code* Commissaire à la réindustrialisation pour la Bretagne.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 29
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES© Laurent Vigneron/REA« Le département de l’Ille-et-Vilaine se caractérise par l’impact économique particulièrement fort du bassin d’emploi deRennes. Son dynamisme interne lui vaut un taux de chômage inférieur à celui de la Région et très en retrait par rapport àcelui constaté au niveau national. ». Zone d’activité à Rennes.du travail. Celui-ci préconise la mise en œuvre de cetteobligation pour les entreprises (ou pour les groupesd’entreprises) employant plus de 1 000 salariés dans lesEtats membres de l’Union européenne couverts par laDirective communautaire 94-45 du 22 septembre1994.Le fait générateur réside dans la décision prise de procéderà un licenciement collectif affectant par sonampleur l’équilibre d’un bassin d’emploi ; les entreprisesqui y recourent sont tenues de contribuer à lacréation d’activités et au développement des emploissur ce même bassin d’emploi en signant avec l’Etat uneconvention de revitalisation.Les entreprises qui font l’objet d’une procédure deredressement ou de liquidation judiciaire en sont exonérées.Le décret d’application date du 31 août 2005 et la circulaireDGEFP/DGTPE/DGE/DATAR a été diffuséele 12 décembre 2005.Cette convention est conclue entre l’entreprise et lePréfet de département, qui fixe un montant comprisentre 1 et 4 SMIC par emploi supprimé en plus desobligations liées au Plan de Sauvegarde de l’Emploi(PSE). A défaut d’un accord, il est procédé à une taxationd’office de l’entreprise, qui abonde ainsi le budgetde l’Etat. Cette négociation est théoriquement indépendantedu plan de sauvegarde de l’emploi, mais lespartenaires sociaux sont toujours extrêmement vigilantssur le maintien du lien entre la société et le territoire ; àce titre, ils demandent à participer au comité de suivide la convention. Celle-ci peut également prévoir desmesures liées au réemploi du site industriel.Par ce dispositif, l’Etat entend lutter contre la désindustrialisationet amortir le choc psychologique dulicenciement collectif par le maintien du lien entre l’entrepriseet le territoire. En participant aux efforts derevitalisation, une société mettant en œuvre un PSErépond également à des objectifs de gestion territorialedes emplois et des compétences par le financement deformations et la recréation d’emplois (notamment parun appui apporté aux créateurs d’entreprises).UNE APPROCHE PARTENARIALE ASSUM<strong>É</strong>ELe lien fort s’inscrivant dans le droit (et voulu par lesacteurs locaux) entre l’entreprise et le territoire a trouvésa limite dans les effets dévastateurs de la crise économiqueet financière qui a débuté en 2007.Face à une situation d’une ampleur inédite, l’Etat a proposéaux collectivités et aux partenaires sociaux unesolution de mutualisation dépassant la seule empreinteterritoriale de l’entreprise touchée par un PSE.Dans la méthodologie habituelle, la convention de revitalisations’applique à une zone géographique resserrée30R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
JACQUES GARAU© Bigot/ANDIA.fr« Néanmoins, le bassin d’emploi de Rennes a dû subir la baisse vertigineuse d’activité de la filière automobile, puisque l’usinePSA de La Janais est essentiellement tournée vers les véhicules haut de gamme ». Chaîne de montage de l’usine PSA de LaJanais.et touchée économiquement par la baisse d’activité oule départ de la société concernée. L’unité de compte estdonc la commune, la communauté de communes oud’agglomération, voire des cantons mitoyens. Au-delà,la légitimité des partenaires s’étiole, car les salariés sontattachés à retrouver un emploi préservant leur style devie et ne les obligeant pas à s’éloigner de leurs attachesfamiliales et amicales. L’entreprise missionne donc uncabinet spécialisé dans la revitalisation, dont la premièretâche est d’élaborer, en liaison avec le sous-préfet etles élus, un projet de territoire avant d’assurer une missionde prospection.Parallèlement, la cellule de reclassement organise lerecensement des compétences des salariés et met enplace des formations en adéquation avec les gisementsd’emplois. Il s’agit donc de fournir aux personnes unnouveau travail qui ne modifie pas trop l’équilibregénéral de leur vie, objectif qui est d’ailleurs la prioritédes syndicats de salariés. Les élus sont eux aussi particulièrementsensibles à l’avenir économique de leur territoireet à l’apport financier généré par les entreprisesindustrielles et de services dépendant de la société deplus de 1 000 salariés à l’origine du licenciement.L’expression de « plan de sauvegarde de l’emploi et derevitalisation » trouve ainsi pleinement son sens.Le département de l’Ille-et-Vilaine se caractérise parl’impact économique particulièrement fort du bassind’emploi de Rennes. La zone d’emploi couvre environles deux tiers du département, repoussant à ses limitesSaint-Malo, Vitré, Fougères et Redon. Elle a une population,en croissance constante, de plus de 650 000habitants, dont plus de 400 000 pour l’agglomérationde Rennes Métropole.Son dynamisme interne lui vaut un taux de chômageinférieur à celui de la Région et très en retrait par rapportà celui constaté au niveau national. Néanmoins,elle a dû subir la baisse vertigineuse d’activité de la filièreautomobile, puisque l’usine PSA de La Janais estessentiellement tournée vers les véhicules haut degamme. Cette filière est fortement concentrée autourde ce site, avec 130 établissements sur 237 et 71 % deseffectifs du secteur automobile.En 2007, le poids de la filière dans la sphère productiveétait de 18 % dans la Zone Economique deRennes, avec 16 850 salariés, et de 14 % dans celle,voisine, de Redon, avec 1 240 salariés. Entre 2007 et2011, il aura été mis fin à 3 489 contrats à duréeindéterminée (CDI) et à 1 500 emplois d’intérimaires,dans ce seul secteur d’activité, auxquels il faudraajouter environ 500 postes dans l’électronique etles technologies de l’information et de la communication(TIC). Cette situation entraînera, à terme, lamise en œuvre de vingt-et-une conventions de revitalisation.La préfecture de l’Ille-et-Vilaine a donc initié unedémarche de réflexion avec les partenaires sociaux, lesR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 31
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESchambres consulaires et les collectivités, afin de définirdes axes de travail dans trois domaines : a) l’accompagnementdes salariés touchés par les mutations économiques,des jeunes en insertion et des salariés en chômagepartiel, b) la formation professionnelle et, enfin,c) la revitalisation.Cette situation préoccupante a justifié une réponseorganisée au plan du département et de chacun descinq bassins d’emploi. Pour ce faire, le groupe de travaila proposé la création d’un partenariat en vue de larevitalisation des bassins d’emploi et des pays dudépartement, formalisé par la signature d’une conventioncadre à la déclinaison de laquelle ont été associésles représentants des collectivités territoriales, l’associationdes maires, les organismes consulaires et despartenaires sociaux membres de la commission paritaireinterprofessionnelle régionale (COPIRE). Cetteconvention cadre formalise l’accord des partenairessur une organisation départementale de préparation etde suivi des conventions de revitalisation, en cohérenceavec les stratégies de développement locales etdépartementales.Cette démarche transgressant les habitudes et les tabousdu lien entreprise/territoire se voulait cohérente avec lesbesoins identifiés à l’échelle départementale et complémentaired’autres dispositifs d’appui aux entreprises,comme le Fonds national de Revitalisation desTerritoires localisé sur l’arrondissement de Fougères etrespectueux de la zone d’attractivité sur l’emploi constituépar le bassin rennais au niveau départemental. Ilfaut rendre hommage à la hauteur de vues des élus etdes partenaires sociaux, qui a permis la réussite de ceprojet.Un dispositif innovantLa convention instaure entre les signataires, à compterdu 1 er juin 2009, un partenariat visant à rechercher, àsolliciter et à accompagner tout projet de création d’activitésou d’emplois de nature à participer à la revitalisationdes bassins d’emploi du département d’Ille-et-Vilaine.La mise en œuvre des actions retenues dans le cadre dece partenariat est une mission de service public confiéeà l’association Idea 35, sur la base d’une conventionspécifique conclue avec l’Etat. Idea 35, qui est uneagence de développement économique départementale,intervient en liaison avec les collectivités locales et lesacteurs locaux du développement économique. Lesfonds remis par les entreprises sont encaissés et décaisséspar l’Agence de Services et de Paiement dans lecadre d’une convention qui prévoit la gestion comptableet financière du FDR 35.Un ensemble de conventions régit les relations entre lespartenaires. Tout d’abord, une convention classique,signée entre l’Etat et l’entreprise assujettie à une obligationde revitalisation, dont l’unité territoriale de laDIRECCTE est maître d’œuvre pour le préfet de l’Illeet-Vilaine.Elle constate la volonté de l’entreprise departiciper à l’action mutualisée et en fixe les modalitéspratiques et la durée (de 36 mois).Une convention cadre établit le partenariat départementalà compter du 1 er juillet 2009. Elle définit lefonctionnement, les ressources disponibles, le pilotageet les actions éligibles, qui sont au nombre de six :• le soutien aux créations d’emplois proposées par desentreprises non encore implantées dans les bassinsd’emploi du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’auxcréations d’emplois issues de projets de développementet de création d’entreprises locales, prioritairement dansle secteur industriel et dans celui des services à l’industrie,afin de favoriser l’embauche de salariés licenciéspour motif économique par les entreprises adhérant audispositif partenarial ;• le soutien à la création d’emplois par l’insertion parl’activité économique ;• le soutien à des actions de prospection nouvelles favorisantl’installation de nouvelles entreprises sur les bassinsd’emploi du département de l’Ille-et-Vilaine ;• le développement des actions de promotion, d’accueilet d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises;• la GPEC territoriale ou les actions collectives permettantde contribuer, même indirectement, à la créationd’emplois ;• les projets structurant le territoire (plateformes,études de projets innovants…).Un règlement d’application précise les modalités pratiques(notamment les conditions d’éligibilité à chacunede ces actions).Une convention est conclue, entre l’associationIdea35 et l’Etat, sur le champ d’intervention et lesengagements mutuels, en particulier en termes d’informationsréciproques (cette mission est rémunérée àhauteur de 10 % des sommes collectées). Uneconvention lie également l’entreprise bénéficiaire àIdéa35, en particulier en matière de durée du maintiendes emplois, qui est au minimum de trois annéesaprès le versement de l’aide.L’Etat a également confié par convention l’exécution dela gestion financière du fonds à l’Agence de Service etde Paiement. Celle-ci est le payeur de l’aide aux porteursde projets validés par le comité d’engagement.Elle est chargée du recouvrement des aides indûmentversées, en cas de non respect de ses obligations parl’entreprise bénéficiaire (le tribunal administratif deRennes est compétent pour trancher les litiges éventuels).L’ASP reçoit une rémunération égale à 5 % dessommes collectées.L’avantage de cette solution réside dans sa robustesse,car elle fait uniquement appel à des opérateurs reconnussur le territoire, efficients et ayant l’habitude de collaborerpour un coût inférieur de moitié aux dispositifshabituels. Il n’y a donc pas de temps à consacrer àl’adaptation et à l’appropriation du territoire par lesacteurs locaux.32R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
UN PILOTAGE PRAGMATIQUE ADAPT<strong>É</strong>AU TERRAIN ET À LA CRISELes partenaires ont souhaité fédérer les acteurs économiqueset institutionnels tout en préservant une gestioncourante souple et pragmatique ; est conservé unniveau intermédiaire de conduite qui détient le pouvoirdécisionnel.Le comité d’engagement est la cheville ouvrière du dispositifpuisqu’il décide des projets à financer et déterminele montant des financements attribués, sur la basede dossiers présentés et instruits par Idea 35. Il se réunitgénéralement mensuellement.Ce comité, présidé par l’Etat, est composé :• des services compétents de l’Etat (Commissaire à laréindustrialisation, Unité Territoriale de la DirectionRégionale des Entreprises, de la Concurrence, de laConsommation, du Travail et de l’Emploi (UTDIRECCTE), Direction Générale des FinancesPubliques (DGFiP)),• des collectivités locales concernées (Conseil régional,Conseil général, communautés de communes oud’agglomération concernées par les dossiers des entreprisesayant adhéré au dispositif de revitalisationmutualisé),• de deux représentants des partenaires sociaux (unreprésentant des syndicats des salariés et un représentantdes organisations professionnelles d’employeurs)désignés par la commission paritaire interprofessionnellerégionale (COPIRE) parmi ses membres,• des représentants des entreprises signataires d’uneconvention de revitalisation.La réunion de ce comité d’engagement est une occasion,pour les partenaires, d’échanger sur le fonctionnementde la structure et de préciser les orientations àtravers l’étude de cas concrets. Le débat sur les projetsen présence des entreprises bénéficiaires renforce le lienau territoire voulu par les partenaires sociaux et permetaussi de rester au plus près de la réalité économique.Nous avons ainsi gardé la possibilité, offerte par laconvention, d’aider à la création d’emplois de servicedans des zones du département de l’Ille-et-Vilaine particulièrementdéfavorisées en raison de la sinistralité oude leur caractère rural particulièrement marqué.Jusqu’à maintenant, cela représente une dizaine d’emplois,sur 446 créés.Le comité de pilotage évalue l’action du fonds ; sa compositionlui permet de prendre des décisions d’orientationsur des propositions du comité d’engagement oudu comité de suivi, mais également d’un de sesmembres ou en réponse à une sollicitation particulière.Il a ainsi travaillé sur un courrier de l’Union desIndustries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM),qui faisait le point sur le choix des projets après sixmois de fonctionnement. Il comprend :• le Préfet (ou son représentant),• le Président du Conseil régional de Bretagne (ou sonreprésentant),• le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine (ouson représentant),• le Président de Rennes Métropole (ou son représentant),• la Présidente de l’Association des maires d’Ille-et-Vilaine (ou son représentant),• les Présidents des communautés de communes oud’agglomérations concernées par les dossiers des entreprisesayant adhéré au dispositif de revitalisationmutualisé.Il a, par exemple, autorisé la prise en charge, sur cefonds, du coût de la création d’emplois dans une entreprisequi a elle-même abondé le FDR35, mais il aremonté ce choix délicat à son niveau décisionnel.La vision stratégique est portée par le comité de suivi,qui réunit les principaux acteurs économiques autourdu Préfet et des élus, puisqu’il est composé :• des membres du Comité d’engagement,• de la Présidente de l’Association des maires d’Ille-et-Vilaine (ou de son représentant),• des Présidents des Maisons de l’Emploi ou, à défaut,des conseils de développement (ou de leurs représentants),• du Directeur territorial de Pôle Emploi (ou de sonreprésentant),• du Président de Force 5, représentant l’ensemble desacteurs consulaires d’Ille-et-Vilaine.Son rôle est d’éclairer les autres comités sur l’évolutionde la situation économique du territoire, afin de repositionnerle dispositif dans un contexte sans cesse mouvant.Il permet aussi une appropriation plus large etdavantage partagée des objectifs et des progrès accomplis.Il est toujours difficile d’évaluer l’effet d’aubaine d’untel dispositif : l’allocation d’une aide de 2 500 € paremploi peut apparaître de faible ampleur au regard ducoût global d’un projet industriel. En revanche, pourles TPE et les PME, le versement rapide des fonds leurpermet de consolider leurs fonds propres et d’améliorerleur capacité d’investissement. Il faut égalementprendre en compte le soutien apporté par l’agence dedéveloppement Idea35 au travers de ses autres métiers,que sont la recherche d’immobilier d’entreprise et lamise en relation avec les institutionnels. Ceux-ci, présentsau comité d’engagement, mettent également àdisposition leurs outils de financement, de formationet d’accompagnement des entreprises.DES R<strong>É</strong>SULTATS ATTEINTS EN RESPECTANTLES OBJECTIFS ET L’ESPRIT D’UN FONDSMUTUALIS<strong>É</strong>Le premier objectif était de convaincre les entreprisesde sortir du carcan des habitudes (surtout dans lesgrands groupes) à fin de confier la mission de revitalisationà des acteurs locaux. Ensuite, il s’agissait d’avoirune gestion souple des dossiers, dans la durée, sansJACQUES GARAUR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 33
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESGraphique 1 : Répartition des emplois soutenus par secteur d’activité.vouloir atteindre au plus vite les objectifs chiffrés derecréation d’emplois des conventions de revitalisationafin de pouvoir libérer les entreprises de leurs obligations,ce qui aurait été contraire à l’esprit de ce partenariat.Sur un potentiel de 21 PSE, 13 entreprises ont déjàsigné des conventions de revitalisation, dont 9 sontadhérentes, pour un montant total de 2 092 236 euros,deux nouvelles entreprises vont rejoindre le fonds (etseulement trois entreprises n’ont pas souhaité le faire)(voir le tableau ci-dessous).Montant total des contributionsMontant des contributions déjàverséesFonds dédiés aux projetsMontant attribuéMontant restantTableau 1.2 092 236 euros1 423 474 euros1 217 453 euros1 197320 euros20 133 eurosCes résultats très encourageants, obtenus entre octobre2009 et mai 2010, attestent de l’adhésion des entreprises,parmi lesquelles des groupes comme PSA ouMotorola justifient pourtant de dispositifs rodés delongue date en collaboration avec des cabinets de revitalisation.Certaines sociétés ont des PSE s’étalant surplusieurs années ; il était donc important de les fidéliserpour avoir un apport financier qui soit assuré dansla durée. Ainsi, la contribution de PSA est calculée surla base des 548 emplois supprimés en 2007, mais laprochaine contribution de ce groupe automobile prendraen compte les 1 750 emplois du PREC 2009.La priorité donnée à l’emploi industriel dans la conventioncadre constituait également un objectif prioritaire,d’ailleurs relayé par les collectivités et l’UIMM au seindes comités d’engagement. 70 % des emplois créés lesont dans des secteurs industriels ou de service auxentreprises (voir le graphique 1).Mais, il était également important de maintenir le lienavec les emplois supprimés, ou tout au moins avecleurs secteurs d’activité. En effet, Idea35 se doit demettre en relation les porteurs de projet avec les cellulesde reclassement, même s’il ne peut exister uneobligation, pour le chef d’entreprise, de recruter lesprofils sélectionnés par ces dernières. La premièreentreprise adhérente étant Motorola, le comité d’engagementa tenu compte, dans sa sélection, du typed’emploi proposé, afin d’offrir des possibilités dereclassement aux ingénieurs et aux techniciens de cegroupe. Néanmoins, pour maintenir un équilibre, larecréation de postes d’ouvriers a été augmentée, parrapport à leur proportion antérieure. Les emplois soutenussont à 41 % des emplois de cadres et à 38 % desemplois d’ouvriers et de techniciens (voir le graphique2).Graphique 2 : Répartition des emplois soutenus par CSP.34R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Les entreprises adhérentes ont licencié 540 personnes etle fonds mutualisé de revitalisation a soutenu la créationde 446 emplois entre octobre 2009 et mai 2010.Les 56 projets acceptés, dont 30 dans le bassin deRennes, pour un total de 269 emplois, représentent86 % des dossiers présentés et ont mobilisé 31 millions €d’investissement.DES OUTILS DE LA REVITALISATIONÀ LA CR<strong>É</strong>ATION D’UN R<strong>É</strong>SEAULes conventions de revitalisation sont un outil demobilisation du territoire qui donne accès à un réseaude compétences et de financements pour les porteursde projets. Ils doivent, pour cela, mener une démarchedans la durée, en étant appuyés par le gestionnaire dufonds, pour valoriser l’investissement en temps qu’ilsont consacré à une réflexion prospective sur leurs entreprises.Au-delà de l’effet d’aubaine, l’intervention du fondsmutualisé de revitalisation doit être l’occasion de fairede l’ingénierie financière afin d’obtenir un effet levierqui installe rapidement et de manière profitable l’entreprisesur son marché. En faisant intervenir de façonconcomitante le fonds mutualisé pour les aides à l’emploiet le Fonds National de Revitalisation desTerritoires comme appui à l’investissement (ce qui estpossible, sur l’arrondissement de Fougères), l’Etat créélocalement un véritable avantage compétitif propre àsoutenir la réindustrialisation d’une zone d’emploi encours de désertification. Par son action et sous l’impulsiondu sous-préfet territorialement compétent, il vise àfédérer les énergies autour d’une ambition partagée.L’expression de cette volonté politique ne sauraitaboutir favorablement si elle était déconnectée desréalités économiques. La présence d’acteurs institutionnelsreconnus rassure les investisseurs en amenantune véritable expertise, au travers d’OSEO,pour le FNRT, et des partenaires du fonds mutualisé,qui valide les dossiers en comité d’engagement. Ilimporte, pour le Commissaire à la réindustrialisation,de maintenir un équilibre entre l’effet d’entraînementpropre à l’action des élus, la pression despartenaires sociaux et la neutralité des services, quiont à prendre l’engagement financier. Les échangesavec Oseo et la Datar sur le FNRT, ou avec cette dernièreet le Cabinet du ministre de l’Industrie, établissentune « jurisprudence » éclairée par une visionplus horizontale.Enfin, l’intérêt d’avoir choisi un opérateur local(comme une agence de développement départementale)réside bien sûr dans la pertinence d’un telchoix, mais également dans sa durabilité sur le terrain.L’agence tisse ainsi un réseau informel qui assurenaturellement une fonction d’intelligence économiqueterritoriale. A la source d’informationsremontant des entreprises et descendant de l’Etat etdes collectivités locales, Idea35 a profondémentmodifié son mode de fonctionnement interne, afinde passer à un développement endogène. En effet, enpériode de crise, il est souvent illusoire d’espérerfaire venir de l’emploi industriel exogène, il fautdonc impérativement augmenter la compétitivitédes entreprises déjà installées. Le lien établi entre le« portefeuille de compétences territoriales » et le« portefeuille d’entreprises adhérentes » doit s’inscriredans la durée et être valorisé par des actions degestion territoriale des emplois et des compétences(GTEC) menées par la DIRECCTE afin d’offrir, surun territoire donné, aux salariés, des emplois tout aulong de leur carrière professionnelle et, aux entreprises,la richesse d’un panel de compétences.JACQUES GARAUR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 35
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESLa restructurationindustrielle dans la Valléede l’ArveAvec la crise de 2008, la Vallée de l’Arve, cœur de l’activité dedécolletage français, a vu une remise en cause de son modèle économiquebasé sur la croissance des volumes. La baisse de lademande est aujourd’hui durable.Espérer sortir de cette crise par le haut nécessite d’adopter uneapproche systémique, passant par la mise en place d’une largegamme d’actions traitant à la fois de questions d’ordre conjoncturel (commela question de l’accès au financement) et de sujets d’ordre structurel (ladiversification des offres sur la chaîne de valeur, la nécessité de développerdes synergies interentreprises opérationnelles et dépasser ainsi les individualismes,la redéfinition de la relation classique entre donneurs d’ordres etsous-traitants dans le sens d’une « coopétition »).par Gérard CASCINO*Située en Région Rhône-Alpes, l’Arve est une rivièreintra-alpine de la Haute-Savoie qui relie laVallée de Chamonix à Genève.La moyenne vallée de l’Arve, qui s’étend de Cluses àBonneville, constitue un territoire industriel caractérisépar une remarquable concentration de petites entreprisesspécialisées dans le décolletage et la mécanique deprécision.Dès le début du 18 e siècle, dans ce territoire marqué pardes hivers longs et rigoureux, l’introduction de l’horlogeriepermet aux agriculteurs de trouver une sourcecomplémentaire de revenus. Les ateliers se développenten tant que fournisseurs de l’industrie horlogère ; celleciva rapidement assurer la prospérité du territoire.Très tôt, l’aménagement hydroélectrique de l’Arve et deses affluents (la Roche-sur-Foron tire une certaine fiertéd’avoir été la première ville électrifiée en Europe) afait de ce pôle horloger le premier centre mondial dedécolletage.Le décolletage est une technique de la mécanique deprécision qui doit son nom au retrait mécanique demétal d’une pièce de faible diamètre, dans le but defaçonner le « collet » d’une vis.Jusqu’à la fin du 20 e siècle, la Vallée de l’Arve s’est adaptéeaux changements sans voir véritablement son développementindustriel entravé.Durant la Première guerre mondiale, la main-d’œuvrelocale est mobilisée dans l’industrie de l’armement pourla fabrication de têtes d’obus et d’instruments de pointage.Après le conflit, s’ouvrent de nouveaux marchésdans les secteurs de l’automobile, des matériels électriques,téléphoniques et radiophoniques.Après la Deuxième guerre mondiale, la croissance estparticulièrement forte pendant les TrenteGlorieuses, avec une diversification dans l’aviation,l’électroménager, la télévision et l’électronique.* Commissaire à la réindustrialisation.36R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
G<strong>É</strong>RARD CASCINO© François Henry/REA« La moyenne vallée de l’Arve, qui s’étend de Cluses à Bonneville, constitue un territoire industriel caractérisé par une remarquableconcentration de petites entreprises spécialisées dans le décolletage et la mécanique de précision ». Vue générale de lavallée de l’Arve en Haute-Savoie (région Rhône-Alpes).Les décolleteurs fournissent à leurs donneurs d’ordresune large gamme de produits complétant la fabricationde pièces métalliques et micromécaniques en grandesséries.L’automobile demeure néanmoins le principal débouchédu décolletage, loin devant l’électrotechnique.Ainsi, à la fin du 20 e siècle, sur une trentaine de kilomètres,de Sallanches (en amont) à la Roche-sur-Foron(à l’aval), la Vallée de l’Arve regroupe les trois quarts del’activité du décolletage français (environ mille entreprises,employant 12 000 personnes).La croissance des volumes produits et des chiffres d’affairesy est continue.Concentrant 10 000 des 12 000 salariés que comptel’industrie dans la vallée, les communes de Cluses,Scionzier, Thiez et Marnaz constituent le principal pôled’emploi.Jusqu’en 2007, le dynamisme économique ne s’est pasdémenti :• en termes d’activité : depuis la crise de 1993, la croissancedes volumes et des chiffres d’affaires est continueet on connaît des pics d’activité historiques, notammenten 2007 (avec + 30 %).• en termes d’emploi : avec moins de 5 %, le chômage,très sensiblement inférieur à la moyenne nationale, y estfrictionnel et le territoire connaît de réelles difficultésde recrutement, que la proximité de la Suisse accentue.LA CRISE DE 2008 : UNE CRISE PROFONDE QUIAFFECTE LE TERRITOIRE ET MET LES ENTREPRISESÀ L’<strong>É</strong>PREUVEComposante de l’économie concurrentielle, le décolletageest fortement dépendant de la dynamique macroéconomiquegénérale. Il est percuté par une profondecrise de la demande qui sévit dans les différentes filièresaval, principalement dans la filière automobile.Dès le printemps 2008, mais surtout depuis l’automne2008, la crise se traduit ainsi très concrètement par uneréduction sans précédent de l’activité. L’effondrementdes commandes est brutal et vertigineux (- 70 % enmoyenne). Il sévit à – 50 % (en moyenne) jusqu’en juin2009.Depuis l’été 2009, une amélioration est observée, quiramène les chiffres d’affaires à - 30 % en moyenne,mais la visibilité reste limitée à quelques semaines seulement.Face à cette situation sans précédent et dès les premièressemaines de la crise, les pouvoirs publics associés,notamment, aux partenaires bancaires initialisent unevigoureuse intervention visant, en premier lieu, à réduire«l’effet ciseau » qu’a cette crise sur la trésorerie desentreprises. Cette intervention s’accompagne d’un sou-R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 37
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIREStien à l’activité partielle de longue durée, qui se concrétiseavec l’opération « Former plutôt que licencier »mise en place à l’initiative de l’Etat et des organisationsprofessionnelles.Le volontarisme de ce plan d’action et l’importance desmoyens qui y sont consacrés (de l’ordre de 12 millionsd’euros pour l’opération « Former plutôt que licencier») permettent de limiter les défaillances d’entrepriseset de contenir les effets négatifs de la crise pourl’emploi (même si, sur 12 mois, le chômage a doublé).Cependant, cette crise que tout un chacun espérait decourte durée s’avère durable : son profil se distingue decelui des crises antérieures que la vallée avait déjà traverséespar le passé.A titre de comparaison, la crise de 1993 avait un profilen V : la baisse d’activité avait été importante, mais lareprise, qui ne s’était guère faite attendre, avait unepente aussi marquée que celle de la descente.Le profil de la crise actuelle est plutôt de type « racinecarrée » (√) : la chute a été profonde et la remontée(intervenue plus d’un an après les premiers signesannonciateurs) est « molle ».A l’heure actuelle, dans les différentes filières, le haut dela branche montante de cette « racine carrée » se situeentre – 25 et – 30 % par rapport aux années de référence.De plus, la marge d’incertitude est de l’ordre de + ou-10% autour de cette position.Dans l’hypothèse (qui ne peut définitivement être écartée)d’une variation à la baisse ramenant à nouveau leschiffres d’affaires à - 40 %, la situation deviendrait trèsdélicate.Dans l’hypothèse plus favorable d’une lente améliorationsituant les chiffres d’affaires à - 25 % ou - 20 %, lacrise serait « digérée », même si le visage de la vallée neserait plus le même, en sortie de crise…Dans ces conditions et aussi efficaces que les amortisseurséconomiques et sociaux aient été jusqu’ici, il estévident que ceux-ci ne sauraient devenir pérennes etque bien des menaces continuent à planer :• La large mobilisation des acteurs publics et des établissementsfinanciers a certes permis, dans un premiertemps, de limiter l’impact économique et social de lacrise, mais elle a aussi généré une dette, que les entreprisesdoivent désormais honorer, tandis que la reprisese dessine. Avec la fin des moratoires qui ont permis demaintenir les entreprises « hors de l’eau », on arrivedésormais à un moment charnière de la crise : on sait,en effet, que l’effet ciseau qu’une crise produit sur lestrésoreries des entreprises intervient à deux momentsclés : en premier lieu, lors de l’entrée en crise et, ensuite,dans la phase de sortie de crise, lorsqu’il devientnécessaire de financer le rebond.• Cet effet ciseau sera d’autant plus marqué, dans laVallée de l’Arve, du fait de la taille des entreprises (pourles trois quarts, des entreprises comptant moins de 20salariés).• La croissance des volumes constituait le moteur del’activité et la base du modèle économique sur lequelétait assise la prospérité de la vallée. Or, on sait désormaisque la baisse de la demande est durable : lesvolumes perdus au profit de pays low cost ne reviendrontpas de sitôt dans la vallée (pour autant qu’ils yreviennent, un jour…)UNE CRISE METTANT EN <strong>É</strong>VIDENCEDES HANDICAPS STRUCTURELS PORTANT SURLES TROIS DIMENSIONS MICRO<strong>É</strong>CONOMIQUESDE LA PERFORMANCE ET MENAÇANTLA P<strong>É</strong>RENNIT<strong>É</strong> DES ACTIVIT<strong>É</strong>SLa compétitivitéLa crise de la demande met en évidence l’essoufflementdu modèle économique régional dominant.Le bassin industriel de la Vallée de l’Arve est constituéd’excellents ateliers de production spécialisés dans lafourniture de pièces, dont la croissance était essentiellementtirée par les volumes et une stratégie de compressiondes coûts.Mais, sans en être la cause, la crise actuelle révèle leslimites d’une telle approche de la compétitivité quimet l’accent sur la dimension marchande de la performance:• avant la crise, le triptyque prix-qualité-délais suffisaità maintenir un avantage compétitif et à soutenir lacroissance ;• avec la crise, la concurrence des pays low cost montrecombien, pour aussi nécessaire qu’elle soit, cettecondition est désormais insuffisante.L’insuffisante diversification des activités et le positionnementdéfectueux des offres sur la chaîne devaleur sont des causes structurelles des difficultéscroissantes que connaissent les entreprises industriellesde la Haute-Savoie.Il est impératif que celles-ci puissent se libérer autantque possible du prix du marché en s’attachant, avectoute l’énergie requise, à :• développer la valeur de leurs productions ;• étoffer leur offre ;• optimiser leur organisation en produisant au plusjuste (lean manufacturing).Hier, les industriels de la vallée étaient des fabricantset des fournisseurs de pièces ; demain, ils seront desfournisseurs de sous-ensembles, ou ne seront plus : telparaît être le chemin incontournable sur lequel ils doiventimpérativement s’engager...Les entrepreneurs de la vallée ont des vertus cardinales: de tout temps, l’approche patrimoniale etindustrielle et l’esprit d’entreprise en ont fait la force.Mais leur faible taille et l’insuffisance criante descoopérations interentreprises résultant de l’individualismequi est aussi le leur, constituent désormais unfrein à leur développement. En est un autre la faible38R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
G<strong>É</strong>RARD CASCINO© Pascal Fayolle/SIPA« Le “chasser en meute” prôné par notre ministre de l’Economie n’est pas une posture courante, dans la Vallée de l’Arve : lesoffres industrielles y sont mal positionnées, mal segmentées, et elles manquent de notoriété à l’échelle d’un marché devenumondial ». Christine Lagarde animant une table ronde à la direction régionale d’OSEO, à Lyon le 15 octobre 2008.sensibilité collective tant à la question de la taille critiquenécessaire pour s’attaquer à des marchés mondialisésqu’à la dimension exogène de la performance.Le « chasser en meute » prôné par notre ministre del’Economie n’est pas une posture courante, dans laVallée de l’Arve : les offres industrielles y sont malpositionnées, mal segmentées, et elles manquent denotoriété à l’échelle d’un marché devenu mondial.L’absence de stratégie collective de développement, ledéficit de marketing et d’image territoriale constituentautant de freins au développement.Il est désormais nécessaire de développer des synergiesinterentreprises qui soient opérationnelles.La nécessaire montée en gamme des productionspasse par la mise en réseau des acteurs du territoire.La productivitéJusqu’à présent, les efforts de productivité des entreprisesportaient quasi exclusivement sur l’optimisationdes temps unitaires de production (intensité desséquences productives d’usinage) ; cette approche dela productivité était en cohérence avec la croissancecontinue des volumes.La baisse tendancielle des volumes oblige à penserautrement la politique d’investissements, en accordantune attention accrue à l’importance des innovationsimmatérielles : il existe, en effet, de véritablesgisements de productivité au cœur des organisations,qui demeurent inexploités faute d’accorder toute l’attentionnécessaire aux « temps connexes » encadrantles séquences directement productives.La rentabilité (la dimension financièrede la performance)Durant les Trente Glorieuses, les courbes des chiffresd’affaires et de la valeur ajoutée connaissaient des évolutionsparallèles. Depuis quelques années, la haussedes chiffres d’affaires ne s’accompagnait plus d’uneévolution, proportionnelle, de la valeur ajoutée.Sans en avoir véritablement conscience, les entreprisesde la vallée érodaient leur profitabilité, mais la haussecontinue des volumes masquait cet état de fait (lesgains en valeur relative masquant les effets en valeurabsolue).La crise a produit un véritable séisme sur la rentabilitédes entreprises et ses conséquences sont palpables :l’investissement a reculé de 30 % au cours des douzederniers mois. Or, faute d’une réelle culture financièreet de la gestion, les PME/TPE de la vallée, quiconstituent l’essentiel de son tissu économique, s’avè-R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 39
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESrent majoritairement incapables de prendre la mesurede l’impact de la crise en termes d’exploitation etd’évolution des postes du bilan financier des entreprises.L’enjeu est donc de changer de posture de gestion : ilconvient de dépasser le simple regard sur l’historiqued’exploitation, qui était de mise jusqu’ici, et de s’engagerrésolument dans un pilotage prévisionnel par le« cash ».UN ENJEU PR<strong>É</strong>GNANT EN MATIÈREDE RESSOURCES HUMAINES : LA N<strong>É</strong>CESSIT<strong>É</strong>DE « MANAGER PAR LES COMP<strong>É</strong>TENCES »En raison de la proximité de la Suisse, les activités dudécolletage et des métiers connexes ont connu, par lepassé, de sérieuses difficultés de recrutement. Celles-ciresurgiront à la première embellie et elles iront croissant,au fur et à mesure que la reprise s’affirmera.Ces difficultés de recrutement sont de nature à menacerle rebond économique et le développement futurde la vallée. En effet, admettre l’hypothèse d’un indispensablechangement de modèle économique (tournédésormais vers la montée en gamme des productionset la fourniture de sous-ensembles à haute valeurd’usage), c’est admettre également, de facto, l’importancestratégique des savoir-faire et des compétences.Dans un contexte d’efficacité croissante des paysémergents, les entreprises sont soumises à un niveaude concurrence encore jamais atteint.Au-delà de la valorisation comptable, la valeur d’uneentreprise ne repose plus seulement sur la qualité deses équipements, mais est constituée d’une série d’actifsimmatériels, qui en constituent le patrimoine réel.Les savoir-faire, assis sur les compétences, sont un élémentessentiel de ce capital immatériel. Il convient deles préserver et de les valoriser : plus les salariés sontmis en mesure de valoriser leur potentiel, plus l’entrepriseest performante.Dans une économie de la fonctionnalité, en cours dedéveloppement, qui va tendre à étalonner les entreprisessur de nouveaux déterminants, la prise encompte des compétences est un élément essentiel de lacompétitivité et du développement de l’excellenceindustrielle.Cela suppose de stimuler l’innovation managérialecomme un élément clé de la performance et de promouvoirdes stratégies d’entreprise qui soient porteusesd’un « management par les compétences ».Par ailleurs, l’enjeu est également de stimuler la mobilitédes salariés les moins qualifiés, dans une perspectivede sécurisation des parcours, en donnant unedimension territoriale à l’approche « ressourceshumaines ».Pour l’heure, cette dimension fait cruellementdéfaut…L’IMP<strong>É</strong>RIEUSE N<strong>É</strong>CESSIT<strong>É</strong> DE SUBSTITUERÀ LA RELATION CLASSIQUE ENTRE DONNEURSD’ORDRES ET SOUS-TRAITANTS, UNE STRAT<strong>É</strong>GIECLIENTS-FOURNISSEURS « GAGNANT/GAGNANT »Dans les différentes filières faisant appel au décolletage,la relation clients-fournisseurs reste marquée parun profond déséquilibre entre, d’un côté, les « donneursd’ordres » et, de l’autre, leurs « sous-traitants ».Les donneurs d’ordres maintiennent une forte pression« coûts » (et, par voie de conséquence, « prix »)sur leurs fournisseurs, vis-à-vis desquels ils exercentune véritable « tyrannie de l’achat ».Telle qu’elle s’organise actuellement, la fonction Achatse caractérise par une approche essentiellement financièrequi, méconnaissant dans une certaine mesure lesmétiers et les techniques, ne parvient plus à évaluer àleur juste mesure les offres des fournisseurs.Pendant la crise, les donneurs d’ordres ont fait jouer àleurs fournisseurs le rôle de « variable d’ajustement ».Leur politique d’outsourcing hors de l’Hexagone (dansles différentes filières) est d’autant plus contestablequ’elle intervient à un moment où les donneursd’ordres allemands accordent, quant à eux, une préférenceà leurs propres producteurs.Cantonnée à une vision partielle et non globale du« coût » et ne permettant pas d’apprécier la compétitivitévéritable des offres, cette vision de l’achat estcontestable tant sur le plan économique qu’éthique.Dans les différentes filières, le sous-traitant ne disposeque rarement d’une visibilité pourtant indispensable; la réintégration brutale de productions et ledésengagement des donneurs d’ordres interviennent,le plus souvent, sans délai de prévenance. Elle augmentele risque, pour des fournisseurs en situation dedépendance marquée et déjà affaiblis par la criseCette situation de fait, qui relève d’une stratégie decourt terme, constitue un frein au progrès et aux processusd’innovation.Elle ne permet pas d’anticiper les enjeux de croissanceet de développement durable, qui sont les leviers durebond économique et les instruments de sortie decrise.La modernisation des rapports de sous-traitance dansle sens d’une « coopétition » constitue donc unenécessité économique.Dans les différentes filières, il est essentiel de ré-humaniserles rapports entre acteurs économiques :• chez les donneurs d’ordres, cette ré-humanisationpasse par la prise de conscience du caractère stratégiquede leurs fournisseurs ;• chez les sous-traitants, elle nécessite une prise deconscience des limites d’une hyperspécialisation techniquepar sous-segments de produits, ainsi que de lanécessité, qui est la leur, d’accroître leur excellence40R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
opérationnelle et leur acheminement vers une taillecritique.Des constats à l’action : les principales pistesde travail en vue d’une revitalisation durablede la Vallée de l’ArveEspérer sortir par le haut de la situation précédemmentdécrite nécessite une approche systémique passantpar la mise en place d’une large gamme d’actions.Il importe, en effet, de travailler simultanément lesquestions d’ordre conjoncturel (portant, pour l’essentiel,sur la question de l’accès au financement) et lessujets d’ordre structurel (portant sur le développementstratégique destiné à accompagner l’indispensablechangement de modèle économique).En ce qui concerne les aspects conjoncturels, l’enjeuactuel et d’un futur proche est de favoriser l’accès aufinancement des entreprises à fort potentiel. Pourcela, le Commissaire à la réindustrialisation propose lacréation d’un Fonds d’Intervention en Entreprises(FIE) permettant de traiter la question de la souscapitalisationdes PME/TPE de la vallée, qui constitueun lourd handicap pour le développement desentreprises à potentiel.En effet, la crise a mis en exergue la nécessité d’accroîtreles fonds propres pour mener à bien les projetsde développement.Or, les outils d’intervention existants (le FondsStratégique d’Investissement – FSI – et ses dérivés) neprennent pas véritablement en compte, localement,les besoins des PME/TPE, qui doivent être soutenuespar des fonds « patients ».Ils laissent pour compte des entreprises à fort potentielqui, sans être nécessairement high tech, n’en sontpas moins stratégiques, à l’échelle d’un territoire.La question des sorties de moratoires est, en effet, undomaine « brûlant ». L’enjeu est de permettre auxPME de transformer une partie de leur dette à moyenterme en obligations convertibles, afin de leur permettrede retrouver une capacité d’autofinancement(CAF) suffisante pour lever de nouveaux crédits productifs.Dans une perspective opérationnelle permettant deconcentrer plus facilement les énergies et les volontés,et même si la constitution d’un fonds à l’échelle de larégion aurait davantage de sens, l’idée est de circonscrirele périmètre de ce fonds au département de laHaute-Savoie.Le tour de table à organiser doit satisfaire à une indispensablemixité de contributeurs privés et publics etnécessite d’inviter toutes les banques actives de laplace, les syndicats professionnels représentatifs, leConseil général, le Conseil régional, OSEO, la Caissedes dépôts, des entreprises privées de taille nationale,des business angels…Il nécessite de rester attentif à la posture des banques,qui ne devront pas se servir de telles possibilités pourgérer quelque forme de désengagement que ce soit.Une pareille démarche fait le lien avec une réflexionplus vaste intégrant la question de la relation entredonneurs d’ordres et sous-traitants : l’enjeu est, eneffet, d’obtenir un engagement de la part des donneursd’ordres (celui-ci serait lourd de symboles etaugurerait d’une nouvelle relation avec les sous-traitants…)Face à un tour de table aussi vaste, se posent nécessairementles questions de la gouvernance, du circuit dedécision, du cadre de gestion, de la mise en formed’une plateforme de coordination du financement etd’un comité « restreint » de crédit, qui sont autant dequestions essentielles, à traiter dès l’amont.L’ingénierie d’un tel fonds passe également par uneréflexion sur les conditions de sa mise en œuvre, quipourrait être facilitée par l’organisation d’un réseau de« facilitateurs-accompagnants ».A cette fin, l’organisation consubstantielle d’une offred’appui-conseil intra-entreprise, sous la forme de diagnosticséconomiques et financiers reliant les voletsstratégiques et opérationnels, nous paraît indispensable.S’agissant des aspects structurels, l’enjeu est de stimuleret d’accompagner le changement de modèleéconomique auquel la Vallée est confrontée.Pour cela, il importe de :• développer le pilotage stratégique et financier desentreprises ;• stimuler et soutenir une approche dynamique de lacompétitivité en développant l’innovation-produit, endiversifiant l’offre et en accroissant la valeur d’usagedes productions ;• développer l’efficacité productive en améliorant laproductivité des temps « connexes ».Il ressort de ces objectifs une série d’actions coordonnéeset concrètes à conduire en Vallée de l’Arve,notamment :• organiser un programme interentreprises de sensibilisationaux nouveaux enjeux de compétitivité et deproductivité, stimuler et accompagner la mise enmouvement des chefs d’entreprises ;• soutenir des actions intra-entreprises de diagnostic(financier, marketing, production, achats, managementet organisation) et d’accompagnement favorisantl’acquisition d’une culture managériale dans lesPME/TPE ;• soutenir des actions intra-entreprises de refonte desprocessus : la stimulation et l’accompagnement dumanagement et le lean manufacturing ;• soutenir l’introduction de technologies plug and playmanufacturing (rupture technologique consistant enl’usage d’équipements de production totalementrepensés, miniaturisés et adaptés en priorité auxpetites et moyennes séries), qui soient cohérentes avecle développement d’une stratégie de marge ;G<strong>É</strong>RARD CASCINOR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 41
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES• initier des partenariats interentreprises multiformes(commercial, technologique, financier, opérationnel)et juridiquement variés (portage, création de structurescommunes) ;• favoriser les rapprochements entre dirigeants d’entreprisesexistantes ;• mettre à profit le « papy boom » des dirigeants etorganiser une politique active en faveur de la transmissionet de la reprise d’entreprises dans des conditionséconomiquement acceptables ;• développer la compétitivité et l’attractivité du territoirepar la mise en place d’un projet productif « macroentreprise» stimulant l’interaction des entreprises ;• stimuler, soutenir et contribuer à une démarche stratégiqueet prospective territoriale et de filières ;• enfin, stimuler le dialogue social territorial.42R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
La reconversion – réussie –d’une entreprise franccomtoisedans l’éolienAprès moult péripéties (rachats successifs, mise en liquidation judiciaire…),la Franc-Comtoise Industrie (Lons-le-Saunier – Jura) estreprise, le 19 février 2010, par le fabricant d’éoliennes Alizeo envue de lui confier la fabrication des soubassements d’éoliennesrabattables. C’est un nouveau défi à relever pour les salariés del’entreprise de Lons-le-Saunier qui, cinquante ans après, vont continuerà vivre l’aventure de la production d’énergie, mais cette foisci,au travers de l’énergie éolienne, après des années d’expérienceacquises dans le nucléaire, la chimie et la pétrochimie.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar Gilles CASSOTTI*LE CONTEXTE HISTORIQUE ET G<strong>É</strong>OGRAPHIQUELons-le-Saunier, capitale du département du Jura, qualifiéeà juste titre de « Cité Verte », occupe une positiongéographique privilégiée au cœur du Jura. C’est uneville de passage, mais c’est aussi un lieu de villégiatureparticulièrement apprécié. L’activité économiqueautour du sel domine toute l’histoire de Lons-le-Saunier, qui lui doit d’ailleurs son nom gallo-romain deLedo Salinarius signifiant « la ville du sel ». Le thermalisme,hérité des Romains, est une des activités économiquesles plus anciennes de la ville. Le sel est doublementprésent à Lons-le-Saunier, au travers de cettetradition thermale ancestrale et, dès le 17 e siècle, au traversde la production de sel (qui ne cessera qu’en 1966).L’activité jurassienne se caractérise par sa diversité etl’excellence dans de nombreux domaines (agriculture,industrie, artisanat). La présence de hautes technologiesau cœur même de petites entreprises est le fruit d’unpassé où, nichés au cœur du massif jurassien, les ingénieuxhabitants cultivaient l’innovation avant l’heure.La réactivité et la créativité sont deux qualités de cedépartement à fort potentiel industriel, dans un environnementmajoritairement rural.Le Jura se positionne « vers le haut » au travers de sonagriculture et de ses Appellations d’Origines Contrôlées(AOC) : fromages, vins, élevage…, de son industrieagroalimentaire (Henri Maire, Lactalis, Groupe Bel), deses leaders dans l’industrie du jouet (Smoby) ou de lalunetterie et, enfin de son artisanat, avec les tourneurstabletiers ou les fabricants de pipes. Chaque villagecompte une activité industrielle ou artisanale, qui recèledes trésors de technicité, de savoir-faire et d’ingéniosité.Le squelette industriel jurassien repose sur la mise envaleur, dès la plus haute Antiquité, des éléments présentssur le territoire : le sel, le bois, le minerai de fer etl’eau (en tant que force motrice).De façon complémentaire, le Jura a été un berceau historiquede la communautarisation du travail et de laproduction qui perdure de nos jours, notamment autravers de coopératives agricoles.* Commissaire à la réindustrialisation en Franche-Comté.gilles.cassotti@franche-comte.pref.gouv.frR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 43
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESImplantation en 1964Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’exploitation du selait donné naissance à une grande entreprise (Solvay), àce qu’une petite fromagerie née à Villards-d’Héria soitdevenue le grand groupe fromager Bel ou à ce que desartisans travaillant la corne et le bois, en s’associant,aient donné naissance à Smoby ou à ce que la clouterieait donné naissance à la lunetterie.C’est en 1964, qu’est créée la Chaudronnerie Franc-Comtoise, à la sortie de la ville de Lons-le-Saunier, cela,bien avant la création d’une Zone Industrielle. Avec uneffectif d’environ 50 personnes, la société réalisera desouvrages de chaudronnerie traditionnelle, comme deschaudières de chauffage central et diverses cuves decapacité moyenne (voir les photos 1 et 2).En 1969, l’entreprise est rachetée par la société franccomtoisePecquet-Tesson qui possède deux autres unitésen France, ainsi qu’une unité en Espagne et uneunité au Mexique. Le nouveau propriétaire complète laproduction en développant la fabrication de condenseursde vapeur destinés aux centrales électriquesd’EDF. L’ère nucléaire va donner un essor fulgurant àl’entreprise, qui voit ses surfaces doubler et ses effectifsatteindre rapidement le nombre de 200 employés. Acette époque, le rayonnement et le savoir-faire industrielde cette société se confondent avec la ville ellemême.La société est cédée, en 1990, à son concurrent, MAN-DWE, et devient la Franc-Comtoise Industrie (FCI).En quelques années, son effectif diminue, passant de180 personnes à une centaine.Son expérience et son savoir-faire restent néanmoinsintacts, ce qui lui permet de concevoir et de réaliser desappareils pouvant peser jusqu’à 300 tonnes. Mais laville de Lons-le-Saunier ne disposant pas de voie navigableà proximité et la législation en matière de transportexceptionnel se durcissant, la société se voitcontrainte de réduire à 200 tonnes le tonnage de sesconvois exceptionnels. Si la plus-value technologiquereste importante dans les affaires réalisées, cescontraintes affaiblissent le site lédonien, en concurrenceavec d’autres unités de son actionnaire, qui décide,Implantation actuellePhotos 1 et 2 : L’usine de la Chaudronnerie Franc-Comtoise en 1964 et aujourd’hui.fin 2005, de fermer sa filiale franc-comtoise. Il n’y restealors pas plus de 55 personnes.Après une mobilisation des salariés et des élus locaux,l’activité est cédée au groupe Seagull Industries, quipossède deux autres unités de chaudronnerie en France.Mais ses réalisations sont essentiellement mono-clientet, très rapidement, de nouvelles difficultés financièresse font sentir. L’effectif passe à 46 salariés et l’entrepriseest mise en redressement judiciaire en juin 2008.Une mobilisation collective permet une nouvelle reprise(en octobre 2008) par le groupe Socom Metallurgy,qui possède sept unités (dont une en Belgique). Maisles effets de la crise économique et financière ne permettentpas à cette société d’être viable, ni même depouvoir attendre une reprise économique. En l’espacede six mois, l’entreprise n’enregistre aucune commandeet, fin 2009, elle ne dispose d’aucune visibilité pour lepremier semestre 2010. Ses actionnaires, soucieux deprotéger le reste de leur groupe, préfèrent déposer lebilan en janvier 2010 et sollicitent une mise en liquidationjudiciaire immédiate.Aux côtés du Député Maire et des salariés, les servicesde l’Etat, au travers d’une double mobilisation de laPréfète du Jura et du Commissaire à la réindustrialisation,ont identifié plusieurs pistes de reprise, allant del’adossement à un groupe d’envergure nationale à lafusion avec un groupe interrégional spécialisé dans desdomaines connexes. Les recherches doivent aller vite :en effet, le tribunal de commerce de Lons-le-Sauniern’a accordé qu’un délai d’un mois à l’entreprise pouridentifier des pistes d’éventuelles reprises industrielles.Tout en orientant ses recherches en direction de sociétésayant une activité similaire à celle de FCI, leCommissaire à la réindustrialisation est informé qu’unesociété produisant des éoliennes a interrogé les serviceséconomiques du Territoire de Belfort, dans le cadred’une recherche de locaux industriels. Le Territoire deBelfort est un bassin d’emploi industriel par excellence ;les mutations du secteur énergétique, qui se sont produitesen 2000 et en 2003, ont permis la création d’undes plus grands parcs industriels de l’Est de la France,44R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
GILLES CASSOTTIPhoto 3 : Un soubassement d’éoliennedont la fabrication est prévue à Lonsle-Saunier(photo ALIZEO).Techn’hom (avec 500 000 m 2 de bâtiments industrielset de bureaux, sur près de 100 hectares, soit 5 % de lasuperficie de la ville, en plein cœur du tissu urbain –http://www.technhom.com/), mais ces mutations ontaussi laissé quelques surfaces susceptibles d’être mobiliséesen faveur de projets industriels « hors normes ».L’offre belfortaine ne convenant pas aux intéressés, leCommissaire à la réindustrialisation prend alors l’initiativede leur proposer, en fonction de leurs exigencesimmobilières et techniques, une visite des locaux deLons-le-Saunier, des locaux qui ont pour particularitéd’être occupés par des salariés dont les compétences etle savoir-faire se conjuguent bien avec les besoins decette société en la matière.Après une première visite du site en présence du personnelmobilisé en faveur d’une reprise industrielle, ils’est rapidement avéré que l’offre et les besoins étaientcompatibles sur nombre de points. Une seconde visite,davantage technique, permet ensuite de valider les fondamentauxindustriels nécessaires aux fabrications souhaitéeset c’est sur ces bases qu’une offre de reprise estalors faite.S’il aura été nécessaire (en partenariat avec les collectivitéslocales et sous l’égide des services de l’Etat dans ledépartement et du Commissaire à la réindustrialisation)de mettre rapidement en place une ingénierie permettantau fabricant d’éoliennes Alizeo de reprendrel’immobilier à la Société d’Economie Mixte régionaleou encore de ne pas supporter la totalité de la massesalariale pendant les deux premiers mois d’exercice,grâce à une mobilisation du dispositif du chômage partielde longue durée (sur un laps de temps suffisantpour rendre le site totalement opérationnel au regard deses nouvelles attributions), la mobilisation générale auxcôtés d’Alizeo et des représentants du personnel permetla reprise de la société FCI, à la barre du tribunal decommerce, le 19 février 2010.Trente-cinq des quarante-cinq salariés sont ainsi repris,lesquels vont continuer l’aventure industrielle commencéeil y a voici près de cinquante ans. La conjugaisondes savoir-faire des salariés, dont certains justifientde vingt à vingt-cinq ans d’ancienneté, et des installationstechniques (qu’il conviendra d’adapter et demoderniser) a permis de répondre aux besoins d’Alizeo,qui compte développer sur place une unité de productiondes soubassements de ses futures éoliennes (voir laphoto 3). Cette pièce technique est la partie centrale etstratégique du savoir-faire différenciateur du produitAlizeo : elle permet, en moins d’une heure, de coucherà l’horizontale une éolienne pesant près de cent tonnes !C’est un nouveau défi à relever pour les salariés del’aventure industrielle à Lons-le-Saunier qui, cinquanteans après, vont continuer à vivre l’aventure de la productiond’énergie, mais cette fois-ci, au travers del’énergie éolienne, après des années d’expérienceacquises dans le nucléaire, la chimie et la pétrochimie.C’est là certainement un signe du destin, pour une villequi fut l’une des toutes premières à pratiquer le trisélectif de ses déchets et à s’équiper d’un incinérateurd’ordures ménagères avec traitement des fumées…dont le réacteur fut d’ailleurs construit dans les locauxde l’entreprise qui nous occupe ici.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 45
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESAlizeo voit le jour en mars 2007 ; elle a pour ambitionde devenir un acteur incontournable sur le marché, enplein essor, de la production d’électricité d’origineéolienne.C’est en 2005 que Richard Lavaur (Docteur Ingénieuren automatique) et Jean-Christophe Bonté (ESCOption finances, puis avocat au Barreau de Paris) engagentleurs premières réflexions autour des problématiquesdu développement durable, de la protection del’environnement et de l’optimisation des forcesmotrices éoliennes.Conscients des enjeux majeurs auxquels va êtreconfrontée notre planète en matière de besoins énergétiquestout en veillant à préserver sa pérennité environnementale,et partant du constat que les pays développésproduisent une partie de leur énergie propre autravers de l’éolien, alors que les régions tropicales ensont pratiquement dépourvues du fait de la puissancedes cyclones et des vents extrêmes qui balayent ceszones, les deux créateurs de l’entreprise décident dedévelopper une offre à l’attention de ces pays, tout enprotégeant les éoliennes contre les risques inhérents auxcyclones.C’est à partir du principe des grues portuaires que desétudes sont menées, qui permettent de déposer des brevetsautour d’une éolienne rabattable anticyclonique àcontrepoids. Trois brevets, propriétés d’Alizeo, sontainsi déposés, tous concernent le principe de basculement.En parallèle, des contacts sont noués avec Areva-JSPM, laquelle, par stratégie interne, cherche à céderl’exploitation de licences pour ses génératrices J48d’une puissance de 800 kilowatts.Opérateur complet du secteur éolien, Alizeo sera à lafois un fabricant d’éoliennes rabattables, de génératricessynchrones sous licence exclusive mondiale Areva-JSPM, un gestionnaire de parc éolien et un producteurd’énergie.Richard Lavaur et Jean-Christophe Bonté créent Alizeoen mars 2007 avec un capital social de 100 000 euros.Ils sont très vite rejoints par deux fonds d’investissementprivés. A ce jour, le capital social de la société estd’un million d’euros, ses fonds propres de 7 millionsd’euros et ils devraient dépasser les 20 millions d’eurosavant la fin de l’année (2010).Afin de valider industriellement l’innovation et d’enoptimiser certains points techniques, un prototype a étéconstruit avec le soutien d’Oseo Languedoc-Roussillonvia une avance remboursable de 1 million d’euros (soit20 % du coût total). Le soubassement a été fabriqué enEspagne, les autres modules de l’éolienne provenant defournisseurs traditionnels de la filière. Le prototype aété ajusté, élevé et mis au point à Rivesaltes (dans ledépartement des Pyrénées Orientales) ; il a été officiellementinauguré au début de l’année (2010).L’éolienne Alizeo présente la particularité de pouvoir secoucher et se relever en moins d’une heure grâce à unvérin hydraulique de plus de 500 tonnes assisté decontrepoids. Les mouvements de basculement sontcommandés, tout simplement, en appuyant sur unbouton. Les manœuvres peuvent être effectuées avecdes vents établis de 100 km/h, quelle qu’en soit la directionet, dans certaines conditions, la composante«vent » a pour effet de redoubler les efforts nécessaires,dus au seul poids de la machine.La partie basse de l’éolienne, appelée « basculeur », alliela puissance de l’hydraulique à un système mécanique.Un châssis d’ancrage, fixe, retransmet les efforts au terrain.Avec son emprise au sol de moins de 200 m 2 et de2 mètres d’épaisseur, le génie civil est totalementdémantelable. L’ensemble supporte un mât de 50mètres de hauteur.Cette éolienne résiste aux vents établis les plus forts :150 km/h en position verticale et 250 km/h en positionhorizontale, avec des pointes pouvant atteindre les 270km/h.Au-delà des avantages liés à son utilisation dans deszones sujettes aux cyclones, cette technologie permet deprocéder à la maintenance de la génératrice dans desconditions moins périlleuses que pour les éoliennes traditionnelles.Enfin, au-delà du surcoût lié au principede basculement, qu’il conviendra d’évaluer dans chaquecas précis d’implantation, la possibilité de coucher l’éolienneà tout moment pourrait également être un facteurde développement y compris en zone non cyclonique,notamment dans les cas où un projetd’implantation de champs éoliens soulève des protestationsaxées autour de la dégradation visuelle du paysage.Grâce au système de basculement, pendant lespériodes de vent trop faible pour utiliser le générateur,le paysage peut retrouver son aspect d’origine, leséoliennes couchées au sol étant souvent cachées par lavégétation environnante.Pour ces applications de « préservation du visuel »,Alizeo envisage d’amortir le surcoût de son système debasculement grâce à une forte augmentation du productibled’électricité au travers de l’équipement de sonéolienne au moyen de pales surdimensionnées. Eneffet, les éoliennes fixes installées à ce jour en zone noncyclonique sont limitées sur ce point, du fait qu’ellesdoivent résister à des vents de 180 km/h qui n’y sontque très ponctuellement relevés. N’étant pas soumise àcette contrainte, l’éolienne Alizeo pourra donc compenserson surcoût de fabrication par une capacité deproduction électrique plus importante (voir les photos4 ci-après).Si le savoir-faire différenciateur d’Alizeo réside dansl’innovation rendant possible le basculement en toutesécurité de l’éolienne, la partie haute de celle-ci, l’aérogénérateur,reste une machine classique, standard etéprouvée, d’une puissance de 1 000 KW, construitesous licence Areva-JSPM. A l’origine, l’entrepriseenvisageait de se fournir auprès de grands constructeursétrangers (comme Enercon, en Allemagne), maisles délais de livraison incompressibles de 36 mois sesont avérés incompatibles avec la démarche commercialed’Alizeo. C’est la raison pour laquelle, en complémentde la fabrication d’un soubassement innovant,Softwind, une filiale d’Alizeo, construira très46R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Photos 4.GILLES CASSOTTISources : ALIZEO.Sources : ALIZEO.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 47
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESPhoto 5 : Eolienne Vergnet GEV HP 1 MW (Source :Vergnet).prochainement des génératrices synchrones à attaquedirecte, qui seront à la fois adaptées au mât rabattableAlizeo et aux éoliennes fixes traditionnelles.L’implantation de cette activité, qui générera entre100 et 150 emplois, est activement recherchée parSoftwind. Elle nécessite des installations immobilièreset techniques spécifiques (ponts roulants de 8 mètressous crochets, d’une capacité de 2 fois 25 tonnes, avecune résistance au sol de 5t/m 2 ). L’usine sera implantéeen France.Alizeo est un des acteurs innovants du secteur de l’éolien.Notons qu’il existait déjà, depuis 2001, une solutionéolienne pour les zones cycloniques, au travers del’offre de la société Vergnet. Le Groupe Vergnet est uneréférence en matière de solutions d’adduction d’eaupour zones rurales en développement et a fourni et installé,à ce jour, plus de 500 éoliennes dans le mondeentier, qui produisent chaque année plus de 150 000MW d’électricité verte. Vergnet s’est orienté, dès 2001,vers une offre permettant la création d’énergie éoliennede petite puissance (80 KW, puis 275 KW) grâce à satechnologie originale d’éoliennes bipales rabattables encas d’alerte cyclonique et ce, grâce à un système detreuil et de poulies. La dernière née de la société, laGEV HP 1 MW permet à la société d’atteindre lespuissances de référence pour le marché actuel. Dans lecas de cette nouvelle éolienne, le mat reste en positionverticale et seuls le multiplicateur de vitesse et les palessont abaissés au niveau du sol.Mais les points communs avec l’offre d’Alizeo se limitentà l’objectif de fournir au marché une solutionindustrielle d’éoliennes rabattables, car les philosophiesdes deux sociétés françaises et les technologies utiliséesrestent diamétralement opposées.Vergnet utilise un système de treuils et de haubans pourdescendre ses génératrices tout en laissant le mat à laverticale, alors qu’Alizeo couche l’ensemble à troismètres du sol, à l’horizontale. Les deux entreprises nepartagent pas non plus la même philosophie tant en cequi concerne le nombre de pales (deux, pour Vergnet,contre trois pour Alizeo) que le type de génératrice :Vergnet privilégie la technologie asynchrone avec multiplicateur,alors qu’Alizeo conforte la technologieAreva avec un dispositif synchrone à attaque directe età aimants permanents. Au-delà des performances et dela fiabilité qui peuvent être mises en avant, le nombrede pales et la présence ou non de multiplicateur sonttous deux des facteurs importants de génération debruit à proximité des éoliennes (voir la photo 5).48R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Les possibilitésde diversification : le casd’un site papetier françaisL’ensemble de la filière papetière française est soumis, à la fois, àdes mutations technologiques importantes et à une forte concurrencemondiale, conduisant les sites français à se restructurer pouraméliorer leur compétitivité et à s’inscrire dans une logique dediversification industrielle.Au travers du cas concret du site papetier d’Alizay se dessinent lesopportunités de l’adoption d’une nouvelle stratégie estampillée«chimie verte » : la production de biocarburants à partir des fibrescellulosiques du bois (filière bioéthanol de deuxième génération) etla fabrication de pâte à usage chimique (production de viscose à partir de lacellulose du bois).Cette réorientation stratégique est parfaitement compatible avec le maintien,voire le développement, de la production de pâte à papier, qui représenteun enjeu majeur en termes de débouchés pour la filière forestière française.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar Pascal CL<strong>É</strong>MENT*, Jean-Jacques BORDES** et Dominique LACHENAL ***Le site papetier d’Alizay, sis dans le département del’Eure, appartient au groupe finlandais M–REALet emploie actuellement 400 salariés, pour uneproduction annuelle de 300 000 tonnes de papier.Jusqu’en mars 2009, il était le principal fabricant depâte à papier à partir de produits forestiers en provenancedu Nord-Ouest de la France : les achats de boissur contrat s’élevaient à 800 000 t de bois par an, ce quireprésentait la moitié de la production des fournisseursde l’usine (80 sociétés d’exploitation forestière desrégions Normandie, Picardie et Pays de Loire).L’unité de production de pâte à papier (soit 105 salariéssur 400) est arrêtée depuis mars 2009, étant devenuedéficitaire du fait notamment d’une concurrence internationaleexacerbée dans ce domaine de production.Un plan social (Plan de Sauvegarde de l’Emploi – PSE)a donc été décidé prévoyant la suppression des 105postes considérés.L’autre unité de production du site d’Alizay, quiemploie 300 salariés, poursuit son activité (la productionde ramettes de papier sous la marque EVOLVE).Elle s’alimente désormais en pâte importée (en provenance,pour l’essentiel, de la Grande-Bretagne), produiteà partir de papiers recyclés.* Commissaire à la réindustrialisation en Haute-Normandie.** Consultant du groupe SECAFI – ALPHA.*** Professeur à l’Institut polytechnique de Grenoble.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 49
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESAfin de compenser la perte d’activité liée à l’arrêt de laproduction de pâte à papier, le site d’Alizay a mis àl’étude plusieurs projets techniques qui sont :• le développement d’une nouvelle activité de fabricationde granulés de bois (pellets) destinés auxchaufferies (bois-énergie) : chiffre d’affaires estimé à10 millions d’euros, pour 15 emplois. Cette unité defabrication de granulés de bois serait la première à utiliserdes rondins de bois. Cette nouvelle orientations’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale et européennede développement des énergies renouvelables.• l’implantation d’une chaudière biomasse de 50MW électrique : dans le cadre du troisième appel àprojet lancé par la Commission de régulation del’énergie (CRE), l’entreprise a proposé – avec succès –la création d’une unité de cogénération à partir debiomasse, de 50 MW électrique. Le site valorisera lachaleur produite par l’unité en l’utilisant pour le fonctionnementde son usine de production de papierimpression.• l’installation d’une unité de désencrage de pâte àfin de recyclage de papiers de bureau usagés : 80 millionsd’euros d’investissements pour 45 emplois. Aucours de cette année (2010), s’est posée la question del’opportunité d’investir dans un équipement permettantde traiter sur le site d’Alizay le papier usagé àrecycler, en vue de sa réutilisation en tant que matièrepremière pour l’unité de production de papier impression.Cette opération de recyclage est aujourd’hui réaliséepar le fournisseur actuel de l’usine d’Alizay,lequel est basé en Grande-Bretagne (160 000 tonnes).Le contrat avec ce fournisseur arrivant à échéancedans 2 ans, s’est ainsi posée la question de la réalisationsur le site même d’Alizay d’une opération, qui serévèle stratégique dans un marché où la valorisationdu papier recyclé revêt une importance de plus en plusgrande.L’ensemble de la filière papetière française est soumiseà la fois à des mutations technologiques importanteset à une forte concurrence mondiale conduisant lessites français à se spécialiser et à se restructurer pouraméliorer leur compétitivité et s’adapter à l’arrivée surle marché de nouvelles capacités de production depâte (elles subissent, en particulier, la concurrence deproducteurs d’Amérique du Sud et d’Indonésie).De grandes incertitudes pèsent aujourd’hui sur lesperspectives de croissance des productions de papierset de pâtes en Europe.L’usine d’Alizay est une des dernières unités de productionde pâte/papier intégrées en France, alors quela balance des échanges est dans ce domaine déjà déficitaire.Le maintien, voire le développement , de cetteproduction représente un enjeu majeur en termes dedébouchés pour la filière forestière française.L’étude du cas du site papetier d’Alizay illustre doncbien les évolutions en cours. Dans ce contexte, uneexpertise des voies possibles de diversification industrielledu site a été réalisée à la demande des partenairessociaux.Il ressort des travaux réalisés par les experts que le sitepapetier d’Alizay dispose de plusieurs opportunités demodernisation ou de diversification industrielle.Après une présentation de l’incidence de l’optimisationdu procédé chimique de fabrication de la pâte à papieren termes d’amélioration des coûts de production del’usine d’Alizay (et donc de diminution du prix derevient), nous insisterons plus longuement sur deuxpistes potentielles de réorientation de l’activité du sitedans le cadre d’une nouvelle stratégie estampillée « chimieverte » : la production de biocarburants à partir desfibres cellulosiques du bois (filière bioéthanol dedeuxième génération) et la fabrication de pâte à usagechimique (en vue de produire, comme en Chine, de laviscose à partir de la cellulose du bois).LA R<strong>É</strong>DUCTION DES COÛTS DE PRODUCTIONPAR UNE OPTIMISATION DU PROC<strong>É</strong>D<strong>É</strong>CHIMIQUE DE FABRICATIONDans l’optique d’une amélioration du procédé de fabricationde la pâte à papier (procédé kraft au sulfate desodium), le site d’Alizay a la possibilité de jouer surdeux étapes du procédé de fabrication : l’améliorationde l’opération de cuisson de la pâte et/ou celle de l’opérationde blanchiment.L’amélioration du procédé de cuissonDans l’hypothèse d’un prix du bois élevé, une améliorationenvisageable résiderait dans l’ajout d’anthraquinone.L’anthraquinone appartient à la famille chimiquedes hydrocarbures aromatiques polycycliques, c’est undérivé de l’anthracène. Il se présente sous la formed’une poudre cristalline solide et est de couleur jauneou gris clair (ou gris-vert) (voir le graphique 1).Il est démontré que l’ajout à proportion de 0,05 %d’anthraquinone au bois, permet d’accroître le rendementen pâte de 1,5 %. Cet apport représenterait, àcapacité de production constante, une moindreconsommation en bois de l’ordre de 3 %, soit une économiede près de 2 millions d’euros par an. Sur la based’un prix d’anthraquinone de 3 euros le kg, le coût del’anthraquinone par tonne de bois produite serait doncde 1,5 euros, soit un montant total de 0,9 million d’euros.L’introduction d’anthraquinone dans le processusde cuisson permettrait ainsi une économie de l’ordre de1 million d’euros par an.L’amélioration de l’opération de blanchimentEn termes de coûts variables, le blanchiment de lapâte représente le deuxième poste financier. Selon les50R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Graphique 1 : Evolution du coût du bois dans la tonne de pâte €/t.PASCAL CL<strong>É</strong>MENT, JEAN-JACQUES BORDESET DOMINIQUE LACHENALGraphique 2 : Evolution du coût de la tonne de pâte €/t.Graphique 3 : Part respective des frais variables et des frais fixes dans l’évolution du coût de la tonne de pâte €/t.usines, le coût du blanchiment est compris entre 25 et45 euros/ADT (air-dry ton ou tonne de pâte séchée àl’air). Celui-ci dépend surtout de l’essence des bois(résineux, feuillus) et de la séquence utilisés. Avec uncoût de 40 euros/ADT, le site d’Alizay se situe doncdans le haut de la fourchette (voir les graphiques 2 et3).Ce faible niveau de performance s’explique par le procédéemployé qui ne repose pas sur la mise en oeuvred’un traitement à l’oxygène, ainsi que (sans doute) parR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 51
Tableau 2 : Bilan économique de l’introduction de l’oxygène dans la séquence de blanchiment.• le diester, à partir d’huiles végétales (huile de colza,huile de palme) ;• et le bioéthanol, dit de première génération, à partirde la saccharose (sucre de canne et sucre de betterave)ou de l’amidon (maïs, blé).Le diester est un substitut du diésel, tandis que le bioéthanolen est un de l’essence.En 2009, la production française de bioéthanol a été de1 400 millions de litres (810 Ml en 2006), obtenue,pour l’essentiel, à partir du raffinage de la betterave àsucre et, pour une part moindre, à partir de céréales.Les principaux producteurs sont les Etats-Unis (principalementà partir de maïs) et le Brésil (essentiellementà partir du sucre de canne), avec pour chacun une productionde l’ordre de 25 milliards de litres. A titre decomparaison, la consommation de pétrole, sous formede carburants, dépasse les 2 000 milliards de litres ; lesbiocarburants disposent donc d’une marge de croissancedes plus importantes.S’agissant des biocarburants dits de première génération,les deux principales filières d’approvisionnement enmatières premières sont : la filière huile et la filière sucre.La filière sucre est de loin la plus développée, notammentau Brésil (la production de bioéthanol de ce payscouvre environ le quart de ses besoins en carburant).De nombreuses critiques se font jour au regard de la« confiscation » de terres agricoles au profit de ces deuxfilières, avec pour corolaires : une augmentation duprix du foncier, une hausse des cours des produits alimentairesde base (maïs, sucre, lait, viande…), desrisques de famines… Au Brésil, près de la moitié deschamps de cannes à sucre sont consacrés à la productionde biocarburant. Cette part prise par le biocarburantdans l’agriculture a conduit à une très forte haussedu prix des terres agricoles au cours de l’année 2007.Ainsi, même si le concept de biocarburant apparaîtcomme très séduisant sur les plans écologique et économique,la pression démographique est telle que cettesolution est peu viable – à terme – pour les filières« sucre » et « huile ».Il en résulte l’émergence d’une très forte contestationau regard des voies de production de biocarburantsactuellement empruntées :• tout d’abord, le bilan carbone correspondant ne serévèle pas plus favorable que celui de l’utilisation dupétrole, du fait d’une utilisation massive d’engrais etd’une consommation importante de carburants d’originefossile nécessaires à la production des matières premières,• ensuite, l’origine alimentaire des matières premièresentrant dans le procédé de synthèse du bioéthanol soulèveune question d’éthique sérieuse,• enfin, les plantations de canne à sucre et de palmiersà huile se développent au détriment de la forêt primaireou d’autres cultures.De fait, l’augmentation de la production de biocarburantne pourra se faire que par l’utilisation de matièreslignocellulosiques (bois, déchets forestiers et agricoles) ;cette nouvelle génération de biocarburants est appeléebioéthanol de deuxième génération. De très nombreusesrecherches sont consacrées au développementd’une filière dédiée au bioéthanol de deuxième génération.Dans cette optique, la production de bioéthanol dansdes usines de pâte à papier présenterait de nombreuxavantages :• la logistique d’approvisionnement en bois existe déjà,• les procédés chimiques utilisés sont parfaitementoptimisés et pratiquement autonomes en énergie et enproduits chimiques,• la gestion des effluents est maîtrisée,• la cellulose extraite est disponible pour produire,entre autres, du bioéthanol,• les hémicelluloses peuvent être extraites et servir à laproduction, notamment, du bioéthanol,• les obstacles techniques ont tous été levés.De plus, l’utilisation de la ressource bois pour la productionde biocarburant n’entre pas, en France, enconcurrence avec les terres agricoles.Ainsi, au cours des dernières années, on a pu observerque des surfaces importantes de terres agricoles étaientpetit à petit reconquises par la forêt (environ 60 000hectares par an).Ainsi, l’intérêt manifesté par les pouvoirs publics auregard de cette nouvelle voie est double : elle représenteune possible réponse aux préoccupations environnementalesexprimées dans le cadre du Grenelle del’Environnement et à la raréfaction de la ressourcepétrole, d’une part, et elle répond à la volonté de mettreen place une politique de gestion durable d’un environnementforestier en forte croissance, d’autre part.Dans le cas de l’usine d’Alizay, la voie consistant àextraire les hémicelluloses avant la cuisson et à les fermenteren vue d’obtenir du bioéthanol (comme préconisédans de nombreux travaux) n’est pas aujourd’huiopérationnelle (la technique de fermentation des hémicellulosesde feuillus (pentoses) n’est, en effet, pas encoreau point).PASCAL CL<strong>É</strong>MENT, JEAN-JACQUES BORDESET DOMINIQUE LACHENALR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 53
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESSchéma 1 : Procédé chimique de cuisson.La seule voie envisageable est donc celle de la productionde bioéthanol à partir de la seule fraction de pâtede cellulose aujourd’hui commercialisée (la partie destinéeà alimenter la machine à papier n’est pas concernée)(voir le schéma 1 ci-dessus).La pâte produite sur le site d’Alizay contient (approximativement)80 % de cellulose et 20 % d’hémicelluloses,principalement des xylanes. Ces dernières rendentplus difficile la production de bioéthanol. Dessolutions sont envisagées, mais leur faisabilité industriellen’est pour l’instant pas encore démontrée. Latransformation de la pâte en bioéthanol ne porteradonc que sur environ 85% du poids de la pâte (cellulose+ glucomannanes résiduels).C’est cette voie que la France a choisi d’explorer via unconsortium constitué de Tembec, Danisco/Genencor,l’INSA Toulouse et l’Université de Bordeaux (programmeANR/PNRB/ADEME ; ANR-05-BIOE-007).D’autres projets de ce type ont également vu le jour,dont un projet Néo-Zélandais (New ZealandLignocellulosic Bioethanol Initiative, avril 2008) ainsique le projet Lignol, en Amérique du Nord (1) (ce dernierprojet semble d’ailleurs être le plus avancé). Cesexpérimentations ont permis de dégager les élémentsessentiels permettant d’évaluer le prix de revient dubioéthanol de deuxième génération et de le comparerau prix de vente du bioéthanol de première génération.Sur le plan technique, la pâte écrue obtenue après cuissondevrait pouvoir être directement traitée par hydrolyseenzymatique, ce qui permet de s’exonérer de la réalisationdes opérations de blanchiment et de séchage.Cette opération de cuisson vise à transformer la celluloseen glucose par l’action des cellulases. Elle se pratiquedans des conditions douces (pH voisin de 5, pourune température de 50°C).Il est à noter que les études précédemment citées montrentque cette opération a une efficacité optimalequand un blanchiment partiel (blanchiment à l’oxygène)est réalisé au préalable.De même, les pâtes de bois feuillus présentent, en général,une très bonne réaction au traitement enzymatique(en tout cas par comparaison aux pâtes de bois résineux).Les progrès réalisés dans le domaine des cellulasessont très rapides, de sorte que l’on peut estimerque la séquence de blanchiment ne sera bientôt plusune opération nécessaire. Le rendement en glucose(poids de glucose produit par rapport au poids de cellulosepure traitée) devrait être de l’ordre de 85%(hypothèse basse).Les temps de traitement dépendent de l’efficacité desenzymes et de l’état de la pâte. D’après les donnéespubliées, on peut estimer que la durée d’hydrolyseserait de 48 à 72 heures. Ce traitement est réalisé dansdes cuves agitées à la pression atmosphérique. Le tauxde matière sèche (cellulose) en début de traitementpourrait être de l’ordre de 10 à 20 %.(1) Pour plus d’informations, voir le site Internet suivant : www.bioenergy.novozymes.com.54R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Les sucres formés sont alors fermentés pour obtenir del’éthanol sous l’action de levures, dans des conditionségalement très douces (pH voisin de 4, pour une températurede 35° C). Cette opération a un rendementthéorique de 51%, comme le montre la réaction ci-dessous:C6H12O6 ➝ 2C2H5OH + 2 CO2 (51 % en poids)Le rendement réel est très proche de ce rendementthéorique. La durée de traitement serait du mêmeordre que celle de l’hydrolyse. Ce traitement se faitégalement en cuves. Il est à noter que ces deux étapespourraient être réalisées de manière simultanée, ce quiaurait pour effet de favoriser la conversion de la celluloseen glucose, en faisant disparaître le glucose toutau long du cycle de production. Une réalisation combinéedes opérations de saccharification (hydrolyse) etde fermentation serait envisageable, ce qui devraitréduire la durée totale du traitement et de l’investissementnécessaire.La production d’éthanol à partir de la pâte aujourd’huicommercialisée (sur une base de 150 000 t) serait doncde l’ordre de 50 000 t/an, soit environ 60 000 m 3d’éthanol ou encore l’équivalent de 60 millions delitres. A noter que cette capacité de production restemodeste au regard de celle obtenue à partir de sucre debetterave ou de blé (à titre d’exemple, l’usine Tereos deLillebonne produit 3 millions d’hectolitres à partir de800 000 t de blé).Le prix de revient (frais variables en euros/litre, horsenzymes) du bioéthanol de deuxième génération ainsiproduit sera de 2,5 X, où X correspond au coût de lapâte écrue exprimé en euros/kg, sur la base des différentsrendements indiqués précédemment. Il fautrajouter à ce prix théorique le coût des enzymes quiserait voisin de 10 cents d’euros par litre d’éthanol, et lecoût des levures qui se situe à environ 5 cents d’eurospar litre d’éthanol.Il est rappelé que le cours de l’éthanol de premièregénération est voisin de 50 cents d’euros/l, éthanol quibénéficie aujourd’hui d’une subvention de 30 centsd’euros/l.Sur la base de ce cours, l’éthanol cellulosique obtenudans les conditions précitées devrait présenter un coûtde revient de la pâte à papier inférieur à 200 euros/t, cequi était loin d’être le cas en 2008. En tenant comptede la subvention actuelle de 30 cents d’euros/litred’éthanol, une marge bénéficiaire ne pourrait être dégagéequ’avec un coût de revient de la pâte inférieur ouégal à 300 euros/t. Ce qui signifie que dans l’environnementéconomique actuel, il faudrait se fixer un « targetcost » (coût cible) du même ordre (300 euros/t).L’investissement pour la capacité envisagée (0,6 millionsd’hectolitres) correspond à un montant total de24,5 millions d’euros (installé), qui se répartiraitcomme suit:• Hydrolyse : 10 millions d’euros sur la base d’unedurée de traitement de 72 heures, avec un hypothèse dequasi linéarité dans le temps (soit un coût de 6 millionsd’euros sur 36 heures). La durée de 72 heures est celleretenue ici par sécurité. (Novo retient pour sa part unefourchette se situant entre 36 et 72 heures),• Fermentation : 6 millions d’euros (sur une base de 36heures),NB : les phases d’hydrolyse et de fermentation pourraientêtre réalisées en simultané par un même équipement,mais les rendements seraient moins bons. Cetteoption n’est donc pas chiffrée.• Distillation-deshydratation : 7 millions d’euros,• Stockage éthanol (4j) : 0,5 million d’euros,• Tour de refroidissement par eau : 1 million d’euros.A cet investissement devra éventuellement s’ajouter lecoût d’une étape de centrifugation destinée à enlever lesmatières solides des vinasses (opération indispensabledans le cas du blé, mais qui, dans le cas de la cellulose,dépend de l’efficacité de l’hydrolyse). L’intérêt de cettedernière opération reste néanmoins à être confirmé.Coût estimé : 7 millions d’euros.Pour conclure sur cette seconde partie, nous souligneronsl’existence d’une réelle demande de bioéthanols deseconde génération et ce, pour trois raisons :• tout d’abord, les bioéthanols de première générationfont l’objet de vives critiques tant de la part des mouvementsécologistes que des pouvoirs publics ;• ensuite, les attentes vis-à-vis des biocarburants deseconde génération sont fortes et l’utilisation dematières lignocellulosiques s’impose, de touteévidence ;• enfin, le développement de ce type de productions’intègrerait parfaitement dans la politique de gestiondurable de la forêt française, telle qu’elle est conçueactuellement.En tout état de cause, un engagement réussi sur cettenouvelle voie sera conditionné (sans aucun doute) à lamise en place de mesures d’accompagnement (R&D,aides à l’investissement, subventions,…).LES PÂTES CHIMIQUES SP<strong>É</strong>CIALES : UN MARCH<strong>É</strong>MONDIAL DE 4,5 MILLIONS DE TONNES PAR ANLe marché des pâtes spéciales connaît un regain decroissance depuis quelques mois. Au sein de ce marché,la viscose, qui tout en étant une pâte spéciale n’en estpas moins une commodité, est l’objet d’un intérêt toutparticulier (hausse des cours : inférieur à 800 $/t aucours du 1er trimestre 2009, le coût est supérieur à1200 $/t depuis la fin 2009). En Chine, la viscoseconstitue un marché induit par la reconversion desterres cotonnières chinoises et par l’intérêt des consommateurspour cette matière.La viscose est un substitut du coton. La forte demandeactuelle résulte de la régression des surfaces cultivées encoton, en faveur d’autres cultures. Par ailleurs, unengouement réel pour les fibres viscose semble se fairejour dans plusieurs grands pays d’Asie. Enfin, dans leprolongement des préoccupations environnementales,la demande pour les fibres textiles issues de la biomassePASCAL CL<strong>É</strong>MENT, JEAN-JACQUES BORDESET DOMINIQUE LACHENALR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 55
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESdevrait croître également, un peu partout dans lemonde.A titre d’illustration de cette mise sous tension du secteur,on peut cité le cas de la société Fulida, principalproducteur chinois de viscose, qui a conclu un doubleaccord avec la compagnie Neucel Speciality Cellulose :l’accord porte, d’une part, sur une prise de participationminoritaire de la société Fulida dans le capital deNeucel et, d’autre part, sur la livraison de viscose (160Kt).Près de 4,5 millions de tonnes de pâtes cellulosiquesissues du bois sont destinées, de par le monde, àd’autres applications que la production de papier. Surces 4,5 millions de tonnes, environ 65% sont utilisésdans le procédé viscose ou dans sa variante moderne, leprocédé Lyocell, pour un usage essentiellement textile.Ce marché a connu une croissance mondiale de 7% paran au cours des 5 dernières années (10% en Chine). Leprix de vente des pâtes à dissoudre a augmenté de plusde 30 % au cours de l’année 2009 pour atteindre,aujourd’hui, des niveaux supérieurs à 900 euros/ADT,en ce qui concerne la viscose (voir le tableau 3).Par ailleurs, la viscose figure parmi les pâtes spéciales lesmieux adaptées au plan industriel à l’emploi de la technologiekraft, actuellement utilisée sur le site d’Alizay.La croissance chinoise, la pression pesant sur l’utilisationagricole des terres, le caractère écologique de la viscosedans le domaine du textile renforcent la positionde cette matière par rapport aux fibres textiles traditionnelles.La reconversion programmée d’un site kraft en viscose(Thurso), ainsi que le redémarrage d’une unité viscosearrêtée depuis plusieurs mois (Neucel SpecialityCellulose) sont autant de signes forts de la vigueur dece marché. Enfin, dans une version plus aboutie, onpeut imaginer une conversion vers les autres pâtes spéciales(ethers et acétates de cellulose), mais cela n’estenvisageable qu’à un horizon plus lointain.Dans ce contexte, les pâtes pour viscose s’affirmentcomme un débouché des plus intéressants pour lesusines françaises productrices de pâte à papier à base debois feuillus.Ces usines de pâte à dissoudre disposent de deux atoutsessentiels :• le procédé kraft (fabrication de la pâte par emploi desulfate de sodium) peut être facilement amélioré afin dedevenir un procédé encore plus « vert »,• le procédé de production de pâtes de celluloses à dissoudrepeut également être utilisé pour la productionTableau 3 : Le marché des pâtes spéciales.de celluloses destinées à des usages chimiques (plastiquescellulosiques : esters, ethers de cellulose) ainsique d’autres constituants du bois à l’état pur (bioraffinerie)entrant dans la synthèse chimique.Les celluloses à dissoudre diffèrent de la pâte à papierpar le fait qu’elles sont plus pures (moins d’hémicelluloses)et davantage dépolymérisées. Les taux d’hémicellulosessont de l’ordre de 2 à 5 % et la viscosité de la celluloseest comprise entre 400 et 600 cm 3 /g dans sonutilisation à fin de production de la viscose ; ces donnéessont à rapprocher de celles des pâtes papetières quiprésentent des taux de 20 à 25 % d’hémicelluloses etune viscosité de 900 à 1 100 cm 3 /g.Le procédé technique consiste donc à extraire lamajeure partie des hémicelluloses par un traitementdes copeaux en utilisant soit de la vapeur d’eau, soitune solution d’acide diluée à une température voisinede 160°C ; ce traitement est apporté avant de soumettreles copeaux à la cuisson kraft (une cuisson facilitéepar rapport à l’utilisation de copeaux non traités).Cette cuisson peut éventuellement êtreremplacée par une cuisson à base de soude-anthraquinone,laquelle ne génère aucun produit soufré malodorant.Le blanchiment exige des extractions alcalinesrenforcées, mais peut également reposé surl’emploi de réactifs oxygénés (oxygène, ozone, eauoxygénée) en lieu et place du dioxyde de chlore(séquence totally chlorine free, TCF). L’ensemble duprocessus de traitement peut donc être parfaitement«vert ». Le rendement final serait de l’ordre de 35 à38 %, soit un taux légèrement inférieur à celui de lacellulose présente dans le bois.A titre d’exemple, on peut citer l’usine Brésilienne deBacell qui fonctionne selon ce principe avec l’utilisationde copeaux d’eucalyptus. Cette usine kraft produit unepâte à dissoudre. Un autre exemple est celui de l’usinede Thurso du groupe Fraser Papers (Québec) qui aprèsavoir cessé son activité va être reprise par FortressPapers. Cette usine kraft, à partir de bois feuillusmélangés, va être transformée en unité de productionde pâte à dissoudre d’une capacité de 200 000 t/an.L’investissement lié à cette transformation est de 60millions d’euros, somme qui recouvre les coûts liés :• à la modification du procédé de cuisson (hydrolyse àhaute température) ;• à l’augmentation de la capacité de combustion (+ 20 %de matière organique à brûler) ;• à l’augmentation de la capacité de caustification (leprocédé qui sera utilisé sur le site de Thurso se révèleplus gros consommateur de soude) ;• à l’adaptation des opérations du blanchiment et deséchage de la pâte (opérations déjà réalisées sur le sited’Alizay).Le coût de revient de la pâte à dissoudre est supérieur àcelui d’une pâte papetière en raison principalement de ladifférence de rendement. Dans le cas de l’usine deThurso, que l’on peut comparer à celle d’Alizay, l’augmentationdu coût de revient serait de l’ordre de70 euros/ADT. Ce surcoût est à rapprocher du différen-56R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
tiel de prix (220 euros/ADT) existant entre la BHK(Bleached Hardwood Kraft : pâte kraft de résineux blanchie)et la viscose. Dans le cadre du marché de la NBHK(Northern Bleached Hardwood Kraft : pâte kraft de résineuxblanchie du Nord (Amérique, Scandinavie)),Thurso se situait clairement parmi les compétiteurs lesmoins performants en termes de coûts. En revanche, lerepreneur Fortress fait clairement le pari de la restaurationde la compétitivité de cette usine, grâce au changementde production (voir les graphiques 5 et 6 ci-dessous).PASCAL CL<strong>É</strong>MENT, JEAN-JACQUES BORDESET DOMINIQUE LACHENALGraphique 5 : Comparatif des prix de vente des pâtes à dissoudre et NBSK – Source : Fortress Paper (ValeursFOEX).Graphique 6 : Prix de la pâte Mixed Hardwood (Nord) en $/t.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 57
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESSchéma 2 : Conversion du procédé kraft en « bioraffinerie ».L’usine d’Alizay après transformation pourrait poursuivreson évolution sur la voie d’une bioraffinerie plus complèteavec la récupération des sucres. Elle pourrait ainsidégager une plus grande marge bénéficiaire, en réduisantnotamment sa consommation de soude (voir le schéma 2).La production simultanée de pâte à dissoudre et de pâtepapetière constituerait la solution idoine, en permettantà l’usine d’Alizay de maintenir une activité de productionde pâte papetière. Le principe consisterait à transformerla pâte papetière aujourd’hui commercialisée en pâte àdissoudre, ce qui implique de lui appliquer des traitementsappropriés pour éliminer les hémicelluloses présentes(20 % de la pâte blanchie) et conférer à la celluloseune bonne réactivité chimique. Contrairement à lavoie précédente, la cuisson kraft ne serait pas modifiée.CONCLUSIONLes choix de diversification précités restent trèsouverts pour les prochaines années et leur concrétisationéventuelle restera dépendante tant de l’impactéconomique sur la filière de l’émergence denouveaux producteurs de pâte très actifsd’Amérique du Sud et d’Asie que de la stratégie desactionnaires présents ou à venir.Or, la stratégie actuelle de ces derniers est très directementaxée sur la production de papiers et d’emballages.Une des opportunités de développementserait donc d’adosser l’usine d’Alizay à un opérateurdéjà présent dans la filière concernée :Ce pourrait être :• un pétrolier, en ce qui concerne les biocarburants :l’intérêt serait de bénéficier de la capacité derecherche de ce dernier, de ses moyens financiers et,bien évidemment, de sa maîtrise des débouchés ;• un opérateur dans le textile, en ce qui concerne laviscose : un opérateur qui souhaiterait maîtriser unesource de matière première autre que le coton, dontles cours fixés au niveau international sont fortementspéculatifs (tension spéculative qui affectemoins les cours du bois de par sa dimension avanttout régionale).58R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
La recherche etl’enseignement supérieur,un enjeu de la batailleéconomique dansles territoiresCR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESRevitaliser un territoire, c’est à la fois répondre à des crises à chaud(fermeture d’un site), mais aussi promouvoir un développement(re)créateur d’emplois qui s’appuie sur les atouts du territoire. Onconçoit donc qu’il faille insérer la revitalisation dans une véritablestratégie de développement territorial, si l’on veut en assurer la cohérence etla solidité. Or, de plus en plus, dans une « économie de la connaissance »,le système d’enseignement supérieur et de recherche se voit assigner un rôleimportant vis-à-vis de ces objectifs…par Daniel FIXARI et Frédérique PALLEZ*Ce point a été théorisé par différents chercheursqui ont mis en avant la troisième missiondes universités, à savoir le développement économiquedu territoire sur lequel elles sont implantées(Etzkowitz (H.) et Leydesdorff (L.) 1997). Du côté despouvoirs publics, cette prise de conscience a égalementdonné lieu, depuis quelques années, à diverses réformesinstitutionnelles, qui mettent l’accent sur l’importanced’un système d’Enseignement Supérieur et deRecherche (ESR) travaillant en lien avec les acteurs duterritoire : création des Pôles de Recherche etd’Enseignement Supérieur (PRES), RéseauxThématiques de Recherche Avancée (RTRA), opérationCampus, « grand emprunt », soutien à la mutualisationdes structures de valorisation… La création despôles de compétitivité (PC) est également un élémentde ce vaste chantier puisque les acteurs académiques yjouent un rôle majeur. Quant à l’autonomie des universités,telle qu’elle résulte de la loi LRU, elle est denature à donner elle aussi de nouvelles marges demanœuvre aux établissements universitaires sur leur territoire.Quel bilan peut-on faire de cette réorganisation du systèmede l’enseignement supérieur et de la recherche, del’articulation entre les différentes structures créées, durôle des acteurs du territoire ? Le système s’ordonne-t-ilau regard du développement économique du territoire ?Et si oui, comment ?On présentera succinctement :* Professeurs à Mines ParisTech.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 59
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES• Les grandes politiques nationales et la question del’articulation entre les différentes structures ;• La montée en puissance des collectivités territoriales,notamment des régions, dans l’élaboration d’une véritablestratégie territoriale de développement économique,dans laquelle le monde universitaire est partieprenante ;• Les initiatives infrarégionales appuyées sur des établissementsuniversitaires bénéficiant d’une nouvelleautonomie, mais parfois inquiets d’un possible désengagementde l’Etat…En conclusion, on évoquera quelques obstacles à laconstruction de stratégies territoriales intégrées.LES POLITIQUES NATIONALES DE RECHERCHEET D’INNOVATION : Y A-T-IL UN PILOTE DANSL’AVION ?Depuis près de vingt ans maintenant, pour certains, lesEtats et régions européens promeuvent des politiquesindustrielles ou de développement économique quitendent à favoriser l’ouverture des entreprises sur larecherche et l’enseignement supérieur, notamment àtravers les politiques de clusters. Simultanément sontmenées des politiques visant à réformer les systèmesd’enseignement supérieur et de recherche (commel’Exzellenzinitiative lancée en Allemagne en 2005),notamment pour en faire un atout dans la bataille économique.Même en France, pays dont l’on sait que, traditionnellement,son université est à la fois très liée àl’Etat et très éloignée de l’industrie, on peut mettre enévidence une évolution progressive vers un systèmeorganisé autour d’établissements universitaires « entrepreneuriaux» dotés d’une stratégie, à la gestion plusdécentralisée, contractualisant avec la tutelle étatique ets’ouvrant aux entreprises. Système allant aussi versdavantage de différenciation territoriale et d’interconnexionavec les collectivités territoriales.UN FOURMILLEMENT D’INITIATIVESEntre 2004 et 2006, une série d’initiatives des pouvoirspublics, rapprochées dans le temps, ont ainsi donnénaissance successivement :• aux pôles de compétitivité (PC), des clusters labelliséspar l’Etat et soutenus financièrement par des fondspublics finançant des projets de R&D collaboratifsentre chercheurs académiques et entreprises (1,5 milliardd’euros sur la période 2005-2008, renouvelés surles trois années suivantes). Soixante-et-onze pôles sontactuellement labellisés, avec quelques ajustementsrécents.• aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur(PRES), qui sont destinés à favoriser la coopération desuniversités entre elles et avec les grandes écoles en fédérantces établissements situés sur un même territoireautour d’activités communes (organisation des écolesdoctorales, valorisation de la recherche,…) et, progressivement,autour de véritables stratégies coordonnéesde recherche et de formation. Ils promeuvent pour laplupart une logique de site (1) transdisciplinaire etbénéficient d’une aide publique de soutien à la structure.Aux neuf PRES de départ, sont venues s’ajouter sixautres structures du même type.• aux Réseaux thématiques de recherche avancée(RTRA) (treize actuellement), qui ont pour but de« rassembler, autour d’un noyau dur d’unités derecherche proches géographiquement, une masse critiquede chercheurs de très haut niveau, fédérés dans lecadre d’une stratégie partagée ». Ils s’appuient sur unefondation alimentée au départ par une dotationpublique, mais destinée à accueillir aussi des fonds privés.• au Plan Campus, qui a sélectionné des sites d’excellencesouvent liés à des PRES et à des PC dynamiques,pour des investissements importants, sites qui aurontaussi vocation à bénéficier des retombées du « grandemprunt ».Ces différents instruments ont pour ambition, chacunselon des principes différents, de contribuer à laconstruction d’un système qui permette des interactionsaccrues entre les mondes industriel et académique.Qu’en est-il, dans les faits ?Un puzzle qui se met en place ?Un des premiers résultats qui ressort des études empiriques(Fixari, Lefebvre, Pallez, 2008) est que nousavons affaire à une variété de configurations régionales,ce qui interdit d’emblée de porter un jugement globalisant.Les différences entre les territoires tiennent certesà leur « importance » objective en termes économiqueset scientifiques, mais elles reflètent aussi la plasticité desdispositifs mis en place. Modelés par les initiatives d’acteurslocaux, ils s’adaptent, en s’éloignant parfois notablementdes intentions initiales de leurs concepteurs,aux situations locales héritées du passé et aux caractéristiquescontrastées des secteurs industriels et scientifiquesconcernés, se prêtant plus ou moins à la collaborationindustrie-recherche.Que dire, maintenant, des relations entre ces structures? Alors qu’ils pourraient jouer un rôle clé sur leurterritoire, la plupart des PRES ont souffert d’un déficitde légitimité et de moyens, qui a limité leur capacitéd’action et compliqué le nécessaire partage des tâchesavec les RTRA, sur les thématiques communes : danscertains cas, on observe une délégation des activités derecherche du PRES au bénéfice du RTRA, maisailleurs, l’interface peut être plus conflictuelle et com-(1) Dans le cas de PRES métropolitains, mais certains PRES ont choisiune configuration régionale (comme le PRES de Bretagne, par exemple).60R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
DANIEL FIXARI ET FR<strong>É</strong>D<strong>É</strong>RIQUE PALLEZ© Guillaume Horcajuelo/REA« Les Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) (treize actuellement) ont pour but de rassembler, autour d’un noyaudur d’unités de recherche proches géographiquement, une masse critique de chercheurs de très haut niveau, fédérés dans lecadre d’une stratégie partagée ». Recherche agronomique au CIRAD (à Montpellier), groupement de laboratoires RTRA gérés parl’INRA.plexe à organiser. Un autre constat est la quasi-absencede relations entre les PRES et les pôles de compétitivité,même dans le domaine où les PRES semblaient apriori les plus légitimes, à savoir le volet formation.Cette absence s’explique, en particulier, par le fait queles pôles, au début, ont été incités à être avant tout des« usines à projets » de R&D, et que l’aspect formationy a été quelque peu négligé.Quant aux RTRA, certains d’entre eux peuvent choisird’ignorer complètement les pôles de compétitivité pourtravailler (plutôt en bilatéral) avec des industriels surdes innovations de rupture incompatibles, au nom dusecret industriel, avec les exigences du travail collaboratifqu’encouragent les pôles.Au total, si les dispositifs PRES, RTRA et PC sont souventjugés « intelligents » pris séparément, ils ont étéconstruits de manière relativement indépendante lesuns des autres. Leurs interfaces ne sont ni naturelles (ausens où il y aurait des complémentarités évidentes), nivraiment fixées par les textes juridiques qui leur ontdonné naissance.En outre, ils prennent place dans un paysage déjà saturé(nombreux organes de valorisation, fondationspubliques et privées, clusters de recherche et réseauxscientifiques préexistants, notamment au niveau régional…).D’où, parfois, des tensions institutionnellesliées à des recouvrements de compétences, à des questionsde leadership, à un sentiment de concurrencedans l’accès aux financements… Partant de ce constat,deux attitudes coexistent. Certains estiment qu’uneattitude volontariste visant (notamment) à une simplificationradicale est nécessaire. D’autres jugent que le« puzzle » va progressivement se mettre en place, mêmesi la cohérence d’ensemble n’était pas donnée au départ.Cela étant, ces politiques traduisent un mode d’actionpublique qui nous semble en profonde rupture avec desconceptions longtemps mises en application. L’Etat yrelâche sa position surplombante et préfère, auxapproches top-down, des approches bottom-up (appelsd’offres vis-à-vis des entreprises ou du monde académique)et incitatives (par le biais de divers mécanismesde financement). La conduite même de ces politiquesse veut de plus en plus partenariale : définition concertéedes objectifs, voire liberté donnée à ces organisations,sur certains aspects, de définir par elles-mêmes lesindicateurs sur lesquels l’Etat les évaluera. Ce qui n’empêchepas les pouvoirs publics de fixer des cadres générauxappliqués dans les appels d’offres, les labellisationset les critères de financement. Mais les instruments nesont pas entièrement figés, ce qui traduit une volontéd’apprentissage et d’expérimentation..., mais, peut-êtreaussi, des controverses internes à l’appareil d’Etat.Cette nouvelle philosophie peu normative peut donnerl’impression qu’il n’y a pas de pilotage des poli-R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 61
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIREStiques publiques menées. Elle suppose de la part despouvoirs publics une capacité d’apprentissage quin’est en rien donnée. Elle nous semble, toutefois, dansses principes, assez adéquate à la construction desinteractions complexes et évolutives entre acteurs querequièrent les politiques d’innovation territorialiséesactuelles.R<strong>É</strong>GIONS : LA MISE EN ORDRE DE BATAILLEL’émergence de stratégies régionalesDans ce contexte mouvant, il est frappant de constaterle rôle croissant joué par les collectivités territoriales(CT) dans ces politiques. Dans bien des cas, lesRégions avaient déjà choisi de favoriser la fédérationet la structuration du paysage industriel et académique,parfois même avant la naissance des pôles decompétitivité (des « clusters » régionaux avaient ainsivu le jour, par exemple, en Rhône-Alpes). Elles lefont en jouant un rôle de facilitateur lors de la créationde nouvelles structures, en favorisant les regroupementsou en apportant des aides financières(notamment dans le cadre des Contrats de ProjetEtat-Région).Les Régions ont ainsi soutenu les pôles de compétitivité(en en finançant largement l’animation et certainsprojets). Elles investissent aussi sur certaines thématiquesde recherche propres, jugées prioritaires parrapport à leur stratégie de développement économique,en s’appuyant notamment sur les PRES ou lesRTRA pour l’organisation des axes thématiquesqu’elles ont choisis. Ainsi, la région Ile-de-France acréé les Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) pourstructurer ses priorités de recherche, et la gestion del’un d’entre eux a été confiée à l’un des PRES franciliens.Mais l’aiguillon européen les pousse aussi désormaisà mettre en cohérence leurs actions dans le cadred’une Stratégie Régionale d’Innovation (SRI), dontla formalisation est imposée aux Régions dans lecadre de la programmation des fonds FEDER. LaRégion Bretagne a été la première à achever l’exercice,mais d’autres SRI sont maintenant finalisées ouen voie de l’être. Cet exercice, souvent très lourd,qu’accompagnent des consultants, a notamment permisaux Régions de cartographier l’ensemble desacteurs de la recherche et de l’innovation présents surleur territoire et de commencer non pas à en réduirele nombre, stigmatisé par certains rapports(Guillaume 2007), mais à clarifier les attributionsrespectives de chacun et à renforcer leur professionnalisme.Il va aussi obliger progressivement lesRégions à énoncer plus clairement leurs priorités et àtravailler sur la « gouvernance » de leur système d’innovationet de recherche.Une gouvernance multi-niveaux qui se cherche ?Les collectivités territoriales jouent souvent un rôlecomplémentaire de celui de l’Etat, dont elles contribuentà soutenir les politiques, même si elles ont peupris part à leur définition (Aust et Crespy, 2009). Uneévolution récente positive est d’ailleurs le fait que, lorsde la récente mise en place des « contrats de performance» des pôles de compétitivité avec l’Etat, en 2008,il a été choisi d’y associer les Régions en tant que cosignataires.Mais on peut constater que la structuration qu’induisentles Régions dans le paysage scientifico-industrieldu territoire n’est pas nécessairement complètementcohérente avec les axes définis pas les dispositifs labelliséspar l’Etat et que l’élaboration des SRI a pu être sourcede conflits avec celui-ci (Lefebvre, 2009). Ainsi, parexemple, les DIM de la Région Ile-de-France ne recoupentque partiellement les axes des PC et des RTRAfranciliens.On est donc conduit à se poser la question de la coordinationde ces différentes politiques, d’autant queparmi les sources d’inefficacité des politiquespubliques souvent citées, figure la question de la multitudedes institutions publiques qui, à différentsniveaux territoriaux, orientent et soutiennent larecherche et l’innovation. Or, aucune procédure systématiquene permet actuellement de rendre comptedes effets intégrés de ces diverses politiques quis’adressent souvent à des acteurs identiques, sur unterritoire donné. Les évaluations lancées actuellementsont elles-mêmes conçues dispositif par dispositif,plutôt que « par territoire ».Caractéristiques d’une tendance générale de l’actionpublique contemporaine, qui, de plus en plus, associedifférents niveaux de gouvernement, ces questions sontd’autant plus brûlantes que d’autres acteurs, à unniveau infrarégional, souhaitent s’appuyer sur le systèmed’enseignement supérieur et de recherche pourconduire leur politique de développement économique.SUR LES TERRITOIRES, UNE PRISEDE CONSCIENCE DU RÔLE DE L’ESR DANSLA DYNAMIQUE <strong>É</strong>CONOMIQUE LOCALEDes collectivités impliquéesLes collectivités territoriales de niveau infrarégional(essentiellement les Conseils généraux et les intercommunalités)sont de facto des acteurs du développementéconomique, même si ce n’est pas une compétencereconnue : créations de technopoles, soutienà des projets structurants ou à des entreprises, par lebiais d’aides à l’innovation… A ce titre, même si62R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
DANIEL FIXARI ET FR<strong>É</strong>D<strong>É</strong>RIQUE PALLEZ© Stéphane Audras/REA«Une évolution récente positive est d’ailleurs le fait que, lors de la récente mise en place des “contrats de performance” despôles de compétitivité avec l’Etat, en 2008, il a été choisi d’y associer les Régions en tant que cosignataires ». Bâtiment deshautes technologies à l’Université Jean Monnet, à Saint-Etienne.elles n’étaient pas directement en charge des questionsd’enseignement supérieur et de recherche, elless’y intéressent depuis longtemps, car cela est considérécomme une source d’activité et d’attractivitépour le territoire : la lutte pour les antennes universitairesou pour les IUT a été souvent (notammentdans les zones sinistrées économiquement) un levierde la revitalisation. Mais, même en l’absence decrise, ces collectivités territoriales s’engagent de plusen plus dans des actions de soutien aux établissementsd’enseignement supérieur situés sur leurs territoireset elles formalisent parfois ce soutien dansdes conventions. L’Université de Pau et des Pays del’Adour, par exemple, a signé des conventions nonseulement avec les Conseils généraux des PyrénéesAtlantiques et des Landes, mais aussi avec la communautéd’agglomération de Pau- Pays de l’Adour,conventions qui lui donnent accès à des ressourcescomplémentaires, sur des axes spécifiques choisis parces collectivités.Mais l’action reste tâtonnante, les contraintes financièresvont croissant (notamment pour les Conseilsgénéraux étranglés par le poids de leurs dépensessociales) et se fait jour, chez les collectivités, le besoind’une doctrine stratégique clairement formulée etsoucieuse d’efficacité : comment s’appuyer sur lesimplantations universitaires pour construire une stratégiede développement économique ?L’angoisse des villes moyennesCette attente est exacerbée sur certains territoires, enraison des enjeux particuliers liés aux universités«moyennes » où grandit l’inquiétude d’un risque dedésengagement de l’Etat, qui tendrait à se focaliser surquelques gros sites d’excellence, comme semble lemontrer la politique des PRES, de l’opération Campuset du « grand emprunt ». Ce mouvement de réflexionstratégique sur l’ESR au niveau des agglomérationsmoyennes a d’ailleurs été encouragé par la Datar qui,en 2008, a financé des travaux de prospective sur neufvilles (2) autour de ce thème (3). De leur côté, certainesuniversités moyennes lancent, en association avec lescollectivités locales concernées, des travaux sur l’affirmationde leur stratégie dans le nouveau paysage del’ESR, comme les y incite d’ailleurs leur nouvelle autonomieissue de la loi LRU de 2007.D’ores et déjà, certains principes généraux se font jour :• encourager le développement de quelques thématiquesdifférenciantes sur le plan recherche et formation,en lien avec les atouts et les acteurs du territoire ;(2) Albi, Tarbes, Boulogne, Troyes, Bourges, Roanne…(3) Voirhttp://www.datar.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_655/villes_moyennes_334/experimentation_20_2841.htmlR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 63
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES• attirer les étudiants par des formations plus professionnalisantes,un encadrement plus proche et plussoucieux de leur réussite, une proximité avec le mondeprofessionnel ;• attirer les chercheurs de haut niveau par des équipementsperformants, un soutien sur leurs thématiques etpar une qualité de vie qui n’est pas (ou plus) celle desgrandes métropoles ;• jouer l’insertion dans des réseaux universitaires, nonseulement au niveau régional (PRES), mais aussi auniveau interrégional ou/et au niveau international.Participant nous-mêmes à des travaux de ce type,notamment avec les collectivités du Sud Aquitain, nouspouvons noter la transformation des esprits tant dans lemonde des collectivités territoriales que dans le mondeacadémique et, malgré les difficultés, la naissance d’unevolonté de co-construction de stratégies qui prennent encompte le rôle accru des universités dans le développementéconomique du territoire. Ce chemin n’est pourtantpas exempt de difficultés, et nous voudrionsconclure en en mentionnant certaines.CONCLUSION : LA DIFFICILE CONSTRUCTIONDES STRAT<strong>É</strong>GIES TERRITORIALESPlus la question de la revitalisation économique des territoiressera traitée « à froid », dans le cadre d’une stratégied’anticipation construite avec tous les acteurs duterritoire, plus grande, selon nous, sera l’importance duvolet « Enseignement supérieur-recherche » (ESR). Laconstruction des avantages distinctifs du territoire surcertaines thématiques attractives à la fois pour desentreprises et pour des chercheurs, sa (nécessaire) flexibilitééconomique (qui suppose une flexibilité suffisantede la main-d’œuvre, et donc des capacités de formation)passent, en effet, par un travail partenarial desreprésentants du territoire avec l’ESR. Certaines villesmoyennes l’ont bien compris et mettent en place,comme Albi, un conseil de site animé par la communautéd’agglomération qui associe non seulement lescollectivités territoriales et les représentants de l’ESR,mais aussi les représentants de l’Etat et du monde économique.Mais il ne faut pas non plus verser dans l’irénisme et desdifficultés subsistent : les logiques d’acteurs ne sont pasidentiques, y compris entre collectivités territoriales. Lebien public territorial n’est pas une donnée acquise : ilse construit, par bribes, dans les différentes initiativesqui se mettent en place. Pointons certaines des difficultésque nous avons pu observer.D’abord, le vaste mouvement de recomposition du systèmed’enseignement supérieur et de recherche n’estpas sans déstabiliser certains universitaires, qui viventmal ce qu’ils considèrent comme un affaiblissement desvaleurs académiques. Or, l’autonomie renforcée desétablissements universitaires fait désormais de ces établissementsdes acteurs stratégiques qui ne se laissentpas dicter leur politique, mais doivent d’autant plusconstruire, en interne, un difficile consensus entre leursmembres.Les collectivités territoriales, de leur côté, sont partiellementen compétition entre elles pour attirer les ressourceséconomiques, ce qui ne facilite pas l’expressiond’une politique commune. Elles sont, en outre, enmatière d’enseignement supérieur et de recherche, obligéesde compter avec l’Etat et les grands organismes derecherche nationaux, qui gardent encore les leviers institutionnelsde la labellisation et l’essentiel des financements,notamment au niveau des personnels.Enfin, se pose la délicate question de la relation au territoiredes acteurs académiques et économiques : il nefaut évidemment voir ni les uns ni les autres commeexclusivement liés à un territoire, fût-ce au niveaurégional. Le développement des établissements universitaires,voire leur survie, passe certes par un ancragelocal et une réponse aux attentes des interlocuteurs territoriaux,mais aussi, nécessairement, par l’inscriptiondans des réseaux plus larges, en France et à l’international,garants de leur qualité et de leur dynamisme académiques.Quant aux entreprises, notamment les plusgrandes, même si leur ancrage territorial, en lien avecdes compétences locales et le soutien des collectivités,peut s’avérer un avantage déterminant (Aggeri et Pallez,2004), il ne faut pas sous-estimer le fait qu’elles cherchentmaintenant à optimiser au niveau internationalleurs politiques d’implantations et de collaborationsavec le monde académique.La bataille des territoires ne fait que commencer.BIBLIOGRAPHIEAGGERI (F.) et PALLEZ (F.), Comment agir sur lesrisques de désindustrialisation dans la filière automobile? Rapport Sofirem/ENSMP, 2004.AUST (J.) et CRESPY (C.), Les collectivités locales faceà l’enseignement et la recherche. Pouvoirs locaux III/2009 (n° 82), 2009.CRESPY (C.), Gouvernance de la recherche et compétitivitédes régions : quel rôle pour l’action publique territoriale.Politiques et management public vol. 25 (n°2):pp23-44, 2007.ETZKOWITZ (H.) and LEYDESDORFF (L.), Eds,Universities in the global economy : a Triple helix ofUniversity-Industry-Government Relations. London,Cassell Academic, 1997.GUILLAUME (H.), Rapport sur la valorisation de larecherche, IGF-IGAENR, 2007.FIXARI (D.), LEFEBVRE (P.) et PALLEZ (F.), Quellearticulation entre PRES, RTRA et pôles de compétitivité? - Rapport pour la DIACT, 2008.LEFEBVRE (Ph.), Cluster policy in France : Regionsand multi-level governance in a state-led policy,Colloque Clusters policies in Europe, Audencia, Nantes,5-6th October 2009.64R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Les plateformesd’innovation : des facteursde compétitivitédes territoiresLevier essentiel de la politique de compétitivité, les plateformesd’innovation offrent aux membres des pôles de compétitivité unaccès ouvert à des ressources mutualisées (équipements, personnelset services associés).Ces plateformes constituent la première étape de la mise en placed’un écosystème impliquant les trois piliers des pôles de compétitivité: les entreprises, les organismes de recherche et les établissements d’enseignementsupérieur.CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESpar Romain BEAUME* et Vincent SUSPLUGAS**Depuis le lancement de la politique des pôles decompétitivité, 1 950 projets de R&D collaboratifsont été déposés par les acteurs de ces pôlesdans le cadre des appels à projets du fonds unique interministériel(FUI), parmi lesquels 813 ont été soutenus,ce qui correspond à 4,3 milliards d’euros de dépenses deR&D et à 1,6 milliard d’euros de soutiens publics.Cette « usine à projets » constitue le cœur de l’activitédes pôles de compétitivité, à partir duquel ils se sontconstruits avant de développer de nouvelles dimensionsregroupées sous le terme d’ « écosystème d’innovationet de croissance ». En lien avec les acteurs existants(comme Ubifrance, en matière d’appui au développementinternational), les pôles de compétitivité visent àagir sur différents leviers essentiels de la compétitivitéde leurs membres :• le développement de synergies territoriales entre les troisacteurs pivots des pôles : les entreprises (grandes etpetites), les centres de recherches et les établissementsde formation (écoles et universités, laboratoires derecherche, services de valorisation, centres de formation…)afin de favoriser la conception de projets etd’actions collaboratifs ;• la conduite de projets collaboratifs entre grandes entreprises,PME et laboratoires (qu’il s’agisse de R&D surdes sujets de plus en plus déterminants pour le positionnementstratégique des entreprises ou de la mise encommun de plateformes de R&D et d’essais) ;* Ingénieur des Mines, Chef du Bureau « Politiques d’innovation et detechnologie » à la Direction générale de la Compétitivité de l’Industrie etdes Services (DGCIS) du ministère de l’Economie, de l’Industrie et del’Emploi.** Chef du Bureau « Politique des pôles de compétitivité » à la Directiongénérale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) duministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 65
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES• l’anticipation des besoins en compétences et en qualificationsnouvelles, l’adaptation des formations à ces besoins etla gestion des ressources humaines ;• la valorisation de l’innovation ;• l’implication des organismes de financement privés(capitaux-risqueurs, capitaux-développeurs, businessangels, institutions financières et bancaires...) permettantd’assurer la croissance des entreprises membres despôles, à chaque stade de leur développement ;• un développement ciblé et pragmatique à l’internationalpour accéder à des partenariats technologiques et à desmarchés potentiels avec de meilleurs rayonnement etattractivité ;• l’appropriation des outils essentiels à la promotion et à laprotection des innovations (normalisation, qualité, propriétéintellectuelle, intelligence économique…) ;• la pérennité de la dynamique d’innovation, notammentpar la mise en œuvre, avec le concours des collectivitésterritoriales, de stratégies de soutien à la création d’entreprises(des incubateurs et des pépinières), mais aussid’une politique de développement urbain, d’infrastructureset de réservations foncières visant à accroître lessynergies locales et à favoriser l’insertion des pôles dansleurs territoires respectifs ;• l’attractivité du territoire, grâce au renforcement de lavisibilité des compétences nationales, publiques et privées,dont il dispose ;• plus généralement, la mobilisation de l’ensemble desforces (publiques et privées) autour de grands enjeuxéconomiques, technologiques et sociétaux dûmentidentifiés.Dans ce contexte, les plateformes d’innovation apparaissentcomme un levier essentiel de cette politique.Elles sont destinées à offrir des ressources mutualisées(équipements, personnels et services associés) en accèsouvert, principalement aux membres du (ou des)pôle(s) de compétitivité labellisant(s) (et plus particulièrementaux PME). Elles ont pour objectif de menerà bien des projets de recherche et développement àforte retombées économiques pouvant aller jusqu’à laphase d’industrialisation et de mise sur le marché. Cetype de structure doit notamment permettre de procéderà des projets d’innovation, à des essais et à des tests,de développer des prototypes et/ou des préséries, voirede servir d’écosystèmes d’innovation ouverts aux usagers,les « living labs ».Il s’agit, ainsi, avant tout, d’apporter aux entreprises(petites et grandes) les équipements de recherche etles services nécessaires au développement de leurinnovation et des locaux permettant à des équipesmixtes issues de laboratoires de recherche et d’entreprisesde mener, ensemble, des projets collaboratifs.De tels équipements ne pourraient généralement niêtre financés (en raison des montants importants àmobiliser) ni être rentabilisés (en raison d’un usagepar acteur qui resterait insuffisant, bien que cet usagesoit important et rentable une fois mutualisés lesbesoins de plusieurs entreprises et organismes derecherche).Autour de ces équipements tirés par les besoins desentreprises industrielles et des sociétés de service, cesplateformes peuvent bénéficier à des écosystèmes quieux-mêmes s’orientent vers ces besoins : des organismesde recherche, des spin off et des start up, de petites et degrandes entreprises, des grandes écoles et des universités.QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES FRANÇAISESLe projet « Bio-raffinerie », une plateformed’innovation pour la raffinerie végétaleL’ambitieux projet Bio-raffinerie recherche innovation(B.R.I.), sur le site de Pommacle-Bazancourt, constitueun exemple de plateforme d’innovation (voir la photo1).Autour des unités industrielles de transformation desmatières premières d’origine agricole déjà présentes surle site considéré (une unité de production de sucre debetteraves, une glucoserie/amidonnerie de blé, uneunité de production de bioéthanol, une unité de productiond’actifs cosmétiques), la plateforme d’innovationB.R.I. constitue un écosystème unique dédié auconcept de raffinerie végétale de première et de deuxièmegénération.Cette plateforme permettra, à partir d’un ensembled’équipements et de savoir-faire uniques, la mise aupoint et l’extrapolation de procédés biotechnologiquesdu laboratoire jusqu’à l’échelle de la démonstrationindustrielle. Ce premier volet représente un budget de23,7 millions d’euros ; il est soutenu par les partenairespublics à hauteur de 6 millions d’euros (dont 3,3 millionsd’euros mobilisés par l’Etat).En plus de ce volet technologique, le projet prévoit lacréation d’un institut de la bio-raffinerie, ainsi quel’installation d’équipes d’enseignement supérieur et derecherche de premier rang et d’un incubateur pour les« jeunes pousses » travaillant dans les domaines des biotechnologieset de la chimie « verte ».Le financement de la plateforme d’innovation B.R.I.doit permettre de créer un environnement très favorableà l’émergence des biotechnologies industrielles,qui sont considérées comme un élément clef dans lerenouvellement de l’industrie chimique et des polymèresdevant permettre d’aller vers une plus grande utilisationdes ressources renouvelables et de satisfaire ainsiaux exigences d’une croissance durable. Dans le mondeentier, des entreprises spécialisées cherchent à substituerdes matières premières renouvelables au pétrole brut.Le projet global vise la constitution d’un écosystèmeimpliquant bien les trois piliers des pôles de compétitivité,à savoir les entreprises, les organismes de rechercheet les établissements d’enseignement supérieur. En l’occurrence,il se compose de quatre volets distincts :66R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
ROMAIN BEAUME ET VINCENT SUSPLUGASPhoto 1 : Plan d’ensemble du projet Bio-raffinerie.• 1) « BIODEMO », une unité de démonstration enbiotechnologies industrielles (blanches) permettant lamise au point et l’extrapolation de procédés dédiés à laproduction d’intermédiaires de synthèse (ou synthons)à une échelle limitant considérablement les risquesinhérents à l’industrialisation. Ce volet est porté par lasociété ARD, qui met ainsi son savoir-faire et ses équipementsau service d’entreprises extérieures ;• 2) un « institut de la bio-raffinerie », qui met en placeet gère des moyens communs (restauration, salles deréunion, espaces de travail, etc.) associés à une activitéd’animation, de développement de partenariats, decommercialisation et de communications. Ce volet doitêtre confié à une association constituée par les acteursde la plateforme ;• 3) un volet académique, le « centre d’excellence », quisera installé sur la plateforme dès la rentrée 2010, dansdes locaux adaptés et équipés, et animé par une équiped’enseignement et de recherche de l’Ecole CentraleParis, qui sera suivie ultérieurement d’une deuxièmeéquipe provenant d’Agro Paris Tech. Ce volet est portépar le Conseil général de la Marne, qui sera propriétairedes équipements, qu’il mettra à la disposition desenseignants-chercheurs, des thésards et des étudiants ;• enfin, 4) un volet intitulé « Technopôle » destiné àaccueillir de « jeunes pousses » créés sur les thématiquesde la raffinerie végétale, de la chimie « verte » ou de labiotechnologie industrielle (incubateur). Ce volet estporté et mis en œuvre par les Chambres de Commerceet d’Industrie de Reims et d’Epernay, ainsi que par leConseil régional de Champagne-Ardenne.Des exemples de laboratoires de recherche nouantdes liens durables avec les entreprises et les pôles decompétitivitéLe Technocampus EMC2 a été inauguré au mois deseptembre 2009. Il s’agit d’une plateforme de rechercheet technologies mise à la disposition des entreprises etdes chercheurs et dédiée à l’ensemble de la filière matériauxcomposites, depuis la conception de pièces jusqu’àleur production à l’échelle industrielle.Les partenaires présents sur le site sont :• des laboratoires universitaires de recherche de grandesécoles partenaires : l’Ecole Centrale, l’Ecole des Mines,l’ICAM et l’Ecole Polytechnique de l’Université deNantes ;• le pôle de compétitivité EMC2 ;• un centre d’expertises sur les composites, le CentreTechnique des Industries Mécaniques (CETIM) ;• des industriels fournisseurs de moyens technologiques: AIRBUS et EADS IW (Innovation Works).Technocampus EMC2 a été conçu pour répondre tantaux besoins communs qu’à des demandes spécifiquesémanant non seulement des différentes filières industrielles,mais aussi des pôles de compétitivité (notam-R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 67
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESment des pôles EMC2, Génie Civil Ecoconstruction etiDforCAR) et des PME-PMI désirant s’impliquer dansdes programmes collaboratifs ou dans des projets individuels,dans le domaine des matériaux composites.Un autre exemple est constitué, en France, par le pôlegrenoblois de nanoélectronique (MINALOGIC), qui aacquis le statut de référence internationale grâce au rôled’intégration technologique joué par le Leti. Cet écosystèmea débouché, avec la création de MINATEC(2 400 chercheurs, 1 200 étudiants et 600 industriels etspécialistes du transfert technologique, regroupés sur20 hectares), sur la constitution d’un véritable campusd’innovation qui sera appelé à prendre encore plusd’ampleur avec le projet Giant (Grenoble Isère AlpesNanotechnologies). Le pôle toulousain AerospaceValley a, quant à lui, lancé la création de l’AerospaceCampus, qui vise à regrouper sur un site unique descentres de recherche privés et publics, des établissementsd’enseignement supérieur et des infrastructuresafin de soutenir le développement de PME.DES PLATEFORMES D’INNOVATIONAUX <strong>É</strong>COSYSTÈMES D’INNOVATIONLes plateformes d’innovation constituent les premièresbriques d’écosystèmes d’innovation et de croissance. LePrésident de la République a décidé, dans le cadre desinvestissements d’avenir (le « grand emprunt »), definancer des projets similaires (« plateformes mutualiséesd’innovation ») et de plus grande ampleur (« campusd’innovation – instituts de recherche technologique »(IRT)) : 3,2 milliards d’euros sont ainsi réservés pourfinancer ces projets, avec respectivement des enveloppesde 200 millions d’euros et de 3 milliards d’euros.Le développement, en France, d’écosystèmes compétitifsen matière d’innovation constitue, en effet, un axeprioritaire des investissements d’avenir. « Ces institutsde recherche technologique seront des plateformesinterdisciplinaires rassemblant les compétences de l’industrieet de la recherche publique dans une logique deco-investissements public-privé et de collaborationétroite entre tous les acteurs. Ils devront être labelliséspar un pôle de compétitivité et disposer d’une visibilitéinternationale » (1). Ils auront pour vocation de « renforcerles écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité» pour « viser le peloton de tête mondial dansleur domaine ».Le campus d’innovation, outil de gestion deparcours d’innovation articulant « techno push »et « market pull »Classiquement, deux grands modes d’organisation del’innovation sont possibles : le mode « techno push »etle mode « market pull ».Dans le mode dit « poussé » (« technology-push »), deséquipes de chercheurs mettent au point des technologieset leur cherchent, dans un second temps, des applicationscommerciales. Certaines innovations de rupturesont emblématiques des succès que peut rencontrercette approche, à l’instar du nylon, du laser, du transistorou encore des bio-puces. Néanmoins, ce mode d’organisationpeut déboucher sur des impasses, car il nepermet pas de focaliser l’effort de recherche.L’autre mode d’organisation de l’innovation repose, àl’inverse, sur une approche « tirée » (« market-pull »).Cette approche part des produits et services dont leconsommateur a envie et ceux-ci sont réalisés en utilisanten priorité des briques technologiques disponiblesdans l’entreprise ou sur le marché, bien souvent enallant chercher des technologies développées pourd’autres applications et nécessitant d’être adaptées à uncontexte d’utilisation nouveau. Dans un tel processusd’innovation, la difficulté est alors de concevoir dessolutions permettant de concilier l’horizon temporeld’un projet industriel et celui de la recherche. Selon lessecteurs, la mise en œuvre d’un projet de développementdure de quelques semaines à quelques années,alors que la construction d’une compétence scientifiqueou technique nouvelle nécessite plusieurs années.Les campus d’innovation technologique doivent sesituer à la jonction de ces deux logiques d’innovation etdévelopper une capacité de programmation de larecherche en fonction des besoins de marchés identifiés.Leur vocation est de permettre à des équipes d’explorersimultanément les technologies et les marchésafin de construire des feuilles de route qui soient partagéespar les entreprises et les laboratoires de recherche.C’est pourquoi il importe de rapprocher les sources deconnaissances. Les campus d’innovation visent donc lacréation d’écosystèmes favorables au pilotage de larecherche et du développement par l’innovation.Le campus d’innovation en tant qu’accélérateurdes démarches d’« innovation ouverte » propresaux pôles de compétitivitéLes processus d’innovation des entreprises connaissentactuellement une évolution vers des modes d’« innovationouverte ». Il s’agit pour elles de collaborer avecdes partenaires extérieurs (fournisseurs, clients, universités…)dans la conception d’innovations. Les travauxmenés récemment par l’OCDE (voir le rapportdu symposium «Open innovation in global networks »,décembre 2008) soulignent cette évolution :« Confrontées à une concurrence mondiale de plus enplus vive et à une hausse des coûts de la recherchedéveloppement(R-D), les entreprises ne peuvent plussurvivre sur leurs seuls efforts de R-D et elles doivent(1) Source : projet de loi de finances rectificative, pour 2010, textedéposé à l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010.68R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
echercher des modes nouveaux et plus ouverts d’innovation.Les activités d’innovation des entreprisess’internationalisent et se convertissent à « l’innovationouverte ». En outre, l’OCDE indique que cette évolutions’accompagne d’une « démocratisation » del’innovation, car les utilisateurs des innovations sontde plus en plus impliqués dans les processus d’innovation.L’enjeu est donc de créer des écosystèmes dans lesquelsdes entreprises collaborent tout autant que par le passéavec leurs fournisseurs et leurs clients, mais égalementavec les laboratoires et avec les consultants de R & Dprivés. Il est donc d’une importance fondamentale quela France se dote d’un certain nombre de campus danslesquels les pratiques d’innovation ouverte pourrontêtre largement adoptées afin d’accroître le potentield’innovation de notre pays. L’innovation ouverte supposeque les entreprises ne se basent plus principalementsur leurs propres recherches pour innover. Lespratiques d’innovation ouverte supposent que des écosystèmespuissent se constituer, dans lesquels desconnaissances internes à certaines entreprises doiventêtre « sorties » de la société (par l’intermédiaire de brevets,d’une entreprise commune, de spin-off) pour permettrede lancer des innovations. Pour faciliter l’implémentationde l’innovation ouverte, il est doncnécessaire que des écosystèmes se constituent, dans lesquelsdes entreprises de toute taille interagissent avecdes laboratoires de recherche, ainsi qu’avec des « intermédiairesde l’innovation ».L’exemple de la société néerlandaise Philips soulignel’importance d’une implication forte de la part desentreprises dans la création de tels écosystèmes ; il estemblématique des transformations actuelles des processusd’innovation. Son siège néerlandais (situé àEindhoven) accueille ses laboratoires, dont la localisationétait dans le passé tenue secrète. Philips a décidéde le transformer en un campus ouvert qui vise à favoriserl’innovation en facilitant l’échange des idées. Ceparc technologique d’une superficie de 174 000 m 2accueille des start-up, des centres de recherche (publicsou privés) autour des laboratoires de Royal PhilipsElectronics. Ce campus créé en 1999 a été ouvertdepuis lors aux autres entreprises high tech, ainsi que,depuis 2004, aux instituts de R&D. Il préfigure denouveaux écosystèmes d’innovation : 25 entreprises etcentres de R&D, outre Philips, y sont installés, de7 000 à 8 000 ingénieurs, chercheurs et entrepreneursy travaillent conjointement et s’organisent pour échangerleurs équipements et leurs innovations. La croissancede ce campus a été soutenue, dans sa phased’ « ouverture », par différents partenaires (RoyalPhilips Electronics NV, le ministère de l’Economienéerlandais, la ville d’Eindhoven…).EN CONCLUSIONPour être efficace, une politique de l’innovation doits’appuyer sur un management collectif en la matièrerenforçant la performance et le nombre des interactionsentre acteurs industriels et monde de la recherche,notamment au sein des pôles de compétitivité. Face àcet enjeu, la création de plateformes d’innovation et decampus d’innovation technologique devra accroître lafréquence et l’intensité des relations entre grandesentreprises, PME et laboratoires de recherche en matérialisantet en renforçant le cœur de l’écosystème despôles de compétitivité les plus performants.En interagissant plus fréquemment, ces acteurs pourrontinitier une dynamique d’innovation et de transfertsde savoir-faire qui se matérialisera par un flux régulierde nouveaux projets innovants tournés vers le marché.ROMAIN BEAUME ET VINCENT SUSPLUGASR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 69
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOISDANS LES TERRITOIRESCréer des emplois dansles territoires : quelqueséléments de prospectivedes investissementsindustriels en FranceL’évolution de l’investissement est à juste titre considérée comme unfacteur décisif des perspectives de croissance économique et decréation (ou de maintien) d’emplois sur les territoires. Un effort réel d’investissement(celui-ci étant entendu au sens large d’investissement matériel +investissement immatériel) d’une entreprise est, en effet, pour celle-ci, lacondition impérative de l’amélioration de son efficacité productive, du développementde ses innovations et de ses implantations à l’étranger et de saconquête de nouveaux débouchés, en un mot, de la garantie de sa compétitivitédurable sur les marchés…par Gilles LE BLANC*Or (c’est là désormais un constat largement étayéet partagé), notre industrie souffre d’un déficitd’investissement à la fois dans les moyens deproduction, dans la recherche et développement(R&D) et dans la commercialisation (publicité, design,marques). Pour établir quelques éléments de prospective,nous commencerons par repérer les principales tendancesactuellement à l’œuvre pour nous interrogerensuite sur leur poursuite (ou sur leur correction éventuelle).Puis, nous examinerons les déterminants possiblesdes futurs investissements industriels, en tenantcompte de l’évolution envisageable des champs d’activité,des produits et de la structure de l’industrie.Depuis une vingtaine d’années, deux grands processusbouleversent les contours traditionnels de l’investissementindustriel : d’une part, une baisse continue dutaux d’investissement des entreprises (rapporté à leurvaleur ajoutée) que ne compense pas une apparenteattractivité des financements étrangers et, d’autre part,une dispersion croissante des destinations sectorielles etde la nature des investissements liés à l’industrie.En 2008, le taux d’investissement corporel dans l’ensembledes branches industrielles (agroalimentaire +industrie manufacturière + énergie) s’est élevé à 18,7 %de la valeur ajoutée. En 2007, une forte hausse de l’investissementavait mis fin au sous-investissement marquéde la période 2002-2006. Malheureusement, cettereprise, fort attendue, a été stoppée net par la crisefinancière et économique à partir de la mi-2008,* Professeur d’économie, Mines ParisTech.70R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
puisque l’on estime que l’investissement industriel aconnu un recul, par la suite, de 20 à 25 %. Or, sontaux, de 18-19 %, était déjà inférieur à ceux des années1980 et des années 1990 (qui était de 20 %, en moyenne).Cette donnée agrégée masque également des situationstrès différenciées selon les secteurs, ce qui est asseznaturel, mais aussi selon la taille des entreprises, ce quisignale un problème de nature plus structurelle. Ainsi,d’après les données de la Centrale des bilans de laBanque de France, l’investissement des petites etmoyennes entreprises de l’industrie manufacturières’est élevé à 12 % de la valeur ajoutée en 2008. Une tendanceidentique est observée en ce qui concerne l’effortde R&D des entreprises, qui a décliné, passant de1,5 % du PIB, en moyenne, dans les années 1990, àmoins de 1,3 % en 2007, soit un niveau inférieur de30 % à ceux de l’Allemagne ou des Etats-Unis et deuxfois moindre que celui du Japon.Ce recul continu des dépenses d’investissement corporelet de R&D ne peut être compensé par l’attractivitédu territoire français, dont on vante la deuxième outroisième place qu’il occupe régulièrement dans les destinationsdes investissements directs à l’étranger.Les deux tiers des 421 projets d’investissements recensésen 2009 par l’Agence Française pour lesInvestissements Internationaux (AFII) visent, certes, lesecteur manufacturier (principalement l’énergie etl’agroalimentaire). Mais, dans cet ensemble, la fonctionvéritablement productive ne concerne que 30 % desinvestissements.Mais surtout, le niveau élevé des investissements étrangersen France, tel que mesuré dans la balance des paiementsde la Banque de France, mérite un examendétaillé. On s’aperçoit, en effet, que les deux tiers des43 milliards d’euros comptabilisés en 2009 sont classésdans la rubrique « autres opérations ». Il s’agit dans unelarge mesure de prêts et de flux de trésorerie à l’intérieurde groupes, suite à la concentration de leurs opérationsde financement par les grandes entreprises mondialesdans des structures ad hoc implantées dans certains paysattractifs. Il s’ensuit une majoration artificielle des fluxd’investissement entrants. En suivant le principe dereclassement « directionnel étendu » proposé parl’OCDE, le niveau annuel des investissements étrangersen France passe de 57, 70, 43 et 43 milliards d’eurosrespectivement, entre 2006 et 2009, à seulement20, 32, 12 et à un déficit de 4 milliards d’euros aprèsun tel retraitement.La seconde tendance structurelle actuellement constatéeest un brouillage continu des frontières et ducontenu des investissements liés aux activités industrielles.Une première manifestation en est leur extensionsectorielle au-delà du périmètre manufacturiertraditionnel, dans le champ des services, à la suite duprocessus d’externalisation constaté au sein des entreprises.Bien que l’on considère habituellement les servicescomme des activités à faible investissement, on noteraque dans la branche des services aux entreprises, la formationbrute de capital fixe s’est élevée en 2009 à 53milliards d’euros, soit à 18,5 % de la valeur ajoutée, unniveau comparable à celui du monde industriel. Ceteffort massif d’investissement est essentiellementconcentré dans deux secteurs, celui du conseil et assistance(informatique, ingénierie) et celui des servicesopérationnels (location sans opérateur mettant demanière temporaire des équipements lourds variés à ladisposition des entreprises). Environ 40 % de l’activitéde la branche des services aux entreprises provenantd’une demande émanant des secteurs industriels, onmesure à quel point le volume des investissements liésà l’industrie est plus large que ne l’évaluent les classificationsstatistiques en usage.La seconde évolution majeure concerne la nature desinvestissements, avec un poids croissant des investissementsimmatériels, qui dépassent désormais les investissementscorporels classiques. Ces nouveaux investissementsindustriels jouant un rôle décisif dans lacompétitivité de l’offre des entreprises se déploient dansdeux domaines, de façon comparable (20 milliardsd’euros chacun) : la R&D et la mise en marché des produits(publicité, design, marketing).Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces évolutions encours, pour l’avenir des investissements industriels ? Lepremier processus mis en évidence a plusieurs conséquencesimportantes : le vieillissement de l’appareilproductif, un déficit croissant d’efficacité et d’innovationpar rapport aux concurrents et, surtout, un effortfinancier encore plus considérable à consentir dans lefutur pour rattraper ces handicaps.Compte tenu de l’intensité de la concurrence désormaismondiale, des difficultés persistantes rencontréespar les entreprises dans leur recherche de crédits et demontants en jeu qui ne cessent d’augmenter, uneinversion de tendance spectaculaire est peu probable àcourt ou moyen terme. Ce diagnostic agrégé pourracependant être infirmé pour certains secteurs particuliersou pour des groupes d’entreprises bénéficiant deperspectives prometteuses et pouvant tirer profit destrès bas taux d’intérêt à long terme, cela, au prix d’uneforte concentration et spécialisation de l’investissementindustriel.La seconde tendance identifiée (fractionnement sectorielde l’investissement industriel et poids croissant del’immatériel) devrait, pour sa part, logiquement se prolonger(voire s’intensifier) sous le double effet de la diffusionaccrue des technologies numériques et d’uneimbrication croissante entre biens et services, en particulierdans ces domaines prometteurs que sont l’environnement,la santé ou l’énergie.Une seconde approche de la prospective des investissementsindustriels consiste à partir des caractéristiquesanticipées de l’industrie future pour en déduire lesbesoins, les formes et les lieux privilégiés d’investissement.On proposera de l’organiser autour de troisgrandes variables explicatives : la nature des futures activitésindustrielles de croissance, les acteurs et le degrépossible de différenciation territoriale.GILLES LE BLANCR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 71
CR<strong>É</strong>ER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRESUn paramètre essentiel pour analyser les futures opportunitésindustrielles dans notre pays est la notion defrontière technologique, qui regroupe, pour chaquecatégorie de biens ou de services, les meilleures technologieset configurations existantes.L’Europe et la France se situent depuis quelque tempsdéjà sur cette frontière technologique. Contrairementaux pays émergents, qui se lancent dans une stratégie derattrapage visant à produire et commercialiser des biensdéjà existants, tout l’enjeu consiste ici à inventer, àmettre au point, à valider et à faire diffuser des offresradicalement nouvelles. Il s’agit donc largement d’unprocessus d’expérimentation, de tâtonnement, debouillonnement créatif, avec d’inévitables redondances,gaspillages ou échecs.Plusieurs demandes économiques et sociales nouvellesoffrent un point d’appui pour développer ces nouvellesactivités industrielles : l’environnement, la santé, les loisirsculturels… Dans tous ces cas, il n’y a pas de solutiontechnologique, de format de bien ou de service,d’organisation productive et de modèle économiquequi s’imposeraient spontanément, mais, au contraire,de multiples possibilités s’offrent.Dans cet univers d’expérimentation et de variété, lesinvestissements dans la R&D, dans la production etdans la commercialisation seront vraisemblablementplus fragmentés, de plus petite taille et d’une durée devie plus courte qu’aujourd’hui. Ce contexte spécifiqueoffre une première opportunité de positionnementsgéographiques différenciés entre territoires pour l’accueil,la conduite et la consolidation d’investissementsindustriels.Il faut ensuite s’interroger sur le possible visage futur dela structure industrielle de notre pays. Celle-ci se caractériseaujourd’hui par un petit nombre de très grandesentreprises, une quasi-absence, désormais criante, d’entreprisesintermédiaires et de nombreuses PME et TPE.En 2008, seulement 4 % des entreprises industriellesont plus de cinquante salariés, 82 % en ont moins dedix, et 14 % en ont entre dix et quarante-neuf. Ce vastetissu méconnu de PME (souvent familiales et dirigéespar leurs propriétaires fondateurs) est clairement menacé,sur le court terme, par la consolidation internationaleaccélérée de grandes firmes globales (y comprisd’origine domestique), par le départ à la retraite prochainde nombreux dirigeants-actionnaires principauxet par l’effort financier croissant d’investissement et deR&D requis pour rester compétitif.A partir de là, on peut imaginer deux scénarios diamétralementopposés : soit un affaiblissement lent, maiscontinu, de ce tissu de PME (le paysage industrielconservant sa structure actuelle, mais à une échelle plusréduite ; la large couverture sectorielle et géographiquede l’industrie domestique serait ainsi amoindrie maismaintenue) ; soit, dans un second scénario, la concurrenceintensifiée et le départ à la retraite massif de dirigeants(ainsi que d’une fraction importante des personnels)pourrait conduire, en l’espace de dix ou quinzeans, à la disparition presque complète de la myriade dePME et TPE existant actuellement (ne subsisteraientalors que les très grandes firmes globales et un réseau destart-up et de jeunes petites entreprises centrées sur l’innovationet en recomposition permanente en matièrede produits, d’actifs et de main-d’œuvre).Dans le premier cas, les formes et la géographie de l’investissementindustriel resteraient sensiblement lesmêmes qu’aujourd’hui, mais à un niveau bien entenduinférieur et décroissant.Dans le second cas, on assisterait, à l’opposé, à unereconfiguration complète et très ouverte, à ce stade, deslieux d’investissement privilégiés (concentrés sur lespetites firmes innovantes et les grands groupes mondiaux),ainsi que de la nature de ces investissements.Pour apprécier la rupture potentielle, il suffit de rappelerqu’en 2008, 30 % des investissements sont consacrésau renouvellement d’équipements, contre 20 % àleur modernisation et seulement 15 % à l’introductionde nouveaux produits.La troisième variable à prendre en considération estl’ouverture possible d’un degré territorial de différenciationdes investissements industriels. En raison dupoids des normes et des standards, des éventuellesréglementations nationales et/ou européennes et de larecherche d’économies d’échelle, cette dimension a étélargement absente, dans le passé. Pour un type donnéde bien (ou de service), les technologies, les formesd’organisation et les modèles économiques étaient sensiblementles mêmes, quel que soit le lieu d’implantationen France. Mais comme on l’a vu, il n’est pas dit,compte tenu du poids des caractéristiques d’usage et dela variété technologique existante, que dans les secteursprésentant les opportunités de croissance industrielleles plus prometteuses (environnement, santé, culturelnumérique), une seule solution s’imposera et dominerale marché.On peut, au contraire, imaginer qu’à l’issue de la phased’expérimentation et de validation des offres potentielles,subsisteront plusieurs modèles et configurations.Cette possibilité ouvre un espace potentiel de différenciationterritoriale permettant la coexistence, dans unmême secteur, d’investissements industriels déconcentréscorrespondant à des trajectoires distinctes, avecpour résultat une rupture historique avec la tendanceactuelle de très forte polarisation géographique des activitésindustrielles.Un paramètre inconnu, de nature politique et institutionnelle,très difficile à anticiper aujourd’hui, joueraun rôle décisif dans le jeu effectif des trois variablesbrièvement décrites précédemment : le degré d’autonomiedes territoires, à l’échelle de la région ou de groupesde régions, leur permettant de jouer un rôle actif dansces processus, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégieslocales avec des moyens qui leur soient propres.Selon l’évolution de l’organisation territoriale, lesmoyens financiers respectifs des acteurs (locaux et centralisés),la poursuite (ou non) de la dynamique européenneet le bilan des multiples initiatives observablesaujourd’hui dans les diverses collectivités territoriales, la72R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
alance penchera vers une réelle autonomie d’action,ou au contraire vers un maintien de l’équilibre actuel,souvent ambigu. Selon les cas, cela conduira égalementà une situation inédite dans notre histoire industrielle,à savoir une forte concurrence entre territoires enmatière d’investissement industriel, déjà perceptible àtravers quelques cas récents, comme Google ou FirstSolar, mais susceptible de prendre une tout autreampleur et de constituer de redoutables enjeux de politiquepublique.GILLES LE BLANCR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 73
HORS DOSSIERLes nanos :applications et enjeuxNous sommes déjà entrés dans le nanomonde. Il existe aujourd’huisur le marché plus de huit cents produits dont la fabrication faitappel aux nanotechnologies : écrans plats à base de LED organiques,pneus de voiture contenant des nano-céramiques, crèmessolaires à base de nanoparticules de titane, peintures pour automobilesqui ne se rayent pas, raquettes de tennis dont le cadre est renforcépar des nanotubes de carbone… Ce nombre ne cesse decroître : selon certaines estimations, le marché mondial des produitsnano dépassera 1 000 milliards de dollars en 2015.par Ilarion PAVEL*Quel est l’intérêt des nanotechnologies ? Ellespermettent de fabriquer des produits pluspetits, plus légers et moins chers : des ordinateursplus performants, des moyens de communicationplus rapides, des traitement médicaux plus efficaces, uncadre de vie plus agréable, et cela, en respectant l’environnement.PR<strong>É</strong>HISTOIRE DES NANOTECHNOLOGIESDes produits nano existent depuis longtemps. Parexemple, la coupe de Lycurgue, conservée au BritishMuseum, qui date du IV e siècle. Eclairée en réflexion,elle est verte, alors qu’en transmission elle est rouge : cephénomène surprenant s’explique par la présence, dansle verre, de particules d’or et d’argent de taille nanométrique(voir les photos 1 et 2). Les fameuses lames deDamas, fabriquées avant le XI e siècle, doivent leur soliditéexceptionnelle à des nanoparticules de carbone présentesdans l’acier qui les constitue. Quant aux couleursvives des vitraux des cathédrales gothiques, elles sontdues à des nanoparticules d’or.Nos ancêtres ont fabriqué ces produits par pur hasard,par un «accident heureux», grâce à leur travail et leuringéniosité, sans posséder les moindres connaissancesen nanotechnologies et cela doit nous inspirer un profondrespect.Ce n’est que dans les années 1980 que les nanotechnologiescommencent à se développer, avec l’invention dumicroscope à effet tunnel par Gerd Binnig et HeinrichRohrer (prix Nobel de physique en 1986), puis avec ladécouverte des fullerènes par Harold Kroto, RichardSmalley et Robert Curl (prix Nobel de chimie en1996). Désormais, il s’agit d’une ingénierie de la matièreréalisée intentionnellement et non plus par hasard.Depuis les années 1990, elles connaissent un granddéveloppement.L’enjeu des nanotechnologies : concevoir et fabriquerdes structures, des dispositifs et des systèmes en structurantla matière au niveau atomique ou moléculaire, àune échelle située en dessous de 100 nanomètres (rappelonsqu’un nanomètre (nm) représente un milliardièmede mètre, soit 0, 000 000 001 mètre ; il est environ500 000 fois plus petit que l’épaisseur d’un trait de styloà bille, 30 000 fois plus fin que l’épaisseur d’un cheveuet représente quatre atomes de silicium mis l’un à côtéde l’autre).* Ingénieur en chef des Mines (ilarion.pavel@mines.org).74R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Photos 1 et 2 : Lacoupe de Lycurgue,verte par réflexion,rouge en transmission.(© British Museum).ILARION PAVELA l’échelle nanométrique, des propriétés et des comportementsnouveaux apparaissent, qui sont spécifiquesà cette petite échelle et différents de ceux du matériaumassif d’origine de la nanoparticule : effets quantiques,grande réactivité chimique, effets spécifiques dus à lagrande surface de contact. Par exemple, l’or, à l’échellenanométrique, est de couleur rouge, un effet dû à desphénomènes quantiques faisant intervenir les plasmonsde surface (ce sont des oscillations collectives d’électronsqui se produisent à la surface d’un métal) et il estchimiquement réactif, contrairement à l’or massif, quidoit précisément sa valeur à sa passivité chimique quilui donne une grande stabilité dans le temps. <strong>É</strong>tant depetite dimension, une nanoparticule comporte relativementpeu d’atomes (quelques centaines ou quelquesmilliers), dont une forte proportion est située en surface,ce qui induit des contraintes sur son réseau atomique,le déforme, le réarrange et engendre beaucoupde défauts de surface : ce sont ces derniers qui augmententla réactivité de la nanoparticule par rapport aumatériau massif (voir la photo 3).Photo 3 : Une solution colloïdale d’or nanométriqueest de couleur rouge.LA MICRO<strong>É</strong>LECTRONIQUEET LES MICROSYSTÈMESRevenons au milieu du XX e siècle. L’invention (en1948) du transistor par John Bardeen, Walter Brattainet William Shockley (prix Nobel de physique en1956) marque le début d’un progrès fulgurant del’électronique. En raison de sa petite taille et de safaible consommation, le transistor remplace rapidementles tubes à vide, ouvrant la voie à la miniaturisation.En 1959, Jack Kilby (prix Nobel de physiqueen 2000) et Robert Noyce ouvrent la voie à la microélectroniqueen réalisant le premier circuit intégré : sescomposants électroniques sont interconnectés, dèsleur fabrication, sur un support commun en silicium,appelé puce. Depuis quarante ans, le nombre destransistors sur la surface d’une puce double tous lesdix-huit mois (ce phénomène est décrit par la loi deMoore). Actuellement, un microprocesseur d’ordinateurcontient plus d’un milliard de transistors, dont lataille spécifique est de 45 nm (voir le graphique et laphoto 4).Les technologies développées dans l’industrie microélectroniqueont été transposées avec succès dans lafabrication de microsystèmes : accéléromètre, laboratoiresur puces, puce à ADN, distributeur d’insuline.Les applications concernent aussi bien la sécurité et lanavigation aérienne, que les outils médicaux de diagnosticet de soin. Elles sont fondées sur le concept defabrication appelé « top-down » (par voie descendante) :Graphique et photo 4 : Loi de Moore : le nombre de transistors sur la surface d’une puce double tous les 18 mois.(© Intel).R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 75
HORS DOSSIERPhotos 5 et 6 : Image d’une surface de graphite vue avec le microscope à effet tunnel (© Bruno Fouquet).on part d’un matériau, on le découpe et on le «sculpte»pour fabriquer un composant aux dimensions les pluspetites possibles.Mais cette course à la miniaturisation devient aujourd’huide plus en plus difficile. D’abord pour des raisonstechniques : plus les transistors sont petits, plus il estdifficile de dissiper la chaleur que produit leur fonctionnement.De plus, à l’échelle nanométrique, les loisde la physique quantique commencent à se manifesteret elles sont susceptibles de perturber le fonctionnementnormal des transistors, qui sont conçus sur lesfondements de la physique classique.Ensuite, pour des raisons économiques. Certes, avec laproduction de masse, le coût de fabrication d’un transistordiminue, mais, en même temps, les investissementsnécessaires à la mise en place de procédés defabrication de plus en plus sophistiqués deviennentprohibitifs : aujourd’hui, le coût d’une usine de fabricationde microprocesseurs atteint 3 milliards d’euros.Un changement de technologie est donc nécessaire etles nanotechnologies pourraient apporter une réponse.D<strong>É</strong>COUVERTES SCIENTIFIQUESDANS LE NANOMONDELe premier instrument mis au point pour voir le nanomondefut le microscope à effet tunnel. Pendant que sapointe métallique très fine balaye la surface du matériauà quelques nanomètres de distance, seulement, decelui-ci, on applique une tension électrique qui fait passerdes électrons, par «effet tunnel», entre la pointemétallique et la surface de l’objet. Après avoir enregistréles variations de ce courant, on reconstitue par ordinateurle relief de la surface survolée avec une précisionde l’ordre de l’atome, soit 0,1 nm. Mais le microscopeà effet tunnel permet de visualiser exclusivement desmatériaux conducteurs (voir les photos 5 et 6).Pour examiner des matériaux isolants (comme les polymères,les céramiques ou les cellules vivantes), on aconçu le microscope à force atomique. Celui-ci disposed’une pointe fixée sur un bras de levier flexible, quibalaye et interagit avec la surface du matériau à observeren en suivant le relief. La déformation du levier,mesurée à l’aide d’un faisceau laser, est enregistrée parun ordinateur.Ces instruments étaient initialement conçus pourobserver la surface des matériaux. Aujourd’hui, onpeut aussi les utiliser pour déplacer les atomes un parun, à l’instar d’une « pince à atomes », afin d’assemblerla matière atome par atome et de construire desédifices moléculaires que l’on peut intégrer dans dessystèmes plus grands : c’est la technique de fabricationsuivant le concept appelé « bottom-up » (voieascendante). Mais construire des nano-objets à l’aided’un microscope à force atomique reste une techniquede laboratoire que l’on peut qualifier d’artisanale: elle ne permettra pas une production industrielle,car déplacer les atomes, un par un, avec la«pince à atomes» demanderait beaucoup trop detemps.D’autres solutions émergent peu à peu, qui exploitentà la fois les avancées de la physique, de la chimie et dela biologie pour fabriquer des objets nanométriques ensérie.Une des méthodes prometteuses, inspirée de la physiquedes surfaces, est l’auto-organisation, qu’illustrele processus de la formation de la buée sur les vitres :la vapeur d’eau se condense de façon uniforme sur lasurface de la vitre en formant une multitude demicrogouttes régulières. Ainsi, les exemples les plusréussis de nano-systèmes bâtis selon la voie ascendantesont ceux réalisés par la nature dans un processusd’évolution de plus de 3,5 milliards d’années, qui adonné naissance au monde du vivant, si riche et sicomplexe, que nous connaissons aujourd’hui (voir laphoto 7).D’autres techniques nouvelles permettant la fabricationindustrielle de nano-objets sont en cours de développement.En attendant, plusieurs types de nanoparticulessont déjà utilisés :• le nanotube de carbone, mis en évidence en 1991par Sumio Iijima (NEC, Japon) est un feuillet de graphiteformé d’atomes de carbone disposés en réseauhexagonal (évoquant un nid d’abeilles) et enroulé surlui-même, comme un cigare. Son diamètre est del’ordre du nanomètre et sa longueur peut atteindre76R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Photo 7 : Auto-organisation : les molécules, qui ontune terminaison spécifique (en jaune), s’attachent ausubstrat et s’ordonnent (© Bruno Fouquet).plusieurs micromètres. Les nanotubes de carbone sontcent fois plus résistants que l’acier, et six fois pluslégers. Ils sont déjà utilisés dans la fabrication dematériaux composites à hautes performances pourarticles sportifs : cadres de vélo, raquettes de tennis,clubs de golf. Du fait de la petite taille caractéristiquede toute nanoparticule, les nanotubes ont une trèsgrande surface de contact, ce qui les rend intéressantsdans la catalyse chimique, le filtrage de polluants, lafabrication d’électrodes pour batteries électriques oules piles à combustible. Leurs propriétés électriquesspéciales, très sensibles lorsque des molécules étrangèress’y accrochent, les rendent particulièrementadaptés à un usage dans des capteurs chimiques etbiologiques (voir la photo 8) ;• des nanoparticules d’oxyde de titane sont déjà courammentutilisées comme filtres dans les crèmessolaires pour leur capacité d’absorber les rayons ultraviolets.Si elles étaient de taille micrométrique, cesparticules diffuseraient la lumière visible, ce qui rendraitla crème de couleur blanche, donc peu esthétique.En diminuant leur dimension jusqu’à l’échellenanométrique, elles ne diffusent plus la lumière, maiselles gardent leur propriété d’absorption des ultraviolets.Photo 8 : Structure d’un nanotube de carbone.(© Chris Ewels, www.ewels.info).TROIS CHAMPS D’APPLICATIONDES NANOTECHNOLOGIES : L’<strong>É</strong>LECTRONIQUE,LE BIOM<strong>É</strong>DICAL ET LES MAT<strong>É</strong>RIAUXLes nanotechnologies vont permettre de poursuivre lesprogrès de l’électronique :• diodes électroluminescentes organiques (OLED) : cesdernières années, les OLED se sont imposées commeune technologie bon marché pour la fabrication desécrans plats et elles ouvrent de nouvelles perspectivespour l’éclairage. Une OLED est constituée d’un polymèreélectroluminescent pris en sandwich entre deuxélectrodes : une cathode en aluminium ou en calcium,qui injecte des électrons, et une anode transparente enoxyde d’indium-étain, qui injecte des « trous » (desmanques d’électrons). C’est dans le polymère qu’a lieula recombinaison des électrons et des trous, ce quiengendre de la lumière qui s’échappe ensuite par l’anodetransparente. Mais l’indium est un élément chimiquerare et l’électrode d’indium-étain est fragile,donc peu flexible. La remplacer par des nanotubes decarbone permettra de fabriquer des anodes plusflexibles et moins chères ;• spintronique : l’électronique d’aujourd’hui est fondéesur la propriété qu’a l’électron, chargé électriquement,d’interagir avec les champs électriques. Mais l’électronpeut aussi, comme une minuscule boussole, s’orienterdans les champs magnétiques grâce à son spin, qui peutêtre assimilé à sa rotation autour d’un axe (comme larotation d’une toupie). C’est sur ce type d’interactionqu’est fondée la magnétorésistance géante, un effetquantique observé quand on superpose en alternancedes couches de fer et de cuivre d’épaisseur nanométrique.La résistance électrique mesurée perpendiculairementà ces couches dépend de l’orientation magnétiquerelative des couches de fer, qui dépend elle-mêmedu champ magnétique externe. Grâce à l’application dece principe, les têtes de lecture des disques durs desordinateurs d’aujourd’hui sont extrêmement sensibles,ce qui a permis de réduire la taille des domaines magnétiquesdu disque dur et donc d’augmenter sa capacité.Les recherches continuent pour développer une électroniquede spin (ou spintronique) qui permettrait demettre au point de nouveaux composants électroniques,en particulier des mémoires miniaturisées ;• transistors moléculaires : un grand défi de l’électroniqueest de remplacer le transistor classique par unemolécule chimique ou biologique fonctionnantcomme un interrupteur de courant électrique, ouvrantainsi la voie à l’électronique moléculaire. La taille dutransistor pourrait être divisée par mille, ce qui permettraitde fabriquer des ordinateurs beaucoup plus petits,plus rapides, moins chers et consommant moins d’électricité(voir la photo 9) ;• ordinateur et cryptographie quantiques : l’informationet la communication quantiques sont un autredomaine d’avenir. L’enjeu est de réaliser un ordinateurILARION PAVELR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 77
HORS DOSSIERPhoto 9 : Transistor moléculaire à base de la moléculede benzènethiol (© Bruno Fouquet).quantique doté d’une immense puissance de calcul,outrepassant les capacités de tous les ordinateurs classiqueset permettant notamment des communicationstotalement sécurisées, impossibles à intercepter sansque l’on ne s’en rende compte. Aujourd’hui, les avancéesde la cryptographie quantique permettent desapplications industrielles dans la transmission sécuriséedes clés de cryptage, mais en raison des difficultés techniquespour mettre au point un système physique quisoit capable d’effectuer un calcul quantique (il fautminimiser le couplage avec l’environnement afin d’empêcherla perte rapide de cohérence quantique), l’ordinateurquantique ne sera pas réalisé dans un futurproche ;En biomédecine, les applications sont également prometteuses.Dans le passé, déjà, les avancées de la physique,en particulier de l’optique, ainsi que le développementde l’ingénierie ont apporté une contributioncruciale au développement des moyens d’observationdu monde vivant. Sans l’invention du microscope, auXVII e siècle, par Zacharias Jansen, et sans les améliorationsqu’y a apportées Anton von Leeuwenhoek, lescours de biologie se limiteraient encore aujourd’hui à ladissection d’animaux et le soin médical à l’utilisation deplantes médicinales. Sans le microscope électronique,on aurait été incapable de voir la structure d’une celluleet sans les rayons X, le code génétique garderait encoreses secrets. Plusieurs applications sont en cours dedéveloppement :• vecteurs de médicaments : ils sont conçus à base devésicules, appelées liposomes, qui encapsulent le médicament,ou à base de dendrimères, des molécules trèsramifiées (comme les branches d’un arbre, d’où leurnom), sur lesquelles le médicament est accroché. Levecteur empêche la dilution du médicament dans lesang et sa dégradation à travers les barrières immunitairesdu corps humain : le médicament n’est libéré deson vecteur qu’une fois arrivé à la cible visée (un organe,un tissu, voire une cellule) et le vecteur est alorsdégradé par l’organisme. La vectorisation permet ainside mieux cibler le médicament et donc d’en diminuerla dose administrée (et ainsi les effets secondaires) (voirla photo 10) ;• imagerie médicale : des nanoparticules magnétiques,utilisées comme agents de contraste, augmentent localementle champ magnétique mesuré par les appareilsd’imagerie par résonance magnétique. Si l’image meten évidence une tumeur, on peut alors attacher auxnanoparticules des anticorps qui vont se fixer spécifiquementsur cette tumeur. A l’aide de rayonnementsinfrarouges ou micro-ondes que captent les nanoparticules,on chauffe la tumeur, ce qui permet de la détruire;• implants et prothèses médicales : on recouvre la surfacedes implants et des prothèses médicales d’un revêtementnano-poreux en titane, qui les rend davantagebiocompatibles et plus faciles à tolérer par le patient.Des structures nano-poreuses en apatite (phosphate decalcium) sont par ailleurs utilisées comme échafaudagepour la régénération de l’os en cas de fracture : grâce àla structure lacunaire de cette structure nano-poreuse,les cellules osseuses se développent plus facilement etremplacent l’apatite nano-poreuse par de l’os (voir laphoto 11).Photo 10 : Vecteur de médicament à base de liposome: le médicament est encapsulé par le liposome. Despolymères y sont attachés pour lui permettre de traverserles barrières immunitaires du corps humain(© François Caillaud, Sagascience, CNRS).Photo 11 : Prothèse de fémur recouverte de titanenano-poreux (© Primal Cry).78R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Photo 12 : Solutions contenantdes marqueurs moléculaires classéspar taille croissante. Première rangée: ils sont éclairés par la lumièrevisible. Deuxième rangée : éclairéspar un rayonnement ultraviolet.En dessous, structure d’un marqueurmoléculaire : les dimensionsdu grain déterminent la couleur dela lumière émise, la coque amplifiecette couleur et le ligand permet dele fixer sur la cible.(© CEA-DRFMC).ILARION PAVEL• marqueurs moléculaires : certaines nanoparticulesémettent de la lumière quand elles sont éclairées enultraviolet. Ce phénomène, appelé fluorescence, est dûà des effets quantiques qui apparaissent en raison deleurs très petites dimensions. Elles peuvent être utiliséescomme sondes fluorescentes, des marqueurs moléculairesqui suivent la trace des réactions chimiques ou desprocessus biologiques à l’intérieur des cellules de l’organismehumain (voir la photo 12).D’autres domaines très prometteurs de la médecine,comme la thérapie génique ou l’utilisation des cellulessouches, auront sans doute besoin d’outils perfectionnésque seules les nanotechnologies sont en mesure deleur fournir.Le troisième champ d’application important est la sciencedes matériaux. Au XX e siècle, déjà, c’est l’invention denouveaux matériaux qui a largement permis les progrèsspectaculaires de l’aéronautique, de l’exploration spatialeet océanique et de l’observation astronomique. Unbon nombre de ces matériaux ont ensuite trouvé desapplications dans des objets courants, comme les automobiles,les bateaux à voile, les skis, les raquettes de tennis,les vestes en Goretex ou les poêles à frire. Les nanotechnologiespermettent d’améliorer des matériauxexistants ou d’en mettre au point de nouveaux :• polymères composites : un enjeu important pour l’aéronautiqueest de remplacer le fuselage métallique desavions par des matériaux composites à base de polymères,moins chers, plus légers et plus résistants à lacorrosion. Mais, contrairement aux métaux, les polymèressont des isolants électriques, ce qui pose problèmeen cas de coup de foudre sur l’avion. L’adjonctionde nanotubes de carbone au matériau polymère peutrendre celui-ci conducteur. Par ailleurs, la faible résistanceau feu des polymères peut être améliorée parl’ajout de nanoparticules de céramique, qui les rendentignifuges ;• revêtements antibactériens : jusqu’à présent, on utilisaitdes substances chimiques antiseptiques. Une autresolution consiste à recourir à des revêtements à base denanoparticules d’argent. En effet, les ions argent ont unfort effet antibactérien : ils fragilisent la membrane cellulairede la bactérie, bloquent la réplication de sonADN et perturbent la respiration cellulaire. Ce type derevêtement peut être utilisé dans les installations deventilation, dans les hôpitaux ou dans la fabrication desinstruments médicaux ;• matériaux auto-réparateurs : on introduit dans lematériau des polymères encapsulés, ainsi qu’un durcisseur(une substance chimique ayant la propriété,comme son nom l’indique, de durcir le polymère). Encas de fissure, les capsules éclatent et libèrent le polymère,qui, en s’écoulant dans la fissure, entre en contactavec le durcisseur et répare ainsi le matériau (voir laphoto 13) ;• isolants thermiques : il s’agit d’utiliser un aérogel, unmatériau nano-poreux contenant jusqu’à 99,8 % d’air,ce qui lui confère une capacité d’isolation exceptionnelle,l’air étant un très mauvais conducteur de chaleur.Un grand défi serait de fabriquer des aérogels parfaitementtransparents, afin de pouvoir les utiliser pourl’isolation des vitres (voir la photo 14).Par leur nature, les nanotechnologies constituent undomaine interdisciplinaire et elles promettent desapplications dans de multiples secteurs industriels(électronique, biotechnologies, santé, énergie, environnement,sécurité) : c’est ce qu’on appelle une technologiediffusante (comme l’électricité l’a été, à la fin duXIX e siècle).<strong>É</strong>NERGIE, ENVIRONNEMENT, S<strong>É</strong>CURIT<strong>É</strong>De la production d’énergie propre à la diminutionde l’impact écologique des activités humaines, lesapplications industrielles des nanotechnologies sontvariées :R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 79
HORS DOSSIERPhoto 13 : Matériau auto-réparateur: en cas de fissure, les capsuleséclatent, libérant le polymère, quiréagit avec le durcisseur et réparele dommage.(© Advanced Materials).Photo 14 : Les aérogels sont des isolants thermiquesexceptionnels (© NASA/JPL-Caltech).• cellules photovoltaïques : les cellules photovoltaïquestraditionnelles, à base de silicium ou d’arséniure de gallium,nécessitent des matériaux d’une grande pureté etdes processus technologiques coûteux. Les effortsactuels visent à les remplacer par des matériaux organiques,qui mimeraient la photosynthèse des plantes.Ces nouvelles cellules photovoltaïques, moins coûteuses,sont en outre flexibles : elles peuvent donc épouserdes surfaces courbes. Elles utilisent un matériauorganique, appelé colorant, dont la molécule, en absorbantla lumière, passe dans un état excité, puis cède unélectron à une nanoparticule de dioxyde de titane, quisera finalement conduit vers une des électrodes.L’ensemble est plongé dans une solution d’iode, quiassure la conduction électrique entre le colorant et ladeuxième électrode ;• piles à combustible : elles pourraient équiper les voituresélectriques et les appareils électriques portables.Elles sont l’énergie propre par excellence, car leur seulrésidu est de l’eau. Leur fonctionnement repose sur ladécomposition catalytique de l’atome d’hydrogène enun proton et un électron, qui a lieu à l’anode. Tandisque le proton est transporté à l’intérieur de la pile, viaune membrane polymère, vers la cathode, où il se combineà l’oxygène pour produire de l’eau, l’électron estforcé de rejoindre la même cathode, mais par le circuitextérieur, en produisant de l’électricité. L’utilisation decatalyseurs nano-poreux, grâce à leur grande surface decontact, augmente le rendement des piles à combustible.Des recherches visent, par ailleurs, à remplacer leplatine par des nanomatériaux moins onéreux ;• osmose inverse : quand on sépare de l’eau pure et del’eau salée par une membrane semi-perméable (qui laissepasser l’eau, mais pas le sel), l’eau tend à passer de lapartie pure vers la partie salée : ce phénomène est appeléosmose. Mais en augmentant suffisamment la pressiondans la partie salée, on inverse le sens du déplacement: c’est l’osmose inverse. Les nanotechnologiespermettent de fabriquer des membranes nano-poreusesplus résistantes et nécessitant une pression moins élevée,et donc de diminuer la consommation d’énergiepour désaliniser l’eau de mer, par exemple (voir laphoto 15) ;• dépollution des sols : conséquence des activités industrielles,certains sols sont contaminés par des substancestoxiques, telles que les solvants organiques chlorurésPhoto 15 : Osmose inverse : en appliquant une pression,l’eau traverse la membrane nano-poreuse, mais lesions de sel sont arrêtés.80R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
Photo 16 : Nanoparticule de fer utilisée dans la dépollutiondes sols : en s’oxydant, elle réduit le solvant chloruré(trichloréthylène) en hydrocarbure (éthylène) et enions de chlore non toxiques. Les ions de plomb Pb +2sont réduits en plomb métallique, qui se fixe dans le sol(© www.lawandenvironment.com).(trichloréthylène, tétrachlorure de carbone, dioxine) oules métaux lourds (chrome. plomb). Grâce à leur grandesurface spécifique, des nanoparticules de fer, injectéesdans le sol contaminé, réagissent avec les substancestoxiques en les réduisant en composés moinsnocifs. Par exemple, les ions Cr (VI) présents dans lescendres volantes des incinérateurs d’ordures ménagères,des ions très toxiques et solubles, sont réduits en ionsCr (III) non toxiques et insolubles, qui se fixent dans lesol et ne seront donc plus entraînés par la pluie dans lesnappes phréatiques. De même, les nanoparticules de feragissent sur les solvants chlorurés en les réduisant enhydrocarbures et en ions de chlore, qui ne sont pastoxiques (voir la photo 16) ;• purification de l’air : le trafic automobile dégrade laqualité de l’air à cause des émanations de monoxyde etde dioxyde d’azote, et de composés organiques volatils,qui peuvent causer des troubles respiratoires. On pourraitincorporer à la peinture des bâtiments urbains desnanoparticules d’oxyde de titane, qui ont un fort effetphoto-catalytique et peuvent dégrader ces émanationstoxiques. Sous l’influence des ultraviolets solaires, l’oxydede titane crée des radicaux libres, des substances chimiquesayant des électrons non appariés, et donc trèsréactives. Les oxydes d’azote présents dans l’air sontainsi transformés en ions nitrates, beaucoup moinstoxiques.Ces techniques de nano-filtration et de photo-catalysesont également utilisées pour traiter les eaux usées, tantindustrielles que domestiques.Enfin, un autre secteur industriel concerné est celui dela sécurité civile :• détection d’explosifs : il est facile de fabriquer desexplosifs. Il n’est nul besoin d’installations compliquées: il suffit d’avoir quelques connaissances de baseen chimie et quelques substances chimiques d’usagecourant, par exemple le TATP (tri-acétone tri-peroxyde),qui peut être synthétisé à partir d’acétone (un solvantutilisé pour enlever le vernis à ongles), d’eau oxygénéeet d’acide sulfurique, ce dernier jouant le rôle decatalyseur. Contrairement à la plupart des explosifs, leTATP ne contient pas d’azote, ce qui le rend difficile àdétecter par les systèmes classiques, fondés sur la miseen évidence de cet élément chimique. Relativementpuissant et faisant partie des rares explosifs à pouvoirdétonner en milieu humide ou dans l’eau, il est la causede l’interdiction des liquides dans les bagages à maindes passagers des avions. Des matrices de nanotubes àbase d’oxyde de titane peuvent être utilisées pour détecterle TATP. En effet, les molécules de l’explosif s’accrochentaux nanotubes en formant des complexes quimodifient un courant électrique traversant ces matrices.Ces capteurs peuvent être intégrés à des appareils portatifsminiaturisés ;• détection de substances chimiques : les nanotechnologiespermettent par ailleurs de réaliser des « nez électroniques» capables de détecter des substances chimiquesdangereuses. Ils sont constitués d’un brasvibrant, comme celui du microscope à force atomique,sur lequel on a déposé une couche spécifique capable defixer les molécules de la substance à détecter. Celles-ci,en se posant sur le bras vibrant, l’alourdissent et modifientsa fréquence de résonance, ce qui rend possible ladétection de la substance chimique recherchée ;• détection des virus : aujourd’hui, du fait de l’augmentationdes flux de voyageurs, les virus circulent pluslibrement et ils risquent de propager des épidémiesdangereuses. Des personnes mal intentionnées peuventégalement, grâce aux progrès de la biologie moléculaire,fabriquer en laboratoire des virus dangereux et lesdisséminer dans la nature à des fins criminelles ou terroristes.Les virus peuvent être détectés à l’aide de capteursconstitués d’une couche d’or d’épaisseur nanométrique,sur laquelle on accroche des anticorpsspécifiques. Un faisceau laser, qui est réfléchi par lacouche d’or, se trouve modifié quand des virus se lientavec les anticorps présents à la surface de cette coucheréfléchissante (voir la photo 17) ;Photo 17 : Détection de virus : le faisceau laser, se réfléchissantsur la couche d’or, se trouve modifié quand lesvirus se lient avec les anticorps. La présence des virusmodifie le milieu optique où se propagent les plasmonsde surface (ondes formées à l’interface métal-isolant).ILARION PAVELR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 81
HORS DOSSIERPhoto 18 : Nano-codes-barres à nano-bâtonnets contenant une succession de six tranches à deux métaux différents(© Nanoplex Technologies)• identification de personnes : les empreintes digitalesétaient déjà utilisées comme signature par lesBabyloniens il y a quatre mille ans, mais ce n’est qu’aumilieu du XIX e siècle que la police, à Londres, commenceà les utiliser pour identifier les criminels. Lestechnologies numériques permettent aujourd’huid’identifier automatiquement un individu parmi plusieursmillions à partir de douze points caractéristiqueschoisis sur la centaine de points qui caractérisent la texturede son empreinte digitale. Le dessin de l’iris, l’irrigationsanguine de la rétine, le réseau veineux de lamain peuvent également être utilisés comme élémentsbiométriques. Des nanoparticules fluorescentes à based’oxyde de zinc permettent de rendre visibles des tracesd’empreintes digitales, même sur des surfaces humides ;• lutte contre la contrefaçon : on peut marquer un produitde manière unique et pratiquement infalsifiable endisséminant des nanoparticules magnétiques de manièrealéatoire à un endroit déterminé de sa surface. À l’aided’un scanner magnétique semblable à la tête de lectured’un disque dur, on lit ce code-barres magnétiqueet on identifie le produit. Un faussaire devrait reconstituerla configuration exacte des nanoparticules magnétiques,ce qui serait très difficile et coûteux. Une autrepossibilité serait de fabriquer des nano-codes-barres àl’aide de nano-bâtonnets, chacun contenant une successionde tranches de métaux différents comme l’or,l’argent ou le platine. Avec trois métaux, un nanobâtonnetà cinq tranches engendre 135 codes. Enmélangeant plusieurs types de nano-bâtonnets, onobtient donc une combinatoire d’une richesse impressionnante(voir la photo 18).RISQUES POTENTIELSComme toute technologie nouvelle, les nanotechnologiessoulèvent optimisme et enthousiasme, mais aussiinquiétude et méfiance. Des romans de science-fictionexpriment ces dernières de façon angoissante. Ainsi,<strong>É</strong>ric Drexler, dans Engines of Creation, paru en 1986,évoque la menace du « gray goo », une gelée griseconstituée de nanorobots capables de s’auto-répliqueren consommant la matière vivante de la planète.Michael Crichton, l’auteur du scénario du film JurassicPark, a repris cette idée dans son roman La proie (Pray)paru en 2002 : un essaim volant de nanoparticulesintelligentes menace la vie sur la Terre.Dans la vision d’Eric Drexler, les «assembleurs moléculaires»sont des dispositifs capables de positionner unatome ou une molécule avec une grande précision et deconstruire ainsi, atome par atome (ou molécule parmolécule), des édifices complexes, que l’on peut appelernano-machines. Ces «assembleurs moléculaires»peuvent s’auto-répliquer ou fabriquer de nouveaux«assembleurs moléculaires», encore plus complexes(voir la photo 19).Dans la pratique, ce processus est impossible : il faudraitd’abord initier le processus en construisant unassembleur moléculaire qui puisse démarrer une productionen série de nanomachines. En outre, concevoirune nanomachine est difficile, car, malgré les progrèsréalisés dans la simulation mathématique, il est pratiquementimpossible de prédire le fonctionnement précisd’un assemblement complexe d’atomes.Sélectionner les réalisations réussies en écartant leséchecs est pratiquement impossible par d’autresméthodes que celle spécifique à l’évolution darwinienne(la survie ou l’extinction), qui nécessiterait un tempstrès long. Enfin, construire une nanomachine atomepar atome demanderait de casser et de former des liaisonschimiques entre des atomes ou des moléculesdéterminés tout en évitant les atomes et les moléculesindésirables se trouvant dans le voisinage. Un tel processusreste très difficile à mettre en pratique car il sedéroule dans un environnement instable, à cause del’agitation thermique et des effets quantiques.Les problèmes réels posés par les nanotechologies sontplutôt d’ordres toxicologique et éthique.Du fait de leur petite taille, les nanoparticules peuventpénétrer dans l’organisme en franchissant les barrièresnaturelles (au niveau des poumons, de la muqueusenasale, du tube digestif, voire de la peau). Elles ont unesurface spécifique plus grande que les substances« macro », car plus la taille des particules diminue, plusleur surface de contact est grande. Enfin, ayant unnombre restreint d’atomes, elles présentent des défautsde surface qui leur confèrent une réactivité chimiqueaccrue.Lors de son évolution, l’homme a toujours vécu encontact avec des nanoparticules naturelles, comme lescendres d’éruptions volcaniques, les fumées des feux deforêt, les aérosols transportés par le vent ou le pollen82R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
ILARION PAVELPhoto 19 : Nano-robot réparant lescellules du corps humain, imaginépar des auteurs de romans de science-fiction(©www.techtoggle.com).produit par les plantes. Mais ce n’est que depuis récemmentqu’il est en contact avec des nanoparticulesmanufacturées, ce qui pose pertinemment la questionde leur impact sur sa santé. C’est pourquoi plusieursprojets de recherche ont été lancés sur le thème de latoxicité potentielle des nanoparticules.Ces études posent de grands défis car la réponse de l’organismedépend de chaque nanoparticule et il est difficilede tirer des conclusions générales pour des classesplus larges. De plus, certaines nanoparticules nontoxiques peuvent piéger, à leur surface, des moléculestoxiques et pénétrer dans l’organisme : cet effet estappelé «cheval de Troie».Au-delà de l’impact sur la santé se pose la question dudevenir des nanoparticules disséminées dans la nature,de leurs interactions avec les plantes et les animaux etde leur transport dans l’environnement.Enfin, les nanotechnologies soulèvent des problèmeséthiques. Manipuler des cellules souches ou remplacerdes organes défaillants de l’organisme humain peutconduire à des dérapages, en particulier à des travauxvisant à améliorer l’être humain ou à augmenter artificiellementses capacités.ACCEPTABILIT<strong>É</strong> SOCIALECes perspectives suscitent des inquiétudes, d’autant plusque les objets nanométriques, invisibles à l’œil nu, nesont pas perceptibles directement. Certaines expériencesmalheureuses comme l’utilisation de l’amiante dans laconstruction, longtemps présenté comme un matériaumiracle (isolant électrique, résistant au feu et à l’agressionchimique) alors qu’il est toxique, ont rendu legrand public plus anxieux face aux risques potentiels.Une mesure radicale consisterait à abandonner larecherche en nanotechnologies. Cela nous protégeraitcertes des risques potentiels, mais nous priverait enmême temps des retombées positives de cette recherche.Il appartient à la société de peser les bénéfices et lesrisques et de décider de poursuivre ou d’abandonnercette voie de recherche et de développement. Par unaccord international, l’ensemble des pays pourrait déciderd’abandonner la recherche en nanotechnologies etchoisir d’explorer d’autres voies.Plus raisonnablement, plusieurs actions sont envisageables: mettre au point des protocoles d’évaluationtoxicologique et éco-toxicologique, avec des tests delaboratoire in vitro et sur animal, des règles de bonusage dans la production des nanoparticules, des systèmesde surveillance sanitaire des personnes exposées,des règlements de traçabilité des produits nano, desmoyens pour que les consommateurs soient informésen toute transparence, des comités d’éthique pours’interroger sur l’opportunité de développer les nanotechnologies.Ces problèmes, qui relèvent plus de décisions politiquesque de choix scientifiques et techniques, ne sontd’ailleurs pas spécifiques aux nanotechnologies. Il y aun espace de liberté et un espace de contraintes : ce quenous réaliserons ne dépend que de nous.Pour assumer ses décisions et juger les choix technologiques,le citoyen doit avoir une culture scientifique.Comment comprendre le monde d’aujourd’hui sansun minimum de compréhension de la science ?Comment ne pas se sentir perdu, impuissant, frustré,quand on ne se représente pas du tout la façon dontfonctionne un circuit électrique ? Aujourd’hui, seulsquelques cerveaux privilégiés ont accès à la compréhensionde la réalité, alors que le plaisir de faire un pasde plus vers le réel inaccessible est un des plus merveilleux.Il est urgent de transformer l’enseignementdes sciences. L’école doit apporter à chacun, quelquesoient ses possibilités intellectuelles apparentes, lesmoyens d’être un peu moins myope face au réel.R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 83
FOR OUR ENGLISH-SPEAKING READERSCREATING JOBS IN THE REGIONSOF FRANCEEditorialPierre CouveinhesIntroductionClaude TrinkIndustry’s new financial tools and their application in the Nord-Pasde Calais RegionFrançois YoyotteSince the autumn of 2008, the recession has led the Frenchgovernment to design new tools for intervening in favor of thecountry’s productive sector, especially manufacturing. How arethese tools appropriated and used at the regional level? Followinga description of the Nord-Pas de Calais Region and its system ofsupport for economic development, light is shed on the waysthese new financial tools are being put to use.The Industry Forum (Etats généraux de l’Industrie), a catalyst forLorraineEric PierratIn Lorraine, the Industry Forum was warmly welcomed.How Oise Department is coping with de-industrializationClaude TrinkOise has been hit by plant closings. How is this department inPicardy coping with this loss of industry? Who are thestakeholders in local economic development? What means arebeing used? What part have the officials in charge ofindustrialization played?The successful revitalization of Ille-et-Vilaine Department, westernFranceJacques GarauThe government commissioner for reindustrialization providesengineering services to firms and local authorities with the aim ofpreserving or creating jobs. Owing to his role as an interfacebetween companies, labor representatives, elected officials andthe state, this commissioner is able to focus know-how onmassive, concomitant interventions for the sake of making localindustry more competitive.Restructuring industry in the Arve ValleyGérard CascinoThe Arve Valley in the Alps is the center of the French nuts-andboltindustry. The 2008 recession has brought its business model,based on a growing volume of production, under question.Demand has fallen, and will stay low. To rise above this situationmeans adopting a systemic approach with a wide range of actionsfor handling questions related to the business cycle (e.g., access tofunds) and to structural issues, such as the diversification ofproducts in the value chain, the need to develop an effectivesynergy between firms so as to move beyond individualism, andthe redefinition of the classical relation between firms andsubcontractors in terms of a “coopetition” (a mixture ofcompetition and cooperation).The successful reconversion of a firm in Franche-Comtéto wind powerGilles CassottiAfter many an episode (successive buyouts, bankruptcy,etc.), Franc-Comtoise Industrie was taken over, on19 February 2010, by Alizeo, a windmill manufacturer,with the aim of having it make the bases for installingfolding wind turbines. This is a new challenge for theemployees of this company in Lons-le-Saunier (JuraDepartment) as it becomes involved in the adventure ofproducing wind power fifty years after having acquiredexperience in nuclear power, chemistry andpetrochemistry.Restructuring the paper industryPascal Clément, Jean-Jacques Bordeset Dominique LachenalThe French paper industry undergoes, at times,major technological changes and encounters stiffcompetition worldwide. All this leads to restructuringFrench plants with the goal of improving theircompetitive edge and diversifying. Through the caseof a paper plant located in Alizay (Eure Department),we catch sight of the opportunities opened byadopting a new “green chemistry” strategy forproducing biofuels from wood fiber cellulose (a secondgenerationbioethanol technology) and making chemicals(viscose) from wood pulp. This strategic reorientation is fullycompatible with maintaining or even developing the productionof wood pulp. It represents a major outlet for the French forestindustry.Higher education and research, an issue in the economic battle beingwaged in the regions of FranceDaniel Fixari and Frédérique Pallez“Revitalizing” a local area means both reacting immediately to acrisis by shutting down plants and boosting a redevelopmentbased on the local area’s assets so as to create jobs. We understandwhy revitalization must enter into a genuine strategy of territorialdevelopment in order to ensure its coherence and solidity. Intoday’s “knowledge economy”, the system of higher educationand research is being assigned a role in reaching these objectives.Platforms of innovation: A competitive edge for local areasRomain Beaume and Vincent SusplugasThe “platforms of innovation” are a major lever ofcompetitiveness. They offer to members of a “competitive pole”(high-technology cluster) access to shared resources (equipment,personnel and services). These platforms are the first phase inestablishing an ecosystem involving the three pillars ofcompetitive poles: firms, research organizations and institutionsof higher education.Prospects of foreign investments in FranceGilles Le BlancFor local areas, investment trends are rightly considered to be adecisive factor in the prospects for economic growth and thecreation (or preservation) of jobs. For firms, their own efforts interms of both material and immaterial investments are anecessary condition for improving efficiency in production,developing innovations, setting up operations abroad andR<strong>É</strong>SUM<strong>É</strong>S <strong>É</strong>TRANGERSR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 85
R<strong>É</strong>SUM<strong>É</strong>S <strong>É</strong>TRANGERSwinning new outlets — in short, for guaranteeing a durablecompetitive edge in the marketplace.MiscellanyNanoproducts: Applications and issuesIlarion PavelWe have entered the nanoera. More than 800 products are nowon the market that have been manufactured by usingnanotechnology: organic LED screens, tires containingnanoceramics, sun-tan lotions with nanoparticles of titanium,automobile paint that cannot be scratched, tennis racketsreinforced with carbon nanotubes… The number of products isconstantly rising. According to some estimates, the globalnanomarket will amount to more than one trillion dollars in2015.Issue editor: Claude Trink86R<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010
AN UNSERE DEUTSCHSPRACHIGEN LESERLeitartikelDIE SCHAFFUNG VONARBEITSPLÄTZEN IN DENWIRTSCHAFTSGEBIETENPierre CouveinhesEinführungClaude TrinkDie neuen Finanzierungsinstrumentarien zugunsten der Industrieund ihre Einführung in der Region Nord-Pas de CalaisFrançois YoyotteSeit dem Herbst 2008 sieht sich der Staat aufgrund der Krise dazuveranlasst, neue Lenkungsinstrumentarien zugunsten derProduktionswirtschaft bereitzustellen, insbesondere für dieIndustrie. Wie werden die Instrumentarien mobilisiert und aufregionaler Ebene eingesetzt ? Nach einer Präsentation der RegionNord-Pas de Calais und ihres Systems von Akteuren, die zurwirtschaftlichen Entwicklung beitragen können, stellen wir unsdie Aufgabe, die praktische Anwendung dieser neuenInstrumentarien zu bewerten.Die Generalstände der Industrie : ein Katalysator für LothringenEric PierratIn der Region Lothringen wurde die Einberufung der „EtatsGénéraux de l’Industrie“ besonders günstig aufgenommen.Wie das Département Oise gegen die Entindustrialisierung kämpftClaude TrinkDas Département Oise ist sehr stark vonIndustriebetriebseinstellungen betroffen. Wie kämpft dasDépartement gegen diese Entindustrialisierung ? Wer sind dieAkteure der lokalen Wirtschaftsentwicklung ? WelcheInstrumentarien kommen zum Einsatz ? Wie ist der Beitrag desmit der Reindustrialisierung befassten Kommissars zu bewerten ?Das sind die Fragen, auf die wir in diesem Artikel zu antwortenversuchen.Die gelungene Neubelebung des Standorts Ille-et-VilaineJacques GarauDie Funktion des mit der Reindustrialisierung befasstenKommissars besteht in der Bereitstellung vonEngineeringskompetenz für die Unternehmen und dieWirtschaftsgebiete, so dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffenwerden können. Diese Position an der Schnittstelle zwischenUnternehmen, Sozialpartnern, Volksvertretern und Staat erlaubtes ihm, das gesamte Know-how für eine umfassende und Kräftebündelnde Standortpolitik zugunsten der Wettbewerbsfähigkeitder Industrie in einem bestimmten Wirtschaftsgebiet einzusetzen.Die Umstrukturierung der Industrie im Gebiet der Vallée de l’ArveGérard CascinoInfolge der Krise von 2008 wurde in der Vallée de l’Arve, demwichtigsten französischen Industriestandort für Dreharbeit, dasWirtschaftsmodell des volumenorientierten Wachstums der Kritikunterzogen. Der Rückgang der Nachfrage setzt sich weiterhin fort.Möchte man die Krise unter den bestmöglichen Bedingungenüberwinden, muss systemisch vorgegangen werden, indem maneine beträchtliche Reihe von Maßnahmen trifft, die sowohlFragen konjunktureller Natur (wie die Frage derKapitalbeschaffung) als auch strukturelle Gesichtspunkteberücksichtigen ( die Diversifizierung des Angebots auf derWertschöpfungskette, die notwendige Entwicklung der Synergienzwischen verschiedenen Betrieben und damit die Überwindungder Individualismen, die Neudefinition des klassischenVerhältnisses zwischen Auftraggebern und Zulieferern, um imSinne der „Coopetition“ kooperativ zu konkurrieren).Die gelungene Anpassung eines Unternehmens der Region Franche-Comté an die Märkte der WindenergieanlagenGilles CassottiNach vielerlei Peripetien (wiederholte Rückkäufe,Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses...) wurde dieFranc-Comtoise Industrie (Lons-le-Saunier – Jura) am 19. Februar2010 vom Windkraftanlagenhersteller Alizéo übernommen, derdie Firma mit der Herstellung von Sockeln für herabklappbareWindräder betraute. Dies ist eine neue Herausforderung für dieBeschäftigten des Unternehmens von Lons-le-Saunier, denn nach50 Jahren nehmen sie weiterhin an dem Abenteuer derEnergieerzeugung teil, aber von nun an im Bereich derWindenergie, nach langjährigen Erfahrungen im Nuklear-,Chemie- und im Petrochemiesektor.Die Umstrukturierung in der PapierindustriePascal Clément, Jean-Jacques Bordes und Dominique LachenalDer gesamte Sektor der französischen Papierindustrie ist miterheblichen technologischen Veränderungen konfrontiert undmuss sich gleichzeitig gegen eine starke weltweite Konkurrenzdurchsetzen. Dies veranlasst die französischen Standorte zuUmstrukturierungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessernund die Anpassung an die Logik der industriellen Diversifizierungermöglichen sollen.Am Beispiel der Entwicklung des Papierproduzenten von Alizaylässt sich die Zweckmäßigkeit der Einführung einer neuenStrategie mit dem ökologischen Gütezeichen „chimie verte“ (grüneChemie) aufzeigen : Ziel ist die Produktion von nachwachsendenBrennstoffen auf der Grundlage von Holzzellulosefasern(Bioethanolherstellung der zweiten Generation) und dieProduktion von Paste für chemische Verwendungen (Herstellungvon Viskose aus Holzzellulose).Diese strategische Neuorientierung ist durchaus vereinbar mit derBeibehaltung, ja sogar der Entwicklung der Produktion vonPapiermasse, die für die französische Forstwirtschaft einenwichtigen Absatzmarkt darstellt.Hochschulwesen und Forschung, ein zentrales Thema im Kampf fürdie Entwicklung von WirtschaftsräumenDaniel Fixari, Frédérique PallezDie Neubelebung eines Wirtschaftsraum kann sowohl in derschnellen Reaktion auf Krisensituationen bestehen (Stilllegungeines Standorts) als auch in der Arbeitsplätze schaffendenFörderung der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich auf dieVorteile des Wirtschaftsraums stützt. Es versteht sich von selbst,dass eine wirtschaftliche Neubelebung im Rahmen einer wahrenEntwicklungsstrategie erfolgen muss, wenn sie kohärent undR<strong>É</strong>SUM<strong>É</strong>S <strong>É</strong>TRANGERSR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 87
A NUESTROS LECTORES DE LENGUA ESPAÑOLAEditorialPierre CouveinhesIntroducciónClaude TrinkCREAR EMPLEOSEN LOS TERRITORIOSLas nuevas herramientas de financiamiento de la industria y suaplicación en la región francesa del Nord-Pas de CalaisFrançois YoyotteDesde el otoño de 2008, la crisis ha obligado al Estado a forjarnuevas herramientas de intervención en favor de los sectoresproductivos, especialmente el sector de la industria.¿Cómo estas herramientas se movilizan y adaptan a nivel regional?Después de presentar la región Nord-Pas de Calais y el sistema deactores que apoyan el desarrollo económico, el artículo trata deexplicar la aplicación práctica de estos nuevos instrumentosfinancieros.Los estados generales de la industria: un catalizador para eldepartamento francés de la LorraineEric PierratEn la región de Lorraine, la realización de los Estados Generalesde la Industria ha tenido una acogida muy favorable.Cómo el departamento francés de Oise lucha contra ladesindustrializaciónClaude TrinkEl departamento de Oise se ha visto gravemente afectado por loscierres de las empresas industriales. ¿Cómo lucha estedepartamento contra la desindustrialización? ¿Quiénes son losactores del desarrollo económico local? ¿Qué herramientas seaplican? ¿Cuál ha sido la contribución del Comisionado para laindustrialización? Estas son las preguntas que trataremos deresponder en este artículo.La revitalización del departamento de Ille-et-VilaineJacques GarauEl Comisionado para la reindustrialización presta un servicio deingeniería para el beneficio de las empresas y territorios con el finde crear y conservar empleos. Este rol de interfaz entre lasempresas, representantes sociales, funcionarios y el Estado permiteconcentrar las diversas capacidades en torno a una intervenciónmasiva y concomitante en aras de la competitividad de la industriaen un territorio determinado.La restructuración industrial del valle del ArveGérard CascinoCon la crisis de 2008, el Valle del Arve, centro de la actividad decorte francés, tuvo que enfrentar un reto a su modelo de negociosque se basaba en un aumento de los volúmenes. La disminuciónde la demanda se ha confirmado y seguirá por algún tiempo.Para superar esta crisis con la cabeza en alto, hace falta un enfoquesistémico, mediante el establecimiento de una amplia gama deacciones dirigidas tanto a cuestiones de carácter coyuntural (comoel tema de acceso a la financiación) como a cuestionesestructurales (la diversificación de las ofertas en la cadena de valor,la necesidad de desarrollar sinergias entre las empresas superandoasí los individualismos, la redefinición de la relación tradicionalentre los contratistas principales y subcontratistas en el sentido deuna “coo-petencia”).La reorientación de una empresa del departamento de Franche-Comté hacia los mercados de la energía eólicaGilles CassottiDespués de muchas aventuras (ventas sucesivas, liquidaciónadministrativa, etc.), la empresa Franc-Comtoise Industrie (enLons-le-Saunier - Jura) fue adquirida el 19 de febrero de 2010 porel fabricante de equipos eólicos Alizeo para la fabricación de basespara turbinas eólicas plegables. Es un nuevo reto para losempleados de la empresa de Lons-le-Saunier, que, cincuenta añosdespués, seguirán viviendo la aventura de la producción deenergía, pero esta vez a través de la energía eólica, tras años deexperiencia adquirida en la energía nuclear y las industriasquímica y petroquímica.La restructuración en la industria papeleraPascal Clément, Jean-Jacques Bordes y Dominique LachenalToda la cadena de papel francés está sometida al mismo tiempo acambios tecnológicos importantes y una fuerte competenciaglobal. Esto tiene como consecuencia la reestructuración deciertos sitios en Francia con el fin de mejorar su competitividad ycontribuir al principio de la diversificación industrial.A través del caso concreto de la fábrica papelera de Alizay se venlas oportunidades de adopción de una nueva estrategia de tipo“química verde”: la producción de biocombustibles a partir defibras de celulosa de madera (bioetanol de segunda generación) yla fabricación de pulpa para la industria química (producción deviscosa usando celulosa de la madera).Esta reorientación estratégica es plenamente compatible con elmantenimiento o el desarrollo de la producción de pasta decelulosa, que es un problema importante en términos deoportunidades para el sector forestal francés.La enseñanza superior y la investigación, un elemento clave en lalucha económica en los territoriosDaniel Fixari, Frédérique PallezLa revitalización de un territorio significa responder a las crisiscuando se presentan (cierre de un sitio) y también promover eldesarrollo (re)creador de empleos basándose en los recursoslocales. Por lo tanto, es concebible que se deba insertar larevitalización en una verdadera estrategia de desarrollo territorialreal, si se quiere garantizar su coherencia y solidez. Ahora bien,cada vez más, en una “economía del conocimiento”, se asigna alsistema de enseñanza superior y la investigación un papelimportante en relación con estos objetivos...Las plataformas de innovación: factores de competitividad de losterritoriosRomain Beaume y Vincent SusplugasPalanca clave de las clave de competitividad, las plataformas deinnovación proporcionan a los miembros de los polos deR<strong>É</strong>SUM<strong>É</strong>S <strong>É</strong>TRANGERSR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 89
R <strong>É</strong> A L I T <strong>É</strong> SINDUSTRIELLESune série des Annales des MinesMAI 2010ISSN 1148.7941ISBN 9-2-7472-1682-1S O M M A I R EAPRÈS LA CRISE FINANCIÈRE : UN RETOURÀ L’<strong>É</strong>CONOMIE R<strong>É</strong>ELLE ?<strong>É</strong>ditorial Pierre CouveinhesAvant-propos Christian Stoffaës et Xavier DallozI. Un diagnostic pour dépasser la criseLes causes véritables du chômage Maurice AllaisRetour aux fondamentaux Marcel BoiteuxPour des ingénieurs socio-économistes Caude MartinandEnvie d’aventures Francis MerII. Paroles d’économistesManifeste pour l’économie réelle. Les économistes ont-ils uneresponsabilité dans la crise ? Christian StoffaësPour en finir avec l’hégémonie du lien économiqueMichel BerryIII. Paroles d’entrepreneursLa crise ! Quelle crise, ou plutôt : quelles crises ?André LamotteL’investissement de l’Etat dans les hautes technologies : uneapproche keynésienne Daniel PichoudRevenir à la dissociation historique des métiers financiersPierre-Henri LeroyLa stratégie du luxe : un point fort pour la France / une stratégied’entreprise pour le monde qui advientVincent BastienLa crise, catalyseur du rétablissement de la primauté del’économie réelle sur l’économie virtuelle Franck BiancheriIV. Paroles de scientifiquesCrises et métrologie. A quoi sert la prospective ?Thierry GaudinReconstruire la compétitivité de la France et de l’EuropeAndré-Yves Portnoff et Xavier DallozV. Paroles d’ingénieursL’économie numérique, un défi systémiqueJean-Pierre CorniouLe rôle des Business Angels dans le financement de la croissancedes PME innovantes Interview d’Eric Berthaud parBernard NeumeisterBULLETIN DE COMMANDELa culture, une des clés du développement durableHervé DigneAprès la crise financière : un retour vers l’économieréelle ? ou : la France dans l’économie mondialiséeGrégoire Postel-VinayCe numéro a été coordonné par Christian Stoffaëset Xavier DallozA retourner aux <strong>É</strong>ditions ESKA, 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 PARISTél. : 01 42 86 55 65 - Fax : 01 42 60 45 35 -❑ Je désire recevoir ...... exemplaire(s) du numéro de Réalités Industrielles mai 2010 « Après la crise financière : unretour à l’économie réelle ? » (ISBN 978-2-7472-1682-1) au prix unitaire de 23 € TTC.Je joins ❑ un chèque bancaire à l’ordre des <strong>É</strong>ditions ESKA❑ un virement postal aux <strong>É</strong>ditions ESKA CCP PARIS 1667-494-ZNom ................................................................. Prénom ..................................................................................................Adresse ..............................................................................................................................................................................Code postal ...................................................... Ville .......................................................................................................
SOMMAIREJUIN 2010ISSN 0295.4397ISBN 978-2-7472-1701-9• THE PRINCE’S EYE-GLASSES – by Claude RIVELINE, December 2007• THE INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF ACCOUNTING: THERESISTIBLE RISE OF THE IASC/IASB – by Bernard COLASSE, March2004• THE GLOOMY SIDE OF PROJECTS: WHEN WORKING ON APROJECT JEOPARDIZES INDIVIDUALS AND GROUPS –by Alain ASQUIN, Gilles GAREL and Thierry PICQ, December 2007• IN CHINA, BETWEEN GUANXI AND THE CELESTIALBUREAUCRACY – by Philippe D'IRIBARNE, June 2009• WESTERN AND CHINESE STYLE MANAGEMENT: COMMENT FROMA PRACTITIONER ON PHILIPPE D’IRIBARNE’S ARTICLE: “IN CHINA,BETWEEN GUANXI AND THE CELESTIAL BUREAUCRACY” –by Dominique POIROUX, June 2009• A FRENCH JOURNAL ON MANAGEMENT: SURVIVING AND THRI-VING –THE CASE OF G<strong>É</strong>RER & COMPRENDRE – by Michel BERRY• DO YOU SPEAK ENGLISH OR GLOBISH? – by Jean-Paul NERRIÈRE,March 2003• FAILED LANDINGS IN BAD WEATHER – by Christian MOREL,June 2009• WOMEN, AN OBJECT OF INNOVATION – par Hervé DUMEZ,June 2005• EGYPT AND THE EXPERTS – by Michel CALLON, December 2006• Philippe FACHE:ELECTRONIC COMMUNICATIONS, On Marie Bia Figueiredo andMichel Kalika’s. La Communication électroniqueLA COMMUNICATION <strong>É</strong>LECTRONIQUE ? À propos du livre de MarieBia Figueiredo et de Michel Kalika, La Communication électronique.• Youcef BOUSALHAM : HUMAN RESOURCE MANAGEMENTIN MASS-MARKET RETAILING, On Christophe Vignon’s (ed.), LeManagement des ressources humaines dans la grande distribution• LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DANS LA GRAN-DE DISTRIBUTION. À propos de l’ouvrage collectif Le Managementdes ressources humaines dans la grande distribution (coordonné parChristophe Vignon).• Daniel FIXARI : THE GAME OF RULES, A MULTIDISCIPOLINARYAPPROACH, On Hervé Dumez and Jean-Baptiste Suquet’s (eds.)« Les Jeux de la règle », une approche interdisciplinaire.• « LES JEUX DE LA RÈGLE » UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE.À propos du livre « Les Jeux de la règle » Une approche interdisciplinaire,Coordonné par Hervé DUMEZ et Jean-Baptiste SUQUETB U L L E T I N D E C O M M A N D EA retourner aux <strong>É</strong>ditions AGPA-ESKA, Muriel DUBOSQUET, 4, rue Camélinat, 42000 SAINT-<strong>É</strong>TIENNETél. : 04 77 43 26 73 - Fax : 04 77 41 85 04 - muriel.dubosquet@eska.fr❑ Je désire recevoir ....... exemplaire(s) du numéro de Gérer & Comprendre juin 2010 - numéro 100 (ISBN 978-2-7472-1701-9) au prix unitaire de 23 € TTC.Je joins ❑ un chèque bancaire à l’ordre des <strong>É</strong>ditions ESKA❑ un virement postal aux <strong>É</strong>ditions ESKA CCP PARIS 1667-494-ZNom ................................................................. Prénom ...................................................................................................Adresse ..............................................................................................................................................................................Code postal ...................................................... Ville ........................................................................................................