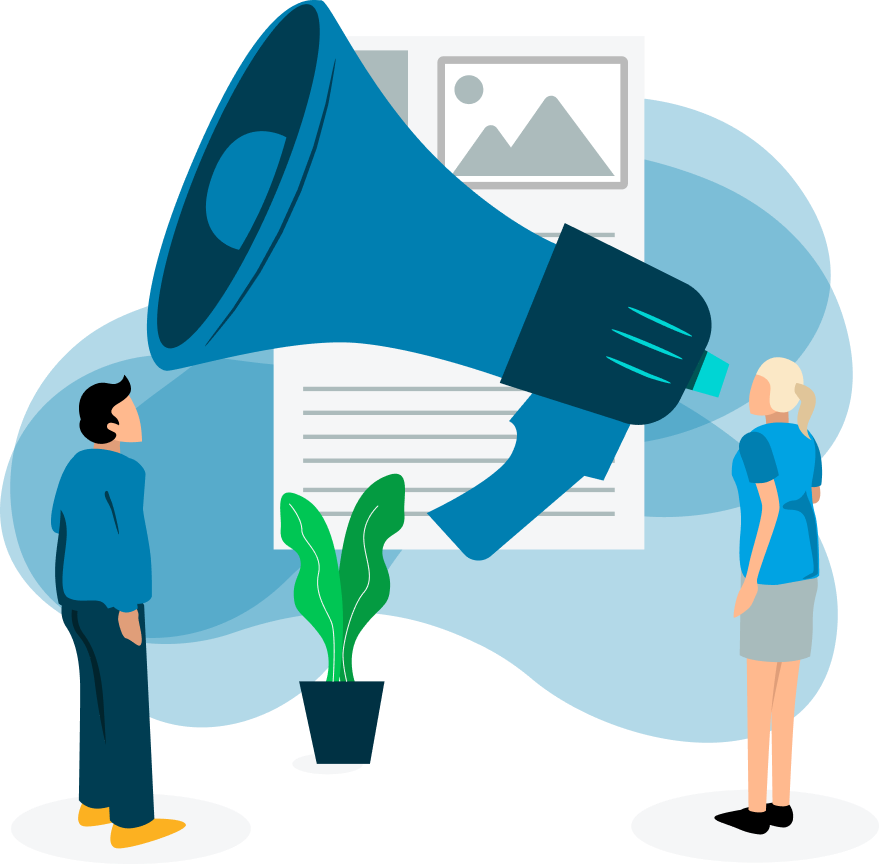Désolé j'ai ciné #13
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1
2
EDITO
Voilà le premier numéro de cette nouvelle décennie alors déjà on vous
souhaite à tous une belle année. Le cinéma nous réserve encore de
belles choses et en seulement deux mois on a eu le sacre ultime (et
mérité) de Parasite, Sam Mendes qui nous a proposé un morceau de
cinéma tellement intense qu’il nous a inspiré pour parler de nos plans
séquences préférés, le mythe de l’homme invisible remis au goût du
jour ainsi qu’Harley Quinn qui prend son envol pour faire son petit
film à part. Mais ce numéro est aussi plaçé sous le signe de l’amour
avec notre rétrospective spéciale Saint-Valentin.
En bref, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle
année encore pleine de surprises, de dossiers et de rétrospectives
et on vous prévient d’avance, le prochain numéro promet de beaux
dossiers pleins de charmes et d’espions en tout genre...
Margaux Maekelberg
3
62.
S O M M A I R E
3. EDITO
24. LES PLANS SÉQUENCES
44. SUICIDE SQUAD : DC UNIVERSE, MORT-NÉ
54. RÉTROSPECTIVE MICHEL HAZANAVICIUS
4
6. RÉTROSPÉCTIVE SAINT-VALENTIN
30. RÉTROSPECTIVE SAM MENDES
50. PORTRAIT ABDEL RAOUF DARFI
RÉTROSPECTIVE UNIVERSAL MONSTERS
5
Rétrospective
À numéro sorti en février, l’envie nous est irrésistible de ne pas consacrer une partie
de nos pages à la Saint-Valentin, occasion idéale pour vous établir un petit dossier
sur nos films d’amour favoris. Car c’est aussi ça, le cinéma, une passion qui peut
se conjuguer avec l’amour. Évidemment, les exemples sont légion, et on pourrait
vous composer un hors-série complet sur le sujet, surtout après plus d’un siècle de
cinéma où le genre est l’un des plus représentés. Une petite sélection, des exemples
récents comme des classiques plus anciens, voici un florilège, une petite proposition
de rattrapages à ceux qui veulent parfaire leur exercice de séduction, raviver leur
flamme ou simplement savourer des œuvres de qualité sur le sujet. Découverte du
sentiment passionnel, amour mêlé de science-fiction, grand fresque romanesque et
romantique, sortez les plaids, les chocolats chauds, blottissez-vous contre l’être aimé,
soyez assuré qu’ici, vous apprécierez tout.
Sai
Thierry de Pinsun
6
nt-Valentin
7
8
RENDEZ VOUS (1940)
Pour ce qui est des comédies, qui plus est romantiques,
on ne présente plus Ernst Lubitsch qui en est quasiincontestablement
le maître. Sa capacité à toucher
autant qu’à faire rire tout en développant des messages
forts, dépassant largement le cadre de la simple
histoire d’amour, est ici avec « Rendez-vous » plus que
jamais démontrée.
Adaptant la pièce « Parfumeries » de Miklos Laszlo, le
cinéaste nous envoie à Budapest suivre la vie d’une
petite boutique de maroquinerie, pendant la période
de Noël, où travaillent Alfred Kralik (James Stewart) et
Klara Novak (Margaret Sullivan). Ceux-ci ne s’entendent
pas mais correspondent malgré eux par le biais des
petites annonces. Alfred découvrant que sa mystérieuse
interlocutrice n’est autre que Klara va tout faire pour se
faire aimer sans gâcher leur petit jeu de lettres.
Lubitsch est aussi bon metteur en scène qu’auteur et
il dévoile ici l’étendue de ses qualités dans les deux
domaines pour offrir une histoire d’amour délicieuse.
Il n’y a pas d’autre mot que « régal » pour évoquer ce
petit bijou de « romcom » dont chaque réplique est
savoureuse et chaque séquence parfaitement agencée
pour jouer avec les sentiments du spectateur tout en
évoquant des questions sociales ou morales.
Le cinéaste ne se contente pas de parler de l’amour de
deux êtres qui sont plus proches qu’ils ne le croient,
il profite de la galerie de personnages présents
dans la boutique pour traiter de thèmes encore
assez peu mentionnés dans le cinéma de l’époque
comme l’adultère ou le chômage. Ce faisant, il ancre
parfaitement son propos dans la réalité et on croit
facilement à ce qui nous est présenté. L’engagement
pour les protagonistes étant appuyé, l’implication
émotionnelle n’en est que plus forte.
Mais quid des deux tourtereaux émoustillés par leur
relation épistolaire mais qui peinent à se retrouver
alors que leurs quotidiens respectifs sont marqués de
regards croisés ?
Lubitsch fait là preuve d’une grande habileté et fait de
Klara Novak bien plus qu’un simple intérêt amoureux
pour Alfred. Elle occupe l’écran au même titre que lui
et leurs interactions, au cœur du film, rythment celuici.
La réalisation va alors se permettre de très beaux
moments comme une séquence dans un bar où la mise
en scène, alliée aux lignes de dialogues cinglantes
que s’échangent les deux collègues, crée une situation
hilarante bien que frustrante du fait que nous ayons
connaissance du quiproquo qui règne. Il faut préciser
que la relation Stewart-Mulligan, tous deux icônes
du vieil Hollywood, traduit une grande alchimie et
les deux se répondent du tac-o-tac avec un charisme
ébouriffant.
Ainsi, on a là une œuvre sur la rencontre entre deux
personnes que tout oppose en théorie mais que l’esprit
rapproche inévitablement. Un film aussi qui montre
que ce qui compte, bien plus que la récompense
finale, c’est le chemin à parcourir et le développement
du personnage de James Stewart en est le parfait
exemple, lui qui se soumet indirectement à l’amour
qu’il éprouve pour sa charmante et brillante collègue.
Si on ajoute à cela la modernité du propos sur la
société ainsi que dans la gestion du rôle féminin, on
ne peut pas être plus sûr que l’on est face à l’une des
toutes meilleures comédies romantiques jamais faites.
On peut noter que le succès et la réussite intrinsèque
de ce métrage est tel qu’il a inspiré Nora Ephron
a adapter la même pièce pour son « Vous avez un
message » mais si l’on ne devait retenir qu’un seul «
shop around the corner » en période de Saint-Valentin,
c’est bel et bien celui d’Ernst Lubitsch, un cupidon du
septième art comme on en fait plus.
Elie Bartin
9
Il y a tant de choses à dire sur ce film qui est d’une
richesse folle en tous points. Wim Wenders, connu
notamment pour son très beau « Paris, Texas », revient
ici en Europe après une expérience outre Atlantique
qui ne s’est pas très bien passée et, alors que la guerre
froide touche à sa fin, livre une œuvre d’une ampleur
dingue et d’une résonance encore actuelle.
On suit donc deux anges invisibles existant depuis
la nuit des temps. Damiel (Bruno Ganz) et Cassiel
(Otto Sander), errent dans Berlin, toujours séparée en
deux, et écoutent les pensées noires des habitants,
enfermés dans un quotidien morne et déprimant
comme une prison, pour ensuite les recenser. Face à
tant de tristesse, Damiel, las d’être simple spectateur
de ce monde en perdition, souhaite devenir humain
et la découverte de Marion (Solveig Dommartin),
trapéziste paumée dans un cirque fermant ses portes,
va le toucher et le faire se décider à quitter les cieux
définitivement.
Perdre l’immortalité par amour, y a-t-il quelque
chose de plus beau ? Certes, ce n’est pas tout l’enjeu
du film qui, comme dit en préambule, traite de
nombreux éléments. Pourtant, c’est bel et bien ce
point qui ressort car, dans une capitale allemande
montrée en ruines, Wenders vient presque naïvement
apporter l’amour comme échappatoire. Mais pour
que cela marche, il passe d’abord par une heure
d’installation de ce monde dévasté où les complaintes
lancinantes des âmes mortes de Berlin se mêlent aux
mouvements flottants de la caméra, le tout sublimé
par la photographie en noir et blanc d’Henri Alekan.
L’ambiance est donc lourde mais la poésie l’emporte.
Les voix-off alliées à la musique comme les citations
sur l’enfance et l’innocence, grandement teintées de
nostalgie au début, avec des gamins justement dont
le regard encore vierge sur le monde qui leur permet
d’avoir conscience de la présence des anges, tout est
beau et puissant.
Ces êtres ailés, condamnés à regarder l’humanité
sombrer perdent progressivement, avec les humains,
tout espoir et se mettent à regarder vers le passé,
d’où les comptines sur le jeune âge où tout semblait
plus gai et réconfortant. Mais là, le tour de magie
intervient. Une virée au cirque change tout. Une vision,
comme angélique, vient perturber notre ange et en
un monologue intérieur, il est conquis. Comprenant la
palette d’émotions permise par la forme humaine, et
touchée par cette femme désespérée, il succombe et
entreprend, poussé par un Peter Falk jouant son propre
rôle à merveille, de perdre ses ailes.
L’amour devient donc l’enjeu du film et Wenders
magnifie ce sentiment. Passant du noir et blanc aux
couleurs, avec lesquelles Alekan offre une photographie
toute aussi belle. La caméra cesse de voler et demeure
à hauteur d’homme à mesure que Damiel, comme
il apprend à distinguer l’orange du bleu, découvre
l’humanité. Ganz sort de sa posture quasi mutique
d’ange gardien spectateur du malheur pour devenir
un homme en quête de vie, d’expérience mais surtout
d’une femme qui l’a touché et dont nous savons qu’elle
a eu conscience à un moment d’avoir une présence
bienveillante à ses côtés. L’auteur joue alors d’une
écriture minutieuse, avec un chassé-croisé qui prend
aux tripes. On revisite des décors jusqu’alors mornes
que la recherche de l’être aimé et l’optimisme y étant
attaché rendent dingues. L’ambiance punk rock de la
capitale allemande, ressort des tréfonds et l’on se prend
au jeu lors d’un concert de Nick Cave où l’enjeu est
tant de ressentir la musique comme échappatoire d’un
peuple désabusé que d’accomplir la syzygie, symbole
de l’humanisation complète de Damiel.
Le questionnement existentiel de cet ange prend
alors une dimension romantique folle et dévastatrice
puisque la rencontre des deux êtres et la réussite de
la quête de l’âme humaine pour Damiel va dépendre
exclusivement de la décision de Marion. La femme
est seule maîtresse du destin de celui qui a quitté un
monde supérieur, à l’abri des affres de la vie humaine
pour la rejoindre et partager ces tourments justement.
Wim Wenders offre alors une œuvre blindée
d’émotions, mélancolique et triste dans un premier
temps pour virer dans un optimisme libérateur ensuite.
« Les ailes du désir » est donc un film hautement
spirituel mais qui garde l’humain en son cœur. Le
désir du titre, ici spinozien, vient créer un pont entre le
ciel et l’Homme et nous amène, émus, à contempler
l’abandon d’une immortalité dans l’espoir d’allumer
une flamme éternelle.
Elie Bartin
10
LES AILES DU DÉSIR (1987)
11
12
JE SUIS UN CYBORG (2006)
Si la comédie romantique est un genre pouvant
sembler « plan-plan » à certains, Park Chan-wook n’est
pas de cet avis, du moins il dynamite le concept dans
son film d’amour fantastique « Je suis un cyborg », petit
ovni cinématographique aussi barré que poétique, déjà
traité dans un précédent numéro dans le cadre d’une
rétrospective consacrée au cinéaste (voir Désolé j’ai ciné
n°11) mais ici abordé sous un autre angle.
Ainsi, il faut rappeler brièvement que l’on suit le
quotidien de Young-goon, jeune fille internée en
hôpital psychiatrique car elle est persuadée d’être
un cyborg. Elle refuse alors de se nourrir d’aliments
« humains » par peur de casser son système, ce qui
l’affaiblit grandement, mais elle va rencontrer Il-soon
qui va tout faire pour lui ramener son humanité et
éviter qu’elle ne devienne définitivement hors-service.
Le postulat de départ est déjà farfelu avec cette
histoire « teen » perchée, d’autant que le réalisateur
ne s’en tient pas qu’à ces deux personnages. Au
contraire, il développe une véritable galerie au sein
de l’établissement médical. Chaque personne va avoir
son problème mais surtout on va voir comment chaque
individu essaie de le surmonter, soit seul, soit avec
l’aide de ses camarades. Cette variété dans les troubles
va alors permettre au cinéaste de se faire plaisir et de
donner lieu à des scènes toutes plus folles les unes que
les autres.
Car « Je suis un cyborg » est un film complètement
dingue avec une idée de mise en scène à la seconde
de sorte qu’on frise presque avec l’expérimental par
instants. Park Chan-wook met toute sa maestria visuelle
au service de ces marginaux qui, à l’instar de Younggoon
cherchant son utilité en tant que robot, sont à la
quête de leur place en ce bas-monde. Et c’est là que
l’amour intervient, comme tout un symbole, comme
une libération.
Là où il a fait auparavant de la vengeance un exutoire,
pouvant faire perdre leur humanité aux personnages,
l’auteur coréen joue cette fois du sentiment le plus
beau qui existe pour revenir à l’humain justement. Il se
sert de cette romance improbable et mignonne entre
deux adolescents aussi paumés que malades pour
offrir, au milieu de ses expérimentations dantesques
parfois d’une violence terrible, une histoire d’une
grande poésie.
Il montre avec inventivité la découverte des sentiments
et toute la complexité qui l’entoure. Il-soon se doit
d’être d’une immense créativité pour empêcher la
mort de faim de celle qu’il aime même si tout ce qui
lui importe finalement est d’être avec elle. Celle-ci,
croyant devoir être impassible à tout par sa condition
de cyborg, est toute chamboulée par cette irruption
d’émotions et apprend peu à peu à s’abandonner
aux joies de la vie. Les péripéties s’enchaînent à un
rythme haletant, et si certaines scènes sont peut-être
trop exagérées, tout ceci témoigne de la générosité
du réalisateur à sortir un film aussi spectaculaire que
touchant.
Park Chan-wook signe donc là une œuvre
probablement mineure dans sa très grande
filmographie, le film pouvant cliver par sa folie
incessante parfois gratuite, mais d’une grande beauté.
Lui qui signera « Mademoiselle » dix ans après, autre
œuvre axée sur l’amour valant largement le détour,
offre un teen-movie romantique unique et plein de
vitalité où l’amour naissant devient salvateur.
Elie Bartin
13
On aurait pu continuer sur Richard Curtis avec son
écriture sur « Yesterday », où amour rime avec The
Beatles, mais le film de Danny Boyle, s’il remplit bien
les cases de la comédie romantique charmante, est
trop bancal pour nous avoir suffisamment marqué
et gagner ses lettres de noblesses pour errer dans
ce dossier. On va donc garder la deuxième partie de
l’équation, le Fab Four, pour un film romantique sous
forme de fresque psychédélique : « Across The Universe
», de Julie Taymor.
Jude (Jim Sturgess), docker à Liverpool vivant avec sa
mère, décide de s’enrôler dans la marine marchande
dans l’espoir de retrouver son père, un G.I américain.
Il abandonne ses repères pour découvrir l’Amérique
de tous les excès, et grâce à une colocation avec Max
va rencontrer la soeur de ce dernier, Lucy (Evan Rachel
Wood). Dès lors, le récit va s’axer sur les amours des
deux jeunes, tiraillés par l’Histoire américaine des
années 60/70. Comédie musicale totale, le choix des
Beatles n’est pas anodin tant la retranscription de leurs
paroles en images offre des moments grandioses.
S’ils sont très nombreux, même majoritaires dans
la narration, les passages usant des chansons ne
sont donc pas gratuits, et usent des textes pour
offrir une vision de l’action. On va donc suivre les
déambulations de ces jeunes en proie à leurs amours
respectives sur Hold Me Tight, All My Loving, avant
que les rencontres croisées ne se fassent sur With
A Little Help From My Friends, l’arrivée de la guerre
du Vietnam avec I Want You (She’s So Heavy).... Des
scènes qui passent de la comédie musicale typique,
avec chant et chorégraphie, à la pure métaphore
psychédélique qui ne ménage aucun de ses effets. Avec
des tentatives de mise en scène toujours innovante,
chaque morceau devient un voyage, allant de plus en
plus loin dans son délire. Métaphores brillamment
utilisées qui renforcent un répertoire musicale déjà
excessivement riche de double sens. Ceux qui ne
comprennent pas la notoriété des Beatles et pourquoi
leurs amateurs les déclarent comme le groupe qui
en dix ans a bouleversé tous les horizons musicaux
découvriront un groupe hors-normes, qui a teinté
d’expérimentations son art et qui ici se voit offrir un
hommage qui retranscrit à merveille le génie de ses
membres. Julie Taymor a d’ailleurs l’intelligence,
contrairement à « Yesterday » cité précédemment, de
ne pas forcément puiser dans le répertoire le plus
connu du groupe. Au milieu de morceaux qui font
forcément mouche dans l’imaginaire collectif (Let
It Be, Helter Skelter...), des raretés, des titres plus
appréciés par les amateurs, à l’image de Strawberry
Fields Forever, issu du Magical Mystery Tour, album
non reconnu comme faisant partie de la discographie
officielle.
Au casting déjà grandiloquent s’ajoutent des invités
de marque, tels que Joe Cocker venu pousser la
chansonnette sur Come Together, Bono pour I Am
The Walrus, Eddie Izzard pour Being For The Benefit
Of Mr Kite ou encore Salma Hayek sur Happiness
Is A Warm Gun. Chacun représente un personnage
extravagant déjà présent dans les titres des Beatles,
et les scènes s’axent autour d’eux pour leur offrir la
vedette d’un show épique le temps d’un morceau.
Tous accompagnent Lucy et Jude dans leurs aventures,
eux qui vivent leur magnifique histoire d’amour
jamais unilatérale mais semée d’embûches, de visions
qui s’éloignent quand Lucy veut entrer dans la révolte
guerrière et que Jude pense qu’il peut dénoncer
les injustices uniquement par l’art. Deux être qui se
retrouvent quand leur amour est plus fort que toutes
les choses qu’ils entreprennent. Un amour qui est
aussi celui du groupe d’amis que l’on découvre au fur et
à mesure, de ces personnages attachants qui vivent au
gré de leurs passions et de leur fougueuse jeunesse.
Avec « Across The Universe », Julie Taymor fait une triple
déclaration d’amour. À ses personnages, pour lesquels
elle voue une passion qui se sent à chaque angle de
caméra, aux Beatles, qu’elle fait redécouvrir même aux
plus fins connaisseurs (on n’en sera jamais certain, mais
nous est avis que Paul McCartney et Ringo Starr ont
pleuré en voyant un tel hommage), mais aussi à cette
époque d’insouciance, où la jeunesse hurlait sa colère
et son amour pour l’Art, pour la Liberté sexuelle, pour
la Musique. On retrouve avec Sadie la soul, quand le
chant devient plus qu’un son mais une âme, et avec Jo-
Jo un sosie de Jimi Hendrix bien peu dissimulé.
Chaque personnage porte évidemment un nom issu
d’un titre des Beatles (Hey Jude, Lucy In The Sky With
Diamonds, Maxwell’s Silver Hammer, Jo-Jo présent
dans le titre Get Back, etc….) et ce jusqu’au-boutisme
peut aussi frôler une certaine indigestion. Les titres
parfois s’enchaînent sans interruption narrative, et Julie
Taymor se perd dans ses expérimentations de mise en
scène qui peuvent parfois lasser. Mais la générosité de
l’entreprise surpasse les quelques moments douteux, si
tant est que l’on accepte cette incroyable invitation au
voyage.
Thierry de Pinsun
14
ACROSS THE UNIVERSE (2007)
15
16
MOONRISE KINGDOM (2012)
L’amour, ce n’est pas que l’obsession des plus grands.
Nos jeunes bambins font eux aussi leurs expériences,
souvent plus douloureuses quand il s’agit des
premiers émois et des premières déceptions, mais qui
conservent ce caractère pur, touché par la grâce, de
l’amour. Et alors que nous avons admiré « Adoration
» de Fabrice du Welz, narrant la fuite de deux enfants
fous l’un de l’autre devant l’incompréhension des
adultes, nous aurions trouvé difficile de ne pas penser
au parallèle avec « Moonrise Kingdom » (2012), chef
d’œuvre de Wes Anderson et coup de cœur ayant
parfaitement sa place ici.
Suzy aime Sam et Sam aime Suzy, cela ne fait
aucun doute. Un simple échange de regards et une
correspondance passionnelle les mettent à l’évidence
: ils doivent fuir leur quotidien ensemble, et aller
vivre leur amour loin des autres. Les autres : la famille
de Suzy, qu’elle ne comprend plus à mesure qu’elle
grandit, et le camp de scouts de Sam, seul repère
puisqu’orphelin, passant de foyer en foyer. Retranché
sur une île minuscule, le jeune couple sait que sa
retraite sera courte, et que chaque minute est un
moment précieux à savourer. Les inquiétudes des
enfants, passant de leur amour à vivre au combat pour
rester ensemble, font écho à celles du monde adulte
qui les entoure. Wes Anderson utilise alors un double
filtre pour traiter des mêmes problématiques, des
difficultés que l’on rencontre dans nos vies dont les
solutions semblent si évidentes quand on les regarde
avec des yeux d’enfant.
« Moonrise Kingdom » traite avant tout de l’amour
impossible. Impossibilité pour ces enfants d’être
ensemble alors que les adultes font tout pour leur
interdire, impossibilité pour Mrs Bishop (Frances
McDormand) de vivre une vie épanouie avec son
amant, le Captain Sharp (Bruce Willis). Contradiction
lorsque cette même mère interdit à Suzy de revoir Sam,
elle qui est également en quête de liberté. Les adultes
sont obsédés par le bien-être des enfants, l’équilibre
qu’il faut leur apporter, et sont totalement aveuglés
par le fait que ces derniers ont tout compris à ce qui
les rend heureux, et à ce dont ils ont besoin. Thème
récurrent chez Wes Anderson, que l’on voyait déjà dans
Rushmore (1998), La Vie Aquatique (2004) voire même
dans le couple principal du Grand Budapest Hotel
(2014) : l’innocence comme source d’illumination et
d’intelligence.
Ce thème de la passion à tout prix est disséminé dans
un métrage truffé des gimmicks d’Anderson, qui
atteignent ici une certaine apogée. On y retrouve le
ton « conte de fée », narré à la manière de « Pierre Et Le
Loup », et le rôle du narrateur (Bob Balaban) accentue
cet aspect hors de toute temporalité. On le verra avec «
The Grand Budapest Hotel » ou avec « L’Île Aux Chiens »
(2018), Wes Anderson est un amoureux de ces histoires
intemporelles qui peuvent se raconter et se réadapter
à travers les âges. Alors la mise en scène joue de tout
: les contrastes alambiqués, notamment lors des
séquences orageuses, les musiques décalées – un régal
de voir nos deux amoureux danser sur « Le Temps De
L’amour » de Françoise Hardy -, tant dans les écoutes de
personnages que dans la bande originale d’Alexandre
Desplat qui ne manque pas d’espièglerie, les plans sur
les maisons qui font penser à des villages de poupées...
Surtout, s’il poussera le vice jusqu’à en atteindre une
limite parodique dans le métrage suivant, la symétrie
est bien présente. Comme une marque de fabrique que
l’on remarque instantanément chez Anderson, chaque
plan est travaillé au millimètre, souvent découpable en
deux parties distinctes qui se répondent. Ce qui donne
au visuel un cachet unique, dans la veine de ce que
propose son auteur.
Ce qui marque particulièrement dans « Moonrise
Kingdom », c’est l’amour que l’on ressent
immédiatement pour tous ces personnages. Même
l’antagoniste « Social Services » (Tilda Swinton) nous
apparaît sympathique tant le trait est forcé, et cache
sous ses grands airs une véritable envie de servir
l’intérêt des enfants. Les scouts qui font des misères
à Sam deviennent ses alliés dès que le bien commun
devient figure de proue, et à la manière d’un conte de
fées, tout le monde s’entraide et s’embrasse dans une
farandole finale. Il y a malgré tout un ton grave, parlant
du manque de repères des orphelins, la déconnexion
des mondes enfants et adultes qui peinent à se
comprendre, mais qui est annihilé par la volonté
d’Anderson de rester dans un esprit léger, positif et
aimant, à l’image de son couple principal. « Moonrise
Kingdom » est une épopée, une invitation à l’aventure
qui ne peut que charmer, et une ode au romantisme
qu’il serait malheureux de rater. On reste scotché à
son écran par des visuels qui flattent la rétine sans
interruption, et cette petite histoire, sans complexité
mais non sans profondeur, nous touche en plein cœur.
Thierry de Pinsun
17
Richard Curtis est un véritable orfèvre de l’amour.
Quand il ne fait pas d’autres tentatives de styles où il
brille par son écriture (« Cheval de Guerre » (2011), «
Mr Bean » (1990), « Blackadder » (1983)), il se complaît
dans la comédie romantique, et en a d’ailleurs écrit
beaucoup des plus marquantes au royaume de Grande-
Bretagne : « Quatre Mariages Et Un Enterrement »
(1994), « Coup De Foudre À Notting Hill » (1999) ou
les deux premiers « Bridget Jones » (2001, 2004),
magnifiés par leurs dialogues toujours savoureux et un
comique de situation qu’il maîtrise à merveille.
Quant à ses réalisations, on regrette juste qu’elles
soient si peu nombreuses. « Love Actually » (2003),
film choral où chaque histoire est un roman d’amour
prenant à souhait, et « Good Morning England » (2009),
ode au rock et à la liberté, deux films qui sont devenus
instantanément cultes (et inutile de se demander
pourquoi c’est culte, les regarder et les ressentir suffit à
le comprendre). Pour ce dossier spécial Saint-Valentin,
on va s’intéresser au troisième film du réalisateur,
malheureusement plus méconnu, mais que certains
membres de la rédaction aiment à appeler « Le boss
final des comédies romantiques » : « Il Était Temps ».
Pour ses 21 ans, Tim (Domnhall Gleeson) obtient
un cadeau inestimable : un secret de famille. Et pas
n’importe lequel ! Son père (Bill Nighy) lui apprend
que les garçons de la famille ont une habilité
particulière, celle de pouvoir voyager dans le temps,
de revenir vers des instants de leur propre existence
qu’il peuvent alors revivre, ou en modifier certains
éléments. Tim prend alors une décision : il se servira
de cette capacité pour trouver l’amour. Tentant d’abord
d’attirer l’affection de Charlotte (Margot Robbie) envers
lui durant un été, il réalise vite que les sentiments
ne sont pas des éléments altérables, mais qu’ils
peuvent être orientés si déjà présents. La vie de Tim
va donc se construire par cette capacité à revivre les
moments ratés, et tourner les chances de son côté. Il
va ainsi faire la rencontre de Mary (Rachel McAdams)
et tout faire pour la séduire. La vie avance, son couple
aussi, les enfants arrivent, les gens vieillissent, et
Tim va apprendre à ses dépens le contrepoint de
cette capacité, les changements fatals que cela peut
occasionner, et les décisions à prendre pour équilibrer
une vie familiale saine et les tentations affiliées à son
don.
Les pouvoirs de Tim, s’ils servent à nourrir le récit
d’un humour qui fonctionne et parviennent à être
détournés pour devenir un élément apportant le ton
dramaturgique au film, ne sont qu’annexes, un prétexte
pour aborder le grand sujet de la vie d’un angle altéré.
Richard Curtis fait le récit de l’amour, la filiation,
l’acceptation des morts parentales, et surtout une
grande œuvre sur la famille. Chez Curtis, elle est unie,
soudée, se soutient dans les moments les plus ardus.
La force d’ « Il Était Temps » réside avant tout dans ses
personnages, auxquels on s’attache instantanément par
la force des dialogues et de leur caractérisation propre à
son auteur.
Pour illustrer l’écriture des personnages de Richard
Curtis, prenons exemple dans son long-métrage
précédent : « Good Morning England ». Alors que
nous découvrons les protagonistes de cette radio rock
sur mer, pour le coup très nombreux, on se surprend
à s’interroger quant à l’irruption d’un personnage,
Bob. Le Comte (Philip Seymour Hoffman) lui balance
immédiatement un « Who the fuck are you » qui fait
rire tant ce personnage dénote dans cet univers que
l’on croit totalement connaître. Lorsque l’on revoit le
film, on se rend compte qu’il apparaît dès la vingttroisième
minute du métrage. Cet exemple illustre
parfaitement la capacité de Richard Curtis à écrire des
personnages forts, que nous retenons instantanément,
peu importe si on les voit beaucoup ou pas. Ici, que ce
soit la sœur de Tim, Kit Kat (Lydia Wilson), qui devient
plus importante par la suite, l’oncle Desmond (Richard
Cordery), pourtant doté de peu de dialogues, ou les
parents de Tim (sa mère est jouée par l’incroyable
Lindsay Duncan), on reconnaît ces personnages à
chaque apparition, et ils nous manquent en leur
absence.
Des personnages forts dont on tombe amoureux, qui
nous semblent proches à chaque instant, une histoire
de tous les jours mais pourtant forte, « Il Était Temps
» est une immense réussite, qui ne peut que charmer
même les plus réfractaires. On quitte la rêverie avec
l’envie d’appeler ses proches, de déclarer des flammes
amoureuses jusqu’alors inavouées, et surtout de ne
plus perdre une minute face à la brièveté de la vie.
L’angle surnaturel prétexte fait d’ailleurs penser à « Mon
Inconnue » d’Hugo Gélin, lui aussi charmant à souhait.
Le voyage dans le temps serait-il l’angle parfait pour
aborder la comédie romantique ?
Thierry de Pinsun
18
IL ÉTAIT TEMPS (2013)
19
20
UPSIDE DOWN (2013)
On retire Julie Taymor, les Beatles, et on garde Jim
Sturgess pour un nouveau tour. Il faut dire que
l’Anglais a une bonne bouille pour les comédies
romantiques. Direction Argentine avec le réalisateur
Juan Solanas, qui pour avoir un budget à la hauteur de
ses ambitions vient gratter par chez nous et au Canada.
On aurait tort de lui en vouloir tant « Upside Down »,
s’il est sorti de manière anecdotique, est un petit bijou
pour tous ceux ayant pu poser leurs yeux dessus.
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, deux
planètes cohabitent, quasiment collées l’une à l’autre,
sans que leurs habitants ne puissent réellement
entretenir de liens, les deux mondes possédant une
gravité opposée. L’une des deux planètes, de par
ses seules ressources minières, plonge ses habitants
dans une pauvreté profonde, la seule source d’emploi
étant une tour les reliant à l’autre univers, pour sa part
bien plus chanceux en termes géologiques, lui ayant
alors permis de perdurer – on peut y voir, comme
dans « Across The Universe », la dualité Liverpool /
New York -. Pourtant, haut dans les montagnes, des
sommets sont presque en connexion, et c’est ainsi
qu’Adam (Jim Sturgess) va rencontrer Eden (Kirsten
Dunst). Leur relation doit se faire à l’abri des regards,
étant évidemment interdite, mais alors qu’ils sont
découverts, Eden est victime d’un accident, et disparaît.
Un temps plus tard, Adam découvre qu’elle n’est
pas morte, et décide d’aller tenter sa chance, d’être
employé dans cette immense tour qui lui permettra
de rejoindre sa bien-aimée, à condition qu’il trouve un
moyen d’inverser sa propre gravité...
Au-delà du caractère science-fiction de l’œuvre, rien de
nouveau sous le script de Juan Solanas. Un film qui
parle du dépassement de soi, de trouver une solution
irréelle pour obtenir ce que l’on souhaite, une grande
fresque sur l’amour où sans antagoniste, le seul
empêchement que connaissent les amoureux réside
dans le fossé social qui les sépare. C’est alors dans son
visuel que le cinéaste va parvenir à faire la différence.
Déjà par une direction artistique qui, avec très peu
de moyens, parvient toujours à nous émerveiller.
On s’envole avec les protagonistes où, pour pouvoir
se rapprocher, ils s’encordent et s’amusent à se faire
planer l’un au-dessus de l’autre. On est subjugué par
l’agencement de la tour, où ces employés de bureaux
n’ont qu’à regarder au plafond pour communiquer avec
leurs collègues de l’autre monde. Lorsque Adam trouve
un moyen temporaire de se rendre sur l’autre monde,
on joue avec les effets, on manipule les éléments pour
toujours trouver des moyens originaux de traiter le
sujet. Un sujet et un traitement que Makoto Shinkai ne
renierait pas.
« Upside Down » tient surtout pour ses protagonistes,
avec son couple Kirsten Dunst / Jim Sturgess que l’on
veut voir braver tous les obstacles pour se retrouver,
accompagnés de personnages secondaires toujours
attachants (Timothy Spall, qu’on veut immédiatement
pour ami proche, en tête), bien que malheureusement
trop peu nombreux. Ce qu’il offre, Juan Solanas
l’offre avec générosité et sens de la mise en scène,
mais on sent que le manque de budget fait réduire
son ambition, réduit la consistance d’un monde qui
peine à exister. Il n’empêche qu’ « Upside Down »
est une œuvre magistrale pour son auteur, qui traite
de ses thématiques avec brio. Le « flop » relatif du
film ne lui aura pas apporté les meilleures augures,
et son nouveau film, « Que Sea Ley », n’est d’ailleurs
pas sorti par chez nous. On espère cependant le voir
prochainement, et surtout que l’on reconnaisse à
Solanas son talent. En attendant, on vous en parle, et
vous n’avez plus d’excuses pour ne pas vous jeter sur ce
film parfait à partager avec vos conquêtes !
Thierry de Pinsun
21
22
CALL ME BY YOUR NAME (2018)
Ah le premier amour. Celui qui vous met des
papillons dans le ventre, celui qui vous fait vous sentir
vivant, fou, celui qui vous fait regarder votre montre
toutes les deux secondes en attendant le prochain
rendez-vous. Mais le premier amour c’est aussi les
premiers sentiments, les premières hésitations, les
premiers questionnements sur sa sexualité. Et c’est
ce déferlement d’émotions que va subir le jeune Elio,
17 ans. En vacances avec ses parents dans le nord de
l’Italie, sa vie va se retrouver chamboulée à l’arrivée
d’un étudiant préparant son doctorat : le charismatique
Oliver. Une méfiance qui va se transformer en amitié
pour devenir quelque chose de beaucoup plus intime.
Une relation amoureuse à remettre dans le contexte
puisque toute l’action du film se déroule dans les
années 80. Une romance discrète, à l’abri des regards
où tout passe par des échanges visuels, des non-dits
dont cette scène tout en plan séquence où Elio avoue
à demi-mot ses sentiments pour Oliver. Sufjan Stevens
entonne Mystery Of Love qui vient sublimer cette
histoire d’amour de sa voix envoûtante. Le mystère
qu’est l’amour, les questionnements qu’il engrange…
Il faut d’ailleurs saluer le travail du réalisateur qui
nous offre une bande originale avec des morceaux
magnifiques alternant entre le piano, des chansons
festives des années 80 et cette chanson « Words » de
F.R David qui résume à elle seule la complexité qu’est
l’amour. “Call me by your name” n’est pas une histoire
d’amour, c’est l’histoire de l’amour. Le plus pur, le
plus viscéral qu’on puisse ressentir puisque c’est le
premier. Doucement mais sûrement, comme un rayon
de soleil d’été venant caresser tendrement la peau,
Luca Guadagnino nous embarque dans une histoire
exacerbant chacune de nos plus profondes émotions
pour nous transporter, nous bouleverser. En touchant
ainsi la corde sensible qu’est l’amour, le film arrive à
toucher un large public allant ainsi au-delà du sexe et
de l’orientation sexuelle de chacun. Le tout est de se
souvenir de cette marque indélébile que laisse l’amour
sur vous.
Mais ce qui fait la magie de “Call me by your name” ce
sont les interprétations magistrales d’Armie Hammer
(Oliver) et Timothée Chalamet (Elio). Une amitié qui
s’est développée avant le tournage du film et qui,
d’une façon totalement incroyable, transparaît à
l’écran d’une manière puissante et dévastatrice. Les
échanges de regards, les chamailleries, les balades à
vélo, le premier baiser. Jamais dans la précipitation, le
réalisateur aime nous faire languir. Tantôt ils s’aiment,
tantôt Oliver l’ignore jusqu’à ce moment fatidique
où l’été s’achève… Le talent d’Armie Hammer (vu
récemment dans Free Fire) s’exprime enfin dans un
rôle sur-mesure, complexe et vulnérable se complétant
ainsi parfaitement avec la révélation qu’est le jeune
Timothée Chalamet, brillant de justesse et de douceur.
Une mention spéciale également aux parents d’Elio
(joués par Michael Stuhlbarg et Amira Casar) qui
viennent apporter encore plus de douceur au film
en prenant le contrepied avec des parents affectifs
envers leur fils et qui le poussent à être celui qu’il veut
devenir. Luca Guadagnino crée ainsi une parenthèse
dénuée de mauvaises ondes.
Tout n’est que sensualité dans ce film tout en finesse,
loin de n’être que du sexe ni de la romance. Le lieu,
la musique, l’atmosphère, tout est empreint de cette
magnifique sensualité qui se ressent dès les premières
minutes du film pour ne plus nous quitter. Les scènes
de sexe entre Elio et Oliver sont urgentes, désireuses
mais aussi extrêmement pudiques. En imposant un
tempo lent à son film, Luca Guadagnino veut être
certain de marquer le spectateur. La sensualité se
retrouve dans chaque recoin.
Le discours du père d’Elio est la lueur d’espoir, ce rayon
de soleil qui nous manquait tant sous cette épaisse
neige hivernale (le temps a passé depuis le départ
d’Oliver) pour donner tout son sens au film. « Nous
n’avons qu’un corps et qu’un coeur » alors chérissonsles
même si parfois c’est dur, même si parfois ça fait
mal parce que la seule façon d’avancer dans la vie et
de se sentir pleinement vivant et de se faire frapper de
plein fouet pour la joie et la douleur.
Un véritable concentré d’amour et de vie. On ne se
contente pas de regarder “Call me by your name”, on se
laisse envoûter, on aime, on souffre, on exulte, et on en
redemande, encore et encore.
Margaux Maekelberg
23
24
BREAKING
Hong Kong, de jour. Un homme marche seul dans une rue quelque peu
animée. Il monte dans un appartement pour retrouver ses complices
braqueurs à l’étage. En bas, un peu plus loin, sont garées deux voitures
de police en planque. Les cambrioleurs descendent en se faisant passer
pour des citoyens lambdas. Leur chauffeur est contrôlé par des agents de
la circulation. Ni une, ni deux, des policiers en civils font alors diversion en
improvisant une dispute mais un sac laissé dans la voiture des braqueurs
attire l’attention d’un agent de la circulation. Commence alors une fusillade.
En lisant la description de cette scène d’introduction, on pourrait s’attendre
à un découpage très élaboré, avec une multitude de plans. Mais Johnnie To
décide d’en faire un plan séquence de sept minutes. En peu de temps, les
enjeux sont posés. La caméra virtuose du réalisateur capte avec minutie la
montée en tension qui transforme cette rue banale en décor de western.
« Breaking News » raconte l’histoire de l’assaut d’un immeuble par des
policiers pour aller arrêter ce fameux gang de braqueurs. Mais les médias
étant présent sur place pour couvrir l’événement, la police décide de redorer
son blason en transformant l’opération en véritable show télévisé. Tout ceci
tourne vite à la guerre des images, quand les braqueurs se mettent à filmer
l’opération de leur point de vue. Le génie du plan séquence d’ouverture
opère alors une sorte de note d’intention. À l’inverse du reste du film, les
premières minutes ancrent le spectateur dans le réel, en prenant leur temps
pour présenter les deux factions opposées. Les malfrats sont silencieux,
calmes et avancent dans la rue à découvert, en toute impunité, tirant sur
une police acculée, obligée de se cacher pour riposter. Le rapport de force
est inégal. Et loin des caméras de télévision, il n’y a ici qu’un seul point de
vue, celui du réalisateur. Cette introduction s’efforce d’être la plus objective
possible, en total contraste avec le reste du film et sa subjectivité due à la
multiplication des points de vue. La radicalité de la mise en scène s’oppose
donc aux images tronquées, remontées et détournées plus tard par la
machine médiatique de la police.
NE
Car si l’ouverture de « Breaking News » reste un immense moment de
cinéma, ça n’est pas seulement par son tour de force technique (tourner dans
les rues étroites de Hong Kong a sûrement dû demander un entraînement
féroce) mais surtout parce qu’elle offre une réflexion sur la fabrication des
images. Le philosophe Jean Baudrillard disait « Nous sommes dans un
univers où il y a de plus en plus d’information, et de moins en moins de sens
». C’est exactement ce qui se passe dans le reste du film. La multiplication
des points de vue amène un trop plein d’informations, allant même jusqu’à
faire un flash info sur une star locale venant apporter son soutien aux forces
de l’ordre. En sélectionnant elle-même les séquences qu’elle diffusera au
public, la police ampute une partie de la vérité, du sens. Tout ceci dénature
le réel pour créer une simulation de réalité au profit des forces de l’ordre,
rappelant que chaque manipulation d’image est politique. Il est d’ailleurs
amusant de faire un parallèle entre la guerre médiatique de « Breaking
News » où les braqueurs propagent des images montrant une facette des
événements peu flatteuse pour la police, et le monde réel où les réseaux
sociaux servent de contre-pouvoir à la diffusion de scènes validées par le
pouvoir en place. L’ouverture du film, elle, est claire, nette et précise. La
somme des informations sur les personnages et leur rapport de force amène
du sens. Tout ceci grâce à la mise en scène de Johnnie To et la confiance qu’il
porte au médium cinéma.
Sous couvert d’un film d’action de commande, « Breaking News » est une
œuvre politique où les sept minutes de plan séquence d’introduction servent
de représentation du réel là où celui du milieu du film sera déformé par
l’appareil médiatique jusqu’à devenir une copie, d’une copie, d’une copie. Ce
que Baudrillard aurait appelé une simulation.
Mehdi Tessier
WS (2004)
25
26
À LA POURSUITE
DE DEMAIN (2015)
Le film de Brad Bird est basé sur une notion qui peut paraître bien naïve dans une époque rongée par le cynisme : l’espoir, la croyance en un
monde meilleur par l’action, face au passéisme d’une génération qui voit la chute et ne fait rien pour s’y préparer. Dès lors, le personnage de
Cassie sert de repère moral, jeune femme cherchant à se confronter à ceux qui voient en la catastrophe une issue inéluctable. Rien d’étonnant
à ce qu’elle soit nourrie par une curiosité dévorante dès lors qu’elle reçoit ce pin’s lui promettant monts et merveilles. Il faudra patienter pour
pouvoir faire face à cet autre monde mais la patience est récompensée par l’un des plans les plus merveilleux des années 2010.
Le plan séquence nous introduit directement dans ce nouvel univers avec force, que ce soit par l’entrée dans le champ ou bien le début de la
superbe musique de Michael Giacchino. Toute cette scène nous permet donc de faire face à un nouveau décor prometteur d’espoir par les yeux
tout aussi rêveurs de Cassie, subjuguée comme nous par les technologies présentées. On sent dès lors une véritable énergie, un dynamisme
flamboyant qui nous revigore et nous fait pétiller les yeux. La caméra de Bird est en perpétuel mouvement, la musique de Giacchino a de quoi
mettre des couleurs dans la vie de n’importe qui et les promesses du film annoncent un avenir brillant… Jusqu’à la rupture brutale de la scène.
Il n’est d’ailleurs pas étonnant que celle-ci se termine par notre héroïne retenue physiquement par la réalité et ne pouvant donc pas embrasser
totalement cette promesse de monde meilleur. Voilà comment en une simple scène Bird arrive à faire exploser le propos de son long-métrage
: ces annonces pour l’avenir, ces voyages vers l’ailleurs, ces technologies qui amènent en plus du pratique du rêve à part entière, c’est à nous de
les construire. Le restant du film va pousser Cassie à chercher cette promesse et l’accomplir dans ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs
divertissements des années 2010. Son lourd échec financier résonne donc avec brutalité dans une actualité où l’on brise toute possibilité du
futur à base de décisions réductrices. Et tandis que les gens manifestent pour un avenir meilleur, la question se pose à chacun sur le rôle que
l’on peut avoir dans une évolution de notre univers.
Liam Debruel
27
THE HAUNTING OF HILL HOUSE (201
28
Avec son passage au télévisuel, Mike Flanagan a su exploiter sur un récit à plus longue durée le traumatisme d’une famille et l’impact que
celui-ci aura eu sur leur construction individuelle. Réunis par la mort, la même qui les avait brisés par le départ de leur mère, les survivants de ce
schéma familial éclaté font ce qu’ils peuvent pour mettre de côté leurs différends, en vain tant l’explosion est inévitable. Ce sixième épisode en
est le plus bel exemple et use du plan séquence pour inscrire définitivement la série dans le questionnement de Flanagan sur la manière de se
relever de ce qui nous a détruits.
Ainsi, « Two storms » aura été critiqué pour n’être qu’un étalage vulgaire et simpliste de maestria visuelle perdant en signification par sa
volonté d’éblouir sans fondement. C’est pourtant ignorer les résonances qui se créent entre passé et présent, deux journées fondatrices dans
la destruction d’un bonheur familial s’unissant par le biais de la mise en scène avec une virtuosité qui n’a d’égale que sa quête émotionnelle
tangible. La caméra virevolte dans des décors provoquant un étouffement pour tout un chacun, accumulant sa propre frustration jusqu’à ce que
le détonateur arrive à la fin de son compte à rebours, prévisible dans sa volonté de faire valdinguer les doutes de ses personnages.
Le plan séquence illustre, à l’opposé du merveilleux d’« À la poursuite de demain », une forme de répétition de l’histoire et une forme d’horreur
dans ce que cela implique. Les deux décors partagent en ce sens une ambiance funèbre, celle du drame à venir et celle de la perte déjà
subie. C’est ce qui fait de « The Haunting of Hill House » une série passionnante, dans sa manière d’user du fantastique pour s’inscrire dans
un processus de deuil général dont personne ne semble réellement sortir excepté les morts eux-mêmes. Face au désarroi provoqué par la
mort et la manière dont les fantômes se font autant protecteurs annonciateurs du macabre qu’outils instrumentalisant la peine pour encore
plus anéantir les êtres, l’union semble le seul moyen de se protéger. Cette amertume sera exacerbée par la fin de cet épisode, l’un des plus
bouleversants des années 2010, à l’image de l’entièreté de cette première saison.
Liam Debruel
8)
29
Sorti en ce début d’année, “1917” a connu de nombreux éloges
à sa sortie, mais occulte le talent de son réalisateur au yeux
de ses détracteurs, voyant dans ce titre un « jeu vidéo » ou «
un film de chef op ». Pourtant, fort d’une filmographie variée
et riche, Sam Mendes a su tirer son épingle du jeu dans le
cinéma américain, parvenant aussi bien à ausculter la famille
américaine dans toute sa splendeur et ses contradictions que
le plus célèbre des agents secrets britanniques. Naviguant avec
aisance entre les genres et les drames divers, le tout avec cette
même plongée dans le cœur et les doutes de ses personnages
pour en dégager une humanité qui inonde l’écran de manière
permanente. Retour sur un auteur de qualité aux œuvres
toujours pertinentes par leur acuité sur notre existence propre
et la volonté de faire passer ses réflexions et émotions dans une
esthétique toujours irréprochable.
Liam Debruel
RÉTROSPECTIVE
30
SAM MENDES31
Un premier long est l’occasion pour un cinéaste de
laisser libre cours à toutes ses envies. Des années
qu’il tente de le mettre à bien, l’impossibilité de
savoir s’il parviendra à en faire un autre, beaucoup
de facteurs qui font que généralement, ce premier
long est celui de la tentative ultime, un gloubi-boulga
foutraque où il met tout ce qu’il peut, tant que ça
passe. Et généralement le métrage qui lui confère le
plus de personnalité, et un charme indéniable tant ses
maladresses, que l’on ne verra plus si sa carrière prend
le pas, sont siennes. Oubliez ce qui vient d’être dit,
Sam Mendes est l’anti-thèse prouvant la théorie. Son
« American Beauty » est d’une maîtrise incroyable, qui
nous imprime la rétine autant que l’esprit.
AMERICAN BEAUTY (1999)
Le rêve américain, en théorie, se base sur l’égalité
des chances. Toute personne, quelles que soit ses
origines, sa couleur de peau, son statut social ou
encore son éducation, doit se voir offrir les mêmes
opportunités que les autres, les mêmes chances de
succès. Et par succès, on ne parle pas forcément de
réussite financière, mais de réel épanouissement,
de pouvoir avoir le métier que l’on souhaite et dans
lequel on ressent du plaisir, de pouvoir construire sa
vie de famille sans se soucier du lendemain. Mais
dans le pays où il faut payer pour pouvoir éduquer ses
mômes (égalité pour tous ? Belle ironie, sors d’abord
ton portefeuille) et où le capitalisme est roi, l’idéal
que tout Américain moyen hurle avec fierté se voit
meurtri, corrompu par le tout argent, et la concurrence.
Concurrence professionnelle, mais aussi sociale, il ne
s’agit plus tant de réussir pour soi, il s’agit de réussir
pour le montrer aux autres, et être toujours un poil au-
32
dessus de son voisin.
Cette science du paraître, les Burnham en sont les
experts. Dans leur banlieue parfaite, ils ont la maison
parfaite, ils sont le couple parfait, ils ont les métiers
parfaits, la fille parfaite, les voisins parfaits, rien ne
dépasse ni ne sature. Sauf que cette façade, que l’on
devine très rapidement, est sur le point d’éclater. Lester
(Kevin Spacey) aborde sa crise de la quarantaine, et
avec elles les envies de liberté qui vont avec : envie
de quitter son boulot qu’il déteste, envie de quitter sa
femme qui est selon lui devenue une poupée plastique
sans âme qui ne le touche plus, envie de se taper, car
c’est là l’élément déclencheur, Angela Hayes (Mena
Suvari), la copine de sa fille Jane (Thora Birch), qui du
haut de ses 16 ans et de ses airs d’allumeuse sûre d’elle
le fait rêver.
Elle représente la liberté sexuelle qu’il n’a plus, se
vante constamment de ses expériences avec les
hommes, souvent dans du dialogue cru, et pousse
Jane, à force de provocations, dans les bras de Ricky
Fitts (Wes Bentley), jeune voisin récemment arrivé
et aux prises avec un père (Chris Cooper) militaire,
autoritaire et hautement homophobe. Jane est
d’ailleurs le second élément en passe d’attirer le chaos
au sein de la famille. Elle qui passe d’enfant parfaite
sous couvert de la pression du paraître à adolescente
en ébullition, n’en peut plus de ces carcans hypocrites
dans laquelle les siens évoluent, ni de sa mère qui ne la
comprend pas ou de son père qui a renié son ancienne
complicité avec elle pour préférer reluquer sa copine.
En choisissant Ricky comme constat de rébellion, lui qui
deale toutes sortes de drogues et semble un électron
libre, elle découvre une sensibilité et un romantisme
insoupçonné.
Carolyn (Annette Benning), qui joue à l’épouse et
la mère parfaite, et qui est en un sens celle qui a
contribué à rendre la famille aussi morne, se lance
quant à elle en quête du frisson. Éloignée de ce mari
qui l’ennuie à mourir, elle recherche l’insolite, l’interdit
qui lui fera ressentir son corps, ses émotions. Au fond,
les Burnham veulent tous la même chose : vivre à
nouveau, selon leurs désirs, retrouver leur folie, leur
jeunesse, ou le droit à l’insouciance de l’enfance que
Jane n’a pas connu. Mais au centre de leurs non-dits, de
cette haine qui s’est instaurée entre eux et qui a atteint
un point de non-retour, la famille est vouée à sa perte.
Lester le dit d’ailleurs dès son introduction en voix-off :
il va se libérer mais également mourir. Alors l’ébullition
prend place, tout le monde converge autour de lui, lui
déclamant sa colère ou le voyant comme une manière
subsidiaire d’enfin relâcher ses nerfs. On sait que la
mort le guette, mais on ne sait de qui elle va venir tant
tout le monde a une raison.
À la manière de Ricky, qui épie les Burnham avec sa
caméra, Sam Mendes se pose dans ce petit monde,
narre de manière chorale les déboires de chacun, et
nous même lentement vers l’apothéose explosive. On
entre dans les têtes de ces personnages, découvrant
leurs fantasmes (notamment ceux de Lester envers
Angela, dans ce foisonnement de roses rouges, image
totalement culte aujourd’hui), et le réalisateur se joue
des cadres pour illusionner la réalité. La photographie
de Conrad L.Hall, légende parmi les chefs opérateurs
qui fera une seconde collaboration avec Mendes
pour son métrage suivant, et la musique magnétique
de Thomas Newman contribuent à cette ambiance
épurée, totalement lisse et désincarnée, qui joue de ses
aspérités que l’on ne remarque que peu avant qu’elles
n’envahissent le cadre.
« There’s nothing worse than being ordinary »
En voulant jouer l’adulte expérimentée, Angela
manque de perdre son innocence au profit d’un Lester
qui conçoit enfin son fantasme juvénile comme une
perversion, et renvoie à tous ceux rêvant d’une scène
de sexe entre cet homme mûr et cette jeune enfant
leur statut de complice. Le père de Rick, fier de son
homophobie, prend conscience face au départ de
son fils de sa propre sexualité. À se mentir, on ne vit
pas. Sam Mendes éclate le rêve américain, y libère
les frustrations liées à cette course à la gloire vaine, et
se demande simplement : Être le meilleur vaut-il le
sacrifice de soi ? Tant de remises en questions pour un
film qui parvient en deux heures à traiter parfaitement
des maux modernes. Un Oscar du meilleur film mérité,
et décerné pour une fois à une oeuvre qui ne sera pas
oubliée deux mois plus tard. Un pamphlet revanchard
qui a inspiré Desperate Housewives, série traitant tout
aussi brillamment des mêmes thèmes. Et surtout, un
départ de carrière flamboyant pour Sam Mendes, qui
ne cesse depuis de varier ses tons.
Thierry de Pinsun
33
34
LES SENTIERS DE LA PERDITION (2002)
Après une œuvre aussi dense et aboutie qu’ « American Beauty », difficile pour Sam
Mendes de savoir sur quel type de projet s’atteler. Avant de repartir vers une critique
acerbe des mentalités guerrières américaines avec « Jarhead », il se dirige vers la
fiction pure, mais également le récit historique, avec « Les Sentiers De La Perdition ».
L’histoire est celle de Michael Sullivan (Tom Hanks), homme de main d’un patron
de mafia irlandaise, John Rooney (Paul Newman), pendant la Grande Dépression.
Il est envoyé pour régler un différend avec un associé d’affaires, mais ce dernier se
retrouve assassiné par Connor (Daniel Craig), le fils de Rooney. Élément perturbateur,
Michael Jr (Tyler Hoechlin), alors caché dans le véhicule, va assister à la bavure.
Malgré la confiance entre John Rooney et Michael Sullivan, Connor part dans un
épisode de paranoïa et, dans un geste désespéré, décide de faire tuer Michael, et
d’assassiner lui-même les membres de sa famille. Perdant alors sa femme et son plus
jeune fils, Michael va s’enfuir, aux côtés de Jr, s’efforcer de survivre alors qu’un tueur
à gages (Jude Law) est à leurs trousses, et organiser sa vengeance.
Retranscrire les années 30, réussir à nous plonger dans une période donnée et nous
la rendre crédible n’est pas chose simple. Pourtant, « Les Sentiers De La Perdition
» s’inscrit dans la lignée des plus grands néo-noirs, notamment grâce à la photo
de Conrad L.Hall. Le chef opérateur légendaire, pour son dernier film (il mourra
peu de temps après le tournage), met tout son talent et son expérience au service
d’une retranscription précise, pour un genre sur lequel il a déjà excellé (« Fat City
» de John Huston en 1972, « Black Widow » de Bob Rafelson en 1987). Sa seconde
collaboration avec Mendes, après « American Beauty », lui vaudra d’ailleurs sept prix
amplement mérités. Vient s’ajouter la bande originale de Thomas Newman, tout
en subtilité, qui parfait cette ambiance léchée au possible. On déambule dans ces
décors travaillés au détail, on ressent les affres et les problématiques de l’époque,
et le casting, où les égos pourraient se bousculer vu le nombre de grands noms
présents, se mêle parfaitement à la danse, offrant des personnages forts, dont un
Paul Newman mémorable, lui aussi dans l’un de ses derniers grands tour de piste.
On retrouve une thématique chère à Mendes, celle de la cellule familiale éclatée.
La mort guettait Lester Burnham, telle une finalité lui faisant prendre conscience
de la distance qu’il avait pris avec sa fille Jane, ici elle est l’élément déclencheur,
le point qui disperse les éléments pour que Michael Sullivan se retrouve seul avec
un fils pour qui il n’arrive à exprimer aucun sentiment d’attachement. La relation
père-fils, et la notion de filiation, se ressentent aussi dans le duo Rooney. Là où
Sullivan s’est toujours éloigné de son fils pour ne pas le voir suivre ses traces, tout
en lui vouant un amour paternel sans faille, John Rooney se contente de son fils
Connor, dont il n’approuve rien, mais est contraint de le soutenir par devoir sanguin.
Des personnages en bout de course, sentant leur fin approcher, et dont le spleen
imprègne l’écran.
En gardant une sobriété inaltérable, Tom Hanks offre à Michael Sullivan ce visage
triste, fatigué, qui a porté trop longtemps sur ses épaules le poids de crimes qui lui
ont permis de survivre mais ont condamné son âme. Opposé dans ses agissements,
Connor Rooney n’est pas si éloigné de ce sentiment éculé. Lui qui est perdu dans la
spirale infernale se perd en quête de tranquillité, d’une potentielle rédemption qui
lui fait regretter chacun des choix qui lui semblaient nécessaires alors. Daniel Craig
est parfait en nerveux torturé et imprévisible. Mendes sait acter ses moments forts,
notamment dans son travail sonore, où chaque balle tirée ne l’est pas au hasard et
se doit être entendue, son poids devant peser sur nos propres consciences. Notre
moralité est également mise à l’épreuve lorsque l’on se demande jusqu’où on est
prêt à accompagner cet homme en quête de vengeance, si les dégâts causés et les
vies ôtées valent moins que la sienne et celle de son fils.
En deux films, Sam Mendes s’impose. Il propose avec « Les Sentiers De La Perdition
» une expérience sensible, unique, qui rend hommage à toute une époque
cinématographique aujourd’hui révolue, sans pour autant la singer. La présence de
Paul Newman, alors l’un des derniers grands, n’est pas anodine et renforce cet écho.
On sort de la séance épuisé, lessivé d’une violence froide et sèche, et avec l’assurance
d’avoir vu un grand métrage.
Thierry de Pinsun
35
La guerre : sûrement ce que l’Homme a fait de pire sur cette planète. Tuer, détruire,
en retirer de la satisfaction, cette routine semble n’être jamais partie très longtemps
de la surface du globe et on en vient à se demander si l’on est capable d’apprendre
de nos erreurs. Quand « Jarhead » commence, avec une voix-off pleine de tristesse
suivie de la reprise de la scène iconique de « Full Metal Jacket », une impression
de déjà-vu ressurgit. Celle que l’on va avoir à faire à bien plus qu’une simple
représentation de conflit et que ce qui va compter c’est bien l’homme au cœur de
celui-ci : sa position, ses motivations, sa psyché.
Pour ce faire, Mendes reprend la sauce « American Beauty » et l’adapte au genre
auquel il s’attelle pour offrir une vision pleine de cynisme de la guerre, deux heures
de mise à l’épreuve de la moralité du spectateur. L’histoire vraie d’Anthony Swofford,
ici incarné par Jake Gyllenhaal, sied alors aux envies du cinéaste : celle d’un
homme devenu Marine, ayant passé plus de la moitié d’une année dans le désert
à n’attendre qu’une seule chose, exploser joyeusement la tête d’un soldat irakien
avec son 70 millimètres. La caméra de Mendes ne le quitte jamais et entraîne le
spectateur dans une virée aux confins de la folie.
Les références fusent aussi vite que les insultes du Sergent (Jamie Foxx) : de «
Voyage au bout de l’enfer » en passant par « Apocalypse Now », le Vietnam semble
omniprésent mais pourtant incompris. Ces témoignages de l’horreur d’un conflit
ayant flingué, littéralement comme mentalement, des milliers d’individus tiennent
lieu de discours motivants et de chants galvanisants. « La chevauchée des Walkyries
» de Wagner est entonnée gaiement tel un hymne national avant un match de
foot et l’on en vient à se plaindre d’entendre les Doors au motif que l’on voudrait
des chansons plus adaptées à l’époque pour symboliser temporellement cette
nouvelle lutte. Tout semble hors de propos, hallucinant et plus le métrage avance
et plus on comprend le sens de ce fameux surnom qui donne son titre à l’œuvre : «
Jarhead ». Ce que l’armée crée, ce ne sont pas des soldats mais bien des réceptacles
à commandes, vides, creux, sans aucune capacité cérébrale, seulement bons à
entendre et respecter des ordres, aussi absurdes soient-ils. La guerre est fantasmée,
coolifiée voire même sacralisée. Elle devient un rituel pour ces machines formatées
dans l’attente de l’exécution de la seule tâche à laquelle ils sont programmés : tuer,
symbole de l’appartenance aux héros de la patrie.
Pour traduire cet enfermement psychologique progressif, Mendes fait alors preuve
d’une grande maestria, à l’instar de Roger Deakins qui offre une photographie
splendide. L’horizon permet alors au blanc immaculé du désert de se fondre au
ciel pour ne plus créer qu’une enclave monochrome, une prison invisible mais
aveuglante. Dans cette fournaise, les hommes brûlent certes la graisse qui entoure
leur âme comme le dit Troy, mais la transpirent irrémédiablement et sans s’en
rendre compte. L’extérieur devient problématique puisque l’éloignement entraîne la
montée de la paranoïa. Dès le foyer quitté et la terre de bataille rejointe, les femmes
sont considérées comme infidèles, comme si ces soldats souhaitaient d’office ne
pas se faire d’illusions, et cette accusation infondée à l’origine se transforme parfois
en réalité. Cette ultime déconnexion avec le vrai monde conduit à la fin de tout, à
l’image de la scène d’hallucination de Swofford, où le dortoir devient presque un
manoir gothique plus terrifiant que jamais.
La seule issue désormais : la guerre. Mendes joue ici avec nos nerfs, et on finit par
attendre inlassablement l’arrivée du conflit pour que les morceaux rock entendus
depuis le début résonnent enfin à juste titre. Et c’est là que la magie opère, que
le piège se referme. Les bombes sont là et avec elles les traces qu’elles laissent.
Le décor, certes emprisonnant mais pur, perd son blanc virginal pour laisser place
en son cœur aux cadavres calcinés jonchant le sol. Les soldats se mettent alors à
avancer dans ce qui ressemble de plus en plus à une reproduction des conséquences
de l’éruption du Vésuve, les puits de pétrole étant mis à feu également. Le ciel,
jusqu’alors épargné de la frénésie barbare de ceux qu’il surplombe, est envahi à son
tour. L’enclave est reformée, une nouvelle prison construite, seulement on est de
l’autre côté du spectre des couleurs.
« La terre saigne » dit Jake Gyllenhaal. Pourtant, si en moins de deux heures Mendes
a déjà réussi à traduire la fameuse fin de l’innocence du titre, on n’est pas au bout de
nos peines. On est certes déjà éprouvé par l’expérience vécue mais la récompense
n’est toujours pas là. Le cinéaste nous tient en haleine avec son ultime ressort. Le
36
gâteau bourré de cynisme est prêt, il ne manque plus
que la cerise. Clou du spectacle et du cercueil de la
moralité du spectateur n’ayant toujours pas compris :
le climax, où Swofford a enfin l’occasion d’étaler de la
cervelle irakienne sur le mur d’une tour de contrôle.
La cible est dans le viseur, l’arme calibrée, tout est
réuni pour qu’il accomplisse la dernière étape, celle
qui va le faire rentrer au panthéon de la nation. Mais
non. Un caporal débarque et interrompt ce moment
du sacre. Frustrant au premier abord, cet ultime
rebondissement est celui qui parachève une réflexion
entamée à notre insu depuis la première seconde. En
créant volontairement ce sentiment, Mendes nous
met face à nous-mêmes, qui venons de souhaiter que
le protagoniste, embarqué dans une guerre dont la
stupidité n’a pas cessée d’être démontrée, tue de sangfroid
un autre homme, son semblable.
Le conflit est néanmoins réglé, l’ennemi vaincu. L’âme
cependant, est perdue, quelque part dans le désert.
Le constat est là : quinze ans avant sa balade en plan
séquence dans les tranchées, Mendes a déjà tout
compris et, malgré un léger manque de subtilité propre
à son style, il nous laisse vidés, aux côtés des « pots »
que l’on a accompagné la fleur au fusil pendant deux
heures.
Elie Bartin
JARHEAD (2005)
37
38
LES NOCES REBELLES (2008)
Après s’être aventuré dans le néo-noir et le film
de guerre, Sam Mendes calme ses envies de
grandiloquence, et se recentre sur le portrait familial –
bien que le thème ne l’ait jamais quitté – en choisissant
d’adapter « Revolutionary Road », nouvelle de Richard
Yates. Il choisit de concentrer son récit sur la figure
du couple, ses dysfonctionnalités et sa toxicité. Pour
aborder une narration des plus abruptes, ponctuée
de moments forts, d’explosion de colère et de
dialogues lourds à porter, il propose le projet à l’un des
couples les plus iconiques du cinéma : Kate Winslet
et Leonardo di Caprio, les Rose et Jack de « Titanic »
(1998). Ceux qui nous ont offert l’amour à la folie dans
l’immense fresque de James Cameron vont ici mettre
leur talent et leur complicité à rude épreuve, puisqu’il
va s’agir de s’entre-déchirer de la pire des manières.
Lorsque April rencontre Frank, le jeune homme la
charme par son insouciance et son ambition. Le couple
est beau, voit la vie comme un chemin sans la moindre
embûche et se laisse porter, brûlant les étapes à vitesse
déraisonnable. Chez les Wheeler, rien ne dépasse.
C’est d’ailleurs ce qui charme les Givings, un ménage
voisin dont Helen (Kathy Bates) a vendu la demeure
à la famille sur Revolutionary Road. Les Wheeler sont
parfaits, s’aiment d’un amour fusionnel, et rien ne
peut se mettre en travers de leur chemin. Mais les
années passent, avec elles la routine, les passions qui
s’éreintent, et plus les amants se regardent, moins
ils se reconnaissent. Lui a laissé tomber ses idées
d’ailleurs pour s’enfermer dans une vie de bureau
au sein d’un travail qu’il déteste, elle a sacrifié ses
ambitions existentielles pour devenir la mère au foyer
modèle. Et sous les apparences, le malaise grandit,
creuse une fosse béante au rebord de laquelle les
protagonistes luttent pour ne pas y plonger.
« Les Noces Rebelles » est le récit d’une destruction.
Destruction annoncée par John Givings, le
fils mentalement handicapé des voisins cité
précédemment, qui tente de faire exploser les
humeurs de Frank, de le mettre à l’épreuve pour en
réalité le mettre en garde. Quand April parvient à
convaincre Frank d’abandonner cette vie si lisse qui les
déprime, ce dernier accepte en douce une promotion
à son travail, faisant de l’argent-roi sa priorité, toujours
au sacrifice de lui-même. Les pressions sociétaires - la
solution du deuxième enfant, pour sauver le couple
mais aussi entrer dans la norme - et financières dans
une Amérique en proie à sa quête erronée d’idéal,
broient le couple, les font douter, et les éloignent
à mesure qu’il tombent dans cette colère. La colère
de ne pas parvenir à s’accomplir, à ne pas vouloir les
mêmes choses – les ont-ils vraiment déjà voulues?
-, la colère de se retrouver face à un étranger qui ne
nous comprend pas et dont on est persuadé qu’il fera
tout pour nous nuire. Alors ils chutent dans la spirale
infernale, celle de l’adultère, de la violence, surtout
verbale mais par moments physique, et l’harmonie
explose.
Ici, tout est question de dialogues. Les moments
forts se situent dans les affrontements, où les deux
comédiens portent sur leurs épaules une partition
éreintante, les mettant dans des états seconds dans
le cadre d’un tournage qui, on l’imagine, a dû être
particulièrement chaotique. La tension est palpable,
suinte par les bords de l’écran, et on transpire, on
serre ses poignées de siège et ce ressentiment est le
nôtre, celle colère est celle que l’on contient en tout
instant, et qui ici nous explose à la gueule en nous
emportant avec elle. Surtout, la tension ne nous lâche
jamais, et dans les moments mondains, où le couple
feint les apparences, ou dans ceux où ils tentent de se
retrouver, on appréhende un coup, une éclate verbale.
On sort épuisé, mis à terre par un récit d’une justesse
traumatisante, et d’un constat fataliste qui ne laisse que
peu d’espoir.
À l’instar d’ « American Beauty », mais également des «
Sentiers De La Perdition » et de « Jarhead » Sam Mendes
met en garde contre les faux-semblants, le manque de
communication et les points de non-retours. Ils nous
montre les extrêmes de nos égarements, et le manque
de loyauté envers soi-même qui ne peut mener qu’à
l’auto-destruction, dans un rapport à la mort toujours
aussi omniprésent. “Les Noces Rebelles” brille par sa
justesse, à l’instar du sentiment du noirceur qu’il laisse
au fond de la gorge.
Thierry de Pinsun
39
Après s’être attaqué deux fois à la structure familiale,
notamment au couple, de manière acerbe et violente,
Sam Mendes revient de manière plus apaisée et légère
dans « Away we go », un film qui, s’il est mineur dans
la filmographie du réalisateur, demeure un beau petit
moment de cinéma.
Burt Farlander (John Krasinski) et Verona de Tessant
(Maya Rudolph), deux jeunes trentenaires un peu
galériens, filent le parfait amour. Verona tombe
enceinte et, alors que le couple idéal pensait se reposer
sur les parents de Burt pour pouvoir avancer dans leurs
vies professionnelles malgré l’arrivée d’une nouvelle
bouche, ils apprennent à trois mois de l’accouchement
que ceux-ci partent en Belgique pour deux ans. Ils
décident alors de voyager à travers le continent nordaméricain
pour trouver un endroit où créer leur famille,
en se basant sur des villes où des personnes leur étant
proches vivent.
Il est étonnant de voir Mendes se prêter à l’exercice
du film quasi « feel-good », une comédie légèrement
dramatique où l’ambiance est globalement joyeuse.
Dès le départ, il lance les hostilités, initiant son film
avec une scène de sexe au sein de laquelle l’humour
prend bien vite le pas sur l’excitation, nous révélant
un couple des plus fun, cherchant simplement à vivre
heureux mais qui va être chamboulé par l’imminence
de la parentalité. On est sur un schéma classique de
la comédie de couple, sauce US, où celui-ci va devoir
affronter un point clé de la vie avec des situations
délirantes. A ce titre, et dans un tout autre registre,
on peut penser à « 40 ans : mode d’emploi » de Judd
Apatow, fort sympathique.
Pour autant, le scénario de Dave Eggers et Vendela Vida
regorge de petites surprises qui vont venir pimenter
ce carcan originel en faisant du film un road-movie
où chaque destination et rencontre va traduire un
tourment du binôme impatient mais encore insouciant
quant à ce qui les attend. Chaque ville va alors apporter
son lot de séquences improbables : Phoenix où l’amie
de Verona se moque de ses enfants tout en admettant
qu’ils sont, avec l’alliance qu’elle a au doigt, la seule
raison qui fait qu’elle n’a pas quitté son mari ; Madison
dans laquelle gît Ellen (Maggie Gyllenhaal), aux idées
complètement radicales et dérangées concernant la
gestion des enfants et ainsi de suite. Le couple est aussi
source d’hilarité permanente. Leur côté « fuck-ups »,
allié à leur humour souvent en dessous de la ceinture,-
on pense au running gag de Burt qui s’inquiète
principalement de savoir s’il trouvera toujours le
vagin de sa femme après l’accouchement ou si celle-ci
gardera sa belle poitrine -, et leur amour imperturbable
en font des énergumènes délirants et attachants dont
on souhaite voir le bonheur éclore sous nos yeux.
Au milieu de toutes ces péripéties, Sam Mendes
n’oublie pas qu’il est cinéaste. Certes plus réservé que
sur la plupart de ses métrages, il distille çà et là des
plans forts, jouant particulièrement des sur-cadrages
autour du couple Burt-Verona comme pour créer des
photos de famille et montrer qu’ils n’ont pas besoin
de plus qu’eux pour créer leur foyer et être heureux.
Cette discrétion dans la mise en scène qui n’est donc
pas anodine permet au métrage d’avancer avec une
certaine subtilité à ce niveau. Par ailleurs, il faut relever
la très bonne direction d’acteurs car, même si l’on est
face à un surjeu quasi-constant, mais volontaire, pour
certains, ils sont tous en pleine possession de leur
rôle et on arrive à y croire tout du long. Cependant,
et c’est là où Mendes pèche souvent, la musique est
trop présente et, bien que plaisante car constituée
de nombreux morceaux pop-rock, elle dessert
beaucoup l’impact émotionnel de certaines scènes.
Cette superficialité vient marquer une frontière entre
le spectateur et les personnages, alors au cœur de
discussions souvent percutantes et pleines de sens.
L’entreprise reste néanmoins une réussite dans
l’ensemble. La naïveté qui se dégage du film est
enivrante et on a l’impression que Mendes, après ses
« Noces rebelles », dont on ressort éprouvé, vient se
ressourcer en attendant de revenir aux choses sérieuses
en livrant l’un des meilleurs opus d’une saga qui
avait besoin de fraîcheur, dans lequel il décortique
psychologiquement la figure emblématique de l’agent
007, avec « Skyfall ».
Elie Bartin
40
AWAY WE GO (2009)
41
42
1917 (2019)
La course pour la survie est sans doute l’un des moteurs les plus puissants qui soit pour l’être humain. Les récits
durant les guerres qu’a connu notre monde rentrent souvent en lien avec ce besoin de vivre, essayer de faire face à
l’horreur puis essayer de s’en détacher pour mieux retrouver la normalité. Ce besoin de survie se retrouve ainsi au
cœur de “1917”, dans ce qu’on pourrait considérer comme une course de deux heures afin d’essayer de sauver, en
plus de soi-même, les autres. C’est en somme le récit d’une humanité qui se doit d’être en mouvement perpétuel
pour subsister face aux autres et aux forces de la nature avant de pouvoir enfin connaître le repos mérité.
Dans ce sens, le dispositif visuel du plan séquence continu constitue une prise de décision logique par sa volonté
d’immersion dans cette fuite en avant, collant au plus proche des deux soldats mis face à une terreur plus large que
ce que leur destin ne semblait le paraître. Ce sont deux héros non pas par le combat mais leur courage, leur absence
de résignation face à leur tâche et la menace d’une perte humaine vaine, tout autant que la guerre en elle-même.
Mendes fait donc au mieux pour dresser un portrait de courage dans cette adversité mais cela en cherchant le moins
possible à glorifier le combat afin d’éviter de tomber dans un paradoxe belliciste inhérent au genre.
C’est l’un des gros problèmes du film de guerre même, tel que souligné par François Truffaut : en illustrant le combat,
on l’iconise, volontairement ou non. Dans ce sens, Mendes évite en permanence l’affrontement direct, faisant de son
long-métrage une œuvre montrant l’horreur du conflit à posteriori, les seuls moments dits « d’action » ne dégageant
un certain gigantisme que pour répondre à l’aspect macroscopique de ce qui arrive à nos protagonistes, en résonance
à leur destin microscopique de nature.
Pas étonnant en ce sens que Schofield et Blake se retrouvent plus aux prises avec les éléments de la nature que les
allemands même, la lâcheté de certaines personnes intéressant moins Mendes que l’illustration d’un certain courage
ainsi que la bêtise inutile de tels combats. La façon dont lui et Deakins illustrent le récit va en ce sens, gardant à
conserver une certaine empathie tout en offrant un voyage dans un enfer que l’humain, dans sa volonté d’autodestruction,
n’hésite pas à perpétuer indéfiniment.
Loin de la simple prestation technique gratuite dans laquelle on a catégorisé le film de manière trop simpliste, « 1917
» constitue un récit d’humanité, dramatique par ses ramifications répétées encore et encore tout au long de l’histoire.
La fuite en avant de Schofield et Blake permet au mieux de nous confronter à l’absurdité de notre comportement
belliqueux tout en questionnant par sa linéarité apparente le besoin que nous avons de mener à notre annihilation.
De tels récits anti-guerre, surtout au vu de l’actualité, devraient être célébrés et non renfermés car certains ne peuvent
voir qu’on peut allier recherche esthétique et profondeur narrative…
Liam Debruel
43
SUICIDE SQUAD :
DC UNIVERSE, MORT-
44
NÉ
45
46
En à peine trois métrages, le DCEU (comprendre « DC
Extended Universe », en réponse au « Marvel Cinematic
Universe ») est passé de promesse grandiose à fiasco
total. « Man Of Steel » (2013) et son alter-ego assombri,
« Batman V Superman » (2016), n’étaient pas exempts
de défauts, mais entamaient un cycle à la personnalité
propre, et à la volonté d’offrir un spectacle adulte,
mêlant notre rapport au divin au spectacle pur. Le
troisième volet de cet univers étendu, « Suicide Squad
» (2016), va vite nous faire comprendre que le DCEU va
s’enfoncer dans le mauvais goût.
Alors le studio tente de redresser la barre, en effaçant
ce volet en faisant appel à James « Les Gardiens De La
Galaxie » Gunn, et en proposant un volet sur le seul
personnage « apprécié » du film, Harley Quinn, avec
« Birds Of Prey » qui s’apprête à sortir. L’occasion pour
nous de revenir sur la recette d’un ratage complet
et d’essayer d’en comprendre les facteurs. La genèse
même du projet n’est pas sous les meilleures augures
: dans l’idée d’introduire une bande de vilains qui
peuvent tenir tête au Chevalier Noir - et qui nourrissent
de leur machiavélisme nombre de fictions dérivées -,
on leur offre un film...où ils sont les héros. On repense
à “Venom”, pourtant succès l’année dernière, qui partait
sur le même principe : puisque Sony n’a plus les droits
de Spider-Man, il va prendre un de ses méchants
emblématiques...pour en faire un gentil.
Et quand on vous dit « gentils », on ne parle pas du fait
qu’ils sont les personnages principaux de leur film et
qu’on se doit de les suivre quels que soient leur choix
moraux. Loin l’idée d’être devant une sensation à la «
The Devil’s Rejects » (2005) de l’ami Rob Zombie, ou
plus récemment du « Joker » (2019) de Todd Phillips.
Ici, toutes les aspérités possibles vont être lissées pour
ne nous offrir que des gentils bonhommes au passé
tortueux, qui expliquent toutes leurs actions par leurs
traumatismes. On peut associer ce choix scénaristique
au premier facteur responsable du drame : la présence
de Will Smith au casting. On connaît l’acteur pour ses
choix de production tyrannique, et son incapacité,
en plus de fournir un jeu correct, à endosser un rôle
n’ayant aucun trait de noblesse. Un tueur à gages
sanguinaire dont la seule vocation est d’éliminer la
chauve-souris ? Rajoutons-lui un enfant et le fait qu’il
souhaite se ranger pour ce dernier. On se demande
toujours pourquoi l’ami Will a accepté un rôle aux
antipodes de ses valeurs, toujours est-il qu’avec lui sur
l’une des manettes, on sait de quoi il retourne. Ce n’est
peut-être pas de son fait, mais rien de moins étonnant
de voir cette tripotée de personnages qui vont se lever
et renier leur nature pour la cause commune.
Le deuxième facteur, autrement plus important, réside
dans la réception critique de « Batman V Superman
». Là où les critiques s’acharnent, et à raison, sur un
troisième acte trop axé action et faisant offrande à la
bouillie numérique – visiblement, DC et Warner n’ont
pas compris, en témoigne le dernier acte de « Wonder
Woman » (2017) par exemple -, le ton trop sérieux du
film, ainsi que certains choix dramaturgiques pourtant
clairs sont également vivement critiqués, unique
élément que le studio prend très à cœur. Alors que le
métrage est peu à peu réhabilité, notamment après la
sortie de sa version longue, et a eu un rapport financier
plus que correct, impossible pour les actionnaires de
risquer leur nouvelle source de revenus. Il faut sortir
du ton apporté par Zack Snyder – jusqu’à l’éjecter de
« Justice League » (2017) dans des conditions encore
plus déplorables -, lisser le tout et tenter de copier la
recette Marvel, quant à elle toujours aussi fructueuse,
en mettant de l’humour à tout-va. Alors on malmène
le film en le renvoyant régulièrement en « reshoots
». À l’heure où la moindre information entachant la
production d’un long métrage est instantanément
publique, on savait pertinemment qu’il ne fallait plus
attendre grand chose du film de David Ayer.
Mais ce « Suicide Squad » aurait-il été une franche
réussite sans sa création chaotique ? Ici aussi, pas
si sûr. On veut bien tenter d’identifier les éléments
ajoutés, qui ternissent le ton par leurs blagues pas
franchement bienvenues, mais il n’empêche que
la volonté principale, évoquée plus haut, en faisait
déjà un produit prévu pour l’échafaud. « Suicide
Squad » est une horreur de sa première à sa dernière
minute par tous les choix qui y sont faits. Que ce soit
les personnages tous absolument inconsistants qui
décident à mi-chemin d’avoir une motivation parce que
47
« il faut sauver le monde », une antagoniste dont on
ne comprend ni les enjeux ni l’intérêt, et un pseudodiscours
politique sur la gestion de la réhabilitation des
criminels qui n’apporte aucune grille de lecture, rien ne
sauve les meubles, pas même les fameux «maquillages
et coiffures » pourtant lauréats d’un Oscar. Les fameuses
capacités spécifiques à la qualité de “méta-humains”
de l’escouade sont rapidement noyées sous des scènes
de gunfights sans saveur et filmées à la truelle, retirant
tout ce qui aurait pu faire le sel du métrage. Une
présentation de Deadshot où l’on voit ses capacités au
tir, et aucune utilisation dans la mise en scène pour
justifier son talent par la suite. Mention spéciale à Killer
Croc, qui sert juste à faire des blagues. Harley Quinn
a été appréciée ? On se demande bien pourquoi, tant
le personnage n’est pas respecté, que son duo avec le
joker, ici raté au possible malgré la bonne volonté de
Jared Leto, est absolument pathétique. Margot Robbie
cabotine, surjoue une folie à laquelle on ne croit
jamais, donne deux trois coups de batte par-ci par-là.
Si ça suffit à mettre les mascus en rut, tant mieux pour
eux, mais pour l’intérêt réel, on repassera.
On note les musiques, qui peuvent charmer les plus
naïfs, mais même ici, le choix est sans risques : des
classiques rock déjà utilisés dans des œuvres bien
plus pertinentes, les groupes que l’on nous ressort
lors de toutes les compilations « Guitar Hero » avec
l’unique titre que ces producteurs sans culture – oui,
les copains, Black Sabbath a sorti bien plus de titres
que Paranoid ou Iron Man – déversent chaque fois
qu’il leur manque une idée. La manière d’ailleurs de
les déblatérer en enchaînement constants lors de la
présentation des personnages montre bien qu’ils n’ont
d’autre but que celui d’attiser le “cool”, et n’ont aucune
force évocatrice. Pour voir comment utiliser ces mêmes
types de classiques de manière intelligente, on vous
recommande le “Watchmen” (2009), toujours de Zack
Snyder, qui savait alors jouer avec l’époque, la force des
paroles, le sens du rythme.
David Ayer a surpris avec son « Fury » maîtrisé, mais est
vite utilisé, écorché et lessivé par une production qui,
on suppose, ne lui a laissé aucun choix artistique. Un
nom qui fait bien sur l’affiche mais dont on ne voit ni
l’ambition ni la patte (sur ce point-là, enfin quelque
chose venant de chez Marvel / Disney qu’ils ont réussi
à imiter à la perfection!), condamné à aller flirtouiller
chez Netflix avec son « Bright » bien ridicule (et à la
morale bien pataude...Tiens donc, il y a également
Will Smith à l’affiche!). En espérant que la leçon soit
comprise et que James Gunn, bien plus habitué des
productions chaotiques, puisse tirer quelque chose de
son reboot/remake, et parviendra à éventuellement
relever le niveau du DCEU et les motiver à nouveau à
tenter de la prise de risque. Au vu des récents métrages
de la licence, “Justice League” et “Shazam” (2019) en
tête, le challenge est de taille. Quand les blockbusters
s’uniformisent, il est triste de se dire que c’est là l’une
des seules choses qui pourrait violemment frapper
la fourmilière. Parce que « Birds Of Prey », on y croit
moyennement.
Thierry de Pinsun
48
49
PORTRAIT
ABDEL RAOUF DAFRI
50
« Les gens pensent que je suis arrogant, mais je suis seulement sûr de moi ». C’est
la phrase qui définit le mieux Abdel Raouf Dafri, scénariste dont le nom rayonne
depuis quelques années et qui s’efforce, avec d’autres comme Guillaume Lemans par
exemple, de donner un nouveau souffle au cinéma populaire français.
Abdel Raouf Dafri est né en 1964 à Marseille de parents algériens. De son propre
aveu, l’école ne l’intéresse pas vraiment, préférant dévorer avec avidité des bandes
dessinées, des polars noirs mais aussi des classiques de la littérature française. Le
jeune Abdel souffre de trouble de l’attention et son je-m’en-foutisme ostentatoire
l’amène à redoubler la 6e et la 5e. Le proviseur conseille donc à ses parents de
l’orienter vers un lycée technique. Il passe sur les bancs de deux établissements pour
devenir chaudronnier soudeur puis rentre aux ateliers collectifs de la métallurgie. De
son alternance à l’usine, il garde le souvenir d’un camarade aux doigts coupés et d’un
autre à l’oeil crevé. C’est donc par réflexe de survie qu’il ne se rend pas à l’examen et
se retrouve sans diplôme dans la France miterrandienne où le phénomène des radios
libres explose. Dafri y voit la possibilité d’aiguiser sa verve gouailleuse et s’engouffre
dans la brèche. Sous le pseudonyme de Francis Panama, il passe des disques de
musique noire américaine achetés chez le disquaire du coin et parle avec passion des
chanteurs et des musiciens.
Sa voix plaît et on lui propose de devenir animateur salarié à la radio la Voix du Nord.
Son goût pour la provocation l’amène à animer des débats du genre « Pourquoi doiton
ramener les immigrés à la frontière? » ou encore « Doit-on piquer les vieux? ».
Exercice qui l’amuse beaucoup. Dans une autre émission, il fait gagner des VHS pornos
qu’un ami a récupéré dans un carton tombé d’un camion. Quelques temps plus tard,
il repasse par la case chômage puis fait de la communication d’entreprise. Dafri est
quelqu’un qui en veut, et devient animateur sur TMC pour l’émission « Panama on
the beach ». Lors d’une soirée avec d’autres gens de la télé, il se retrouve en face de
personnes sans culture ni références. Il refuse de passer du temps avec ces gens-là.
S’ensuivent quelques années de chômage pendant lesquelles Dafri ne reste pas sans
rien faire. Il passe ses journées à continuer d’enrichir sa culture des grandes œuvres
littéraires françaises, mais surtout à regarder des films et à les décortiquer. Il s’acharne
à comprendre la grammaire scénaristique et commence, alors qu’il est encore au
RMI, l’écriture de « La Commune » qui deviendra plus tard une série sur Canal +. En
parallèle, Dafri envoie le scénario de « Un Prophète » à Canal Plus Écriture, alors dirigé
par François Cognard, qui l’encourage grandement à continuer. Son script n’est pas
accepté tout de suite car il ne correspond pas à la demande du cinéma français de
l’époque. Mais tout ceci ne sera pas vain, car grâce à ce scénario et à « La Commune
», il rencontre le producteur Marco Cherqui, qui va miser sur son talent. C’est lui qui
propose le scénario de « Un Prophète » que Dafri a peaufiné avec l’aide de Nicolas
Peufaillit. Le film deviendra le succès qu’on connaît.
Mais avant la sortie du film, la réputation qui précède le scénario de Dafri lui vaut
d’être engagé par Thomas Langmann dont l’ambition de produire un biopic sur
Jacques Mesrine ne trouve pas un angle scénaristique viable. Dafri y voit une
opportunité de travailler sur un personnage ancré dans l’inconscient collectif français
pour questionner son identité et accouche d’un scénario qui donnera lieux à deux
films, l’un étant l’adaptation du livre de Jacques Mesrine, l’autre un scénario original.
Le diptyque réunira 4 millions de spectateurs en salles et assoit la stature d’Abdel
Raouf Dafri comme un personnage majeur du cinéma français.
« Un Prophète » suit le parcours de Malik El Djebena, un jeune homme condamné à six
années de prison, et qui ne sait ni lire ni écrire. D’abord sous les ordres d’un clan de
prisonniers corses, il utilise son intelligence pour développer son propre réseau. Dafri
écrit le film en voulant montrer une frange de la population qu’on voyait rarement
dans le cinéma français, des gens issus de l’immigration. Le pari est réussi puisqu’on y
découvre le talent de Tahar Rahim et de Reda Kateb, véritables révélations. Mais il est
difficile de ne pas y voir une sorte d’autobiographie de Dafri sous forme de prophétie
51
auto-réalisatrice. Malik, c’est lui. Il utilise alors ses talents
dans l’art du langage pour monter les échelons, non pas
dans la voyoucratie, mais dans le milieu du cinéma. Si
à la fin du film, le protagoniste sort de prison avec les
honneurs et une nouvelle famille, Dafri lui, repart avec
le succès et une certaine notoriété.
Néanmoins ce n’est pas seulement le succès qui rend
intéressant quelqu’un comme Abdel Raouf Dafri, mais
surtout les thématiques qui jalonnent ses scénarios.
Car, sous couvert du genre, ses films sont hautement
politiques. Il tente de faire une cartographie de
l’histoire de France, comme une sorte d’analyse
psychogéographique éthérée et cinématographique.
Il s’efforce de montrer un visage plus nuancé de l’âme
humaine, sans aucune polarisation bien/mal. Le
personnage de Malik El Djebena dans « Un Prophète »
se rapproche de celui de Jean-Baptiste Grenouille (“Le
parfum”) mais sous ce prisme romanesque, le film
pose la question du système carcéral français et celle
d’un échec de l’intégration avec un cloisonnement en
communautés. Dafri n’écrit pas des films à charge mais
pose les bases d’une réflexion. La vie de Mesrine est
prétexte à montrer une facette clandestine de l’histoire
récente, de son grand banditisme à ses réseaux
d’extrême gauche en passant par l’OAS. Il dessine
le parcours schizophrénique d’un héros tour à tour
immense salaud et homme flamboyant. Dafri s’obstine
à montrer une certain ambiguïté chez ses personnages
et Mesrine en est l’avatar parfait.
Avec la sortie de son premier film en tant que
réalisateur, Dafri s’attaque à la guerre d’Algérie. Si l’on
pouvait s’attendre à un film à charge, il n’en est rien.
« Qu’un sang impur » est le portrait d’une guerre qui,
en 1960, a sombré dans l’ensauvagement et dont les
deux camps ont perdu pied avec la réalité et surtout la
décence. Le film montre les exactions menées aussi bien
par l’armée française que par le FLN contre la population
algérienne. Oubliez la dichotomie entre bien et mal.
Sous le soleil des Aurès, l’ombre se mêle à la lumière
et les personnages ne sont que nuances de gris. Dans
ce paysage crépusculaire, Dafri se demande ce que
signifie être français à l’époque de la guerre d’Algérie.
Car la carte n’est pas le territoire et le commando du
film montre des citoyens dont uniquement un seul
membre est, comme s’amuse à le dire le réalisateur, “de
souche Astérix”. Pourtant tous se battent pour le drapeau
tricolore. Malheureusement, les dialogues parfois trop
littéraux et le manque d’expérience de Dafri en tant
que directeur d’acteurs n’aident pas les comédiens qui
sont justes une réplique sur deux. Le résultat final a une
patine de western qui fait du bien. On retient surtout le
film pour son projet initial, montrer l’absurdité de cette
guerre qui a laissé une plaie difficile à refermer, dont les
algériens paient encore le prix aujourd’hui et qui reste
un tabou dans la société française.
Abdel Raouf Dafri s’intéresse à l’histoire de son pays et
nous tend un miroir grimaçant mais intraitable dans son
constat : les choses ne sont jamais aussi simples que ce
qu’elles paraissent.
Mehdi Tessier
52
53
RÉTROSPECTIVE
MICHEL HAZ
54
ANAVICIUS
55
« La Classe Américaine », l’immense détournement qui
le fit flirter avec « The Movie Orgy » (1968) de Joe Dante,
démontre un talent naturel de Michel Hazanavicius pour
la comédie. Avec son diptyque « OSS 117 », il prouve sa
capacité à filmer une comédie tantôt potache, tantôt
subtile, toujours efficace, mais aussi un film d’action
combiné à un film d’époque maîtrisé.
Pour accompagner un personnage connu des lecteurs de
Jean Bruce mais aussi des cinéphiles les plus acharnés
- le désormais très célèbre agent ayant déjà eu droit à
plusieurs adaptations entre la fin des années 50 et la fin
des années 60, dont trois réalisées par André Hunebelle
-, Hazanavicius a trouvé en Jean Dujardin l’acteur parfait
pour endosser le rôle. Celui que l’on voit immédiatement
comme Hubert Bonisseur De La Bath dès qu’il amorce
un rôle comique – on pense notamment au « Retour Du
Héros » (2018) de Laurent Tirard - a trouvé en OSS 117 un
alter-ego qui lui colle à la peau, et qu’il prend un malin
plaisir à jouer. Il faut dire qu’avec un tel personnage, il
y a de quoi se faire plaisir. Maladroit, persuadé de sa
perfection, sexiste, homophobe, raciste, il représente
à lui seul les exacerbations les plus folles de la « vieille
France ».
OSS 117 1 & 2 (2006 - 2008)
Les polémiques sont d’ailleurs nombreuses quant
au caractère du personnage, beaucoup le prenant
au premier degré. Il s’agit pourtant de rire de lui, pas
avec lui, et l’idée est de jouer avec les stéréotypes, les
déballages de clichés que l’on n’entend que trop dans
des discussions mondaines (les femmes ne pouvant
avoir de métier « d’homme » car il faut « porter des
objets lourds »...). À aucun moment, OSS 117 n’est
56
mis en valeur, mais est au contraire constamment
tourné en ridicule (ne serait-ce que par ses noms de
couverture, Lucien Bramard et Noël Flantier), les films
nous questionnant alors sur notre rapport à l’humour.
On se pose la question de ce pourquoi on rigole, de si
les blagues d’Hubert qui nous font sourire jaune n’ont
pas à un moment été les nôtres.
Son administration est toute aussi ridicule : celle qui
envoie son agent le plus cliché et le plus franchouillard,
un boulet innommable incapable de faire preuve de
discrétion dans l’infiltration, à la rencontre d’autres
cultures qu’il ne cherche pas à comprendre parce que
tout doit être adapté à lui, et pas le contraire. Un peu
plus, et on croirait qu’on nous dresse un portrait du
touriste français s’étonnant et faisant un scandale parce
qu’il n’y a pas de pain au restaurant de sa destination
vacancière.
L’humour fonctionne alors parce que la vulgarité du
personnage est totalement assumée, sans jamais être
glorifiée. On s’amuse de sa grossièreté, de sa connerie
imperturbable nous faisant penser à ce vieil oncle des
repas de famille qu’on essaie d’éloigner le plus possible
du ballon de rouge. Ce qui fait mouche, ce sont avant
tout les dialogues, écrits par un Jean-François Halin
en très grande forme. Tous se faisant écho et étant
réfléchis pour correspondre à un certain rythme (on
y retrouve des techniques d’écriture de Francis Véber
dans ses comédies les plus cultes), il y a toujours de
quoi se régaler. D’autant plus quand les gimmicks
agissent en miroir dans les deux films, tout en ayant
leurs personnalités propres. « Le Caire Nid D’espion »
(2006) va accentuer son côté absurde par le décalage du
personnage avec la réalité qui l’entoure, là où « Rio Ne
Répond Plus » (2009) le montre plus âgé, et forcément
encore plus dépassé, donc plus idiot. Les tons changent,
rendant chaque film unique, aux gags renouvelés.
La panoplie de personnages entourant Hubert n’est
évidemment pas en reste, tous participant au succès du
film, notamment les femmes, qui ont le beau rôle dans
les deux métrages. Là où Hubert se moque allègrement
d’elles et met constamment en doute leurs capacités,
les relayant au rang d’assistantes, Larmina (Bérénice
Béjo) et Dolorès (Louise Monot) sont en réalité celles qui
font avancer l’enquête, accumulent les indices, et font
preuve de poigne lors des moments d’action. Le crédit,
par le plus grand des hasards et le fait qu’il intervient
au bon moment, revient à ce bon vieux Hubert, mais le
spectateur n’est pas dupe.
Les dialogues de Jean-François Halin sont sublimés
par la mise en scène d’Hazanavicius. OSS 117 n’est
pas une simple comédie de dialogues, elle est aussi
visuelle, tant par le choix des décors, parfaitement mis
en valeur, que des gags visuels, eux aussi foisonnant
et toujours bien pensés. Les femmes qui se retournent
toutes dès qu’Hubert croise leur chemin dans « Le Caire
Nid D’Espion », fil rouge dont on se délecte, le fait qu’il
soit constamment à découvert, tire sans bouger et ne
reçoive pas la moindre balle alors que ses opposants
sont à deux mètres dans « Rio Ne Répond Plus », tout est
amorcé pour que chaque plan appose une générosité
humoristique, qu’elle soit le cœur même de la séquence
où une idée d’arrière-plan. Comme le dit Hubert, «
J’aime les panoramas » et chaque fois qu’il est question
d’un plan large sur un décor, une référence s’installe.
Des flagrantes comme « L’homme de Rio » (Philippe de
Broca, 1964), « Sueurs Froides » (Alfred Hitchcock, 1958)
notamment via l’utilisation des travellings compensés
lors de l’ascension du Corcovado, ou des plus discrètes
qui se révèlent via le mimétisme de certains plans,
les allusions dans les dialogues ou autres, Michel
Hazanavicius fait éclater sa cinéphilie maladive à l’écran,
et rend hommage autant qu’il parvient à suffisamment
créer pour ne pas sembler uniquement nostalgique. Lui
qui se plaisait à compiler et détourner dans « La Classe
Américaine » utilise ici son propre film pour jouer avec
ces images de cinéma qui lui trottent en tête et qu’il
adore.
Les deux « OSS 117 » ne sont donc pas que des comédies
potaches dont l’humour fonctionne par le charme des
personnages. Ils sont aussi deux films minutieux et
travaillés, et deux œuvres majeures du cinéma français
des années 2000. Deux métrages qui dressent un
portrait politique pertinent quant à l’époque coloniale,
et font par la satire le jeu des couches de lecture. Il y a
toujours des choses à remarquer à chaque visionnage,
des détails qui nous échappent et qui font de ce
diptyque un grand moment de comédie. On est content
de conserver Jean-François Halin aux dialogues pour «
Alerte Rouge En Afrique Noire », même si en voyant sa
série « Au Service De La France », on a là la preuve que
son talent d’écriture paraît plus anecdotique quand il
manque cruellement de mise en scène. Gageons que
Nicolas Bedos, ayant déjà fait ses preuves par les aspects
comiques dans ses deux films, réussira à sublimer
l’exercice pour ce troisième opus terriblement attendu.
Thierry de Pinsun
57
Dire que le film de Michel Hazanavicius était un
phénomène serait sous-évaluer l’impact qu’il a eu à sa
sortie, notamment dans ses différentes récompenses
comme les Oscars du Meilleur film, Meilleur réalisateur,
Meilleur acteur dans un premier rôle ainsi que la
Palme du Meilleur acteur pour Jean Dujardin. Mais
comme pour chaque sortie qui se sera vu abordée de
manière continuelle et persistante, les retours se font
plus violents encore, même quand cela est loin d’être
justifié. Dès lors, moins de dix ans après sa sortie, peuton
confirmer que la volée de louanges qu’il a reçues est
justifiée ? La réponse est oui, mille fois oui.
Si l’on devait résumer « The artist », on pourrait le faire
en le qualifiant de déclaration d’amour au septième art,
formule passe-partout servant à certains titres d’acquérir
une forme de profondeur, totalement justifiée ici.
Hazanavicius aborde son récit avec passion, notamment
dans sa manière de dépeindre un Hollywood en pleine
transition par la révolution sonore, construisant autant
de carrières qu’elle en a détruites. On ressent donc une
crainte tout à fait légitime de la nouveauté, obligeant
chacun à franchir une nouvelle étape qui peut sembler
insurmontable pour certains. Et pourtant, ce besoin
d’avancer est une nécessité, comme montré plusieurs
fois par notre société.
Georges Valentin est donc un exemple parfait d’être
réticent par la nouveauté, cherchant à s’enfermer dans
le passé comme si le futur ne pouvait jamais le rattraper.
Son destin de vie mis en lien avec celui de la jeune
actrice Peppy Miller (Bérénice Béjo dans une prestation
superbe trop souvent occultée par celle de son partenaire
de jeu) rentre dans une forme de résonance, celle d’une
génération qui, si elle s’enferme dans son mode de vie
précédent, ne peut que rester bloquée face à celles et
ceux qui montent dans le train de la nouveauté.
Dès lors, si le bagout de Jean Dujardin laisse place à une
forme de désespoir, voyant dans le son un cauchemar, sa
prestation remarquable souligne le besoin de s’adapter
et de savoir laisser de la place à d’autres afin de continuer
à vivre de son rêve. « The artist » se révèle dès lors
lumineux par la manière dont Hazanavicius dépeint un
monde artistique qui sait faire cohabiter différents types
de rêveurs sachant voir dans le changement non pas un
mur mais une porte vers un monde qui peut s’améliorer.
C’est à nous désormais de voir si nous serons prêts à la
franchir…
Liam Debruel
THE ARTIST (
58
2011)
59
60
LE REDOUTABLE (2017)
Après son «The Artist» oscarisé, Michel Hazanavicius
se lance dans un film plus personnel, plus
politique également, avec «The Search». Métrage
malheureusement oublié depuis - le marketing, alors, n’a
clairement pas aidé le film à exister -, il lui considère luimême
comme un écart, un rappel à l’ordre que personne
n’est infaillible, y compris un réalisateur en plein succès.
Il choisit avec sa proposition suivante, «Le Redoutable»,
de parler de ce qu’il aime le plus, le cinéma, à travers la
figure de Jean-Luc Godard. Plus précisément à la fin des
années 60, où la révolution sociale va le pousser dans
une crise existentielle, lui qui sort de La Chinoise et se
remet en question sur sa suite artistique.
Coup de génie que de vouloir parler de Jean Luc Godard
à travers la comédie. Le film ne se proclame aucunement
du Biopic et provoque les plus tatillons en jouant de
l’image du réalisateur chouchou de la nouvelle vague.
Le réalisateur réunit Louis Garrel en Godard et Stacy
Martin en Anne Wiazemsky, choix qui apparaît comme
une évidence tant les deux acteurs s’amusent à casser
le quatrième mur, à jouer avec les codes du cinéma de
Godard. Des personnages Godardiens, en comme. À
travers une confusion volontaire, Hazanavicius parle de
Godard, ou plus précisément de son image et surtout de
son cinéma.
Cela détonne alors comme une déclaration d’amour qui
par sa subtilité pourrait laisser entendre après visionnage
du film : “ Mais tu crois qu’il était comme ça ?” ou encore
“ Bah dis donc ce Godard c’était qu’un con”. Et nous
de leur répondre : “ Mais ce n’est que de la comédie,
voyons, c’est même là qu’Hazanavicius excelle !» Avec
«La Classe Américaine» (1993) Hazanavicius donnait
le ton de ces films dont les répliques sont connues de
tous. Le redoutable réalisateur est de retour dans ce
qu’il connaît de mieux et nous amuse dans des scènes
merveilleuses, comme la manifestation étudiante ou la
discussion dans la cuisine, intégralement en sous-titres.
«Le Redoutable», ce n’est pas que Godard mais aussi
Hazanavicius, qui après avoir amusé le monde entre
«OSS 117» (2006 ; 2009) et «The Artist» s’est remis en
question, a tenté l’exercice politique puis est revenu vers
ce qui le caractérise le mieux, ce qu’il maîtrise. Ainsi va la
vie au bord du redoutable.
Marwan Foudil
61
Quoi de mieux pour commencer l’année que de frissonner ? C’est bel et bien le
programme que nous vous offrons. Trois ans après l’échec du remake « La momie »
(2017), enterrant la tentative d’Universal de lancer un « Dark Universe » - sorte de
MCU des monstres - Blumhouse est venu récupérer une des figures de proue du projet
avorté pour sortir « Invisible Man », nouvelle adaptation de l’œuvre de H.G. Wells. À
cette occasion, il nous a semblé bon de se replonger dans une période de l’histoire du
cinéma où l’horreur émergeait réellement, et où un bon nombre de moments cultes
ont vu le jour : il s’agit ni plus ni moins de la période « Universal Monsters », du studio
éponyme.
Cette galerie de personnages, aussi effrayants que touchants pour la plupart, a laissé
une grande empreinte sur le septième art. À l’heure où l’horreur issue des gros studios
semble peiner à se renouveler, il n’est pas inintéressant de comprendre d’où certains
codes et figures que nous admirons proviennent afin de se ressourcer et, qui sait,
apprécier la tentative à venir de relancer une machine quelque peu en panne.
De l’arrivée de Paul Leni, dont « L’homme qui rit » (1928) va inspirer les œuvres qui
suivent, aux récentes ébauches de remakes dont le “Wolfman” de Joe Johnston (2010),
nous allons tenter, via un étendard limité mais ô combien représentatif de métrages du
mouvement, de vous en offrir un aperçu. L’âge d’or des années 30 avec les monstres
James Whale et Tod Browning, les figures qui nous viennent immédiatement en tête
telles que “Dracula”, jusqu’à une tentative d’explication du fiasco entourant le remake
de “La Momie” cité plus haut, penchons-nous sur une branche de l’histoire d’Universal,
source de gloire comme de désillusion du studio au globe !
Elie Bartin
62
UNIVERSAL
MONSTERS
63
64
L’HOMME QUI RIT (1928)
Après une première adaptation de Victor Hugo
réussie, jalon du lancement de la production de films
de monstres pour le studio, Universal recommence
l’exercice en revenant sur une œuvre pas forcément
aussi connue que « Notre-Dame de Paris » mais toute
aussi propice à garnir son univers horrifique, à savoir
« L’homme qui rit », sous la direction de Paul Leni,
réalisateur allemand, ayant travaillé sur deux autres
films pour le studio au globe.
Ce qui frappe ici directement est le mariage entre
deux styles à savoir l’écriture d’Hugo, servant certes un
monstre, mais un qui s’avère plus beau qu’effrayant,
à l’image du Bossu de l’autre roman suscité, et la
mise en scène de Leni, s’inscrivant directement dans
le style expressionniste apparu dans son Allemagne
natale et ayant alors le vent en poupe. Cette alliance
va donner lieu à une œuvre riche visuellement comme
émotionnellement qui, quatre ans avant le « Freaks » de
Tod Browning, offre un message fort de tolérance.
On suit alors Gwynplaine (Conrad Veidt), jeune garçon
noble défiguré et condamné à sourire pour le restant
de ses jours, qui va rencontrer Dea (Mary Philbin), une
jeune fille aveugle, et Ursus (Cesare Gravina), sous
la tutelle duquel les deux marginaux vont grandir,
devenir stars d’un « freak show » mettant en scène
« l’homme qui rit » et tomber amoureux. Mais ce
bonheur va être chamboulé par la noblesse anglaise et
ses agissements contre la bande d’itinérants.
Partant de ce postulat, somme toute peu original, Leni
va réussir à développer un mélodrame romantique
des plus forts, doublé d’une petite morale sociale
bienvenue. En effet, dans ce film muet, le cinéaste
expressionniste parvient à toucher le spectateur tout en
l’impressionnant. Les décors sont grandioses, exagérés
et rappellent fortement ceux que l’on pouvait trouver
dans des films comme « Le cabinet du Docteur Caligari
» de Robert Wiene, dans lequel Conrad Veidt tient
d’ailleurs le rôle principal. Cet aspect visuel donne déjà
un certain charme à l’œuvre et, combiné à l’histoire
poignante qui se déroule, on obtient un conte sombre
bouleversant.
Le caractère muet du film est également une force car
cela amène la mise en scène à devoir exprimer des
émotions sans pouvoir se reposer sur autre chose. Leni
y montre une aisance folle, en jouant sur des plans
de face des personnages, superposés parfois, et le
cadrage expressionniste, si particulier et déjà bien usé
en 1928. On trouve là une œuvre de référence tant la
maîtrise est réelle. On peut juste regretter un dernier
acte, davantage orienté action, qui s’avère être un peu
brouillon et parfois difficilement lisible mais c’est bien
peu en comparaison des nombreux émerveillements
visuels proposés.
Aussi, malgré le fait que ce soit muet, Leni insère des
sons, possibilité révélée par « Le chanteur de jazz » un
an avant, et c’est toujours pertinent. Il va notamment
se servir de bruits de rire pour appuyer l’humiliation
subie par Gwynplaine lors de ses représentations, ce
qui va contribuer à nous attendrir un peu plus pour
ce malheureux, dont le gagne-pain est synonyme de
souffrance morale. On est alors attaché à ce marginal et
on se rend compte que le monstre ce n’est pas lui mais
bien cette société qui tend à l’exploiter et ne le voit que
comme un être difforme. Ce rapport aux gens va être
brillamment contrebalancé par Dea qui, étant aveugle,
va aimer Gwynplaine pour ce qu’il est réellement car
elle n’a que faire de ce à quoi il ressemble.
Ainsi, s’il est intéressant de revenir sur ce métrage
pour introduire le dossier lié aux films Universal, c’est
en partie grâce à ce ton et son travail artistique qui
va grandement impacter la suite des productions du
studio, malgré un accueil critique très peu favorable à
l’époque. Si Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson ont
puisé dans cette œuvre pour créer le personnage culte
du « Joker », dans le même studio James Whale, tout
comme Tod Browning, reprendront grand nombre des
codes esthétiques introduits par Leni ici, dans « Dracula
» ou « Frankenstein » par exemple. Cela traduit bien
l’importance de « trésor de l’expressionnisme muet
allemand », comme l’appelait Roger Ebert.
Élie Bartin
65
Dracula, un nom qui fait frissonner mais aussi un nom qui nous amène son lot
d’images en tête et force est de constater que la représentation la plus répandue
du plus grand de tous les vampires est issue de ce film réalisé par Tod Browning
pour le compte des studios Universal. À l’heure où ceux-ci enchaînent leurs films
de monstres, ils décident de s’emparer de l’histoire du mythique comte, telle que
racontée par Bram Stoker à la fin du 19ème siècle, neuf ans après la première
adaptation officieuse par F.W. Murnau avec son très célèbre « Nosferatu ».
On va donc voir Renfield se rendre au château des Carpates pour rencontrer celui
qu’il ignore être un vampire et finaliser des transactions immobilières. Il va se
faire hypnotiser et au comte de se rendre en Angleterre où il ne va pas tarder à
entreprendre de créer de nouveaux semblables, notamment de jeunes filles qu’il
destine à faire devenir ses épouses.
Là où tous les films précédents mettent en avant des créatures aussi monstrueuses
que victimes de la société qui les entoure, Browning va se détacher de la nouvelle
et de ce carcan pour iconiser Dracula, ici interprété par l’excellent Bela Lugosi. Ce
dernier est mis en valeur pendant l’intégralité du métrage, le cinéaste n’hésitant pas
à le filmer en contre-plongée ou à jouer d’effets de lumière sur ses yeux afin de lui
donner un regard fort, menaçant. Il faut à cet égard mentionner le très bon travail de
Karl Freund, directeur de la photographie, qui rend l’œuvre magnifique et qui, paraitil,
a géré une grande partie de la réalisation.
La mise en scène est donc d’une grande intelligence, que ce soit pour la mise en
valeur du personnage comme suscité que pour des éléments plus anodins comme la
gestion de ses transformations entre chauve-souris et forme humaine ou ses réveils
une fois la nuit tombée. Le réalisateur s’amuse à ne pas couper, à simplement décaler
sa caméra vers une fenêtre nous faisant comprendre qu’il est l’heure pour finalement
revenir vers Dracula debout et en pleine forme, prêt à aller se nourrir. Les effets
spéciaux de certaines de ces scènes ont certes pris un coup de vieux et semblent
assez ridicules mais un certain charme opère et l’on n’y prête que peu attention.
L’essentiel est que Dracula n’est alors plus un monstre à proprement parler mais
le héros de l’histoire que l’on va suivre tout du long et qui par son air de dandy
mystérieux nous fascine. Lugosi est habité par ce rôle, qu’il tenait déjà au théâtre
avant, et on le voit prendre du plaisir dans sa partition d’aristocrate assoiffé de sang
et prêt à toutes les manipulations pour obtenir ce qu’il veut. On peut tout de même
regretter l’absence totale de musique, à l’exception du générique d’introduction
et d’une séquence à l’opéra (il est ici question de la version de base, une bande
originale complète a été composée plus tard par Phillip Glass pour une reprise du
film), qui pourrait agrémenter certains segments qui paraissent un tantinet longs et
vides. La fin est également assez en-deçà du reste de l’œuvre, trop rushée et un peu
ingrate vis-à-vis du personnage mythifié pendant une heure.
Cela dit, ce film, jouissant de décors grandioses avec un air gothique marqué
et une réalisation les sublimant tout autant que celui qui les hante, procure un
certain plaisir à la (re)découverte, nous rappelant l’origine d’une vision désormais
totalement intégrée dans l’imaginaire collectif du vampire (et ce n’est pas Netflix qui
va dire le contraire avec leur série sortie en ce début d’année !). Tout en s’éloignant
de la formule empathique, notamment employée avec brio pour « Frankenstein »,
monstre rival du comte si l’on veut, Browning crée un mythe, une icône culturelle à
jamais gravée dans l’histoire.
Elie Bartin
66
DRACULA (1931)
67
68
FRANKENSTEIN (1931)
Si l’on ne devait retenir qu’un seul film de la série
des monstres Universal, « Frankenstein » serait très
probablement l’heureux élu tant il catalyse toute
l’essence du projet et dégage, en moins d’une heure
et quart, une puissance phénoménale. À peine six
mois après le « Dracula » de Browning, axé autour de
la mythification du personnage et de la performance
virevoltante de Bela Lugosi, James Whale est venu
percuter le public avec ce qui peut être considéré
comme son chef d’œuvre, une fable quasi-parfaite,
mélangeant poésie et macabre, aux émotions fortes.
L’histoire, qu’on ne présente même plus vraiment, est
celle du scientifique Henry Frankenstein qui, voulant
créer la vie, va construire un corps à partir de cadavres
mais le cerveau qu’il va implanter à sa création sera
celui d’un assassin.
Dès le départ, un cadre assez malsain est installé : un
personnage nommé « La Créature » sans acteur attitré
au générique, une sépulture est violée, un cerveau
volé et la vanité de l’homme est mise au grand jour.
Ce dernier, se prenant pour un démiurge, essaie de
repousser les limites de la science et de la nature en
créant un être complètement artificiel.
Whale a parfaitement compris la nouvelle de Mary
Shelley et le cinéaste va réussir à créer une ambiance
ambiguë où le questionnement du spectateur est
constamment mis à rude épreuve. Si la créature effraie
au premier abord par son apparence, on apprend à
la découvrir au fil du métrage et on se rend compte
que l’on est plus face à un pantin déboussolé et vide,
n’ayant jamais eu pour but de vivre et qui, ce faisant, va
tenter d’imiter ceux qu’il rencontre pour se rapprocher
de l’humanité. De leur côté, les humains sont montrés
comme avides de pouvoir et de reconnaissance, arriérés
car arrêtés par leurs a priori et face à la monstruosité,
apparente seulement, ils répondent par la cruauté.
Le spectateur, va alors commencer à développer une
certaine empathie pour la créature, victime d’une vie
qu’elle n’aurait pas du connaître mais que les autres lui
font payer.
À partir de là, le cinéaste se permet de jouer avec le
ton et d’offrir des ruptures brutales, choquantes pour
l’audience à l’image de la séquence avec la petite fille,
seule personne à ne pas avoir peur du « monstre »,
qui, partant d’une poésie et d’une grande tendresse,
termine dans une horreur glaçante. Pour autant, la
construction narrative et la mise en scène, combinées
au jeu brillant de Boris Karloff, nous font pardonner
toutes les exactions commises par ce géant sans âme.
La fin du film va également être forte à ce titre avec
l’opposition créateur contre créature qui se conclut de
manière dévastatrice avec le spectateur qui contemple
l’horreur de l’humain.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que ce film
dialogue d’une certaine manière avec le « Metropolis
» de Fritz Lang, sorti quatre ans plus tôt, dans sa
vision de l’excès de progrès scientifique, cette volonté
démiurgique de l’homme qui lui fait perdre son
humanité, qui amène finalement plus de danger
qu’autre chose. Certes l’angle pris est différent avec ici
Whale qui tente d’humaniser et de nous émouvoir avec
le monstre de Karloff mais le fond reste assez identique
et voir deux films de ce temps-là déjà évoquer ce
qui est aujourd’hui l’un des thèmes principaux de la
science-fiction avec l’intelligence artificielle, reste aussi
surprenant que plaisant. Puis, à l’instar de l’autre œuvre
suscitée, Whale épouse un certain expressionnisme et
offre une œuvre époustouflante sur le plan technique.
Les décors sont sublimes et sublimés par la mise en
scène virtuose du réalisateur et les effets visuels sont
très réussis. Le maquillage et costume de la créature
sont parfaits et surtout la séquence de la naissance de
celle-ci jouit d’artifices très solides pour l’époque, qui
ont clairement mieux vieilli que les chauves-souris de «
Dracula ».
Ainsi, avec « Frankenstein », James Whale réussit un
film somme dans un registre particulier. Premier gros
carton pour Universal dans sa franchise, il apporte une
légitimité au genre et ouvre le public sur un nouveau
cinéma, mêlant divertissement d’épouvante et critique,
poésie tragique et horreur glaçante. Il est important de
noter que ce film, au même titre que celui de Browning
précité, crée une nouvelle figure culturelle avec Boris
Karloff, comme Lugosi pour le comte, avec un parti pris
pourtant bien différent.
Là où Browning crée un personnage mythologique
avec Dracula, Whale montre une création déboussolée
et attachante dans « Frankenstein ». Peut-être moins
prétentieux mais tout aussi ambitieux que les métrages
précédents du studio, celui-ci reste un fier étendard
d’un mouvement, un jalon du cinéma d’horreur
ayant grandement conditionné une partie de ce qui
suit et ouvert les portes à Whale pour de nouvelles
expérimentations comme « La maison de la mort » ou «
L’homme invisible ».
Elie Bartin
69
Un an après son renversant « Frankenstein », James Whale revient aux commandes d’un nouveau film de monstres pour Universal avec « La
maison de la mort », huis-clos mi-horrifique mi-comique moins ambitieux mais d’une grande modernité, tout en s’inscrivant toujours dans son
style fortement inspiré de l’expressionnisme.
En effet, il réunit ici le couple Waverton, Roger Penderel (Melvyn Douglas), un faux dandy, Sir William Porterhouse (Charles Laughton), une
fausse duchesse prénommée Gladys (Lillian Bond) dans la maison isolée des Femm, habitée par la fratrie composée de Horace, Rebecca et
Saul, leur vieux père mais aussi le majordome Morgan (Boris Karloff). Cette réunion est forcée par une rude tempête qui contraint les différents
invités de passer la nuit dans cette bâtisse qui n’a rien de rassurant, où le danger semble pouvoir survenir de partout et de tout le monde.
Si ce genre est aujourd’hui bien connu, c’était loin d’être le cas quand James Whale a sorti ce petit ovni filmique marqué par un ton improbable,
jonglant continuellement entre effroi et comédie, à la limite du grotesque par instants. On a alors des répliques qui fusent dans tous les sens
avec des personnages qui tuent le long temps qu’ils ont à passer ensemble en se chamaillant. Même les hôtes participent à ce jeu de répartie,
ce qui rend chaque personnage attachant à sa manière avec leurs caractères respectifs se développant au gré des lignes de dialogue qui
s’enchaînent. Les interactions sont donc au cœur du film avec un couple qui se forme pendant qu’un autre se renforce, la vieille sourde Rebecca
qui vient effrayer l’épouse Waverton tandis qu’Horace fait preuve de lâcheté à l’égard du mari et ainsi de suite. Le but étant bien entendu de
voir ce qui se passe une fois l’horreur arrivant, ici sous la forme d’un Boris Karloff alcoolique et brutal, l’acteur livrant une excellente prestation,
accompagné par un pyromane manipulateur en la personne de Saul Femm et l’on voit comment nos protagonistes résistent à ces deux «
monstres ».
À côté de ça, James Whale ne lésine pas sur les effets pour marquer l’aspect horrifique de son film, avec des décors grandement teintés
de l’expressionnisme, dans la veine de son précédent film pour le studio, à l’image d’une maison dont l’intérieur se révèle immense en
comparaison à ce qu’elle laisse présager de l’extérieur. Il joue également sur les ombres et s’amuse à rendre Morgan effrayant et gigantesqu,
alors qu’en fond un bruit de tempête ne cesse pendant l’intégralité du métrage, ce qui crée une véritable ambiance anxiogène. Il va même
faire quelques tentatives avec le montage en se permettant une séquence un peu psyché, un peu dissonante et presque mal venue mais dont
l’ambition artistique fait plaisir à voir.
Si la fin ressemble plus à un grand n’importe quoi qu’autre chose avec une chute qui intervient de manière aussi impromptue qu’un cheveu
sur la soupe, le cinéaste parvient dans l’ensemble à offrir un spectacle riche et jamais ennuyeux qui, un an après la merveille qu’avait été «
Frankenstein », vient démontrer son immense talent de réalisateur dans le mélange de tons ainsi que la versatilité des productions Universal,
capables d’offrir des œuvres d’une grande profondeur comme de simples divertissements de très bonne facture.
Élie Bartin
70
LA MAISON DE LA MORT (1932)
71
72
L’HOMME INVISIBLE (1933)
Alors que son remake sort en cette fin février, il est
nécessaire de se pencher sur le cas de « L’homme
invisible », réalisé par James Whale en 1933, film assez
particulier au sein de la série Universal Monsters mais
qui s’inscrit dans la lignée des meilleurs et des plus
intéressants à revoir. On est donc aux côtés de Jack
Griffin, scientifique complètement absorbé par son
travail, qui a trouvé la formule pour devenir invisible.
Alors qu’il fait tout pour retrouver sa forme originelle,
le village où il s’est réfugié prend peur tandis que lui,
découvrant l’étendue des possibilités offerte par son
pouvoir, commence à avoir la folie des grandeurs.
James Whale est un habitué de la maison et il a
déjà marqué les esprits avec son « Frankenstein »,
déjà évoqué, notamment dans sa gestion des tons
et des émotions. Là où avec la créature, il optait pour
une certaine poésie sombre, il décide là de changer
totalement de recette.
Le film commence de manière étrange, avec la
découverte de cet individu ressemblant à une momie,
et tourne vite à la comédie quand Jack use de sa
nouvelle capacité pour se jouer de la tenante de
l’auberge. Le ton va alors être assez léger, avec même
quelques petits moments d’émotions à la découverte
que le scientifique était fiancé avant l’expérience, et
on s’attache à cet homme cherchant à retrouver sa
peau caractérisant son humanité. Pourtant, et c’est là le
tour de force opéré par Whale, plutôt que de la jouer
sentimentale comme il l’avait fait dans son adaptation
de Mary Shelley, le cinéaste embrasse complètement la
folie, contrairement au texte de H.G. Wells, et marque
un changement de ton brutal quand Jack décide de
conquérir le monde et de tuer sans aucun état d’âme.
Cette radicalité, teintée d’un humour bien cynique,
est très perturbante pour le spectateur se retrouvant
comme trahi par celui qu’il suit depuis le début.
À côté de cette prouesse narrative, la mise en scène
n’est pas en reste. Si Whale ne dispose pas d’énormes
décors comme dans ses autres films pour le studio,
il jouit d’effets spéciaux très impressionnants pour
l’époque, avec lesquels il s’amuse pour créer autant
de comédie que d’effroi. Par ailleurs, il a grandement
conscience de toutes les possibilités offertes d’un point
de vue cinématographique avec un tel concept et il s’en
donne donc à cœur joie pour régaler l’audience. À ce
titre, le climax est magnifique en termes de réalisation
et la conclusion du métrage vient à nouveau nous
perturber en rappelant que bien qu’on ne le voyait pas,
il y avait derrière cette folie invisible un jeune homme
passionné.
Ce mélange d’écriture originale et de technique
innovante donne un fort côté moderne à cette œuvre
qui a apporté un vent de fraîcheur non négligeable à
l’industrie à l’époque. S’il a été un succès en son temps
par son aspect novateur, « L’homme invisible » demeure
encore aujourd’hui un petit bijou de film d’horreur
fantastique et l’un des plus beaux représentants de
l’ère Universal Monsters. Si Whale a préféré jouer
la carte de la radicalité, au risque de déranger voire
perdre les spectateurs, il est intéressant de voir ce que
cette histoire, riche en possibilités, peut donner en
d’autres mains et à une époque où le cinéma d’horreur
de grands studios ne serait pas forcément contre un
nouveau vent de fraîcheur.
Elie Bartin
73
La figure du lycanthrope ne pouvait qu’aboutir dans le monde des Monstres
d’Universal. Aussi culte que celle du vampire ou de la créature de Frankenstein,
cette créature a tout à fait sa place dans un film propre qui, s’il est moins mis
en avant que le Dracula de Browning ou les Frankenstein de Whale, mérite tout
autant d’égards par sa manière de s’inscrire également dans une forme d’horreur
plus humaniste.
Durant uniquement 66 minutes, le film de Georges Waggner gagne en efficacité
ce qu’il perd en durée pour brosser un peu plus certains personnages ainsi que
quelques relations qui participent pourtant à la mécanique narrative. Ainsi, le
portrait qui se dresse du malchanceux Lawrence Talbot aurait pu profiter d’être
plus approfondi dans son lien avec son père, marqué par la mort d’un autre fils
qu’il préfère largement au survivant. Il y a néanmoins de quoi comprendre cette
tension qui tend à la destinée peu heureuse de Talbot.
Tout est ainsi écrit pour que notre protagoniste principal soit vu comme un
malheureux qui, de malchance en malchance, se retrouve confronté face à sa
propre monstruosité qu’il ne peut plus contrôler, une forme de violence qui le
consume de l’intérieur. Lou Chaney Jr amène assez de nuances dans son jeu pour
pouvoir ressentir de l’empathie face à ce destin tragique, que ce soit en tant que
personnage malheureux ou monstre grandiose, porté par un maquillage qui ne
prend pas une ride. La mise en scène joue en ce sens de son aspect gothique et de
sa nature brumeuse pour perpétuer son aspect irréel, permettant au fantastique
d’embraser les douleurs intimes et de sublimer ses instants d’horreur avec une
beauté qui, comme les chefs d’œuvre d’horreur que sont ces Universal Monsters,
fonctionnent toujours autant qu’à leur première découverte.
Alors, si l’on aime à citer certains titres plus connus (et par certains aspects plus
aboutis), n’oublions pas de donner à Georges Waggner la reconnaissance d’avoir
su porter à l’écran la vision du loup-garou avec une justesse qui sera rarement
égalée, notamment dans l’hommage apporté par Joe Johnston des décennies
après…
Liam Debruel
LE LOUP-GAROU
(1941)
74
Le box-office en aura connu, des déceptions financières injustes au vu des propositions
cinématographiques qui, si elles ne sont pas totalement abouties, constituent au
minimum des pépites qui poussent au revisionnage. C’est exactement dans ce genre
de catégorie que rentre ce “Wolfman”, au tournage aussi chaotique que ses recettes.
Souffrant d’une préproduction horrible et de tensions permanentes avec les studios
(au point que Johnston sortira nettement plus ravi de son expérience sur « Captain
America »), “Wolfman” partait déjà avec une étiquette d’œuvre maudite, appuyée
par divers montages circulant selon les versions. En ce sens, il est préférable de
s’orienter vers le Director’s cut tant celui-ci profite de ses ajouts pour amener au
mieux une atmosphère mélancolique. Le film joue en effet bien plus sur le décès du
frère de Lawrence Talbot, obligé de revenir dans un lieu qu’il voulait oublier à cause
de cette perte tragique. La dualité entre Benicio del Toro (sans aucun doute une de
ses meilleures prestations) et Anthony Hopkins (par instants un peu trop dans le
surjeu) sied à cette confrontation familiale qui ne fait qu’exacerber la transformation
lycanthropique de notre personnage principal.
Johnston confère du cachet à son œuvre et parvient à maîtriser aussi bien ses
instants les plus gothiques que ceux plus amusants, notamment lors d’une scène
d’attaque graphiquement réjouissante. On sent ainsi son implication, ainsi que celle
de la plupart de son casting et des responsables des effets spéciaux, pour se tirer
au mieux des contraintes du studio (ayant placé quand même plus de 150 millions
de dollars dans le projet) et pour offrir un bel hommage aux films de monstres
Universal.
THE WOLFMAN
(2010)
Pourtant, le réalisateur de Rockeeter et de Jurassic Park 3 (que l’on ne va pas
mentionner plus pour le bien de chacun) parvient à aller plus loin qu’un simple
clin d’œil de fan et livre une œuvre aussi tragique que l’originale et qui, si elle
comporte quelques petits soucis plus dûs à ses conditions de création, mérite
d’être largement réévaluée par sa beauté formelle et la façon dont elle parvient à
ressusciter le lycanthrope dans ses dimensions les plus dramatiques. Bref, de quoi
faire la file dans la liste des longs-métrages aussi décevants financièrement que
réussis artistiquement.
Liam Debruel
75
LA MOMIE (2017)
76
Il fallait bien s’y attendre à un moment ou un autre :
Universal se devait de ressusciter ses monstres dans
un univers partagé. En effet, si cela a bien fonctionné
avec Marvel, pourquoi cela n’irait pas avec des créatures
aussi mythiques ? Voici donc qu’arrive le Dark Universe,
avec logo et photo de casting à l’appui. Pourtant, si l’on
retrouve bien le casting de cette “Momie”, on a déjà
oublié que Johnny Depp devait incarner l’Homme
Invisible et Javier Bardem la créature de Frankenstein,
la faute au flop monumental du film d’Alex Kurtzman.
Mais si le “Wolfman” de Joe Johnston ne méritait pas
son naufrage pécunier, ce n’est aucunement le cas pour
cette “Momie” 2017, sans doute parmi le pire de ce
que les blockbusters ont pu nous offrir dans les années
2010.
La chose qui marquait le plus dans la découverte
des monstres originaux d’Universal était leur cœur
humaniste, ce soin apporté pour dresser en figures
tragiques ces créatures qui y gagnaient en empathie.
Cela tombe bien, cette “Momie” n’en a rien à battre
malgré l’excellent choix de Sofia Boutella dans le rôle
titre. Elle constitue d’ailleurs le seul accomplissement
du film, le seul point appréciable d’une catastrophe
tellement mécanique dans son écriture et sa mise
en scène qu’on croirait les deux faites en mode
automatique par une machine qui se base sur ce
qu’elle croit que les spectateurs apprécient. Même le
rôle d’action man d’un Tom Cruise pourtant habitué
à cela dénote avec un goût amer, passant à côté des
promesses de film d’aventure auxquelles cela aurait
pu conduire (à la manière de la saga “La Momie” avec
Brendan Fraser).
L’humour y est oubliable tout comme les personnages,
les effets étaient déjà datés de plusieurs années à
sa sortie et les séquences d’action oublient une fois
sur deux d’être lisibles. Quand le film veut virer à
l’horrifique, il se vautre dans le pire de ce qui était
possible dans le PG13. Dans ses meilleurs moments,
la “Momie” est un pâle remake du “Loup-Garou de
Londres” mais semblant plus daté que celui-ci. Quant
à ses pires instants, ils sont d’une telle médiocrité que
l’on attend qu’ils remplacent la peine de mort dans
certains états américains. Si le film était au moins
divertissant dans son ratage intégral, à la manière
d’un “Cinéman” ou “The Room”, on pourrait tourner la
page plus rapidement. Dommage pour nous : ce longmétrage
n’est qu’une énorme purge désagréable dans
tous ses aspects. C’est d’ailleurs sa seule réussite (avec
le choix de Sofia Boutella) : ce machin rate tellement
tout ce qu’il veut faire qu’il constitue un triomphe de
médiocrité, prenant en permanence la pire décision à
tout instant.
Il n’est dès lors guère étonnant d’avoir choisi la
figure de la “Momie” pour tenter d’inaugurer ce
Dark Universe tant le film d’Alex Kurtzman est sorti
directement putride sur les grands écrans. On espère
sincèrement voir l’affiche à côté de la définition de
Désastre au dictionnaire tant ce mémo de producteurs
mécanisés passe totalement à côté de tout. Espérons
que les changements opérés par Leigh Whannell sur
l’Homme invisible seront plus aboutis mais on a assez
confiance : jamais il ne pourra faire pire que cette
débâcle inutile et foireuse.
Liam Debruel
77
Steven Moffat et Mark Gatiss. Pour les amateurs du
paysage télévisuel britannique actuel, ces deux noms
sonnent comme une promesse. Celle que tout projet
affilié à leur nom risque d’être un bijou d’écriture et de
narration, avec des personnages hauts en couleurs castés
à merveille. Le Moff, on ne le présente plus. Tant pour
son excellente sitcom injustement oubliée « Coupling »
(en français « Six Sexy »), que pour son exploit de relancer
«Doctor Who» et de lui offrir une mouture moderne fort
appréciée - quand il ne fait pas des prouesses sur grand
écran (le « Tintin » de Steven Spielberg, on le lui doit
en partie) -, le showrunner et scénariste s’est imposé
comme une figure majeure au Royaume-Uni. Gatiss
s’est rapidement joint à la fête, signant quelques scripts
ainsi que le très bon « An Aventure In Space And Time »,
et le duo d’incorrigibles fut lancé.
Le pinacle de leur collaboration reste « Sherlock ». Avec
un format court (trois épisodes par saison), et un duo
d’acteurs (Martin Freeman, Benedict Cumberbatch)
en phase avec leurs personnages, cette réadaptation
moderne des frasques du célèbre détective d’Arthur
Conan Doyle est un coup de génie. Apprendre qu’ils
comptent s’aventurer dans une relecture du mythe de
Dracula, ça nous laisse rêveur. Sortie sur Netflix ce 1er
janvier, la mini-série propose trois épisodes, chacun
dans un ton différent, proposant en premier lieu une
réhabilitation des codes de Bram Stoker avant de les
détourner et tenter de les transcender.
« Les Règles De La Bête » conte la triste mésaventure
de Jonathan Harker, envoyé en Transylvanie pour aider
le comte Dracula à acquérir un bien immobilier en
Angleterre. Il va y devenir la victime du Vampire, s’affaiblir
pendant que ce dernier se nourrit de sa jeunesse, et
absorbe ses sentiments, son amour pour sa fiancée
Mina que la Bête va ensuite tenter de retrouver. Un récit
que l’on connaît donc, si l’on s’est intéressé au roman de
Bram Stoker, ou que l’on a vu la fabuleuse adaptation
de Francis Ford Coppola, qui est ici raconté après coup,
par un Harker affaibli, et qui se voit interrogé par deux
nonnes. L’épisode reste une mise en bouche savante, qui
nous plonge dans une zone de confort qui s’avère bien
déroutante dès lors que la fiction commence à abattre
ses réelles cartes. Ce qui pouvait sembler fainéant de la
part de deux auteurs se contentant d’adapter de manière
trop pauvre une œuvre déjà poncée se transforme en
pari original : en une heure, ils résument les grandes
lignes du mythe, nous le recontextualisent, et entament
leur travail de détournement dans une dernière demieheure
qui laisse pantois quant à la suite.
C’est malheureusement cette même suite, « Vaisseau
Sanguin », qui plombe cette ambiance classieuse. Cette
fois-ci à bord d’une embarcation maritime à destination
de l’Angleterre, Dracula se retrouve piégé par sa nemesis,
le tout aussi célèbre Van Helsing. Sur le papier, ce que
raconte l’épisode est ingénieux : le Vampire réunit
différents représentants sociétaux, partant du principe
qu’en les « dégustant », il acquiert leurs origines, leurs
manières qui lui permettront de s’intégrer à la société
moderne et leur culture – on nous donne d’ailleurs une
explication quant à sa frayeur du divin, due uniquement
au fait qu’il ait « assimilé » des bigots toute son existence,
et avec eux leur foi -. Le menu est présenté comme une
accession initiatique, comme une mise à jour que le
Comte effectue régulièrement pour se réhabiliter aux
moeurs de chaque période. Mais dans le rendu, et par
la présence de Van Helsing qui doit convaincre ses
partenaires de traversée qu’ils sont aux griffes avec une
créature démoniaque, le périple se transforme en huis
clos, cluedo même, qui peine à maintenir son spectateur
sous tension une heure trente durant. On n’est jamais
réellement emporté dans cette danse survivaliste, où
les éléments s’affrontent et se déchaînent pourtant avec
une certaine passion.
Dans “Sombre Boussole”, on aborde la dernière
thématique vampirique, la plus iconique de toute : la
solitude. L’éternité du comte, pourtant proposée à ses
sbires comme un choix astucieux, est une malédiction,
une condamnation à passer cette même éternité
seul. Noyé dans le romantisme, ce dernier cherche
désespérément sa compagne, celle qui accepterait cette
même condition de manière désintéressée, pour vivre
un amour pur, inconditionnel. L’épisode joue avec ce
principe, nous montrant au final un personnage bien
moins bestial qu’il n’y paraît, et avant tout dominé
par ses sentiments, ses faiblesses. Après une énième
désillusion quant au monde alentour qui ne le connaît
ni ne le comprend, le monstre réalise la futilité d’un tel
don d’immortalité, et embrasse une destinée morbide
dans un final apocalyptique. Une fois encore, l’épisode
a du mal à se tenir et peine à convaincre dans ses choix
d’ambiance. Une déception attristante tant le scénario
brille de moments forts, d’idées réussies, et d’une
volonté de dépoussiérer le mythe à tout prix qui est la
clé vers une œuvre unique mais aussi la contrainte qui
l’enferme dans son postulat.
Revisiter, c’est le mot d’ordre, qui construit les fulgurances
et sacrifices de cette mini-série. Nombreuses sont les
78
DRACULA (2020)
79
80
fictions ayant tenté de s’approprier le mythe, de jouer
avec ses codes, pour le meilleur et pour le pire mais
rares sont celles qui parviennent à les détourner avec
des ressorts originaux. Sur le papier, « Dracula » est de
celles-ci. Ici, la meilleure idée vient de l’assimilation des
croyances et coutumes selon les cultures diverses des
victimes de la Bête. Insinuer que les codes inhérents aux
vampires et à la manière de les combattre ne sont pas
réels mais crus par Dracula lui-même car il a consommé
des gens qui se sont racontées sa légende d’âge en
âge, voilà un axe qui permet beaucoup de libertés pour
rendre certains de ses codes vains et ainsi mieux les
détourner. Inondé de lumière, hurlant à terre et pensant
mourir, le comte réalise qu’il ne ressent aucune douleur,
et que cette peur primaire n’est que le fruit du mythe que
les peuples ont imaginé autour de lui, pas de ce qu’il est
réellement. Vivant dans un mensonge, remettant tout
en question, ce sont ses propres pulsions, sa propre
immortalité qui est mise en cause, et ne lui semble plus
un si bel atout. En cela, sa relation conflictuelle avec Van
Helsing prend sens, tant dans la rivalité qui les anime
que dans la passion qui les unit.
C’est d’ailleurs là le point culminant du travail des deux
auteurs, dont on reconnaît alors la patte : la relation
entre Van Helsing et Dracula. En faisant de la nemesis du
Comte une femme, ils offrent une relecture complète,
qui parvient à jouer avec les surprises. Alors présentée
comme une nonne au caractère impétueux dans le
premier épisode, on est loin de se douter qu’il s’agit
là du célèbre chasseur de primes, que l’on a toujours
identifié sous des traits masculins. Et au vu de la clarté
d’écriture et du rôle sur mesure offert à Dolly Wells, on
en vient à regretter que les deux zouaves aient lâché la
barque « Doctor Who » avant l’ère Jodie Whittaker, qu’ils
auraient réussi par leur plume à magnifier. Ici, l’actrice
s’empare du rôle, est possédée, et nous fait oublier les
anciennes moutures pourtant très marquantes et loin
d’être honteuses. On adore immédiatement cette femme
forte, déterminée, qui lutte contre l’innommable et des
forces bien plus puissantes qu’elle avec une poigne
de fer, quitte à en voler totalement la vedette à Claes
Bang, qui s’il campe un Comte Dracula charismatique
et mystérieux, dont les traits physiques ne sont pas sans
rappeler ceux de Bela Lugosi, manque cruellement de
contenance. Dommage tant leur relation est idyllique,
teintée de fascination morbide pour celle qui va tout faire
pour retrouver le Vampire à travers les âges, transmettre
cette obsession à sa descendance, et sacrifier sa propre
vie pour causer la perte de son ennemi adoré. Amants
maudits, adoration macabre, on retrouve dans cet antre
du malsain une forme de pureté, qui fascine autant
qu’elle débecte.
Entachée par une réalisation loin d’être à la hauteur
d’un tel récit, « Dracula » reste malgré tout du bel-œuvre.
Nombre d’éléments auraient gagné à être développés
tandis que d’autres sont ternis par des longueurs
qui nous perdent là où l’on aurait pu être fasciné tout
du long. On salue malgré tout ces deux adeptes des
prises de risque, qui montre qu’ils en ont encore dans
la plume. On les espère mieux accompagnés sur leurs
prochains ébats.
Thierry de Pinsun
81