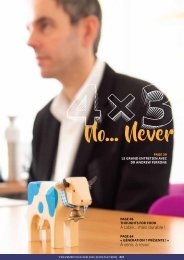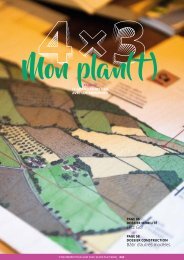10_4X3_AVR20_CS_BATBD (1)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Doit-on s’inquiéter pour les
ressources disponibles ?
2/3 de notre eau potable
proviennent du barrage de la
Haute Sûre, dont la SEBES est
gestionnaire. Les 2/3 du bassin
versant du lac (428 km²) se
trouvent en Belgique. Il faut de
gros investissements pour assurer
une eau de bonne qualité à partir
d’une eau de surface. Il est moins
onéreux d’exploiter les eaux de
source. Or actuellement, rien
que dans le bassin versant de la
Syre, plus de 5000 m 3 /jour d’eau
de source sont indisponibles,
car non conformes aux normes
de potabilité, pour la majeure
partie en raison des nitrates
ou/et des pesticides. C’est une
grande perte si on sait que la
fourniture journalière moyenne
de SEBES a été de 55.000
m 3 /jour de 2010 à 2016.
Et puis il y a le changement
climatique ! Au Luxembourg,
depuis que la température est
mesurée, 16 des 17 années les
plus chaudes ont eu lieu au 21 e
siècle. Les hivers auront plus de
pluie et moins de neige, les étés
seront plus secs. II y aura plus
souvent des événements de forte
averse. Ces facteurs influenceront
la recharge de la nappe. »
En fait, les solutions
durables sont déjà
dans la nature ?
« La nature, avec ses fonctions
écosystémiques, dispose d’un
potentiel énorme pour épurer
l’eau et améliorer la qualité de
l’eau potable. Avec des zones de
protection et des mesures très
ciblées, aux effets suivis, des
améliorations sont constatées,
parce que les micro-organismes
présents dans le sol peuvent agir.
Même chose pour les eaux
de surface. On doit laisser
suffisamment d’espace au
cours d’eau, supprimer les
aménagements rigides, remettre
à ciel ouvert des tronçons busés,
relever et élargir le lit mineur,
redynamiser des zones inondables,
restaurer des zones alluviales.
Cela active la capacité d’autoépuration
des cours d’eau.
Une mesure clé est la renaturation
des berges. La ripisylve - la
végétation bordant les milieux
aquatiques - protège le cours d’eau,
fournit de l’ombre, garde donc
les températures plus fraiches.
Les racines fixent les nutriments
présents dans l’eau. Les feuilles sont
à la base de la chaîne alimentaire
du milieu aquatique. Les arbres en
soi sont des régulateurs du climat.
RESSOURCÉ PAR ALAIN DUCAT
DES CHIFFRES
DANS LE VERT
Photo Natur&Emwelt
Le Luxembourg choisit des
chemins politiques verts, en se
donnant des moyens d’avancer
(photo natur&ëmwelt)
La loi budgétaire 2020 prévoit des
investissements environnementaux
pour 502 millions d’euros. Trois fonds
dédiés se détachent : la gestion de
l’eau reçoit 17 % du total des dépenses
environnementales, le fonds climat
et énergie 13 % et la « protection de
l’environnement » 1 %. Ce dernier a
en fait plus de 20 ans mais, à l’origine,
il englobait l’ensemble des actions,
un peu tous azimuts. Désormais,
avec des fonds dédiés, le ciblage
des actions gagne du terrain.
Le ministère de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable
alimente le fonds pour la gestion de l'eau
(97 millions), qui reçoit aussi 9 millions
(produit de la taxe prélèvement
d'eau et rejet des eaux usées).
Le fonds climat et énergie reçoit une
contribution prélevée sur les ventes
de carburants (88,5 millions), 40 % du
produit de la taxe sur les véhicules
automoteurs (27,2 millions) ou encore
le produit de la vente de droits
d'émissions (estimé à 18 millions).
Le fonds pour la protection de
l'environnement (55 millions) reçoit
aussi 4 millions via le nouveau
système numérique d'évaluation et
de compensation en éco-points.
A.D.
› La suite est à lire sur INFOGREEN.LU
DOSSIER NATURE HUMAINE
4×3 – NUMÉRO 10 – TRIMESTRIEL – AVRIL 2020 15