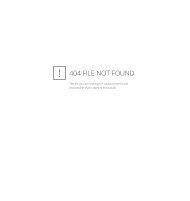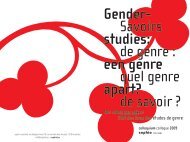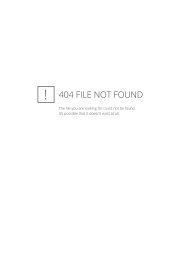Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dossier 10 dossier<br />
poursuite de l’égalité entre les femmes et<br />
les hommes qui est posée. En effet, la<br />
pertinence du savoir féministe ne se limite<br />
pas qu’à son apport épistémologique<br />
(en termes de déconstruction/reconstruction<br />
des savoirs au regard des rapports<br />
sexués): son enseignement participe de<br />
l’éducation au changement en formant<br />
des étudiant-es qui seront peut-être<br />
amené-es un jour à élaborer des politiques<br />
publiques. Dans ce sens, l’enjeu du réseau<br />
vise un public large en s’adressant aux<br />
“personnes engagées dans l’action politique,<br />
sociale ou culturelle intéressées par les objectifs<br />
de l’association” 14 .<br />
Le débat interne qui a mené à la formulation<br />
du projet <strong>Sophia</strong> s’est donc construit<br />
autour de militantes évoluant professionnellement<br />
dans le monde de la<br />
recherche et de l’éducation. Elles font le<br />
triple constat de la prétendue neutralité<br />
du savoir scientifique, de l’absence d’une<br />
lecture en termes de genre au sein des<br />
différentes disciplines et de la sous-représentation<br />
des filles/femmes dans l’enseignement<br />
et dans l’étude de certaines<br />
disciplines 15 . Elles dénoncent cette situation<br />
de discrimination des femmes dans<br />
les universités, à la fois en tant que productrices,<br />
destinatrices et objets de savoir,<br />
ainsi que l’absence de financement et de<br />
reconnaissance de ces activités de recherche<br />
et de formation par l’université, et le<br />
retard en la matière par rapport à d’autres<br />
pays européens. Pour remédier à ce constat,<br />
elles proposent de soutenir l’institutionnalisation<br />
académique du féminisme,<br />
par une action collective de coordination<br />
entre différents acteurs militants<br />
et institutionnels, du Nord et du Sud du<br />
pays.<br />
L’entrée de <strong>Sophia</strong> dans l’espace public<br />
s’est faite avec sa constitution en a.s.b.l.<br />
et le développement de ses activités de<br />
diffusion, d’information et de formation.<br />
Notons par ailleurs que les discussions<br />
internes ayant mené à sa constitution<br />
prennent déjà naissance dans un événement<br />
public, le colloque du GRIF. La<br />
constitution de <strong>Sophia</strong> en enjeu de débat<br />
politique, c’est-à-dire son inscription à<br />
l’agenda politique de certain-e-s responsables<br />
politiques, se fait en parallèle au<br />
développement de la politique d’égalité<br />
des chances (aux niveaux communautaire,<br />
fédéral voire européen). En effet,<br />
dès le moment où la reconnaissance politique<br />
du rôle de <strong>Sophia</strong> dans la promotion<br />
de l’égalité est sollicitée ou que des<br />
demandes de subsides sont déposées<br />
auprès des institutions en charge de l’égalité<br />
des chances, le réseau devient une<br />
question politique appelant à une décision<br />
politique. Nous pourrions même ajouter<br />
qu’en tant que projet relevant du féminisme,<br />
questionnant les frontières entre<br />
le privé et le politique, <strong>Sophia</strong> est un enjeu<br />
politique, indépendamment des relations<br />
formelles avec les institutions.<br />
… et dans un contexte de<br />
développement du féminisme<br />
institutionnel et de la<br />
politique d’égalité des<br />
chances<br />
Des prémices à un “féminisme institutionnel”<br />
se repèrent, dans notre pays,<br />
dans les années 1970 avec la constitution<br />
de groupes de femmes au sein de certains<br />
partis politiques (CVP et PSC, dès 1973),<br />
la constitution de la Commission du travail<br />
des femmes et de la Commission consultative<br />
du statut de la Femme (en 1975).<br />
Notons que cette époque est celle de la<br />
première Conférence des Nations Unies<br />
sur les Femmes (Mexico, 1975), inaugurant<br />
la Décennie internationale de la<br />
Femme (1975-85), qui encourage l’action<br />
des Etats dans la promotion de l’égalité<br />
entre les hommes et les femmes,<br />
notamment par la mise sur pied d’institutions<br />
et de politiques publiques d’égalité<br />
des chances et par des mesures de<br />
lutte contre les discriminations de genre 16 .<br />
Cela donne lieu, à la veille des années<br />
sophia | n° <strong>40</strong> | 2004<br />
1980, à l’installation des Commissions<br />
pour l’égalité des chances des filles et des<br />
garçons dans l’enseignement en Communauté<br />
française et en Communauté<br />
flamande (1979-80).<br />
En 1985, Miet Smet devient secrétaire<br />
d’Etat à l’Environnement et à l’émancipation<br />
sociale, en charge de l’égalité des<br />
chances. La création, l’année suivante,<br />
du Conseil de l’émancipation lance véritablement<br />
le début du “féminisme d’<br />
Etat” en Belgique 17 . Devenue ministre<br />
de l’Emploi et du Travail en 1991, Miet<br />
Smet installe l’Unité de l’égalité des<br />
chances au sein de son ministère en 1992.<br />
Le Conseil de l’égalité des chances des<br />
femmes et des hommes remplace, en<br />
1993, le Conseil de l’émancipation 18 .<br />
Cette institutionnalisation politique du<br />
féminisme prendra forme progressivement,<br />
jusqu’à comprendre aujourd’hui<br />
“les Conseils consultatifs auprès du gouvernement<br />
fédéral (Conseil de l’égalité des<br />
chances entre hommes et femmes) et de certains<br />
des gouvernements fédérés comme la<br />
toute récente création d’un Institut de l’égalité<br />
des hommes et des femmes, l’existence<br />
d’un centre d’accueil et de soutien aux activités<br />
des organisations de femmes (Amazone),<br />
les administrations fédérales et fédérées de l’égalité<br />
des chances (Directions de l’égalité<br />
des chances ...) et enfin la ‘subsidiation’ des<br />
associations et des activités féministes par<br />
les divers niveaux de pouvoirs.” 19 . Cette<br />
dynamique sera d’ailleurs consacrée par<br />
la 4e Conférence Mondiale des Femmes<br />
(Beijing, 1995). Du côté des institutions<br />
européennes, tant le Parlement que la<br />
Commission et le Conseil de l’Union<br />
Européenne intègrent ce processus par<br />
l’intermédiaire de divers départements<br />
et dispositions législatives 20 . Comme<br />
annoncé, nous n’entrerons pas plus dans<br />
le détail de cette institutionnalisation de<br />
l’égalité des chances aux niveaux communautaire,<br />
fédéral, européen et international.