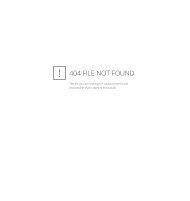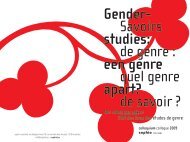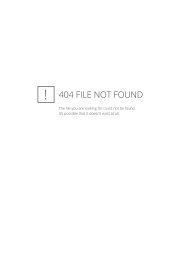Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
Nieuwsbrief 40 (pdf) - Sophia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dossier 16 dossier<br />
interviews<br />
sophia | n° <strong>40</strong> | 2004<br />
Etudes Féministes/Etudes de Genre 2004 en<br />
Communauté française: le passé, le présent, le futur.<br />
Introduction<br />
En 2000, les numéros 21/22, 23, 24, 25<br />
du bulletin de <strong>Sophia</strong>, ont publié les interviews<br />
des pionnières des études féministes/<br />
études de genre dans les différentes<br />
universités belges (également disponibles<br />
sur le site). Ces articles avaient pour objet<br />
un état des lieux des études féministes/<br />
études de genre. Aujourd’hui, dans le<br />
contexte du processus de Bologne et de<br />
modification fondamentale du paysage<br />
universitaire, nous voulons refaire un tour<br />
de table. En tant que réseau de coordination,<br />
<strong>Sophia</strong> a en effet pour mission<br />
de donner plus de visibilité aux liens interuniversitaires<br />
déjà tissés.<br />
Les études féministes/ études de genre<br />
ont-elles obtenu une place au sein de l’université<br />
? Et quelle place? Le processus de<br />
Bologne va-t-il avoir une influence positive<br />
ou négative sur les études féministes/<br />
études de genre ? Ou encore, comment<br />
peut-on évaluer la situation quatre ans<br />
après? Quelles évolutions ont eu lieu au<br />
cours de ces quatre années ? Quelle vision<br />
des études féministes/ études de genre se<br />
profile? Mais surtout: quels projets pour<br />
l’avenir ? Comment envisager le futur?<br />
Les interviews ont été réalisées dans un<br />
laps de temps court car notre idée n’était<br />
pas de parcourir de manière exhaustive les<br />
dynamiques ancrées dans les études<br />
féministes/études de genre en Belgique.<br />
Il s’agissait plutôt de donner une photographie<br />
de leur état, de leur développement<br />
ou de l’impasse dans laquelle elles<br />
se trouvaient notamment aussi face aux<br />
réformes de l’enseignement supérieur<br />
engendrées par le processus de Bologne.<br />
Nous avons parcouru quatre universités<br />
francophones au sein desquelles nous<br />
avons rencontré certaines personnes que<br />
nous tenons particulièrement à remercier:<br />
l’UCL (Mylène Baum, Nathalie Frogneux,<br />
Ada Garcia), l’ULB (Eliane Gubin,<br />
Bérengère Marques-Pereira, Marie-<br />
Geneviève Pinsart, Sophie Stoffel), les<br />
FUSL (Jean-Pierre Nandrin, Olivier<br />
Paye), l’ULG (Annie Cornet, Juliette<br />
Dor), l’UMH (Marielle Bruyninckx).<br />
Nous avons également interrogé Hedwige<br />
Peemans-Poullet, fondatrice de l’université<br />
des femmes car cette association<br />
a joué et joue encore un rôle historique<br />
dans la production et la diffusion<br />
des savoirs féministes en Communauté<br />
française.<br />
Etudes sur les Femmes,<br />
Etudes Féministes ou Etudes<br />
de Genre?<br />
Le terme de genre optient la majorité des<br />
préférences des personnes rencontrées.<br />
Par contre, les raisons qui expliquent le<br />
choix de ce terme peuvent varier: c’est<br />
parfois faute d’autres termes plus adéquats,<br />
c’est souvent parce que le terme<br />
genre “passe mieux”, car il est moins “connoté”<br />
que “études féministes” qui introduisent<br />
une dimension militante. Cette<br />
dernière semble avoir été délibérément<br />
abandonnée par la majorité des personnes<br />
interrogées car jouer la carte du militantisme<br />
féministe au sein d’un centre<br />
ou groupe de recherche semble faire peur,<br />
peur de se faire dénigrer, peur de ne pas<br />
Sandrine Debunne<br />
être considéré-e comme scientifique, peur<br />
d’être isolé-e. Hedwige Peemans Poullet<br />
de l’Université des Femmes est la seule à<br />
revendiquer l’utilisation du terme Etudes<br />
féministes.<br />
Eliane Gubin, Histoire, ULB.<br />
“Les termes Etudes Femmes sont grammaticalement<br />
choquants en Français. Les<br />
termes Etudes Feministes ont une connotation<br />
militante. Avec Etudes sur les<br />
Femmes, on peut tout étudier mais on<br />
risque de dériver vers étude sur la femme!<br />
Le terme de genre semble plus “noble”<br />
car il n’est pas connoté féminin, ce terme<br />
engendre une dimension relationnelle<br />
(rapports de genre) et permet aussi de<br />
toucher aux études sur la masculinité.<br />
Par ailleurs, c’est depuis l’émergence des<br />
études de genre, que des études sur l’homosexualité<br />
(masculines principalement)<br />
ont vu le jour. La stratégie a donc été d’avancer<br />
masqué-e pour obtenir un résultat<br />
et cela a porté ses fruits, alors pourquoi<br />
pas ?”<br />
Marie-Geneviève Pinsart, Philosophie<br />
et Lettre, ULB.<br />
“Je préfère le terme genre car Etudes Féministes<br />
est trop connoté et souvent mal<br />
perçu dans le monde académique. Etudes<br />
Femmes est aussi trop limité car il ne s’agit<br />
pas uniquement des femmes. Le genre<br />
a donc été choisi en désespoir de cause,<br />
ne trouvant pas de traduction française au<br />
terme de Gender.”<br />
Olivier Paye, Sciences Politiques, FUSL.<br />
“Tout d’abord le terme de genre a été<br />
choisi car il soulignait la dimension soci-