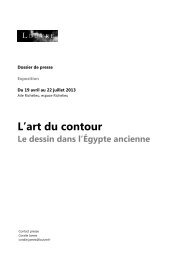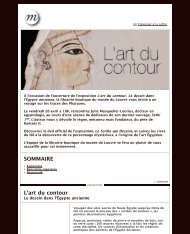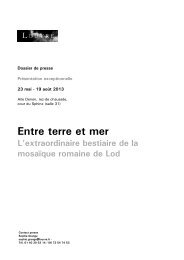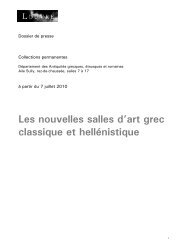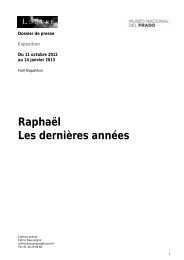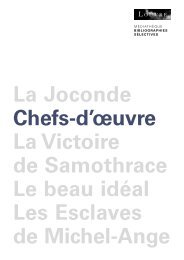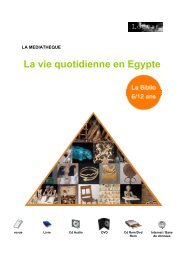Chypre - Musée du Louvre
Chypre - Musée du Louvre
Chypre - Musée du Louvre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Entre Byzance et l’Islam (milieu <strong>du</strong> VII e siècle - fin <strong>du</strong> X e siècle)<br />
Sous le règne d’Héraclius (610-641), <strong>Chypre</strong> devient un élément clef <strong>du</strong> dispositif de défense de l’Empire byzantin<br />
contre les Perses puis contre les Arabes qui envahissent la Syrie, la Palestine et l’Égypte et dévastent<br />
<strong>Chypre</strong> dès les années 649-650.<br />
Enfouis lors de la conquête arabe de l’île, deux trésors d’argenterie ont été coup sur coup découverts sur le<br />
même site à Lamboussa-Lapithos, près de Kyrénia, en 1899 et 1902, le « premier », acquis aussitôt par le British<br />
Museum, le « second » aujourd’hui principalement partagé entre Nicosie et New York. Les deux trésors<br />
constituent un témoignage éloquent sur la richesse des élites chypriotes au début <strong>du</strong> VII e siècle.<br />
Les six plats d’argent de l’Histoire de David, qui portent tous des poinçons <strong>du</strong> règne d’Héraclius, illustrent la<br />
splendeur des dernières heures de la culture antique. Ils proviennent <strong>du</strong> « second » trésor, ainsi que des cruches<br />
de bronze, sans doute destinées à contenir un trésor monétaire et des bijoux, une main votive et quelques autres<br />
objets de bronze ici réunis.<br />
Les bouleversements intro<strong>du</strong>its par les invasions arabes con<strong>du</strong>isent en <strong>Chypre</strong> à un étrange partage de l’île, dès<br />
688, entre Arabes et Byzantins, ménageant aux deux rivaux un accès égal aux ports. Les trois siècles<br />
« obscurs » de l’histoire de <strong>Chypre</strong>, qui s’ouvrent alors, n’ont laissé que de maigres vestiges : quelques inscriptions,<br />
des lampes et des sceaux. Toutefois, les liens de l’Église chypriote avec Constantinople sont demeurés<br />
vivaces et ininterrompus <strong>du</strong>rant toute cette période, comme l’assure à lui seul un Évangile <strong>du</strong> IX e siècle.<br />
Une nouvelle province byzantine (965-1191)<br />
<strong>Chypre</strong>, grâce à la reconquête de l’empereur Nicéphore Phocas, redevient byzantine en 965 pour plus de deux<br />
siècles. Une ère de renouveau s’instaure et, au-delà des particularismes, des liens étroits se sont rétablis entre<br />
<strong>Chypre</strong>, l’Empire et Constantinople.<br />
L’île offre désormais, jusqu’à la fin <strong>du</strong> XII e siècle, les contours d’une province prospère, qui se couvre d’églises<br />
aux décors de fresques exceptionnels, en particulier dans le massif montagneux <strong>du</strong> Troodos. L’impressionnant<br />
Saint Démétrios provenant de l’église Saint-Antoine à Kellia permet ici d’évoquer cet âge d’or de la peinture<br />
byzantine.<br />
<strong>Chypre</strong> participe pleinement à l’économie générale de l’Empire, comme le montre notamment la circulation des<br />
céramiques importées des grands centres byzantins. Elle est aussi réputée pour sa soie, et les sources arabes concordent<br />
pour dire que les ports de l’île et sa capitale, Nicosie, sont des centres commerciaux où l’on trouve<br />
« toutes sortes de pro<strong>du</strong>its, des biens manufacturés et des marchandises ». Des flacons de verre au précieux<br />
décor émaillé ont été découverts à Paphos et à Nicosie.<br />
Le sulfate de cuivre, le « bleu de <strong>Chypre</strong> » des dictionnaires, est une ressource largement exportée, mais aussi<br />
sans doute travaillée sur place, pour la confection de petites icônes, d’objets liturgiques ou de croix. C’est également<br />
le cas de la stéatite, une pierre tendre relativement facile à travailler, abondante en <strong>Chypre</strong> et exploitée<br />
depuis l’Antiquité, comme l’attestent les traces d’un atelier <strong>du</strong> XII e siècle récemment découvert en fouilles à<br />
Nicosie.<br />
Icônes et manuscrits<br />
Dès le début <strong>du</strong> XII e siècle, une situation politique inédite intervient en Orient. En 1099, la première croisade a<br />
entraîné la fondation des États latins de Terre sainte. <strong>Chypre</strong>, depuis longtemps déjà sur la route des pèlerins<br />
d’Occident, se trouve aussi sur celle des croisés et une force centrifuge nouvelle tend désormais à l’inscrire davantage<br />
encore dans le Levant.<br />
Les icônes chypriotes posent alors la question de leurs liens avec l’art constantinopolitain et de la plus ou moins<br />
grande autonomie artistique de l’île. La Vierge Éléousa <strong>du</strong> peintre Théodore Apsevdis, auteur des fresques de<br />
l’Enkleistra de Saint-Néophyte près de Paphos en 1183, est étroitement apparentée à la peinture de la capitale<br />
byzantine sous les Comnène par le traitement subtil des carnations et des drapés aux accents classiques, même<br />
si le bandeau à la partie inférieure <strong>du</strong> cadre a pu être rapproché de motifs en usage en Terre sainte et au Sinaï.<br />
Le nimbe traité en relief <strong>du</strong> saint moine, de son côté, caractérise des icônes dites « des croisades ». Quant au<br />
Christ con<strong>du</strong>it au Calvaire (Elkomenos) de Pelendri, vers 1200, il se distingue par son caractère narratif et par<br />
des personnages plus pondéraux qui témoignent d’une réelle autonomie artistique.<br />
Le phénomène s’observe bien davantage dans la peinture des manuscrits, en particulier avec un groupe attribué<br />
à l’aire « palestino-chypriote ». Ce sont surtout des évangéliaires, des psautiers, des ménées ou ménologes qui<br />
ne se singularisent pas dans leur principe au sein des manuscrits byzantins, mais qui présentent un aspect<br />
provincial et dont l’attribution demeure disputée entre <strong>Chypre</strong> et les grands centres de Syrie et de Palestine.