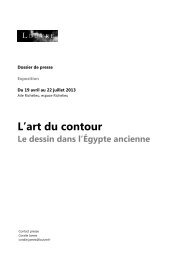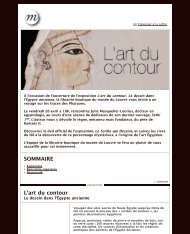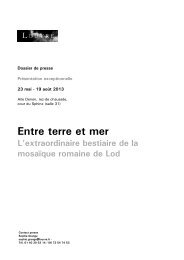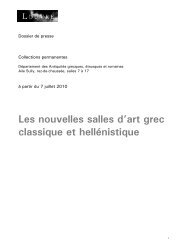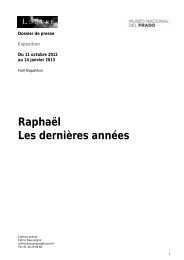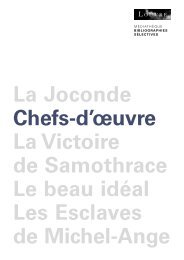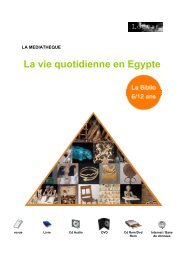Chypre - Musée du Louvre
Chypre - Musée du Louvre
Chypre - Musée du Louvre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Saint Mammès chevauchant le lion.<br />
Icône, première moitié <strong>du</strong> XVI e siècle. H. 105 cm x L. 61,5 cm. Paphos,<br />
<strong>Musée</strong> byzantin, <strong>Chypre</strong> © Paphos, musée byzantin.<br />
L’icône provient de l’église Saint-George d’Achéleia, un<br />
hameau situé à cinq kilomètres à l’est de Paphos. Saint Mamas,<br />
ou en français saint Mammès, est représenté chevauchant un<br />
gros lion rouge, à la crinière flamboyante. Tous les deux<br />
regardent le spectateur. Le saint, les cheveux agités par le<br />
vent, porte une tunique sombre, délicatement ornée d’un fin<br />
galon doré sur la poitrine, aux épaules, aux poignets et à la<br />
partie inférieure.<br />
Sur ses épaules, un manteau rouge flotte au vent, semé de<br />
joyaux de perles et de pierres précieuses. Ses chaussures<br />
sont brodées d’or et de perles. Il tient d’une main sa houlette<br />
de berger et serre contre lui un petit agneau. Saint Mamas,<br />
un berger de Cappadoce qui aurait été martyrisé à Césarée au<br />
III e siècle, est une figure très populaire de l’Orient chrétien,<br />
même si son culte est aussi largement attesté en Occident.<br />
Dès le IV e siècle, une basilique est élevée sur son tombeau à<br />
Césarée de Cappadoce, où Basile de Césarée prononce un<br />
panégyrique en son honneur, et où affluent de nombreux<br />
pèlerins, tandis que Grégoire de Nazianze évoque à son tour<br />
le saint dans une de ses homélies. De là, son culte se diffuse<br />
rapidement, en même temps que ses reliques, à Constantinople,<br />
en Grèce, en Crète, à Jérusalem, et se propage en <strong>Chypre</strong> où<br />
son corps serait arrivé miraculeusement après avoir navigué<br />
sur les flots dans une cuve de marbre, échouée près de Morphou.<br />
Il est un des saints les plus vénérés de <strong>Chypre</strong> où plus de quatre-vingts églises lui sont dédiées, dont celle de<br />
Morphou qui abrite un grand reliquaire. Sur l’icône, l’adjectif « Myroblite » de l’inscription fait allusion au<br />
myron miraculeux suintant de sa tombe. Le culte <strong>du</strong> saint s’est aussi propagé très tôt en Occident, en particulier<br />
en Italie et en France où la cathédrale Saint-Mammès de Langres, placée sous son vocable dès le VIII e siècle, a<br />
rassemblé une partie de ses reliques.<br />
L’hagiographie de saint Mamas dépeint le saint sous les traits d’un jeune berger, auteur de nombreux miracles,<br />
qui aurait notamment apprivoisé un lion avant d’être transpercé d’un coup de trident. L’iconographie le<br />
représente le plus souvent, comme ici, chevauchant un lion, tenant sa houlette et un agneau, détail qui rappelle<br />
ses vertus de protecteur des bergers. On trouve en <strong>Chypre</strong> une abondante série d’images de saint Mamas<br />
sur les icônes et sur les fresques des églises, surtout il est vrai à partir <strong>du</strong> règne des Lusignan et, plus encore,<br />
au XVI e siècle. C’est dans cette tradition que s’inscrit l’icône d’Achéleia, attribuable à la première moitié<br />
<strong>du</strong> XVI e siècle. Oeuvre de qualité d’un peintre post-byzantin, sa facture est encore proche de celle de la peinture<br />
de la fin de l’époque des Paléologues, comme le montrent la mise en page serrée, plusieurs éléments débordant<br />
sur le cadre, l’élégance de la composition, le sens <strong>du</strong> volume, un goût presque baroque pour la couleur<br />
et l’animation <strong>du</strong> vivant. La touche fine et les rehauts<br />
plus clairs hérités de la peinture byzantine confèrent aux formes une plasticité vigoureuse et une grâce surnaturelle<br />
et joyeuse. Elles vont de pair avec une grande fraîcheur, qui se veut même un peu naïve dans la description<br />
méticuleuse des griffes <strong>du</strong> lion ou des sertissures d’or retenant, sur les joyaux <strong>du</strong> manteau, les cabochons<br />
de pierre au milieu des fleurs de perles, toutes soigneusement ombrées.<br />
Ce sont autant de traits qui appartiennent en propre aux oeuvres <strong>du</strong> peintre Philippe Goul, auteur des fresques<br />
de l’église de la Sainte- Croix d’Agiasmati à Platanistassa (1494-1505) et de l’église Saint-Mamas de Louvaras<br />
(1495), et à son entourage, dans les dernières années <strong>du</strong> XV e et les premières décennies <strong>du</strong> XVI e siècle.<br />
Ce texte est extrait de la publication <strong>Chypre</strong> entre Byzance et l’Occident, IV e -XVI e siècle, sous la direction de<br />
Jannic Durand et Dorota Giovannoni. Coédition Somogy / musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> éditions.<br />
Chapitre : « <strong>Chypre</strong> vénitienne (1489–1571) : contrastes artistiques » par Marina Solomidou-Ieronymidou - Texte de<br />
G . Philotheou.