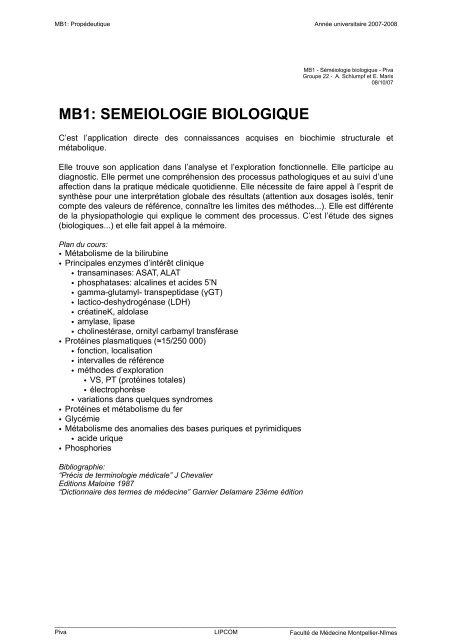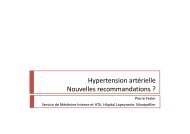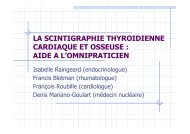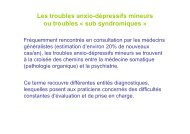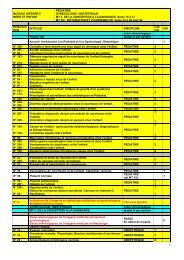mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier
mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier
mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
MB1: SEMEIOLOGIE BIOLOGIQUE<br />
MB1 - Séméiologie <strong>biologique</strong> - Piva<br />
Groupe 22 - A. Schlumpf et E. Maris<br />
08/10/07<br />
C’est l’application directe <strong>de</strong>s connaissances acquises en biochimie structurale et<br />
métabolique.<br />
Elle trouve son application dans l’analyse et l’exploration fonctionnelle. Elle participe au<br />
diagnostic. Elle permet une compréhension <strong>de</strong>s processus pathologiques et au suivi d’une<br />
affection dans la pratique médicale quotidienne. Elle nécessite <strong>de</strong> faire appel à l’esprit <strong>de</strong><br />
synthèse pour une interprétation globale <strong>de</strong>s résultats (attention aux dosages isolés, tenir<br />
compte <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong> référence, connaître les limites <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s...). Elle est différente<br />
<strong>de</strong> la physiopathologie qui explique le comment <strong>de</strong>s processus. C’est l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s signes<br />
(<strong>biologique</strong>s...) et elle fait appel à la mémoire.<br />
Plan du cours:<br />
• Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine<br />
• Principales enzymes d’intérêt clinique<br />
• transaminases: ASAT, ALAT<br />
• phosphatases: alcalines et aci<strong>de</strong>s 5’N<br />
• gamma-glutamyl- transpeptidase (γGT)<br />
• lactico-<strong>de</strong>shydrogénase (LDH)<br />
• créatineK, aldolase<br />
• amylase, lipase<br />
• cholinestérase, ornityl carbamyl transférase<br />
• Protéines plasmatiques (≈15/250 000)<br />
• fonction, localisation<br />
• intervalles <strong>de</strong> référence<br />
• métho<strong>de</strong>s d’exploration<br />
• VS, PT (protéines totales)<br />
• électrophorèse<br />
• variations dans quelques syndromes<br />
• Protéines et métabolisme du fer<br />
• Glycémie<br />
• Métabolisme <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong>s bases puriques et pyrimidiques<br />
• aci<strong>de</strong> urique<br />
• Phosphories<br />
Bibliographie:<br />
“Précis <strong>de</strong> terminologie médicale” J Chevalier<br />
Editions Maloine 1987<br />
“Dictionnaire <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine” Garnier Delamare 23ème édition<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine et ictères ou “jaunisses”<br />
Objectif: valeur sémiologique du dosage <strong>de</strong> la bilirubine<br />
• symptôme clinique: ictère<br />
• organe: foie<br />
• métabolite responsable <strong>de</strong> l’ictère: bilirubine<br />
Ictère ou jaunisse<br />
• coloration jaune plus ou moins intense <strong>de</strong> la peau et <strong>de</strong>s muqueuses jusqu’au marron<br />
vert<br />
• manifestation clinique d’une augmentation du taux <strong>de</strong> bilirubine circulant<br />
• affecte tous les âges <strong>de</strong> la vie<br />
Les causes <strong>de</strong> l’ictère sont multiples: certaines sont graves, d’autres bénignes ou<br />
physiologiques. L’ictère ne doit jamais être négligé. Il doit être exploré pour connaître<br />
l’origine avec certitu<strong>de</strong>.<br />
I - Métabolisme normal <strong>de</strong> la bilirubine<br />
1 - Etape pré-hépatique<br />
La bilirubine n’a pas une origine hépatique. Elle provient en majeure partie <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>struction dans le système réticulo-endothélial <strong>de</strong>s hématies vieillies (environ 120 jours).<br />
L’hémoglobine est alors libérée et sa molécule est déstructurée en chaîne α et en chaîne<br />
β. Le fer et la globine sont libérés. La fraction héminique conduit à une bilirubine<br />
préhépatique ou bilirubine libre ou non conjuguée.<br />
SRE: ensemble <strong>de</strong> cellules disséminées dans différents tissus <strong>de</strong> l’organisme. Il regroupe:<br />
• les histiocytes du TC<br />
• tissus splénique (rate) et lymphoï<strong>de</strong> (ganglions)<br />
• les cellules <strong>de</strong> la moelle osseuse<br />
• les cellules du foie: cellules <strong>de</strong> Kupffer<br />
Fe 3+ globine<br />
Hg = > choléglobine = > vendoglobine = > biliverdine = > bilirubine<br />
La bilirubine a une absorbance élevée son dosage est donc facile.<br />
Elle arrive par la veine porte au foie.<br />
2 - Etape hépatique<br />
Quand les fonctions hépatiques sont normales, la bilirubine est totalement transformée<br />
dans le foie en bilirubine conjuguée.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Trois mécanismes interviennent:<br />
• captation hépatocytaire<br />
• glycuro-conjugaison<br />
• excrétion biliaire<br />
La bilirubine conjuguée ainsi formée sera excrétée dans la bile.<br />
Remarque: la capacité <strong>de</strong> glycuro-conjugaison est limitée à trois fois la production normale<br />
≈ 3x300 mg/L/jr<br />
≈1mg/L/jr<br />
SANG BILE<br />
Transport <strong>de</strong> la bilirubine libre dans l’hépatocyte<br />
3 - Etape post hépatique<br />
La bilirubine conjuguée forme <strong>de</strong>s pigments biliaires. Elle est excrétée dans la bile qui est<br />
stockée dans la vésicule biliaire. Déversée dans le duodénum elle subira une succession<br />
<strong>de</strong> modifications structurales: c’est le cycle entérohépatique qui conduit à la formation <strong>de</strong><br />
bilinogènes dont la majeure partie sera excrétée sous forme <strong>de</strong> stercobiline dans les selles<br />
et urobiline dans les urines<br />
Composition <strong>de</strong> la bile<br />
• eau<br />
• enzymes dont Pal, γGT, 5’N...<br />
• électrolytes sulfoconjugués (détoxification)<br />
• protéines<br />
• cholestérol, lécithine<br />
• sels biliaires = détergents fabriqués à partir du CHO <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s aminés taurine et glycine<br />
• pigments biliaires ( bilirubine conjuguée)<br />
La bile joue un rôle très important et très complexe dans la physiologie <strong>de</strong> la digestion.<br />
Cycle entéro hépatique<br />
RE<br />
Bilirubine libre R<br />
Pôle vasculaire<br />
Glycuronyltransférase<br />
(+ 2 aci<strong>de</strong>s<br />
glucuroniques) Pôle biliaire<br />
CHO<br />
COOH<br />
Ac glucuronique<br />
oxydation en C6<br />
20% <strong>de</strong>s pigments biliaires seront déconjugués en bilirubine libre et réabsorbés par le foie<br />
75% seront transformés en bilinogènes incolores: urobilinogène, stercobilinogène qui<br />
après oxydation donneront <strong>de</strong>s produits d’élimination fécale : urobiline et stercobiline.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
5% <strong>de</strong>s bilinogènes échappent à l’oxydation; ils seront réabsorbés et en partie éliminés<br />
par le rein ce qui conduit à une trace normale d’urobiline urinaire.<br />
Lorsque la production <strong>de</strong> bilirubine libre augmente anormalement (hémolyses<br />
pathologiques) le foie élimine cet excès en accélérant le processus <strong>de</strong> glycuroconjugaison<br />
(dans les limites <strong>de</strong> sa capacité).<br />
Cette hyperproduction <strong>de</strong> bilirubine conjuguée entraîne une amplification <strong>de</strong> cycle entéro<br />
hépatique et donc une élévation <strong>de</strong> l’urobiline urinaire à partir <strong>de</strong>s 5% réabsorbés.<br />
II - Les formes circulantes <strong>de</strong> la bilirubine<br />
1 - La bilirubine non conjuguée ou bilirubine libre<br />
En fait elle est liée à l’albumine: une mole d’albumine transporte 2 à 5 moles <strong>de</strong> bilirubine.<br />
C’est la forme pré-hépatique. Chez le sujet normal c’est la seule forme circulante<br />
(présence normale dans le plasma). C’est une molécule hydrophobe, insoluble dans l’eau,<br />
soluble dans les solvants organiques et les lipi<strong>de</strong>s (forme neurotonique +++).<br />
2 - La bilirubine conjuguée<br />
C’est la forme post-hépatique. Normalement absente du plasma ou présente à l’état <strong>de</strong><br />
traces. Elle est soluble dans l’eau et insoluble dans les lipi<strong>de</strong>s. Dans certains états<br />
pathologiques elle s’accumule dans le sang et sera alors éliminée par les reins sous forme<br />
<strong>de</strong> pigments biliaires urinaires.<br />
Dans le sang:<br />
BT = BL + BC<br />
BT = BL + 0+<br />
BT= bilirubine totale<br />
0+ = à l’état <strong>de</strong> traces<br />
3 - Caractères généraux <strong>de</strong> la bilirubine<br />
Dénomination Localisation Solubilité Métabolisation Formes<br />
circulantes<br />
BL<br />
BNC<br />
B indirecte<br />
BC<br />
B directe<br />
BT = BL + BC<br />
pré-hépatique hydrophobe<br />
insoluble dans<br />
lʼeau<br />
soluble dans<br />
les lipi<strong>de</strong>s<br />
post-hépatique soluble dans<br />
lʼeau<br />
insoluble dans<br />
les lipi<strong>de</strong>s<br />
subit la<br />
glycuroconjugaison<br />
hépatique<br />
excrétion<br />
normalement<br />
dans la bile<br />
subit le cycle<br />
entéro<br />
hépatique<br />
liée à la sérum<br />
albumine<br />
présence<br />
normale dans<br />
le plasma<br />
absente<br />
normalement<br />
dans le plasma<br />
Valeurs<br />
normales<br />
17μmol/L<br />
0 ou < 3μmol/L<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
17 = 10x1,7 +0<br />
[µmol/L] = [mg] x 1,7<br />
III - Valeurs <strong>de</strong> référence<br />
1 - Enfants adultes<br />
BT : < 17 µmol/L soit 10 mg/L (2 à 24)<br />
on la trouve presque exclusivement sous forme <strong>de</strong> bilirubine libre<br />
BC: absente ou < 3 µmol/L (0 à 8)<br />
1 mg/L => 1,7 µmol/L<br />
2 - Nouveaux nés<br />
En raison du contexte physiologique et en l’absence <strong>de</strong> toute pathologie on donne:<br />
âge du nouveau né valeur normale pour la bilirubine totale<br />
12 heures < 103 μmol/L 60 mg/L<br />
J+2 < 145 μmol/L 85 mg/L<br />
J+3 < 196 μmol/L 115 mg/L<br />
J+4 à J+5 < 150 μmol/L 88 mg/L<br />
J+5 à J+15 baisse progressive jusquʼaux valeurs <strong>de</strong> lʼadulte<br />
( 17 μmol/L )<br />
Le taux <strong>de</strong> bilirubine conjuguée sera fonction <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> maturité du foie il doit rester<br />
inférieur à 10% <strong>de</strong> la bilirubine totale. Il ne faut pas confondre l’ictère physiologique et<br />
l’ictère pathologique; il existe une pério<strong>de</strong> à surveiller pour ne pas laisser <strong>de</strong> séquelles au<br />
cerveau<br />
3 - Valeurs pathologiques<br />
L’ictère est cliniquement décelable pour une bilirubine totale proche <strong>de</strong> 30 µmol/L. Pour<br />
<strong>de</strong>s valeurs comprises entre 20 et 50 µmol/L (20 à 30 mg/L) on parlera d’état subictérique.<br />
On parle d’ictère franc pour une bilirubine totale <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 120 à 190 µmol/L<br />
(70 à 110 mg/L). Dans les cas très intenses les valeurs <strong>de</strong> la bilirubine totale peuvent aller<br />
jusqu’à 850 µmol/L (500 mg/L) et plus. Le sérum est alors fortement coloré en jaune avec<br />
<strong>de</strong>s reflets verdâtres.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
IV - Valeurs sémiologiques globales<br />
Le dosage permet:<br />
• d’authentifier un ictère ou un sub-ictère<br />
• <strong>de</strong> chiffrer son intensité<br />
• <strong>de</strong> suivre son évolution<br />
C’est la comparaison <strong>de</strong>s taux sériques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux formes circulantes, c’est à dire bilirubine<br />
libre et bilirubine conjuguée, qui par leur valeur discriminante permet <strong>de</strong> cerner les causes<br />
<strong>de</strong> l’ictère. L’orientation sémiologique dépendra du pourcentage <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
formes <strong>de</strong> la bilirubine circulante.<br />
Quand le taux <strong>de</strong> la bilirubine libre équivaut à 70% <strong>de</strong> la bilirubine totale, on parle d’ictère<br />
à la bilirubine libre.<br />
BL/BT = 70%<br />
Quand le taux <strong>de</strong> bilirubine conjuguée équivaut à 80% <strong>de</strong> la bilirubine totale, on parle<br />
d’hyperbilirubinémie conjuguée.<br />
BC/BT = 80%<br />
Entre ces <strong>de</strong>ux valeurs, on parle d’ictère mixte.<br />
V - Hyperbilirubinémies et ictères<br />
1 - Les hyperbilirubinémies à bilirubine libre<br />
A - Affections constitutionnelles<br />
Le foie n’est pas responsable <strong>de</strong> l’ictère. Le mécanisme est le suivant: hémolyse<br />
pathologique → libération anormale d’Hb → surproduction <strong>de</strong> bilirubine libre qui dépasse<br />
la capacité du foie → ictère à bilirubine libre<br />
a - affections constitutionnelles<br />
Atteintes globulaires : anisocytose, fragilité <strong>de</strong>s hématies (mb)<br />
Sphérocytose: maladie <strong>de</strong> Minkowski-Chauffard (défaut <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s protéines<br />
membranaires)<br />
Enzymopathies érythrocytaires: la plus fréquente est le déficit en G6PD (Glucose 6<br />
Phosphate Déshydrogénase), affection liée au sexe et au chromosome X. Elle se révèle<br />
par <strong>de</strong>s crises aiguës d’hémolyse induite par <strong>de</strong>s facteurs déclenchants tels que les<br />
médicaments ou les fèves fraîches (favisme).<br />
Thalassémies: ce sont <strong>de</strong>s affections génétiques répandues dans le mon<strong>de</strong> entier<br />
mais plus particulièrement au Niger, au Mali, en Thaïlan<strong>de</strong> jusqu’au pourtour<br />
méditerranéen. C’est une anomalie <strong>de</strong> structure <strong>de</strong> l’Hb caractérisée par un défaut <strong>de</strong><br />
synthèse portant sur une ou plusieurs chaînes <strong>de</strong> la globine et entraînant une maturation<br />
précoce <strong>de</strong>s hématies qui avortent intra médullairement.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Hémolyse<br />
ictère<br />
C’est une affection grave qui peut passer longtemps inaperçue jusqu'à l’intervention d’un<br />
facteur déclenchant qui peut être iatrogène (nivaquine) ou une maladie infectieuse.<br />
Il ne faut pas confondre thalassémie et drépanocytose. La thalassémie est due à une<br />
anomalie <strong>de</strong> structure <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> globines et <strong>de</strong> leur région. Elles sont soit<br />
manquantes, soit en surnombre soit malformées. Les globules rouges ne sont pas<br />
fonctionnels et sont fragilisés. Cette pathologie est mieux supportée par la population<br />
noire que caucasienne.<br />
La drépanocytose ou anémie falsiforme est due à la substitution d’un AA (6) sur la<br />
chaîne β:<br />
b - affection acquises<br />
anémie hypochrome microcytaire (petits GR)<br />
Val Glu<br />
HbS → HbA<br />
P N<br />
Elles sont dues à <strong>de</strong>s facteurs externes aux globules rouges:<br />
• Des facteurs transfusionnels<br />
• erreurs <strong>de</strong> transfusion (groupes)<br />
• isoimmunisation <strong>de</strong>s polytransfusés (perte <strong>de</strong> la tolérance avec sécrétion d’anticorps<br />
contre les globules rouges entraînant l’hémolyse)<br />
• Des facteurs toxiques<br />
• métaux lourds, solvants organiques... (dérivés chlorés très toxiques)<br />
• venins <strong>de</strong> serpents<br />
• champignons (amanite phalloï<strong>de</strong>)<br />
• Des facteurs infectieux ou parasitaires<br />
• septicémie à germe hémolysant<br />
• paludisme<br />
• Des facteurs mécaniques<br />
• prothèse valvulaire<br />
• hémodialysés (injection d’héparine)<br />
B - Déficits hépatiques en glycuronyltransférase (GT)<br />
a - Déficit définitif mais partiel en GT ou maladie <strong>de</strong> Gilbert (hyperbilirubinémie libre<br />
congénitale)<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Il s’agit d’une affection fréquente qui touche 2 à 4 % <strong>de</strong> la population sans aucun signe<br />
d’atteinte hépatique. Le foie possè<strong>de</strong> seulement une faible capacité à conjuguer la<br />
bilirubine libre dont la moindre surproduction s’accumule.<br />
L’ictère épisodique et peu intense est induit par divers facteurs:<br />
• stress<br />
• état infectieux<br />
• jeûne<br />
• excès <strong>de</strong> fatigue physique<br />
• facteurs iatrogènes<br />
• sport intense<br />
L’ictère régresse <strong>de</strong> lui même ou sous l’effet d’inducteurs enzymatiques (phénobarbital)<br />
Cette affection ne justifie aucun traitement il s’agit plus d’un handicap que d’une maladie.<br />
Si dans une famille un individu mala<strong>de</strong> est décelé alors il y a une enquête familiale.<br />
b - déficit définitif total en GT (maladie <strong>de</strong> Criegler Najiar)<br />
Cette maladie se manifeste dès les premières heures <strong>de</strong> la vie par un ictère intense à<br />
bilirubine libre qui passe rapi<strong>de</strong>ment à la chronicité. La bilirubine libre augmente<br />
rapi<strong>de</strong>ment pouvant atteindre <strong>de</strong>s valeurs très élevées. Le nouveau né risque <strong>de</strong><br />
développer une encéphalopathie gravissime conduisant à la mort. Ici aussi la découverte<br />
d’un cas entraîne une enquête familiale.<br />
Maladie <strong>de</strong> Gilbert Syndromes <strong>de</strong> Criegler Najiar 1 et 2<br />
Promoteur 1A 2 3 4 5 COOH<br />
Région variable Région constante<br />
Mutations <strong>de</strong> la bilirubine glycuronyltransférase<br />
La base génétique est la même entre les <strong>de</strong>ux. Tous les pourcentages <strong>de</strong> déficit peuvent<br />
exister mais dans tous les cas c’est grave.<br />
C - Ictère physiologique du nouveau né (déficit transitoire)<br />
C’est une affection très fréquente qui touche 50% <strong>de</strong>s nouveaux nés et 75% <strong>de</strong>s<br />
prématurés. A la naissance alors qu’il y a toujours surproduction <strong>de</strong> bilirubine libre il peut<br />
apparaître un déficit transitoire en GT consécutif à une immaturité hépatique. L’ictère<br />
toujours à bilirubine libre sera modéré à intense n’excédant pas 85 µmol/L (50 mg/L). Il se<br />
produit à J+2 ou J+3.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> toute autre pathologie associée l’enzyme re<strong>de</strong>venant progressivement<br />
fonctionnelle les troubles régressent d’eux même en 7 à 10 jours.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
C’est une affection physiologique différente <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Criegler et Najiar ou <strong>de</strong><br />
l’ictère néonatal par incompatibilité rhésus (très graves).<br />
D - Ictère pathologique du nouveau né ou ictère par incompatibilité foeto-maternelle<br />
(maladie hémolytique du nouveau né)<br />
C’est une affection assez fréquente dont on connaît bien aujourd’hui le mécanisme,<br />
l’évolution et le traitement. Il s’agit d’une incompatibilité foeto-maternelle rhésus ou ABO<br />
entraînant dès la naissance une hyper hémolyse pathologique aggravée par le contexte<br />
physiologique post natal.<br />
Chez la mère Rh- après plusieurs grossesses il peut apparaître <strong>de</strong>s anticorps acquis<br />
dirigés contre les antigènes <strong>de</strong>s hématies foetales. Au moment <strong>de</strong> l’accouchement ces<br />
anticorps (dits agglutinines irrégulières) peuvent passer la barrière placentaire et auront un<br />
effet agglutinant sur les hématies foetales.<br />
L’ictère à bilirubine libre est souvent très intense (> 200 µmol/L)<br />
Cette affection nécessite une surveillance étroite car à partir d’un taux <strong>de</strong> bilirubine libre <strong>de</strong><br />
l’ordre <strong>de</strong> 250 µmol/L (150 mg/L) il apparaît un risque majeur: la bilirubine libre va diffuser<br />
en raison <strong>de</strong> sa liposolubilité dans les constituants cellulaires lipidoprotéiques du SNC<br />
entraînant <strong>de</strong>s troubles neurologiques irréversibles: c’est l’ictère nucléaire.<br />
Incompatibilité <strong>de</strong>s facteurs rhésus<br />
Ce sont <strong>de</strong>s variants protéiques immunogènes <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong>s érythrocytes découverts<br />
pour la première fois par Rhesus-Affen. Le variant D (PM=417 AA) est fréquent chez 84%<br />
<strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> race blanche que l’on nomme Rh + les autres Rh -.<br />
Si un enfant Rh + naît d’une mère Rh - il est possible que <strong>de</strong>s GR foetaux parviennent<br />
dans la circulation maternelle par effraction pendant l’accouchement traversant le placenta<br />
et y déclenche une forte synthèse d’anticorps <strong>de</strong> type immunoglobulines G contre<br />
l’antigène Rhésus D <strong>de</strong> l’enfant. Cette réaction n’a aucune conséquence pour la mère et<br />
l’enfant lors du premier accouchement.<br />
Les complications surviennent lors d’une prochaine grossesse si l’enfant est Rh +.<br />
1ère grossesse<br />
Mère rhésus D-<br />
Foetus rhésus D+<br />
Au premier accouchement les sangs <strong>de</strong> la mère et du foetus sont en contact. Les<br />
globules rouges foetaux induisent chez la mère la production dʼanticorps anti rhésus <strong>de</strong><br />
classe IgG appelés agglutinines irrégulières. Ces agglutinines IgG hémolysent les<br />
globules rouges foetaux Rh D +.<br />
Le foetus né nʼest pas en danger<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
La mère est immunisée et gar<strong>de</strong> la mémoire <strong>de</strong> la protéine D qui ne lui appartient pas.<br />
A la <strong>de</strong>uxième grossesse:<br />
Mère rhésus D -<br />
Foetus rhésus D +<br />
La mère sécrète les anticorps qui passent le barrière placentaire et il va y avoir hémolyse <strong>de</strong>s<br />
globules rouges foetaux.<br />
Le foetus est en danger (anémie, oedème, ictère nucléaire avec séquelles neurologiques).<br />
Il y a <strong>de</strong>s risques dʼavortement plus ou moins précoces.<br />
Solution: surveillance du taux <strong>de</strong> bilirubine non conjuguée et <strong>de</strong>s IgG, UV (permettant<br />
lʼélimination <strong>de</strong> la bilirubine libre), perfusions dʼalbumine, exsanguino-transfusion<br />
(changement total sang du foetus ce qui est dangereux) et prophylaxie aux IgG (vaccin)<br />
Prophylaxie <strong>de</strong> la maladie hémolytique du nouveau né<br />
En absence <strong>de</strong> traitement: immunisation <strong>de</strong> la mère, les globules rouges passent par<br />
effraction le barrière placentaire et la mère fabrique les anticorps (délai 48h)<br />
Le traitement consiste à lui injecter <strong>de</strong>s IgG tout <strong>de</strong> suite après le premier accouchement<br />
avant qu’elle ne synthétise les siennes <strong>de</strong> manière à éliminer les traces <strong>de</strong> globules<br />
rouges foetaux restant après l’accouchement. Pas d’immunisation <strong>de</strong> la mère. Tout se<br />
passe pour la grossesse suivante comme si c’était une première grossesse.<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
2 - Les hyperbilirubinémies à bilirubine conjuguée<br />
La production <strong>de</strong> bilirubine libre et sa conjugaison sont normalement assurées mais la<br />
présence d’un obstacle mécanique sur les voies biliaires extra hépatiques entraîne:<br />
• une diminution ou un arrêt <strong>de</strong> l’excrétion biliaire: cholestase<br />
• une diffusion <strong>de</strong> la bile à travers le foie où elle va passer dans tout le secteur vasculaire<br />
entraînant un syndrome <strong>de</strong> cholestase extra hépatique.<br />
L’ictère à bilirubine conjuguée sera intense à très intense.<br />
Hyperbilirubinémie avec 80% <strong>de</strong> bilirubine conjuguée pouvant atteindre <strong>de</strong>s valeurs très<br />
élevées: bilirubine totale = 850 µmol/L soit 500 mg/L<br />
1 mg/L → 1,7 µmol/L<br />
La bilirubine conjuguée soluble s’élimine dans les urines sous forme <strong>de</strong> pigments biliaires,<br />
les urines prenant une teinte foncée et un aspect mousseux.<br />
Les étiologies les plus fréquentes sont dues à <strong>de</strong>s obstacles mécaniques sur les voies<br />
biliaires:<br />
• lithiases biliaires (= calculs formés par du cholestérol et du bilirubinate <strong>de</strong> Ca2+)<br />
• cancer <strong>de</strong> la tête du pancréas ou <strong>de</strong>s voies biliaires<br />
3 - Les hyperbilirubinémies <strong>de</strong> type mixte<br />
Elles sont la conséquence d’un certain nombre d’affections et <strong>de</strong> lésions hépatiques<br />
(atteinte hépatocytaire, tumeur au foie...) entraînant une baisse du drainage et <strong>de</strong><br />
l’excrétion biliaire, c’est à dire une cholestase intra-hépatique (la fonction <strong>de</strong> glycuroconjugaison<br />
étant conservée)<br />
Les étiologies les plus fréquentes sont:<br />
• les hépatites (nécroses hépatocytaires d’origine diverse<br />
• hépatites ABCDE<br />
• hépatites médicamenteuses (antibiotiques, neuroleptiques, antidépresseurs)<br />
• hépatites toxiques (venins, champignons, pestici<strong>de</strong>s, métaux lourds)<br />
• les cirrhoses (insuffisance hépatocytaire chronique) dues à l’alcool, aux médicaments ou<br />
aux virus.<br />
• les cancers primitifs et secondaires du foie<br />
Deux cas particuliers: les maladies <strong>de</strong> Dubin-Johnson et <strong>de</strong> Roto<br />
Ces <strong>de</strong>ux maladies rares et bénignes (1% <strong>de</strong> la population) correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s troubles<br />
<strong>de</strong> l’excrétion biliaire qui se manifestent par l’augmentation <strong>de</strong> la bilirubine totale.<br />
BT = BNC (40%) + BC (60%)<br />
Le foie est pigmenté:<br />
• en noir par <strong>de</strong> la mélanine dans la maladie <strong>de</strong> Dubin-Johnson<br />
• en vert sombre dans la maladie <strong>de</strong> Roto<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Le patient est asthénique. Il n’y a pas <strong>de</strong> cholestase ni <strong>de</strong> cytolyse hépatique.<br />
Pas <strong>de</strong> traitement médicamenteux.<br />
Cholestase = rétention biliaire, baisse ou arrêt du flux biliaire se traduisant par une<br />
augmentation <strong>de</strong> la bilirubine conjuguée et <strong>de</strong> la bilirubine totale.<br />
Cholestase intra-hépatique<br />
• hépatites<br />
• cancers primitifs et secondaires du foie<br />
• cirrhose biliaire primitive (+++ chez la femme)<br />
• cirrhoses toutes confondues<br />
Cholestase extra-hépatique<br />
• par obstacle: lithiase ou calculs<br />
• par compression <strong>de</strong>s voies biliaires par un cancer <strong>de</strong> la tête du pancréas.<br />
Augmentation <strong>de</strong> la bilirubine totale, la bilirubine conjuguée, d’enzymes (phosphatase<br />
alcaline, γGT, 5’ Nucléotidase) et <strong>de</strong> protéines (C3, Cer, IgA, IgM)<br />
En conclusion<br />
Le caractère non conjugué d’une hyperbilirubinémie doit évoquer an premier lieu<br />
• une hémolyse pathologique (en sachant que l’ictère ne se déclare que lorsque la<br />
capacité <strong>de</strong> glycurono-conjugaison est dépassée)<br />
• un déficit en glycuronyltransférase (souvent d’origine constitutionnelle)<br />
Les ictères à bilirubine conjuguée sont consécutifs soit:<br />
• à une cholestase<br />
• à une obstruction <strong>de</strong>s voies biliaires (calcul, compression par cancer <strong>de</strong> la tête du<br />
pancréas)<br />
cf tableau<br />
Fin du cours “Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine et ictères ou jaunisses”<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes
MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />
Sujet normal<br />
Ictère hémolytique<br />
Ictère par déficit en GT<br />
(mdie <strong>de</strong> Gilbert)<br />
Ictère par hépatite ou<br />
cirrhose<br />
Ictère par obstruction<br />
complète<br />
Bilirubine Bilirubine Pigments biliaires Urobiline Stercobiline urinaire (coloration <strong>de</strong>s<br />
libre conjuguée<br />
urinaire<br />
selles)<br />
3 - 17 µmol/L 0 0 traces normales présence normale (selles colorées)<br />
➚➚➚➚ normal ou ±➚ 0 ➚➚➚ ➚➚<br />
➚➚ 0 0 traces normales normales ou faiblement décolorées<br />
➚➚ ➚➚ présence importante ➚➚➚ ➘selles ±décolorées<br />
normale ➚➚➚ ➚➚➚ traces ➘➘➘selles décolorées<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Piva<br />
LIPCOM<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes