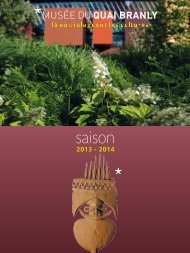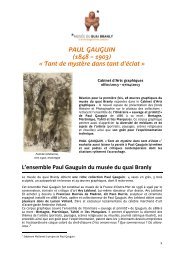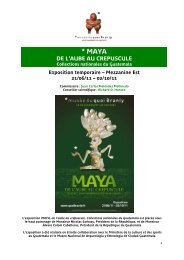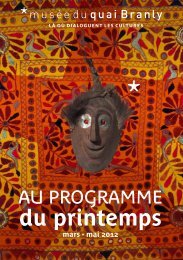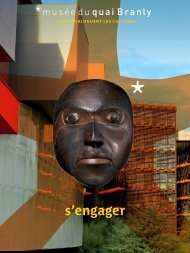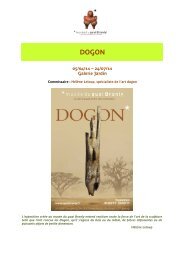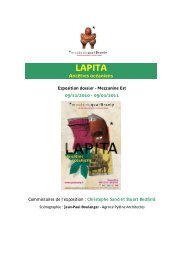Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly
Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly
Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
* ART ET AUTHENTICITE<br />
Le mot « art » qui figure dans le titre de l’exposition <strong>et</strong> <strong>du</strong> catalogue qui l’accompagne,<br />
n’est pas employé à la légère. Selon un cliché de l’anthropologie, de nombreuses<br />
cultures n’ayant pas de vocable pour désigner l’art, l’utilisation <strong>du</strong> mot serait suspecte.<br />
Ironiquement, même dans les langues européennes qui disposent d’un mot, il n’existe<br />
pas de consensus sur son sens <strong>et</strong> sa définition est régulièrement réévaluée. Avant le XX e<br />
Ironiquement, même dans les langues européennes qui disposent d’un mot, il n’existe<br />
pas de consensus sur son sens <strong>et</strong> sa définition est régulièrement réévaluée. Avant le XX<br />
siècle <strong>et</strong> avant le déplacement <strong>du</strong> champ de l’art sous l’eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> Modernisme, on parlait<br />
rarement d’« art » pour les types d’obj<strong>et</strong>s figurant dans c<strong>et</strong>te exposition. Les avantgardes<br />
européennes admirent les canons formels de l’ « art dit primitif ». Elles les<br />
intro<strong>du</strong>isirent dans leurs pro<strong>du</strong>ctions artistiques ce qui était aussi une façon d’exprimer<br />
leur respect pour leurs créateurs. Des artistes comme Pablo Picasso <strong>et</strong> Henry Moore, des<br />
critiques comme Roland Penrose <strong>et</strong> Roger Fry ont été inspirés par c<strong>et</strong> art ou l’ont célébré<br />
dans leurs propres œuvres. Ils n’étaient pas exempts de préjugés naïfs sur les « artistes »<br />
<strong>et</strong> les sociétés qui l’avaient créé, mais ils lui donnèrent une nouvelle dimension, ce qui<br />
obligea le public à le prendre de plus en plus au sérieux. Il n’est pas étonnant que<br />
Picasso, Moore <strong>et</strong> Penrose aient chacun possédé des moulages de la figure reli<strong>quai</strong>re de<br />
Rurutu, conservée au British Museum.<br />
e<br />
siècle <strong>et</strong> avant le déplacement <strong>du</strong> champ de l’art sous l’eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> Modernisme, on parlait<br />
rarement d’« art » pour les types d’obj<strong>et</strong>s figurant dans c<strong>et</strong>te exposition. Les avantgardes<br />
européennes admirent les canons formels de l’ « art dit primitif ». Elles les<br />
intro<strong>du</strong>isirent dans leurs pro<strong>du</strong>ctions artistiques ce qui était aussi une façon d’exprimer<br />
leur respect pour leurs créateurs. Des artistes comme Pablo Picasso <strong>et</strong> Henry Moore, des<br />
critiques comme Roland Penrose <strong>et</strong> Roger Fry ont été inspirés par c<strong>et</strong> art ou l’ont célébré<br />
dans leurs propres œuvres. Ils n’étaient pas exempts de préjugés naïfs sur les « artistes »<br />
<strong>et</strong> les sociétés qui l’avaient créé, mais ils lui donnèrent une nouvelle dimension, ce qui<br />
obligea le public à le prendre de plus en plus au sérieux. Il n’est pas étonnant que<br />
Picasso, Moore <strong>et</strong> Penrose aient chacun possédé des moulages de la figure reli<strong>quai</strong>re de<br />
Rurutu, conservée au British Museum.<br />
Moore passa de nombreuses heures dans le <strong>musée</strong>, dans les années 1920, à dessiner des<br />
sculptures de <strong>Polynésie</strong> <strong>et</strong> d’ailleurs. On qualifie désormais plutôt ces œuvres de<br />
« tribales » ou d’ « <strong>et</strong>hniques ». Quel que soit l’adjectif, le mot « art » est désormais<br />
solidement établi <strong>et</strong> vise moins à faire entrer ces obj<strong>et</strong>s dans des systèmes de<br />
classification européens qu’à honorer le savoir-faire <strong>et</strong> la créativité des <strong>Polynésie</strong>ns, au<br />
même titre que sont aujourd’hui honorées <strong>et</strong> valorisées les traditions artistiques <strong>du</strong><br />
monde entier. La plupart des définitions de l’art le relient à l’esthétique, à des<br />
jugements sur la beauté, le goût, la forme <strong>et</strong> l’habil<strong>et</strong>é de l’exécution. Chacun pourra<br />
remarquer le soin extrême <strong>et</strong> le raffinement avec lesquels les obj<strong>et</strong>s présentés dans<br />
l’exposition ont été exécutés. Les qualités plaisaient à la fois aux artisans <strong>et</strong> aux<br />
utilisateurs <strong>et</strong> elles étaient, en outre, garantes d’efficacité puisque ce soin devait<br />
honorer les dieux comme une forme de sacrifice propitiatoire. Une esthétique <strong>du</strong> divin<br />
était ici à l’œuvre.<br />
Qu’un obj<strong>et</strong> semble grotesque ou magnifique à l’œil occidental<br />
ne compte pas. Ces choses étaient fabriquées pour remplir une<br />
fonction, pour pro<strong>du</strong>ire des eff<strong>et</strong>s dans le monde – <strong>et</strong> c’est<br />
toujours le cas. Pour Alfred Gell (1998), l’art pris dans son sens<br />
interculturel le plus large n’est pas une affaire d’esthétique ni<br />
de sens, mais de pro<strong>du</strong>ction d’eff<strong>et</strong>s sur le milieu social, une<br />
capacité à agir. Alfred Gell concevait l’art comme un système<br />
d’action destiné à changer le monde plutôt qu’à être le support<br />
de propositions symboliques. De son point de vue, un obj<strong>et</strong><br />
d’art est l’équivalent d’une personne (ou d’un dieu). Il n’a ni<br />
besoin d’être « beau », ni de « symboliser » ou de « représenter<br />
» quoi que ce soit. Il matérialise ou rend sensible ce à quoi il<br />
renvoie tel un index. Par respect pour les images ou « idoles »,<br />
Gell rej<strong>et</strong>te la conception timorée qui en fait de simples<br />
« représentations » de la divinité, des auxiliaires de la piété <strong>et</strong><br />
affirme au contraire qu’ils sont des dieux – une instance<br />
physique <strong>du</strong> divin.<br />
Boîte à ossements en forme de personnage debout<br />
Îles Australes, Rurutu © British Museum, Londres<br />
14