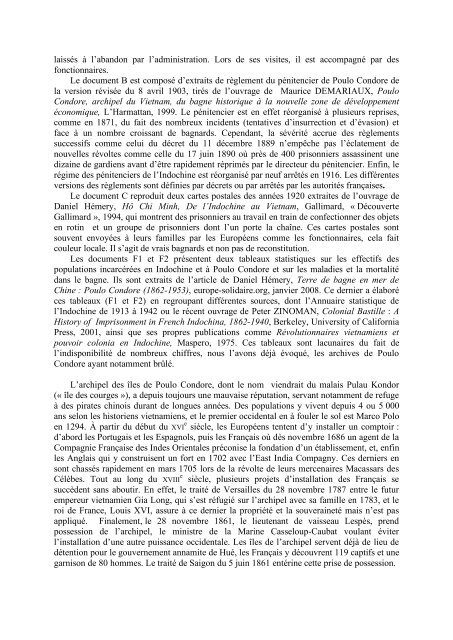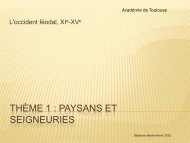dossier 3 faire regner l'ordre colonial - le site d'Histoire Géographie
dossier 3 faire regner l'ordre colonial - le site d'Histoire Géographie
dossier 3 faire regner l'ordre colonial - le site d'Histoire Géographie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
laissés à l’abandon par l’administration. Lors de ses vi<strong>site</strong>s, il est accompagné par des<br />
fonctionnaires.<br />
Le document B est composé d’extraits de règ<strong>le</strong>ment du pénitencier de Poulo Condore de<br />
la version révisée du 8 avril 1903, tirés de l’ouvrage de Maurice DEMARIAUX, Poulo<br />
Condore, archipel du Vietnam, du bagne historique à la nouvel<strong>le</strong> zone de développement<br />
économique, L’Harmattan, 1999. Le pénitencier est en effet réorganisé à plusieurs reprises,<br />
comme en 1871, du fait des nombreux incidents (tentatives d’insurrection et d’évasion) et<br />
face à un nombre croissant de bagnards. Cependant, la sévérité accrue des règ<strong>le</strong>ments<br />
successifs comme celui du décret du 11 décembre 1889 n’empêche pas l’éclatement de<br />
nouvel<strong>le</strong>s révoltes comme cel<strong>le</strong> du 17 juin 1890 où près de 400 prisonniers assassinent une<br />
dizaine de gardiens avant d’être rapidement réprimés par <strong>le</strong> directeur du pénitencier. Enfin, <strong>le</strong><br />
régime des pénitenciers de l’Indochine est réorganisé par neuf arrêtés en 1916. Les différentes<br />
versions des règ<strong>le</strong>ments sont définies par décrets ou par arrêtés par <strong>le</strong>s autorités françaises.<br />
Le document C reproduit deux cartes posta<strong>le</strong>s des années 1920 extraites de l’ouvrage de<br />
Daniel Hémery, Hô Chi Minh, De l’Indochine au Vietnam, Gallimard, « Découverte<br />
Gallimard », 1994, qui montrent des prisonniers au travail en train de confectionner des objets<br />
en rotin et un groupe de prisonniers dont l’un porte la chaîne. Ces cartes posta<strong>le</strong>s sont<br />
souvent envoyées à <strong>le</strong>urs famil<strong>le</strong>s par <strong>le</strong>s Européens comme <strong>le</strong>s fonctionnaires, cela fait<br />
cou<strong>le</strong>ur loca<strong>le</strong>. Il s’agit de vrais bagnards et non pas de reconstitution.<br />
Les documents F1 et F2 présentent deux tab<strong>le</strong>aux statistiques sur <strong>le</strong>s effectifs des<br />
populations incarcérées en Indochine et à Poulo Condore et sur <strong>le</strong>s maladies et la mortalité<br />
dans <strong>le</strong> bagne. Ils sont extraits de l’artic<strong>le</strong> de Daniel Hémery, Terre de bagne en mer de<br />
Chine : Poulo Condore (1862-1953), europe-solidaire.org, janvier 2008. Ce dernier a élaboré<br />
ces tab<strong>le</strong>aux (F1 et F2) en regroupant différentes sources, dont l’Annuaire statistique de<br />
l’Indochine de 1913 à 1942 ou <strong>le</strong> récent ouvrage de Peter ZINOMAN, Colonial Bastil<strong>le</strong> : A<br />
History of Imprisonment in French Indochina, 1862-1940, Berke<strong>le</strong>y, University of California<br />
Press, 2001, ainsi que ses propres publications comme Révolutionnaires vietnamiens et<br />
pouvoir colonia en Indochine, Maspero, 1975. Ces tab<strong>le</strong>aux sont lacunaires du fait de<br />
l’indisponibilité de nombreux chiffres, nous l’avons déjà évoqué, <strong>le</strong>s archives de Poulo<br />
Condore ayant notamment brûlé.<br />
L’archipel des î<strong>le</strong>s de Poulo Condore, dont <strong>le</strong> nom viendrait du malais Pulau Kondor<br />
(« î<strong>le</strong> des courges »), a depuis toujours une mauvaise réputation, servant notamment de refuge<br />
à des pirates chinois durant de longues années. Des populations y vivent depuis 4 ou 5 000<br />
ans selon <strong>le</strong>s historiens vietnamiens, et <strong>le</strong> premier occidental en à fou<strong>le</strong>r <strong>le</strong> sol est Marco Polo<br />
en 1294. À partir du début du XVI e sièc<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s Européens tentent d’y instal<strong>le</strong>r un comptoir :<br />
d’abord <strong>le</strong>s Portugais et <strong>le</strong>s Espagnols, puis <strong>le</strong>s Français où dès novembre 1686 un agent de la<br />
Compagnie Française des Indes Orienta<strong>le</strong>s préconise la fondation d’un établissement, et, enfin<br />
<strong>le</strong>s Anglais qui y construisent un fort en 1702 avec l’East India Compagny. Ces derniers en<br />
sont chassés rapidement en mars 1705 lors de la révolte de <strong>le</strong>urs mercenaires Macassars des<br />
Célèbes. Tout au long du XVIII e sièc<strong>le</strong>, plusieurs projets d’installation des Français se<br />
succèdent sans aboutir. En effet, <strong>le</strong> traité de Versail<strong>le</strong>s du 28 novembre 1787 entre <strong>le</strong> futur<br />
empereur vietnamien Gia Long, qui s’est réfugié sur l’archipel avec sa famil<strong>le</strong> en 1783, et <strong>le</strong><br />
roi de France, Louis XVI, assure à ce dernier la propriété et la souveraineté mais n’est pas<br />
appliqué. Fina<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong> 28 novembre 1861, <strong>le</strong> lieutenant de vaisseau Lespès, prend<br />
possession de l’archipel, <strong>le</strong> ministre de la Marine Casseloup-Caubat voulant éviter<br />
l’installation d’une autre puissance occidenta<strong>le</strong>. Les î<strong>le</strong>s de l’archipel servent déjà de lieu de<br />
détention pour <strong>le</strong> gouvernement annamite de Hué, <strong>le</strong>s Français y découvrent 119 captifs et une<br />
garnison de 80 hommes. Le traité de Saigon du 5 juin 1861 entérine cette prise de possession.