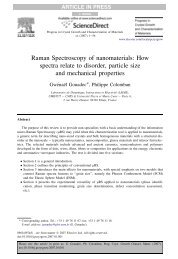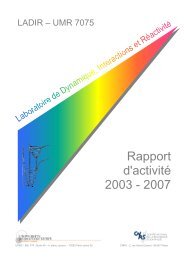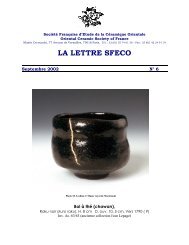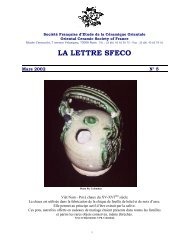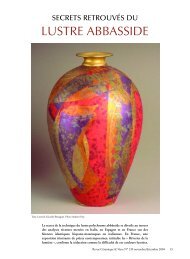THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ch. 1 Compositions des verres<br />
SiO 2 Al 2O 3 Na 2O K 2O CaO MgO Fe 2O 3 SiO 2/(0,5*Al 2O 3) Na+K+Ca*<br />
Verre bleu 68,8 1,2 15 2,8 6,9 4,4 0,9 114,67 15,80<br />
Glaçure<br />
bleue<br />
63,9 2,8 15,4 4,5 6,7 3,9 2,8 45,64 16,65<br />
* Na+K+Ca=0,5 x Na2O + 0,5 x K2O + CaO<br />
Tab. 1.1 : Compositions moyennes de verres et glaçures de Mésopotamie 1500 av. J.-C., en poids %,<br />
(Paynter S. et Tite M., 2001). Les deux dernières colonnes seront ultérieurement utilisées<br />
dans notre classification (paragraphe 1.2.1.b page 22).<br />
En effet, la quantité légèrement plus grande en Al 2O 3, K 2O et Fe 2O 3 dans la glaçure peut<br />
s’expliquer par une addition d’un peu d’argile pour faciliter lors de la mise en œuvre, le dépôt sur le<br />
tesson. Il est important de souligner un point rarement considéré dans la littérature : la<br />
composition finale d’un émail est toujours différente de celle avant mise en œuvre, une part<br />
significative des fondants (voir §1.1.3) s’évaporant ou diffusant dans le support argileux/siliceux,<br />
qui en retour enrichi l’émail en certains éléments comme l’aluminium, le fer, …<br />
Le quartzite et la stéatite ont été émaillés très tôt (Ellis L. et Newman R., 2005).<br />
Ces compositions ont un fort coefficient de dilatation thermique (par exemple le saut dû à la<br />
transition α/β du quartz à 573°C), comparable à celui des glaçures alcalines et des pâtes siliceuses,<br />
contrairement à la plupart des argiles cuites qui possèdent un coefficient d’expansion plus faible.<br />
Cela a pour conséquence de produire des fissures dans la glaçure après cuisson si la composition<br />
de l’émail n’est pas adaptée (Munier P., 1957 ; Paynter S. et Tite M., 2001). Le passage d’une<br />
céramique à corps siliceux à une céramique à corps argileux a donc nécessité une modification<br />
profonde de la composition de l’émail.<br />
b/ Vitraux et verres plats<br />
Avec l’apparition du verre soufflé (I er s. ap. J.-C.), deux techniques se sont développées à<br />
partir du IVe s. pour les produits « plats », utilisées et améliorées jusqu’au XIXe s. (Richet P.,<br />
2000) :<br />
- la technique du verre soufflé en plateau (« cive ») : le verrier souffle une bulle qu’il<br />
ouvrira à une extrémité pour obtenir, par la force centrifuge (mouvement très rapide de<br />
rotation), un disque plat pouvant atteindre jusqu’à 1,5 – 1,8 m de diamètre (Normandie,<br />
Angleterre) ;<br />
- la technique du verre soufflé en manchon : le verrier souffle une bulle cylindrique<br />
dont il coupera les deux extrémités avant de la fendre sur toute sa longueur. Le cylindre<br />
ouvert est ensuite placé dans un four de re-cuisson pour être complètement déroulé et<br />
former une feuille rectangulaire (Lorraine, Allemagne, Bohême, Venise).<br />
1.1.3 La coloration du verre<br />
Un verre/émail apparaît coloré, soit :<br />
- du fait qu’il recouvre un milieu coloré (pâte du tesson, dessin sous-couverte) ;<br />
- du fait de la dissolution d’ions chromophores (Cu + , Co 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 4+ , etc.)<br />
absorbant pour certaines longueurs d’onde de la lumière et donnant donc en réflexion la<br />
coloration non absorbée. Cette coloration reste peu « puissante » d’où l’appellation de<br />
« couleur transparente » donnée à ce type de technique. Elle convient parfaitement aux<br />
13