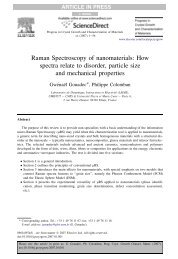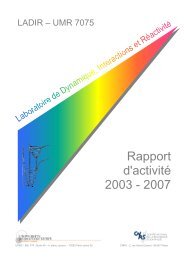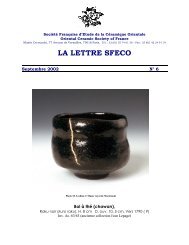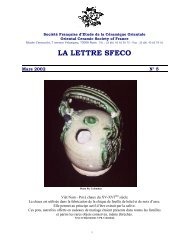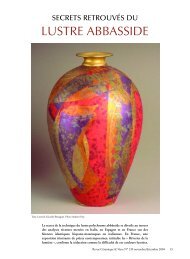THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ch. 1 Compositions des verres<br />
- deux rapports, 0,5 Na 2O + 0,5 K 2O + CaO (symbolisé par Na+K+Ca) et 0,5<br />
Na 2O + 0,5 K 2O + CaO + PbO (symbolisé par Na+K+Ca+Pb), représentant<br />
respectivement les teneurs en fondants “ioniques” et la totalité des fondants.<br />
Ces trois graphiques (fig. 1.8) présentent une « vue d’ensemble » des compositions<br />
collectées dans la littérature pour des verres/émaux produits entre 1650 av. J.-C. et le XVIe siècle,<br />
en Europe, aux Proche et Moyen-Orient. A titre de comparaison nous avons ajouté quelques<br />
compositions de porcelaines et des couvertes Vietnamiennes.<br />
Le graphique de la figure 1.8a met en évidence les techniques de fabrication homogènes. Il<br />
est clair que si les compositions pour un type d’objet présentent une même valeur de rapport, leur<br />
différentiation par des méthodes d’analyses de la liaison chimique comme la spectroscopie<br />
vibrationnelle sera peu efficace car l’analyse vibrationnelle mesure en fait la force (via le nombre<br />
d’onde) et le transport de charge instantané (via l’intensité des raies) des liaisons chimiques. Dans<br />
le cas contraire, où les données se situent sur une pente dans nos diagrammes, la technique<br />
d’analyse devrait être discriminante et d’autant plus que la pente sera forte.<br />
Une première zone correspond aux pâtes de porcelaines (Vietnamiennes) « super<br />
alumineuses » mais ayant une proportion vitreuse importante (Colomban Ph. et al., 2003a), la<br />
seconde englobe des glaçures opacifiées à l’étain (Tite M. S. et al., 1998), à l’antimoine (Mass J. L. et<br />
al., 1998), ainsi que des verres au natron (Henderson J., 2002). La troisième zone, concerne les<br />
verres islamiques aux cendres de plantes et mixtes (cendres et natron) du VIIIe au XIVe siècle<br />
(Henderson, 2002), composés d’environ 60 % en poids de silice et moins de 5% en poids d’oxyde<br />
d’aluminium. On peut déjà noter que les compositions Romaines ne présentent pas ou très peu de<br />
variations et seront donc a priori difficiles à différentier entre elles par diffusion Raman.<br />
Le graphique de la figure 1.8b classe les compositions selon la quantité de fondants<br />
« ioniques » (0,5 Na 2O + 0,5 K 2O + CaO). Plus la quantité de fondant est importante et plus la<br />
température de mise en œuvre est faible (cf. chapitre 2). L’ionicité de la liaison chimique ayant une<br />
grande importance sur l’intensité des composantes Raman, la considération des intensités sera a<br />
priori un critère important de discrimination. On distingue clairement :<br />
- les pâtes et couvertes de porcelaines cuites à haute température (>1200°C) qui ont<br />
peu de fondant (moins de 5%), les principaux étant l’oxyde de calcium (~ 1,9%) et de<br />
potassium (~ 2,3%) ;<br />
- les glaçures opacifiées à l’étain, entre 5 et 14% de fondant, principalement l’oxyde<br />
de sodium (~ 4%). D’abord les glaçures d’Europe avec les Majoliques (Pavia et Ferrara) et<br />
Hispano-moresque (Espagne), puis Islamiques (Egypte) et les Majoliques (Deruta, Urbino),<br />
et de nouveau Islamiques (Iran, IraK) ;<br />
- une troisième zone, des verres et émaux comparables où la teneur en fondant est<br />
variable. Cette zone concerne les verres du Moyen-Orient au natron (I er millénaire),<br />
islamiques à la cendre de plantes et mixte (VIIIe-XIIe siècles), romains opacifiés à<br />
l’antimoine et des émaux Islamiques du XIIIe-XVIe siècles.<br />
Dans le graphique de la figure 1.8c nous avons ajouté le plomb à la somme des fondants.<br />
On peut découper la courbe en trois zones. La première zone concerne les pâtes de porcelaines<br />
(fortement vitreuses) qui ne contiennent pas de plomb. Une seconde zone semblable à la troisième<br />
zone du graphique de la figure 1.8b. La dernière zone est composée essentiellement de glaçures<br />
d’Europe et du Proche-Orient opacifiées à l’étain (Tite M. S. et al., 1998), contenant en moyenne<br />
30% d’oxyde de plomb.<br />
21