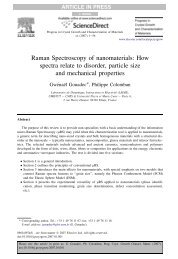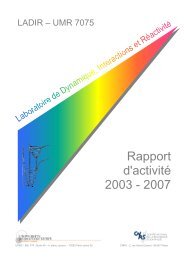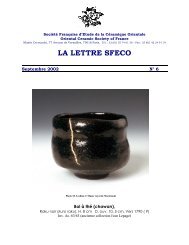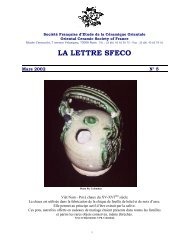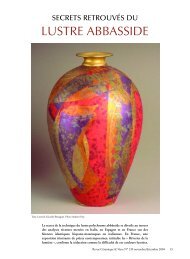THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ch. 2 Raman des silicates amorphes<br />
verres de confinement de résidus nucléaires (Li H. et al., 2000), les porcelaines vietnamiennes (Liem<br />
N. Q. et al., 2000) et l’étude des propriétés vibrationnelles de la silice (Zotov N. et al., 1999). C’est<br />
cette approche que nous utiliserons.<br />
Nous discuterons dans un premier temps de la structure et de la « polymérisation » des<br />
silicates cristallins et amorphes. La seconde partie sera consacrée à la signature Raman des silicates.<br />
Et enfin, dans une dernière partie, nous comparerons les signatures Raman obtenues selon diverses<br />
configurations instrumentales.<br />
Au laboratoire nous disposons de plusieurs spectromètres Raman, différents par leur<br />
dispositif d’illumination et de collection de la lumière (« micro » / « macro »), leur laser d’excitation<br />
et les longueurs d’ondes produites, leur mobilité, … (les caractéristiques de chacun sont données<br />
en annexe 5). Nous discuterons, après traitement du spectre, des distorsions induites par le<br />
spectromètre utilisé pour un même échantillon.<br />
Une méthode de traitement du spectre sera définie pour extraire les paramètres les plus<br />
pertinents. Nous montrerons que ces outils permettent de classer les verres silicatés selon leur<br />
composition, leur température de mise en œuvre et donc dans certains cas leur origine ou époque.<br />
Nous verrons quels sont les outils Raman les plus discriminants en allant de classements simples<br />
jusqu’aux méthodes plus complexes utilisant l’analyse multivariée.<br />
2.1 Les silicates<br />
L’unité structurale de base des silicates, est le tétraèdre SiO 4 formé par l’association de<br />
quatre atomes d’oxygène de gros diamètre (1,2 Å) autour d’un petit atome de silicium (0,56 Å). Cet<br />
assemblage possède quatre valences libres qui peuvent être utilisées, soit pour une polymérisation<br />
avec d’autres tétraèdres, soit pour être saturées par des cations proches afin de constituer un édifice<br />
électriquement neutre. On utilisera la notation Q n (n indique le nombre d’atomes d’oxygènes<br />
pontants par tétraèdre) pour décrire les configurations d’un verre silicaté. Le tétraèdre isolé sans<br />
oxygène pontant sera l’unité Q 0 et à l’extrême un tétraèdre complètement lié au réseau via 4 atomes<br />
d’oxygènes pontants sera appelé Q 4.<br />
2.1.1 Classification des silicates cristallins<br />
La liaison Si-O (distance Si-O : 1,66 Å) est très forte (fusion de SiO 2 à environ 1740°C) et<br />
très covalente. Elle rend l’entité (SiO 4) 4- très stable : même à l’état liquide, les silicates fondus<br />
restent fortement polymérisés. En conséquence, le tétraèdre SiO 4, base de l’architecture des<br />
silicates, est donc aussi une unité vibrationnelle bien individualisée.<br />
Chaque classe de silicates cristallins peut être spécifiée par son type de coordinance : Q 0,<br />
Q 1, Q 2, Q 3 et Q 4 (figs. 2.1 à 2.6).<br />
Les nésosilicates possèdent des tétraèdres (SiO 4)<br />
isolés, leur charge négative étant compensée par des<br />
cations isolés.<br />
Ce type de coordinence est appelé Q 0.<br />
36<br />
Fig. 2.1 : Tétraèdre « isolé » (SiO 4) 4- .