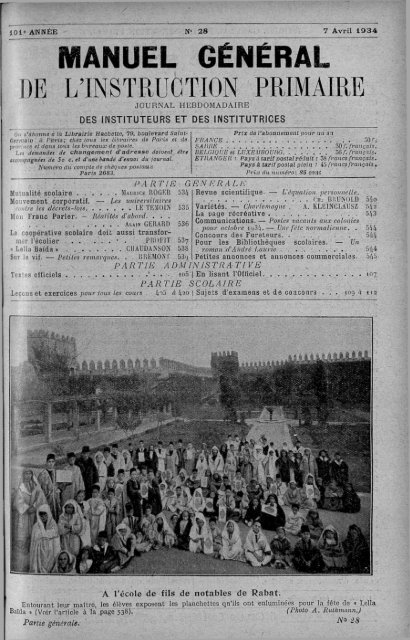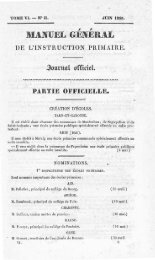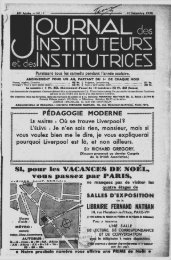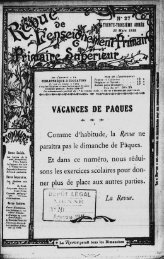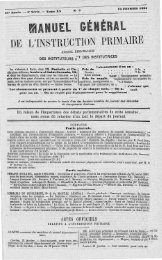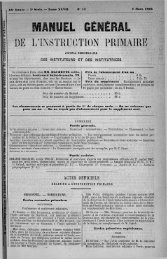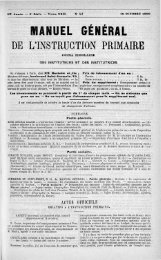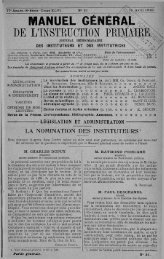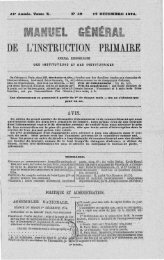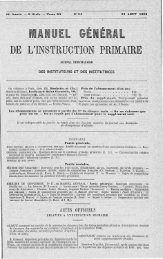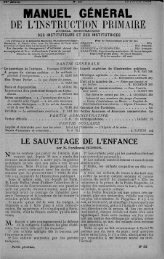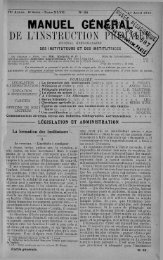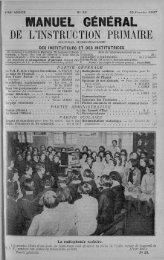MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
101« ANNÉE N' 28 7 Avril 1934<br />
<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong><br />
<strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />
JOURNAL HEBDOMADAIRE<br />
<strong>DE</strong>S INSTITUTEURS ET <strong>DE</strong>S INSTITUTRICES<br />
On s'abonne à la Librairie Hachette, 79, boulevard Saint-<br />
Germain à Paris; chez tous les libraires de Paris et de<br />
province et dans tons les bureaux de poste.<br />
Les demandes de changement d'adresse doivent être<br />
accompagnées de 5o c. et d'une bande d'envoi du journal.<br />
Numéro du compte de chèques postaux<br />
Paris 2683.<br />
FRANCE<br />
S Ali RE<br />
Prix de l'abonnement pour un an<br />
ZO f.<br />
50/V français.<br />
RELGIQIJE et LUXEMBOURG 56 f. français.<br />
ETRANGER î Pays à tarif postal réduit : 5S francs français.<br />
Pays à tarif postal plein : io francs français *<br />
Prix du numéro: 85 cent<br />
PARTIE GENERA LIC<br />
Mutualité scolaire . . . . . . MAURICE ROGER<br />
Mouvement corporatif. — Les universitaires<br />
contre les décrets-lois LE TEMOIN<br />
Mon Franc Parler. - Réalités d'abord. . . .<br />
. . . AI.AIN GERARD<br />
La coopérative scolaire doit aussi transformer<br />
l'écolier • . PROFIT<br />
« Lella Baïda » CIIAUDANSON<br />
Sur le vif. — Petites remarques. . . IÎR1ÏM0NI'<br />
534<br />
535<br />
536<br />
53y<br />
538<br />
53 c)<br />
Revue scientifique. — L'équation personnelle.<br />
C11. BlfUiSOI.D<br />
Variétés. — Cliarlewagne . A. KLE1NCLÀUSZ<br />
La page récréative . . .<br />
Communications. — Postes vacants aux colonies<br />
pour octobre m3i.— line féte normalienne. .<br />
Concours des Fureteurs<br />
Pour les Bibliothèques scolaires. — Un<br />
roman xl'André l.aUric . . . . . . . .<br />
Petites annonces et annonces commerciales.<br />
54o<br />
542<br />
543<br />
544<br />
544<br />
544<br />
545<br />
PA R T1E /I DM INJSTRA- TA VE<br />
Teites officiels ' . . . io5 | En lisant l'Officiel<br />
107.<br />
PARTIE SCOLAIRE<br />
leçons et exercices pour tous tes cours /p5 à 420 ] Sujets d'examens et de concours<br />
A l'école d e fils de notables de Rabat.<br />
Entourant leur maître, les élèves exposent les planchettes qu'ils ont enluminées pour la fête de' « Lella<br />
Baïda » (Voir l'article à la page 538). (Photo A. Rutkniann.)<br />
Partie générale. 28
534<br />
Mutualité scolaire.<br />
<strong>DE</strong>S sociétaires au nombre de 870 094 en<br />
1913-1914, de 762431 en 1920-1921, de<br />
697604 en 1930-1931, de 656001 en 1932-1933,<br />
ces chiffres disent, assez la baisse continue de<br />
la Mutualité scolaire. Il en est de cette institution<br />
comme de toutes celles qui ont derrière<br />
elles un passé déjà long. L'habitude, engendre<br />
l'indifférence et l'intérêt se porte sur les créations<br />
nouvelles. Le temps n'est plus où Cavé et<br />
Edouard Petit soulevaient l'enthousiasme des<br />
maîtres en révélant ce moyen alors quasi unique<br />
de développer le sens social chez les écoliers.<br />
A ce motif s'en ajoutent d'autres, inspirés<br />
par le sentiment de l'utilité. Les avantages<br />
qui résultent de l'affiliation à la Mutualité<br />
scolaire semblent de peu d'importance aux<br />
familles et, ce qui est plus grave, l'application<br />
généralisée de la loi sur les assurances sociales<br />
apparaît comme dispensant de tout effort<br />
connexe de prévoyance.<br />
Nos collaborateurs ont entrepris à maintes<br />
reprises de dissiper cette double apparence.<br />
Après eux, je rappellerai que l'indemnité journalière<br />
de maladie n'est demeurée au taux<br />
d'avant guerre que là où, malgré la dévalorisation<br />
du franc, la cotisation n'a pas été augmentée.<br />
Ailleurs, elle a pu être élevée de 0,50 à<br />
3 francs. Je rappellerai en outre que cette indemnité<br />
est loin d'être négligeable, puisque les<br />
assurances sociales ne remboursent intégralement<br />
ni les frais de médecin ni les frais de pharmacien.<br />
Très justement, le législateur n'a pas<br />
voulu décharger complètement l'assuré du soin<br />
de prévoir. Dans un bulletin de V Union nationale<br />
des Mutualités scolaires ', on relève des<br />
exemples suggestifs. La maladie d'un enfant<br />
(30 jours, 4 visites de médecin à 20 francs,<br />
50 francs de pharmacie) laisse à la charge du<br />
père, assuré social, une somme de 49 f. 10. Que<br />
l'enfant soit mutualiste, il recevra 30 francs, si<br />
l'indemnité journalière est de 1 franc, correspondant<br />
à une cotisation annuelle de 10 francs,<br />
75 francs si l'indemnité journalière est de<br />
2 fr. 50, correspondant à une cotisation<br />
annuelle de 20 francs.<br />
Ce n'est pas seulement en cas de maladie<br />
que la Mutualité scolaire ajoute ses avantages<br />
propres à ceux des assurances sociales. Pour<br />
obtenir la retraite entière, les assurés sociaux<br />
doivent avoir effectué des versements complets<br />
pendant 30 années. Dans ce calcul, la loi<br />
stipule que, pour les assurés sociaux, chaque<br />
année de versement, avant 16 ans, dans une<br />
mutualité scolaire, comptera pour une demiannée<br />
d'assurances sociales.<br />
1. Nov. 1933,. rue Récamïer. Paris.<br />
TOUT CELA est-il suffisamment connu ? Nous<br />
ne le croyons pas. Trop souvent l'enfant<br />
verse sa cotisation, d'un geste machina!,<br />
et sans se rendre compte qu'il travaille pour<br />
lui-même en même temps que pour les au 1res.<br />
De là sans doute tant de livrets abandonnés,<br />
alors que, de plus en plus, le pont est établi<br />
entre les mutualités d'enfarits et les mutualités<br />
d'adultes et que la loi sur les assurances sociali s<br />
a tout prévu pour que les versements ne soirnt<br />
pas perdus.<br />
On ignore aussi communément les au Ires<br />
bienfa ts de la mutualité scolaire, les œuvres<br />
qu'elle a permis de créer, soit directement,soit<br />
en collaboration : colonies scolaires, préventoriums,<br />
etc.,. Étl'on ne mesure pas assez non<br />
pl is les effets d'une éducation qui, poursuivipendant<br />
la scolarité entière, habituerai d'enfant<br />
à préparer, certes, son propre avenir, mais aussi'<br />
à comprendre le sens de l'entr-'aiiic.<br />
La valeur de la Mutualité scolaire reste<br />
donc intacte, accrue même par la loi des assurances<br />
sociales. Les deux institutions se complètent.<br />
Comme le disait M. Strauss, l'apôtre<br />
toujours ardent de la solidarité : « Pour que les<br />
assurances sociales fonctionnent bien, il faut<br />
une conscience mutualiste que justement la<br />
Mutualité scolaire a pour but de créer ».<br />
Et de même le rôle de la Mutualité scolaire<br />
n'a pas été limité par le dévêloppement<br />
des Coopératives, des Sous des Ecoles ou<br />
l'œuvre des Pupilles de l'École publique.<br />
Parmi ces organismes si bienfaisant , en de-;<br />
hors d'un domaine commun, la Mutualité sco-;<br />
laire a son champ d'action réservé : participation<br />
à l'assurance maladie et à l'assurance<br />
retraite. La législation actuelle ajoute des]<br />
arguments nouveaux à ceux de ses premiers<br />
artisans. Il n'en est que plus opport n de restaurer<br />
l'esprit d'autrefois.<br />
Beaucoup d'ailleurs ne l'ont pas laissé<br />
perdre. J'ai assisté jadis à une réunion de la<br />
grande Mutualité landaise, j'assiste régulièrement<br />
à l'assemblée plénière de VUnion nalionale<br />
des Mutualités scolaires publiques. Toujours<br />
je retrouve la foi qui animait Edouard<br />
Petit, lorsqu'en 1916, à Milan, — la dernière<br />
occasion que j'eus de l'entendre, —- il développait<br />
ce thème qui lui était cher : l'éducation,<br />
sociale par la Mutualité scolaire. La Mutualité<br />
scolaire est obligatoire dans les écoles italiennes.<br />
Je ne souhaite pas qu'elle le devienne<br />
en France. Pour contribuer à ' duc alion, elle<br />
doit demeurer facultative. Mais n'est-i pas<br />
regrettable qu'une institution aussi utile ait<br />
autant perdu de son ancienne prospérité ?<br />
MAURICE ROGEH.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S G GlLLARD- Cent Dictées sur / CR , h "( e ' s , 300 q ? e £l 0 ",f4.20<br />
vi. v*iL»L*Ai\.u vi/iu empruntés a/a vie rurale, avec réponses.
PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 535<br />
MOUVEMENT CORPORATIF<br />
LES UNIVERSITAIRES CONTRE LES DÉCRETS-LOIS<br />
Dans le mouvement de protestation de<br />
tous ceux qui sont atteints par les économies<br />
lixces dans les décrets-lois, l'Université figure<br />
au premier rang. C'est qu'en effet, les conséquences<br />
des mesures prises par le Conseil des<br />
ministres, dans la journée du 29 mars seront<br />
préjudiciables non seulement au personnel<br />
ensei-iiiaïft tout entier, mais encore au service<br />
de l'enseignement tous les degrés.<br />
Quelles sont ces mesures ?<br />
I n premier train de plus de 2 milliards<br />
d'économies, par la suppression de 10 % de<br />
l'effectif des agents de l'Etat, sans distinction<br />
entre les services. M. Berthod rejoignait dans<br />
cette circonstance toutes les associations et<br />
tous les syndicats qui groupent les fonctionnaires<br />
de l'Université. Ce n'est pas dans une<br />
administration où les créations d'emplois devraient<br />
être reconnues automatiquement qu'il<br />
faillirait parler de suppressions de postes.<br />
Parle même train,d'importantes économies,<br />
ion parle de 700 millions] seraient obtenues<br />
avec une réduction de 5 à 10% des traitements,<br />
et cette fois sans abattement à la base, ni<br />
exonération. On prévoit également plus de<br />
G00 millions d'économies par la suppression<br />
des cumuls, offices, etc...<br />
Puis viennent les sacrifices imposés aux<br />
retraités. D'après ce que nous savons des<br />
intentions des services financiers, il ne s'ag -<br />
rail, pas seulement d'une diminution momentanée<br />
des pensions, mais d'un bouleversement<br />
profond de la loi de 1924; au lieu des trois<br />
quarts du traitement moyen, on envisagerait<br />
!a moitié seulement; d'autre pa t, e p.afond<br />
serait abaissé de 45000 fr. £ 35000 fr. De"<br />
même serait modifié le régime des" majorations<br />
aux fonctionnaires ayant fait la guerre.<br />
Rien n'est encore décidé pour les pensions<br />
des combattants, mais ce n'est que partie<br />
remise, et bientôt nous connaîtrons sans doute<br />
encore, sur ce chapitre, d'importar.tes réductions.<br />
Ces propositions, connues en partie avant<br />
le départ en vacances du personnel enseignant,<br />
devaient naturellement provoquer une vive<br />
reaction des intéressés. A Paris, un meeting<br />
organisé par les confédérés et les unitaires<br />
avait pour conclusion l'ordre du jour suivant :<br />
Les universitaires, réunis le 26 mars 1934 à la<br />
Bourse du Travail, sur convocation des syndicats<br />
conlédérés et unitaires de l'Enseignement de la<br />
Seine, "<br />
S élèvent contre les décrets-lois, contre toute<br />
ftninution des traitements et indemnités des<br />
fonctionnaires et agents des services publics comme<br />
les salaires ouvriers déjà scandaleusement comprimés;<br />
Protestent contre toute économie faite sur le .<br />
budge t, dé jà lamentablement insuffisant, de l'éducation<br />
nationale;<br />
Affirment leur volonté de défendre les organisations<br />
eL les libertés ouvrières contre les attaques<br />
des forces de réaction, qu'elles se réclament de la<br />
légalité actuelle ou qu'elles s'inspirent directement<br />
des fascismes allemandj italien ou autrichien ;<br />
Se solidarisent entièrement avec la classe<br />
ouvrière organisée au sein de laquelle ils entendent<br />
mener l'action quotidienne comme la lutte décisive ;<br />
Se félicitent de l'accord réalisé entre les deux<br />
organisations syndicales dont ils veulent respecter<br />
spontanément la discipline dans l'action;<br />
S'engagent à travailler dans tous les arrondissements<br />
de Paris, dans toutes les communes de<br />
banlieue, au rapprochement fraternel des travailleurs<br />
manuels et intellectuels de toutes tendances<br />
pour poursuivre la lutte.<br />
De son côté, le Cartel des services publi< s<br />
communiquait à la presse, le 27 mars :<br />
Le Cartel confédéré des services publies s'est<br />
réuni au siège, de la C. G. T. à 14 h. 30, sous la<br />
présidence de Lenoir, secrétaire administratif de<br />
la C. G. T.<br />
Il a pris connaissance des intentions du gouvernement<br />
qui résultent tant du discours du président<br />
du Conseil que des renseignements recueillis,<br />
intentions qui se traduiraient par une forte réduction<br />
des traitements, une compression massive<br />
des effectifs aboutissant à la mise en retraite<br />
anticipée de 80 000 agents...<br />
Le Comité central proteste énergiquement<br />
contre l'injustice de tels projets qui imposent de<br />
nouveaux et lourds sacrifices aux agents des<br />
services publics et plus particulièrement aux petits<br />
et qui auront pour effet de désorganiser les services<br />
publics, mais qui sont, muets sur les moyens de<br />
résoudre la crise économique et de mettre fin au<br />
scandale des fraudes fiscales.<br />
.11 dénonce, une fois . de plus . la politique de<br />
déflation suivie par le gouvernement, politique qui<br />
a fait faillite dans tous-les pays qui l'ont déjà<br />
expérimentée et qui aboutîf-a, automatiquement à<br />
une aggravation de la crise et à un accroissement<br />
de la misère dans le pays.<br />
Le Cartel décide, comme premier moyen de<br />
protestation, d'organiser un meeting vendredi soir<br />
30 mars, à la Bourse du Travail, et d'alerter tous<br />
les adhérents de ses fédérations.<br />
Aussitôt les. syndicats des transports en<br />
commun -— T.C.R.P. — et ceux de l'éclairage<br />
et des forces motrices — Gaz et Électricité —<br />
prenaient leurs dispositions pour appuyer le<br />
mouvement du Cartel.<br />
C'est se dementle mercredi 4avril que seront<br />
définitivement adoptées, au cours d'un Conseil<br />
des ministres, les mesures proposées par le<br />
Gouvernement. Le texte des décrets paraîtra<br />
vraisemblablement le lendemain au Journal<br />
officiel. L E TÉMOIN.<br />
^rrincAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. j. LE BAS. Cent Dictées 4.60
536 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />
MON FRANC PARLER<br />
RÉALITÉS D'ABORD<br />
LE vent souffle en tempête sur l'Administration.<br />
Le bâtiment sera-t-il emporté<br />
? Ou les dégâts se Borneront-ils à<br />
quelques tuiles arrachées, à quelques volets<br />
mis à mal ?<br />
Pour l'instant, le vent fait rage et il est<br />
bien difficile de se prononcer sur le sort que<br />
le Destin réserve au bâtiment administratif<br />
et à ses habitants. Vaut-il mieux qu'il soit<br />
jeté bas ou est-il possible de le réparer ?<br />
Affaire de tempérament. Affaire aussi d'âge.<br />
Les préférences de la jeunesse vont toujours<br />
au neuf, celles de l'âge mûr au vieux neuf.<br />
En attendant, quelle magnifique occasion<br />
poui' les constructeurs en chambre de donner<br />
libre essor à leur folle imagination ! Qui<br />
n'a pas son petit projet de réforme ? Les<br />
amateurs s'en donnent à cœur joie. Pour<br />
sacrifier à la mode du jour, ne faut-il pas<br />
à tout prix trouver du nouveau ?<br />
L'enseignement ne pouvait naturellement<br />
pas rester à l'abri de la vague de renouvellement.<br />
Depuis la guerre, cette vague déferle sur<br />
ses plates-bandes avec un entrain qui commence<br />
toutefois à faiblir et qui, sans la crise<br />
financière; tendrait sans doute à s'apaiser<br />
complètement.<br />
Mais nos trois enseignements sont solidement<br />
bâtis sur du roc et l'enseignement<br />
primaire n'est pas le moins bien conçu pour<br />
résister à l'effort des hommes et du temps.<br />
Cependant, il semble que ce soit surtout sur<br />
lui que nos réformateurs aient voulu s'acharner.<br />
Si j'en crois leurs assurances, les écoles<br />
normales représenteraient le point faible de<br />
la construction.<br />
TL n'entre certes pas dans mon intention de<br />
I traiter aujourd'hui la question dans toute<br />
son ampleur. Le débat est ouvert, d'ailleurs,<br />
depuis de nombreuses années. Et il n'est pas<br />
près de se clore, si j'en juge d'après la direction<br />
dans laquelle il se développe. Nous aurons<br />
fréquemment l'occasion d'y revenir : la<br />
question est si complexe !<br />
Pour aujourd'hui, je voudrais seulement<br />
envisager un côté particulier du problème,<br />
à'propos d'un nouveau projet les concernant<br />
que M. Maurice Robert, député, vient de<br />
déposer sur le bureau de la Chambre sous<br />
la forme d'une proposition de loi « avant<br />
pour objet d'intégrer les écoles normales<br />
primaires d'instituteurs et d'institutrices dans<br />
l'école unique ». Les intentions de l'auteur<br />
ne sont pas jci en cause. Ses sentiments à<br />
l'égard des écoles normales sont connus.<br />
II ne leur veut que du bien. Trop de bien I<br />
mcme. E t c'est sur ce point que je voudrais<br />
lui chercher chicane, négligeant volontairement<br />
les autres dispositions de sa proposition<br />
qui, par ailleurs, soulèvent également d'intéressantes<br />
controverses.<br />
M. Maurice Robert veut réduire les écoles<br />
normales à un rôle strictement professionnel.<br />
La durée des études y serait ramenée<br />
à deux ans « et les écoles normales pouvant<br />
désormais satisfaire complètement aux besoins<br />
du service, nul ne pourra être instituteur<br />
public ou institutrice publique sans avoir<br />
été élève-maître ou élève-maîtresse d'une<br />
école normale ».<br />
INSI, l'intention de l'auteur est très<br />
A claire : seuls, les élèves des écoles<br />
normales auront accès aux fonctions d'instituteur.<br />
Les suppléants et les intérimaires<br />
doivent abandonner tout espoir d'entrer<br />
jamais dans les cadres. Nous revenons au<br />
régime de la loi du 30 avril 1921, aggravé.<br />
A cette époque, en effet, le législateur avait<br />
prévu des dispositions spéciales en faveur,<br />
des suppléants. Une porte de service leur<br />
était laissée ouverte. Ils conservaient la<br />
possibilité d'être titularisés après un stage<br />
d'un an dans une école normale.<br />
M. Maurice Robert se montre impitoyable<br />
à leur égard. Les écoles normales disposet-il<br />
dans son article premier, « se recrutent<br />
dans l'enseignement du second degré. » Et<br />
plus loin, à l'article 5 : «Les candidats à<br />
l'école norma e âgés de 17 à 20 ans»... Rien<br />
pour les suppléants. Pas même une échelle<br />
de corde n'est prévue pour les hisser à l'intérieur<br />
du bâtiment.<br />
Cependant, il faut se résigner à les laisser<br />
y entrer. Impossible d'échapper au dilemme :<br />
le service des suppléances sera exclusivement<br />
assuré par les élèves sortant des écoles normales,<br />
perspective peu agréable pour nos<br />
normaliens, ou il continuera à être confié<br />
à un personnel de même origine qu'actuellement,<br />
et le recrutement en serait rapidement<br />
tari si ce personnel ne pouvait compter sur<br />
une titularisation plus ou moins lointaine.!<br />
Quant à l'astreindre à un stage dans une<br />
école normale, l'expérience de 1921 a démontre<br />
la difficulté d'organiser et d'imposer cette<br />
obligation.<br />
Sur ce point, la proposition Robert devra<br />
donc être modifiée. En théorie, elle ne peut<br />
que rallier tous les suffrages. Mais il y a | oin<br />
de la théorie à la réalité. Et c'est exclusivement<br />
de réalités que se nourrit une bonne<br />
administration. ALAIN GÉRARD.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. \i Chants scolaires par A.DANGUEUGER et J. BONNET, 'BROCHÉ'.' 3.60
PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 537<br />
La coopérative scolaire doit<br />
aussi transformer l'écolier.<br />
ES années passent. Les souvenirs amassés, au<br />
L cours de la vie s'estompent peu à peu;les<br />
amitiés demeurent. Le bien que, grâce à elles,<br />
l'on a pu faire ensemble porte ses fruits et,<br />
quoi qu'on pense de ces fruits, n'eussent-ils<br />
que la valeur d'un grain de sable, rien n'en<br />
sera perdu. Infime est le travail de la fourmi;<br />
néanmoins la fourmilière s'élève et se creuse<br />
pour le bonheur de la tribu. C'est de menus<br />
efforts incessamment répétés par l'ensemble<br />
des humains qu'est né et que se continue le<br />
progrès de l'humanité. Ainsi, dans les classes<br />
organisées socialement par nos amis, quelque<br />
chose reste encore qui durera : c'est, avec des<br />
souvenirs nombreux et d'autant plus vivaces<br />
qu'ils dateront de l'enfance, une leçon ineffaçable<br />
dans le cœur des jeunes gens d'aujourd'hui<br />
: la nécessité de l'union par laquelle on<br />
triomphe de l'apathie générale et de la mauvaise<br />
fortune, une espérance autant qu'un<br />
exemple.<br />
Cette espérance nouvelle qu'à la coopérative<br />
les faits n'ont jamais démentie, sera une force<br />
pour la vie. Elle y est soigneusement entretenue.<br />
Maîtres et élèves continuent les devanciers.<br />
A travers les générations successives<br />
d'écoliers, le flambeau passe de main en main<br />
et les maîtres veillent afin que la flamme soit<br />
toujours haute et claire. Si, après quinze ans,<br />
près de douze mille instituteurs et institutrices<br />
en France et aux colonies nous ont suivi, si de<br />
l'étranger nous viennent des encouragements<br />
précieux, c'est, sans doute, parce qu'il y a<br />
dans la petite coopérative scolaire quelque<br />
chose de particulièrement intéressant.<br />
E qui a intéressé tout d'abord, c'est la prospé-<br />
^ rité matérielle d'une école jadis dépourvue<br />
de tout et qui est maintenant visiblement<br />
enrichie. Un matériel d'enseignement et u n<br />
outillage collectif, une installation améliorée,<br />
a la fois plus propre et plus riante : voilà ce<br />
que, sagement dirigés par leurs maîtres, les<br />
petits coopérateurs ont p u lui procurer euxmêmes.<br />
Partout ce premier stade est accompli;<br />
et les ressources créées chaque année, plus que<br />
suffisantes pour l'entretien, peuvent déjà, en<br />
maint endroit, servir en partie à d'autres fins.<br />
Mais ce côté... intéressant de la question,<br />
nous l'avons dit bien des fois, n'est qu'un<br />
moyen. Le but véritable est d'autre portée.<br />
Déjà par le fonctionnement régulier de la<br />
petite association, c'est l'esprit d'union et<br />
c'est l'esprit d'entr'aide qui se sont éveillés<br />
dans les âmes. Par des actes quotidiens, des<br />
habitudes ont été créées et c'est là une initiation<br />
précieuse à la vie collective. Le selfgovernment<br />
y trouve son compte aussi, dans<br />
la confiance accordée et dans la liberté concédée,<br />
en certains domaines, aux petits coopérateurs.<br />
Et c'est l'éducation tout entière qui,<br />
par la coopérative, prend sa place à côté et<br />
au-dessus de l'instruction : éducation morale<br />
et sociale par l'esprit nouveau introduit dans<br />
la classe, éducation intellectuelle par l'emploi<br />
facilité des méthodes actives, éducation esthétique<br />
par le travail manuel mis à la portée des<br />
enfants, éducation sous tous ses aspects !<br />
Mais pour que soient réalisés ces heureux<br />
résultats, il faut faire vivre réellement la<br />
coopérative. Si elle ne fonctionne que par<br />
à-coups, si l'effort n'est donné qu'en vue des<br />
résultats pécuniaires, n'est-il pas à craindre<br />
que le but véritable ne soit oublié ? Une<br />
classe propre, embellie, abondamment pourvue,<br />
c'est déjà quelque chose de nouveau et<br />
de précieux; mais des élèves formés aux<br />
bonnes habitudes d'esprit et de cœur, c'est<br />
tout ; avec les moyens créés par eux, il convient<br />
de s'occuper de cette fin dès qu'on le peut. La<br />
coopérative n'a pas été créée seulement pour<br />
procurer à l'école les ressources qui lui manquaient,<br />
mais aussi pour amorcer, par la<br />
gestion et l'utilisation de ces ressources, une<br />
œuvre plus haute. Qu'on se dise bien que la<br />
petite association qui partout a brillamment<br />
parcouru le premier stade de l'acquisition des<br />
moyens, doit partout, maintenant, entrer<br />
résolument dans le deuxième stade : celui de<br />
l'emploi régulier des moyens d'éducation<br />
acquis ou créés.<br />
La coopérative scolaire a transformé matériellement<br />
l'école; n'oublions pas qu'elle doit<br />
aussi et surtout transformer l'écolier.<br />
PROFIT.<br />
l% T a&tre O f f i c e g r a t u i t d e ^acstitees. Nous rappelons que noire Office de vacances esl ouvert depuis le 2G mars : il a pour but de mettre<br />
directement en relations ceux de nos abonnés qui recherchent un logement pour une villégiature de<br />
.vacances et ceux qui désireraient louer, en août et septembre, une partie de leur appartement ou de leur<br />
maison.<br />
Nous engageons nos abonnés à nous faire parvenir dès que possible leurs offres de location (Voir<br />
'6 numéro du 24 mars, p. 501.)
538<br />
ce Lella Baïda ».<br />
LELLA BAÏDA est une charmante fête<br />
coranique célébrée vers la fin du mois<br />
de Ramadan consacré au jeûne religieux. Elle<br />
est marquée par la remise aux jeunes élèves<br />
du msid (école coranique) de planchettes enluminées<br />
exécutées au cours de ce mois de jeûne.<br />
Dès ies premiers jours clu mois de Ramadan,<br />
chaque élève apporte un œuf et un citron au<br />
fquih du msid (maître indigène enseignant le<br />
Coran). Souvent même, il y joint quelque<br />
argent.<br />
Œufs et citrons servent en partie à préparer<br />
les planchettes et les couleurs, mais la grosse<br />
part servira à rendre plus substantielle la<br />
traditionnelle harira du fquih (soupe qui est<br />
la première nourriture cuisinée absorbée après<br />
le coup de canon du soir annonçant quotidiennement<br />
la rupture du jeûne).<br />
L'argent servira à acheter les ingrédients<br />
divers employés : papier, colle, poudre colorante,<br />
roseaux taillés, etc...<br />
LE fquih commence tout d'abord à j)réparer<br />
les planchettes. Il utilise pour cela,<br />
non pas une planchette de bois, mais simplement<br />
des feuilles de carton qu'il recouvre d'une<br />
belle feuille de papier blanc. 11 colle la feuille<br />
sur le carton, soit avec du blanc d'œuf, soit<br />
avec de la colie de farine. Quelques élèves<br />
aisés remplacent souvent le carton par une<br />
planchette en bois blanc, ce cjui est conforme<br />
à l'ancienne tradition.<br />
Ces planchettes étant préparées, le fquih y<br />
trace des motifs décoratifs variés au moyen<br />
d'un compas. Il assure personnellement le<br />
traçage des dessins compliqués et charge ses<br />
meilleurs élèves de tracer les motifs simples<br />
destinés aux jeunes élèves. L'ensemble de ces<br />
dessins se présente sous forme de poissons,<br />
de papillons et surtout de rosaces.<br />
Quand toutes les planchettes sont tracées,<br />
et c'est généralement le programme de la<br />
première moitié de Ramadan, il faut songer<br />
au zouaq (enluminure). On s'occupe tout d'abord<br />
des couleurs que l'on prépare comme celles<br />
employées pour la gouache. Leur gamme est<br />
généralement limitée au jaune, au vert, au<br />
rouge, au bleu et au noir. Anciennement, elles<br />
étaient d'origine végétale, mais aujourd'hui<br />
c'est le droguiste qui fournit la poudre colorante.<br />
Quelle joie à l'annonce du commencement<br />
de l'enluminure ! Il s'agira de bien garnir les<br />
petits motifs symétriques de chaque dessin<br />
avec la couleur lustrée appropriée qui, en<br />
séchant, formera un relief luisant du plus bel<br />
eflet. Il faudra surtout éviter soigneusement<br />
de garnir les chebbaks (petits ronds parsemés<br />
dans chaque dessin qui émailleront l'ensemble<br />
de petites étoiles immaculées). Chacun réalisera<br />
au mieux le contraste des couleur-.<br />
Pas de pinceau pour ce travail délicat, mais<br />
simplement le roseau traditionnel dont la<br />
pointe eflilée ira couvrir les plus petits recoins.<br />
Les élèves, groupés à trois ou quatre aulour<br />
d'un mejmâ (sorte d'encrier en terre cuite<br />
vernissée percé en général de sept trous renfermant<br />
les diverses couleurs et les roseaux<br />
taillés), exécuteront patiemment leur travail<br />
délicat. Un petit chiffon permettra le nettoyage<br />
du roseau lors du changement d'emploi des<br />
couleurs.<br />
Tous les élèves sont attentifs pcndantles séances<br />
d'enluminure. Ce travail de patience<br />
exige, en outre, une parfaite sûreté de main.<br />
Le fquih contrôle le travail et donne des<br />
conseils pour l'emploi des couleurs. Une bonne<br />
dizaine de jours est nécessaire pour l'enluminure<br />
des lellas baïdas. Il faut absolument<br />
qu'elles soient achevées pour la journée de<br />
lila kcbira (grande nuit), le vingt-septième<br />
jour du mois de Ramadan.<br />
Ce jour-là, chaque élève apportera un oadeau<br />
en espèces au fquih ; c'est le fekkak. En<br />
échange, le donateur recevra sa lella haidu<br />
qu'il pourra emporter à sa maison et montrer<br />
à ses parents et amis. Le père n'oubliera pas<br />
de remettre une petite somme à son enfant<br />
en la lui rendant. Parents et amis donneront<br />
également quelque chose.<br />
Le soir même, quand la famille fera le tour<br />
de la ville pour visiter les sanctuaires et les<br />
mosquées illuminées à giorno, cet argent<br />
permettra à l'enfant d'acheter des sucreries<br />
que de nombreux marchands ambulants<br />
offrent à tous les coins de rues ou aux portes<br />
des lieux saints.<br />
Chaque jeune musulman'accrochera ensuite<br />
sa lella baïda dans sa chambre. Ce souvenir<br />
fixera une étape évocatrice de ses études coraniques.<br />
Quelquefois, le dessin est tout simplement<br />
exécuté sur la planchette en bois dur utilisée<br />
quotidiennement pour l'étude du Coran. Dans<br />
ce cas, il ne pourra être conservé que pendant<br />
les dix jours de congé qui suivent le vingtseptième<br />
jour. Quand les études coraniques<br />
reprendront, il faudra faire disparaître la<br />
belle enluminure sous la couche de sounsal<br />
(fine argile blanche) qui remet habituellement<br />
à neuf sâ planchette pour l'étude journalière<br />
du Coran. A ce moment-là, peut-êLre une larme<br />
perlera-t-elle pour traduire son gros chagrin.<br />
Cependant, à trois reprises au cours de ses<br />
études coraniques, le jeune musulman chan-<br />
CERTIFICAT 0' ÉTU<strong>DE</strong>S. G. <strong>MANUEL</strong>. 100 R éd actio n S aiueiopllmeVta. 3 séries. La série. 3.60
7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 53»<br />
géra de modèle de planchette pour adopter un<br />
format plus grand en rapport avec les progrès<br />
de sa mémoire. Lors d'un tel changement, il<br />
pourra conserver sa belle lella baïda et le fquih<br />
n'oubliera pas alors d'écrire au verso de<br />
celle-ci le dernier verset étudié. Quelle belle<br />
relique à conserver précieusement !<br />
i s fillettes, qui ne fréquentent pas le msid,<br />
L reçoivent cependant l'enseignement coranique<br />
dans la maison particulière d'une fquira<br />
(maîtresse coranique privée). Elles célèbrent<br />
In fête de lella baïda avec beaucoup plus<br />
d'éclat que les garçons.<br />
Parées de leurs plus beaux atours, elles se<br />
réunissent, par groupes et, à tour de rôle,<br />
organisent de jolies petites fêtes dans la maison<br />
de l'une d'elles. Après avoir fait admirer individuellement<br />
leurs planchettes enluminées par<br />
leurs hôtesses, elles placent leur lella baïda<br />
au milieu du patio et exécutent une joyeuse<br />
ronde tout autour en chantant la ritournelle<br />
suivante :<br />
Lella baïda, lella baïda !<br />
Donne-moi un œuf pour enluminer ma planchette!<br />
Ma planchette est chez le fquih.<br />
Et le fquih est au Paradis.<br />
Quoi de plus doux que le Paradis!<br />
Notre Maître nous l'a permis.<br />
SUR L<br />
Petites rc<br />
'T'ous l'admettent : une bonne classe, c'est<br />
A une classe où la discipline semble se<br />
faire toute seule, sans que le maître ait besoin<br />
d'intervenir.<br />
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Voici<br />
quelques extraits d'un carnet d'inspections :<br />
Classe unique : 25 élèves. Une bonne leçon<br />
de morale sur « le soin » vient de se terminer :<br />
« Maintenant, copiez le résumé.—• Monsieur, mon<br />
encrier est vide... — Mon cahier est fini... -—<br />
S'il vous plaît, Monsieur, une plume, la mienne<br />
est cassée ». Et, naturellement, cinq minutes<br />
se perdent. J'allais intervenir discrètement,<br />
niais continuant de feuilleter le cahier de préparation,<br />
je rencontre un bon plan de causerie<br />
sur ce sujet : « la prévoyance ».<br />
Cours préparatoire. — Une leçon de lecture.<br />
O Toi qui nous entends ! exauce nos vœux.<br />
Ne nous refuse pas d'espérer.<br />
Par la Majesté du Prophète Mohammed,<br />
Mohammed et ses compagnons<br />
Qui se trouvent au Paradis.<br />
Tau ! Tau !<br />
Le blé est sur la terrasse.<br />
Fatima et Ilalima sont sur un citronnier.<br />
Quoi de plus doux qu'un citron !<br />
Notre Maître nous l'a permis.<br />
O Toi qui nous entends ! exauce nos vœux.<br />
Ne nous refuse pas d'espérer.<br />
Par la Majesté du Prophète Mohammed,<br />
Mohammed et ses compagnons<br />
Qui se trouvent au Paradis.<br />
Thé, gâteaux, jeux divers et chants accompagnés<br />
du tambourin agrémentent les fêtes<br />
données à l'occasion de lella baïda. Vive<br />
lella baïda !<br />
Plus tard, les élèves doués pour le dessin<br />
et l'enluminure utiliseront leurs talents pourréaliser<br />
de beaux cadres dans lesquels desversets<br />
seront encadrés dit belles enluminures.<br />
Ils trouveront preneurs à un bon prix à l'occasion<br />
des fêtes canoniques.<br />
E VIF<br />
CHAUDANSON,<br />
Directeur de l'Ecole de fils de notables de Rabat-<br />
Tous sont devant les tableaux... Le maître<br />
lit d'abord, puis tous lisent en chœur « br...r<br />
brebis ». A la récréation, j'interroge : « Pourquoi<br />
agir ainsi ... ? — Cela « rentre » mieuxT<br />
M. l'Inspecteur, ceux qui savent aident le&<br />
autres.... — Oui, mais lorsqu'ils se trompent,<br />
vous criez bien fort pour rectifier. Le bruit<br />
appelle le bruit ».<br />
N<br />
E provoquons-nous pas parfois, par maladresse<br />
ou négligence, les « remue<br />
ments », l'agitation dont nous nous plaignons ?<br />
« On ne travaille bien que dans la joie «déclarent<br />
les Instructions officielles. Ajoutons ;<br />
« ... et dans le calme ».<br />
BRÉMONT,<br />
Inspecteur de l'Enseignement primaire à Laval-<br />
Les conférences pédagogiques de 1934.<br />
Aux termes de la circulaire ministérielle du 7 février dernier, le sujet des conférences<br />
pédagogiques, cette année encore, sera choisi, dans chaque département, par /'Inspecteur<br />
d'académie.<br />
Nous remercions par avance ceux de nos abonnés qui voudront bien nous communiquer lé<br />
texte du sujet proposé dans leur circonscription.<br />
Comme les années précédentes, nous serons à la disposition de ceux qui le désireront pour<br />
leur fournir, par lettre particulière, moyennant 5 francs, des indications, une documentation,<br />
des suggestions sur le sujet qu'ils auront à étudier.
540 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />
SIEVUE SCIENTIFIQUE<br />
LÉGUA TION PERSONNELLE<br />
I<br />
A vie fébrile que nous impose le machi-<br />
-> nisme moderne demande à l'homme des<br />
qualités dont il n'avait pas besoin, au même<br />
degré, il y a seulement un demi-siècle. La<br />
sûreté et la promptitude de nos réflexes nous<br />
préservent, par exemple, et préservent nos<br />
semblables des accidents que peut entraîner la<br />
vitesse de nos véhicules modernes. Le mécanicien<br />
de chemin de fer qui aperçoit le signal<br />
d'arrêt et renverse la vapeur, le conducteur<br />
de tramway ou l'automobiliste qui bloque ses<br />
freins devant un obstacle imprévu, le pilote<br />
d'avion de combat qui voit surgir soudain<br />
l'ennemi au-dessus de sa tête, redresse son<br />
appareil et dirige sa mitrailleuse sur son adversaire,<br />
tous ceux-là doivent attendre de leurs<br />
nerfs des réactions extrêmement rapides. C'est<br />
dans une fraction de seconde que se joue parfois<br />
notre destinée.<br />
LES physiologistes nous enseignent qu'entre<br />
l'instant où nos sens perçoivent le<br />
signal qui va commander notre réflexe et<br />
l'instant où ce réflexe est accompli, il s'écoule<br />
un temps qui varie d'un individu à l'autre et,<br />
pour un même individu, d'un instant à l'autre.<br />
C'est ce temps qu'on appelle Y équation personnelle.<br />
L'excitation extérieure a provoqué<br />
un courant nerveux qui s'est propagé le long<br />
des nerfs sènsitifs jusqu'aux centres nerveux.<br />
Ceux-ci ont réfléchi le courant dans les nerfs<br />
moteurs qui l'ont transmis aux muscles<br />
intéressés. La durée totale de ce double<br />
mouvement est petite, mais elle n'est pas nulle.<br />
TL est facile d'imaginer un dispositif qui<br />
J- permettra de mesurer l'équation personnelle.<br />
L'observateur soumis à l'épreuve<br />
devra, par exemple, enregistrer l'apparition<br />
d'un signal lumineux. Cette apparition sera<br />
C<br />
Chronographe... _c-<br />
~T<br />
provoquée à intervalles irréguliers par l'examinateur.<br />
On constituera deux circuiLs électriques<br />
juxtaposés ; chacun d'eux contiendra<br />
une pile, un interrupteur et urfcéleetro-aimant<br />
•enregistreur analogue à celui qui existe dans<br />
le poste récepteur d'un télégraphê Morse.<br />
L'un des circuits contiendra en outre une<br />
r<br />
lampe électrique dont l'allumage sera commai<br />
dé par l'examinateur. Le candidat fermera<br />
l'autre circuit, en appuyant sur l'interrupteur,<br />
chaque fois que la lampe s'allumera. Les<br />
styles portés par les palettes des deux élec.tros<br />
viendront inscrire, côte à côte, sur un cylindre<br />
enregistreur, le geste de l'examinateur ou, ce<br />
qui revient au même, l'apparition du signal<br />
lumineux, et la réaction du candidat. On enregistrera<br />
le temps sur le même cylindre, au<br />
moyen d'un chronographe, mécanisme d'hnrlogerie<br />
muni d'un style qui tracera une encoelie<br />
à intervalles réguliers.<br />
L'épreuve sera répétée un grand nombre<br />
de fois. Après l'expérience, on déroulera le<br />
papier placé sur le cylindre enregistreur et on<br />
mesurera avec précision, pour chaque couple<br />
de deux inscriptions, la distance des doux<br />
génératrices du cylindre qui passent par os<br />
inscriptions. Supposons que le mouvement de<br />
rotation dù cylindre soit bien régulier, et que<br />
le chronographe fournisse une inscription tous<br />
les 1/5 de seconde, la distance de deux inscriptions<br />
consécutives étant égale à un centimètre.<br />
Une distance de un millimètre entre les<br />
génératrices que nous venons de définir représentera<br />
donc 1/50 de seconde. Quand on aura<br />
dépouillé les résultats de toutes les expériences,<br />
on constatera que les valeurs obtenues<br />
ne sont pas identiques, mais qu'elles se groupent<br />
autour d'une valeur moyenne. On pourra<br />
représenter ces résultats sur un graphique de<br />
la manière suivante. On prendra une feuille<br />
de papier quadrillé et, sur une ligne horizontale,<br />
on numérotera les carreaux en convenant<br />
que chacun d'eux représente un centième de<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M<br />
seconde. Supposons qu'on ait trouvé deux<br />
résultats égaux à 4/100 de seconde, 6 égaux à<br />
5/100, etc. Au point marqué 4, on élèvera une<br />
perpendiculaire sur laquelle on portera vers<br />
CERTIFICAT O'ÉTU<strong>DE</strong>S, f,. <strong>MANUEL</strong>. 200 Problèmes "ZVépo"nia". 9 3 séries. La s érie.4.20
7 Avril 34 PARTIR <strong>GÉNÉRAL</strong>E 541<br />
le haut une longueur égale à deux fois le côté<br />
d'un carreau. Au point marqué 5; on portera<br />
une longueur égale à 6 fois 16 côté d'un carreau<br />
et on procédera de même pour toutes<br />
les valeurs obtenues dans le dépouillement<br />
des résultats. E n joignant par un trait continu<br />
les extrémités supérieures de toutes ccs<br />
perpendiculaires, on obtiendra une courbe<br />
en cloche analogue à celle que représente la<br />
figure. Le sommet déjà cloche correspondra,<br />
[sur la graduation horizontale, au retard le<br />
plus fréquemment observé.<br />
Le dispositif que nous venons d'esquisser<br />
peut être modifié facilement suivant les conditions<br />
de l'épreuve. S'agit-il, par exemple, d'un<br />
conducteur de tramway ? On l'installera sur<br />
une plate-forme d'expérience pourvue de tous<br />
les instruments qu'il est appelé à manœuvrer.<br />
On simulera devant lui les divers incidents qui<br />
peuvent se présenter et l'on enregistrera successivement<br />
l'instant où l'incident est provoqué<br />
et celui où le conducteur a fait le geste ou les<br />
geste; que commande cet incident. On déterminera<br />
alors le temps qui s'est écoulé entre ccs<br />
deux instants et il sera facile, connaissant la<br />
vitesse normale d'un tramway dans les conditions<br />
où se trouvait placé le conducteur, de<br />
savoir si les réactions de celui-ci ont été appropriées<br />
et suffisamment promptes pour éviter<br />
les conséquences fâcheuses de l'incident.<br />
TL peut arriver que, dans certaines fonclions,<br />
on ne recherche pas à tout prix<br />
la rapidité du réflexe, mais la comparabilité<br />
de celui-ci, à divers moments d'une même<br />
expérience ou dans diverses expériences qui<br />
peuvent être éloignées les unes des autres. On<br />
sait, par exemple, que pour contrôler la<br />
marche de leurs horloges, les astronomes déterminent<br />
chaque jour le passage d'une même<br />
étoile dans le plan méridien du lieu de l'observatoire.<br />
Le temps écoulé entre deux passages<br />
successifs est le jour sidéral. Pour observer le<br />
passage de l'étoile dans le méridien, l'astronome<br />
chargé du service de l'heure dispose<br />
d'une lunetle méridienne dont l'axe optique<br />
peut balayer le méridien du lieu. Il suit l'étoile<br />
dans son mouvement quand elle approche de<br />
ce plan et, au moment-précis où l'image de<br />
1 étoile vient se placer sur le réticule vertical de<br />
la lunette, il appuie sur u n manipulateur qui<br />
ferme le circuit d'une pile et enregistre son<br />
geste sur un graphique où s'enregistre également<br />
le mouvement de la pendule à contrôler.<br />
La fermeture du circuit se fait toujours avec<br />
un certain retard sur le passage à observer.<br />
1 our pouvoir corriger les déterminations<br />
obtenues,, il faut connaître la valeur de ce<br />
retard. Supposons que deux astronomes aient<br />
ete soumis à l'examen dont nous décrivions<br />
tout à l'heure les épreuves, et soient 1 et 2 les<br />
deux courbes obtenues. Le second observateur<br />
a des retards qui, en moyenne, sont plus considérables,<br />
mais ces retards sont plus constants<br />
f<br />
1)<br />
/ i \<br />
/ : \ 2<br />
/ \ i 1<br />
! 1 \<br />
/ i i<br />
0 1 2 3 4 5 0 7 8 0 10<br />
et les corrections qu'on pourra faire subir à<br />
ses déterminations seront plus sûres. Il n'est<br />
pas douteux qu'il doit être préféré au premier,<br />
à ce point de vue.<br />
ON eut besoin, pendant la guerre, pour<br />
repérer par le son les batteries ennemies,<br />
de sélectionner des observateurs qui<br />
devaient enregistrer, non pas des signaux<br />
lumineux,-mais le passage de l'onde sonore que<br />
provoque le départ d'un coup de canon. Là<br />
encore, on recherchait, avant tout, la constance<br />
des réactions d'un même observateur.<br />
Des hommes appartenant à toutes les professions<br />
furent soumis à l'épreuve et l'on constata<br />
que les meilleurs résultats étaient donnés par<br />
des cultivateurs ou des bergers, dont les nerfs<br />
ne sont pas surmenés comme ceux des intellectuels<br />
ou des citadins.<br />
On raconte même qu'un officier zélé voulut<br />
un jour comparer les résultats de quatre observateurs.<br />
Il les plaça en un même point du front<br />
avec quatre manipulateurs reliés par quatre<br />
lignes téléphoniques à l'appareil inscriptcur.<br />
Les quatre hommes devaient enregistrer séparémçnt<br />
les coups que tirait une même pièce<br />
d'artillerie. Ils se trouvaient exactement dans<br />
les mêmes conditions expérimentales, au même<br />
moment de la journée et cette épreuve collective<br />
devait donner les meilleurs résultats.<br />
L'officier ne tarda pas à constater que les<br />
inscriptions s'enchevêtraient d'une manière<br />
incompréhensible. Il prit la détermination<br />
d'aller voir ce qui se passait à l'observatoire et<br />
voici ce qu'il constata. Les quatre observateurs<br />
avaient pensé qu'un seul suffisait à faire<br />
ce qui avait été demandé à chacun d'eux. Les<br />
quatre. manipulateurs, disposés côte à côte<br />
sur un siège, étaient recouverts d'une planchette<br />
sur laquelle s'était assis l'un des hommes.<br />
Chaque fois qu'il entendait un coup de canon,<br />
il soulevait légèrement son corps et le laissait<br />
retomber lourdement sur la planchette. Il<br />
disposait ainsi de toutes ses facultés pour faire<br />
une manille avec ses trois compagnons.<br />
ÇJjRTlF/CAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S.pA. HOLOT. ZOOQuestionsd&Sciences usuelles<br />
CU. B'RTJNOLD.<br />
avec La<br />
réponses, série. 2.75
542 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 3^'<br />
VARIÉTÉS<br />
LA MORT <strong>DE</strong> CHARLEMAGNE 1<br />
Voici quelques pages extraites d'un important ouvrage publié sous le titre « Gharlemagne<br />
par M. Kleinclausz, doyen de la Faculté des lettres de Lyon.<br />
Louis est désigné comme le successeur<br />
de Gharlemagne.<br />
R, à la fin. de l'année 813, l'âge et la maladie<br />
O ne lui laissaient plus l'espoir d'une<br />
longue vie. T^ouis survivait seul de ses fils<br />
et les ambassadeurs byzantins venaient de le<br />
saluer du titre de Basileus. Il n'avait donc plus<br />
aucune raison de remettre sa décision à plus<br />
tard; sinon, il risquait d'être surpris par la<br />
mort avant d'avoir rien fait et de compromettre<br />
ainsi cette paix dont il souhaitait tant qu'elle<br />
lui survécût. Tel était d'ailleurs l'avis de son<br />
entourage, qui le lui fit connaître par la voix<br />
d'Eginhard. C'est pourquoi furent convoqués<br />
à l'assemblée d'Aix des évêques, abbés, comtes,<br />
prêtres, diacres et grands laïques, de tout<br />
l'empire, tandis que le roi Louis était invité à<br />
s'y rendre. Tout le monde présent, l'empereur<br />
prit la parole, et après avoir rappelé les services<br />
rendus à l'Etat par le roi d'Aquitaine et<br />
sa fidélité inébranlable envers son père, il<br />
demanda à tous les assistants, « du plus grand<br />
au plus petit », s'ils étaient d'avis qu'il lui<br />
transmît le titre impérial. La réponse unanime<br />
fut que ce projet était « conforme à la volonté<br />
de Dieu et à l'intérêt du royaume a.<br />
En conséquence, le dimanche 11 septembre<br />
S13, s'accomplit dans la chapelle d'Aix une<br />
cérémonie grandiose. Charlemagne, vêtu des<br />
insignes impériaux, fit son entrée dans l'église,<br />
couronne en tête, appuyé sur l'épaule de son<br />
fils. Agé de trente-cinq ans, celui-ci était alors<br />
en pleine vigueur, et, bien qu'il fût seulement<br />
de stature moyenne, sa forte poitrine, ses<br />
larges épaules, ses bras puissants formaient<br />
un vigoureux contraste avec lés membres<br />
fatigués du vieillard dont il guidait les pas;<br />
mais leurs visages au teint brillant, aux yeux<br />
grands et clairs, étaient empreints d'une égale<br />
noblesse. Us s'avancèrent jusqu'à l'autel de<br />
Notre-Seigneur Jésus-Christ, où Charlemagne<br />
avait fait déposer une couronne d'or autre<br />
que la sienne; puis, après avoir longtemps<br />
prié ainsi que Louis, l'empereur se tourna vers<br />
son fils et, devant la foule des évêqùës et des<br />
grands, lui exposa longuement ses devoirs,<br />
« l'avertissant par-dessus tout d'aimer et de<br />
craindre le Dieu tout-puissant, d'observer<br />
ses préceptes et de défendre ses églises », lui<br />
enjoignant « de se montrer toujours miséricordieux<br />
pour ses sœurs, ses neveux, et en<br />
général tous ses proches », lui demandant<br />
« d'honorer les prêtres comme des pères, d'aimer<br />
les peuples comme ses fils, d'introduire au<br />
besoin par la force les superbes et les criminels<br />
dans la voie du salut, d'êti'e le consolateur<br />
des monastères et le père des pauvres, de choisir<br />
des ministres fidèles, incorruptibles et crai<br />
1. Un vôKin-4. Pai'is. Hachette, éditeur, 50 francs.<br />
gnant Dieu, ayant en haine les présents, de<br />
ne dépouiller aucun homme de sa charge sans!<br />
motif, bref, de se montrer irrépréhensible en<br />
tout temps devant Dieu et devant tout le<br />
peuple. » Enfin, il l'invita à lui faire savoir<br />
s'il voulait obéir à ses commandements et,<br />
le roi d'Aquitaine ayant répondu affirmativement,<br />
Charles prit la couronne déposée<br />
sur l'autel et la lui mit sur la tête, tandis que<br />
la foule criait joyeusement : « Vive l'empereur<br />
Louis ! » La messe célébrée, les deux empereurs<br />
sortirent, le fils soutenant toujours le père,<br />
après que celui-ci eut remercié Dieu en ces<br />
termes : « Sois béni, Seigneur Dieu, toi qui<br />
m'as donné de voir aujourd'hui de mes yeux<br />
un fils né de moi assis sur mon trône. » Un|<br />
brillant festin termina, selon l'usage, cette 1<br />
grande journée.<br />
Sa succession réglée, Charlemagne montra<br />
une fois de plus qu'il n'entendait rien changer;<br />
à la constitution de l'Etat franc, tant qu'il<br />
vivrait. Après avoir prodigué au nouvel auguste<br />
les honneurs et les présents et l'avoir tendrement<br />
embrassé, il l'invita au bout de quelques<br />
jours à rentrer en Aquitaine, ce ' qu'il fit, et,,<br />
dit un ancien historien, « le seigneur empereur<br />
conserva son royaume et son titre avec honneur,<br />
comme il convenait ».<br />
Derniers moments de l'Empereur<br />
EPENDANT Charlemagne n'avait rien voulu<br />
C changef à son genre de vie et, après le<br />
départ de Louis pour l'Aquitaine, il se rendit,<br />
comme au temps de sa jeunesse, aux environs<br />
d'Aix pour chasser. Quand il rentra, dans son<br />
palais, vers le i er novembre 813, la maladie<br />
le terrassa définitivement. A partir de ce<br />
moment, les incommodités se firent de plus<br />
en plus fréquentes et, le 22 janvier 814, à la<br />
suite d'une violente attaque de fièvre survenue<br />
après un bain, il dut s'aliter. En vain il essaya<br />
d'une diète absolue, se contentant d'un peu<br />
d'eau : une pleurésie se déclara et, le 27 janvier,<br />
il fit appeler son archichapelain, l'archevêque<br />
de Cologne Hildebald, pour recevoir les derniers<br />
sacrements. A cette heure suprême do sa<br />
vie, il .était tout à. la dévotion, priant, faisant<br />
des aumônes, mais ses forces l'abandonnaient<br />
de plus en plus. Le samedi 28 janvier, vers<br />
neuf heures du matin, après avoir esquissé<br />
de son mieux le signe (le la croix sur son front,<br />
sa poitrine et tout son corps, il réunit les pieds,<br />
allongea "les bras, ferma les yeux et expira en<br />
prononçant les paroles du psalmiste : « Seigneur,<br />
je mets mon âme entre tes mains.» Il était<br />
âgé de près de soixante-douze ans et en avait<br />
régné un peu plus de quarante-cinq.<br />
KLEINCLAUSZ.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. M. HOLOT. 100 Questions d'histoire c L 10 g°éogpii O ie S répontes. 2-^
7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E<br />
LA PAGE RECREATIVE<br />
La naissance de la III e République<br />
et M. F. Bouisson.<br />
N jour, un parlementaire était à la tribune;<br />
U il faisait un -excellent discours documenté,<br />
intéressant, mais :<br />
— La République, dit-il, n'a encore que<br />
67 ans*..<br />
On était en 1927. M. Bouisson bondit sur son<br />
siège, se pencha vers l'orateur :<br />
— 57, mon ami, 57; de 1870 à 1927, il n'y a que<br />
57 ans.<br />
— Bah ! fit le député plaisamment, la République<br />
n'est pas femme à se fâcher pour cela.<br />
Elle s'en moque bien.<br />
—• Oui, la République ! dit alors M. Bouisson<br />
au milieu des rires de toute la Chambre; mais,<br />
moi aussi, je suis né en 1870, et je ne veux pas<br />
qu'on dise que j'ai 67 ans !<br />
(Voilà).<br />
RCommuniqué par M. PIERRE GAMACHE,<br />
L ihsl., Pointu-Noire. (A. E. F.).<br />
Un mot du roi des Belges.<br />
K roi des. Belges menait. souvent à Paris,<br />
L incognito. Au cours d'une de ces visites,<br />
il y a quelques années/il ^accepta ^ dîner, un<br />
soir, chez une grande dame française afui de<br />
rencontrer un écrivain célèbre.<br />
Celui-ci, dont les idées révolutionnaires<br />
n'étaient ignorées de personne, crut devoir, tout<br />
en dégustant des mets savoureux, tenir devantle<br />
roi des propos incendiaires.<br />
Albert I er , qui l'écoutait avec attention,<br />
remarqua l'air affreusement gêné de la maîtresse :<br />
de maison. Alors il se pencha vers elle et' lui dit<br />
à l'oreille, tandis que l'écrivain se servait une:<br />
part copieuse de truffes au Champagne :<br />
—• Regardez ce qu'il mange et vous ne croirez:<br />
pas ce qu'il dit.<br />
- (Voilà.)<br />
Communiqué par MME BRICIIE,<br />
D ojue E.Decorps. Villeurbanne (Rhône).<br />
Le châtiment.<br />
P'IIÀRLES-QUINT, dans sa retraité, se livrait<br />
à des travaux d'horlogerie. Or, un matin,<br />
son domestiqué, entrant dans la cellule de son<br />
royal maître, renverse maladroitement la table<br />
où se trouvaient alignées une trentaine de<br />
montres. Le domestique devient blême. Il<br />
s'attend à quelque châtiment. Quelle n'est ças<br />
sa stupéfaction de voir Charles-Quint lui designer,<br />
en souriant, les môntres brisées :<br />
: — Bravo, mon enfant. Tu es plus habile que<br />
moi, car t u as trouvé le moyen de les mettre<br />
toutes d'accord.<br />
Lectures pour ions. L. Lovs.<br />
[<br />
Communiqué par MME HERBA-UT, inst.<br />
Boirargues} par Montpellier (.Hérault).<br />
Une épitaphe de Catherine de Médicis.<br />
\TOICI line épitaphç de Catherine de Médicis<br />
qui eut, à son époque, un grand succès :<br />
« La reine, ci-gît,, fut un diable-et u ç ange<br />
Toute pleine de blâme et de louange<br />
Elle soutint l'Etat et l'Etat mit à bas<br />
Elle fit maints accords et non moins dé débats<br />
Elle enfanta trois rois et trois guerres civiles<br />
Fit bâtir des châteaux .et ruina des villes<br />
Fit de bonnes lois et dé mauvais édits'<br />
Souhaite-lui, passant, çnfer et paradis. »<br />
Reines de France, par EMILIE CARPENTIER.<br />
U<br />
I Communiqué par ÎÎME' G AUTIER, inslit.<br />
L Chànipdchicrs (Dèux-Sèires),<br />
Vocation.<br />
NE vocation n'est pas toujours- bien marquée,<br />
un flottement se produit, on tergi<br />
verse, on s'interroge, on "se tâte, puis, les circonstances<br />
aidant, il faut souvent peu de chose<br />
pour en décider.<br />
Un jeune homme avait ainsi longtemps<br />
hésité entre la peinture et la médecine. Finalement,<br />
il s'était- arrêté à l'idée, qu'un jour, il<br />
serait médecin.<br />
Des amis lui demandèrent les raisons qui<br />
avaient pu amener ainsi assez subitement 6a<br />
détermination : « Voici, dit-il : dans la peinture,<br />
toutes les fautes sont exposées à la vue, tandis<br />
que dans la médecine, elles sont entenrées avec<br />
le malade ».<br />
Marseille-Matin.<br />
FCommuniqué par JIME PASTORET, inslit.<br />
|_ à Seillans (Var).<br />
La rose et la violette.<br />
'INSTITUTRICE cherche à faire comprendre<br />
L par l'image la différence existant entre<br />
la rose et la violette.<br />
— Une belle- dame, dit-elle, portant une<br />
somptueuse toilette, passe fièrement dans la<br />
rue, sans daigner regarder personne : c'est la<br />
rose. Derrière elle,, vient une petite créature qui<br />
marche tête baissée.<br />
Et une élève d'interrompre :<br />
— C'est son mari.-<br />
Communiqne par MLLE ÏVIR!\ISIER, insl.,<br />
I à la Grand*Maison (Pas-de-Calais).<br />
Le subtil mendiant.<br />
ous la place de la Concorde, dans les cou<br />
S loirs du Métro et du Nord-Sud où passent<br />
des milliers de voyageurs, un mendiant s'est<br />
installé sur un petit pliant, la casquette à la<br />
main. Il fait de belles journées. Frais et gaillard,<br />
il pourrait travailler : il aime mieux gagner<br />
ainsi sa vie.<br />
Voici le brèf dialogue que nous surprimes<br />
hier entré un passant trop moraliste et lui :<br />
— N'avez-vous pas honte, disait le passant,<br />
de faire un pareil métier ?<br />
— Monsieur, répliqua le drôle, j accepte<br />
l'argent des imbéciles, et non leurs impér-<br />
tineilCeS ' . ' (VAvénir).<br />
VCommuhiquè par "M. 'GEORGES TEXIER,<br />
L • iiïstitixteûr'ù Sigismoiid (Vendée).<br />
Chacune des anecdotes de la Page récréative donnent lieu à une rétribution de cinq francs.
<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />
COMMUNICATIONS<br />
Postes vacants aux colonies pour<br />
octobre 1934.<br />
On demande actuellement aux colonies pour la<br />
rentrée .d'octobre un certain nombre d'instituteurs,<br />
à savoir :<br />
1° En A. O. F., 12 instituteurs pourvus du B. S.<br />
et du C. A. P.<br />
2° A Madagascar. — 9 instituteurs pourvus du<br />
B. S. et du G. A. P.<br />
Les instituteurs dos trois classes de début auront<br />
la préférence.<br />
II n'y a de poste vacant dans aucune autre colonie<br />
et il n'y a nulle part aucun poste vacant ni pour<br />
institutrice ni pour ménage enseignant.<br />
Adresser les demandes, dès à présent, au Ministère<br />
dos Colonies (Inspection-Conseil de l'Instruction<br />
publique) qui fournira tous les renseignements<br />
complémentaires nécessaires.<br />
Une fête normalienne.<br />
Les élèves-maîtres de 3° année do l'Ecole Normale<br />
d'Instituteurs do Versailles organisent îc 22 avril,<br />
à 14 h. 30, dans les nouveaux bâtiments, 3, boulevard<br />
de Lesseps, une fête de promotion au cours do<br />
laquelle ils' interpréteront * l'Exlra » de P. Vebcr,<br />
Monsieur de Pourceau r/nac, comédie-ballet de Molière.<br />
Chants et récits divers.<br />
La location est ouverte :<br />
Ecrire à' M. Diard, Ecole Normale de Versailles.<br />
CONCOURS <strong>DE</strong>S FURETEURS<br />
Résultats du Concours n° 2g.<br />
Question principale. — Le personnage historique<br />
qui fui successivement roi des Romains, roi<br />
de Bohême, roi de Hongrie, empereur d'Autriche,<br />
et qui refusa la couronne de Pologne est Maximilien<br />
II (1527-1576), fils de l'empereur Ferdinand<br />
i or .<br />
Cette question nous a été communiquée par<br />
M. Taccoen, Ecole Normale, 44, rué d'Arras, à<br />
Douai (Nord) (prix de 25 fr.).<br />
Question subsidiaire. — Nous avons reçu<br />
40 réponses exactes.<br />
Le lauréat de ce concours est M. E- Pérochon,<br />
Instituteur à Verruycs (Deux-Sèvres) qui a indiqué<br />
que nous recevrions 38 réponses exactes (prix<br />
de 50 fr,).<br />
Concours n 3 32.<br />
Question principale. — Un automobiliste ayant<br />
causé un accident a pris la fuite sans que le numéro<br />
de sa plaque ait pu être relevé exactement. Certaines<br />
observations ont été faites et la police a recueilli les<br />
déclarations suivantes :<br />
1 er témoin : les 6 chiffres du numéro sont différents<br />
;<br />
2° témoin : les 3 premiers chiffres forment un<br />
carré ;<br />
3 3 témoin : les trois derniers chiffres forment un<br />
cube ;<br />
4 e témoin : le nombre est divisible par 3;<br />
5 e témoin : les deux chiffrés du milieu forment un<br />
nombre premier.<br />
Quel est le numéro de la plaque ?<br />
Question subsidiaire. — Combien de nos abonnés<br />
répondront exactement à la question principale<br />
p<br />
Les réponses devront nous parvenir, au plus<br />
tard, le mardi 17 avril.<br />
Les résultats do ce concours paraîtront dans<br />
le; Manuel général n° 31, du 28 avril.<br />
S®€Mir les Bibliothèques scolaires*<br />
André Lauric a été, parmi les romanciers de la<br />
jeunesse, un des plus brillants. Son nom vient<br />
immédiatement après celui de Jules Verne dont<br />
il a été l'émule. Comme lui, il sait donner un puissant<br />
accent humain aux romans d'aventures qui,<br />
sous sa plume, ne sont pas seulement des imbroglios<br />
plus ou moins compliqués, mais des récits<br />
vraiment attachants et émouvants. Quel est le<br />
secret commun à André Lauric et à Jules Verne ?<br />
C'est qu'ils ont fait do leurs personnages de vrais<br />
êtres de chair et d'os, parfaitement vivants, non<br />
de vains fantoches; le lecteur s'intéresse à eux, les<br />
voit agir en se rendant compte des sentiments,<br />
des mobiles qui les poussent à l'action, approuve<br />
ou blâme leurs actes. Cet art de faire vivre les<br />
personnages en les mêlant intimement aux péripéties<br />
du roman, les deux grands romanciers<br />
l'ont possédé à un rare degré, et c'est pourquoi,<br />
UN ROMAN D'ANDRE LAURIE<br />
jusqu'ici, ils n'ont pas été remplacés dans la faveur<br />
du jeune public.<br />
Comme Jules Verne encore, André Lauric<br />
a été un « ânticipatcur » et un prophète remarquable.<br />
Le Rubis du Grand Lama 1 qui vient de<br />
paraître dans la Bibliothèque des Ecoles et des<br />
Familles, conçue spécialement en vue des distributions<br />
de prix, en est une preuve. Dans ce beau<br />
et passionnant roman, l'auteur a prévu toutes les<br />
possibilités delà conquête do l'atmosphère à l'aide<br />
du .« plus lourd que l'air ». Un jeune Français est<br />
devenu le roi de la season à Londres parce qu'il<br />
possède un énorme rubis brut qui vaut un nombre<br />
respectable de millions. Mais la curiosité de tous<br />
est piquée : comment est-il devenu le propriétaire<br />
de cette pierre d'une grosseur inusitée ? Sur ces<br />
entrefaites, avec le produit de la vente du rubis,<br />
1. Un volume gr. in-8 ill.; broché 20 fr,', relié pcrcal. 28 fr.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. M. HOLOT. 100 Questions d'histoire e d! 0 g 0 c2g. C aphi" s réponses. 2 '• 7.5
7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 545<br />
ic liii'os du récit fait construire un appareil volant<br />
et organise un grand voyage aérien vers le centre<br />
asiatiquo. Dès lors la conviction s'établit qu'il<br />
possède le secret d'une mine de rubis au Tibet.<br />
Cellr- hypothèse est renforcée par le fait que les<br />
joailliers ont baptisé «rubis du Grand Lama»<br />
la fameuse pierre. Non seulement les curiosités,<br />
mais aussi les convoitises sont déchaînées, et au<br />
cours de la randonnée dans les airs, elles provoqueront<br />
les plus dramatiques incidents, qui<br />
donneront au récit un si vigoureux intérêt romanesque.<br />
PETITES ANNONCES DU " M A N U E L <strong>GÉNÉRAL</strong>"<br />
CONOITIONS D'INSERTION<br />
j* ANNONCES NON commi-'hciales (Minimum 2 lignes), jj annoncer commerciales (Minimum 2 lignes).<br />
Abonnis — L'abonnement d'un an donne droit à 5 lignes à 1 Ir la ! ^ our l° us ' es lecteurs indistinctement, abonnes ou non: 10 fr. la ligne.<br />
ligue. — Chaque ligne supplémentaire, 8 fr. avec E0 •/« de réduction, Réception des Annonces<br />
soit < Ir. la ligi:e II LE» <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>S D'INSEKTIOM ACCOMPAGNÉES <strong>DE</strong> LEUR MONTANT DOIVENT<br />
Pour toutes les annonces supplémentaires, 8fr. atee E0 •/« de réduc-l N0 " s PARVENIR IO jour> ou moins A I. AVANCE.<br />
. - , POUR DÉNÉFICIEI» DÛ-TARIF RÉDUIT ÉTABLI POUR LES PETITES ANNONCES<br />
110,1 * PRIVÉES EN FAVEUR <strong>DE</strong> NO» ABONNÉS, UNE BAN<strong>DE</strong> RÉCENTE D'ENVOI DU<br />
A'ON abonnis — 8 fr. la ligne. || JOURNAL DOIT ÊTKE JOINTE A TOUTE <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>.<br />
La ligne comporte une moyenne de 30 lettres, signes ou espaces.<br />
A'ofû. — Il n'est pas fourni de justificatifs — Les annonces de librairie ne sont pas insérées. — Les demandes de renseignements pour les<br />
iViitcs Annonces doivent être accompagnées d'un timbre pour la réponse.<br />
POUR RÉPONDRE AUX PETITES ANNONCES<br />
!' Mettre Sa réponse sous enveloppe fermée allranchieâ GO cent Ne pas mettre<br />
l'adresse sur relie enveloppe : inscrire seulement en téte le N* de la petite<br />
itmionccû Inquelle on répond (Modèle A);<br />
r Placei celle l" enveloppe dans une seconde également fermée et affranchie<br />
r. :c centimes et l'adresser au Slimurl Général, Service de le Publicité. "9. boulevai-d<br />
Saint-Germain; Paris (Modèle B)<br />
= ENSEIGNEMENT<br />
•- Cours et leçons =====<br />
nROFESSORAT chant et musique,Elat<br />
1 ei Ville do Paris. Cours oraux et par<br />
correspondance. J.-R. Pierron, 1 -47, av.<br />
Parnieniier, Paris, 10®, M. G. 9441.<br />
i AT1N. Leçons partie, p. corrosp. Grds<br />
L début. Bacc. Licences. M. Lavarenno,<br />
prof, agrégé au lycée de Reims.<br />
M. G. 9453.<br />
ICENCIÉE ès lettres prépare au<br />
L baccalauréat l r * partie et philosophie.<br />
soit par correspondance, soit par<br />
leçons particulières. Mlle G. Senninger,<br />
!•, rue Lobineau, Paris, 6*. M. G. 233.<br />
pACC. Préparation par corresp. par<br />
J-) , prof. Lycées de Paris, membres<br />
Jury. Ecr. : Podevin, S, rue des Boulangers,<br />
Paris, 5". Timb. p. rép.<br />
M. G. 294.<br />
= Institutions, Pensionnats. =<br />
IRECTEUR expér.louerait ou achè<br />
D terait instit. garçons.-M. G. 321.<br />
Modèle A<br />
M. G. 6861.<br />
Modèle B<br />
Manuel Général 50<br />
Service<br />
de la Publicité cenl.<br />
79, Boul St-Germain.<br />
Pari?<br />
Ollres et demandes d'emplois,<br />
I 1 .Sy nd. enseig. libre laïque place pers.<br />
C enseig. et surv. Délégué : M Gillos,<br />
8, r. Màrtinval, Lovallois-Perret. Tél. Pereire<br />
18-0-2. Toute demando non satislaite<br />
au bout d'un mois doit être renouvelée<br />
pour être maintenue.<br />
M. G. 948}.<br />
"LACEMENT personnel enseignant.<br />
P Vente d'institutions. Agence Enseignement,<br />
15, bd St-Michel, Paris, 5*.<br />
M. G. 9981.<br />
iNST',21 a., B. S., cherche pr. août,<br />
I sept., place surv. col. vac. mer ou<br />
montagne. M. G. 327.<br />
•; Pensionnaires. .<br />
I NSTC *50 km. Paris, garderait2 fillettes;<br />
bons soins, bon air. M. G. 328.<br />
- 1 Permutations. ; »<br />
iNST" du dép 1 do la Seine demande<br />
i permutante pour le dép 1 i NSTITUTRICE Indre-et-Loire, exeat,<br />
I permuterait institutrice Seine-et-<br />
Oise. Toujours valable. Al. G. 326.<br />
iNST" Lot, ville, voie ferrée, perm.<br />
I Gironde ou environs immédiats Paris.<br />
Toujours valable. M. G. 330.<br />
INSTITUTEUR Rhône permuterait<br />
I avec collègue Hte-Garonne.<br />
M. G. 331.<br />
i NSTITUTEUR I-Ite-Saônecherche per-<br />
I mutant ou permutante Jura.<br />
M. G. 334.<br />
INSTITUTRICE Finistère, demande<br />
I permutante pour les Basses-Pyrénées.<br />
Toujours valable. M. G. 335.<br />
= EMPLOIS, TRAVAUX DIVERS =<br />
C O P I E S adresses pr publicité,15 fr. le<br />
cent et gr. gains pr tous.. Echaniill.<br />
du trav. gratis : Laboratoiro do Provence,<br />
Serv. B. N. à Marsèille.<br />
M. G. 8539.<br />
d'Oran.<br />
J ' A I gagne plus de 1000 fr. p. mois en:<br />
M. G. 316.<br />
1955 par travail correspondance chez<br />
soi p. loisirs. Mêmes possibilités à tous.<br />
INSTITUTRICE Cher, permuterait tout Preuves et rens. c. timbre à C. Jour-<br />
I département, ville préférence ou<br />
colonies. M. G. 323.<br />
dois, inst., bd Gambetta, Charleville.<br />
M. G. 143.<br />
Suite des petites annonces à la page 546.<br />
Librairie HACHETTE, 79, boulevard Saint-Germain, Paris (VI e ).
546 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />
PETITES ANNONCES (Suite)<br />
UGMENTEZ VOS revenus par trav. Excursions. Alt. 55i m. Au Syndicat «<strong>DE</strong>VELOPPEMENT dos films Baby,<br />
A écr. fac. lionnète. Gains imp. prou (VInitiative : listes d'hôtols, app. mou i " 6 fr. 70 p. film. Moiocamcra loué<br />
vés. T. p. rép. Loupias, Mirabol-Riffnac illés ( i'iiiib e pr réponse). M. G. 314 20 fr. par 7 jours, Georges Jaquinod,<br />
(Avoyron). M. G. 333.<br />
Coupy-Bollegarde i Ain). M. G. 315.<br />
* vendre, maison i pièces, nombreuses<br />
HOTELS<br />
/V servitudes jardin, cour, dans bourg LE Grat. Otlro 5 n°' d'iffér. pour<br />
= PENSIONS <strong>DE</strong> FAMILLE = chareniais. Autobus Electricité. Libre<br />
chacun dos n°* -27-66-95.<br />
ELVÉTIA, 2S bis, bd Diderot, Paris Je suite. Facilités de paiement.<br />
M. G. 317.<br />
n (Gare de Lyon). Ch. 16 à 50 fr.<br />
M. G. 325. M. G. 8615.<br />
ICE. « Le Minaret-IIÔtel », 22ô, Prom.<br />
MARIAGES<br />
N des Anglais. Jardins. Soleil. Toui LLE trentaine, inst., éduc. parf.,<br />
confort. Cuisine renommée. Pension n 50 000 revenus épouserait prof, ou<br />
55--40 fr. Meilleur accueil. inst<br />
M. G. 9864.<br />
ylLLEFRANCHE-SUR-MEil. 10 m.<br />
V Nice, Flôiel Ker-Maria, plage,mont,<br />
jard., exc. cuis., 25 f. p. comp.<br />
M. G. 185.<br />
vrlCE. Pension Danto, 17, rue Fricero,<br />
il confort., 2 min. mer. Pens. r>0 fr.<br />
2 pers. M. G. 239.<br />
TJAQUES agréables et peu coûteuses<br />
I au Palace bourgeois d'Aix-les-<br />
Bains Sévigné l'hôtel e-asoleillé. Prix<br />
unique 50 fr. M. G. 282.<br />
IMMEUBLES<br />
= Achat, vente, location<br />
Villégiature.<br />
QALLANCHES ( HAUTE-SAVOIE), Sé-<br />
O jour agréable. Large vallée riante et<br />
saine. Face au Mont Blanc. Promenades.<br />
r . M. G. 249<br />
aiUNISIE. Commis P. T. T., 52 a., gd.<br />
I bien, dés. corr. vue rnar. avec inst cl<br />
•22-28. Photo. Entrevue France été h»5i.<br />
Très sérieux. M. G. 320<br />
LGÉRIE. J. instituteur cor v. mar<br />
Vinst c# ENDRAIS Histoire universelle Quillet,<br />
Vpays et peuples 8 volumes, neuf,<br />
1000 fr. valou 1 ,00 lr. M. G. 319.<br />
• vOUBLE emploi, 850 fr., Ilist. univer-<br />
IJ se.le neuve, payée, 1470 f. Accepterait<br />
en échange machine coudre,<br />
ou T. S. F., état neuf. M. G. 322.<br />
. CIIÈTERAIS Manuel général 11)28-<br />
\ 1929. Bonnaud, La Chôvrerie, n.<br />
RufTec (Chte). M. G. 324. DIVERS<br />
ou intérimaire, 18-24 a. l'hoto, • vlSPOSANT capitaux, prêterais discr,<br />
retour ass. M. G. 32 t. I ® A collègues, Rembours. 1 à 12 mois»<br />
NST' S.-et-O. dés. corr. vue mar. coll.<br />
M. G. 9443.<br />
1 19-24 a , gr., brune. J. photo.<br />
| 'AVICNIlt? Faites (aire une étude de<br />
M. G. 336.<br />
\J votre horoscope on envoyant dato<br />
naissance, prénom et 5 fr. au professeur<br />
Adluh, 62, ruo Felix-Fauro, Colombes<br />
OBJETS DIVERS<br />
(Seinel. — Graphologie. 5 f.<br />
Achat, vente, échange.<br />
M. G. 944G.<br />
céder, excellente occasion, Pathé i)UETS aux instituteurs. Fleurisson,<br />
A Baby neuf. Bès, St-Nazaire (Pyr.-O.) I av. Rochambeau, Rochefort-s.-Mer.<br />
M. G. 3 1 2<br />
M. G 241.<br />
Librairie HACHETTE, 79, Boulevard Saint-Germain, Paris (VI").<br />
Comme an Photographie.<br />
Le film a remplacé, pour la projection,<br />
le support-verre encombrant et fragile.<br />
Mais la projection sur film n'est vraiment pratique que si vous avez un<br />
Projecteur Filmostat<br />
Le FILSIOSTAT, malgré sa grande puissance lumineuse,<br />
n'altère pas les films.<br />
Le FILMOSTAT, gTâce à sa simplicité de manipulation,<br />
permet la<br />
proj ection sans tâtonnements.<br />
Le FILMOSTAT est<br />
d'un prix modique<br />
et ses lampes sont<br />
durables et peu<br />
coûteuses.<br />
Le FILMOSTAT<br />
est agréé -<br />
par le Mi- C<br />
nistère de<br />
l'Education<br />
Nationale,<br />
et susceptible<br />
d'une subvention.<br />
Les Collections FILM OS TA T=HA CflETTE mettent à votre disposition une<br />
sélection incomparable de vues se rapportant à toutes les matières<br />
iHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuii mu min mu illustrables par la projection. iiiiii»miiiiiimimmHiiiiiiiminmiiiin»<br />
fPROSPECTUS SUR <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong> |<br />
Nous offrons un billet de la LOTERIE NATIONALE de la 9 e tranche ou, à défaut, de la 10 e aux<br />
10 premiers acheteurs qui se recommanderont de ce te annonce.
Avril 34 PARTIE GENERALE 547<br />
I rèmli. 2 ans, taux rais. Urgent.<br />
Garantit».<br />
M. G. 318.<br />
EXCURSIONS. VOYAGES<br />
l'organisât, dénommée Les Clochettes.<br />
Rensoig. : Mmo Cudot, 75, av. République,<br />
Paris, 11\ M. G. 332.<br />
PETITES ANNONCES (Suite. )<br />
21 BON <strong>DE</strong> 0 FR. 50<br />
valable en paiement des<br />
Primes de rem&ourssmsnt<br />
du « Manuel général »<br />
pour 1933-1934<br />
Jusqu'à concurrence de 50 °/0<br />
de la valeur des prinles choisies.<br />
» \ bis BON <strong>DE</strong> 0 FR. 50<br />
' I valable en paiement des<br />
Primes de remlioursament<br />
du
<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />
CREME de SAVON<br />
ou<br />
CREME SANS SAVOI<br />
^Vo/re décision dépend<br />
'(.) rfe iro/rc barbe!;<br />
à elle de choisir entre la Crème de Savon Gibbs et la Crème Rapide Sans Savon Gibbs<br />
Ne croyez pas que le même produit, si bon soit-il. convienne également a toutes les barbes, à tous les épidermes<br />
Sinon, pourquoi Gibbs vendrait-il deux produits également excellents comme la Crème de Savon et la Crème Rapide<br />
Sans Savon (cette dernière s'employant sans eau ni blaireau) ?<br />
La vérité c'est que la Crème de Savon convient aux épidermes un peu gras. La mousse savonneuse "décape" le poil<br />
en dissolvant le ''sébum " ou graisse qui l'entoure et diminue ainsi considérablement lo résistance à l'action du rasoir.<br />
La Crème Rapide Sans Savon est à conseiller aux épidermes secs, car ses éléments onctueux préviennent toute<br />
irritation. Pour les épidermes normaux, ni secs, ni gras, le choix dépendra du goût et des habitudes de celui qui se rase<br />
Mais de toutes façons, c'est un essai des deux produits qu'il faut taire. L'un des deux vous conviendra certainement.<br />
A votre barbe de vous dire lequel !<br />
celui qui sait réduire ses frais<br />
pour vous offrir au moindre<br />
prix la meilleure qualité.<br />
En développant sans cesse<br />
leur production irréprochable<br />
qu'elles livrent directement<br />
au Public, les<br />
RASEZ-VOUS GRATIS PENDANT QUINZE JOURS!<br />
Remplissez le coupon ci-contre et adressez-le à<br />
THIBAUD, GIBBS et Cie, 22. rue de Marignan, Paris<br />
Vous recevrez en retour un échantillon de Creme de Savon Gibbs et<br />
un échantillon de Creme Rapide Sans Savon Gibbs! Essayez les deux...<br />
Votre barbe choisira !<br />
M : R"A .NT<br />
BÂUBEAU<br />
de BKSANÇON<br />
se 3ont acquis ce titre. Il justifie la faveur et la<br />
réputation croissantes dont jouit depuis plus d'un<br />
demi'siècle<br />
B M O N T R E ' Y F I I I '<br />
7 Premiers Prix - 35 Médailles d'Or<br />
aux Concours de l'Observatoire National<br />
de Besançon<br />
Consultez le CATALOGUE illustré de plus de 2800<br />
dessins qui est envoyé gratis et franco sur demande<br />
Demandez<br />
Catalogue N° 32<br />
vente directe tissus linge corps<br />
et maison<br />
139, Avenue Jean-Jcurès, Paris<br />
COMME'' • ; J "<br />
SOVS LES PAS ''!*£• ^<br />
DV CHEVAL : - ' i ï<br />
OATTILA... ^<br />
OV L OCCYSOL A PASSE<br />
L HERBE N E POVSSE PLVS;<br />
MONTRES, BIJOUX, RÉVEILS<br />
PENDULES, CARILLONS, ORFÈVRERIE Notice, prix et renseignements gratuits sur demande;<br />
adressée à la Société L'OCCYSOL 0 REMISE AU CORPS ENSEIGNANT '<br />
5, Quai de Javel, GRENOBLE (Isère) ? Tél. 9-67]<br />
Conditions spéciales à MM. les Instituteurs.<br />
1
7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 549<br />
A LA GRAN<strong>DE</strong> MAISON <strong>DE</strong><br />
RUSTIQUES<br />
Meubles de toutes Provinces françaises.<br />
DÉCORATION — COSY-CORNER<br />
FAUTEUILS CUIR. — FACILITÉS <strong>DE</strong> PAIEMENT<br />
172, Avenue du Maine - PARIS (Métro Alésia).<br />
Jn visage<br />
trop pâle.<br />
Un joli visage, que seuls les fards parviennent à<br />
colorer, révèle au premier regard, cette- faiblesse<br />
particulière du sang que l'on nomme anémie et<br />
dont les causes sont si complexes. La pâleur n'est<br />
pas le seul signe, ni le seul inconvénient de l'anémie<br />
: elle s'accompagne d'autres troubles bien plus<br />
l>cuiBles, vertiges, fatigue constante, tristesses<br />
invincibles, névralgies... Parmi les malaises les<br />
plus caractéristiques, notons la lenteur des digestions,<br />
l'atonie générale du tube digestif. Cette<br />
inertie (qui a souvent son origine dans l'insuffisance<br />
hépatique), offre le danger particulier d'encombrer<br />
l'organisme de déchets et par suite d'intoxiquer<br />
le sang, déjà pauvre, en le chargeant de poisons<br />
intestinaux qui devraient normalement être<br />
éliminés chaque jour.<br />
De sorte que l'anémique se trouve pris dans un<br />
cercle vicieux d'où il lui semble qu'il ne peut<br />
sortir. Son anémie se renforce elle-même, et l'effet<br />
augmente la cause...<br />
Ce qu'il faut donc soigner, c'est l'intestin et le<br />
sang : en débarrassant régulièrement l'organisme<br />
ses déchets toxiques, en augmentant les sécrplions<br />
gastriques et en activant les fonctions du<br />
foie, on purifiera le sang, on lui rendra sa force et<br />
sa fraîcheur. C'est là précisément le rôle de la<br />
Tisane des Chartreux de Durbon, qui tire des<br />
plantes alpestres les mieux choisies le principe<br />
vivifiant et activant dont l'anémique a besoin. Ce<br />
licitement, expérimenté depuis deux siècles, a fait<br />
ses preuves : il agit doucement mais sûrement et<br />
transforme peu à peu la constitution même du<br />
sang.<br />
En vente toutes pharmacies.<br />
Le flacon : 14 fr. 80.<br />
TOILES DU NORD<br />
Draps confectionnés et toile au mètre,<br />
au prix de gros, sans Intermédiaire.<br />
Mesdames, demandez catalogue d'échunt. gratuit<br />
à L'UNION TOILIÈRE DU NORD<br />
LILLE, 14, i
M A N U E L G É N É R A L D E L ' I N S T R U C T I O N P R I M A I R I i 7 Avril 3'»<br />
, A p r e u v e<br />
, E < ° " F O R T 1<br />
'<br />
U H A P E R ^<br />
{N" 345 du cat.) Chombre bombée "Miracle"<br />
ronce noyer vernie Armoire bombée, 3<br />
portes, gronde gfoce, largeur l m. 40, tiroir<br />
bijoux intérieur ; I lit corbeille larg. 1*40 ;<br />
J table liseuse morbre. Complète ..<br />
MASTIC LHOMME - LEFORT<br />
Indispensable pour g reffer et cicatriser les plaies<br />
d e s arbres e t v ignes; est employé o nctueux o u<br />
liquide pour reconstituer les vergers<br />
LA GLU LHOM tflE-LEFORT<br />
protège les arbres contre tous insectes<br />
PARIS, 3 8 , r u e d e s Alouettes, 3 8 , P A R I S<br />
GUI<strong>DE</strong> CHANT !<br />
KASRIELl<br />
6 , R u e Tolain, P A R I S (20 e ) |<br />
Demander le CATALOGUE B |<br />
e s t f ^ t e<br />
GRAN<strong>DE</strong>S FACILITÉS <strong>DE</strong> PAIEMENT ACCORDÉES U s i n e s e l A t e l i e r s .<br />
SUR <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong> 5 2 , rue. d e s Poissonniers<br />
REPRISE EN COMPTE <strong>DE</strong> V O S VIEUX MEUBLES (à 150 mètres des Magasins)<br />
LIVRAISONS GRATUITES A DOMICILE DANS TOUTE<br />
LA FRANCE<br />
V i s i t e s t o u s l e s m a t i n s<br />
55, Boulevard Barbès - PARIS m<br />
(Ne paa confondre s Coin Ruo Loba»)<br />
• • •<br />
Succursales : LE HAVRE 19, Rue du Chillou • LILLE 114, Rue Nationale<br />
MARSEILLE il, Rue Montgrand B NANTES 27, Rue du Calvaire • TOULOUSE H, Rue St Pantalébn<br />
Rem'se de iO % accordée<br />
aux membres de l'Enseignement<br />
<strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>Z N O T R E A L B U M GRATUIT<br />
BON<br />
découper et à faire parven.r<br />
aux GALERIES BARBES pour<br />
recevoir gratuitement: I" l'Album<br />
général d'Ameublement 2" l'Album de literie,<br />
divans, studios et mobiliers sacrifié».<br />
Rayer la mention inutile. _<br />
Nos magasins restent ouverts le Samedi toute la journée.<br />
F A B R I Q U E D E S O I E R I E L Y O N - P A R I S<br />
.. Spécialiste en soie naturelle garantie lavable et • -<br />
durable vend au prix de fabrique, prix spécial<br />
pour 5,10,15 m. même en coloris différents (aclie- |.<br />
ter en f abr que est économique). Echantillon gra- : i<br />
•luit sur demande à L A SOIE LAVABLE (Service ( ;<br />
de P ropagande li) 6, passage Viulel,PARIS X ' .<br />
Participat ion gratuite à la Loterie Nationale. — !<br />
SPECIALISTE <strong>DE</strong>S SOIES GARANTIES LAVABLES<br />
PETIT HARMONIUM PORTATIF<br />
à l'usage d u c h a n t clans les é c o l e s<br />
Prix : 2 octaves, 4 7 5 f. 3 oct., 6 0 0 i'.<br />
2 octaves Iranspositeur, 5 9 2 !'.<br />
Nouveau s y s t è m e clcclriquc « V e n t i l e x - » ,
7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 551<br />
<strong>DE</strong>NTOL<br />
<strong>DE</strong>NTIFRICE<br />
MU GfNîlfRK<br />
ANTISEPTIQUE<br />
EAU - PATE.<br />
POUDRE<br />
SAVO [N<br />
rrrr,i/ifif/r//Ji<br />
TOL AiTX AHTliCPUQULSCÛM<br />
En oente :<br />
Pharmacie<br />
Parfumerie<br />
f* K F \ p A I T Pour recevoir gratuitement<br />
et franco un échantillon de<br />
<strong>DE</strong>NTOL, il suffit d'envoyer à la Maison<br />
FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris, sous<br />
enveloppe affranchie à 0 fr. 50, son adresse<br />
exacte et bien lisible en y joignant la présente<br />
annonce du Manuel général.<br />
67<br />
pièces<br />
argentées<br />
F A C U L T É GARANTIE<br />
<strong>DE</strong> RETOUR 20 ANS<br />
SPLENDI<strong>DE</strong> MENAGERE<br />
Valeur réelle' 1.000 frs<br />
Riche Orfèvrerie de style Moderne, en métal extra blanc argenté<br />
flux plus fortes charges : Coutellerie à lames inoxydables<br />
de Nogent forgées à la main<br />
12 Couverts de table 12 Couteaux de table<br />
12 Cuillers à café 12 Couteaux dessert<br />
1 Louche à potage 1 Service à découper<br />
1 Manche à gigot 1 Service à salade<br />
1 Coffre-Écrin A 2 compartiments<br />
A CRÉDIT COMPTANT<br />
630 Frs 567 Frs<br />
Quantité limitée. Les commande» «eronl<br />
servies dan» l'ordre d'arrivée et Jusqu'à épuisement<br />
G R A T U I T *;"«*('• 0P B, >*<br />
1 Rue BORDA<br />
PARIS (3 e )<br />
EJCANP<br />
ADRESSEZ-VOUS A LA<br />
PHOSPHATINE<br />
FALIÈRES<br />
ASNIÈRES (Seine).<br />
pour recevoir franco de jolis<br />
-POINTS<br />
au prix ciel ir. le cent. 4 fr. 50 les cinq cents<br />
8 fr. le mille.<br />
Paiement en timbres-poste joints<br />
à la demande.<br />
LAINES A MATELAS<br />
Lavée à fond depuis 8 fr. le kg. Echantillons grnluils.<br />
O. BERNARD, 37, rue Saint-Jacques. Tourcoing.<br />
ETU<strong>DE</strong>S CHEZ SOI<br />
I.'ÉCOLE UNIVERSELLE, placée sous le haut<br />
patronage (le plusieurs Ministères et Sous-Secrétariats<br />
d'Ktat, la plus importante école du monde, permet,<br />
firâcé à ses cours par correspondance, de faire chez soi,<br />
dans le minimum de temps et avec le minimum de frais,<br />
des études complètes dans toutes les branches du savoir.<br />
Elle vous adressera gratuitement sur demande, celles<br />
de tes brochures qui se rapportent aux études on<br />
carrières qui vous intéressent :<br />
Broch. 13302 : Toutes les classes de l'enseignement<br />
primaire, Certificat d'études, Bourses,<br />
Brevets, C. A. P., Professorats, Inspection<br />
primaire.<br />
Broch. 13310: Toutes les classes de l'enseignement<br />
secondaire, Baccalauréats, Licences.<br />
Broch. 13312 : Grandes Ecoles spéciales.<br />
Broch. 13323 : Carrières administratives.<br />
Broch. 13326 : Emplois réservés.<br />
Broch. 13334 •• Toutes les carrières de l'Industrie<br />
et des Travaux publics.<br />
Brcch. 13338 : Carrières de l'Agriculture métropolitaine<br />
et coloniale.<br />
Broch. 13343 : Toutes les carrières du Commerce,<br />
de la Banque, de la Bourse, des<br />
Assurances, de l'Industrie hôtelière.<br />
broch. 13350 Langues étrangères- Tourisme.<br />
Broch. 13358 : Orthographe, Rédaction. Versification,<br />
Calcul, Dessin,Ecriture Calligraphie,<br />
broch. 15364 ; Mari.ie marchande.<br />
broch. 13310 : Solfège, Chant, Piano Violon,<br />
Flûte. Saxophone, Accordéon, Professorats.<br />
Broch. 13315 : Arts du Dessin, Professorats.<br />
Broch. 13318 : Métiers de la Couture, de la<br />
Coupe, ne la Mode et de la Chemiserie.<br />
Broch. 13388 : Journalisme et Secrétariats.<br />
Broch. 13391 . Carrières du Cinéma.<br />
Bi^och. 13395 .-Carrières coloniales.<br />
LCOL.K IjIMÏ V 1 ÎKSIÎLLB<br />
59, Boni Exelmans Paris 16»i<br />
AVEZ-VOUS UN<br />
FILMOSTAT?<br />
Prospectus spécial sur demande.<br />
Librairie HACHETTE, 79, boul. St-Germian, Paris.
<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 'J/t<br />
REMISE <strong>DE</strong> 10 °/0 AUX MEMBRES <strong>DE</strong> L'ENSEIGNEMENT<br />
Demandez notre catalogue illustré gratuit<br />
CHÊNE MASSIF<br />
GARANTIE ILLIMITÉE<br />
FACILITÉS <strong>DE</strong> PAIEMENT<br />
^ REPRISE <strong>DE</strong>S VIEUX MEUBLES<br />
LIVRAISON GRATUITE DANS TOUTE LA FRANCE<br />
R U E C R O Z A T I E R , P AR1S-XII*<br />
une seule entrée<br />
POLYCOPIE<br />
LA PIERRE HUMI<strong>DE</strong><br />
remplace avantageusement<br />
tous les autres procédés.<br />
Demander notice « Au CYGNE »<br />
Saint-Mars la Brière. (Sarthe).<br />
CRINS-LAINES A MATELAS<br />
Gar. in!. 8 f r. lekg. —Eclin ni. gratuit sur demande.<br />
W. VRIELINGKE, 241, rue Brun-Pain, Tourcoing.<br />
'22, Chaussée Fernand-Forest<br />
TA TOURCOING (Nord)<br />
jà découpnr, à remplir el à HfJn'HSer^oiiB enve-<br />
I loppc affranchie à . Fra . 0.50 à l'adrc^so de<br />
i CROZATIER MEUBLES, 10 r Cror.aticr, Parie-XII<<br />
1<br />
I iVorru.<br />
•|.j Adresse..<br />
i*<br />
*<br />
PRÉPARATION DIRECTE ET PERSONNELLE<br />
par correspondance<br />
au C. A.<br />
" 1<br />
(ou Professorat de Comptabilité.<br />
Envoi gratuit des conditions et documents sur demande<br />
adressee à M. Ch. LEJEUNE. directeur de l'ECOLS<br />
PHEP" UNIVERSITAIRE, O.rue Bridaino, ParisH7-)<br />
LOTERIE NATIONALE<br />
part de1/10«de Billet attribuée<br />
pour tout achat de 250 fr. fait<br />
directement en Fabrique chez<br />
Eugène CAUDRON<br />
Fabricant, ELBÉUF(Seine-Inf )<br />
Maison de confiance /ondée en IS'JO.<br />
TISSUS POUR HOMMES<br />
Ccstumes et Pardessus mesure<br />
Coupe et façon GRAND TAILLEUR<br />
CHEMISERIE pour HOMMES<br />
TOILES — DRAPS <strong>DE</strong> LU<br />
LINGE de Table et de Toilette<br />
etc., etc.<br />
Collection gratis et franco s. demande.<br />
emise spéciale à MM. les Fonctionnaires<br />
et Membres de l'Enseignement<br />
Se recommander du Manuel général.<br />
5313. — INID. LAHURE, 9, rue de Fleurus, Paris. — 1934. Le Gérant : WALTENER.
anuel général 1933-1934, N # 28 7 Avril 1934<br />
PARTIE ADMINISTRATIVE<br />
Textes officiels.<br />
dmission dans les écoles primaires supérieures<br />
et les cours complémentaires.<br />
Circulaire ministérielle du 16 mars 1934<br />
MM. les Recteurs et Inspecteurs d'académie.<br />
Pour répondre à diverses questions, j'ai l'honnir<br />
de vous faire connaître dans quelles condijns<br />
les élèves seront admis dans les écoles priaires<br />
supérieures à la rentrée d'octobre 1934, en<br />
[édition des circulaires du 11 juin et du 25 nombre<br />
1933.<br />
L'enseignement primaire supérieur, faisant suite<br />
l'enseignement primairo élémentaire, reçoit les<br />
èves qui, pourvus du certificat d'études priaires,<br />
ont achevé leur scolarité primaire, et sont<br />
;és d'au moins douze ans révolus au 31 décembre,<br />
n quelle classe doivent-ils entrer pour suivre le<br />
lurs normal des études primaires supérieures ?<br />
Ces études ont une durée réglementaire de trois<br />
îs et sont sanctionnées par le brevet d'enseilement<br />
primairo supérieur et par le brevet éléentàire,<br />
auxquels peuvent seuls se présenter les<br />
indidats qui ont 16 ans révolus au 31 décembre,<br />
en résulte que les élèves qui veulent, après les<br />
ois années réglementaires d'études, se présenter<br />
1 brevet élémentaire ou au brevet d'enseignement<br />
imaire supérieur, doivent avoir, en entrant en<br />
e année, 13 ans révolus au 31 décembre. Les<br />
èves entrant en l re année avant l'âge de 13 ans<br />
: peuvent pas, au terme do leurs études, être<br />
indidats à ces examens et sont obligés de redouter<br />
la 3 e année.<br />
Cette prolongation irrégulière des études priaires<br />
supérieures provient le plus souvent de ce<br />
it que les élèves ont passé directement de la<br />
asse du certificat d'études dans la première année<br />
ccole primaire supérieure, au mépris de l'organiition<br />
réglementaire de nos écoles.. Il existe en<br />
iet après la classe du certificat d'études (cours<br />
ipérieur l re année) dans les écoles primaires' éléentaires,<br />
ou avant la classe de l re année dans les<br />
:oles primaires supérieures, une classe où sont<br />
Imis les élèves titulaires du certificat d'études<br />
rimaires, qui ont 12 ans au 31 décembre, .et qui<br />
sulent soit achever le cycle complet de la scolate<br />
primaire élémentaire, soi t se préparer aux études<br />
rimaires supérieures. C'est le cours supérieur<br />
• année) des écoles primaires élémentaires ou<br />
cours préparatoire des écoles primaires supécurcs.<br />
Dans celte classe doivent entrer norma-<br />
Ment les élèves pourvus du certificat d'études,<br />
ui auront 12 ans révolus au 31 décembre suiant.<br />
H arrive parfois que des enfants bien doués parjurent<br />
le cycle complet des études primaires élémentaires<br />
en six ans au lieu de sept. Us ont suivi la<br />
'asse du certificat d'études à 11 ans (cours supéeur<br />
l re année) mais ils n'ont pu se présenter à<br />
« examen que l'année suivante (cours supérieur<br />
année)'; S'ils ont le certificat d'études et si,<br />
"oiquo âgés de 12 s au 31 décembre, ils ont, en<br />
'«i suivi régulièrement les deux années régulières<br />
du cours supérieur, ils remplissent les conditions<br />
pour etre admis en l re année d'école primaire<br />
supérieure.<br />
Mais cette mesure ne doit être prise qu'en faveur<br />
de très bons élèves, qui soient très nettement au<br />
niveau de la l re armée d'école primaire supérieure<br />
et qui perdraient leur temps et leur entrain à<br />
revoir dans un cours préparatoire d'école primaire<br />
supérieure un programme qu'ils connaissent parfaitement.<br />
Elle n'est opportune que pour des élèves<br />
non pas à la remorque, mais à la tête de leur classe,<br />
et qui, on 3 e année, seront, malgré leur âge, facilement<br />
au niveau du brevet élémentaire. L'année<br />
suivante, ils no redoubleront pas la 3 e année;<br />
dans une 4 e année, ils prépareront non pas seulement<br />
le brevet élémentaire, mais encore et avec<br />
toutes chances do succès, le concours d'entrée<br />
dans une ccole ou dans une administration.<br />
Pour tous les autres élèves, il est plus profitable<br />
d'avoir fait une année préparatoire que de redoubler<br />
une troisième année. L'intérêt, commun des<br />
maîtres et des enfants est de n'admettre en 3° anné&<br />
que des élèves aptes à en suivre facilement les<br />
enseignements et d'alléger les classes d'examens<br />
d'élèves à qui deux années de travail sont nécessaires<br />
pour se présenter avec chances sérieuses de<br />
succès.<br />
C'est à la conscience des professeurs et des directeurs<br />
que les parents s'en remettent pour décider,<br />
dans l'intérêt unique des enfants. C'est à eux aussi,<br />
délibérant en Conseil des maîtres, que je fais<br />
confiance, pour affecter chaque élève à la classe où<br />
son travail donnera les meilleurs résultats. Les<br />
directeurs et les directrices devront prévenir par<br />
écrit les parents que les élèves, exceptionnellement<br />
admis en l ro année à 12 ans, devront faire<br />
4 années d'études avant de pouvoir se présenter<br />
au brevet élémentaire ou au brevet d'enseignement<br />
primaire supérieur. Directeurs et professeurs devront<br />
porter une attention particulière aux études<br />
et aux progrès de ces élèves et, le cas échéant,<br />
leur faire doubler la l re ou la 2 e année, s'ils constatent<br />
que les résultats ne correspondent pas aux<br />
espérances.<br />
En 1934, comme déjà en 1933, aucun crédit n'a<br />
été inscrit au Budget pour créations d'emplois<br />
dans l'enseignement primaire supérieur. Il me sera<br />
donc impossible d'augmenter le nombre des professeurs<br />
dans aucune écolo primaire supérieure. Si<br />
les demandes d'inscriptions en l re année paraissent<br />
devoir excéder le nombre des places disponibles,<br />
non seulement à l'internat, mais aussi dans les<br />
classes des professeurs actuellement en service<br />
dans chaque établissement, il conviendra d'instituer<br />
un concours d'entrée en première année. Tous<br />
les enfants qui auront 13 ans révolus au 31 décembre<br />
1934 peuvent s'y présenter. Les enfants<br />
qui auront 12 ans révolus à la même date et qui<br />
ont suivi régulièrement depuis octobre 1932 les<br />
deux années du cours supérieur avant d'obtenir lo<br />
certificat d'études pourront aussi y prendre part.<br />
Le classement se fera en tenant compte des con-<br />
'JjRJIFICA T D'ÉTU<strong>DE</strong>S. 26 Chants scolaires d'auteurs différents. I vol. ïn-16, cari. 4.60
10 ; <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril<br />
Une dictée • • •<br />
Une leçon de choses..<br />
La cuisson du Riz.<br />
" Il n'y a rien de pire...<br />
et de meilleur que la<br />
langue " a dit Esope, On<br />
peut en dire autant du riz<br />
Rien de plus exécrable<br />
que du riz mal cuit. Rien<br />
j \ u de c pplus iud davuui savoureux UUA 4qu'un U t<br />
^ riz bien préparé. Appr<br />
^ nez donc à a cuire le ri riz.<br />
Pour bien cuire le riz, il<br />
faut d'abord le laver<br />
jusqu'à ce que l'eau ne<br />
soit plus trouble. Puis le<br />
mettre sur feu vif dans<br />
de l'eau froide salée en<br />
le recouvrant à peine.<br />
Quelques tours de bouillon.<br />
Remuez un peu et rejetez<br />
toute i'eau en excédent.<br />
Remettez le riz sur<br />
feu doux dans un récipient<br />
bien clos et laissezle<br />
gonfier vingt minutes<br />
environ sans le remuer.<br />
C'est ainsi que l'on prépare<br />
le bon riz d'Indochine.<br />
Ecrire au bureau de Propagande '<br />
62, Rue de Richelieu, Paris (2 e )
7 Avril 34 PARTIE ADMINISTRATIVE. — N° 28 107<br />
naissances et des aptitudes des enfants plus que de<br />
'leur âge. Les boursiers subiront le concours d'entrée<br />
en l r0 année comme tous les autres élèves.<br />
Le cours supérieur 2° année dans les écoles primaires<br />
élémentaires ou le cours préparatoire des<br />
écoles primaires supérieures est une classe de la<br />
scolarité obligatoire. L'État qui impose l'obligation<br />
doit donner aux parents les moyens d'y satisfaire.<br />
11 n'y a jamais manqué, même en ces temps<br />
de nécessaires compressions budgétaires. Partout<br />
où les effectifs le justifieront et où les conditions<br />
matérielles le permettront, je suis disposé, dans la<br />
limite dos crédits inscrits au Budget et après avoir<br />
prononcé toutes les suppressions compatibles avec<br />
la bonne administration do l'enseignement, à<br />
crée; des classes de cours supérieur 2 e année ou des<br />
classés de cours préparatoire.<br />
Il c:st bien entendu qu'il ne saurait y avoir aucune<br />
rivalité entre les cours supérieurs (2 e année) des<br />
écoles primaires et -les cours préparatoires des<br />
écoles primaires supérieures. Dans une école<br />
primaire où il est possible d'instituer, soit une<br />
classe de cours supérieur 2 e année, soit «ne section<br />
spéciale dans une classe à deux cours, les élèves<br />
doivent achever à cette école leurs études primaires<br />
élémentaires, et entrer ensuite à l'écolo primaire<br />
supérieure directement en l re année. Au contraire,<br />
lorsque le nombre des classes et des élèves ne permet<br />
pas d'avoir dans une école primaire élémentaire une<br />
classe ou une section spéciale de cours supérieur<br />
2° année, les enfants de cette école, une fois pourvus<br />
du certificat d'études, peuvent être admis au cours<br />
préparatoire d'une école, primaire supérieure.<br />
Cours complémentaires.<br />
'L'admission des élèves dans les cours complémentaires<br />
se fera dans les mêmes conditions que<br />
dans les écoles primaires supérieures.<br />
Je ne saurais trop insister sur l'utilité d'organiser,<br />
daiis toutes les écoles primaires pcrniniies d'un<br />
cours complémentaire, une classe de cours supérieur<br />
2 e année pour les élèves reçus au certificat<br />
d'études. Lorsque les effectifs ne permettront pas<br />
de créer une classe spéciale de cours supérieur<br />
2 e année, il sera de bonne pédagogie de constituer<br />
une section spéciale dans une classe à deux cours.<br />
Une année d'initiation, comparable au cours préparatoire<br />
des écoles primaires supérieures, a la<br />
plus haute importance pour les progrès ultérieurs<br />
des élèves, au cours complémentaire.<br />
Cette organisation pédagogique placera les<br />
élèves des cours complémentaires dans les mêmes<br />
conditions scolaires de travail et de progrès que les<br />
élèves des écoles primaires supérieures.<br />
Comme dans les écoles primaires supérieures, il<br />
est normal que les élèves entrant en l re année de<br />
cours complémentaire soient âgés de 13 ans révolus<br />
au 31 décembre. Toutefois les enfants âgés de<br />
12 ans révolus, qui auront fait deux années de cours<br />
supérieur avant d'obtenir le certificat d'études,<br />
pourront être admis en l ro année, s'ils sont jugés<br />
aptes à suivre cette classe. (A suivre).<br />
En lisant l'Officiel.<br />
Charges de famille du retraité.<br />
L'article 41 de la loi du 30 mars 1929 dispose :<br />
« lorsque le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté<br />
aura des enfants postérieurement à sa mise à<br />
la retraite, sa pension sera majorée des indemnités<br />
pour charges de famille qu'il percevrait s'il était<br />
en activité ». (J. O. du 7 mars 1934. — S. p. 366).<br />
Pension pour services hors d'Europe.<br />
Il a .été exposé que la loi de 1853 accorde aux<br />
fonctionnaires venant de France une majoration<br />
de service égale à la moitié du temps passé en<br />
Afrique du Nord, et demande si cette majoration<br />
est accordée aux fonctionnaires (instituteurs)<br />
prenant leur retraite en 1934, quel que soit le<br />
nombre de leurs années de services antérieurs à la<br />
loi de 1924.<br />
Réponse affirmative. En application des dispositions<br />
de l'article 77 de la loi du 14 avril 1924,<br />
qui autorise les agents en fonctions lors de la promulgation<br />
de la loi à revendiquer le bénéfice des<br />
dispositions antérieurement en vigueur pour les<br />
services accomplis avant ladite promulgation<br />
toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables<br />
que celles de la loi nouvelle, les fonctionnaires<br />
retraités ont le choix, pour lo décompte<br />
do la bonification de service afférente à leurs<br />
séjours hors d'Europe, entre l'un ou l'autre des<br />
deux régimes, c'est-à-dire qu'ils peuvent opter<br />
entre les deux combinaisons ci-après :<br />
1° Décompte, pour la période antérieure au<br />
17 avril 1924, de la bonification de services prévue<br />
par l'article 10, paragraphe 1 er , do la loi di^<br />
9 juin 1853; décompte pour la période postérieure<br />
de la bonification de services instituée par l'article<br />
9, paragraphe 1 er , de la loi du 14 avril 1924;<br />
2° Application, tant pour la période antérieure<br />
que pour la période postérieure au 17 avril 1924,<br />
de la bonification de services prévue par l'article 9,<br />
paragraphe 1 er , susvisé. (J. O. du 7 mars 1934. —<br />
S. p. 366).<br />
Èloignement de l'école : bourses d'entretien.<br />
Les renseignements nécessaires à rétablissements<br />
des états de propositions des bourses d'entretien<br />
sont fournis, dans chaque département,<br />
aux inspecteurs d'académie qui adressent ensuite<br />
au ministère leurs propositions. Pour l'attribution<br />
des bourses, il est tenu compte : a) de<br />
l'éloignemcnt de l'école; b) de la situation do<br />
famille; 2° les familles qui se croient lésées peuvent<br />
adresser une réclamation au ministre avant que la<br />
répartition totale des crédits ne soit faite, [J. O.<br />
du 1 mars 1934. —D. p. 816).<br />
Indemnités de déménagement.<br />
Des indemnités de déménagement peuvent être<br />
accordées, dans les limites des crédits inscrits au<br />
budget, aux instituteurs ayant été, par suite de<br />
la suppression do leur poste, l'objet d'une nomination<br />
d'office à un poste inférieur ou équivalent<br />
à celui qu'ils occupaient. Ces maîtres doivent,<br />
par la voie hiérarchique, adresser leur demande,<br />
accompagnéo des factures justificatives, à M. le<br />
préfet de leur département. [J. O. du 10 mars 1934.<br />
— D. p. 885).<br />
CERTIFICAT iP'£n/l7fS.iM.Hoi.OT.2000uestionsileSciencesusiieHesrgp,"°fes,s£îe.2- l 75
10S <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />
y j e ^ . x e t ^ e *fé<br />
I i><br />
(L'EXCELLENTE AFFAIRE DU MOIS:<br />
98.518 Lustra en bronza fondu à 4 lumières '<br />
Manuel général 1933-1934 N» 28 7 Avril 1934<br />
PARTIE SCOLAIRE<br />
RTRT TOPPAPtTÏTT IMCillVï? A fJTÎ^^ [Sous cette rubrique, noirs mettrons ici, chaque semaine, l'annonce des<br />
t)l^IL/Ljr\.Ai i l 1 H/ —— - îUU V tL JLIJ / publications nouvelles pouvant intéresser nos lectrices et lecteurs.]<br />
Emile de Girardin, le créateur de la Presse moderne, par M AURICE RECLUS. — Un vol-in-8,<br />
des a Figures du Passé », broché : 25 fr. ; cartonné : 35 fr.<br />
Journaliste lui-même, et d'un beau talent, historien réputé, M. Maurice Reclus nous donne une vivante biographie<br />
du pèro du journalismo moderne, de cet Emile de Girardin qu'on a pu appeler le Napoléon de la Presse. Ecrite avec<br />
l'esprit brillant et la sûreté d'information qu'on connaît à son auteur, cette biographie campe superbement « l'homme<br />
qui connut tant de gens et fut mêlé à tant de choses »...<br />
Toute la vie de Girardin passe sous nos yeux, de la naissance adultérine au diiel avec Carrel, des grandes luttes de<br />
la maturité aux dernières batailles du vieillard.<br />
CENTRE D'INTÉRÊT : L'ARROSOIR<br />
Exercices d'observation et modelage.<br />
Un arrosoir d'enfant. — Matériel : Un arrosoir<br />
par groupe de 5 ou 6 enfants.<br />
REMARQUE. — I' est utile de lier toujours 'es<br />
exercices d'observation aux exercices de modelage<br />
et aux exercices de dessin. En effet, un objet est<br />
connu lorsque l'enfant en a pris possession par tous<br />
ses sens. Cependant, rien n'oblige la maîtresse à<br />
présenter toujours en premier lieu l'exercice, d'observation<br />
et de le faire suivre par les exerc.ces de<br />
modelage et de dessin. A l'école maternelle, les procédés<br />
d'enseignement n'ont rien de rigide et d'uniforme,<br />
ils varient su.vant les sujets, et la maîtresse<br />
s'efforce de les présenter de la manière qui soit le<br />
plus agréable et le plus profitable aux enfants<br />
Ainsi, nous avons montré, dans notro précédente<br />
leçon, comment un exercice d'observation pouvait<br />
être confondu avec ''exercice de dessin. Cette fois<br />
nous donnerons un exemple d'observation combinée<br />
à un exercice de modelage.<br />
L'objet de noire élude est cette semaine un objet<br />
fabriqué : l'arrosoir. C'est dire qu'il ne retiendra<br />
pas 'ongtemps l'attention de nos élèves si la maîtresse<br />
ne le fait- pas étudier act:vement, la pâte<br />
plastique à la main, pour essayer d'imiter le modèle<br />
donné.<br />
Pourquoi no pas commencer par le dessiner ?<br />
C'est parce que le dessin en est très difficile. Ne<br />
faut-il pas proportionner la hauteur à la largeur,<br />
donner aux anses une forme convenable? etc II<br />
apparaît judicieux de l'observer en composant<br />
chaque partie patiemment, au fur et à mesure de<br />
son étude.<br />
Demandons d'abord aux enfants :<br />
A quel usage cel ustensile esl-il destiné?s-* Il est t'ait<br />
pour contenir la plus grande quantité d'eau possible<br />
afin do la verser sur les plantes.<br />
La partie principale de l'arrosoir est un cylindr»<br />
(comme le tuyau du pocle, comme le verre d'une<br />
lampe), plus haut que 'arge. Prenons un gros morceau<br />
do pâte plastique, roulons-le entre nos mains,<br />
puis roulons-le sur la planche à modeler pour que<br />
la surface en soit bien unie et lisse.<br />
Soulevons l'arrosoir de fer. Quelle est la forme du<br />
fond ? #->• Elle est ronde, comme le couvercle d'un<br />
poêle. Le rouleau de pâte que nous avons modelé a<br />
un fond tout bosselé. Aplatissons sa base en la<br />
frappant légèrement sur la table. Plaçons le cylindre<br />
insi obtenu sur la planche. Est-il bien d'aplomb ?<br />
e penche-t-il pas à droite ? à gauche ? Les bords en<br />
>ont-ils bien droits ?<br />
Regardons à nouveau l'arrosoir. Repose-t-il<br />
lirectement sur le sol? Que voyons-nous autour du<br />
ond ? »->• Un cercle de fer qui l'entoure et le rend<br />
Partie scolaire.<br />
plus solide. Plaçons un cercle de pâte autour du<br />
rouleau dressé sur la planche.<br />
Observons maintenant la partie supérieure de<br />
l'arrosoir. — Le« bords se rapprochent pour fermer<br />
presque complètement l'orifice. De loin, nous no<br />
voyons que deux lignes obliques qui partent des<br />
bords du cylindre et ne se rencontrent pas tout â fait<br />
au sommet. L'un des enfants se place juste au-dessus<br />
de l'arrosoir. Que voit-il ? »-> Un trou rond par<br />
lequel le jardinier emplit l'arrosoir d'eau.<br />
Prenons un peu de pâte, donnons à sa base le<br />
même diamètre qu'au cylindre, amincissons-le de<br />
manière à lui donner une forme pointue. Nous<br />
coupons ensuite la pointe avec l'ébauclioir.<br />
Que voyons-nous de chaque côlé de l'arrosoir ? *->•<br />
Nous voyons un tube creux et terminé par une pomme<br />
donl l'une des faces est percée de trous comme une<br />
passoire. Le tube par où l'eau arrive à la pomme<br />
est rattaché au sommet do l'arrosoir par une barre<br />
de fer horizontale. Pourquoi ?<br />
Prenons un peu do pâte, roulons-la pour obtenir<br />
un long Lube étroit au sommet, large à la base.<br />
Retirons la pomme de l'arrosoir. Quelle est sa<br />
forme ? A quoi sert-elle ? Arrosons une plante avec<br />
l'arrosoir non muni d'une pomme. La plante se<br />
penche, elle pourrait se briser. L'eau coule trop fort<br />
et en trop grande abondance. Elle se répand toute<br />
au même endroit et creuse la terre au pied de la<br />
plante, s'étalant ensuite en une large flaque.<br />
Plaçons la pomme à l'extrémité du tube et arrosons<br />
une autre plante Regardez l'eau qui sort do<br />
l'arrosoir. »-> Elle se partage en petits jets qui<br />
s'écartent les uns des autres. La plante reçoit une<br />
petite quantité d'eau £ la fois, elle ne plie pas. elle<br />
ne s'incline pas brusquement,-l'eau s'infiltre dans<br />
la terre petit à petit et ne creuse pas la terre eu<br />
s'enfonçant. La pomme de .l'arrosoir est-elle utile?<br />
Dites pourquoi. Adaptons maintenant lé tube de<br />
pâte au cylindre, après avoir noté qu'i doit prendre<br />
naissance à une faible distance du fond.<br />
Les anses. — Remplissons l'arrosoir d'eau et<br />
faisons-le porter par un enfant. L'eau coule-t-elle<br />
par la pomme quand on tient l'arrosoir par l'anse<br />
supérieure? #-> Non. — L'arrosoir reste-t-il droit? —-<br />
Quand le jardinier porte-t-il l'arrosoir par cotte<br />
anse ?<br />
Découpons un peu de pâte, aplalissons-la et<br />
plaçons-la à cheval au-dessus de l'orifice.<br />
L'anse placée sur le côté a-t-eile la même forme<br />
que la l ro ? A quoi ressemble-t-elle?»-* A une oreille.<br />
Notons sur l'arrosoir les points où elle s'attache et<br />
plaçons-la, après lui avoir donné une courbure<br />
exacte. A quoi sert-elle ? A quel moment le jardinier<br />
tient-il l'arrosoir par cette anse ?<br />
Prenons un arrosoir plein d'eau et tcnons-Ic.<br />
Il s'incline, l'eau s'écoule dans le tube et s'échappe<br />
m 2S•
106 CLASSE D 'INITIATION '7 Avril 34<br />
par la pomme. Plaçons l'anse sur notre arr soir dp<br />
pâte, en remarquant qu'elle est du côté opposé au<br />
tube.<br />
Allons à la pompe, nous remplirons nos petits<br />
arrosoirs en essayant de ne pas nous mouiller les<br />
pieds, puis, les saisissant par l'anse latérale, nous<br />
arroserons doueement nos violettes et nos primevères.<br />
Exercices sensoriels.<br />
1° Des cercles d'égales grandeurs son dess nés<br />
rur des feuilles de papier, la maîtresse a tracé au<br />
préalable doux petits ronds dans chacun d'eux.<br />
Los enfants continuent le travail en respectant<br />
.'écartement et la grosseur de ces ronds.<br />
2° Des arrosoirs placés de maniérés différentes sont<br />
peints sur une feuille de carton. La forme et les<br />
dimensions des arrosoirs sont semblables mais les<br />
couleurs diffèrent. IJ sîagit de placer la silhouette<br />
d'un arrosoir (tracée à la plume seu.ement) à' côté<br />
de l'image qui convient.<br />
3° Comp èler des silhouettes gui contiennent des<br />
lacunes. — Distribuer des croquis où l'une des<br />
parties de l'arrosoir a -été oubliée. L'enfant destine<br />
l'anse ou la pomme qui manque.<br />
Exercices de langage.<br />
Quand arrose-t-on les plantes 1 A quel moment<br />
de la journée ? A-t-on besoin d'arroser l'hiver?<br />
Pourquoi ? — Pour quelle raison arrose-t-on les<br />
filantes? — Arrosë-'t-on toujours avec' un arrosbir ?<br />
Dans les : ardins 'publics, avez-vous vu le jardinier<br />
arroser lés pelouses "et les massifs de fleurs? De quel<br />
instrument se' servait-il ? — Arrose-t-on les arbres?<br />
Les arbustes ? Lesquels? — Les rues ne sont-elles<br />
pas' aussi arrosées? De quelle façon? A quel<br />
moment de la journée ? — Comment s'appëlle la<br />
voiture qui arrose les rués? Qui la conduit? — Qiié<br />
devient la poussière lorsque 'l'eau ruisselle sur la<br />
route ? — Ou s'en va l'eau souillée par la poussière ?<br />
Exercices de conjugaison.<br />
Un enfant mime d'abord les diverses actions du<br />
jardinier et les exprime à haute voix.<br />
Je bêche mon jardin, Je sème des graines,<br />
Je ,)ioche, * Je désherbe les allées,<br />
Je ratisse, Je plante de la salade,<br />
Je trace des sillons, J'arrose os fleurs.<br />
Puis un petit camarade so place devant le jardinier.<br />
Celui-ci se lait et c'est le 2° enfant appelé qui<br />
lui dicte ses .gestes :<br />
Tu bêches ton jardin,<br />
Tu pioches,<br />
lu ratisses,<br />
lu traces des sillons,<br />
Tu sèmes dos graines,<br />
Tu désherbes les allées.<br />
Tu plantes de la salade,<br />
Tu arroses les fleurs.<br />
Nous écrivons deux do ces phrases à la l'°,<br />
puis à la 2° personne du singulier, en remarquant<br />
ja lettre s ajoutée à la 2° personne,<br />
Calcul.<br />
L'idée de la division. — I. Le dividende est une<br />
nrandeur non mesurée. — 1° Je veux faire un collier<br />
de perles à plusieurs petites filles. Le fil de laiton<br />
que j'ai là, dans ma boîte, est très long. Que dois-je<br />
l'aire pour que chaque fiiletto ait un collier? »-> 11<br />
faut partager le laiton entre mes petites filles.<br />
2° Nous voulons préparer un bouquet de violettes<br />
en papier de soie pour l'offrir à notre maman. Voici<br />
une très grande feuille de papier de soie violet. Que<br />
dois-je faire pour que, ce soif, chaque enfant puisse<br />
emporter un bouquet ? »-> Il faut partager la feuille<br />
do papier entre les petits élèves.<br />
'3° Les petits s'asseyent autour de là tablé "à<br />
sable. Le tas de sable est peu épais. Pour que chaque<br />
enfant puisse faire un pâté, les joueurs doivent se<br />
partager le tas de sable.<br />
La maman a fait cuir'e un bon plat de macaroni.<br />
Tous ses enfants ont faim.Pour que tous se régalent,<br />
que va faire la maman?»-» Elle va partager le macaroni<br />
entre tous ses convives.<br />
Le dividende est une grandeur mesurée. — La<br />
maman achète 8 croquets. Elle veut les partager<br />
entre ses deux enfants René et Michel. Mais elle<br />
no veut pas faire de jaloux, aussi elle donnera<br />
autant de croquets à Michel qu'à René.<br />
Pour donner à tous deux une égale quantité de<br />
gâteaux, elle donne un seul croquet à la fois à chacun,<br />
et cela jusqu'à ce qu'il né reste plus de croquets à<br />
partager. Appelons près de nous deux enfants *èt<br />
distribuons-leur des croquets. .<br />
Un petit beurre à Michel, un à René. Dans nia<br />
première distribution, j'ai donné une fois 2gâteaux.<br />
Continuons... J'ai donné encore unefois2 gâteaux,<br />
j'ai donné ainsi déux fois 2 gâteaux, puis trois fois<br />
2 gâteaux, puis quatre fois 2 gâteaux. Combien<br />
Michel a-t-il dé croquets ?»-> 4. — Et René? 4.<br />
Disposons ainsi l'opération.<br />
oo oo oo oo 8<br />
0 |4<br />
Il ne reste plus de gâteaux à la maman. Elie a<br />
tout distribué. Il lui en reste 0.<br />
Prenons maintenant nos jetons et nos petites<br />
assiettes de carton.<br />
Une maman a 3 enfants. Disposons leurs assiettes<br />
sur la table. Elle veut partager entre eux 15 pommes.<br />
Elle en donne d'abord une.à chacun. Elle a distribûo'<br />
ainsi une fois 3 pommes. Puis comme il en reste,<br />
elle en donne .encore une fois 3 et continue ainsi sa<br />
distribution jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus,,ou<br />
qu'il lui en reste un nombre insuffisant pour permettre<br />
une distribution complète. . Séparons les<br />
groupes de pommes au fur et à mesure do leurs<br />
distributions.<br />
000 ooo ooo ooo ooo 15 13<br />
1 l'ois ~ ' 0 |5<br />
La maman a pu donne/5 fois 3 pommes et il nd<br />
lui én reste plus. Combien chaque enfant a-t-il reçu<br />
de, pommes? s-> 5. — Comptons les jetons placée<br />
dans nos assiettes. Dans chaque assiette, il y a;<br />
5 jetons ou 5 pommes.<br />
Récitation.<br />
LES PETITS JARDINIERS<br />
Au fond de l'allée,<br />
Douce et bien sablée,<br />
Joyeuse assemblée<br />
Des petits blondinsy<br />
La mine sévère,<br />
Tout à leur affaire,<br />
S'amusent à faire<br />
Des petits jardins.<br />
Afin que ça pousse,<br />
Chacun sur la mousse,<br />
Renverse l'eau douce<br />
D'un bel arrosoir.<br />
La besogne faite,<br />
Mine satisfaite,<br />
On crie à tue-tête :<br />
« Maman, viens donc voir 1 »<br />
JULES JOUY.<br />
MULE R LAFOND,<br />
Directrice d'Ecole d'application.<br />
CERTIFICAT 0'ÉTU<strong>DE</strong>S. \2 Chants scolaires par A.DANGUEUGER et J. BONNET. ^Ôôhé'. 3.60
7 Avril 34 ÉDUCATION M O R A L E E T CIVIQUE 407<br />
EDUCATION MORALE ^<br />
La bonne humeur.<br />
Dans une leçon telle que celle-ci, le meilleur exemple<br />
que le maîlre ait à proposer, implicitement, à ses<br />
élèves, doit être le sien propre : nulle part mieux<br />
qu'en classe on ne saurait observer, en effet, les résultats<br />
heureux de la bonne humeur et l'influence salutaire<br />
qu'exerce sur autrui le spectacle d'un visage<br />
paisible et souriant.<br />
COURS ÉLÉMENTAIRE. — I. Jean qui<br />
pleure et Jean qui rit. — Tout lo monde, certainement,<br />
a chanté la chanson; et tout le monde<br />
aussi, j'en suis sûr, connaît des camarades qui<br />
ressemblent soit à l'un soit à l'autre de ces deux<br />
« Jean », c'est-à-dire que les uns ont toujours<br />
l'air désagréable, tandis que les autres ont toujours<br />
l'air gentil; les premiers sont toujours de mauvaise<br />
humeur, les autres toujours de bonne humeur. Il<br />
n'est pas difficile, n'est-ce pas, de s'en apercevoir :<br />
au premier coup d'œil, on sait à quoi s'en tenir.<br />
1° Les « Jean-qui-pleurc » ont le visage morne, le<br />
regard sombre, les lèvres maussades. Leur parlet-on,<br />
ils ne vous répondent pas ou vous disent des<br />
paroles revêches; s'approche-t-on d'eux, ils froncent<br />
les sourcils, se mettent en colère et sont prêts<br />
à vous donner un mauvais coup. Rien ne leur plaît,<br />
rien ne les intéresse ni ne les amuse. Ils ne cessent<br />
de se plaindre, de gémir, de grogner, et les occasions<br />
leur en manquent d'autant moins qu'ils commettent<br />
sottises sur sottises, maladresses sur maladresses.<br />
Mécontents d'eux-mêmes et des autres,<br />
COMPLÉMENTS POUR LES COURS<br />
MOYEN E T SUPERIEUR. — II. Importance<br />
de la bonne humeur. — L'égalité d'humeur, ce<br />
n'est pas du tout, comme nombre de gens l'ima<br />
A L'ECOLE <strong>PRIMAIRE</strong> m*mmmmm<br />
ginent, une vertu secondaire et dont nous avons lo<br />
droit de nous dispenser : c'est un devoir.<br />
1° Un devoir envers autrui, d'abord, parce qu'il<br />
est profondément injuste de faire subir à ceux qui<br />
nous entourent, par notre impolitesse ou notro<br />
maussaderie, les conséquences d'événements où ils<br />
ne sont pour rien;<br />
2"Un devoir envers nous-mêmes, ensuite, car la<br />
bonne humeur a la plus heureuse inlluence sur notre<br />
vie intellectuelle et sur notro perfectionnement<br />
moral.<br />
« D'abord, elle porte bonheur. C'est une vérité delà<br />
dernière évidence. N'avez-vous pas remarqué que, dans<br />
vos jours de très bonne humeur, la fortune vous a étc<br />
mystérieusement favorable ? Ce sont ces jours ofi tout<br />
nous réussit, où tout nous sourit. Tous nos souhaits<br />
sont exaucés; les affaires les plus embrouillées se démêlent<br />
et s'éclaircissent comme par magie... Rien n'inspire<br />
comme la bonne humeur. Il n'y a pas de café, pas d'élixir<br />
qui vaille la bonne humeur pour éclaircir les idées. Quand<br />
on est de mauvaise humeur, on fait mal tout ce qu'on a<br />
à faire. La bonne humeur, au contraire, c'est la grâce,<br />
c'est l'harmonie, c'est le tact.<br />
« Voici un troisième bienfait de la bonne humeur, et<br />
non le moindre : elle nous rend meilleurs. Elle nous<br />
dispose à la bienveillance et à l'indulgence. Nous imaginons<br />
partout de bons sentiments,de bonnes intentions;<br />
nous prenons tout en bonne part. La bonne humeur est<br />
contagieuse et c'en est le plus grand bienfait. Quand<br />
nous sommes vraiment de bonne humeur, tous les visages<br />
s'éclairent autour de nous. Nous rayonnons, c'est-àdire<br />
que notre bonne humeur rayonné, comme la chaleur<br />
de nous à ceux qui nous approchent. »<br />
les
403 LECTURE DU SAMEDI 7 Avril 34<br />
L'homme de bronze et l'homme de bois.<br />
Le petit Nils Holgersson, qui a été changé en<br />
tomte (sorte de lutin, de génie familier du foyer<br />
Scandinave), se promine une nuit dans la ville de<br />
Iiarlskrona.<br />
Il n'y avait pas un être vivant sur la place; seul<br />
un homme de bronze se dressait sur un socle élevé.<br />
C'était un grand homme vigoureux, vêtu d'un<br />
chapeau tricorne, d'une longue redingote, de culottes<br />
courtes et de gros souliers. I] tenait à la main un<br />
bâton et avait bien l'air de savoir s'en servir au<br />
besoin, car il avait un visage terriblement sévère<br />
avec un grand nez recourbé et une bouche très<br />
laide.<br />
a Qu'est-ce qu'il lait ici, celui-lù, avec sa grosse<br />
lèvre pendante? » dit enfin le gamin. Jamais il ne<br />
s'était senti plus petit et plus misérable que ce soir,<br />
il essaya de se donner du courage en faisant le<br />
fanfaron<br />
Il n'avait fait que quelques pas lorsqu'il entendit<br />
quelqu'un marcher derrière lui. Des pieds lourds<br />
martelaient le pavé et un bâton frappait le sol. On<br />
eût dit que l'homme de bronze lui-même s'était<br />
mis en route. Nils épia les pas et se sauva en courant;<br />
il eut bientôt la certitude que c'était l'homme<br />
de bronze. La terre tremblait et les maisons en<br />
étaient secouées. Lui seul pouvait marcher aussi<br />
lourdement et Nils eut peur de son mot de tout<br />
à l'heure. Il n'osa tourner la tête<br />
« Il se promène peut-être pour son plaisir, pensat-il.<br />
11 ne pourra m'en vouloir do ce que j'ai dit.<br />
C'était sans mauvaise intention. »<br />
Au lieu de continuer tout droit, Nils prit une rue<br />
transversale. Mais il entendit bientôt l'homme de<br />
bronze qui s'engageait dans cette même rue, et il eut<br />
très peur. Comment trouver un refuge dans une<br />
ville où toutes les portes sont fermées ? Il aperçut<br />
à droite une vieille église de bois, entourée d'un<br />
vaste square. Il s'y précipita sans hésitation • a Si<br />
seulement j'arrive là, je serai bien protégé ».<br />
Tout à coup, il aperçut au milieu de l'allée qui<br />
menait à l'église un homme qui lui faisait des<br />
signes. II fut très heureux et s'approcha en hâte....<br />
Mais lorsqu'il fut arrivé tout près de l'homme,<br />
qui était debout sur un petit tabouret, au bord de<br />
l'allée, il s'arrêta interdit.
7 Avril 34 CALCUL : COURS PRÉPARATOIRE ET ÉLÉMENTAIRE 409<br />
AWHM^IQUhVvSWfM;!<br />
M'RTJilQURS 6 É OM^TRIE<br />
COUR S PREPA RATG<br />
Les nombres de 41 à 50.<br />
•I. Composer les nombres de 41 à 50. — Nous<br />
jouons à l'épicier. L'épicier dispose des boîtes de<br />
s:irdines sur un rayon : 4 piles de 10 boîtes font 40<br />
(4,paquets de bûchettes); il continue par uné5° pile<br />
de 10 : 41, 42... 49, 50. 5 piles de 10 boîtes font 50.<br />
Sur un autre rayon, il place 4 piles de 10 boîtes ou<br />
• R. : 360 I'.<br />
6. Une fruitière a acheté 250 f. de pommes. Mais<br />
une certaine quantité s'est avariée. Elle ne retire<br />
de la vente que 205 f. Quelle est sa perte ?<br />
s-> R. : 45 f.<br />
2° année. —1. Un épicier achète 96 f. de miel à<br />
12 f. le kg. 11 vend le miel en faisant un bénéfice de<br />
2 f. par ltg. Ouel est son bénéfice total ?<br />
9-> R. : 16 f.<br />
2. Un ébéniste a vendu 45 tables au prix moyen<br />
de 155 f. la table. Les tables lui reviennent à 5265 f.<br />
Quel bénéfice n-t-il réalisé sur sa vente ?<br />
»-> R. : 1710 r.<br />
3. Un crémier a acheté des fromages 250 f. les 100.<br />
Il les revend 36 f. la douzaine. Quel est son bénéfice<br />
sur 1000 fromages ? »-» R. : 500 f.<br />
4. Un propriétaire a acheté un immeuble 158 000 f. ;<br />
les réparations se sont élevées à 19 750 f. Il revend<br />
l'immeuble 190 000 f. Ouel est son bénéfice ?<br />
»-» R. : 12250 f.<br />
5. Un bijoutier achète 12 montres pour 2040 f.<br />
Il en revend 7 à 215 f. l'une et le reste à 2Û5 1'. la<br />
montre. Quel est son bénéfice total?<br />
s-> R. : 490 f.<br />
6. Une fruitière a acheté 125 kg. de pommes à 2 f.<br />
le kg. Mais 15 kg. de pommes so sont avariés. Le<br />
reste n'a pu Être vendu que 2 f. le kg. Quelle perte<br />
a subie la fruitière 1 »-»• R. : 30 f.<br />
CERTIFICATD'ÉTU<strong>DE</strong>S(j.GILLARD. Cent Dictées emprlZéTulï,&%rnie. avec3SSÏÏÏÏ!4.20
410 CALCUL : COURS MOYEN 7 Avril 34<br />
LES; MULTIPLES 0»U MÈTRE (révision).<br />
Exercices.— 1. Dans une longueur de 17 465 m.,<br />
que représentent les chiffres 5, 6, 4, 7 ?<br />
2. Combien de km. dans 75 hra.; 245 dam?<br />
3. Convertir en dam : 320 m.; 4 hm.; en mètres :<br />
2 km.; 3 hm. 4 dam.; 2 hm. 5 m.<br />
Problèmes. — t rc année. — 1. Combien faut-il<br />
de rails de 15 m. pour établir une ligne de tramway<br />
de 1455 m. ? »-• R. : 194.<br />
2. Quel est le poids de 7 dam. d'un tuyau de plomb<br />
qui pèse 4 kg. au mètre ? »-> R. : 280 kg.<br />
•1° année. —1. Combien faut-il de rails de 15 m.<br />
pour établir une voie de chemins de fer de 1 km.<br />
5G dam. de long ? R. : 208.<br />
2. Un arpenteur mesure un champ rectangulaire<br />
avec la chaîne d'un dam. Il la porte exactement<br />
8 fois suivant la longueur et 5 fois suivant la<br />
largeur. Dire en mètres le périmètre du champ.<br />
a-* R : 260 m.<br />
LA CIRCONFÉRENCE. LE CERCLE<br />
Exemples de cercles : roues, jetons, pièces de 10 t.,<br />
20 f.... Le tour du cercle ou circonférence. Le centre.<br />
Le rayon. Tous les rayons d'un cercle sont égaux.<br />
Exercices. -— 1. Avec une pièce de monnaie,<br />
tracer une circonférence, puis une autre. Découper<br />
les 2 cercles; constater qu'ils se superposent dans<br />
tous les sens.<br />
2. Orner une bande avec des cercles (les cercles<br />
peuvent empiéter les uns sur les autres); colorier.<br />
3. Plier un cercle en papier de manière que les<br />
2 parties se recouvrent exactement; le plier dans un<br />
autre sens. On obtient le centre. Vérifier que les<br />
rayons sont égaux.<br />
C O U R S M O Y E N<br />
ET CERTIFICAT D'ETU<strong>DE</strong>S<br />
L'INTÉRÊT<br />
Ce que c'est que l'intérêt.— Voire boulanger,<br />
pour donner de l'extension à son commerce, a décidé de<br />
livrer du pain dans des hameaux éloignés. Il a besoin<br />
d'une automobile, mais il lui manque de l'argent. Il<br />
s'adresse à son voisin pour lui emprunter 10 000 f .<br />
Ce dernier accepte moyennant un intérêt de 5 %.<br />
liaisons : service rendu; risques du prêteur. Le capital;<br />
le taux; l'intérêt; l'échéance.<br />
Calcul de l'intérêt. — I re année.— (Calcul de<br />
l'intérêt annuel). — 1. Le boulanger a emprunté<br />
10 000 f. à 5 %. Intérêt annuel? s>-> I = taux x centaines<br />
de francs du capital, ou 5 x 100 = 500 f.<br />
2. Le boulanger s'est engagé à rembourser les<br />
10.000 f. au bout do 3 ans. Quels intérêts aura-t-il<br />
versés pendant les 3 ans?~«-> I = 5 x 100 X 3<br />
= 1500 f.<br />
2= année. — 3. Le boulanger peut rembourser<br />
les 10 000 f. au bout de G mois. Calculer l'intérêt.<br />
. ., 5 x 100 X G „ „ ,<br />
Intérêt = — = 250 f.<br />
4. Il les rembourse en 9 mois 10 jours. Intérêt en<br />
1 jour, puis en 280 j., soit 388 f. 80 par excès.<br />
CALCUL MENTAL<br />
1 année. — 1. Calculer l'intérêt annuel de 200 f.<br />
300 f., 500 f., 1000 f. à 3 %, 4 -%, 5 %.<br />
2. Une personne emprunte 5000 f. à 4 %. Elle<br />
rembourse la somme prêtée à la lin de l'année. Que<br />
donne-t-eile ?<br />
3. Une maison valant 25 000 f. est louée de<br />
manière à rapporter 6 %. Quel est le montant du<br />
loyer ?<br />
2 « année.— 1. Calculer l'intérêt annuel, à 5 %,<br />
de 750 f., de 3200 f., de 4G00 f.<br />
2. Quel est l'intérêt à 3 % de 700 f. en 6 mois?<br />
en 3 mois ? de 8000 f. à 4 % en 9 mois ?<br />
3. Calculer l'intérêt de 2000 f. à 4 1/2 % en 180 j.;<br />
90 j.; 45 j.<br />
PROBLÈMES<br />
1 " année. — 1. Un épicier emprunte à une<br />
banque 4800 f. au taux de 7 %. Quel intérêt annuel<br />
aura-t-il à verser ? »-* R. : 336 f.<br />
2. Un rentier a placé un capital de 320 000 f. à<br />
4 1/2 %. Quel revenu annuel retirera-t-il de son<br />
placement ? »->• R. :14 400 f.<br />
3. J'ai un jardin qui m'a coûté 3500 f. Combien<br />
faut-il le louer pour qu'il me rapporte 4 % ?<br />
SH>- R. : 140 f.<br />
4. Un propriétaire possède un champ de 3 ha qui<br />
lui a coûté 1500 f. l'hectare. Combien devra-t-il le<br />
louer pour qu'il lui rapporte 3 1/2 % ?<br />
R. : 157 t. 50.<br />
5. Un commerçant a emprunté 55 000 f. à 5 %.<br />
Au bout d'un an, il rembourse la somme empruntée<br />
et ajoute les intérêts. Combien doit-il verser ?<br />
»->• R. : 57 750 f.<br />
6. Une maison de valeur 200 000 f. est louée de<br />
manière qu'elle rapporte 9 %. Le propriétaire paie<br />
700 f. d'impôts. Quel est le revenu net de la maison ?<br />
s-> R. :17 300 f.<br />
8 « année. — 1. Deux cultivateurs voisins avaient<br />
à céder l'un et l'autre 175 quintaux de blé. L'un<br />
vend sa récolte à 94 f. 50 le quintal et place son<br />
argent à 4 %. L'autre ne cède sa récolte que 3 mois<br />
et demi plus tard au prix de 95 f. 75 le quintal. Quel<br />
a été le marché le plus avantageux ?<br />
R. : Le 2 e marché; 25 f. 80 en plus.<br />
2. Une maison a coûté 85 000 f. Le propriétaire<br />
paie chaque année 1G0 t. d'impôts et dépense en<br />
moyenne par an 300 f. en réparations diverses.<br />
Combien doit-il louer sa maison pour en retirer un<br />
revenu net de 6 % ? R. : 5560 f.<br />
3. Sur un foirail, on compte en moyenne, chaque<br />
jour de foire : 300 voitures attelées, 100 automobiles,<br />
250 veaux, 60 bêtes à cornes, 500 paires de<br />
volailles, 500 douzaines d'œufs. Quelle sera la recette<br />
des droits de place si on applique le tarif suivant :<br />
volaille, 0 f. 25 la paire; œufs, 0 f. 10 la douzaine;<br />
automobiles, 1 f. ; voitures attelées 0 f. 50; veaux,<br />
2 f.; bêtes à cornes, 0 f. 50. (On recommande de<br />
représenter le décompte sous la forme de tableau).<br />
Quel séra le revenu annuel communal, si le recouvrement<br />
coûte 120 f. par foire et s'il y a 2 foires par<br />
mois ? (C. E. P.). »-> R. : 955 f. ; 20 040 f.<br />
4. Une personne a pu économiser une somme de<br />
75 000 f. Elle place les 2/5 de cette somme à 4,5 %<br />
et le reste à 5 %. Quel est son revenu annuel V<br />
(C.E.P.). »-+ R. : 3 600 f.<br />
5. J'avais acheté, à raison do 288 f. l'are, un terrain<br />
rectangulaire de 45 m. de long et de 152 m. de<br />
périmètre. Je me suis acquitté 6 mois après l'achat<br />
et j'ai payé, en plus du prix, un intérêt de 6 1/2 %.<br />
A combien me revient le terrain ? [C. E. P.).<br />
R. : 4148 f. 15.<br />
6. Une personne a fait construire pour la somme<br />
de 475 000 f. un immeuble comprenant 8 logements<br />
qui seront loués tous au même prix. Cette personno<br />
déclare avoir un revenu net de 6 % % de la somme<br />
qu'elle a déboursée. Sachant qu'elle supportera<br />
chaque année des frais divers s'élevant à 1/50 do<br />
la même somme, on demande : 1° la somme totale<br />
qu'elle doit recevoir annuellement de tous ses locataires;<br />
2° le montant du loyer trimestriel de chaque<br />
locataire. (C. E. P.).<br />
K-Î-R. : 40 375 f. — 1261 f. 75.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. J. LE BAS. Cent Dictées s' assées dan * , Avec question» a<br />
_______________________ M. I_u U/W. v m i l'ordre grammatical, e f réponses. *•"«»
7 Avril 34 L A N G U E FRANÇAISE': COURS PRÉPARATOIRE<br />
CENTRE D'INTÉRÊT : LE PRINTEMPS<br />
[ C O U R S P R É P A R A T O I R E ]<br />
I. — RÉCITATION<br />
LE PINSON<br />
Le printemps naît aujourd'hui.<br />
Parmi les floraisons blanches<br />
Un pinson chante les branches.<br />
Tui tui, tio tio tui !<br />
Sous les pieds les roses franches<br />
Font de fines avalanches;<br />
L'oiseau va, vient et s'enfuit...<br />
Tui tui, tio tio tui !<br />
ROBERT CAMPION.<br />
Rimes paysannes. Molière, à Lisieux.<br />
II.— ÉtOCUTION ET VOCABULAIRE<br />
CONTE D'UN SOIR <strong>DE</strong> PRINTEMPS<br />
Dans un joli village vivait autrefois une bonne grand'<br />
mère... En ce temps-là, la nuit, le peuple des fées couchait<br />
ses bébés dans les tulipes, pour qu'ils pussent y<br />
dormir comme dans des berceaux.<br />
Or, un soir, la vieille grand'mère entra dans son jardin<br />
et elle trouva de grosses tulipes blanches. Dans chaque<br />
tulipe donnait un -petit bébé de fée. La grand'mère fut<br />
bien contente de voir ces bébés. Et elle prit sa pelle, sa<br />
befchei son râteau, son arrosoir et son plantoir, et plantai<br />
le long des allées des centaines, et des centaines .d'oï-j<br />
gnons de tulipes pour que les fées aient des berceaux pour<br />
leurs' petits. « Comme la grand'mère est gentille ! se<br />
dirent les .fées. Il-faut la. récompenser de sa bonté. » Et,<br />
à la place de son ancienne demeure, les fées firent une<br />
jolie chaumière toute fleurie. Ses murs étaient de boutons<br />
de roses; pour tuiles le toit avait des feuilles de<br />
lierre, et les fenêtres étaient en gouttes de rosée.<br />
D'après J. NEWMAN. Dans le royaume des fleurs.<br />
Élocution. •—• Se procurer quelques tulipes el les<br />
observer. — En quelle saison poussent les tulipes ?<br />
— Où se passe cette histoire? — Au. lieu.de : le<br />
peuple des fées, on pourrait dire... î — Que faisaient<br />
les fées? — Pourquoi? — Qu'arriva-t-il un soir?<br />
— Que pensa la grand'mère ? — Que fit-elle ? —<br />
A quoi servent: une pelle? une bêche? un râteau?<br />
un arrosoir ? un plantoir ? — Que planta la grand'<br />
mère ? — Que fait-on avec certains oignons ? »-»<br />
Pourquoi les fées furent-elles contentes ? — Que<br />
firent-elles? Comment était la maison qu'elles construisirent?<br />
Vocabulaire. — 1° Le printemps est la saison du<br />
renouveau. La température s'adoucit, les arbres se<br />
couvrent de bourgeons, puis de feuilles nouvelles. Les<br />
p ontes se garnissent de boutons et bientôt, la violette.<br />
ia primevèi'e, :a pâquerette fleurissent nos jardins.<br />
2° En avril, on sort les toilettes printanières, on se<br />
promène dans les jardins fleuris, les prés verdoyants,<br />
les bois égayés de joyeux chants d'oiseaux. On est<br />
heureux de revoir le ciel bleu à travers les bourgeons<br />
bruns.<br />
3° Les arbres bourgeonnent, les fleurs éclosent,<br />
s'épanouissent et embaument le jardin. Les oiseaux<br />
construisent leurs nids. Le cultivateur laboure et<br />
ensemence ses champs.<br />
CERTIFICAT O'ÉTUOES. G. <strong>MANUEL</strong>, 100<br />
, C O U R S É L É M E N T ' M R E .<br />
1. — TEXTES A ÉTCOIER<br />
A. — LE P RINTEMPS (Récitation).<br />
Voici que le printemps, ce fils léger d'Avril,<br />
Seau page en pourpoint vert brodé de roses blanches,<br />
Paraît, leste, fringant et les poings sur les branches,<br />
Comme un prince acclamé revient d'un long exil.<br />
Les branches des buissons verdis rendent étroite<br />
La route qu'il poursuit en dansant comme un fol,<br />
Sur son épaule gauche il porte un rossignol,<br />
Un.merle s'est posé sur son épaule droite.<br />
Et les fleurs qui dormaient sous les mousses de bois<br />
Ouvrent leurs yeux où flotte une ombre vague et tendre<br />
Et, sur leurs petits pieds, se dressent pour entendre<br />
Les deux oiseaux siffler et chanter à la fois.<br />
PAUL BOURGET.<br />
B. — LA F ÊTE DU PRINTEMPS<br />
Des petits garçons et des petites filles marchaient<br />
au pas en Chantant. C'était un vieil air d'autrefois.<br />
Réveillez-vous, belle endormie,<br />
Réveillez-vous si vous dormez.<br />
Cette belle endormie, c'est la nature qui s'étire après<br />
le sommeil hivernal et sourit dans les bois et les jardins.<br />
Après quoi ils se rangèrent sur la pelouse et il s dansèrent<br />
une pavane. Je leur distribuai des sous et même de la<br />
monnaie blanche. Ils me remercièrent à peine et ils<br />
s'enfuirent au pavillon. Attablés, ils mangeaient, ils<br />
buvaient, ils riaient la bouche pleine. Et ils s'en retournèrent<br />
les joues rouges et le ventre gonflé, vers d'autres<br />
maisons, vers, d'autres villages.<br />
Partout, ils récueillent des cadeaux, du pain, du fromage,<br />
des œufs, du beurre, mais on ne leur donne pas d'argent.<br />
Les pauvres mêmes leur offrent quelque chose. On ne<br />
refuse rien à ceux qui annoncent les beaux jours.<br />
H faut prendre garde quand on voit passer des ribambelles<br />
de petits enfants dans les jours qui s'allongent.<br />
Us nous avertissent de guetter le printemps et de nous<br />
réjouir quand nous l'apercevons à distance.<br />
D'après H . BOR<strong>DE</strong>AUX. La robe de laine. Pion.<br />
Élocution. — De quelle fête s'agit-il ? — A<br />
quelles fêtes avez-vous déjà assisté ? — Qui célébrait<br />
cette fête ? — Que chantaient les enfants ? —<br />
Oui est celle belle endormie 1 — Comment comprenez-vous<br />
: le sommeil hivernal ? — Au lieu de pavillon,<br />
on pourrait dire ? — Comment les enfants furentils<br />
reçus? — Qu'est-ce qui nous montre qu'ils étaient<br />
joyeux? — Pourquoi : joues rouges et ventre gonflé?<br />
— Au lieu de recueillent, on pourrait dire? »->• Reçoivent.<br />
— Quels cadeaux leur fait-on ? Pourquoi ?<br />
On est à la campagne. — Quel rôle jouent ces enfants?<br />
»-> Messagers du printemps..— Qu'annoncentils<br />
ainsi ? »-> La joie qu'amènent le soleil, la verdure,<br />
les fleurs, les jours plus longs. —• Au lieu de ribambelles,<br />
on pourrait dire....? — Qu'est-ce qui, dans<br />
la nature, annonce le printemps""?<br />
II, _ VOCABULAIRE<br />
1° Noms. — L'arrivée des cigognes et le retour<br />
des hirondelles annoncent le printemps. La nature<br />
se réveille de son long engourdiscmenl, la sève à<br />
nouveau circule, une fraîche floraison couvre les<br />
arbres fruitiers. Les saules balancent leurs chatons<br />
et les rameaux sont fiers de leur verdure neuve.<br />
2° Adjectifs. — Le printemps est précoce ou<br />
tardif. Un souffle attiédi passe sur la campagne. Une<br />
sève abondante et visqueuse jaillit des bourgeons<br />
Dictées "Tt^ponsês. 3 3 séries. La série. 4.60
412<br />
LANGUE FRANÇAISE : COURS ÉLÉMENTAIRE<br />
tjonflés. Les nids se garnissent d'un moelleux duvet.<br />
3° Verbes. — La nature semble renaître et<br />
sourire, les bourgeons pointent, se.gonflent, croissent,<br />
(datent. Les bois reverdissent, les oiseaux gazouillent<br />
en bâtissant leurs nids.<br />
Exercices. — i° Complétez les phrases : Les oiseaux<br />
fêtent à leur manière... [le retour du printemps) par...<br />
(de joyeux gazouillis). Le soleil rit à travers... (de rares<br />
giboulées). Der parfums de fleurs... (embaument l'atmosphère).<br />
2° Construisez 5 phrases avec les mots : sève, floraison,<br />
chatons, précoce, croître.<br />
III. - GRinilUIBli HT («V.I! tl!SO\<br />
A. — L'adjectif attribut.<br />
1° L'adjectif qualificatif est épilhète quand il<br />
précède ou suit immédiatement un nom. Ex. : Ces<br />
plantes ont de grandes fleurs pourpres.<br />
2° Il est attribut du sujet quand il est séparé du<br />
sujet par un dos verbes : cire, sembler, devenir,<br />
paraître... Ex. : Cet enfant semble souffrant.<br />
Exercices. — i° Construisez 4 phrases où se trouvera<br />
un adj. attribut.<br />
2 0 Analysez les adj. dans les phrases : Vous serez<br />
surpris des progrès rapides de la végétation. Ces petits<br />
poussins iaunes paraissent vigoureux. Ces élèves deviennent<br />
attentifs et leur application semble durable.<br />
13. — Le passé composé avec l'auxiliaire être<br />
dans les verbes en er (1 er groupe).<br />
Le poteau est tombé-, la treille est tombée au pied<br />
de la maison.<br />
Dans ces phrases, les verbes : est tombé et est<br />
lombée, sont composés de l'auxiliaire être au présent<br />
et du verbe tomber (1 er groupe) au participe passé.<br />
Remarquons que lorsque le sujet du verbe est au<br />
féminin (treille), le participe passé prend la marque<br />
du féminin : e. Il y a accord du participe avec le<br />
sujet. (Pas d'accord quand l'auxiliaire est : avoir).<br />
Exercices.— i u Conjuguez au passé composé : arriver<br />
à destination, tomber de haut, en mettant les sujets :<br />
a) au masculin; b) au féminin.<br />
2 0 Analysez les verbes dans les phrases : l'enfant est<br />
parti ; mes amies et moi, nous sommes entrées en trombe;<br />
ton frère et toi êtes restés à la maison. Justifiez l'orthographe<br />
de ces verbes.<br />
IV. — OItTÎI«GR,tl*ÏIE<br />
A. — PRINTEMPS AU VILLAGE<br />
La rosée gouttait des arbres, les oiseaux gazouillaient<br />
dans leurs nids et, au village, retentissaient déjà çà et là<br />
les bêlements des moutons et les mugissements des<br />
troupeaux que l'on chassait vers les pâturages. Quelqu'un<br />
commençait à passer sa faux sur la pierre, et ce<br />
menu son aigu résonnait clairement.<br />
L. REYMONT. Les Paysans, le Printemps.<br />
Traduction FRANCK L . SCIIVELL. Payot.<br />
Observons et justifions. — Printemps (température);<br />
gazouillaien! (sujet pluriel); ni(Zs; déjà;<br />
çà et là; bêlemen/s; pâturages; troupeau! (plur.<br />
des mots en eau = x); faui; résonnai/ (s entre<br />
2 voy.; 3 e pers. imparfait).<br />
B LA FÊTE DU PRINTEMPS<br />
Texte de l'élocution, depuis le début jusqu'à<br />
jardins.<br />
Observons et justifions. — Fâte; marchaienî<br />
(sujet plur.); d'autrefois; réveillez, dormez (2° pers.<br />
plur.); endormie (se rap. à belle); sommeil; hivernal<br />
(hiver).<br />
7 Avril 34<br />
V. — LA PHRASE<br />
Tout verdoie: trembles aux feuilles blondes, charmes<br />
el hôtres aux verdures tendres.<br />
D'après A. THEURIET<br />
1° Explication. — Cette phrase ne contient qu'un<br />
verbe : verdoie (verdoyer) placé au commencement<br />
de la phrase, bien en relief, pour lui donner toute son<br />
importance; il exprime en effet l'idée principale, mais<br />
vague (tout). Les 2 points qui isolent cette partie de<br />
phrase indiquent qu'une explication va suivre<br />
(trembles..., charmes...). L'auteur a supprimé les<br />
devant trembles et charmes de même qu'il a supprimé<br />
le verbe verdoie dans ces 2 parties do phrase (les<br />
(sous-entendu) trembles aux feuilles blondes verdoient...)<br />
pour alléger la phrase, en rendre le débit<br />
plus rapide, plus élégant. Ces 2 parties de phrase<br />
sont équilibrées en ce sens que trembles correspond à<br />
charmes el hêtres, feuilles à verdure et blondes à<br />
tendres.<br />
2° Imitation. — Sur ce modèle, construisons des<br />
phrases commençant par : tout travaille..., touchante...,<br />
tout pousse..., tout fleurit... (au printemps).'<br />
I. COURS MOYEN „<br />
ET CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S<br />
1. — TEXTES A ÉB'IJIHESÏ<br />
A.— MATIN <strong>DE</strong> PRINTEMPS (Récilalion.)<br />
La pluie, enveloppante, ombrage<br />
L'espace, les bois, la prairie,<br />
Et forme sur le paysage<br />
Une cage en verroterie.<br />
C'est la pluie allègre d'avril,<br />
Elle est mince, dansante et lâche<br />
Comme des perles sur un fil.<br />
Elle est joyeuse ! C'est sa tâche<br />
De descendre en jets allongés,<br />
De se glisser, de se loger<br />
Dans les fentes et les entailles<br />
Des bourgeons aux vertes écailles...<br />
Soudain la voici qui s'arrête<br />
Et qui suspend ses gouttelettes...<br />
Le soleil renaît, résolu.<br />
Que l'air est bon quand il a plu !<br />
COMTESSE <strong>DE</strong> NOAILLES.<br />
Les Forces éternelles. Fayard.<br />
B. — L'APPEL AU PRINTEMPS EN ENGADINE.<br />
Une nuit, je fus réveillé par un vacarme effroyable.<br />
Cors de chasse, fifres, clairons, tambours et sonnailles,<br />
gongs et timbales, grelots et crécelles, et aussi casseroles<br />
attachées à la queue des chiens fous, il y avait tout cela<br />
dans cet infernal charivari. Dans la nuit dont triomphait<br />
l'éclat des torches, j'aperçus cinquante ou cent gamins<br />
se démenant comme des démons, soufflant à pleins<br />
poumons ou tapant à tour de bras et la lumière était<br />
suffisante pour distinguer leurs visages triomphants. Us<br />
défilèrent et peu à peu la tempête qu'ils avaient déchaînée<br />
s'éteignit.<br />
Au malin, l'auteur s'informe el il lui est répondu :<br />
« C'est la fête du printemps. » La fête du printemps !<br />
mars commençait à peine, et il avait neigé la veille...<br />
Elle me parut un peu précoce, la fête du printemps.<br />
Elle se célèbre en Engadine à la veille des jours gras. Et<br />
ce formidable bacchanal est destiné à chasser l'hiver.<br />
On lui signifie son congé rudement. Il le faut bien, dans<br />
uu pays où il est enclin à s'endormir pour ne plus s'en<br />
aller. Si personne ne lui criait aux oreilles : « Allez<br />
vous-en ! » il s'acclimaterait volontiers toute l'année.<br />
CERTIFICAT D'ÉTUOES. G. <strong>MANUEL</strong>. 100 Rédactions 3 séries. La série. 3.60
17 Avril 34 LANGUE FRANÇAISE : C OURS MOYEN 413<br />
Ainsi, là-bas, on adresse au printemps de suppliants<br />
appels dans le froid de la nuit.<br />
D'après H. BOR<strong>DE</strong>AUX. La robe de laine. Pion.<br />
, Élocution. — h'Engadine se trouve en Suisse.<br />
|— Qu'y va-t-on faire l'hiver? »->• Patiner, luger,<br />
! faire" du ski... — A quoi correspond cette fête?<br />
W Usage régional. — Quel caractère a-t-elle ?<br />
»-> Un peu barbare. — Quels en étaient les acteurs ?<br />
— Donnez des synonymes do vacarme. »-> Tapage,<br />
charivari, bacchanale. — De quels instruments se<br />
servent les enfants ? — Pourquoi les chiens étaientils<br />
fous ? — Montrez la justesse du mot charivari.<br />
»-* Ensemble de bruits violents et discordants. —<br />
Justifiez l'emploi du mot: démons. »-> Flamme des<br />
,torches, charivari infernal. —Pourquoi : tempêtel<br />
—• Donnez des synonymes do s'éteignit. »-> S'atténua,<br />
se perdit... —- Que répond-on à l'auteur? —<br />
Pourquoi est-il étonné? —A quelle date commence<br />
.le printemps ? -— Qu'entend-on par fours grasl —<br />
Ouel est le but de ce tapage? •—-Expliquez : on lui<br />
signifie son congé. — Pourquoi adresse-t-on au printemps<br />
de suppliants appels 1 s-> On souffre beaucoup<br />
du froid, l'hiver, dans ce pays.<br />
II. _ VnCABillIi.llitE<br />
1. Noms. — Au printemps, les primeurs apparaissent<br />
sur nos marchés. C'est dans la nature une<br />
résurrection générale, une transformation complète.<br />
Sous la caresse des rai/ons printaniers s'opèrent<br />
Véclosion des boutons, Vépanouissement des fleurs,<br />
le développement des pousses, la feuillaison des bois.<br />
C'est la saison de Véquinoxe.<br />
2. Adjectifs. •—- La végétation champêtre, la<br />
forêt feuillue, touffue, les vergers poudrés à frimas<br />
embellissent la nature. Les grelots tremblants du<br />
muguet répandent, d'agrestes parfums. Une brise<br />
molle, un souffle fécondant et vivifiant, avec une joie<br />
communicalive, une allégresse générale errent par<br />
la campagne.<br />
3. Verbes. — Sœur Anne disait : Je ne vois que<br />
le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Les<br />
plantes foisonnent, les oiseaux pullulent et s'égosillent<br />
dans les buissons à fêler le renouveau. Le<br />
soleil avive les couleurs et réjouit tous les cœurs.<br />
Les vieillards eux-mêmes se ragaillardissent.<br />
4. Etude des suffixes on et ule. — Ils ont la<br />
valeur de diminutifs : caneton : petit canard; planiule<br />
: petite plante.<br />
Exercices. — i° Construisez 5 phrases où entreront<br />
les mots : résurrection, pousses, équinoxe, s'égosiller,<br />
foisonner.<br />
2° Ajoutez 2 qualificatifs à chacun des noms : végétation<br />
(drue, tendre); bourgeons (gorgés de sève, rougeâtres);<br />
allégresse (universelle, débordante).<br />
3° Avec les mois : paillasse, bourriche, jupe, manche,<br />
racine (radicule), formez des diminutifs en on ou ule que<br />
vous ferez entrer dans une phrase.<br />
m . — ET conjugaison<br />
A. — La préposition.<br />
1° RÔLE. — Je parler! Jean; il rentre chez lui; j'ai<br />
acheté un bouquet de violettes. Dans ces 3 phrases,<br />
les compléments : Jean, lui, violettes sont indirectement<br />
reliés au mot qu'ils complètent [verbe,<br />
nom) par un petit mot : à, chez, de, appelé préposition,<br />
placé (position) avant (pré) le complément.<br />
Les prépositions sont invariables.<br />
2° LISTE <strong>DE</strong>S PRÉPOSITIONS. — Voir livre. —<br />
a) Certaines prépositions peuvent être adverbes, ex. :<br />
devant; — b) Orthographe de malgré, parmi.<br />
3° REMARQUES. — Distinguer des (enfants) de<br />
dès (votre arrivée); a (il a vu) de à (Paris); près de<br />
(vous) de prêt à (tout); quand (je serai vieux...) de<br />
quant à (moi...); à travers (champs) de au travers de.<br />
4° ANALYSE. — Étude des rapports marqués par<br />
les prépositions.<br />
Exercices. — x° Soulignez les prépositions dans les<br />
phrases : J'ai acheté une botte de poireaux, la taupe<br />
vit sous terre, le serpent rampe à terre; on trouve des<br />
carpes dans les étangs.<br />
2° Analysez ces prépositions.<br />
3° Construisez 5 phrases avec les prépositions : après,<br />
depuis, dès, malgré, voilà.<br />
B. — Le mode subjonctif : temps présent.<br />
Dans la phrase : Je veux que tu viennes, il y a<br />
2 propositions : pr. principalo : je veux; pr. subordonnée,<br />
complément do veux ; que tu viennes. Le<br />
verbe vienne dans une subordonnée complément du<br />
verbe de la principale est au modo subjonctif;<br />
l'action de venir dépend de l'action de vouloir.<br />
La conjonction de subordination unit le verbe qui<br />
est au mode indicatif à celui qui est au subjonctif;<br />
ce dernier mode se conjugue avec la conjonction<br />
que.<br />
Le présent du subjonctif peut exprimer le futur :<br />
je souhaite qu'il fasse beau pendant les vacances.<br />
Pour reconnaître si, dans une phrase, un verbe est<br />
à Vindicatif ou au subjonctif présent (ex. : il faut que<br />
je coure plus vite; je crois que je cours plus vite quo<br />
toi); a) on considère le sens : le verbe dépend-il ou<br />
non du 1 er verbe ? b) on l'emploie à la l re et à la<br />
2 e pers. du pluriel (il faut que nous courions...., je<br />
crois que nous courons...)<br />
Conjugaison au sub.j. présent : des verbes modèles<br />
des 3 groupes; des auxiliaires avoir et être (remarques),<br />
do quelques verbes irréguliers.<br />
Exercices. — i° Dicter les phrases : Croyez-vous que-<br />
Louise ait égaré son livre ? Oui, son livre est égaré.. Il est<br />
sans doute dans son armoire, celle-ci est en désordre.<br />
Il faut que j'aie retrouvé ce livre dans 5 minutes; c'est<br />
fait, j'ai retrouvé le livre, mais il est détérioré.<br />
2 0 Avec les verbes : planter, finir, prendre, faire, voir,<br />
construisez 5 phrases où ces verbes seront employés :<br />
a) à l'indicatif présent; b) au subjonctif présent.<br />
IV. — ORTHO«Bl,ia»nE<br />
A. — RENOUVEAU<br />
Le village semblait se réveiller, non seulement de la<br />
nuit, mais de l'hiver lui-même, sous les fraîches caresses<br />
de cette matinée. C'est un délicieux et fin paradis que es<br />
pays de Thiérache, lorsque arrive le renouveau. L'humidité<br />
naturelle de la région gonfle les tiges de l'herbe,<br />
monte en sève sous l'écorce tendre des arbres, et s'épanouit<br />
en riante et vigoureuse verdure. Les coups de<br />
vent soufflant du nord,les tournasses de pluie arrivant<br />
des Ardennes, ne sont pas à craindre en cette saison. Uns<br />
brise molle court sur la campagne, en battant des ailes<br />
parmi les feuilles, et leur apporte la lointaine odeur salée<br />
de la mer.<br />
J. RICIIEPIN. Miarka. Fasquelle.<br />
Observons et justifions. — Réveiller (quand<br />
2 verbes se suivent, le 2 8 est ù l'infinitif); caresses;<br />
paradis (paradisiaque); ï'ftiérache (entre le cours<br />
supérieur de l'Oise et la Serre); écorcc; coups;<br />
tournasses (tourbillons de vent avec pluie); courf<br />
(ind. présent).<br />
B. - PRINTEMPS<br />
L'année s'annonçait très chaude et très précoce.<br />
De ma petite fenêtre, je voyais tout reverdir sur la côte:<br />
les genêts à boutons d'or et les bruyères roses s'étendaient<br />
jusque sous les roches où la myrtille, la ronce et le chèvrefeuille<br />
grimpaient à foison. Chaque matin, je m'éveillais<br />
au chant du coq... Les coudes sur le toit, j'admirais<br />
les grands bois noyés dans l'azur du vallon; j'écoutais<br />
CERTIFICA T D'ÉTU<strong>DE</strong>S. 26 Chants scolaires d'auteurs différents. I vol. in-16, cart. 4.60
414 LANGUE FRANÇAISE : COURS SUPÉRIEUR 7 Avril 34<br />
les merles, les. grives, les chardonnerets, les fauvettes<br />
s'égosiller au loin, dans les cerisiers en fleur. Us bâtissaient<br />
les nids et se réjouissaient..<br />
ERCKMANN-CIIATRIAN.<br />
Histoire d'un sous-maître. Hachette,<br />
Questions d'examen. — 1° Expliquez : précoce,<br />
à foison, s'égosiller.<br />
2° Analysez : très (chaude); tout (reverdir); jusque<br />
(sous les roches); fauvettes.<br />
3° Nature et fonction des propositions dans la<br />
phrase : De ma petite fenêtre... foison.<br />
V. LE lMRIGRtPlIE<br />
Sujet de devoir. — Comment se traduit, autour<br />
de vous, la joie née de l'arrivée du printemps?<br />
DÉVELOPPEMENT POSSIBLE. — Une joie confuse<br />
semblait circuler dans les veines do la terre et<br />
s'exhaler dans l'air, par les. mille clochettes laiteuses<br />
des muguets, par les mignonnes capuces odorantes<br />
des violettes étalées aux marges des pïéfe. C'était Une<br />
joie communicative. Elle éclatait en rires clairs sur<br />
les lèvres des petites filles assises au pied des haies<br />
et occupées à confect onner des balles avec dés<br />
fleurs de coucou; elles s'épanouissait sur les faces<br />
joufflues des petits pâtres battant du manche de<br />
leur couteau, des brins.de saule pour .en détacher<br />
l'écorce juteuse et fabriquer des sifflets..., elle<br />
gagnait îusqu'aux cloches de l'église, dont les voix<br />
moins grêles s'égrenaient avec une allégresse inaccoutumée:<br />
'<br />
A THEURIET. Sauvageonne.<br />
C O U R S S U P E R I E U R<br />
1. — RECITAT! OY<br />
AVANT-PRINTEMPS<br />
C'est lé sâlutj et c'est l'accueil<br />
Aux lèvres, aux mains mi-ouvertes.<br />
La vigne n'est pas encore verte<br />
Et pend frileuse sur le seuil.<br />
Oh dirait qu'une voix chuchote<br />
De vague espoir, et n'ose pas...<br />
Des rires s'échappent tout bas,<br />
Se taisent soudain, et sanglotent.<br />
Les oiseaux volent indécis<br />
Au bord du grand ciel doux et gris<br />
Où le soleil pâle tisonne<br />
Et le voyageur s'arrêtant<br />
Hésite si c'est le printemps<br />
Ou l'adieu voilé de l'automne.<br />
AMÉDÉE ROUQUÈS. L'Aube juvénile. Lemcrre.<br />
11. VOCABULAIRE<br />
Voir Cours Moyen. — Ajouter l'étude des expressions<br />
Le cycle des saisons, l'éternel recommencement,<br />
le printemps de la vie (jeunesse), l'éveil de<br />
la Belle au bois dormant (nature), l'arrivée du<br />
prince Charmant (printemps), tout un printemps<br />
tient dans ce morceau de toile, compter seize prin<br />
temps (16 ans). — Faire expliquer : réticule (petit<br />
sac); pécule (économies de petite importance);<br />
ovale (petit œuf); upalule ;sort.e de petite cuiller);<br />
vésicule (petite vessie); édicule (petit édifice);<br />
monticiue...<br />
III. — GRAMMAIRE E T C 0 \ J I G A I 8 0 »<br />
A. Voir Cours moyen. — Ajouter l'étude des<br />
locutions prépos.tives : prépositions formées de<br />
plusieurs mots ex. : afin de, jusqu'à..<br />
B. Voir Cours moyen. — Préciser que le subjonctif<br />
s'emploie dans des proposions indépendantes<br />
ou principales avec ou sans que. II peut exprimer :<br />
a) un ordre; 6) un vœu; e) une affirmation atténuée;<br />
d) une supposition une concession (je consens qu'une<br />
femme ait des clartés sur tout. Molière). Si l'action<br />
principale est exprimée au présent ou au futur, on<br />
exprime généralement l'action subordonnée par le<br />
subjonctif présent si cette action est présente ou<br />
future par rapport à l'action principale; Ex. : J e<br />
souhaite (présent) qu'il se ravise (présent ou futur).<br />
I V ORTIIOKRAIMIE<br />
PRINTEMPS EN BRETAGNE<br />
Je reviens encore à vous, ma bonne, pour vous dire que,<br />
si vous avez envie de savoir, en détail, ce que c'est qu'un<br />
printemps, il faut venir à moi.<br />
Je n'en connaissais moi-même que la superficie; j'en<br />
examine cette année jusqu'aux petits commencements.<br />
Que pensez-vous donc que ce soit que la couleur des<br />
arbres depuis huit jours ? Répondez. Vous allez dire :<br />
«Du vert». Point du tout, c'est du rouge. Ce sont de<br />
petits boutons,tout prêts à partir, qui font un vrai rouge;<br />
et puis ils poussent tous une petite-feuille, et comme c'est<br />
inégalement, cela fait -un. mélangé trop, joli de vert et<br />
de rouge.<br />
Nous couvons tout cela des yeux : nous parions de<br />
grosses sommes — mais c'est à ne jamais payer — que<br />
ce bout d'allée sera tout vert dans deux heures; on dit que<br />
non; on parie. Les charmes ont leur manière, les hêtres<br />
une autre. Enfin je sais sur cela tout, ce que l'on peut<br />
savoir.<br />
MADAME D E SÉVIGNÉ. Lettre à Mme de Grignan.<br />
Questions d'examen. — 1° Que savéz-vous sur<br />
Madame de. Sévjg.né? ,.r<br />
2° Qu'est-ce qui fait l'étonnement et l'admiration<br />
de l'auteur ? »-» La fraîcheur des couleurs des bourgeons<br />
et dos feuilles et la rapidité de leur transformation.<br />
3° Sur quel ton est faite cette jolie description ?<br />
4° Analysez : depuis (huit jours)', tout prêts à partir.<br />
V. — RESTACTIOX<br />
Au cours d'une promenade printanièrè, il vous a<br />
semblé entendre les voix de la nature. Que vous ontelles<br />
dit ?<br />
Développement possible. — A. INTRODUCTION.<br />
— Circonstances au -cours desquelles vous avez<br />
entendu ces « voix de la nature ».<br />
B. DÉVELOPPEMENT.— a) La transformation de là<br />
nature : « Pendant que tu jouais, enfant, le grand jeu<br />
de la nature, la superbe et splendide transformation<br />
de la terre, s'est accomplie, b) Sa parure nouvelle :<br />
La voilà vêtue do sa robe verte aux plis immenses;<br />
qu'on appelle des montagnes et des coteaux, c) Son<br />
rôle utilitaire de mère nourricière : Crois-tu que ce<br />
soit seulement pour te donner des marguerites,<br />
qu'elle a versé de son sein cet océan d'herbe et de<br />
fleurs? Non, amie; la grande nourrice, la maman<br />
universelle, a d'abord servi ce bouquet à nos humbles<br />
frères et sœurs par lesquels elle nous nourrit.<br />
d) Les bêles qui bénéficient de ses bienfaits : La bonne<br />
vache, la douce brebis, la sobre chèvre qui vit de si<br />
peu et fait vivre le plus pauvre, c'est pour elles que<br />
se sont préparées ces belles prairies, e) Nous en bénéficions<br />
indirectement : Du lait virginal de la terre<br />
elles vont combler leurs mamelles, te donner le lait,<br />
le beurre.<br />
C. CONCLUSION. — Conseil : reconnaissance.<br />
Reçois-les et remercie ».<br />
MICIIELET. La Femme. Hachette.<br />
MLLE TRIBOULET,<br />
Institutrice.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. \ 2 Chants scolaires par A.DANGUEUGER et J. BONNET. ly.in-8*f<br />
broché. 3.60
7. Avec les 2/5 de l'intérêt d'une somme de 85000 f.<br />
placée à 6 % pendant 2 ans 3 mois, on achète un<br />
terrain rectangulaire valant 3000 f. l'are. Quelle<br />
est la largeur de ce terrain si la longueur a 15 m. ?<br />
(C. E. P.). *-* R. :10 m. 20.<br />
<strong>DE</strong>\$1TÉ. VOLONS '<br />
1. Disposer d'un cube de bois ou de métal dont<br />
P<br />
on connaît la densité; le peser. V = ^ (vérifier).<br />
2. Peser un morceau de pierre ou de métal de<br />
forme quelconque dont on connaît la densité.<br />
Trouver son volume par la méthode du flacon.<br />
Problèmes. — l re année. — 1. Une barre de<br />
fer pèse 58 kg. 4. Calculer son volume si 1 dm 3 de<br />
fer pèse 7 kg. 800. »-> R. : 7 dm 3 487.<br />
2. Une poutre de chêne pèse 0 tonne 74865. Le<br />
m 3 de chene pèse 930 kg. Quel est le volume de<br />
cette poutre? »-> R. : 0 m 3 805.<br />
3. Une pièce de vin pèse 232 kg. pleine et 23 kg.<br />
vide. Quelle est sa contenance, sachant que le poids<br />
d'un litre de vin est 0 kg. 995 ? R. : 210 1.<br />
2» année, — 1. Un vase plein de lait pèse<br />
18 k£. 730. On retire 1/4 du lait qu'il contient, et il<br />
ne pèse plus que 14 kg. 610. Que pèse-t-il quand il<br />
est vide et quelle est sa capacité, si la densité du lait<br />
est 1,03 ? (C. E. P.).<br />
»-> R. : 2 kg. 250—16 l.<br />
2. Pleine d'huile, une bonbonne pèse 16 kg. 300.<br />
Pleine d'eau, elle pèse 17 kg. 300. Sachant que la<br />
densité de cette huile est 0,92, calculez : 1° la contenance<br />
de la bonbonne; 2° son poids lorsqu'elle est<br />
vide. (C. E. P.). »-+ R. : 12 1. 5— 4 kg. 800.<br />
LE PRIW»E RGCTUVUULIIRIi<br />
Exemples. Examen d'un prisme rectangulaire : les<br />
faces; les arêtes; la base; la hauteur. Le développement.<br />
La surface latérale. La surface totale.<br />
Croquis coté.<br />
Exercices. — 1. Comparer le cube et le prisme<br />
rectangulaire quant aux faces et aux arêtes.<br />
2. Construire une boîte en carton de 7 cm. de<br />
long, 4 cm. de large, 5 cm. de haut.<br />
3. Prendre les dimensions de la classe et trouver la<br />
surface des murs (déduire les ouvertures), celle du<br />
plafond.<br />
4. Faire le croquis coté d'une boîte à craie.<br />
Problèmes. — 1 re année. — 1. Pour consolider<br />
une caisse, on l'entoure d'un ruban d'acier dans le<br />
sens de la longueur et dans le sens de la largeur.<br />
Calculer la longueur du ruban qui sera nécessaire.<br />
Dimensions de la caisse : L = 1 m. 35, 1. = 0 m. 40,<br />
h. = 0 m. 48. »-> R. : 5 m. 42.<br />
2. Quelle surface de carton entre dans la construction<br />
d'une boîte avec couvercle ayant 4 dm. de<br />
long, 3 dm. de large et 35 crn. de haut ?<br />
»-> R. : 73 dm 3 .<br />
2° année. — 1. Une poutre en chêne mesure,<br />
3 m. 20 de long, 0 m. 40 de large et 0 m. 25 d'épaisseur.<br />
On la débite, parallèlement à l'épaisseur, en<br />
planches de 0 m. 023 d'épaisseur. On perd au sciage<br />
0 m. 002 par planche. Combien de planches obtiendra-t-on<br />
? Et quelle surface pourra-t-on recouvrir<br />
avec ces planches? (C. E. P.).<br />
»-» R. : 16—12 m 3 80.<br />
2. Une salle de bain mesure 5 m. 80 de long sur<br />
4 m. 95 de large. On veut on faire carreler le sol et<br />
recouvrir les murs de carreaux de faïence jusqu'à une<br />
hauteur de 1 m. 25. Quelle sera la dépense, sachant<br />
que le carrelage revient, tout compris, à 40 f. 75<br />
par m s . et que la porto de la salle a 9 dm. de largeur?<br />
(C. E. P.). R. :2219 f. 25.<br />
H C OURS SUPERI E U R<br />
415<br />
C.• R. : 43 000 f. (Ce problème<br />
peut être résolu par l'algèbre).<br />
2. Un capitaliste place les ,4/15 de son avoir en<br />
maisons, les 2/3 en terres et le reste en actions sur<br />
des entreprises industrielles. Les maisons qu'il loue<br />
lui rapportent 7 %, ses terres 4,5 % et ses actions<br />
| 5%. Sachant qu'il a un revenu annuel de 43 719 f.,<br />
on demande quelle est sa fortune et quelles sont les<br />
' parts différemment placées.<br />
s-> R. : 840 750 f. — 224 200 f.—560 500 f. —<br />
56 050 f.<br />
3. Une personne place une partie de sa fortune à<br />
5 % et une autre partie à 3,50 %, elle a ainsi 2384 f. 70<br />
de revenu annuel. Si la somme placée à 5 % avait<br />
été placée à 3,5 % et si la somme placée à 3,5 %<br />
avait été placée à 5 %, le revenu annuel aurait été<br />
diminué de 16 f. 20. Calculer les deux partiesi de la<br />
fortune. »->• R. : 28 500 f.—27 420 f.<br />
ALGÈBRE<br />
Problèmes à 2 inconnues pouvant aussi se résoudre<br />
comme un problème à 1 inconnue. Ils peuvent également<br />
être résolus par l'arithmétique.<br />
1. Partager 21 000 f. en 2 parties do manière que<br />
l'une, placée à 4 % par an, produise le même intérêt<br />
que l'autre placée à 3 % pendant le même temps.<br />
*-> R. : 9000 f.; 12 000 f.<br />
2. Une personne fait. 2 parts d'un capital de<br />
62 000 f. ; une partie est placée à 5 %, l'autre à 4 %.<br />
L'intérêt annuel total égale 2830 f. Quelles sont les<br />
2 parts du capital? »-* R. : 35 000 f. — 27000 f.<br />
LE PRISME<br />
1. Construire en carton fort une boîte semblable<br />
aux boîtes d'allumettes suédoises, do 6cm.x4 cm.<br />
X 2 cm. (boîte à 2 parties, l'une coulissant dans<br />
l'autre).<br />
2. On a peint les 4 murs d'une salle. La dépense<br />
s'est élevée à 577 f. 50, à raison de 5 f. 25 le m 3 .<br />
Trouvez la longueur de la salle, la largeur étant de<br />
6 m. 25 et la hauteur do 4 m. R. : 7 m. 50.<br />
3. On a employé 1 m- 17 de fer-blanc pour confectionner<br />
une boîte à base carrée do 0 m. 30 de côté,<br />
sans couvercle et qui comporte à l'intérieur 2 cloisons<br />
de même hauteur que la boîte, qui la divisent<br />
en 4 parties égales. Trouver la hauteur de cette boîte.<br />
B-». R. : 0 m. 60.<br />
4. Une salle à manger a 5 m. 70 do long sur 4 m. 50<br />
de largo et 3 m. 50 de haut. On veut en tapisser les<br />
murs avec du papier qui a 0 m. 50 de large. Chaque<br />
rouleau do papier a 8 m.de long et coûte, tout posé,<br />
10 f. 25. Sachant que les ouvertures occupent une<br />
surface de 18 m 3 , que la plinthe a 0 m. 40 de haui<br />
teur, on demande le prix de revient du papier tout<br />
posé. »-» R. : 123 f.<br />
L. LARIVÉ,<br />
Directeur d'école.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. QuÉNioux et VITAL-UCAZE. Le Dessin îrimSiïlLULSTRI; BN 15 fr.
416 HISTOIRE 7 Avril 34<br />
v-vvvfwïjj T- .^Trr* T/iry-<br />
SR wPî<br />
C O U R S ELEM ENTAI .RE<br />
2. Cour brillante. — Avec ses fêtes éclatantesson<br />
grand luxe, la magnificence des costumes.<br />
(Rappeler la simplicité de la demeure et de la vie<br />
de Louis XI).<br />
III. Ses projets. — 1. Montrer que les possessions<br />
do Charles ne sont pas d'un seul tenant : il<br />
voudrait les réunir. Pourquoi ?<br />
2. Très ambitieux, il aspire à la couronne royale.<br />
IV. Sa lutte contre le roi. (Voir livre). — 1. Les<br />
Ligues du « bien public ». — « J'aime tant le<br />
royaume qu'au lieu d'un roi, j'y en voudrais voir<br />
six », disait le duc. Il chercha donc ù démembrer la<br />
Franco et organisa contre Louis XI des coalitions<br />
qui eurent pour prétexte do défendre lo a bien »'<br />
des humbles.<br />
ci) Ses alliés : les grands seigneurs : duc de Bretagne,<br />
duc do Berry, frère du roi... et l'Angleterre.<br />
b) Raconter quelques épisodes de la lutte, en<br />
montrant que le roi triomphe par la ruse, faisant<br />
de belles promesses qu'il ne tient jamais, recrutant<br />
des ennemis ù son adversaire.<br />
2. La défaite de la Bourgogne. — « Charles<br />
vint attaquer les Suisses. Ceux-ci lo battirent à<br />
Granson, puis peu après ô Morat (1476). — Charles<br />
alors essaya de reprendre Nancy. Une bataille<br />
furieuse s'engagea sous les murs de la ville. Les<br />
Bourguignons furent repoussés. Le surlendemain,<br />
au bord d'un étang, on retrouva Charles lo Téméraire<br />
percé de coups de lance, nu, le corps ù moitié<br />
pris dans la glace, le visage à demi dévoré par les<br />
loups (6 janvier 1477) s.(MALET. Le Moyen Affe.Gl.cle<br />
f>". Hachette.)<br />
COURTS MOyENETSUPÉRIEUR<br />
Napoléon et l'Angleterre.<br />
De 1803 à 1815, l'Angleterre poursuit avec une<br />
remarquable ténacité la' lutte qu'elle a entreprise<br />
au début du XVIII e siècle pour ruiner la puissauce<br />
maritime et coloniale de la France. Dans<br />
toutes les coalitions, elle a une part active, fournit<br />
hommes et argent. Malgré les elîortsde Napoléon I er , 1 '<br />
elle garde la suprématie des mers, abat son adver-:<br />
saire à Waterloo et, au Congrès de Vienne, se fait 1<br />
largement payer.<br />
1. La « Trêve » d'Amiens rompue. 1803. —<br />
Charles le Téméraire.<br />
1. Les raisons. — Seule, la lassitude a amené les'<br />
1. Son portrait. —
7 Avril 34 GÉOGRAPHIE 417<br />
il GÉOGRAPHIE II<br />
L'Auvergne.<br />
A. — INDICATIONS<br />
I. Situer l'Auvergne sur la carte. — Partie<br />
importante du Massif Central; au cœur de la France.<br />
1. Les éléments du paysage. — Gravures et projections.<br />
— Décrire : a) le plateau; b) le volcan<br />
éteint; c) la plaine. L'Auvergne est une région très<br />
pittoresque.<br />
2. Genres de vie. — a) Vie rurale : des vignerons,<br />
• les producteurs de céréales (ex. la Limagne). —<br />
Des éleveurs (Monts Dore ou Cantal). — L'exploitation<br />
de la forêt.<br />
b) La vie urbaine : peu de grandes villes (pourquoi<br />
?V. Toutefois 2 centres actifs : Thiers; Clermonl-Perrand.<br />
B. — LECTURES<br />
I. La chaîne des Puys. — Du haut du Puy de<br />
Dôme, on peut, par un temps clair, analyser certains<br />
détails du relief... voici des cratères réguliers, parfaitement<br />
circulaires. Ce sont des édifices de scories noires<br />
et rouges, ou de cendres grises instables dont la forêt a<br />
généralement peine à s'emparer. A côté, vous trouvez<br />
des cônes émoussés.... Des cratères, se sont échappées<br />
des coulées de laves fluides. On suit facilement celles qui<br />
sont sorties du Pariou, comblant en partie les vallées,<br />
barrant certaines où elles ont provoqué la formation de lacs.<br />
— <strong>DE</strong> MARTONNE : les Régions géographiques de la<br />
France. Flammarion.<br />
II. La Limagne. — Le long de l'Allier auvergnat se<br />
succèdent des plaines : les Limagnes. — Celle de Clermont-<br />
Ferrand est de beaucoup la plus vaste et la plus curieuse.<br />
Bordée à l'est et à l'ouest par des murailles rectilignes, elle<br />
déploie de vastes espaces plans, sans autres accidents<br />
que des buttes aussi rares qu'insignifiantes. En général,<br />
ie sol cultivable est une terre noire, d'une fertilité proverbiale<br />
: les moissons y rutilent, non sans se nuancer du vert<br />
îles prairies artificielles, des pommes de terre et des betteraves;<br />
des files de peupliers, de saules ou d'osiers arrêtent<br />
la vue; des noyers dressent leur puissante stature; des<br />
vergers font un riant décor au bord occidental. (ARBOS :<br />
Bulletin de la Société belge d'études géog., mai 1933. Louvain.)<br />
III. Départ du troupeau. — Au mois de mai, on<br />
attache au cou des vaches les sonnettes qui reposent dans<br />
des coffres depuis l'automne. Des foules mugissantes<br />
s'ébranlent pour un trajet qui peut être de courte durée<br />
mais qui peut atteindre 100 à 120 Ion.; en ce dernier cas,<br />
les animaux prennent le train.... Le centre de leur vie<br />
sera alors le 0 buron », lourde bâtisse de maçonnerie tapie<br />
près du sol. ARBOS (OHU. cité.)<br />
COU R S MOYEN ET SU PÉR1EUR.<br />
La Belgique.<br />
Un des plus petits Etats de l'Europe : 30 500 km 2<br />
(à peu près notre Bretagne), mais une grande<br />
puissance économique.<br />
I. Le milieu physique.— 1. Caractères géné=<br />
raux. — a) Situation. Pays ayant une façade sur<br />
la mer du Nord; voisin de grands Etats France,<br />
Angleterre, Hollande, Allemagne.<br />
b) Relief. — Cf. n° 14 : le Nord;— n° 15 : l'Est<br />
(lecture IV). C'est dans l'Ardenne que l'on rencontre<br />
les altitudes les plus élevées (inférieures à 700 m.).<br />
Vers l'Ouest : des parties basses, parfois au-dessous<br />
du niveau de la mer.<br />
c) Climat maritime. — Ecarts atténués; brouillards;<br />
pluies fréquentes. — Toutefois des variantes<br />
dues au relief; vers l'Est, climat aux allures<br />
continentales.<br />
dj Cours d'eau nombreux. Noter les principaux<br />
sur la> carte. — Ils sont abondants, réguliers, utiles<br />
(raisons).<br />
e) Côte basse, rectiligne (peu d'abris), encombrée<br />
de dunes. Un grand port : Anvers.<br />
2. Etude régionale. — Trois divisions : a) La<br />
liaule Belgique. Altitude s'abaissant de l'Est vers<br />
l'Ouest (600-300 m.). L'Ardenne, pénéplaine, avec<br />
ses schistes, quartz, grès, offre peu de ressources<br />
(cf. n° 8 : le Massif Central); son climat est rude.<br />
Des forêts, landes, quelques étangs. Région peu<br />
peuplée; toutefois, dans les vallées plus chaudes, la<br />
vie est plus active, les groupements moins dispersés.<br />
En bordure de l'Ardenne : un grand bassin /touiller;<br />
3 jalons : Mons, Charleroi, Liège.<br />
b) La moyenne Belgique. — Ensemble de hautes<br />
plaines vallonnées. Climat plus doux, sol recouvert<br />
de limons fertiles, propres aux cultures. La moyenne-<br />
Belgique est une voie de passage.<br />
c) La basse Belgique. — Au climat humide, au<br />
sol bas (plusieurs parties au-dessous du niveau de la<br />
mer). De l'eau partout : l'homme a cependant conquis<br />
des terres qu'il a amendées; elles portent des pâturages<br />
et des cultures prospères.<br />
II. La vie économique. — 1. Population :<br />
des Flamands au N.-O., des Wallons au S.-E.,<br />
environ 7 millions 1/2 d'habitants; densité :>262,<br />
une des plus fortes de l'Europe (France : 74).<br />
Les grandes villes : Bruxelles, Anvers, Liège, Gand<br />
ont plus de 1G0 000 habitants.<br />
2. La Belgique, pays agricole. — Vie rurale<br />
active en moyenne et basse Belgique (alluvions fertiles.<br />
Climat océanique. Travail de l'homme).<br />
Culture des céréales : blé, orge, avoine, seigle. —<br />
Cultures industrielles : betterave, lin, chanvre, chicorée,<br />
houblon, tabac. — Cultures maraîchères, des<br />
Ileurs. — Elevage : des bœufs, vaches laitières, chevaux<br />
de trait, moutons, porcs.<br />
3. La Belgique, pays industriel. — a) Sous-sot<br />
riche. Un bassin houiller; production : environ<br />
28 millions de tonnes. — Minerais de fer, de zinc. —<br />
Silice. — b) Industries métallurgiques. Autour de<br />
Liège, dans la vallée de la Sambre... (machines,<br />
ponts, poutres...).— Textiles : travail do la laine à<br />
Veruiers; du lin, du chanvre,en Flandre-, du coton,<br />
autour de Gand. — Alimentaires.<br />
En moyenne Belgique : des minoteries, raffineries,<br />
distilleries, brasseries, laiteries; nombreuses<br />
verreries, tapisseries en Flandre-, dentelles de Matines,<br />
Bruges, papeteries autour de Bruxelles...<br />
4. La Belgique, pays commerçant. — Nombreuses<br />
voies de communication : ferrées (la plus<br />
forte densité); fluviales (pourquoi?). — Un seul<br />
grand port : Anvers (plus de 300 000 h.), bien relié<br />
à l'arrière-pays, commerçant avec la grande colonie,<br />
le Congo belge.<br />
La Belgique importe des matières premières :<br />
minerais de fer, cuivre, zinc, plomb; du coton, lin,<br />
caoutchouc, bois, pétrole; de la laine; des denrées<br />
alimentaires : blé ou farino, bétail, fromage, vin,<br />
produits coloniaux. Elle exporte : des produits<br />
manufacturés : machines, tissus, articles en caoutchouc,<br />
verrerie...<br />
Les principaux pays avec lesquels elle est en<br />
relation : France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas,».<br />
Etats-Unis.<br />
III. Conclusion. — La Belgique doit sa puissance<br />
économique à la densité et à l'activité de sa population.<br />
GEORGES VÉRON.<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S, j . LE BAS. Cent Dictées VORFRTLI7M D ,Z%AI. ^TRS'ÉR 4.60
'ils LEÇONS D E CHOSES 7 Avril 34<br />
IË(X)N5<strong>DE</strong>CH05ES<br />
" ÇQJJRS ÉLÉ M E N TAIRE ï<br />
Un escargot.<br />
Matériel. — Quelques escargots. Une feuille de<br />
salade. Une feuille de papier. Des escargots mis à<br />
jeûner.<br />
Plan de la leçon. — I. Examen extérieur. —<br />
La coquille. Elle semble enroulée, elle commence par<br />
une pointe, d'01'1 part une courbe qui s'élargit de plus<br />
en plus jusqu'à l'ouverture. Couleurs remarquées<br />
sur la coquille.<br />
De la coquille sort l'animal; 4 filets (tentacules);<br />
les compter, les comparer : 2 grands et 2 petits. Audessous<br />
une ouverture; c'est certainement la bouche<br />
II. La marche de l'escargot. — A-t-il de s<br />
pattes, des nageoires, des ailes? Cependant il se déplace.<br />
Observer les mouvements de son corps<br />
quand il marche : on dit qu'il rampe. Citer d'autres<br />
animaux qui rampent. L'escargot avance-t-il<br />
vite ?<br />
III. L'escargot est sensible. — Toucher les<br />
tentacules : les grands; les petits. Que voyons-nous<br />
à l'extrémité des grands? »->• Un point noir : c'est<br />
un œil.<br />
IV. Touchons l'escargot. — Il a le corps froid.<br />
Citer d'autres animaux qui ont le corps froid;<br />
d'autres qui ont le corps chaud. Presser l'escargot;<br />
en sortir un de sa coquille; l'écraser; il n'y a pas<br />
d'os dans le corps de l'escargot.<br />
Mettre l'escargot dans la main; il adhère par une<br />
sorte de colle : matière gluante; enlever cette<br />
matière gluante avec de l'eau : c'est difficile. Faire<br />
marcher l'escargot sur une feuille de salade, sur une<br />
feuille do papier; il laisse la trace de son passage,<br />
V. Enlevons l'escargot de la coquille. —<br />
Une petite résistance. Un corps noir. C'est son<br />
estomac. Un escargot mange; que mange-t-il ?<br />
VI. Un escargot bouché. — Il semble mort,<br />
enfermé dans un cercueil; c'est seulement sa chambro<br />
à coucher; il dort parce qu'il n'a pas eu à manger<br />
depuis longtemps; il a fermé sa maison avec un<br />
mur qu'il a sécrété. Il peut rester ainsi longtemps à<br />
jeûner.<br />
VII. Conclusions. — Les escargots causent des<br />
dégâts dans les jardins; ils sont comestibles.<br />
COURS MOYEN ET SU PÉRI EUR;<br />
Vers, mollusques, rayonnés,<br />
protozoaires.<br />
Matériel. — Ver de terre dans de la terre humide;<br />
un ver de terre tenu dans une boîte depuis plusieurs<br />
heures-, tortillons de terre produits par des vers; escargots<br />
; limaces, moules ou huîtres, coquilles Sl-Jacques<br />
Etoile de mer desséchée, oursin, éponge.<br />
Plan de la leçon. — I. Les vers. — a) Examiner<br />
un ver de terre : il est formé d'anneaux.<br />
b) Ecraser un ver : c'est un invertébré.<br />
c) Passer le doigt dessus, dans un sens, puis dans<br />
l'autre. On sent des soies, au nombre do 4 par<br />
anneau. Elles sont plantées d'avant en arrière;<br />
observer un ver qui rampe.<br />
d) Le ver est effilé aux deux extrémités; la bouche<br />
est au bout le plus mince, l'anus à l'opposé.<br />
c} Couper un ver; les morceaux restent vivants.<br />
/) Observer le ver qui a été maintenu dans une<br />
boîte; il est desséché et presque mort; il meurt<br />
asphyxié, car le ver a une respiration cutanée qui<br />
ne peut s'effectuer que si la peau reste humide; si<br />
le ver n'est pas tout à fait mort, le mouiller légèrement;<br />
il reprend do l'activité.<br />
g) Observer un tortillon de terre; il est constitué<br />
par les déjections du ver'; le ver avale de la terre;<br />
pendant la traversée du tube digestif, de la tête à<br />
l'anus, les matières nutritives passent dans le corps<br />
et la terre est rojetée par l'anus.<br />
h) Piquer un ver, il a un système nerveux.<br />
CONSÉQUENCES. — 1° Les vers ameublissent la<br />
terre; 2° en remontant d'endroits où peuvent être<br />
enterrés des animaux en putréfaction, ils ramènent à<br />
la surface du sol des germes de maladies contagieuses<br />
comme le charbon.<br />
Autres espèces de vers. — Les sangsues; les<br />
vers parasites : oxyures, ténia, trichine, douve du<br />
foie des moutons.<br />
La vie du ténia. — 1° Il vit dans l'intestin de<br />
l'homme, sous forme d'un long ruban ayant jusqu'à<br />
10 m. de longueur; la tête adhère à l'intestin au<br />
moyendecrochets.Ce ruban est formé d'anneaux qui<br />
se renouvellent sans cesse en arrière de la tête, pendant<br />
que les anneaux de la queue, remplis d'œufs,<br />
se détachent et sont rejetés. La nutrition de l'animal<br />
est cutanée, elle s'opère aux dépens des aliments<br />
absorbés par l'homme et devenus assimilables;<br />
le ténia n'a donc pas d'appareil digestif.<br />
2° Les vieux anneaux remplis d'œufs sont emportés<br />
à la terre avec les excréments; si un porc les<br />
avale, ils produisent des larves qui percent la peau<br />
de l'intestin, passent dans le sang et dans les muscles,<br />
lo porc est atteint de ladrerie.<br />
3° Si un homme mange cette viande de porc,<br />
l'évolution continue et la larve devient le ténia.<br />
^ CONSÉQUENCE. — Il faut toujours manger la<br />
viande de porc très cuite.<br />
II. Les mollusques. — a) Observer un escargot.<br />
Sa coquille. Le sortir de sa coquille. C'est un invertébré.<br />
Ses tentacules. Les compter. Les comparer; il<br />
y en a 2 grands et 2 petits; les 2 grands sont<br />
surmontées d'un point noir. Les petits sont l'organe<br />
du toucher; les grands portent les yeux.<br />
Au-dessous des petits : une ouverture : la bouche.<br />
La partie noire est l'estomac.<br />
b) Autres mollusques :<br />
1° Les limaces, les poulpes, les seiches, sans<br />
coquille.<br />
2° Les moules, les huîtres,les coquilles St-Jacqiies,<br />
les coques, avec 2 coquilles.<br />
c) REMARQUE. — Remarquer que les divers<br />
mollusques ont une partie du corps recouverte par<br />
une sorte dé membrane ou repli de la peau. c'est<br />
sous cette membrane appelée manteau que se trouve<br />
l'appareil respiratoire : poumon chez l'escargot;<br />
branchies chez la moule, l'huître.<br />
III. Les rayonnés. — o) Montrer une étoile de<br />
mer, un oursin dépourvu de sa peau épineuse; faire<br />
remarquer le rayonnement.<br />
b) Observer une éponge : c'est le support qui réunit<br />
les membres d'une même colonie.<br />
c) Los coraux. Voir manuel et gravures.<br />
IV. Les protozoaires. — Très petits et très<br />
simples; ils sont presque tous composés d'une simple<br />
membrane renfermant un liquide appelé protoplasma.<br />
La nutrition se fait, par échange à travers la membrane;<br />
ils se reproduisent très rapidement par<br />
division.<br />
Certains se meuvent par des cils vibratiles, d'autres<br />
par des prolongements de l'enveloppe.<br />
De nombreux protozoaires sont des germes de<br />
maladies : fièvre paludéenne, maladie du sommeil,<br />
gros ventre des lapins.<br />
Il y en a de grandes quantités dans les eaux<br />
stagnantes (danger).<br />
E. VENGEON,<br />
Professeur do C. C.<br />
CERTIFICAT D-ÉTU<strong>DE</strong>S. G. <strong>MANUEL</strong>. 100 Dictées VTÏLIÏ'N'SC 3 séries. La série. 4.60
7 Avril 34 CHANT 419<br />
aunanaj<br />
conarm<br />
gsftii Si»!<br />
La bourrée. — Indications.<br />
Lorsqu'on entend chanter des chansons populaires,<br />
il se trouve toujours quelqu'un dans l'auditoire<br />
pour affirmer que la version chantée n'est<br />
pas la bonne, ce qui veut tout simplement dire'que<br />
cette version n'est pas' celle que l'on connaît. Il<br />
en èst de même pour une danse aussi populaire que<br />
la liourrée, qui se danse en bien des régions,' de la<br />
Sologne aux Pyrénées, avec des variantes nombreuses.<br />
Il y a des bourrées à deux temps, à trois temps,<br />
des bourrées qui se dansent à deux (un couple),<br />
à quatre, à six, à huit; il y a la montagnarde, la<br />
(îrousado, la divirada, la bourrée des foulards, la<br />
bourrée de la mariée, la cantalouse, la berrichonne,<br />
la limousine, la croisée, la tournidjaire, l'escloupeto...<br />
et chacune d'elles est la bonne.<br />
Nous ne décrirons que l'une des formes les plus<br />
connues de la bourrée à trois temps.<br />
Composition. — Seize mesures composent un<br />
couplet, — en deux phrases de 8 mesures, chaque<br />
phrase comportant deux fois le même thème.<br />
Mouvement. — Le mouvement, rapide, est<br />
à peu près celui de la valse. Ce mouvement ne se<br />
trouve en rien modifié du fait que la bourrée est<br />
notée à 3/4, au lieu du 3/8 plus fréquent.<br />
Pas. — -Le pas est celui de la valse, — de la<br />
valse bostonnée, — mais court, — et plus lourd,<br />
sur les temps accentués.<br />
Accents. — L'accent, pour le joueur de cabrette<br />
et pour le danseur, porte sur le premier<br />
temps de chaque mesure, et aussi ( un peu moins<br />
durement), sur le troisième. Il est marqué par un<br />
frappéihent de pied. Mais on accentue aussi le<br />
rythme de diverses façons, par exemple par dés:<br />
claquements, et même par des exclamations.<br />
Attitudes. — Le plus souvent, le danseur a<br />
les bras levés, arrondis.<br />
La danseuse tient un pli<br />
de sa jupe ou de son tablier<br />
dechaquecôté(fig.l).<br />
Danseur et danseuse doivent<br />
sans cesse se regarder.<br />
Caractéristique. —<br />
Elle se trouve à la fois<br />
Kg. 1.<br />
dans la lourdeur du pas<br />
du danseur, martelant les<br />
temps forts, dans la mi- j<br />
mique des deux danseurs dont le visage doit tou-1<br />
jours être expressif, et dans les croisements, pour- !<br />
.ohas, qui composent chaque ligure. Les danseurs, I<br />
sans cesse, se rapprochent, s'éloignent, s'attirent, I<br />
se repoussent en se déplaçant sur le côté.<br />
Figures. — C'est leur grande variété qui !<br />
différencie les diverses bourrées. Mais « la figure 1<br />
la plus communément dansée consiste précisément j<br />
dans cette poursuite amoureuse qui est la base |<br />
même de la bourrée ». Parfois, les danseuses se<br />
placent au milieu (bourrée de Vic-sur-Cère) avec<br />
croisements parallèles; parfois les danseurs tournent !<br />
en rond (bourrée de Limagne), « ou enfin, la danse ,<br />
devient un véritable quadrille avec visites, croisements<br />
de mains... (bourrée de Saint-Flour) » (Mario<br />
Versepuy).<br />
Départ. — Danseur et dansouse, au départ, sont 1<br />
tournés l'un vers l'autre, soit éloignés l'un de<br />
l'autre, soit coude à coude, la main gauche sur<br />
la hanche, soit en se tenànt par les mains (fig. 2),<br />
soit en ne se tenant que par une main (fig. 3).<br />
C'est le pied gauche qui frappera le premier<br />
temps des mesures 1, 5, 9, 13.<br />
Nombre de danseurs. — La description qui<br />
suit ne concerne qu'un couple, mais on pourra<br />
faire exécuter la bourrée décrito par un nombro<br />
Fig. 2. Fig. 3.<br />
indéterminé de danseurs. Deux couples peuvent<br />
évoluer dans le même carré.<br />
Un conseil. — Les enfants, lorsqu'ils apprennent<br />
la bourrée, tirent le plus grand profit des<br />
leçons d'un auvergnat authentique. Qu'on recherche<br />
donc ce spécialiste, qui a s la bourrée dans le<br />
sang », qui donnera l'exemple, et qui sera fidèlement<br />
imité. Les exemples vivants sont d'un<br />
autre pouvoir que notre description.<br />
Adaptation au chant publié. -— (Voir Manuel<br />
général du 3 mars 1934.)<br />
Le premier couplet est chanté entièrement par les<br />
cavaliers (et le chœur). Les autres couplets sont<br />
chantés en partie par Iesv danseuses (les 4 premiers<br />
vers) en partie par les danseurs (les 4 derniers vers)<br />
et par le chœur. ,tir<br />
1 cr couplet. — Le cavalier va d'un point A<br />
(départ) à un point B. Non pas en ligne droite, mais<br />
en décrivant, obliquement, quatre petitesîr lignes<br />
brisées. a*<br />
A / \ / \ B<br />
,U avance donc, pondant 4 mesures, recule pendant<br />
4 mesures, et recule en B, mais, cette fois, en<br />
tournant.<br />
La cavalière part de B, recule quand le danseur<br />
avance, ou avance quand il recule, et vient âe<br />
placer en C, troisième sommet du carré ABCD.<br />
2° couplet. — Le danseur poursuit<br />
de B en C. La danseuse fuit<br />
de C en D. A la fin du couplet,<br />
elle se rapprochera du danseur<br />
(fig. 4).<br />
3 e couplet — La poursuite<br />
continue, de C en D pour le danseur,<br />
de D en'A pour là danseuse,<br />
pendant lès 8 premières mesures.<br />
A la mesure 9, les deux danseurs<br />
du couple se tiennent par la main<br />
Fig. 4.<br />
gauche (figure 3). Ils dansent en tournant pendant<br />
4 mesures dans le sens des aiguilles d'une montre, et,<br />
pendant les 4 dernières mesures, en tournant dans<br />
le sens inverse.<br />
4° couplet. — La poursuite permet à chaque<br />
danseur de terminer son carré, pendant les huit<br />
premières mesures.<br />
Puis les danseurs se tiennent par Içs mains., pour<br />
danser les 4 mesures suivantes (fig. 2) et par le bras<br />
pour terminer.<br />
Uno révérence à la danseuse, après le chant,<br />
alors que le danseur lève son chapeau.<br />
NOTA. — On trouvera de plus amples descriptions<br />
de la bourrée dans l'ouvrage : La Bourrée<br />
(Recueil de chants) édité par la Société « La Bour<br />
l rée » 13, boulevard Beaumarchais, Paris; — dans<br />
une étude de Mario Versepuy, publiée par la Musique<br />
à l'Ecole (Numéros d'octobre, novembre, décembre<br />
1924); — dans le Théâtre du Petit Chaperon rouge,<br />
(pages 77 et suivantes), de MAURICE Boucuon<br />
(A. Colin, êditour).<br />
MAURICE CIIEVAIS.<br />
CERTIFICAT 0'ÉTU<strong>DE</strong>S. G. <strong>MANUEL</strong>. 100 RédactionSd/j^o^'emen/s. 35 ^ 1 ' 65 - La série. 3.60
420 CAUSERIE 7 Avril 34<br />
Les usines hydro-électriques récentes.<br />
L'avenir des centrales thermo-électriques est<br />
certainement limité par la nécessité où elles sont<br />
de se procurer constamment un combustible :<br />
charbon ou mazout, en voie de disparition. Au<br />
contraire, les centrales hydro-électriques voient<br />
s'ouvrir un champ extrêmement vaste de réalisations<br />
et les sources dont elles tirent l'énergie sont inépuisables.<br />
Aussi les efforts actuels, et particulièrement<br />
en France, tendent-ils à utiliser au mieux cette<br />
matière première précieuse : l'eau en mouvement,<br />
et la construction de puissantes centrales hydrauliques<br />
a-t-elle été entreprise sans retard. A l'heure<br />
actuelle, un grand nombre d'entre elles fonctionnent<br />
et 1'ach.èvement de plusieurs dizaines d'autres est<br />
activement poussé.<br />
Le principe de toute usine hydro-électrique est le<br />
suivant : faire circuler dans une turbine, appareil<br />
dont la roue à aubes des anciens moulins est l'ancêtre,<br />
un débit d'eau aussi grand que possible, de<br />
façon à en provoquer la rotation avec une puissance<br />
considérable (ce qui ne veut pas toujours dire avec<br />
une vitesse très grande). Sur l'axe même de la<br />
turbine, qui peut etre soit horizontal, soit vertical,<br />
est calé un générateur d'électricité, le plus souvent<br />
un alternateur triphasé, dans lequel toute la puissance<br />
de la turbine est consommée et transformée en<br />
énergie électrique. Des bornes de l'alternateur sort<br />
un courant à tension élevé et qu'on élève encore<br />
grâce à des transformateurs. On obtient ainsi un<br />
courant transportable économiquement, que l'on<br />
dirige par des lignes aériennes vers les points d'utilisation<br />
souvent éloignés de la centrale de plusieurs<br />
centaines de kilomètres.<br />
Deux réalisations sont possibles suivant qu'on<br />
utilise l'eau sous haute ou basse pression : on peut<br />
avoir des centrales de haute chute ou de basse<br />
chute.<br />
Les centrales de basse chute sont établies le long<br />
des rivières ou de fleuves importants dont on retient<br />
les eaux par un barrage peu élevé. L'eau s'écoule<br />
par des conduites de très large diamètre sur des<br />
turbines spéciales (turbine Francis) construites pour<br />
fonctionner sous des pressions faibles. Telles sont les<br />
centrales de La Gentille sur la Garonne, de l'Isle-<br />
Jourdain sur la Vienne (hauteur de chute 10 m. 50),<br />
deTuillièresfhaut. 12m.,)et de Mauzac (haut.5 m. 20)<br />
sur la Dordogne. La plus récente, qui est aussi de<br />
beaucoup la plus importante, est la centrale de<br />
Kembs, mise en service en octobre 1932. C'est la<br />
première d'un chapelet de huit usines destinées<br />
à utiliser les eaux du Rhin, et qui totaliseront une<br />
puissance de 700 000 kilowatts. L'usine actuellement<br />
terminée fournit 186 000 kilowatts et est une<br />
des plus importantes du monde. Elle comporte<br />
5 groupes turbo-alternateurs, alimentés par des<br />
conduites en béton de 8 m. do diamètre et qui<br />
tournent à la vitesse de 98 tours par minute. Ctîaque<br />
groupe a une puissance de 31 000 kilovoltampères.<br />
Chacun des alternateurs, seul, pèse 475 tonnes, et<br />
son rotor 245 tonnes. Ce sont les plus gros de France.<br />
Des transformateurs élèvent à 220 000 volts la<br />
tension qu'ils fournissent. Ils pèsent 242 tonnes<br />
l'un, en ordre do marche.<br />
Les centrales de haute chute sont plus nombreuses,<br />
mais évidemment cantonnées dans les pays accidentés<br />
: Pyrénées, Alpes, Massif Central. Elles<br />
utilisent l'eau soit des lacs de haute altitude, soit<br />
des rivières ou des torrents de forte pente. Dans ce<br />
derniercas, l'irrégularité du débit au cours des saisons<br />
blige à constituer des réserves considérables par la<br />
formation do barrages extrêmement élevés. Lo<br />
barrage d'Eguzon, sur la Creuse, retient 4 millions<br />
et demi de mètres cubes d'eau et sa hauteur est de<br />
00 mètres. Celui du Chambon, sur la Romanche<br />
(Alpes), avec ses 87 mètres de haut, retient 54 millions<br />
de mètres cubes. Le record de la hauteur sera<br />
détenu par le barrage du Sautet sur l'Arc (Alpes)<br />
lequel, haut do 125 mètres, retiendra 130 millions<br />
de mètres cubes formant ainsi un lac de 8 kilomètres<br />
de long et de 352 hectares de superficie; le record<br />
de la capacité reviendra au barrage de Sarrans sur<br />
la Truyère (Massif Central) qui formera une réserve<br />
de 300 millions de mètres cubes derrière une muraille<br />
de 105 mètres de haut. Ces deux barrages sont en<br />
voie d'achèvement; encore de tels lacs artificiels<br />
sont-ils insuffisants pour alimenter de façon continue<br />
les centrales qui leur seront annexées, en<br />
période de sécheresse.<br />
Les centrales ne sont pas toujours situées au pied<br />
des barrages. Elles ont parfois avantage à se trouver<br />
à une altitude inférieure, afin de bénéficier d'une<br />
hauteur de chute plus grande et par là d'une puissance<br />
supérieure. L'eau du barrage est alors guidée<br />
vers les turbines par des canaux d'amenée creusés<br />
dans le roc et de longueur souvent considérable<br />
(plusieurs kilomètres). Ces canaux d'amenée sont<br />
en général horizontaux ou à faible pente. Pour<br />
descendre à l'usine, l'eau emprunte alors une ou<br />
plusieurs conduites forcées. On entend par ce terme<br />
des tubes cylindriques d'acier extrêmement résistants,<br />
soudés ou rivés les uns aux autres et qui descendent<br />
lo long des pentes, soit à l'air libre, soit à<br />
l'intérieur de tranchées, depuis l'extrémité du canal<br />
d'amenée (chambre de prise d'eau) jusqu'aux turbines.<br />
Leur diamètre et leur épaisseur varient avec<br />
l'altitude et leur longueur. Plus épais (jusqu'à<br />
50 millimètres) à la base qu'au sommet, leur diamètre<br />
peut atteindre quelques mètres et leur longueur<br />
plusieurs centaines do mètres. Ils doivent<br />
être .scellés, au sol par de solides massifs de béton<br />
disposés de place en place. On compte dans certains<br />
cas sept conduites forcées parallèles (usine d'Eget) ;<br />
on en réduit lo nombre autant que possible par raison<br />
d'économie.<br />
Les centrales qui fonctionnent à partir des lacs<br />
d'altitude sont toujours alimentées par canaux<br />
d'amenée et conduites forcées.<br />
On peut d'ailleurs monter plusieurs usines en cascade,<br />
l'usine inférieure recevant l'eau du canal de<br />
fuite de l'usine supérieure (usines en cascade d'Artouste,<br />
Hourat, Miègebat, dans les Pyrénées, usines<br />
de Lassoula et de Trammezaigues dans les Pyrénées).<br />
Grâce aux conduites forcées, on peut atteindre<br />
des hauteurs de chute considérables : 406 m. à<br />
Lassoula.<br />
Lorsque les turbines fonctionnent, les conduites<br />
débitent plusieurs mètres cubes d'eau à la seconde<br />
(une dizaine) ; il serait alors dangereux d'interrompre<br />
brusquement le courant d'eau rapide qui les parcourt<br />
: on provoquerait dos phénomènes connus sous<br />
lo nom de a coups de bélier » et dont l'effet serait<br />
capable de faire éclater les tuyaux. Les vannes<br />
permettant d'arrêter lo courant d'eau et d'immobiliser<br />
ainsi les turbines doivent être des vannes<br />
spéciales à effet progressif.<br />
De plus, on intercalera sur la conduite un dispositif<br />
particulier : une cheminée d'équilibre qui absorbera<br />
les surpressions produites par des coups de<br />
bélier accidentels et les rendra inoffensives.<br />
Les turbines utilisées dans les centrales de haute<br />
chute sont généralement des turbines Pelton, dont<br />
le principe est légèrement différent de celui des<br />
turbines Francis et qui sont équipées pour recevoir<br />
des courants d'eaux rapides. Elles tournent en général<br />
plus vito que les turbines Francis (500 à 1000<br />
tours-minute).<br />
(A suivre).<br />
R. RAMBADD,<br />
Agr6gé-Pr6paralenr<br />
A la Facullo des sciences de Eordcaui<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. G. <strong>MANUEL</strong>. 200 Problèmes TUVÉPONLTS" S éries. La série. 4.20
| Avril 34 TEXTES FRANÇAIS EXPLIQUÉS : COURS COMPLÉMENTAIRE 101<br />
£ I I l f K O T I<br />
Autour du Secret de M" Cornille.<br />
(VETIHAEREN : La Plaine; ZOLA : VAtelier) 1 .<br />
I. Machinisme et poésie. — Alphonse Daudet<br />
ous a indiqué d'un mot le sens de sa lettre de<br />
ion Moulin : Le Secrel de M" Cornille : « C'est un<br />
rame », nous dit-il, un drame du progrès qui, en<br />
:éveioppânt le machinisme, détruit fies anciennes<br />
jorrties poétiques du travail humain. Les minoteries<br />
vapeur ont tué les moulins à vent; de rnêrtie les<br />
aehines agricoles ont transformé le travail des<br />
liamps; de même enfin la grande industrie a îSihlacé<br />
les petits métiers de l'artisan. La même idée<br />
ist exprimée avec beaucoup de force et de poésie<br />
[ans- la pièce de Verhaeren : La Plaine-, la desription<br />
de Zola : l'Atelier, montre que le machinisme<br />
lui-même peut ayoir sa poésie".<br />
I II. Le machinisme détruit la beauté' du<br />
inonde : la Plaine. —• l ro question. — Résumez<br />
n une courte phrase _ l'idée_ exprimée dans chacune<br />
Ides strophes de celte poésie. »-> R. : Les villes indus-<br />
Ja-iell'es, en se développant, envahissent et saccagent<br />
la campagne. — Le travail des machines<br />
normes remplace le labeur humain des champs si<br />
aime, si poétique. — La nature est enlaidie et<br />
égradée par le machinisme. — Une sombre régurité<br />
géométrique remplace les aspects vivants et<br />
mineux du monde.<br />
2° question. — Comment est traduite, dans<br />
& première strophe, Vidée d'une lutte incessante et<br />
\nêgale entre la campagne et la villeï $-> R. : Cette<br />
"ée est traduite ; a) par la répétition, au début<br />
es v. 1, 3 ot 4 de la phrase : La plaine est morne;<br />
par les accumulations d'adjectifs et de propotions<br />
reliés à l'aide de la conjonction et : la plaine<br />
|st morte et lasse et ne se défend plus ; la plaine<br />
t morne et morte et la ville la mange; c) par<br />
1 allitération : la plaine est morne et morte.<br />
I 3° question. — Expliquez le sens et la valeur<br />
| es adjectifs employés dans la 2 e strophe. s-» R. : Ces<br />
,-ïiachines sont d'une dimension, non seulement<br />
snnrme, mais exagérée, hors de l'ordre de la nature:<br />
m/perboliques (une hyperbole est une figure de<br />
style par laquelle on augmente excessivement la<br />
8 éi-ité des choses pour qu'elles fassent plus d'imfression);<br />
leurs bras inspirent de la terreur par<br />
1 surs dimensions -. formidables-, l'œuvre de sacca-<br />
;jement qu'ils accomplissent est un véritable<br />
Irime : criminels-, les blés auxquels l'Evangile<br />
emprunte maintes paraboles (récits allégoriques<br />
"iyant une signification morale) ont une douceur<br />
jacifiquo : évangéliques, qui' rend plus odieuse<br />
ur destruction; le vieux semeur, en accomplissant<br />
S]J tâche monotone, songeait » à la fuite utile d'es<br />
' urs », avait le loisir de rêver : mélancolique.<br />
4° question. — Expliquez, dans la strophe 3,<br />
s termes qui expriment V enlaidissement et la<br />
gradation de la nature, s-» R. : L'adjectif orde<br />
(jeminin de ord) est un vieux mot, signifiant sale,<br />
' alpropre; il est la racine du mot encore usité.<br />
dure, auquel il fait penser; les poètes comparent<br />
njvent le brouillard à une écharpe, à un' manteau',<br />
i les fumées, la suie des usines traînent sur lé<br />
el un vêtement qui semble déchiqueté et malropre<br />
: haillon ; les éléments en- sont infectés :<br />
vent est sali; le soleil ne luit plus que d'un éclat<br />
j l. Voir ccs textes d ans les Textes français E. P. S., de<br />
. (JIIEVAILLIER, AUDIAT et AUMEUNIER, 1»« année, pages<br />
128 et 151.<br />
blafard à travers ce voile -. pauvre; c'est comme<br />
nne dégradation de l'astre glorieux : avili.<br />
5'° question. -— Relevez dans la strophe 4 les<br />
expressions contrastées qui expriment la Iransfotmàtion<br />
du paysage, s-» R : Les" maisons, foyers<br />
humains, sont remplacées par des usines; ces<br />
maisons étaient claires; autour d'elles croissaient,<br />
des productions vivantes de la nature que le soleil<br />
éclatant auréolait ' d'or; aujourd'hui, les usines<br />
ont une forme géométrique (rectangulaires); elles<br />
sont immenses et sombres. NotezTe dernier vers qui<br />
rend sensible l'impression d'énormité écrasante:<br />
1° par le tour abstrait : la noire immensité;<br />
2°. par le rythme : le vers a 14 pieds, c'est-à-dire<br />
excède de deux syllabes le' vers régulier le plus<br />
long de la métriquô française."<br />
III. La poésie du machipisme : l'Atelier. •—<br />
Zola dégage, dans ce morceau, la poésie que recèle<br />
un spectacle en apparence aussi prosaïque qu'un<br />
atelier de fabrication de mécanique.<br />
1 r< > question. — La personne qui visite cet.<br />
atelier est une femme : pourquoi Zola a-t-il choisi<br />
ainsi son visileùr ? Pourquoi ne le fait-il pas décrire<br />
par un homme du mélier, un ouvrier métallurgiste,<br />
par exemple? R. : Le visiteur n'étant pas du<br />
métier, tout est nouveau, inconnu, mystérieux<br />
à ses yeux. Un ouvrier métallurgiste, familiarisé<br />
avec ces machines, n'aurait rien trouvé en elles<br />
d'effrayant ni d'étrange. Ce personnage est une<br />
. femme, c'est-à-dire un être que Zola suppose plus<br />
sensible, plus émotif, aux nerfs plus impressionnables<br />
que l'homme; or 1 , l'imagination est surexcitée<br />
par l'émotion.<br />
• 2° question. — Qu'est-ce qui favorise l'espèce<br />
d'Hallucination dont la visiteuse est victime ? s~><br />
R. : D'abord, l'émotion qu'elle éprouve : la peur<br />
instinctive, 1. 3; sans doute le guide qui l'accompagne<br />
la renseigne et la rassure, 1. G; mais ses recommandations<br />
mêmes' ne laissent pas d'être<br />
inquiétantes : elle devait avoir bien soin, 1. 7 : la<br />
peur l'empêche de voir d'abord les objets distinctement.<br />
— En second lieu, l'hallucination est<br />
favorisée par la demi-obscurilê qui règne dans le<br />
hangar; dans la pénombre, tout paraît indistinct,<br />
confus, donc effrayant.<br />
3° question. — Montrez que la vision, d'abord<br />
confuse el fantastique, se précise peu à peu el se<br />
rapproche du réel, mais que cette réalité, même assez<br />
clairement aperçue, reste mystérieuse et terrifiante. s-><br />
R. : Elle ne voit d'abord que de grandes ombres,<br />
1. 4 et 5; des fumées peuplées d'êtres vagues, 1. 10 et 11 ;<br />
elle ne distingue pas les hommes des machines,<br />
L 11 et 12; elle ne voyait rien encore, tout dansait,<br />
1. 15 ot 16. Puis la vision, plus distincte, se rapproche<br />
de la réalité : elle voit les petites forges, 1, 27; les<br />
machines dont on lui explique le rôle : cisailles 1. 35,<br />
machines ù boulons, 1. 37, ébarbeuses, 1. 39, laraudeuses,<br />
1. 41. A ce moment, elle comprit, 1. 47;<br />
elle n'a plus peur; elle est seulement inquiète.<br />
4 e question. — Montrez que ce qui fait la<br />
poésie de cette description, c'est qu'elle damne en même<br />
temps que la vision nette du mécanisme, l'impression<br />
confuse de la vie. »-> R. : La" régularité des mouvements,<br />
la puissance des effets, la matière des<br />
machines (fonte, fer, acier luisant sous la graisse<br />
dés huiles), la nature de leur action (forgeant,<br />
taraudant) donnent la vision nette du mécanisme,<br />
mais les comparaisons et les métaphores (comme<br />
un vol d'oiseau de nuit, mangeaient, croquant à<br />
chaque coup de dents, crachant), présentent les<br />
machines comme des êtres vivants, comme des<br />
monstres. CHEVAILLIER.<br />
ÎIEVAILLIER-AUDIÀT-AUMEUNIBR.LES TEXTES FRANÇAIS. E.P. S. 2° et 3° années. 17 fl\
102 PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE : COURS COMPLÉMENTAIRE 7 Avril 34<br />
^ i ? m a i û U E M ^ N T A L f | B |<br />
Galvanomètres. — Ampèremètres.<br />
Matériel. — 1° Le galvanomètre de la 23 e leçon.<br />
2° Un galvanomètre comprenant un enroulement<br />
d'une vingtaine de mélrcs de fil de 3/10 de mm. isolé<br />
par du colon; cel enroulement a pour support un cadre<br />
. rectangulaire en carlon. — A<br />
/ \ l'intérieur du cadre, une bande<br />
d'acier aimanté (5 cm X 1 cm.)<br />
placée perpendiculairement ' au<br />
plan de l'enroulement; une aiguille<br />
en carlon ( fig. 1) est collée<br />
sur la plaque; par un trou O<br />
placé au-dessus du centre de gralg<br />
' ' vilépasseun axe assujetti au cadre.<br />
3° Un gros aimanl; un enroulement de diamètre<br />
légèrement inférieur à la distance des<br />
pôles de l'aimant; cet enroulement est<br />
fixé à une potence par ses extrémités<br />
libres (fig. 2).<br />
4° Une glace de poche collée sur un<br />
carlon rectangulaire; un manche de<br />
porte-plume fixé verticalement dans une<br />
planchette horizontale serl d'axe à l'ensemble<br />
carlon et glace; un écran; la boîle<br />
cubique de la 1" leçon permettant ai produire<br />
un faisceau lumineux.<br />
5° Une pile quelconque (pile de lampe<br />
de poche), ou batterie d'accumulateurs. Fig. 2.<br />
Plan de la leçon. — I. Principe du galvanomètre.<br />
— Expérience I. — Réunissons les extrémités<br />
du fil du galvanomètre décrit à la 23 e leçon<br />
aux 2 pôles de la pile, le grand axe du galvanomètre<br />
étant orienté nord-sud : dévia lion de l'aiguille.<br />
Inversons lés pôles : déviation de l'aiguille en sens<br />
inverse. Nous voyons donc que :<br />
a) Cet appareil, appelé galvanomètre, permet de<br />
déceler le passage du courant;<br />
b) Qu'il permet d'en déterminer le sens.<br />
RAISONNONS. — Quand lo galvanomètre n'est pas<br />
soumis à l'actiori du courant, l'aiguille est orientée<br />
nord-sud. Quand le courant passe dans le galvanomètre,<br />
le champ magnétique terrestre agit toujours<br />
avec la môme intensité; donc, dans ce cas, l'aiguille<br />
est soumise à 2 actions :<br />
1° Celle du champ magnétique terrestre qui est<br />
constant;<br />
2° Celle du champ magnétique du courant; la<br />
position de l'aiguille dépend de la résultante de<br />
ces 2 forces.<br />
Or, 1e champ magnétique du courant dépend<br />
de l'intensité de ce courant et varie avec lui. Donc :<br />
c) Le galvanomètre permet de mesurer l'intensité<br />
d'un courant.<br />
II. Système astatique.— Comment rendre un<br />
galvanomètre sensible ?<br />
1° En augmentant le champ magnétique du<br />
courant (sans faire varier l'intensite, naturellement);<br />
les expériences do la<br />
N S<br />
J<br />
-1 S N<br />
précédente leçon nous donnent<br />
la solution : augmenter<br />
le nombre des spires do l'enroulement;<br />
2° En diminuant l'action<br />
Fi , du champ magnétique ter-<br />
8 ' restro. Mais celui-ci est constant<br />
en un même lieu; il ne dépend pas de nous de<br />
le modifier.<br />
Examinons la fig. 3 qui représente 2 aiguilles<br />
aimantées réunies par une tige. Appliquons la règle<br />
d'Ampère, nous voyons que les actions du champ<br />
magnétique du courant sur les 2 aiguilles s'ajoutent.<br />
Si les 2 aiguilles avaient des masses magnétiques<br />
rigoureusement égales, l'action du champ terrestre<br />
sur l'ensemble serait nulle. Donc aucune mesure<br />
possible; la déviation des aiguilles sous l'action d'un<br />
courant quelconque serait toujours de 90°.<br />
Mais cette égalité no peut 'exister. Si l'action du<br />
champ terrestre est / sur 1 une et f sur l'autre<br />
l'action sur le système sera //', qui peut être très<br />
petit.<br />
Un tel galvanomètre est extrêmement sensible;<br />
on l'appelle galvanomètre asiatique.<br />
III. Autres systèmes de galvanomètres. —<br />
Dans 1e galvanomètre précédent, nous remarquons :<br />
1° Que le cadre est fixe et l'aimant mobile;<br />
2" Que la force qui s'oppose au champ magnétique<br />
du courant est le champ magnétique terrestre.<br />
a) Utilisation de la pesanteur. — Expérience II.<br />
— Appareil représenté fig. 1 : Le centre de gravité<br />
étant au-dessous du point de suspension, au repos,<br />
la plaque reste horizontale; au passage du courant<br />
elle a tendance à se mettre en croix avec l'enroule-,<br />
ment : c'est la pesanteur qui freine l'action du cou<br />
rant.<br />
b) Galvanomètre à cadre mobile. —Expérience III.<br />
( Fig. 3). — Au repos, le plan du cadre est parallèle<br />
aux lignes de force du champ magnétique de<br />
l'aimant. Que se passe-t-il quand le courant circule<br />
dans l'enroulement ? Nous savons d'après la<br />
précédente leçon que chacune des faces du cadre<br />
devient, l'une un pôle sud, l'autre un pôle nord;<br />
si rien ne s'y oppose, le cadre va tourner exactement<br />
de 90°, quelle que soit l'intensité du courant.<br />
Mais par la torsion qu'il subit, le fil de suspension<br />
s'oppose à la rotation du cadre.<br />
Le cadre est donc soumis à 2 groupes de forces :<br />
1° La torsion du fil;<br />
2° L'action combinée du champ magnétique de<br />
l'aimant qui est constant et du champ magnétique<br />
du courant qui varie avec l'intensité de ce courant.<br />
Faire passer le courant dans le galvanomètre à<br />
cadre mobile. Remarquer lo mouvement du cadre,<br />
REMARQUE. — On augmente la sensibilité du<br />
galvanomètre à cadre mobile en plaçant une masse<br />
de fer doux à l'intérieur du cadre.<br />
c) Emploi d'un miroir. — Expérience IV. — Projeter<br />
un rayon lumineux normalement à la surface<br />
du miroir; recevoir le rayon réfracté sur l'écran,<br />
Faire tourner le miroir; mesurer l'angle; mesurer<br />
l'angle formé avec le nouveau rayon réfracté et le<br />
rayon incident; il est double de l'angle de rotation<br />
du miroir. — Eloigner l'écran. Constatation.<br />
CONCLUSION. — Emploi d'un réflecteur fixé ai<br />
fil du galvanomètre.<br />
IV. Ampèremètres. — a) Elude d'un ampèremètre.<br />
— L'aiguille et son ressort. Les 2 palettes de<br />
fer doux. Une est fixe, l'autre est mobile et solidaire<br />
do l'aiguille équilibréo par l'aiguille. — L'enroulement.<br />
b) Raisonnons. — Le passage d'un courant dans<br />
l'enroulement produit un champ magnétique; les<br />
2 palettes sont aimantées de la même façon. Elles se<br />
repoussent. Le ressort spirale par sa tension s'op)<br />
pose au mouvement. L'aiguille est donc cncorej<br />
soumise à l'action do 2 forces :<br />
1° L'action magnétique du courant;<br />
2° La réaction du ressort.<br />
c) Graduation. — La graduation se fait pat<br />
comparaison avec un voltamètre à azotate d'argent<br />
EXEMPLE. — Problème. Dans un même circuit,<br />
on place un voltamètre à azotate d'argent el<br />
un ampèremètre (faire dessiner le schéma); on;<br />
remarque que pendant toute la durée de l'opéralio^<br />
l'aiguille de l'ampèremètre reste constamment su'<br />
une division a; le courant est passé pendant 3 heures<br />
La masse d'argent déposée à la cathode pendant cij<br />
temps a été de 4 g. 0248, que faut-il marquer ai<br />
point al »-» R. : 3.<br />
E . VENGEON,<br />
Professeur de C. G<br />
E. ESCAL. CHIMIE. 1", 2° et 3' années. E. P. S. Un volume in-16, illustré, cartonné. 15.50
7 Avril 34 HISTOIRE : COURS COMPLÉMENTAIRE 103<br />
KV-fa&j<br />
r S T O Î ?<br />
La question du vote et de la presse<br />
sous la Restauration.<br />
Après 1815, l'histoire de la France prend une face<br />
nouvelle : à la période militaire, succède la période<br />
parlementaire durant laquelle les questions de vote<br />
et de presse tiennent une place de premier plan.<br />
1. Importance de ces deux questions. —<br />
1. Rappeler deux grands principes de la Déclaration<br />
des droits de l'homme. — Souveraineté<br />
de la nation. — Droit de penser, d'écrire, d'imprimer<br />
librement (art. 3, G, 11).<br />
2. Comment ces principes ont été appliqués<br />
depuis 1789.— a) Revoir les diverses constitutions :<br />
îyÔl ; an III ] an VIII. — b) Presse : pas de législation<br />
sous la Révolution : la liberté dégénère en<br />
licence. — Sous l'Empire, livres et journaux sont<br />
soumis à l'examen préalable de l'autorité.<br />
II. Les dispositions de la Charte (leçon n" 25).<br />
— 1. Le vote. — a) Régime censitaire. — « Pour<br />
être électeur et éligible, il faut payer une certaine<br />
somme de contributions directes. — Aucun électeur<br />
rie peut être admis dans la Chambre s'il n'est 3gé<br />
do 40 ans et s'il ne paie une contribution directe de<br />
1000 francs. — Les électeurs ne peuvent avoir<br />
droit de suffrage s'ils no payent une contribution<br />
directe de 300 francs et s'ils ont moins de 30 ans. —<br />
L'organisation des collèges électoraux sera déterminée<br />
par les lois ».<br />
b) Suffrage indirect.— C'est une ordonnance qui,<br />
le 13 juillet 1815, règle le mode de scrutin : Les collèges<br />
d'arrondissement so réuniront le 14 août pour élire<br />
un nombre de candidats égal au nombre des députés<br />
du département. — Les collèges départementaux se<br />
réuniront huit jours après pour élire au moins la<br />
moitié des députés parmi ces candidats. Les collèges<br />
restaient tels qu'ils avaient été constitués par le<br />
senâtus-consulte de l'an X; le nombre des députés<br />
était fixé à 402 (ramené à 258 en 1816). Le » pays<br />
légal » était donc une minorité : 72 199 inscrits<br />
(en 91 : 429 000 électeurs; en 95 : 200 000).<br />
2. Presse. — Rien de bien défini : 0 Les Français<br />
ont le droit de publier et do faire imprimer leurs<br />
opinions en se conformant aux lois qui doivent<br />
réprimer les abus à celle liberté » (art. 8 de la Charte).<br />
Mais quels sont les abus? Oui les réprimera?...<br />
III. L'attitude des partis. — Deux Franco sont<br />
en présence : celle de l'Ancien Régime, effrayée par<br />
les libertés concédées... celle de ta Révolution,<br />
soucieuse do faire respecter les principes do 1789.<br />
La réaction conteste le droit du peuple à se gouverner,<br />
redoute la presse, a plaio dont Moïse a oublié de<br />
frapper l'Egypte ». — Sans réclamer le suffrage<br />
universel, les libéraux désirent l'extension du droit<br />
de vote; sans vouloir l'affranchissement de la presse,<br />
ils sont partisans d'accorder aux journaux une<br />
certaine liberté.<br />
IV. Les grandes lois. -— 1. De la réaction. —<br />
a) Vote. — Loi de juin 1820, du double vote. —Los<br />
électeurs dans chaque département sont répartis<br />
en autant de collèges qu'il y a d'arrondissements<br />
et nomment au scrutin uninominal 258 députés.<br />
Les électeurs les plus imposés, un quart do la totalité,<br />
forment des collèges et, aux chefs-lieux des départements,<br />
choisissent 172 députés. Ce système donnant<br />
deux voix aux grands propriétaires fonciers, assurait<br />
le triomphe des candidats favorables au gouvernement.<br />
Loi du 3 juin 1824. — Elle supprime le renouvellement<br />
par cinquième et fixe à sept ans la durée du<br />
mandat des députés (pourquoi ?)<br />
b) Presse.— «La Restauration maintint d'abord<br />
le régime impérial. Nul ne put Ctro imprimeur ou<br />
libraire s'il n'était breveté par le roi et assermenté.<br />
Tout livre, tout écrit ou simple article dut être<br />
avant l'impression soumis à la censure. — Des<br />
pénalités rigoureuses : la prison, de fortes amendes,<br />
frappaient les délits de presse. » Ces délits furent<br />
jugés par les tribunaux correctionnels qui se montrèrent<br />
impitoyables, les juges étant nommés et<br />
récompensés par le roi.<br />
1 On se montra particulièrement rigoureux pour<br />
la presse périodique : aucun journal no put paraître<br />
qu'avec l'autorisation du roi. Cette autorisation<br />
préalable pouvait toujours être retirée, temporairement<br />
ou définitivement ». MALET : Nouvelle histoire<br />
universelle, t. 3, Hachette.<br />
Le projet de 1827 : Loi de justice cl d'amour,<br />
frappait les périodiques d'une taxe supplémentaire<br />
de 0 fr. 10 par feuille de 30 dm', les non périodiques<br />
d'une taxe de 1 franc. — Si celle loi avait été volée,<br />
elle aurait 1 tué l'imprimerie en France ».<br />
2. Du parti libéral.—-a) Loi électorale de 1817.—-<br />
Los électeurs se réunissent au chef-lieu du déparlement<br />
pour nommer tous les députés du département-,<br />
c'est la première fois depuis 1789 qu'on applique<br />
le scrutin de lisle. — La réunion au chef-lieu favorisait<br />
les libéraux : industriels et commerçants, qui<br />
leur étaient sympathiques, habitaient la ville;<br />
fermiers, propriétaires fonciers qui leur étaient<br />
hostiles, redoutant les longs et coûteux voyages,<br />
s'abstenaient. — Ainsi, en 1817, dans les Landes,<br />
sur G74 inscrits, il n'y a que 330 votants; 83 sur<br />
321 dans les Casses-Pyrénees.<br />
b) Loi de juin 1819 sur la presse. — Autorisation<br />
préalable et censure sont remplacées par le versement<br />
d'un cautionnement (10 000 francs de rentes, soit<br />
un capital de 150 000 f., pour Paris, 5000 en province)<br />
les délits de presse furent jugés par le jury. —<br />
Comme les libéraux craignaient les journaux autant<br />
que les ultras, ils soumirent les périodiques à un<br />
droit de timbre de 0 f. 10, à un droit de poslc de 5 centimes<br />
(par exemplaire).<br />
V. Les ordonnances : 25 juillet 1830. —<br />
1. Mesures contre la presse. — Nul périodique,<br />
nul ouvrage sans aucune distinction ne peuvent<br />
paraître sans l'autorisation royale donnée à l'auteur<br />
et à l'imprimeur. Cette autorisation doit être renouvelée<br />
tous les trois mois et peut être révoquée :<br />
la liberté de la presse n'existe plus.<br />
2. Le roi contre le droit de vote. — • La<br />
ChambredesDéputés ne se composera que dedéputés<br />
de département; le cens électoral cl le cens d'égibilile<br />
se composeront exclusivement des sommes pour<br />
lesquelles l'électeur cl l'éligible sont inscrits personnellement<br />
en qualité de propriétaires ou d'usufruitiers,<br />
aux rôles des impositions foncière, personnelle et<br />
mobilière (les patentes n'entrent plus en Compte). —<br />
Chaque collège d'arrondissement comprenant tous<br />
les électeurs domiciliés dans la circonscription<br />
nommera les candidats aux fonctions de députés en<br />
nombre égal au nombre de députés attribué au département.<br />
Le collège de département,composé du quart le plus<br />
imposé des électeurs, choisira dans la liste des<br />
candidats proposés par le collège d'arrondissement<br />
la moitié des députés et nommera librement l'autre<br />
moitié. — Les électeurs dont la lisle est arrêtée par<br />
le préfet et affichée cinq jours avant la réunion des<br />
collèges, écriront leur vole sur le bureau ou l'il feront<br />
inscrire par l'un des scrutateurs. — Le nombre des<br />
députés est ramené au chiffro indiqué par la Charte,<br />
de 258. — La Chambre est élue pour 5 ans et renouvelable,<br />
chaque année, par cinquièmo ».<br />
CHARLÊTY. La Restauration. Hachette.<br />
Conclusion. — La part de ces deux questions<br />
dans la Révolution do 1830.<br />
GEORGES VÉHON.<br />
A. MILLET. ALGÈBRE. R \ 2 e et 3 B années. E. P . S. Un volume in-16, cartonné 12 fr.
104 GÉOMÉTRIE : COURS COMPLÉMENTAIRE 7 Avril 34-<br />
Angles formés par deux cordes.<br />
I. Propositions. — a) Valeurs : 1° de l'angle<br />
inscrit; 2° de l'angle formé par une corde et la<br />
tangente à "une de ses extrémités; 3° de l'angle<br />
formé par 2 sécantes.<br />
h) Conséquences : Lieu des points d'où l'on voit<br />
une droite donnée sous un angle donné.<br />
II. Exercices dirigés. — 1. Dans un cercla O,<br />
on joint les extrémités d'une corde BC au milieu A<br />
de l'arc BAC. Les bissectrices<br />
BD et CF des angles B cl C du<br />
triangle A BC rencontrent le<br />
cercle en D et F et se coupent<br />
en l. On joint F à A et à B-, D<br />
à A et à C. Etudier la figure en<br />
vue de trouver les arcs, les<br />
angles égaux. Montrer que<br />
AFID est un parallélogramme.<br />
a) Arcs égaux : AB = AC;<br />
BF = FA=ÀD = DC; FC=BD.<br />
b) Angles égaux : (B, = B» = B5 = C, = C2 = C*);<br />
D I); (F» == D.. ABC ACB)...<br />
(F.<br />
(FAD = FID; meme mesure : arc FBCD = arcs<br />
BC + 2FB = ares BC + FD). Le quadrilatère<br />
AFID ayant ses angles opposés égaux est un parallélogramme.<br />
2. On inscrit un triangle équilatéral ABC dans<br />
un cercle O. On prend un point M sur l'arc BC.<br />
Démontrer que MA = M B + M C.<br />
Prendre sur MA le segment MD =<br />
MB. L'angle M valant 60", le<br />
triangle BDM est équilatéral,<br />
d'où BD = BM.<br />
On en déduit l'égalité des<br />
triangles ABD et BCM (I er cas;<br />
les angles B, et B, sont égaux à<br />
60°—Bo). Il en résulte :<br />
AD = MC, d'où AM =<br />
MB + MC.<br />
f 3. Deux cercles O et<br />
O' sont tangents en A.'<br />
Un angle droit pivote<br />
autour de A ; ses côtés<br />
coupent O et O' en B<br />
et C. On trace BE et C F [E et F étant les extrémités<br />
du diamètre commun E A F). Quel est le lieu du<br />
point de rencontre D des droites BE et CF?<br />
Les angles - EBA et ACF sont droits. D l'est<br />
également. Lieu : circonférence de diamètre EF.<br />
4. On donne dans un cercle O une corde AB. Déterminer<br />
sur l'arc AB un<br />
point M, tel que l'on ait :<br />
MB — MA = l.<br />
Soit M le point cherché.<br />
Prolongeons MA de AP<br />
— I. Dans le triangle rectangle<br />
MDP, l'angle P<br />
vaut (l dr — % M). Premier<br />
lieu de P : segment<br />
PAB, capable do cet<br />
angle; deuxième lieu :<br />
circonférence de centre<br />
A et de rayon l. — Mener PB, puis MD qui lui çst<br />
perpendiculaire en son milieu.<br />
III. Devoirs.—1. Soit ABune corde du cercle O.<br />
On joint A et B à un point C<br />
de l'arc AN B, puis C au milieu<br />
M de l'arc AMB. Démontrer<br />
que les triangles CAD, CMB,<br />
DMB ont leurs angles égaux.<br />
a) Les angles C,, C2, B, ont<br />
même mesure : celle du quart<br />
de l'arc AB.<br />
b) Les angles Aj et M, ont<br />
même mesure.<br />
c) L'angle CBM (supplément<br />
de la somme de C2et M,) égale<br />
les angles en D • (suppléments de la somme des<br />
angles C, et A,).<br />
2. On considère 2 cercles de centres O et O 1 de même<br />
rayon égal à la dislance de<br />
leurs centres 00'. Soient A et<br />
B leurs points communs. Par<br />
A; on trace une droite quelconque,<br />
qui coupe ces cercles<br />
en C et C'. Démontrer que<br />
le triangle CC'B est équilatéral.<br />
Les triangles AOO' et<br />
BOO' sontéquilatéraux. Les<br />
arcs AO B et AOB valent 120°. L'angle ACB vaudra<br />
60-(mesure : demi arc AO'B); do même AC'B.<br />
CC'B est équilatéral.<br />
G. <strong>DE</strong>SHAYES.<br />
Professeur do C. C.<br />
Librairie HAGHLTTE, 79, boulevard Saint-Germain, Paris (VI e ),<br />
800 Sujets 1600 Questions<br />
d u Brevet élémentaire<br />
POUR L'ECRIT :<br />
POUR LORAL<br />
100 Dictées, par M. SCHÛNE. i vol. . . . 8 fr.<br />
200 Dictées expliquées, par G. <strong>MANUEL</strong>. 1OO Questions de Morale et<br />
2.Y0I. dè chacun IOO dictées. i" série 8 fr. 10O Questions d'Instruction civique,<br />
2 série 10 fr.<br />
par M. SCHÔNE. I vol<br />
10O Compositions françaises de Morale<br />
et de Littérature, par M. SCHÙNE.<br />
I vol 8 fr.<br />
•IOO Questions d'Histoire et<br />
10O Compositions d'Histoire et de Géo 10O Questions de Géographie, par<br />
graphie, par M. SCHUNE. • vol. . . 8 fr.<br />
M. SCHÙNE. I vol<br />
200 Problèmes et exercices (Arithmé<br />
tique, Algèbre, Géométrie), par 100 Questions de Sciences physiques<br />
8 fr.<br />
8 fr.<br />
J. BAGUET. i vol. • • . . 8 fr.<br />
10O Compositions de Sciences physiques<br />
et naturelles, par J. BAGUET.<br />
i vol 8 fr.<br />
et naturelles et<br />
10O Questions de Sciences mathématiques,<br />
par J. BAGUET. I vol. . . . 8.80<br />
Volumes in-i6, brochés.<br />
N'. B. — Ces ouvrages ne sont pas envoyés gratuitement à titre de spécimens.
Bel général 1933-193-4 N» 28 7 Avril 1934<br />
SUJETS <strong>DE</strong> COMPOSITIONS<br />
donnés dans<br />
fS EXAMENS ET CONCOURS <strong>DE</strong> L'ENSEIGNEMENT <strong>PRIMAIRE</strong><br />
t |<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S <strong>PRIMAIRE</strong>S 1<br />
Orthographe : La petite ville.<br />
tait uno fois une bonne petite ville de province<br />
eposait, tranquille dans son cadre de belles<br />
comme au creux d'un nid de verdure épaisse.<br />
elle venaient tranquillement deux petites<br />
'S au-dessus desquelles les vieux saules . des<br />
inclinaient leurs fronts couronnés de tendresse<br />
H Elle avait de superbes jardins fleuris avec de<br />
incls arbres pleins de nichées heureuses dont elle<br />
feait la beauté comme elle ignorait aussi la grâce<br />
lieuse de ses hôtels d'intendants ou de gouv.er-<br />
de province qui virent, dans leurs salons,<br />
||r au temps du grand Roi, la majesté des<br />
les et la grâce des menuets. BARROUX.<br />
QUESTIONS.<br />
Expliquez : fronts couronnés de tendresse verte;<br />
bcs; niellées heureuses.<br />
1. Analyse grammaticale : elle; tranquillement;<br />
H petites rivières.<br />
III. Conjuguez : venir, au présent, au passé simple<br />
au futur de l'indicatif.<br />
|hmétique pratique et système métrique.<br />
bn achète G barils d'huile d'olive pour 6859 f. 20.<br />
larii plein pèse 89 kg. 700. Vide.il pèse 16 kg. 5.<br />
Itrc d'huile pèse 0 kg. 915. On revend cette huile<br />
50 le kg. Quel bénéfice" fait-on par litre, sachant<br />
les frais s'élèvent à 6 % du prix d'achat?<br />
• Une ménagère achète, à 35 f. le m., de la toile<br />
i pour faire des draps. Chaque drap, fait dei<br />
dont les largeurs s'ajoutent, devra avoir 3 m. 36<br />
ng après le blanchissage. Calculez le prix de la<br />
nécessaire à la confection d'une paire de tels<br />
s, sachant que le blanchissage raccourcit la<br />
1 do 1/15.<br />
Rédaction.<br />
lois sage et ne touche à rien; je reviens bientôt ».<br />
Inaman laisse Bébé, enfant de 4 ans, sur la carb<br />
de la chambre à coucher. Bébé joue un mo-<br />
Kt avec ses images; mais... il y a de si jolies choses<br />
la table à toilette ; des flacons, des boîtes, etG...<br />
| 4 Oh I mon Dieu, c'est maman qui revient!<br />
pel désastre, mais que petit Jean est drôle 1<br />
Bpntez ces scènes successives et terminez à votre<br />
Sciences.<br />
I Expliquez le fonctionnement du thermomètre.<br />
Iment gradue-t-on un thermomètre à alcool ou<br />
lercure ? Peut-on utiliser les métaux pour le<br />
jltionnement du thermomètre? Pourquoi?<br />
Quelles sont les conditions les plus favorables<br />
| faire sécher la lessive? Expliquez.<br />
f<br />
BOURSES NATIONALES (3» sir ie).<br />
Orthographe : Pin d'hiver.<br />
jappelez-vous vos promenades de février et la re-<br />
"he toujours déçue de vos yeux. Les talus n'ont<br />
ne fleur. Le lierre pend le long des murs, endormi,<br />
fché par ses ongles aux crevasses de la chaux. La<br />
Bç ezi a détaché des lambeaux qui retombent du som-<br />
U'illcs. Centre do Conslnnlino.<br />
met, renversés, serrant encore les débris des treillages<br />
qui les portèrent un temps. Les dessous de bois sont<br />
lamentables. Tout l'automne, et même au début de<br />
l'hiver, entre les cépées de chênes, dans les clairières ouvertespar<br />
la mort d'un vieil arbre, au bord du sentier<br />
où s'épanouiront dans un mois les premières stel-<br />
1 aires,les végétations de l'été gardaient une apparence de<br />
vie. Ce n'était plus la belle verdure des jours chauds, la<br />
pâleur saine des bourgeons qui se développent. Mais les<br />
touffes étaient encore debout : les joncs brunis se pressaient<br />
et ondulaient ensemble; il y avait au sommet des<br />
tiges des graines noires mêlées de duvet blanc et l'on voyait<br />
des nids anciens parmi les branches.<br />
A présent, tout est couché, froissé, souillé. Les chasseurs<br />
ont passé; les bestiaux ont piétiné la terre; les<br />
dégels ont achevé de pourrir ce qui fut l'herbe vivante<br />
et souple. • R. BAZIN.<br />
QUESTIONS.<br />
I. Commentez là première phrase du texte.<br />
II. Expliquez : ses ongles; lamentables; cépées;<br />
s'épanouiront.<br />
III. a) Cherchez dans la dictée un exemple de<br />
chacune des formes du verbe.<br />
b) Quelle est la fonction des mots ou groupes de<br />
mots suivants : en (a détaché); un temps; par ta<br />
mort d'un vieil arbre; où (s'épanouiront); debout.<br />
EXPLICATIONS.<br />
I. A l'automne et même au début de l'hiver, la nature<br />
a gardé, bien fanée; hélas ! la parure de l'été : l'herbe est<br />
restée debout, les joncs ondulent ensemble, les graines<br />
sont suspendues aux tiges et on voit des nids anciens dans<br />
les branches.<br />
Mais en février, plus rien !• Notre a recherche est toujours<br />
déçue ». Car
110 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong>-<strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />
DÉVELOPPEMENT.<br />
Est-on de bonne humeur? Tout va bien : on est<br />
heureux et on rend tout le monde heureux autour<br />
do soi-. Mais est-on de mauvaise humeur ? On grogne<br />
contre tout; contre tous, contre soi-même. Et ce<br />
qu'il y a de terrible, c'est que la mauvaise humeur<br />
est communicative. Qu'un seul membre de la famille<br />
11e soit pas « bon à prendre avec des pincettes » et<br />
c'est la discorde au camp d'Agramant...<br />
Aussi, en famille, veillons sur ' noire humeur.<br />
Comment! se contraindre dans la famille? Où pourrai-je<br />
alors détendre mes nerfs ? Ailleurs, nous<br />
n'oserons pas montrer notre mauvais caractère, et<br />
c'est à ceux que nous aimons que nous réserverons<br />
notre mauvaise humeur? Ils seront seuls à souffrir?<br />
Allons, un peu de volonté : si nous avons des contrariétés,<br />
ayons la force de ne pas les laisser voir ou<br />
parlons-en calmement. Et la bonne humeur reviendra<br />
bien vite...<br />
En sociclé, veillons sur notre langue. Point n'est<br />
besoin de longs développements. Ouvrons le livre<br />
des proverbes I « Trop gratter cuit, trop parler nuit.<br />
Avant de parler, tourne sept fois ta langue dans ta<br />
bouche. La parole est d'argent, le silence est d'or. »<br />
J'arrête mes citations, je n'en finirais pas. Ne<br />
parlons pas trop, nous commettrons moins d'erreurs,<br />
nous dirons moins de sottises, nous, donnerons<br />
une meilleure idée de notre éducation, en<br />
n'importunant pas notre entourage. Et surtout,<br />
pour faire le bel esprit, ne daubons pas sur notre<br />
voisin : c'est le signe d'un mauvais cœur.<br />
Seuls, veillons sur nous-mêmes. Encore se contraindre<br />
quand on est seul ? Mais oui, mais oui...<br />
car nous sommes seuls en face de notre conscience,<br />
sans subir les lâches suggestions que l'on ne manquera<br />
pas de nous faire. Lù seulement, nous pouvons<br />
juger notre conduite sans faiblesse, puisque nous<br />
sommes sans témoins. C'est le moment de refréner<br />
ses mauvais instincts, de ne pas « se laisser aller t,<br />
de faire, sincèrement son mea culpa en se promettant<br />
de réagir. C'est surtout vis-à-vis de nous-mêmes que<br />
nouS devons garder correction~et dignité.<br />
Surveillons-nous toujours et partout. C'est dans<br />
cette con train Le morale, dans ce contrôle incessant<br />
de soi-même que nous trouverons la vertu.<br />
SOLUTION.<br />
On construit l'angle B = 60°.<br />
On trace la bissectrice de cet angle. On mens'<br />
parallèle à AB à une distance de 1 cm. 2, de mai<br />
qu'elle coupe là bissectrice à l'intérieur de l'aiu»<br />
L'intersection O est le<br />
centre du cercle inscrit.<br />
On décrit la circonférence<br />
de centre O en prenant<br />
pour rayon une longueur<br />
égale à 1 cm. 2'. O<br />
étant situé sur la bissectrice<br />
est équ'idistànt de BA<br />
et de BC. OD et OE= 1 cm.<br />
2. Là circonférence O est<br />
donc tangente en D et en<br />
E aux côtés de l'angle B.<br />
Du centre O, avec une C E<br />
ouverture de compas égale à 3 cm., on décrit un arc<br />
cercle qui coupe l'un des côtés de l'angle en A. De A,<br />
mène une tangente à la circonférence inscrite : pour<br />
on décrit la demi-circonférence de diamètre AO qui<br />
terminé sur la circonférence inscrite le point de tangi<br />
T. AT prolongé détermine le sommet C du triangle,<br />
Toutes les conditions ont donc été remplies;<br />
= 3 cm. ; B = Go° ; la circonférence O de rayon r = 1 c<br />
est tangente aux trois côtés du triangle.<br />
BREVET ÉLÉMENTAIRE ET CONCOfl<br />
D'ADMISSION AUX ÉCOLES NORMAL<br />
Orthographe :<br />
Rome et la vie rurale en Gaule.<br />
Mathématiques.<br />
I. Un particulier vend un terrain en forme de trapèze<br />
dont la hauteur est 75 m e dont la petite base est les<br />
3/7 de la grande. Il place les 2/5 du produit de la vente<br />
à 4,5 % et le reste à 6 %. Il retire 25 335 f., capital et<br />
intérêts réunis au bout de 2 ans et 4 mois. L'are du<br />
terrain valant 300 f., calculer les bases du trapèze.<br />
SOLUTION.<br />
Taux moyen :<br />
(4,5 X 2) + (6 X 3)<br />
5,4 %.<br />
~<br />
z 5 335 f- X 100<br />
Capital primitif : — = 22 500 f.<br />
• 100 + 5,4x2 1/3<br />
„ , , , . 1 m a Le promeneur qui regarde attentivement les In<br />
essentiels de nos campagnes, suivant les sentierset<br />
routes, les diverses courbes du sol, aperçoit toujours<br />
vestiges delà domination de César : quelques dale<br />
maines que les siècles n 'ont pas brisées et qui frayaient<br />
chemin à l'abondance et à l'ordre. Souveniisl<br />
l'observateur ne pourra point se passer : Rome orgai<br />
le travail, féconde un pays presque inculte, coupe<br />
lialliers, assèche les marécages, multiplie les voies à<br />
courir le négoce. Une forme d'exploitation rurales'®<br />
cine dan3 notre sol et subsistera dans ses grandes!<br />
jusqu'à nos jours, tant sa conception était puissant)<br />
parfaite. H s'agissait d'harmonie et d'équilibre :<br />
domaine, marqué de l'esprit latin, tendait sans cesse à<br />
suffire à lui-même; il produisait tout ce qui était ut<br />
les gens avaient leur nourriture, leur logis, les aniffli<br />
leurs étables, les fourrages et les céréales leurs graij<br />
La carrière, la rivière, le sable, le bois nécessaire<br />
bâtiments et aux outils étaient proches; les prairies,<br />
pacages, les terres à blé, les vignes et les forêts doffl<br />
x 225 00<br />
Surface du terrain : = 7500 m-,<br />
3<br />
, , 1 m. X 7500 X 2<br />
Somme des bases : : = 200 m.<br />
75<br />
leurs richesses. Tout autour, il y avait des ateliers de fo<br />
de serrurerie, de tissage, de charronnage et de men®<br />
„ . 200 m . X 3 „„<br />
Petite base : -60 m.<br />
7 -I- 3<br />
_ , , 200 m. y. 7 ...<br />
Grande base : =140 m.<br />
7 + 3<br />
II. Construire un triangle ABC connaissant la longueur<br />
r du rayon du cercle inscrit, la distance AO entre le<br />
sommet A et le centre de ce cercle, et l'angle B.<br />
On prendra : r = 1 cm. 2; AO = 3 cm. et B = 60°.<br />
Justifier la construction.<br />
8<br />
Pour la première fois, l'homme s'appliquait v'<br />
ment au sol, afin d'en tirer toute sa vit'<br />
CHARLES SYLVESTRE. La vie à la campai"<br />
QUESTIONS.<br />
I. Expliquez les mots et expressions: traits«f<br />
tiels; vestiges-, conception-, qui fragaienl le ck0<br />
l'abondance et à l'ordre-, l'homme s'appliqua*,®<br />
meni au sol, afin d'en tirer toute sa vie.<br />
II. a) Nature et fonction des propositions®<br />
première phrase : « Le promeneur... et à l'ordrt•<br />
b) Analysez le mot : fourrages.<br />
EXPLICATIONS.<br />
I. Traits essentiels. Au sens propre, un trait est<br />
ligne tracée, puis par extension, c'est la marque si»<br />
CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. M.HOLOT. 200QuestionsdeSciencesusuellesRDPO°|CS.SÉRIE^<br />
. aa9i
Avril 34 SUJETS <strong>DE</strong> COMPOSITIONS 111<br />
icative de quelque chose. Essentiel se rapporte à ce qui<br />
institue la nature propre d'une chose. Les traits es-<br />
;cntiels de nos campagnes, ce sont donc leurs marques<br />
laràctéristiques qui font que, leur étant propres, il est<br />
mpossible de les confondre avec d'autres.<br />
Les vestiges sont les' marques, les restes qu'une chose<br />
létruite a laissés de son existence. Les dalles dont il<br />
i'agit dans le texte sont certainement les restes des<br />
ameuses voies romaines qui sillonnaient notre pays.<br />
Une conception, c'est une idée qui se forme dans notre<br />
isprit. Les Romains s'étaient fait de l'exploitation rurale<br />
ine idée « puissante et parfaite ».<br />
Qui frayaient le chemin à l'abondance et à l'ordre: Frayer<br />
m chemin, c'est l'ouvrir, le préparer. Les voies romaines,<br />
in traversant la Gaule dont la campagne était alors<br />
>resque à l'état de nature, rendaient les transports faciles,<br />
apides et sûrs. L'auteur nous montre le domaine galloomain<br />
organisé pour se suffire à lui-même. Tout ce qui<br />
:n sortait, animaux, récoltes, était donc du superflu :<br />
:'était l'abondance. La conquête achevée, les légions<br />
lui empruntaient les voies étaient chargées de la police<br />
Intérieure, donc d'assurer l'ordre.<br />
I L'homme s'appliquait vraiment au sol, afin d'en tirer<br />
loitte sa vie. S'appliquer, c'est faire porter sur,quelque<br />
Ihose tout son effort. L'auteur nous montre le propriétaire<br />
Ee la villa s'appliquant à tirer du sol, non seulement toute<br />
la nourriture, mais encore tout ce qui est nécessaire à la<br />
|'ie. Point n'est besoin dé sortir du domaine pour aller<br />
Ihercher quoi que ce soit. A côté de l'exploitation agricole,<br />
voici là rivière qui donne les poissons,' la vigne qui<br />
Bonne son vin, puis ce sont les carrières, les forêts qui<br />
fournissent les matériaux de construction. Forge, serrurerie,<br />
tissage, charronnage, menuiserie, tous ces ateliers<br />
Itaient dans les bâtiments de la ferme.<br />
I II. a) Le promeneur aperçoit toujours les vestiges de la<br />
nomination de César : quelques dalles romaines : proposition<br />
principale ;<br />
I Qui regarde attentivement- les traits essentiels de nos camwagnes,<br />
suivant les sentiers et les routes, les diverses courbes<br />
I" sol : prop. sub. par le pron. relatif qui, complément du<br />
«om promeneur-,<br />
I Que les siècles n'ont pas brisées :prop. sub. par le pron.<br />
[cl. que, complément du nom dalles ;<br />
I (et) qui frayaient le chemin à l'abondance et à l'ordre :<br />
wrop. sub. par le pron. relat. qui, compl. du nom dalles,<br />
loord. à la précédente par et.<br />
I b) F outrages : nom commun, masc. plur., sujet du verbe<br />
tmicnt de la proposition elliptique : les fourrages et les<br />
lércales (avaient) leurs granges.<br />
Composition française.<br />
I Madame de Mamtenon a dit :<br />
| « Ne faites jamais dépendre votre bonheur des autres. »<br />
I Que psnsez-vous de ce conseil ? Vous paraît-il, en particulier,<br />
compatible avec la pratique de la solidarité ?<br />
S T DÉVELOPPEMENT.<br />
| Le honheur 1<br />
I C'est assurément un plaisir aussi vit que délicieux.<br />
|ans mélange, et dont rien ne saurait altérer ia 'jouisiance.<br />
Tous les hommes en ont une idée bien claire<br />
| '1 est incessamment le terme de leurs vœux. Mais<br />
|e bonheur parfait n'est pas de ce monde, car en<br />
Bumettant que l'homme l'ait atteint, combien de<br />
lemps le conservera-t-il intact ? Le bonheur est<br />
|i ailleurs tout à fait relatif. Placés dans les mêmes<br />
[îrconstances, tel se trouvera parfaitement heureux,<br />
r'J c .® s . u n sa ge, tel sera malheureux parce que tous<br />
• désirs ne sont pas réalisés... Dernièrement, je<br />
Rencontrai une dame qui était en plein ciel : le rêve<br />
f e toute sa vie venait d'être réalise; mais dès qu'elle<br />
jppnt qu une de ses collègues avait reçu, en même<br />
' mps qu elle, les mêmes avantages, son dépit fut<br />
ï!i,?,!' a l ncl 1 ue son bonheur s'évanouit. Regarder<br />
Ko, . v "i! 116 s ? 1 ' no . us dit-on, est le secret du bon-<br />
Ict In?<br />
es / Vra '' F 113 ' 3 un e comparaison avec autrui<br />
|<br />
S1 nécessaire ? Et puis, il y a les faibles, inca<br />
pables de se procurer par eux-mêmes le bonheur :<br />
ils l'attendent d'autres; mais chose curieuse, comme<br />
il ne leur demande aucun effort, ils sont souvent<br />
insatiables et peu reconnaissants. Et si le protecteur<br />
vient à manquer ?... Lorsque notre bonheur dépend<br />
des autres, il est donc bien fragile et c'est pourquoi<br />
Madame de Maintenon a pu nous dire : « Ne faites<br />
jamais dépendre votre bonheur des autres. »<br />
Nous devons donc rechercher le bonheur «égoïste»?<br />
Il y a ceux, en effet, qui veulent « vivre leur vie »<br />
et qui recherchent dans la bonne chère, dans la<br />
satisfaction de leurs appétits, la réalisation de leurs<br />
plaisirs grossiers, ce qui leur suffit pour êLre heureux.<br />
Mais il est un genre de jouissances qui surpassent<br />
toutes les autres, contre lesquelles tous les maux de<br />
la vie ne sauraient prévaloir, qui sont le privilège<br />
de quelques hommes, mais qui sont également réservées<br />
à tous, qui peuvent être de tous les instants,<br />
se retrouver dans toutes les situations de la vie :<br />
ce sont les joies de la conscience, c'est la satisfaction<br />
que procure la pratique de la vertu.<br />
Le perfectionnement de soi-même peut-il être<br />
égoïste, exclusivement? Je ne le pense pas. Voyez<br />
cette infirmière, ce docteur qui se dépensent sans<br />
compter; seraient-ils au point de vue moral ce qu'ils<br />
sont s'ils ne s'étaient point dévoués à autrui ? Leur<br />
bonheur provient justement de leur sacrifice.<br />
Privez donc ce philanthrope de faire du bien :<br />
vous le rendrez extrêmement malheureux de ne<br />
pouvoir soulager les misères qui s'étalent ii ses yeux.<br />
Le père et la mère no sont jamais si heureux que<br />
lorsqu'ils se sont entièrement, absolument, dévoués<br />
à leurs enfants.<br />
Alors... c Rendons-nous heureux les uns les autres »<br />
est encore la plus belle règle de conduite, non seulement<br />
pour notre bonheur personnel, mais pour<br />
celui de l'humanité tout entière.<br />
Histoire.<br />
Les institutions napoléoniennes. A quels besoins répondaient-elles<br />
? Qu'est-ce qui en a survécu ?<br />
Mathématiques.<br />
I. Algèbre.— 3 joueurs commencent une partie<br />
avec des avoirs respectivement désignés par x, y, z.<br />
Ils conviennent qu'après chaque partie, le perdant<br />
doublera pour chaque joueur la somme qu'il avait au<br />
début de la partie qui vient de se jouer. Chaque<br />
j oueur perd une partie.<br />
1. Ecrire après chaque partie la somme que donnera<br />
le perdant et l'avoir de chaque j oueur ;<br />
2 En supposant qu'ils se sont retirés après 3 parties<br />
avec le même avoir de 96 fr., trouver l'avoir de chaque<br />
joueur au début du jeu (la l re partie est perdue par le<br />
joueur qui possède x, la 2° par le joueur qui possède y).<br />
SOLUTION.<br />
A la fin de la première partie, le premier joueur donne<br />
au second : y et au 3 8 z. Le second possède 2y, le troisième<br />
2 z et le premier x — y — z.<br />
A la fin de la deuxième partie, le premier joueur<br />
possède2x—2y—2z,le second : 2y—[x—y—2)—<br />
•= 3 y — x— z, et le troisième4z.<br />
A la fin de la troisième partie, le premier joueur possède<br />
4x — 4y—4z, le second 6 y—2 x — 2 z et le troisième^—<br />
(2X—2 y — 2 2) -— (3 y—*—*) — 7z—*—y.<br />
On aura : 4 * — 4y — 4; = 96.<br />
ou x — y — 2 = 2+ (0<br />
6 y — 2X — 22 = 96<br />
ou 3 y — x — z = 48 (-)<br />
et 72 — x — y = 96. (3)<br />
De (r) et (2), on tire : y — z = .36 (4)<br />
de (2) et (3}, on tire : 2z — y = 12 (5)<br />
'ER TIF ICA T D'ÉTunFS. M. Holot. 10o Questions d'histoire ré*£s%. 2.75<br />
21
m <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />
de (4) et (5), on tire : s — 48, y = 84.<br />
Do (1), on tire x = 24 + 48 + 84 •= 156.<br />
Vérification : '<br />
Avoir du 1", du 2°, du 3 e , Total.<br />
À la fin de la 1 16 partie : 24, 168,. 96, .288<br />
. — 2 0 partie: .48, .48, 192, 288<br />
— 3" partie j 96, 96, 96, 288<br />
Iï. Géométrie. — Deux circonférences de centres<br />
0 et 0', de rayons E et R' sont tangentes extérieurement<br />
en A. On trace deux rayons parallèles et de même sens<br />
0M et O'M'.<br />
a) Démontrer que l'angle MAM' est droit;<br />
b) MM' coupe 00' en S. Montrer que S est fixe<br />
quelle que soit la direction OM en calculant OS en fonction<br />
de R et R';<br />
c) On suppose R = 3 R' et AOM = 60. Calculer<br />
MM' et montrer. que MM' est tangente aux dettx circonférences.<br />
d) Si OM et O'M' sont parallèles et de sens contraires,<br />
montrer que M, A, M' sont en ligne droite.<br />
SOLUTION.<br />
a) MOA + M'O'A => 2 dr (angles intérieurs par rapport<br />
aux parallèles MO et M'O' et à la sécante OS).<br />
-.<br />
MAO = 1 dr<br />
MOA _<br />
; M'AO' = 1 dr<br />
2<br />
M'O'A<br />
2<br />
MAM' = 2 dr — (MAO + M'AO')<br />
MOA 4- M'O'A<br />
=<br />
2<br />
—<br />
dr<br />
0 ~~ z<br />
= 1 dr.<br />
r<br />
l 0<br />
OS _<br />
]<br />
OM ~OMd'où<br />
OS<br />
O'M' " —<br />
R\R + R')<br />
R — R'<br />
c) Si OM = 3 R', OS<br />
3 R- X 4 R'<br />
= fiK'=iR.<br />
2 R'<br />
O'S = 2R'; l'angle, MOS = 6o°; OS étant le double<br />
de OM, le triangle SOM est un triangle rectangle,<br />
demi-triangle équilâtéral; SM = 3 R'yVj M'S = R'\/j<br />
etMM'=.2jR'v/3.<br />
Les angles OMS et O'M'S étant droits, MM' est<br />
gente aux deux circonférences.<br />
d) Les triangles OMA et O'M'A sont isocèles; l'angle<br />
AOM et l'angle AO'M' sont égaux comme alternesinternes<br />
par rapport aux parallèles OM et O'M' et à la<br />
sécante OO'; les deux triangles OMA et O'M'A sont donc<br />
semblables, les angles OAM et .O'AM' sont égaux, ils<br />
occupent la position d'opposés par le sommet. OÀO 1<br />
étant une ligne droite, MAM' l'est également.<br />
Sciences.<br />
I. Les accumulateurs. — Charge. — Décharge,<br />
Utilisation et entretien.<br />
H. On se propose de décomposer 53 g. 5 de chlorure<br />
d'ammonium par la chaux vive, a) Quel poids de chaui<br />
faut-il employer si l'on veut à la fois obtenir tout le gaz<br />
ammoniac contenu dans le chlorure donné et retenir,<br />
par la chaux, toute l'eau formée?<br />
b) En supposant que l'oxydation complète du j<br />
ammoniac donne uniquement de l'eau et de l'azote,<br />
calculer le volume d'oxygène nécessaire pour<br />
le gaz ammoniac obtenu dans l'expérience précédi<br />
et la masse d'eau obtenue.<br />
On donne :<br />
H = 1;N = 14; Cl = 35,5; Ca = 40; 0 = 16.<br />
SOLUTION.<br />
a) 2 NH 4 C1 + 2CaO = CaCP + 2 NH 5 + {CaO ffOl<br />
107 g. de NH'Cl réagissent sur 112 g. de CaO pour<br />
donner 34 g. de NH 1 .<br />
Masse de chaux nécessaire :<br />
112 g. x 53,-5<br />
56 g.<br />
107<br />
. 34 g- X 53,5<br />
Masse d'ammoniaque formée :<br />
= 17 g.<br />
b) 2 NH 3 4- O 3 = 2 N + 3 H'O.<br />
33 i. 6 d'oxygène agissant sur 34 g. de NH 3 donnent<br />
54 g. d'eau.<br />
Vol. d'oxygène nécessaire<br />
331.6 X. .17<br />
=16!. 8.<br />
Masse d'eau formée<br />
54 g- X 17<br />
34<br />
34<br />
= 27 g.<br />
Librairie HACHETTE, 79, boulevard Saint-Germain, Paris (VI").<br />
IVWVVUVWWVWVWWUVlA«A/WVWWVWVWVWWVWïiWWMWV*/rfW