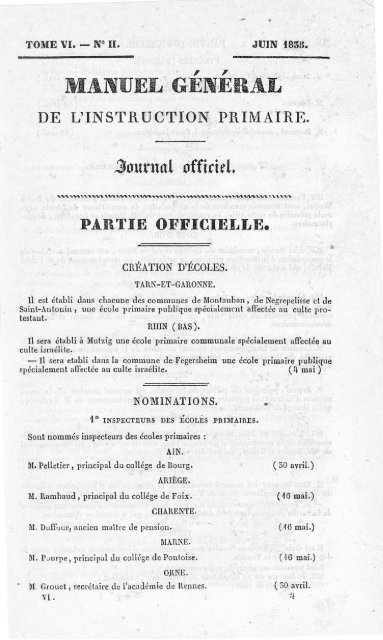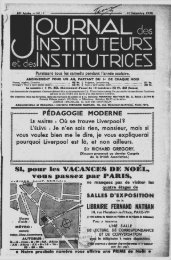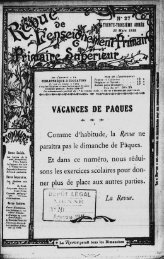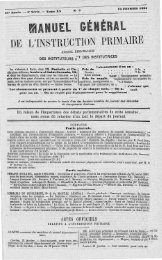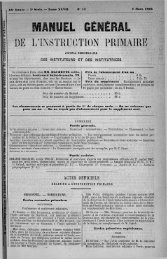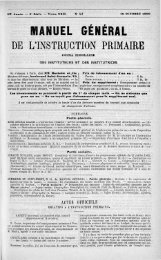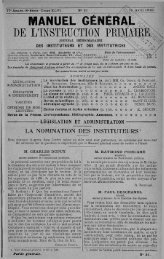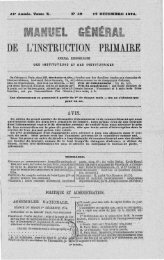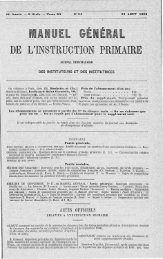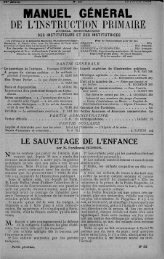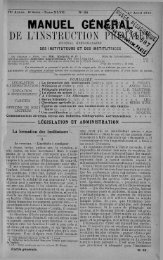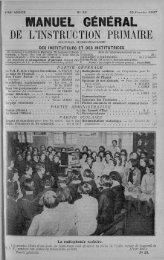PAïlTIE OFFICIELLE .
PAïlTIE OFFICIELLE .
PAïlTIE OFFICIELLE .
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TOME VI. — N » II. JUI N 1833 .<br />
f f<br />
DE L'INSTRUCTIO N PRIMAIRE .<br />
Journal 0ffiftd .<br />
<strong>PAïlTIE</strong> <strong>OFFICIELLE</strong> .<br />
CRÉATION D'ÉCOLES .<br />
TAUN-ET-GARONNE.<br />
Il es t établ i dan s cliacun e de s commîmes deMontauban , d e Negi'epeliss e e t d e<br />
Saint-Antoniii, un e écol e primair e publiqu e spécialemen t afi'ecté e au cult e pro -<br />
testant.<br />
RHIN (BAS) .<br />
Il ser a établ i à Mutzi g un e écol e primair e communal e spécialemen t affecté e a u<br />
culte Israélite .<br />
— Il ser a établ i dan s l a commun e d e Fegersliei m un e écol e primair e publiqu e<br />
spécialement affecté e au cult e Israélite . (f l ma i )<br />
NOMINATIONS.<br />
1° INSPECTEUR S DE S ÉCOLE S PEIMAIRES .<br />
Sont nommés inspecteur s de s écoles primaires :<br />
AIN.<br />
M. Pelletier, principa l d u collèg e d e Bourg. ( 30 avril. )<br />
ARIÈGE.<br />
M. Rambaud, principa l d u collèg e d e Foix. (I C mai. )<br />
CHARENTE.<br />
M. Duffuur, ancien maîtr e d e pension . (4 0 mai. )<br />
WARNE.<br />
M. Puurpe, principa l d u collèg e d e Pontoise. (-1 6 mai. )<br />
ORNE.<br />
M. Grouet, secrélair e d e l'académie d e Rennes . ( 30 avril .<br />
VI . -It-
50 PARTI E <strong>OFFICIELLE</strong> .<br />
PYRÉNÉES (BASSES) .<br />
M. Sicabaig, avoca t à Pau. (3 0 avril. )<br />
PYRÉNÉES (HAUTES) .<br />
M. Ducruc. ( 30 avril. )<br />
SEINE-ET-MARNE.<br />
M. Dumont , sous-bibliotliécair e à Fontainebleau. ("l e mai. )<br />
COMMISSIONS D'INSTRUCTIO N PRIMAIRE .<br />
AUBE.<br />
MM. Fevrand-Lamotte, ancie n négociant , e t Doé , ancie n Procureu r d u Ro i à<br />
Troyes, son t nommé s membre s d e l a commissio n d e surveillanc e d e l'écol e nor -<br />
male primair e de cett e ville, enretnplacemen t d e MM . Mongis e t Forneron, démis -<br />
sionnaires.<br />
COTE-D'OR.<br />
M. l'abbé Massip , aumônie r d u Collèg e royal d e Dijon, eî t nomm é membr e d e<br />
le commission d'instructio n primair e d e cett e ville, e u remplacemen t d e M . l'abbé<br />
Mairot, qu i a changé d e résidence .<br />
EURE.<br />
MM. Lliopital, maire, e t Hébert , juge-de-pai x d'Évreux , son t nommés, l e pre -<br />
mier, président , l e deuxième, membr e de la commissio n d e surveillance de l'écol e<br />
normale primair e d e cett e ville , e n remplacemen t d e MM . Gazai i e t Laporte ,<br />
démissionnaires.<br />
LOIRET.<br />
M. Landrée d e Longcham p es t nomm é membr e d e l a commissio n d'instructio n<br />
primaire d e Montargi s , e n remplacemen t d e M . Desmoulins , qu i a donn é s a<br />
démission.<br />
OISE.<br />
M. Jaquin, principa l d u collèg e d e Beauvais , es t nomm é membr e d e l a com -<br />
mission d'instructio n primair e d e cett e ville, e n remplacemen t d e M . Leclercq ,<br />
q^i a changé d e résidence .<br />
RHIN (HAUT) .<br />
MM. Lœuille t e t Jean'Mongin , régent s a u collèg e d e Colmar , son t nommé s<br />
membres d e la commissio n d'instructio n primair e d e celte ville , e n remplacemen t<br />
de MM . Bardot et Griois, qu i on t donné , leur démission .<br />
SARTHE.<br />
M. Etoc-Demazy es t nomm é membr e d e l a commissio n d'instructio n primair e<br />
du Mans , e n remplacement d e M , Verdier. ( avril. )<br />
— M. Yallée-Platon es t nomm é membr e d e l a commissio n d'instructio n primair e<br />
delà Sarllie , e n remplacement d e M . Lecouteiix, qu i a donn é s a démission .<br />
(-13 mai. )<br />
VENDÉE.<br />
Il es t établi à Bourbon-Vendée un e commissio n d'instructio n primair e poiu ' l e<br />
département d e la Vendée .<br />
Sont nomme s membre s d e cett e commission ,<br />
MM. l e Recteu r o u u n Inspecteur d e l'académie , président ;<br />
le Maire de la vill e ;
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 5 1<br />
le Procureu r d u Roi ;<br />
le Cur é ;<br />
le Pasteur d e l'églis e prolestante ;<br />
Savin-Laclaume ;<br />
le Principal d u collèg e ;<br />
Ganot, régen t de mathématiques a u collège .<br />
O COMITE S D ARRONDISSEMENT .<br />
CANTAL.<br />
Sont nommés membre s de s comités d'arrondissemen t ci-aprè s , savoir :<br />
Comité de Saint-Flour.<br />
M. l'abbéPigasse , principa l du collège , e u remplacement d e M . Boucliet .<br />
Comité d'issoire.<br />
M. Barlaud , principal d u collège , e n remplacement d e M . l'abbé Pigasse .<br />
( t t mai . )<br />
MANCHE.<br />
M. Renard , principa l d u collèg e d e Mortain , es t nomm é membr e d u comit é<br />
d'arrondissement d e cette ville , e n remplacement d e M . Fouqué, qu i a chang é d e<br />
résidence.<br />
MEUSE.<br />
Sont nommé s membre s des comités d'arrondissemen t ci-aprè s ; savoir :<br />
Comité de Commercy.<br />
M. Warin , principal d u collège , e n remplacement d e M . Major, qu i a donné s a<br />
démission.<br />
Comité de SainL-Mihiel.<br />
M. Martinot , instituteu r à Creue , e n remplacement d o M . Simon, qu i es t dé -<br />
cédé. (•ISmai. )<br />
MORBIHAN.<br />
4. Notr e arrêt é d u 1 0 avri l ISSI ) qu i constitu e l e comit é supérieu r d'instructio n<br />
primaire d e Ploërmel pou r tou t l'arrondissemen t d e cette ville, es t rapporté .<br />
2. I l es t établ i deu x comité s supérieur s d'instruction primair e pour l'arrondis -<br />
sement d e Ploërmel, savoi r : le premier, a u chef-lie u mêm e d e l'arrondissemen t<br />
pour le s canton s d e Guer , d e Malestron , d e Mauro n e t d e Ploërrael ; l e secon d à<br />
Jos.selin pou r le s canton s d e Josselin , d e Rohan , d e l a Trinit é e t d e St-Jea n<br />
Brevelay. (2 0 mai. )<br />
SEINE.<br />
M. Molin, maîtr e d e pensio n à Auteuil, es t nomm é membr e du comit é d'arron -<br />
dissement d e Neuill y , en remplacemen t d e M . Gengembre , démissionnaire .<br />
( IS mai. )<br />
4-° ÉCOLE S NORMALE S PRIMAIRES .<br />
LOIR-ET-CHER.<br />
Yu le rapport d e M . le préfet d u départemen t d e Loir-et-Cher ,<br />
Yu l a lisl e pa r ordr e d e mérit e dressé e pa r l a commissio n d'instructio n primair e<br />
ftv
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 52<br />
à l'issu e du concours ouver t pour la nomination , tant aux bourses départementale s<br />
qu'aux quatr e demi-bourse s d e l'État, créée s à l'école normale primair e d e Blois,<br />
Nous avon s arrêt é e t arrêton s c e qui suit :<br />
•1. Son t nommé s demi-boursier s d e l'Éta t à l'écol e normal e primair e d e Blois ,<br />
savoir :<br />
Les sieurs Fouquet (Charles ) ;<br />
Petiau (Françoi s ) ;<br />
Michelin (Nicolas-Étienno ) ;<br />
Macé (Denis) .<br />
2. Ce s jeunes gen s jouiron t de s avantage s attaché s au x demi-bourse s qu i leu r<br />
sont accordées , à partir du jour d e leu r entré e à l'école normale. ( 20 mai. )<br />
LOT.<br />
Vu le s proposition s d e M . l e recteur d e l'académi e d e Cahor s , pou r l a nomina -<br />
tion à l a bours e entièr e e t au x deu x demi-bourse s créée s dan s l'écol e normal e<br />
primaire d e Cahors, su r les fond s de l'État ,<br />
Avons arrêt é e t arrêtons c e qu i sui t :<br />
A. Son t nommé s boursier s d e l'Éta t à l'écol e normal e primair e d e Cahors ,<br />
savoir :<br />
A bourse entière.<br />
Le sieur Mourgue s (Antoine), élève-maîtr e d e second e année .<br />
A demi-bourse.<br />
Les sieurs Delo n (Jean-Antoine ) ,<br />
élèves d e second e année .<br />
Pelissié (Pierre) ,<br />
2. Ce s jeunes gen s jouiront pa r rappe l de s avantage s attaché s au x bourse s qu i<br />
leur sont accordée s , à parti r d u 'I" ' janvier '1835 . (2 0 mai. )<br />
SEINE-ET-OISE.<br />
Sont nommés boursier s d e l'Étatj à l'écol e normal e primair e d e Versailles, le s<br />
jeunes gens dont le s nom s suivent, savoi r :<br />
A bourse entière.<br />
Le sieu r Catteli n (Jean-Baptiste ) , en remplacement d u sieu r Léouye r , qu i n' a<br />
pas accept é l a bourse qu'i l avai t obtenue .<br />
A demi-bourse.<br />
Le sieu r Égass e (Antoine-Jean) , e n remplacement d u sieu r Cattelin , prom u à<br />
bourse entière .<br />
Le sieu r Arnou k (Jacques-Alexandr e ) , e n remplacemen t d u sieu r Delagarde ,<br />
qui n' a pa s accepté. (2l i mai. )<br />
TARN.<br />
Le choix qu e M . l e recteu r d e l'académie d e Toulouse a fait, su r la présentatio n<br />
de l a commission d e surveillance d e l'écol e normale primair e d'Allii, d e M . Person<br />
( Jacques) , pou r dirige r l e cours d e lectur e , grammair e , élément s d'histoire , e n<br />
remplacement d e M . Tabbé Bonafous , appelé à d'autre s fonction s , es t et demeur e<br />
approuvé. ' • (2! | avril. )<br />
YOiSNE.<br />
M. Payen, directeu r d e l'école normale primair e d'Auxerre , es t nommé économ e<br />
de l a mêm e école .<br />
— L e choi x qu e M . l'inspecteu r généra l charg é d e l'aiîministration d e l'académi e<br />
de Pari s a fait , su r l a propositio n d e l a commissio n d e surveillauc e d e l'écol e<br />
normale primair e d'Auxerre , de s personne s ci-aprè s désignée s pou r dirige r le s<br />
cours don t l e détail suit, es t e t demeur e approuv é , savoir :
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 5 3<br />
MM. riil)bé Millon, aumônie r d u collés e , — instructio n moral e e t religieus e ;<br />
Ji.uleine , régent a u collège , — histoir e e t géographi e ;<br />
Goœard, gymnastique .<br />
— V u la liste pa r ordr e d e mérit e dressé e à l'issu e d u concour s ouver t pou r l a<br />
nomination au x bourse s créée s à l'écol e normal e primair e d'Auxerr e , tan t su r le s<br />
fonds de l'État qu e sur ceu x d u département ,<br />
Avons arrêt é e t arrêton. s c e qui sui t :<br />
1. Le s sieur s Plai n (Joseph-Alexis ) e t Thibau t ( Louis-Émile ), son t nommé a<br />
bouisiers d e l'État à l'écol e normal e primair e d'Auxerre .<br />
2 Ce s jeune s gen s jouiron t de s avantage s attaché s au x bourse s qu i leu r son t<br />
accordées , à partir d e l'époque d e leu r entré e à l'école. (2 k avril. )<br />
5" INSTITUTION S DONNEE S PA R L E MINISTR E AU X INSTITUTEUR S , .<br />
PAR ARRÊTÉ S DE S 5 , 15 , 25 , 3 1 JDILLET , 3 0 AOUT , 3 0 SEPTEMBR E E T 3 0 OCTOBR E<br />
mn.<br />
NIÈVRE.<br />
Bercier , à Saint-Verain ; Renault, à Lurci-le-bourg ; Carroi s , à Gir y ; Mauret, à<br />
Neuvy ; Vegniat, à Lamarch e ; Ganneau , à Entrains ; Roy , à Ouda n ; Thiéblot , à<br />
Lorme , Boileau , à Lorme ; Demoncourrier , à NeufFontaines , Cacrea u , à Brass i ;<br />
Philippot, à Chalau x , Dessiau x à Corbign i ; Bargeot , à Sainl-Martin-Dupuit s ;<br />
Léger , à Marigni-l'Eglise ; Deboux, à Gascogn e ; Fugère , à Sais i ; Gaulon, à Ger -<br />
menai ; Robot, à Grenois; Marai s , à Tannai ; Viar d , à Amaz i ; Gilles-le-dou x , à<br />
Asnois ; Cola s , à Lys et Saint-Didier ; Coppin i , à Saint-Germain-des-boi s ; Bizot ,<br />
à Fletz-Cuz i ; Gourliau, à Surgi ; Fouchard, à Dorneci j Bonnet, à Chevroche j Gabué,<br />
à Oiz i ; Gerberon , à Ri x ; Brédiaut, à Ouaigue .<br />
NORD.<br />
Déledêque, à He m ; Isbled , à Ascq; Delporte , à Annappe; Lemoine , à Quesnoi ;<br />
Harbonnier , à Preuxaubois ; Carin , à Louvignie ; Hassault, à Jolimetz ; Taquet, à ,<br />
Englefontaine ; Delfosse , à Br y ; Liénard, à Ghissegnie ; Lerat, à Preuxausart ; Prévost,<br />
à YVarj:nie-le-Petit ; Stievenard, à Croix ; Delcourt , à Wargnie-le-Grand ;<br />
Busignies, à Maresches ; Waignier, à Landrecie ; Duroisel, àLandrecie; Bocquillon ,<br />
à Sepmerie ; Many, à Locquignol ; Lebrun , à Neuville; Claisse , à Forest ; Bouillon,<br />
àBruille; Dentrebec q , à Château-Labbay e ; Poutre , à Flines ; Richard , à Soles -<br />
mes ; Lanssiaux , à Seranvillers ; Masson , . i Artre s ; Laurette , à Aulno i ; Marissal, à<br />
Bellaing ; Brucq, à Estreu x ; Portier, à Famars ; Bataille , à Hauchin ; Marissiau x , à<br />
Hcrrin-et-Oisy ; Lejeune, à Marl i ; Potier, à Mondiaux; Bataille , à Prouvi ; Devaux,<br />
à Querenaiiig ; Clery, à Aniches ; Lamendin , à Cantin ; Perus, à Bugnicourt ; Bou -<br />
langer, à Féchai n ; Dubail , à Goeulzin ; Taisne, à Masn i ; Duquesne , à Nomai n ;<br />
Devred, à Uoucourt; Herbage , à Pecquencourt ; Cornez , à Fenain ; Pennequi n , à<br />
Somaia; Despret , à Aix ; Michel , à Arleu x ; Demarquett e , à Beuyry ; Severl n , à<br />
Landas; Pecqneur , à Lécluse; Devre d , à Monchecourt ; Demolin , à Aub y ; Rouzé ,<br />
à Ecaillon; Fremer y , à Feri n ; Bouché , à Fiers ; L'abbé, à Flines ; Delille, à Flines ;<br />
Ducatillon , à Fressi n ; Sauvage , à Marchienn e ; Carpentie r , à Raimbeaucour t ;<br />
Grattepanche, à Vilers-au-tertre ; Laloux , à Dech y ; Tavernier , à Saméo n ;<br />
Bouillon, .- i Levrarde ; Desfontaine , à Guespaai n ; Vali n , à Lallain g ; Pecqueu r , à<br />
Raches ; Moreau , à Vre d ; Jaillant, à Erchin ; Martinach e , à IJornaing ; Delhay , à<br />
Cuincy ; Durozoy, à Marc q ; Decloquement , à Roost-Warendin ; Variez, à Heles -<br />
mes ; Quievy, à St-Saulv e ; Gobert, à Gonnelie r ; Bouvard , à Armentière ; Lesage ,<br />
à St-Amand ; Bouillon , à St-Amand ; Savar y , à Oxelaër e ; Monta y , à Villerea u ;<br />
Martel,à Noordpeen e ; Véry, à Quievrechai n ; Pluchard, à Rombies; Wuillot, à Saul -<br />
tain ; tiautoit, à Verchain ; Larcanclié , à Havelin ; Ghienn e , à Hordai n ; Bli n , à<br />
Lieu-St-Amand; Brouta, à Neuville-sur-l'Escaul ; Soyez , à Wasnes-au-Bacq ; Galand ,<br />
à Wavrechain-soui-Faulx ; Tourneur, à Curgie; Basly , à Anzi n : Devém y , à Beu -<br />
vrage ; Tacquet , à Présea u ; Abria , à Valencicnue; Carliir , à Noyelle-sur-Selle ;
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 54<br />
Tison , à Marquett e ; Soyez, à Main g ; Dubuissie z , à Thiant ; Davain e , à Trith -<br />
Saint-Léger ; Bar, à Waller s ; Dumont, à ibscon ; Tliison , à Boucla i ; Carre z , à<br />
Auberchicourt ; Drumez , à Coutich e ; Delacroix , à Lauwin-Planqu e ; Vaillant, à<br />
Orcliies ; Leduc , à Saint-Waast ; Hennequin , à Beaumon t ; Gombert , à Fourn e ;<br />
Ducliatelet, à Hautay ; Desnoullet , à Herîie s ; Kepveu s , à Salom é ; Carpentier , à<br />
Wière; Delannoi , à Ennevelin; Bauvin , à Mont-en-Pevèle ; Lefevr e , à Ostricourt ;<br />
Ëgot, à Tourmignie ; Macquart, à Wahaignie ; Laurent , à Moncheaux ; Yerdré e , à<br />
Haubourdin ; Delannoî , à Fiyes ; Devienne , à Ennetière-eu-\Veppes .<br />
OISE.<br />
Lemoîne, à Sainte-Eusoi e ; Boulanger , à Dive s ; Maille , à Bet z ; Lefèvre , a<br />
Mortefontaine ; Buquemont , à Agno n ; Moliii , à Couloisi ; Lemaire , à Traci-le-<br />
Mont; Dubois , à Saint-André-Farivilliers ; Doucet, à Domfron t ; Delafontain e<br />
Herelius'et Ploui ; Cauët, à Moyennevill e ; Tanton , à Sarron ; Lefèvre, à Rantign i ;<br />
Ferret, à Remi ; Dumez , à Yaumois e ; Personne, à Crépi ; Deherme , à Crép i ; Fiez ,<br />
à Montreuil; Delarue , à Gouy-le s Groseiller s ; Marai s , à Frénoi-en-Tliel ; Obry , à<br />
Boran Moranci ; Gourlun , à Neuilli en ïhel ; Leclaire , à Mouclii-le-Cliatil ; Villain ,<br />
à Villers-SaintSépulcr e ; Debonnaire, à Gourchel.<br />
Et p^ou r dirige r une écol e primaire supérieur e : Chrétie n , à Compiègne .<br />
ORNÉ.<br />
Formage, à Ocoaigne s ; Savary, à Saiiit-Pierre-la-Rivîèr e ; Leroi , à Neaupli e ;<br />
Fauvel, à Tournay ; Bazin, à Avoines; Lecœur , à Rasne s ; Simon, à Exmes ; Prieur,<br />
à Almencclie s ; Mortagn e , à Montmere y ;'Tescliez , à Sainte-Honorin e ; Sore l , à<br />
Saint-Aubert ; Guillot , à Briouz e ; Guérin , à Sàint-Hilair e ; Libert, à Montreui l ;<br />
Ruelle, à Sainte-Colomb e ; Poirier , à Labarocli e ; Ernoult , à Cliampsecre t ;<br />
Alexandre, à Saint-Front ; Petit , à ïessé-la-Madelaiii e ; Hue , à Tcssé-la-Ma -<br />
delaine ; Salles , à Tessc-Froulay ; Lainé , à Coutcrnc ; Calbris , à Mouc y ; Duval, à<br />
Sainte Opportune ; Labuppe, à La-Cbapelle-Mocli e ; Reboux , à La-Cbapelle-Moclie ;<br />
Gomas, à Saint-Nicolas Desboi s ; Vannier, àMasle ; Bougon , à Écouché ; Segouin ,<br />
à Bouc c ; l'auvel, à Trun ; Louis , à Bazoches-au-Houhne ; Dibel, à Fon(aine-les -<br />
Bassets ; Lelicvre , à Cbanu; Sineux , à Saint-Fraimbault ; Toutain , à Bellon-en -<br />
Iloulme ; Guillemer, à Lafertémacé ; Blondel. , à Landigo u ; Aunay, à Durcet; Gau -<br />
quelin, à BeHo u ; Delaunay , à Banvo u ; Biu-el , à LaparneiU e ; Fouqiie, à Saires -<br />
la-Verrerie ; Lemonuier , à jSlanlill i ; Massero u , à Moutill i ; Guiboult, à Magni-le^ -<br />
bésert; Belleiigçr , à Bréel ; Purel , à Taillebois ; Mauduit , à Saint-Siméon-de -<br />
Vauce ; Lpry , à Torcliamp ; Mousalier , àjL'épinai-Lecomt e ; Guibout , à Nonant ;<br />
Delaunai, . à Uron ; Perraux, à Lemerleraul t ; Uesgraviers , à Chambo i ; Formage ,<br />
à Pont-Écrepi n ; Guillot , à Leméni l ; Guesnon , à Planche ; Peltier , à Lebailleu l ;<br />
Meneuf, à Brieux ; Desmoiits , à Montabard ; Jelienne, à Saint-Lambert ; Bourgoin ,<br />
à Verrièr e ;<br />
Et pou r dirige r un e écol e primaire supérieur e ; Ledien, à Argentan .<br />
PAS-DE-CALAIS.<br />
Gérard, à Fresnoi ; Hequet , à Anjbleleus e ; Delattre , à Bezinghem ; Plaisant , à<br />
Moncbiet 5 Freville , à Givenchi-en-Gohelle ; Choquet,^à Vaul x ; DelolFre, à S:uns-les -<br />
Marquions; Lesag e , àGraincourt; Beaussart , à ^Yambercpur t ; Vilain, à Lorgie s ;<br />
Dubois , à Fontaine-les-Boulun s ; Decobert, à Ilernicourt ; Cagniard , à Freviller s ;<br />
Carette, à Saint-Po l ; Tellier , à Matringhen ; Vaast , à Choques; Lemaire , à Lic -<br />
ques ; Malderet , à Ilermi e ; Ferton , à 'Wîipe ; Houchart , à Éusn e ; Lavisse , à<br />
Mencas ; Larue, à Boisjea n ; Jonnart, à Amette ; Dié, à Waben ;<br />
PUY-DE-DOME.<br />
Faure-Thomas, à Rio m ; Pourtier, àBromont ; Bacon , à Plauzat ; Guérin , à<br />
Saint-Dier ; Meilbodon, à Egliseneuve ; Serciron, à Saint-Gervai s ; Belin,à S'-Igna t ;<br />
Barbarin , à Champei x ; Coudert , à Fia t ; Fouillouze, à Brassac ; Prunet, à Pont -<br />
gibaud ; Rastoix, à Villosange s ; Labonne, à Chapdes-Beaufort ; Deyrat, à Marsat ;<br />
Grenet, à Saint-Myon ; Worget , à Chatelguyo n ; Bonnefon d , à Bussière e t Priens ;<br />
Fandeleur , à Beauregar d ; Gaultier , à Romagna t : Vidal, à Ceyra t ; Chabaud , à
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 5 5<br />
Chain-iat ; Madeuf , à Sain t Nectair e ; Bizary, à Jumeaux ; Ramade, à Tauves ; Malard,<br />
à Saint-Amand-Tallende ; Martin, à Clianonat ; Lemercier-de-Maisonccll e , à<br />
Malintras ; Tixier , à Menetra l ; Soulier, à Pionsa t ; Marmoiton , à Issac-Latourette ;<br />
Blazeix, à Aubia t ; Descliam p , à Gimenu x ; Duligner, à Ris ; Fustier , au x Pra -<br />
dqaux ; Roncliaud, à Vensat; Roncliaud , à Effiat ; julieu, à Moza c ; Roche, à Beau -<br />
mont ; Désévaux, à Montaigut ; Blancliet, à Cliarborinière ; Labrpsse, à Reauregard ;<br />
Borot, à Varenn e ; Labrosse , à Saint-Genès-du-Ret z ; Arnaud , à Nescher s ;<br />
Martin, à Sauxillange ; Mage , à Meilliau d ; Béai, à Olme t j Tricollet , àPuy-Guil -<br />
laume; Vacherias , à Chateldon .<br />
PYRÉNÉES (BASSES) .<br />
Labat, à Pau ; Duprat, a Sauvagno n ; Doumec , à Asti s ; Peré , à Thez e ; Petit, à<br />
Artigueloutan ; Francez , à Maviiilles ; Mestressat , à Lon s ; Miqueou, à Lescar ; Fré -<br />
cliède, à Lescar ; Cont e , à Bilhèr e ; Audap-Soubie , à Beyri e ; Pelosis , à Aubin ;<br />
Dabaclie, à Doum y ; Labourdette , à Loo s ; Barberon , à Ronlignon ; Raradat , à<br />
Argelos; Puche u , à Baririqu e ; Cassou-Gapdevielle , à Uzei n ; Juge-Boulogne , à<br />
Gelos ; Majourau, à Bourno s ; Souverhielle , à Idron ; Tapia, à Maucor ; Domecq, à<br />
Lezons ctMazères ; Raqué, à Rontignon ; Bergerot, à Narcastol ; Lagrabette, à Angos ;<br />
Saenz, à Ortlie z ; Noye, à Leudresse ; Passema , à Ossen x ; Fourcade , à Andrei n ;<br />
Lembeye-Hau, à Lago r ; Sarraude , à Montaslruc ; Sarraillet, à Viellenave ;<br />
Et pour-diriger un e écol e primair e supérieur e : l e sieur Guilhaumo u , à Pau .<br />
PYRÉNÉES (HAUTES) .<br />
Lapelle-Menjoulou, à Estirac ; Bayerque, à Gazav e ; Berié, à Louderyiell e ; Bon -<br />
neau, à Tramesaigue s ; Hourquet, a Salles .<br />
RHIN ( BA S ).<br />
Meizger, à Grendelbruc h ; Rengel , à Eiklioffe n ; SchcefFer , à Handschuheî m ;<br />
Clémentz, à Ballbronn ; Seyfi-ied , à Flexbourg ; Schceffer , à Engentha l ; Baur , à<br />
Ostwald; Dis , àOtters-sviller; "Weter , à Kirchlieim ; Rùick, à Soultz-sous-Foret ; Bau -<br />
siuger, à Rosfeld; Hertzog, à Weslhausen ; Bernard, à Wingen; Will , à Scliœnbourg ;<br />
Rell, à Lixliausen j Moss , à Sundliausea; Froestler , à Marraoutier ; Engel , à Reu -<br />
tenbourg ; Niess, à Puberg; Roycr , à Strasbour g ; Stiilz, ibid.; Stiilz , ibid. ; Gas -<br />
pard, lii'd . ; Meyer, i'ià/ . , • Illes, ibid. ; Schmidt , Lambs,/Jit?. ; Reussner ,<br />
ibid. j Heiligenstein , ibid.; >Yabuilz , zt/c/.Waegener , ibid.; Mossler , ibid.;<br />
Kastner, ij/t/ . Hecnemann , i'iirf . ; Fischer , ibid.; Kampmann , ibid.; Ennery ,<br />
ibid. ; Schwach, à Altor f ; Amann, à Deinsheîm ; Blum, à Dorlishei m ; Meyer, ibid. ;<br />
Herr, à Ergersheim ; Hetzel, à Gres-wille r ; Schuhler, à Heiligemberg ; Eisenmenger ,<br />
à Molsheim ; Meyev , à Mutzi g ; Eeit h , à Niderhaslach ; Heiurich , à Oberhaslac h ;<br />
lleyer, à Stil l ; Zimmermann, à Soultz-les-Rain s ; Tnestle r , à Achenheim ; Stahl ,<br />
à Bischliei m ; Iluppenheim, ibid. ; Brumder, à Bruschurckersheim ; Erb , à Eckbols -<br />
heim ; Sclinœbelé , à Eckbolshei m ; Eberhardt, à Hangenbiethen ; Grimm, à Hœn -<br />
heim; Ochsmann , à Hœnheim; SiefFert , à Kolbshei m ; SchœfFer, à Lampertheim ;<br />
>yurtz, à Lampertheim ; Hamm , à MIttelhausber g ; Hausser , à Mandolsheim ;<br />
Schiltz, à Niderhausberg ; Hild , à Oberliausberg ; Buheiker, à OberschoefFolsheim j<br />
Brann , à Schillighei m ; Lauche r , à Schiltighei m ; Dac h , à Souffelweyershei m ;<br />
Trappler, à Wolfisheir a ; Brif, iJid . Dock , Ittenliei m ; Eberhardt, à Blaeshei m ;<br />
SchiiFmacher, à Eschau ; Walter, à Grispoltzheim; Borschneck, à Holtzheim ; Kautz ,<br />
à Ichtratzhei m ; Palmer , à Illkirch ; Geng , à Lingolshei m ; Meyer , à Entzhei m ;<br />
Eck, à Plobsheim ; Berchu , à Schlestad t ; Hust , à Vendenhei m ; Schuste r , à Wiftersheim<br />
; Wengler , à Fort-Louis ; Schraut z à Ernosihei m ; Ernst à Hailen .<br />
RHIN (HAUT) .<br />
Worms, à Belfort ; Roiilhier, à Esseri; Girar d , à Bour g ; Schmidt, à Wiltenhei m ;<br />
Fix , à Niederraorsclnville r ; SVackermann , à Liitterbac h ; Wantz , à Mulhause n ;<br />
Yaiitz (George) , à Mulhausen ; 'Vaiit z ( Jean) ,Eschenlauer , à Sainte-Croix -<br />
aux-mines ; Grassman n , à Frélan d ; Siuio u , à Lapoutryy e ; Gerstweilen . à Lalle -<br />
maiid-Romljach ; Schallmann , i i S:nrite-Min'ie-;uiX'-t\Iiiies ; Gérard , à Labaroch e ;<br />
Kuniz , à Samle-Marie-aux-Mincs ; Wubnilz, à Ferlnix ; Muliiiie r , à Sainte-Marie -<br />
aux-Mines ; Sara , Ibid.; hoieui-i., Ibid ; Woûiéà, Ibid ; Ghappuis , à Anjoute s j
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 56<br />
Chapellié, à Eguenigue ; P y , à Aupui x ; Cïiarberet , à Petite-fontain e ; Licl y , à<br />
Rammersmatt ; Casser, à Oberbruck ; Willielm , à Ruelislieira ; Moser , à Kappele n<br />
Weil , à Winlzenheim ; Triollet, à Menoiicourt; Ressie n , à Hecke n ; Thiéband , à<br />
Belhonvilliers ; Gulling, à Guewcnalten ; Mandrux, à Doran s ; Clere, à Beauoourt ;<br />
Kimlz , à Kaysersberg ; Meyer, àWiltelsheim ; Ai-mbrusler, à Zimmei bach ; Eicliert ,<br />
à Dornacl i ; Sclimitt, à Brunslatt ; Killer, à Stetten ; Karra , à Dietwiller ; Gutilzer ,<br />
à Barfeimhei m ; Bauraann, à Ilelfrantzkiic h ; DoUerer , à Landse r ; Gugenbeiger, à<br />
Flaxlanden; Elizer , à Sierenlz; Gaeiig , à UîFheii n ; AUiiaus , à Batteulieim; Hug , à<br />
llabslieira ; Saltzmann, à lUsac h ; Burgart , à Beihgolt z ; Bader, àMunwiiier; Froe -<br />
lich , à MulhauFe n ; Morlot, à Belfort ; lehl, à Eguislieim ; Korum, à Wickerscliwir ;<br />
Solimilt, à Wenlzwille r ; Grandjean , àMontbouton; Girard , à Fescliet-Eglise } Ila -<br />
lelte, à lloppe ; Dubail, à Auxelles-bas .<br />
Et pou r dirige r une école primaire supérieure : Rominger , à Berglieim .<br />
RHONE.<br />
Joubert, à Saint-Leger ; Loffray ,à Ans e ; Peloux, à Morani e ; Berna y , à Ville -<br />
Bur-Jarnioux ; Grouiilet, à Pouilly-le-Monal ; Verjus, à Bagnol s ; Mollard, à Oingt ;<br />
Final, à Coigny ; Silvestre; à Liergues ; Vaissière , à Cliarna y ; Paillasson , à Pom -<br />
miers ; Braillon, à Saint-Cristoplie ; Dussert, à Letra ; Laumond, à Saiiit-Genis-La -<br />
val; Gaillol, à Sainte-foy-lès-Lyon .<br />
SAONE ( HAUTE ) .<br />
Segaux, à Arc; Guillaume , à Montot ; Pouîlley, àBrotte ; Dupain , à Ehuns ; Descliamps,<br />
à Santenot ; Bessori, à Ecqiievillei ; Terrier, à Cognière s ; Pautret, à Bour -<br />
guignon ; Etienney, à Betaiicour t ; Sleneslret, à Dencvre ; Lazard , à Villefxanco n ;<br />
Gaudiot, à Fouvent-Lavilie ; Lardez , à Senargent ; Brun, à Moimai etc . ; Grandjean,<br />
à Franchevell e ; Reignier, àLacorbière ; Theurei , à Danavalle i ; Didier , à Rulian s ;<br />
Borey, à Magnivrai ; Menigo s , à Rignovelle ; Lécareu x , à Gliampe i ; Lalloz , à Be -<br />
louchamp ; Bittet, à Lacreuse .<br />
SAONE ET LOIRE .<br />
Cernesson , à Gennelar d ; Maillet, à Péronne ; Ménétrier , à Saint-Cosme s ; Loge ,<br />
à Gei'g y ; Loge, à Verju s ; Curellon, à Royer ; Guillemiiiot , à Barna i ; Guyo n , à<br />
Bragni ; Bernard , à Charcei ; Poirier, à Geuouillé , Slenzel , à Morogir s ; Genevrier, à<br />
Saint-Germain ; Manvallier, . à Laviileiieuve ; Ma x , à Lerousse t ; Gress e , à Pcneci -<br />
les-forges ; Laurent, à Charolles ; Guilland , à Epina c ; Lucolt e , à Sull y ; Perrin , à<br />
Plolle ; Yerna y , à Cliangi ; Tliomasson , à Saint-Jean-des-vigne s ; Diicrot, à Lugiii ;<br />
J — l — J " 7 — , ..... . 11.I , u 1« 1 ^.IIHCO -<br />
sur<br />
-le-Douhs ; Giierillot , à Lays-sur-Doub s ; Bui.sselot , à Frouteaor d ; Bugnc t , à<br />
Ikaurepaire ; Gay, à Le-Fai ; Sorgues, à Varenne-Saiiit-Snuveu r ; Jaijiaud, à Miroi r ;<br />
Lenoble , à Cuiser i ; .lacquier , à Huill y ; Paul, a . Lagencl e ; Curdin , à Orm e ; Bar -<br />
SARTHE.<br />
zarc, _<br />
Wellerai ;<br />
Etienne, » . - j , —- .. • , ...l . ...i.. , « ..i . ^ «liwit,ÂHVC O , a .<br />
Saint-Ouen-en-Belin ; Poirier , à Cliangi; ; Goiidard , à Ruillé-sur l o Loi r ; Riclie r ,<br />
à Deaumonl-la-Charlr e ; Uroissi n a Saiut-Pierre-de-ClieviUé ; Gilbert , à Saint-Pierre -<br />
de-Lorouer ; Brcbion , à Courdemanch e ; Soulas , à Lamnac ; Broussillou , a Saint -<br />
Denis-des-Coudrai ; Legras ^ à Coulombier s ; Cabaret , à Konan s : Lemoiue, à
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 5 7<br />
Moitron ; Fourmy , à Sceaux ; Corbin , à Chei-rea u ; Maicliand, à Lafresna'ie ; Do -<br />
rison , à Oéliault ; Bigot , à Saint-Aif;nan ;;Cresfot , à Leliiar t ; Laliaye, à Rouessé -<br />
Fontiiine; Deiiiau , à LachapeUe-Diiboi s ; Cliantelou p , à Saint-Victo r ; Guy , à<br />
Morilioucloti ; Lebretoii , à Nogenl-le-Bernar d ; Pasteau, à Laflècb e ; Clottereaii, à<br />
Ferie ; Goubar d , à Sari e ; îjellièi-e-T-amotîi e , à Chantena i ; Tiratay , à Saiut -<br />
Pierre-Jes-Bois ; Dula c , à Leman s ; Bouviee , à Chcmîrc-eii-Cliarnie j Cbartier , à<br />
Saiiit-Sympliorien ; Cliaillon, à Beaufai ; Benoist , à Ruiile-eri-Cliampagne; Ilunault ,<br />
à Fa i e t Chaiiffou r ; iilcrland , à Allonnes ; Leproiist, à Saint-Rerais-de-Fill é ; Heurfebize,<br />
à Rouez; Aubi-y , a Ativers-sur-Moritfaucoii ; Drouet, à Cures ; Feré, à Ma -<br />
rigné ; Clievreau, à Lacbarir e ; Derouault, à Avenue ; Thibault, à Corm e ; Delicg e ,<br />
à Aiicin e ; Piton, à Slontmirail; Guy , à Sainl-George-du-Rozai ; Letard, à Saiut -<br />
Ulplmce_; Blossier , à Saint-Germain-de-la-Coudre ; Goultier, à Maraer s ; Moulin, à<br />
Lechevain ; Halet , à Cliampuissan t ; Goyet, à Oissea u ; Lindet, à Assé-le-Boîn e ;<br />
Neveu, àyiiaine-Lacarelle;Violette, à Doucelle ; Bigot, à Douillet ; Jamin , à Lucbé ;<br />
Proust, à Sairît-Jean-de-Lamotte; Guyo n , à Sabl é ; Prieul , à Sabl é ; Poidevin , à<br />
Saint-Jean-du-Bois ; Anger,àCrc ; Bourgueuf , à Dlssé-sous-Lelud e ; Bignon , à<br />
Epiiieu-le-Clievreuil ; Natier , à Cliampagu é ; Bellange r , à Laquiiite ; Bullanger ,<br />
à Aigné ; Surget, à Tassillé ; Grailler, à Yvré-Lévcque ; Bozoge, à Sainte-Sabine .<br />
Et pour dirige r un e écol e primair e supérieur e : Richard, à Beaumont .<br />
SEIINE.<br />
Hultemin, à Boulogne ; Legand , à Genlilli , Maiisart , à Montreui l ; Janvier, à Aii -<br />
toni ; Gucdé, à Bourg-la-Reine .<br />
SEINE-ET-MARNE.<br />
Changy , à Lava l - Saint-Germain ; Ricard, , à Jabline s ; Franqui n - de-Mon -<br />
lendre , à Aubepierr e ; Maillot , à Aubigny ; Lambert , àBlandy ; Cbauvea u , à<br />
Boissise-la-Bertraud ; Delaforge , à Bombo n ; Chevalier , à Brie-Com(e-Rober t ;<br />
Maslard, à Cel y ; Miller, « à Champeaux ; C.anet, à Chartrelle s ; Joncliery , à Châtre s ;<br />
Galle, à Closfontaine ; Deviercy , à Cooibslaville ; Quirion , à Courqurtaine ; Masson,<br />
à Courtorae r ; Gasc , à Dammarie-les-Ly s ; Bizet , à Evry-les-Chateau x ; Yilt , à<br />
Favières ; Besnard , à Fericy; ' Baudoin, à Ferolles-Antilly ; Blondea u , à Fleur y ;<br />
Delaforge , i Fous u ; Bouché , à Gret z ; Lefèvre , à Guignes ; Rouxel, à Lachapelle -<br />
Gaulhier ; Maillet , a u Chalele t ; Fayolles, à Lescévennes; Magot , à Lésigny ; Fouque,<br />
à Lieusain t ; Dumet, à Liverd y ; Perrot, à Machaul t ; Duvant, à Moissy-Cra -<br />
ninzel : Guittard, à Ozouer-la-Ferrièr e ; Pénard , à Ozouer-le-Youlges ; Chevallier ,<br />
à Perthe s ; Lelong , à Presle s ; Deletain , à Quiers ; Dubarle , à Reau ; Ilusson , à<br />
Roissy ; Jacquinot , à Saint-Germain-Laxi s ; Hanat, à Savigny-le-Teraple ; BicholT ,<br />
à Seiueport; Corbin , à Soler s , Séjourné, à Valence ; Dauge , à Vareddes ; Dagbert ,<br />
à Thieux ; Deviercy , à Argenlièrc s ; Goblet , à Chaume s ; Laurent, à Bréa u ; Gro -<br />
gnot, à Chaill i ; Vaumori n , à Criseno i ; Lacroix, à Lemc e ; Moussé , à Mainie ;<br />
Pouligni, à Mormant; Mauguin , à Ozouer-le-Repo s ; Petit , à Pontaul t ; Gibert, à<br />
Pontcarré; Jumeau x , à Saint-Martin ; Fillol, à Saint-Sauveur ; Roubault, à Saint -<br />
Ouen;Genf.y, à Tourna n ; Tan , à Vaux-le-Peni l ; Cherfds, à Vert-Saint-Denis ;<br />
Godet, à Villeniareuil ; Rourger y , à Fublaine s ;.Chaumet, àCoubert ; Goussier , à<br />
Grégy ; Canet, à Livr y ; Vacheron, à Verneuil ; Delauna y , à Saint-Fargeau ; Julien ,<br />
à Villeneuve-sur-Bello t ; Bénard, à Ormeau x ; Fournier, à Sainte-Colomb e ; Délé -<br />
taia, à Rampillo n ; Noël, à Noisi-sur-École'; Lucas , à Saint-Augusti n ; Bellier, à<br />
Nemours; Dubarle, à Vert-Saint-Denis ; Degrais , à Saint-Méri; Perrin , àFontaine -<br />
Fourché; Dall é , à Youlton ; Besnard, à Rubelle s ; Goussier, à Servon ; Pernot, à<br />
Chatillon-Laborde ; Bouché, à Courtri; Deshor s , à Guérard; Chappée , à Berna i ;<br />
Léofold , à Damniarti n ; Adrot , à Faremoutier s ; Beaunier, à Fontena i ; Monin , à<br />
Lachapelle-Iger ; Carillon , à Lahoussai e ; Vannier , à Lumign i ; Jardin , à Mor -<br />
teorf ; Boin , à Neul'-Moutier s ; Pelion , à Touquin ; Hérisson , à Rozo i ; Laurent ,<br />
à Tijeaux ; Hameau , à Vando i etPlanoi ; Gontier , à Vilbert ; Pelion , à Ville -<br />
neuve-Lecomte ; Antoine , à Bellot ; Nitol , à Boilron ; Lesueur , à ChaulFry ; Tor -<br />
ohet, à Doue ; Dupuis , à Hondevilliers ; Gallot , à Latretoire ; Berthemet , à Mon -<br />
(îauphiii ; Pinar d , à Orly ; Ropay , a Rebai s et SainS-Léger ; Adrien , à S.cblonuièr e ;<br />
Bonnet, à Saint-Cy r e t Saint-Oue n ; Dumenil , à Saint-Denis ; Berlhemet , à Ver -<br />
delet; Coœpoinville , à Auliioi ; Aureix , àBeautlieil ; Gontier , à Boissi-k-Chatd ;
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 58<br />
Bénard, à Cliailli ; Gibert , à Gnérard ; Picot , à Lacelle ; Lacour , à Maisoncell e ,<br />
Joncliéry , à Maupertluiis ; Lefèvre, à Mourrons , Goblet , à Saint s e t Laboissière ;<br />
Laliaye, a Cliartronge s ; Taitre , à Choisi ; Fard e j à Chevr u ; Bordier , à Laclia -<br />
pelle; Coradit i , à Laferté-Gaucher ; Gateau , à Lesclierolle s ; Pilliot , à Marolle ;<br />
Paillard, à Saint-Martiu-des-Champ s ; Lemaire , à Saint-Remi-de-la-Yann e ;<br />
Eouis, à Sainl-Siméon .<br />
SEINE-ET-OISE.<br />
Choisne , à Montfort ; Jaulin, à Auteuil ; Bourgeo n , à Boissi ; Blondeau, à Beynes;<br />
Davoust, à Belioust ; Prunier, à Flexanville ; Doulé , à Gasluis-Laqueue ; Techerot ,<br />
Ihid-, Fié , à Gros-rouvre; Charlie r , à Lesmenals; Guinet , à Marei l ; Belhomme , à<br />
Neauphle-Château ; Guillot, à Neauphle-Levieux ; Poilet , à Orgéru s ; Thibault, à<br />
Letremblay ; Lubi n , à Vic q : Guillard, à Thoiri; Maràine , à Septeui l ; Gerraond ,<br />
à Esmanc é ; Landiii, à Labbeville ; Cbapron, à Nervill e (Presle) ; Feilleux, à Adainville<br />
; Sarriau, à Bazaiuville ; Sebillc , à Gourgent ; Benard , à Dammarliu; Dayiron ,<br />
à Gambai s ; Potel, à Gressei ; Lainé , à Iloudan ; Coûtant, à Longues ; Boullan d , à<br />
Montchanvet; Leba s , a Orvilliers ; Robert , à Prunai-le-Templ e ; Perrie r , à Riche -<br />
bourg; Frichot , à Saint-Martin-des-Cliamps ; Plaisant, à Tiliy; Malié e ^ à Cliatou j<br />
Lefèvre, à Fourqueux ; Barault, à Saint-Germain-en-Laye ; iSlaisant , à Meudo n ;<br />
Delarclie, à Chaville; Tourbier , à Saint-Cloud,; D'hardivilliev , à Garclie s ; Foulon ,<br />
à VillenrAvray ; Demongeot, à Vaucresson; Friou, à Juvisi; Guilbert , à Champlan j<br />
Badin, à Versailles ; Devimeux , à Mareil-Marli ; Clievallier, à Lepccq ; François , à<br />
iîerne ; Petit , à Survillier s ; Cbapro n , à Andrésy ; Dutertr e , à Arnouvill e ; Le -<br />
comte , à Boinvilliers ; Calmeau , à Buclielai ; Girard , à Epone s ; Croiset, à Lafalaise<br />
; Pelletier, à Guervill e ; Bonniii, à Jumeauville ; Cocillet , à Mantes ; Cler -<br />
geon , à Rosn y ; Delabaye, à Soindr e ; Garl u , à Yert ; Denis , à Villette ; Parise ,<br />
à Rosa i ; Ferrie r , à Poissi ; Bosne, à Marcoussi s ; Perot, à Fontenai-les-Briis ; Tro -<br />
cliard, à Le s Bréviaire s ; Cbartie r , à Oriemont ; -Maillard , à Villepinte ; Margalié ,<br />
à Gometz-le-Châte l ; Lenormand , à Mare q ; Leroy , à Villiers-Saint-Frédéri c ; llpurdon<br />
, à Blar u ; Debella y , à Mézière s ; Gasquin, à Bois-Robert etc . ; Calmea u , à<br />
Gassicourt ; Foucho n , à Goussonvill e , Sablea u , à Mante s ; Cliouquet , à Frémé -<br />
court ; Fourgon , à Ableiges ; Jacquin, à Ecouen ; Charpentier , à Arronvill e ; Monvoisin,<br />
à Avernes ; Debella y , à Lebelle i ; Coliat , à Bervill e ; Boullet , à Char s ;<br />
François , à Sery ; Lecler c , à Commeni e t Mouss i ; Barbier, à Condecourt ; Coc u ,<br />
à Cormeille ; Delamothe , à Courcelles ; Mouliette, à Epiai s et Rliu s ; Morand, à Fre -<br />
mainville ; Doreraus , à Gouzengre z ; Barnabot, à Grisi ; Flicliy, à Guir i ; Prunier ,<br />
à Haravillie r ; Fuchet, à Longuess e ; Piscot, à Marin e ; Barbier, à Mongeroult ; Cbapron<br />
, à Neuill y ; Barthélemi, à Nucourt ; Devergi e , à Leperchai ; Ravoisy , à Sagi;<br />
Cliopart, à "Ws ; Bernier , à Valangoujard ; David , à Vign y ; Chouquet, à Fre -<br />
inecourt; Baranton , à Angervill e ; Ret, à Mérévill e ; Buffétrill e , à Pussai ; Bulï'e -<br />
tault, à Monnerville ; Lacheny , à Saclas ; Marcliandon , à Saint-Cy r Larivièr e ; Leriche<br />
, à Guitrancourt ; Tremblay , à Gironville ; Adde , à Asnirèe su r Ois e ; Savou -<br />
ret, à Bellefonlaine ; Adrien , à Pecqueuse .<br />
SEINE-INFÉRIEURE.<br />
Villard , à Tremanville ; Gantais, à Yvetot ; Petit, à Puisenval ; Levillain , à Anvilliers<br />
; Lejeune , .àMortemer ; Poign y , à Guerville ; Vierpont , à Ingouvill e ; Lefèvre<br />
, à Nointo t ; Lefèvre, à ManégUs e ; Baudet, à Bull y ; Crosnier , à Sigi ; Bérenger<br />
, à Tlii l Riberpr é ; Dumesnil , à Beaussault ; Leplicbe y , à Rouen ; Michelin ,<br />
Ibid ; Christoph e , à Mesnil-Pannevill e ; Barr é , à Val d e l a Haye ; Julien , à Bois -<br />
d'Ennebourg; Baria u , à Toqueville-Benarviil e ; Leroux , à Fontaine-Lamalle t ;<br />
Dumorit, à Octeville ; Catelain , à Saint-Gilles-Laaeuville ; Feré , à Serqueux ; Campion<br />
, à Valliquerville ; Lelaumier, à Fauville ; Delassise, à Foucard ; Bion, à Normanville;<br />
Benard , à Saint-Jean d u Cordolina i ; Neveu , à Bois-Guillaume ; Cha -<br />
vanieux, à Saint-Martin e n Campagne; Bouterr e , à Vavengeville ; Nicolas , à Imble -<br />
ville ; Yerniont, à Greraouville ; Yerct , à Veauvill e ; Lemonnie r , à Boishimon t ;<br />
Poullain , à Touffreville ; Caillot, à Caudebe c ; Ablin , à Doudeville ; Lambard , à<br />
Uarcanville ; Deniéport, à Reuville; Saunier , à Roquefort; Liberg e , a Hébervili e ;<br />
Deniéport, à Mauiieville ; Duboc , à Tiettrevill e ; Etic.ime, a Yproville-Bevill e ; Le -<br />
gros, à Bettevill e ; Uauchecoriie , à N,-D.-du-Bec ; Fouquet , à Maromm e ; Plan -
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 5 9<br />
clion, à Saint-Plerre-de-Franqueville ; Bazille , à Etretteville ; Lecroq; à Daubeuf -<br />
Serville.<br />
DEUX-SÈVRES.<br />
Croizin, àBéceleux ; Michel , à Biisseau; Laurent , à Saint-Makent-de-Beugué ;<br />
Gervais, à Beugaon ; Soulisse , à Cherveux ; Brisso n j à Coulon; David , à Saint -<br />
Florent ; Pointeau, à Magné ; Sicot ^ à Saint-Laurs ; Delapierr e , à Cour s ; Hardi ,<br />
à Arçais ; Bonnemain , à Auge ; Poncet, à Coulonge-sur-i'Antin ; Papot, à Roman s ;<br />
Bp-uteau, à Yallan s ; Venant , à Viliiers-en-Plain e ; Joyaux , à Azai-le-Brùl é ;<br />
Pironneau, à Cliizé ; Guyoclion , à Cliey ; Givard, à Saint-Martin-d'Eutringue s •<br />
Guimard, à Prailles ; Valïet , à Brioux ; Marché , à Vitré ; Chauvinea u , à Gou x ;<br />
Barbereau, à Bougon; Groussar d , à Saint-Martia-les-Melles ; Delavaie , à Bouille ;<br />
Delezai, à Loizé ; Coûtant , à Les Aubiers; Godello n , à Faie-sur-Ardi n ; David, à<br />
Lejai ; Marlineau , à Bouin ; Varlet , à Melle; Foisseau , à Saint-Léger; noumeau ,<br />
à Aiffre; Perrain , à Niort; Boucliet , à Niort ; Chabot , àBelleville ; Girard , à Sbu -<br />
vigné; Canard , à Saint-Maixent; Denizea u , à Sainte-Ouenne; Crochery , à Champ -<br />
deniers; Goichon , e à Ardin ; Gourin , à Saint-Gelai n ; Richard , à Sie q ; Bizo n ,<br />
àMarigny; Brottier , à Chanrai ; Chaigne , à Saivr e ; Baillet , à Xaintrai ; Gauvain ,<br />
à Niiei l ; Boinot, à Chàtillon ; Rabiou, à Taizé ; Avril, à Chich é ; Prieur, a Epaune ;<br />
Rias, à Vouill é ; Martinea u , à Saint-Ililaire-la-Palie ; Lambert, à Chai l ; INoquet ,<br />
à Juillé; Jutard , à Ardilleux; Dujarrie , à Han e ; Martineau , à Exoudu n ; Richer ,<br />
à Crezière s ; Collon , à Pezai-l e Chapt; Vinattier , à Montigué ; Brun , à Saint -<br />
Genard ; Bonnet , à Mougo n ; Portron , à Lamothe-Sainte-IIerai e ; Brangie r , à<br />
Beaussais.; Ferr u , à Saint-Coûtant ; Birault, à Sepvre t ; Provost , à Périgné ; Bou -<br />
quet, à Loubillé ; Viollet, à Gournai ; Bobeau, à Secondigné ; Sabourin , à Lus -<br />
sevais ; Trouvé, à Plibou x ; Prévost , à Fressines ; Chauvineau , à Saiute-Solin e ;<br />
Ainaidt, à Asnière ; Proust , à Clussais ; Pellevoisia , à Mellerand ; Ménard , à Lou -<br />
bjgné; Susset , à Fontenill e ; Noquet , à Ville-Follet ; Archimbault , à Chena y ;<br />
Simon, à Messe ; Caublot , à Lepin; Bellangé , à Bressuire ; Rou x , i l Saint-Amant ;<br />
Billy, à Chambronlit ; Auger , à Saint-Aubin .<br />
SOMME.<br />
Carlier, à Carnoi; Leneute, à Hebecourt; Roussel , à Villers-Carbonnel; Coyette ,<br />
à Oust-Marais ; Gorel , à Rosières ; Bondois , à Camps-en-Amiétioi s ; Dewailly , à<br />
Ilogi; Roselet, à Longueau; Hennequet , à Hescamps-Saint-Clai r ; François , à Bro -<br />
covirt; Donzeur , à Brutelle; Lejeune , à Dameri ; Daullé , à Franqueville ; Pruvot, '<br />
à Buigni-Labb é ; Cordie r , à Pprt-le-Gran d ; Monard , ^ à Gamach e ; Caro n , à<br />
Feuquière.<br />
TARN-ET-GARONNE.<br />
Taché, à Lamothe cap-de-ville ; Gardes, à Leojac; Delbreil , àLavaurette ; Calou -<br />
zenès, à Piquecos ; Catala , à Molière ; Mascarade , à Puylarroque ; Vidal , à<br />
Varren ; Savg , à Gazais ; Duthil, à Sauveterr e ; Larnaudie , à Lauzert e ; Régi s , à<br />
Fauroux; Pannassie r , à Saint-Amans; Dupu y , à Malausse ; Fornie r , à Saint-Pau l<br />
d'Espis; Rivet , à Bourg-de-visa ; Condé , à Saint-Clair ; Gauthier , à Labastide -<br />
Saint-Pierre ; Carbonnel , à Saint-Jen^de Boutz ; Rouquat , à Barthe ; Desprats , à<br />
Orgueif; Broustet, à Canals ; Dabasse , à Mongaillard ; Lagardère , à Cumon t ;
GO PARTI E OFFlCIELf.E .<br />
Monestcs, à Casiera-bouze t ; Moynié , à Méauzac ; Bleyuié , à fjîivit ; Saliuc , à<br />
LabasIide-du-Teinple ; Lombi a , à Castel-Fcnu s ; Dussanf , à'Gariès ; Ginesie , à<br />
Bressuls; Saiiliiou , àBrutiiquel ; Mazières , à Laiizerle. ; Simonol , à Verdun; La -<br />
niarque, à Larrazet ; Mayné , à Laccoi u t-Saiiit-Pierre ; Tiloles, à Aucamville; Moulet ,<br />
àNoliie; Saliiic , à Labaï-th e ; Avensac, à Gensac ; Jougla , à Cauze ; Sécresfa n , à<br />
Marignac; Gaillouste , à Moribastie r ; Lavilledieii, à Merles ; Raynal , à Monbarla ;<br />
Sauzet, à Saint-Bauzel; Lafilte. à Bourret ; Salobère , à Bardigue; Lncaa, à Lagué -<br />
pio; Bian , à Génébrière ; Bousquet , à Labourgade ; Jak , àBeaiipuy ; Murât , à<br />
Maumusson; Dussaut , à Sévignac ; Bousigne , à Bouillac ; Lugau , à Gastelsarrasi n ;<br />
Rouaix, àBeaumonf. ; Brunei , à Castelmagra n ; Latailliède , à Sainl-Kioola s d e l a<br />
Grève; Keary , à Escatalens; Bartherol e , à Fajolles; Busquet, à Belbèze ; Gauthier ,<br />
à Labourgace ; Daucli , à Faudoa s ; Jourda , à Yiguron ; Rouge , à Saint-Aigaa n ;<br />
Wuratel, à Caylus; Mayniel , à Lafrançais e ; Crocy, à Puycornet ; Larroque , à Va -<br />
zerac ; Cébe d'Hortei- , à Négreplisse; Ramondy , à Albias ; Prix , à Rioule ; Rigal , à<br />
Reyuies; Soulé , à Saint-Naufary; Cavalier, à Moutauba n ; Gardes, à Cayrac; Pellet ,<br />
à Monteil s ; Estrabol, à Lacapeile ; Emeric, à Loz e ; Verines, à Puylagarde ; Fraisse ,<br />
à Projet ; Badoc, à Moiitastruc; Clausel , à Monfermier; Monmouton, à Négreplisse ;<br />
Gardes, à Saint-Etienne ; Delrie u , à Brassa c ; Glialoupy , à Monjoy ; Bouchar d , à<br />
Lamagister ; Poramiès , à Auvillar s ; Larnaiuli e , à ïréjouls ; RauUet , à Mirabe l ;<br />
Aigoui, à Réalville ; Roussea u , à Réalville; Vidal , à Lhono r d e Ces ; Capi n , à<br />
Auty;Gaurel, à Monclar ; Bovar, àMontpezat ; Lope z , à Montalzat ; Bourdoucl e ,<br />
à Montricou x ; Anquetil , à Moutauban ; Miguel, à Saint-Sardo s ; Montferrant , à<br />
Maubec; Lafitte , à Bourre t ; Gastella, à Sairil-Porquie r ; Laborderie , à Monbequi ;<br />
Lagraiige, à Escauzeaux ; Gautier, à Mauza c ; Miraraont, à Gaumont; Quint , à Mas -<br />
Grenier; Bévi , à Bessens ; Boussuge , à Lamothe-Autuon t ; Brouslet, à Pompigaan ;<br />
Girard, à Gargaviller ; Gimat, à Mansouvill e ; Dou m , à Grisolle s ; Araouroux , à<br />
Lalilte; Bousug e , à Esparsac; Brun , à Barr i ; Germain , à Lavilledie u ; Bayiac , à<br />
Coulure ; Martel , à Montech ; Faucon, à Angeville ; Groscassan , à Roquecor ; Aute -<br />
serre, à Saiiit-Nazaire ; Lacombe , à l'ouffailles ; Boudet , à Gastelsagrat ; Diicro s ,<br />
à Lespalais ; Viallet , à Pommerie; Delo n , à Valence; Combesso n , à Golfech ; Da -<br />
genez, à Saint-Loup ; Faget , à Douza c ; Lafourcade , à Saint-Michel ; Keary , à<br />
Dunes; Carpuat , à Lepin ; Corcly, à Montesquieu ; JaflFard , à Saint-Vincent ; Ci -<br />
rech, à Montaigu ; Gra s , à Montagude t ; Cassou , à Miramon t ; Chertier, à Boudou ;<br />
Gruffeilles, à Valeilles .<br />
VAUCLUSE.<br />
Delor me, à Cadene t ; Pellet. à Cucuro n ; Bellouar d , à Gonl t ; Feraud, à La -<br />
coste ; Matthieu , à Menerbe s ; Fine , à Oppède ; Giraud , à Ansoni s ; Sauvan , à<br />
Beautnoiit; Darrie s , à Bonnieux ; Guichard , à Caseneuve ; Michelin , à Gramboi s ;<br />
Bernard , à Lourniarin ; Jarret, à Pertuis ; Clément , à Villar s ; Armand, à Cabrièr e<br />
d'Aiguës; Liautau d , à Labastide-des-Jourdans ; Boussoi , à Lauri s ; Aumand , à<br />
Peipin-d'Aiguës; Blan c , à Lioux ; Auphant, à Carom b ; Beaux , à Mérindol; Ber -<br />
nard , à Saint-Saturni n ; Lombard , à Vieji s ; Truplième , à Vaugine s ; O'reell y , à<br />
Lapalude; Chauvet , à Saiut-Romain; Milandre , à Visa n ; Bernard, à Faucon; Bre -<br />
mond , à Creste t ; Hugues , à Benume s ; Vach e , à Aubigna n ; Mérita n , à Saignon ;<br />
Geraud , à Saint-Marti n d e Castillo n ; Jean , à Saint-Didie r ; Sauvayre, à Entre -<br />
chaux ; Fabr e , à Moiiteux ; Blan c , à Velleron ; Reynar d , à Veiiague ; Gorlier, à<br />
Saint-Pierre d e Vassols; Carteron , à Sainte-Cécile; Liautaud , à Vacqueiras; Roux ,<br />
à Saint-Roma n ; Cesan , à Gigonde s ; Darnau d , à Savoilla)i s ; Coste-Raimon d , à<br />
Camatel ; Boulet, à Chateauneu f ; Giely, à Ségure t ; Bormet, à Barroux; Favie r , à<br />
Mondragon ; Charass e , à Violes ; Chappo n , à Brautes ; Rivet, à Malaucène .<br />
Et pou r dirige r un e écol e primaire supérieure : Chauvet, à Avignon .<br />
VEISDÉE.<br />
Pouzin, à Latardière ; Falaiseau , à S'-Mesmin-le-Vieux ; Pouponnot, à Lorbrie ;<br />
Naulleau , à Antign i ; Jaudea u , à Bazoges-en-Pareds ; Roy , à ChefFoi s ; Robin , à<br />
Mouilleron-eu-Pareds ; Bouhier , à Saiut-Maurice-des-None s ; Blanchet , à Saint -<br />
Maurice-le-Girard ; Girau d , à Saint-Pierre-du-Chemin ; Benar d , à Saint-Sulpice -<br />
en-Purid-i; David , à Touarsais-Bouldroux ; Clisson , à Fontaine s ; Guinot , à Le -<br />
laiigeu ; Guilbot , à Montreui l ; Roquet, à Vellaire ; Soullard , à Bourneau ; Soul -
PARTIE <strong>OFFICIELLE</strong> . 6 1<br />
lard, à Marsais-Sainte-Uadegontl e ; Appraillé , à Mouzcui l ; Bodin , à Nalliers ;<br />
Giiuvin , à Petasse; Bodiii , à Pouillé ; Soullar d , à Sain t Cy r de s Gats ; Bodia, à<br />
Valerien ; Macoui n , à Sérignc ; Roussière, à Benet ; Boiirnea u , à Daraoi x ; Me -<br />
nard , à Doi x ; Filloiinea u , à Lie z ; Ristord, à Maill é ; Clieiiier , à Maillezais ; Gd -<br />
saiid , à Sainte-Christin e ; Rétail, à Saint-Pierre l e Vieux ; Rerio u , à Vi x ; Pai n ,<br />
à Lebonpèr e ; Aug é , à Lafiocaticre ; Laury, à Lameillerai e ; Yerdon , à M'onsirei -<br />
gne ; Merceroa, à Wontournais ; Brocliard, à Pouzanges ; Chaise , à Réaumur; Bret ,<br />
à Saiut-Michel-Mont-Mercure ; Archambau d , à Saint-Hilaire de s Loge s ; Trotin , à<br />
Toussais ; Guillemet, à Mervent ; Chartron , à Nieuildenan t ; Ghartrô n , à Ouïmes ;<br />
Reverdy, à Saint-Marti n d e l'raigneau x ; Âudebrand , à Saint-MIcliel-le-Clouc q ;<br />
Pineau, à Youvau t ; Micliaud , à Saint-Hilaire de Voust ; Girar d , à Saint-Médard ;<br />
Artaret, à Longevè s ; Laisné , à Jare ; Tessier, à Glouzeau x ; Grégoire, à Laguyon -<br />
nicre ; Esgoanière , à Évrunes ; Lherbet, à Llierbergemon t ; Guillar d , à Sainl-Ful -<br />
gent; Brevet , à Resm y ; Baudry , à Saint-André-Gould'oi e ; Driaud , à Angles ;<br />
Driaud , à Lajonchère; Richard , à Latranche; Barretea u , à Notre-Dame des Monts ;<br />
lîabreu , à Boi s d e Cen é ; Bailleau , à Saint-Pau l d e Mont ; Prta u , à Apremoht ;<br />
Mignoneau , à Saint-Benoi t ; Drié, à Barbatre ; Brau d , à Soullans ; |Cointar d , à<br />
Bouille-Courdant ; Touclio n , à Lcge-Fougereus e ; Chalo n , à Tallud-Sainte-Gem -<br />
me; Marti n , à Menomblet ; Jamboineau , à Longevill e ; Herminier, à Perrier; Mo -<br />
reau, à Avrill é ; Maunereau , à Lebernard ; Pinatel , à Saint-Gilles ; Taupie r , à<br />
Talmont.<br />
VIENNE CHAUTE) .<br />
Failly, à Maisonnaî s ; Cliabaudie , à Cliampagna c ; Balland , à Flavîgna c ; Du -<br />
mond, à Saint-Germain-les-Belle s ; Mouseiiergu e , à Isl e ; Deyignes , à Venieui l ;<br />
Hyeime, à ChaLus .<br />
PARTIE NO N <strong>OFFICIELLE</strong> .<br />
METHODES,<br />
rROClÎDÉS PÉDAGOGIQUES , EXERCICE S PRATIQUES , ETC .<br />
DE L A POLITESS E E N GÉNÉRA<br />
L<br />
ET PRINCIPALEMEN T DAN S LE S ENFANTS .<br />
La politess e es t le complément nécessair e d'une bonn e e'ducation, e t l'insti -<br />
tuteur n e saurai t y attaclie r une tro p grand e importance . L'enfan t pe'ne'tr é d e<br />
ses devoir s , e t qu i compren d c e qu'i l doi t d e reconnaissanc e à se s parents e t<br />
à se s maîtres , leu r témoign e naturellement , e t san s efforts , combie n i l es t<br />
touclié d e leur s soin s • il es t pol i à leu r e'gai'd . Quan d i l aur a reconn u le s<br />
avantages de l a politesse, i l ser a poli ave c tou t l e monde .<br />
On peu t avec Locke définir la politesse, un e grâce , un e bienseance qu i ac -<br />
compagne le s regards , l a voix , le s parole s , le s geste s e t tou t l e maintie n<br />
d'une personne 5 qui nou s ren d agre'abl e aux autres , e t qu i fait que ceux ave c<br />
qui nou s somme s e n relation son t content s de nou s fet d'eux mêmes . C'es t u n<br />
langage par lequel on exprim e les sentiments d'honnêtete ' qu'on a dans le cœur.<br />
Si l a civilit é on politesse es t une des vertus le s plus aimaljles que l'on puiss e
62 MÉTHODES ,<br />
rencontrer dan s là socie'l é j l'incmlite' ou grossièret é es t un de s vices qu i attirent<br />
le plus la haine de s autres hommes.<br />
L'incivilité' di t Labruyère , n'es t pas u n vice, ell e es t l'effet d e plusieur s<br />
vices , d e la sott e vanité , d e l'ignorance d e se s devoir s , d e la paresse, d e la<br />
stupidité, d e la distraction, d u mépri s de s autres , de la jalousie. Pou r n e se<br />
répandre que su r les dehors, ell e n'en es t qu e plus haïssable , parc e qu e c'es t<br />
toujours un défaut visible e t manifeste : il es t vrai cependant qu'il offens e plus<br />
ou moins ^ selon la caus e qui le produit .<br />
C'est en examinant les cause s et les effet s de l'incivilité,que nou s arriveron s<br />
àbien comprendr e la politesse et à l'examiner dans les diverses applications aux<br />
positions de la vie.<br />
On peut faire dérive r l'incivilité de quatr e sources principales :<br />
1 ° D'une rM5«ïC!i e naturell e qu i nou s empêch e d e montre r de l a com .<br />
plaisance pou r le s autres , e t d'avoi r d e juste s égard s pou r leu r état ,<br />
leur positio n social e e t cette brutalité rustique dépl'ai t à tout le monde. Ains i<br />
quiconque désir e montrer qu'i l a reçu le s premier s principe s de l'éducatio n ,<br />
doit cherche r à dépouiller celt e rusticit é qu i es t l a marqu e l a plu s certain e<br />
d'un manque total d e bons sentiments .<br />
D'un mépris pou r les autres , qu i provien t d'u n fonds d'amour-propr e<br />
excessif; e t qu'on n e croie pa s que ce mépris des autre s es t l e partage exclusi f<br />
des enfant s riche s don t les parents on t de s titres , de s dignités e t un e grand e<br />
fortune. C e défau t se trouv e quelquefoi s dan s le s enfant s d'un e bass e con -<br />
dition.<br />
5° D'u n esprit de critique trè s contrair e à l a politesse. Personn e n'aim e<br />
voir ses défauts exposé s a u gran d jou r e n présenc e d e tous. U n reproch e es t<br />
toujours accompagn é d e quelque honte, e t l a révélation publique d'u n défau t<br />
fait toujour s d e la pein e à la personne qu i e n es t l'objet .<br />
La raillerie, lorsqu'ell e es t accompagné e d'u n tou r gracieux e t d'une ex -<br />
pression délicate, es t plus supportable . Mais , comm e cette espèc e d'incivilit é<br />
amuse ceu x qu i n'e n son t pas l'objet , le s railleur s s'imaginen t faussemen t<br />
qu'elle n' a rien d'incivil, pourv u qu'ell e soi t renfermé e dan s d e justes bor -<br />
nes ; cependan t ils devraien t réfléchir qu e s'il s réjouissen t un e assemblé e e n<br />
excitant le s éclats d e rire, c'es t au x dépens d'une personn e qu'ils tournen t e n<br />
ridicule, et qu i ])a r conséquent doit en souffrir . Nous verrons plus bas qu'il es t<br />
une sorte de raillerie permise , c'es t cell e qu i es t u n vrai suje t d e louang e<br />
alors le s idée s agréable s qu i constituen t l a raillerie étan t flatteuses e t diver -<br />
tissantes tou t à la fois, l a personne raillé e y trouv e so n compte e t prend par t<br />
au divertissemen t commun . Mais , comm e i l es t trè s difficil e d e s e conteni r<br />
dans de s bornes exactes, e t que l e moindr e écart peut vous suscite r de s ennemis<br />
irréconciliables e t d'autan t plus dangereu x qu'ils affecteraient de ne pas se<br />
fâcher , nou s conseillons d'évite r avec u n gran d soi n la raillerie , mêm e lorsqu'on<br />
se sentirai t un e habileté remarquabl e à la manie r avec esprit .<br />
4° D'u n esprit de contradiction e t d'un e susceptibilité outrée, défaut s<br />
qui tiennent à un amour-propre exalté , e t nous font dan s l e mond e beaucou p<br />
d'ennemis. L a complaisanc e n e doi t pas alle r jusqu'à approuve r indistincte -<br />
ment et sans cesse les raisonnements faux ou les absurdités que nous entendons. La<br />
politesse ne s'oppose pa s à c e qu'on réfute les opinions fausses et à ce qu'on redresse<br />
les méprise s des autres: mai s il faut le fair e avec toutes les précaution s<br />
qu'exigent le s circonstance s ; san s cel a vou s offense z pa r votre to n tranchan t
EXERCICES , ETC. 6 3<br />
ou par la facilité avec laquelle votre amour-propre s e choque du moindre mot<br />
indirect e t quelquefoi s involontair e qui e'cliappe à un am i o u à u n e'tranger.<br />
On voit dan s l e monde des gen s posse'de' s du mauvais espri t d e la contra -<br />
diction e t qu i blâment tout c e qu'il s voient, tou t c e qu'il s entendent . Cett e<br />
manière d'êtr e est si injurieuse qu'ell e cLoque tout le monde.<br />
Montaigne a dit dan s ses essais « Le silence et la modestie son t de s qualités<br />
très commodes à la conversation. O n dressera un enfant à être épargnant et<br />
ménageant de sa suffisance, quan d il l'aur a acquise , e t à ne point se forma -<br />
liser des sottises et de s fables qui se diraien t en sa pre'sencej ca r c'es t une incivile<br />
importunité d e choquer tout ce qui n'est pa s d e notre goût. Qu'il s e contente<br />
de se corriger soi-même e t ne semble pas reprocher à autrui tout c e qu'il<br />
refuse à faire , ni|contrarie r aux mœurs publiques. Lice t sapere sine pompa ,<br />
sine invidiâ ( Il faut avoir raison san s ostentation et sans jalousie ).<br />
La susceptibilité offens e ceu x ave c qu i nou s nou s trouvons , parcequ'ell e<br />
paraît leur reproche r indirectement d e manquer au x égard s qu i nou s son t<br />
dus, D'ailleur s i l suffi t d'unejpersonne susceptibl e pou r jete r du froid dan s<br />
une société nombreuse et détruire l'accord et la bonne harmonie qu i régnait.<br />
Cette courte explicatio n de l'incivilité et des causes.'jui le produisent , nou s<br />
mène naturellement à mieux comprendre c e que c'es t réellemen t qu e la po -<br />
, litesse.<br />
Pour l'étudier ave c soi n e t l'approfondir , nou s allon s examine r les différentes<br />
formes sous lesquelles ell e s e manifeste a u dehors .<br />
Quoique l a politess e soi t e n réalité un e bienveillance intérieur e pou r no s<br />
semlslables, ell e s e fait voir par des forme s extérieures ; le s yeux , la bouche,<br />
l'attitude du corps révèlen t no s sentiments , e t c'est sur cette observatio n qu e<br />
nous allons établi r les règles générales de la politesse .<br />
De l a tête .<br />
La têt e de l'homme regard e le ciel et présente une face august e sur laquell é<br />
est imprim é l e caractèr e de sa dignité : l'image d e l'âm e y es t peinte : ellé<br />
brille dans sa physionomie. L'excellenc e d e s a nature perc e à travers se s organes<br />
matériels et anime d'un feu divin le s trait s de so n visage .<br />
La bienséanc e e t l a conscienc e d e s a dignité exig e don c qu e l'homm e<br />
tienne la têle droit e e t élevée, dan s un état de repos tranquille, san s lui impri -<br />
mer des mouvements désordonnés .<br />
Les enfant s doivent s e tenir le plu s tranquillement qu'il s le peuvent. Quoique<br />
leur âg e dispose à leur égard à l'indulgence, cependan t ils ne doivent pas<br />
agiter la tête san s motifs, c e qui annoncerai t o u d e l'ennu i o u un e légèret é<br />
excessive. Ils doiven t éviter avec l e plus gran d soi n de se gratter la têt e o u de<br />
passer la mai n dans leur s cheveux, c e qui serai t impardonnable dan s une société<br />
et surtout à table.<br />
Le visage est le miroir d e l'âme, l'interprèt e de la pudeur ou la preuve vivante<br />
delà corruptio n des sentiments . • il ës t don c nécessaire que la premièr e<br />
vue dispose favorablemen t e n notre faveur .<br />
Notre visag e indiquer a l a modestie qu'il fau t bien se garde r d e confondre<br />
a^ec la fausse honte. L a modesti e craint d'offenser la raiso n ; l a fauss e hont e<br />
craint de déplaire au x hommes . L'un e évite tout c e qui es t criminel , l'autr e<br />
tout c e qui n'est pa s à la mode.<br />
Par conséquen t l e visage n'aura rie n de sévère ni d'affecté , rie n de iEarou-
64 MÉTHODES ,<br />
clie, rie n de lége r n i d'c'tourd i : tout y doit respirer un e gravite' douce, un e<br />
sagesse aimable .<br />
La gaîte' , l a se'renite ' du visag e ne doiven t pa s de'ge'ne're r e n licence ni e n<br />
le'gèrete' excessive : car alors ce serait montrer peu d'estime pour les personnes<br />
avec lesquelles on se trouve. ,<br />
Ces règles ne sont pa s tellement générales qu'elle s ne puissent être modifiées<br />
selon les circonstances. Ainsi, par exemple, ctacun comprend que l'expression<br />
du visage ne doi t pas êtr e la mêm e dans un salon o ù s e trouvent de s liommes<br />
graves, et dans la compagnie d e camarades de colle'ge; dans une famille accablée<br />
de tristesse, o u dans une noc e animée pa r les éclat s de gaîté , o u par des<br />
danses joyeuses.<br />
L'homme sag e doit soutenir avec le mêm e courage la bonne et la mauvaise<br />
fortune , quoiqu' à vra i dire, l'enivremen t de l a prospérité soit plus difficile à<br />
supporter pou r l'homme énergiqu e que les coup s de l'adversité . I l fau t don c<br />
que so n visage n'indique n i l'abattement , n i la joie immodérée .<br />
L'enfant peut avoi r l e visage gai , mai s il éviter a ave c l e plus gran d soin<br />
ces excès subit s d e gaîté, ce s éclat s d e rire inextinguible s qu i annoncen t l e<br />
peu d e surveillance qij g ses parents ont exercé su r ses première s impressions .<br />
L'enfant aur a soin chaque matin d e s e laver le visage avec d e l'ea u froide<br />
et de se l'essuyer ave c un linge blanc. La propreté en fait un devoir rigoureux.<br />
Les jeunes filles-même éviteront d e mettr e dan s l'eau froid e qu'elle s em -<br />
jloient d e l'eau d e Cologne , d u vinaigr e e t des préparation s cosmétique s :<br />
'expe'rience a démontré qu e le meilleu r cosmétique étai t l'ea u froide e n été ,<br />
et l'ea u légèrement dégourdie dan s les grands froids d e l'hiver.<br />
Le front est le siège de la douceur, d e la fierté de l'homme : il ne faut donc<br />
pas le froncer inutilement e t y produire de s ride s transversale s qui sont un e<br />
preuve d e la vivacité de s passions e t d e l'emportement habituel .<br />
On doi t évite r ave c grand soin d e froncer les sourcils, c e qu i es t u n signe<br />
apparent d e fierté ou de mépri s : certaines personne s rapprochent le s sourcils,<br />
ce qui donne à leur visage un air de mauvaise humeur et d e violence offensante<br />
pour les autres.<br />
Les enfant s contracten t d e mauvaises habitudes : ils froncen t les sourcils,<br />
ils enflen t leur s joues, il s le s frappent : tous ce s signes extérieur s son t de s<br />
manques de politess e qu'il faut réprimer.<br />
Les yeux sont l'organe le plus important du visage : c'est à la vue que nous<br />
sommes redevable s des sensations les plus agréables que nous fassent éprouver<br />
les merveilleuse s prod uctions d e la nature. Il y a d e quoi s'étonne r lorsqu'on<br />
pense à la diversit é des objet s qu e l'œi l est capable d e saisi r en même temps<br />
et à l'exactitude ave c laquelle il juge e n un instan t de leur situation, d e leu r<br />
figure et de leur couleur. Il veille contre les dangers qui nou s environnent, i l<br />
garde nos pas, i l admet tous les objet s visibles dont la variété et la beauté servent<br />
à nous réjouir.<br />
Sous le rapport moral, le s yen » doivent exprimer des sentiment s dou x e t<br />
affectueux. Certaines gens ouvrent leurs yeux démesurément, ce qui leur donne<br />
un ai r d'effronterie, de hardiesse et d'insolence j d'autres clignent les yeux par<br />
suite de mauvaise s habitudes , c e qui donne un e apparence d e négligence affectée<br />
ou de mépris pou r ceux qui on t des relation s ave c nou s ; d'autre s laissent<br />
errer leurs yeux à l'aventure, n e les fixant su r rien, c e qu i annonce a u<br />
moins une grande mobilité et un e crand e étourderie .
EXERCICES , ETC. 6 5<br />
On recommandera aux enfans, no n seulement de donner à leurs regards une<br />
expression de douceu r e t d e bienveillance , mai s un e expression d'assurance<br />
modeste. Le s enfants ne gardent aucune mesur e : ou ils son t effrcnte's, o u il s<br />
sont d'une timidité ' désespérante ; c'es t i k leur faire garder l e milieu entr e ce s<br />
deux extrême s que doivent tendre les efforts de l'instituteur.<br />
On doit empêche r le s enfant s de se livre r à des amusement s dangereu x e t<br />
grossiers tel s que ceu x d e clignoter, d e relever les paupières, d e loucher, o u<br />
de fixer des objets sans but en ouvran t les yeu x avec effort. Tou s ces jeux qu i<br />
ont pourbut d'excite r l e rire des camarades ^ son t très re'pre'hensihles . •<br />
Les enfant s son t sujet s à des gourme s e t à de la vermine; il fau t donc leur<br />
faire contracter d è bonn e heur e la coutum e de s e peigner régulièrement tou s<br />
les jours. Ce s soins de propreté' sont très utiles à leur santé'.<br />
Nous recommandon s au x jeunes gens d e ne pas affecter un e mod e ridicul e<br />
pour leurs cheveux; cett e recherche annonce des mœurs effe'mine'es . Des cheveux<br />
bien peigne's chaque jour, surtout dan s l'enfanc e , n'exigen t pa s l'emplo i<br />
de pommade ni d'essenc e pour être lisses, propre s etluisans .<br />
Les oreilles son t u n des organe s les plu s pre'cieux . L e condui t auditi f est<br />
tortueux afin qu e rien n' y puiss e pëne'trer ; acciden t qu i arriverait , s'i l e'tai t<br />
droit et sans de'lours. L'entre' e o u conque fuj me des sinuosite's qu i augmenten t<br />
le volum e de ces sons exte'rieurs . Plato n appelai t l a vu e et l'ouï e le s sen s d e<br />
l'âme. L'ouï e est , aprè s la vue, celu i qu i nou s donn e le plu s d'idc'e s , e t qui<br />
favorise le plus nos rapports avec nos semblables.<br />
Les enfant s ne doivent jamais se nettoyer les oreilles en compagnie, n i même<br />
y enfoncer les doigt s , lorsqu'il s e'prouven t un e de'mangeaiso n ; c e serait u n<br />
acte re'préhensible d e malpropreté'.<br />
Le fon d de l'oreill e es t rempl i d'un e humeur e'paiss e de l a couleu r e t d e<br />
la consistance d e cire , appele e cérumen : ell e sert à donne r d e la souplesse à<br />
cet organe. Lorsqu e l e ce'rumen es t tro p abondant o n peu t l'extrair e ave c u o<br />
cure-oreille en y prenant quelque pre'cautio n ; mai s il faut se garder d'y intro -<br />
duire de s têtes d'e'pingl e o u d'autres corp s durs : i l peu t e u re'sulter de s inflammations<br />
et de s e'corchure s trè s dangereuse s e t qu i fon t souffri r horriblement.<br />
11 faut nettoye r chaqu e jou r l'envelopp e extern e d e l'oreille ; mai s i l n e<br />
faut pas s'habituer à user trop fre'quemment du cure-oreille. L'extractio n tro p<br />
souvent re'pe'te'e du ce'rumen amène un endurcissement d e l'appareil intern e d u<br />
sens auditif : nous e n avons v u des exemples effrayants.<br />
On recommander a encor e au x enfant s de n e jamai s parle r à l'oreill e d e<br />
quelqu'un e n pre'senc e de plusieur s personne s : c'est un e impolitess e ; ca r il<br />
semble que l'on veuille user d e mystère . C'es t une mauvais e coutum e chez les<br />
enfants que de crie r très fort à l'oreille d'un camarade qu i ne s'y atten d pas. Il<br />
est d'autant plus ne'cessaire d'interdire ce pre'tendu amusement, qu'il en re'sulte<br />
un ébranlement du ner f auditi f qui peut avoir des suite s malheureuses.<br />
Le nez est l'organe de l'odora t destin é à fair e éprouve r à l'homm e le s impressions<br />
qu i résultent des particules extrêmement ténue s échappée s des corp s<br />
volatilisables. L e soin de cet organe est très important et les enfants le déforment<br />
souvent et l e rendent hideu x pa r l'introduction d e leurs doigts.<br />
On recommandera donc aux enfant s de ne jamais introduire les doigt s dan s<br />
les narines, c e qu i es t malpropr e e n soi-même , e t dégoûtan t pou r ceux qu i<br />
en sont témoins .<br />
VI. 5
m . MÉTHODES ,<br />
Les enfants de la campaj^ne, qui ont continuellement les doigts pleins de terre<br />
et d'ordure s , doiyen t s'absteni r aye c l e plu s gran d soi n de porte r le s doigts<br />
à leu r nez .<br />
Il es t essentiel d'iiabituer le s enfant s à se moucher dè s qu'il s e n ont besoi n<br />
et à ne pas attendr e qu e l a ne'ccssite ' en soit visibl e à tous le s yeux , c e qu i est<br />
horriblement sale . Le mouchoir doi t être renouyele' souvent par les parents, e t<br />
les instituteurs exigeront qu e les élève s aient toujours leurs mouchoirs, e t suffisamment<br />
propres. Quelques enfants déploient leur mouchoir en entier, ce qui est<br />
contraire à la politesse . Gomm e l'action d e se mouche r a quelque chos e d e répugnant<br />
pour les aiitres , il fau t le fair e discrètemen t e t d e manière à êtr e remarqué<br />
le moin s possible. Ains i o n se gardera bien de s e moucher ave c brui t<br />
et d'une manière retentissant e : rie n n'est plus!^impoli ; o n n e tiendra pa s san s<br />
cesse son mouchoir à la main -, on n e l e poser a pas surtout su r une table , sur<br />
une chaise , sur un meubl e j o n le mettra imme'diatement . dan s s a poche après<br />
s'en être servi.<br />
L'habitude d e salue r l a personn e qu i éternu e e t d e l'accompagner d'u n<br />
Dieu Vous bénisse, est tombée en désuétude . Cependant , s i l'o n vi t dan s u n<br />
pays où il es t généralement d'usag e de saluer, o n fera une très légèr e inclina -<br />
tion d e tête , plutô t comm e marqu e de déférence , qu e pou r s e soumettr e à<br />
unehabitude peufondée.<br />
• L'usage du tabac es t sale et malpropre, et nous engageons bien les instituteur s<br />
à recommander au x élèves de s'en'abstenir, àmoins qu e certains d'entre euxn' y<br />
soient obligé s par prescription d u médecin.<br />
La bouche et le s dents exigent d e grands soin s d e propret é , e t nous appe -<br />
lons l'attentio n de s instituteurs e t des familles sur ce point important.<br />
Chaque matin on doi t se rincer la bouche à plusieurs reprise s avec d e l'eau<br />
fraîche, e t passe r un e bross e o u un e petit e éponge su r se s dent s : c'es t l e<br />
moyen d e le s entreteni r blanche s e t propres , e t d e n e pa s laisse r amasse r c c<br />
tartre jaune qui en ternit la blancheur naturelle..<br />
Surtout n e passe z jamai s entr e vo s dent s n i épingle s , n i couteaux , n i<br />
ciseaux : c'est l e moye n infaillible d e les gâter . A plus forte raiso n interdisez<br />
aux enfant s l'habitud e d e coupe r du fil ave c le s dents , o u d'arrache r de s<br />
clous.<br />
Faire de s grimacestire r l a langue , l a passe r su r se s lèvre s à chaqu e<br />
instant, l a faire claquer ave c bruit, enfonce r les doigts dans la bouche , , son t<br />
des actes incivils qu'il faut interdire sévèrement aux enfants .<br />
DE L'ENSEIGNEMEN T D U CALCUL .<br />
A""" articl e (1).<br />
Après l'instructio n moral e e t religieuse , l a lecture , l'écritur e e t l'ortho -<br />
graphe , rie n , dan s nos écoles primaires , n'es t auss i utile, auss i nécessaire ,<br />
que le calcul. E t cependant, tou s ceux qu i on t inspecté comme nous un gran d<br />
nombre d'écoles , on t d û êtr e frappé s d u fâcheu x éta t d e cett e parti e fonda -<br />
mentale de l'instruction primaire.<br />
C^l) Voyez pour le s instruction s su r rarillimétique, le ManueUenéral, t . II . D .<br />
249jt. III,p . 883;t.lY,p,98et'IG8 , ® ' » > P -
EXERCICES , ETC . 1514<br />
Les connaissance s qu e la plupar t de s instituteurs on t e n aritlime'tiqu e sont -<br />
vagues, incomplètes , inexactes . I l es t tou t simple , d'aprè s cela, qu e leur s<br />
c'ièves fassent pe u d e progrè s , e t n e retiennen t d e leur s leçons qu e de s formules<br />
routinière s ^ quelquefois fausses , don t il s s e serven t mécaniquemen t<br />
pour un peti t nombr e d e questions , san s pouyoir rendre compte des proce'de's<br />
qu'ils emploient, san s pouvoir les appliquer aux plus simples problèmes usuels<br />
qu'on leur propose.<br />
D'un autr e côte' , le s commission s d'exame n s e plaignen t aye c raison, -<br />
comme nous avon s p u nou s e n convaincre, d e la faiblesse de s candidat s , e t<br />
surtout d e leu r ignoranc e presqu e absolu e d u calcu l décima l e t d u sys- .<br />
tèiiie métrique . I l y a quelque s anne'e s , o n aurai t pu les excuser jusqu'à u n<br />
certain point. Alors, le s instituteurs e t les aspirants , qu i voulaient e'tendr e un<br />
peu leurs connaissances e n aritbmet-ique , étaien t oljligé s d'avoi r recours au x<br />
savants ouvrage s d e MM. Bourdo n , Lacroi x , Picynaud , ctc. , tro p fort s et-<br />
Irop étendus pour eux, e t don t il s n e retiraien t le plus souvent qu e d e l a fa -<br />
tigue e t du découragement . Maintenan t il s ont, dan s Jes livres d e MM. Ber -<br />
gery, Ferber, Lamotte, Alexandre Meissas, Michelot , Verniev,Woisard, etc. ,<br />
tout c e qu e le s instituteurs , mêm e du degré supérieur^ ont besoin d e savoir ,<br />
présenté avec exactitude, clart é et simplicité.<br />
Ceux qu i n e peuven t s e procure r ce s ouvrages , e n trouven t u n résum e<br />
substantiel dan s le Manuel des aspirants aux brevets de capacité, lînfin , l e<br />
Manuel général a commencé à donner de s instructions pour les examens,<br />
que des circonstances particulières l'ont forcé d'interrompre dans cett e faculté,<br />
mais qu'il s e propose d e continue r incessamment .<br />
Avec d e telle s ressources , le s instituteurs doiven t arrive r promptemen t à<br />
savoir plus d'arithmétiqu e qu'il s n'ont besoin d'e n enseigner. Mai s il ne suffit<br />
pas que, pa r leur instruction, il s soient au dessus de leur tâche ; il faut encore<br />
qu'ils aien t une méthode d'enseignement qui soit ]jien arrêtée dans leur esprit,<br />
dont tous les exercices soient enchaînés et gradués logiquement, e t qui leur soit<br />
parfaitement familière dans toutes ses parties.<br />
Pour expose r un e pareill e méthod e dans tous ses détails, i l faudrai t sorti r<br />
des limites qu i nou s son t tracée s pa r l a natur e mêm e d e notr e recueil. Notre<br />
objet, dan s l e présent articl e et dans ceux qu i l e suivront, es t seulemen t d e<br />
donner de s directions pour la.march e à suivre e t pour le choix des procédés.<br />
La premièr e chos e à fair e es t d'apprendr e au x enfant s l a numération<br />
parlée, c'est-à-dir e l a manièr e d e nommer tou s les nombre s possibles . Pou r<br />
y parvenir, o n se sert ou des dix doigts, o u de traits verticaux tracés sur le tableau<br />
noir ^ o u d u compteur, appel é auss i boulier, ou , c e qu i vau t mieu x<br />
encore , d e ces trois moyens convenablement associés .<br />
On sai t qu e l e compteur, o u boulier, es t u n cadr e e n bois, portan t di x<br />
tringles horizontales e n fer, su r chacun e desquelle s sont enfilées et peuvent se<br />
mouvoir librement dix boules en bois.<br />
Nous n'ayons pas besoin de dire qu'on ne doit jamais employer , comm e o n<br />
le fait à tor t dan s quelque s écoles , le compteur à douze boules, qu i n'es t<br />
nullement propr e à familiariser les enfants avec le système décimal.<br />
Il y a deux manières d'employer le compteur. Dan s la première, o n consi -<br />
dère le s cen t boule s qu i le composen t comm e cen t unité s simple s ; le s neu f<br />
premières boules de chaqu e rangé e son t d e l a mêm e couleu r pou r toutes les
08 ftlÉTHODES,<br />
tringles ; l a dixicni c boul e doit être d'une couleur qui trancli e ayc c celle de s<br />
autres, mai s qu i es t la mêm e pour toutes les dixièmes boules .<br />
Dans la deuxième manière, le s neuf première s boules de la tringle supérieure<br />
son t aussi d e la mêm e couleur , e t repre'sentent de s unité s ; la dixièm e<br />
boule ser t à comple'te r la dizaine ; mai s elle est d'une couleur différente, afin<br />
que les enfants apprennent d e bonne heur e qu'i l n e peu t y avoi r au plu s sur<br />
chaque tringl e qu e neu f unités de la même espèce , et qu'ils passent sans difficulté<br />
de la numération parle'e à la numération e'crite.<br />
Les neuf premières boules de la deuxième tringle repre'senten t les dizaines,<br />
et sont de la mêm e couleu r qu e la dixièm e boul e d e l a premièr e tringle. L a<br />
dixième boule de cette deuxième tringle sert à comploter dix dizaines ; ell e es t<br />
d'une couleur différent e qu e le s neu f autres . Le s neu f première s boule s de la<br />
troisième trta/igZereprésenten t les centaines; celles de la quatrième,les unité s<br />
de raille , etc., le s neuf premières boules de chaque tringle étant toujours de la<br />
même couleur qu e l a dixièm e boul e de l a tringle immédiatement supérieure .<br />
Ce dernie r système permet d e compte r jusqu'à neuf milliards, 99 9 million s ,<br />
999 mille, 99 9 unité s , tandi s qu e dan s le premier on ne compte que jusqu'à<br />
cent. Peut-être serait-il bon d'avoir les deux instruments, e t d e n'employe r le<br />
second que lorsque les enfants seraient bien familiers avec le plus simple.<br />
L'usage de celui-ci est tellement connu , qu'il est inutile d'indiquer aux instituteurs<br />
le parti qu'ils peuvent en tirer, no n seulement pour la numération des<br />
cent premier s nombres , mai s encore pou r enseigner à faire de tête les quatr e<br />
premières règles sur les nombres d'un seul chiffre.<br />
Le compteur, o u boulier complet, qu e nou s proposons , es t beaucou p<br />
moins connu ; nou s n e sommes mêm e pas certains qu'il ai t été exécuté te l qu e<br />
nous venons de le décrire. I l nou s paraît donc nécessaire d'en expliquer l'em -<br />
ploi , te l qu e nous le concevons .<br />
Lorsque les enfants reconnaissent bien e t nomment san s hésiter les dix premiers<br />
nombre s formés ave c les boules de la première tringle, o n leur fai t re -<br />
marquer que, pou r compte r a u delà d e dix o u d'un e dizaine, i l fau t ajoute r<br />
aux. boules d e cett e tringle une ou plusieurs boules de la deuxième, une , pa r<br />
exemple, pou r forme r le nombre onze ; mais qu'on peut représenter ce nombre<br />
d'une autre manière, e n faisant la convention que chaque boule de la deuxième<br />
tringle vaudr a le s di x boule s d e l a premièr e , d e sort e que onze ser a figuré<br />
par une boule d e 1 » deuxième tringl e e t une d e la premièr e ; douze pa r une<br />
boule d e la deuxièm e tringl e et deux d e la première, etc . O n arriver a ains i<br />
jusqu'à vingt, qu'o n représentera o u par une houle de la deuxièm e tringle et<br />
les dix boule s de la première , o u , c e qui vaut mieux, pa r deux boule s de la<br />
deuxième tringle . O n indiquera les nombres de vingt à trente, a u moyen d e<br />
deux boules d e l a deuxièm e tringle , auxquelle s o n associera successivemen t<br />
une , deux, troi s , etc. , boule s de la première. O n représentera d'une manière<br />
analogue tous les nombre s jusqu'à cent, e t alor s on conviendra qu'une boule<br />
de la troisièm e tringle représente dix boule s d e l a deuxième , o u cent boule s<br />
de l a pi'emièr e , e t l'on formera par la combinaison de s boule s de s troi s pre -<br />
mières tringles tous les nombres compris entre cent et mille. Nous ne pousserons<br />
pas plu s loi n cett e explication , qu i nou s sembl e suffisant e pou r bie n ftiire<br />
comprendre le s avantage s d e notre système.<br />
Lorsque les élèves sont à leurs places, o n leur fait répéter, ave c leurs doigts<br />
çt leur s mains ^ c e qu i s e fai t su r l e compteur, e n convenan t qu e le s deux,
EXERCICES , ETC . 6 9<br />
mains , placée s l'un e su r l'autr e , représenten t un e dizain e e u un e boule de la<br />
deuxième tringle , etc . Ave c quelque s signe s subsidiaires , le s main s e t le s<br />
doigts pourraien t exprime r tou s le s noiiibre s d u compteur-, mai s alor s c e<br />
moyen deviendrai t tro p complique' , e t nou s penson s qu'i l fau t e n borne r<br />
l'usage aux nombres compris entre un e t cent.<br />
Si les e'ièves son t devan t l e tablea\ i noi r , o n leur fait représenter les nom -<br />
bres indiques sur le compteu r pa r de s traits verticaux o u imite s placés sur de s<br />
lignes horizontale s , comm e o n l e voit ci-dessou s , e n ayant soi n d e sépare r<br />
des neuf autres ,1 e dixième trait adroite .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 unités .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 dizaines .<br />
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 centaines .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 mille .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 dizaine s de mille .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 centaine s d e mille .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 million .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 dizaine s d e millions .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 centaine s d e millions .<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 milliard s ou billions.<br />
La ligne supérieure figure le s unités simples; l a deuxième ligne en descendant<br />
, les dizaines ; l a troisièm e les centaines , etc .<br />
le compteur étan t plac é à côt é d u tableau noir , dan s le cercle form é par<br />
les élèves, o n peut fair e plusieur s exercices . L e maîtr e énonc e un nombre ;<br />
le premier élève l e figure su r l e compteur, ensuit e l e deuxième élèv e indique<br />
sur le tableau noir avec de s traits verticaux l e nombr e qu e son voisi n vient de<br />
former su r le compteur ; l e troisièm e élèv e nomme l e nombr e ains i repré -<br />
senté d e deux manières différentes. Onreprend les mêmes exercices surunautre<br />
nombre , et , o n conçoi t qu'en le s varian t e t en les mêlant sans cesse , on captive<br />
l'attentio n de s élève s , e t l'o n finit pa r rendre leu r mémoir e indépen -<br />
dante de , l'ordre nature l de s nombres , ordr e qu'on est obligé de suivre rigou -<br />
reusement dans les premières leçons .<br />
Dès qu e le s élève s peuven t 1 ° nomme r tou s le s nombre s figurés su r l e<br />
compteur o u su r l e tableau noir ave c de s trait s verticau x o u ave c le s<br />
mains et les doigts pou r le s cen t premier s nombre s : figurer su r l e<br />
compteur e t su r le tableau noir o u avec les mains et les doigts tou s les nombres<br />
qu'o n leu r dict e j 5 ° exécute r au moye n de ce s diver s procédés le s quatre<br />
règle s sur d e petit s nombres ; alors , disons-nou s , o n leur fai t remarque r<br />
combien ce s moyens d e représente r les nombre s son t longs e t embarrassants ,<br />
on leur dit qu'i l en exist e un autre beaucoup plus rapide et plus simple, e t l'on<br />
arrive ains i naturellement à l'emplo i de s chiffre s , ave c l a certitude qu'il s le<br />
comprendront san s beaucoup d'effort s , e t qu'il s auront sur cet obje t impor -<br />
tant de s idée s nette s qu i manquen t à l a plupar t de s jeunes élèves .
70 MÉTHODES ,<br />
EXERCICES D'ARITHMÉTIQUE ,<br />
AV£C SOLUTION S E T RAISONNEMENTS .<br />
Les exercices que nous offrons aux instituteurs son t tires de l'ouvrage d e M.<br />
Saigey ayant pour titre -.Prohlènies d"arithmétique et exercices de calcul (" 1 ).<br />
De tous les recueils de ce genre, nous pouvons affirmer qu'il n'en est pas d'aussi<br />
applicable que celui de M. Saigey.D'ailleurs la distribution méthodique des matières<br />
, la clarté' de la re'daction , l a nouveauté des applications font de ce s problèmes<br />
u n véritable cour s de calcul auss i utile au x élèves qu'aux instituteurs .<br />
L'auteur, après avoir donné un grandnombre d'exercices sur la numération, les<br />
fractions décimales , le s quatre s règles simple s o u accompagnée s d e nomljres<br />
décimaux, les fraction s ordinaire s e t les nombres complexes , présent e un e<br />
foule de problème s intéressants sur les comparaisons des mesures de longueur^<br />
de surface , d e volume et de s monnaie s ancienne s e t nouvelles j il trait e successivement<br />
des proportions, del à règl e d e trois simple et composée ^ de l'intérêt<br />
de l'argent, de s rentes, de s escomptes , de s assurances , des question s de<br />
société, de s question s sur le s mélanges e t les alli a ges^ sur les matière s d'or et<br />
d'argent, su r le s changes et le s ai'bitrages , su r le s fonds public s étranger s ,<br />
sur les progressions , su r les annuité s et les amortissements, su r les rentes viagères<br />
, le s assurance s et les tontines, su r les permutations et les combinaisons ,<br />
sur le jeu de dé, su r l a loterie. I l termine par des question s su r la géométrie ,<br />
l'astronomie , le s calendriers , l a géodésie, l a géographie , l a mécaniqu e , l a<br />
physique , l a chimie e t la métrologie.<br />
M. Saigey , ancie n élève d e l'école normale, a traité ces questions en homme<br />
qui s e sent maître d e so n sujet. Les instituteurs des plus petite s écoles et ceu x<br />
des école s supérieure s y trouveron t de quoi satisfair e pleinemen t au x besoin s<br />
de leur enseignemen t dan s u n choi x d e quinz e cent s question s trè s variée s<br />
dans leur forme et dan s leu r portée.<br />
L'auteur a puljlié, pou r les instituteurs seulement, un livre contenant toute s<br />
les solution s j mai s ce s solution s ne son t pas accompagnée s d u raisonnemen t<br />
qui s'y appliqu e , e t l'on n e peut e n faire un reproche à M. Saigey. E n effet ,<br />
le volum e serait devenu troi s fois plus gro s , et par suite aurait du être vendu<br />
à un prix élevé qui n'atteignait plus sa destination primitive.<br />
Le raisonnemen t qu e nou s allon s applique r à u n certai n nombr e d'exer -<br />
cices , mettront tou s les instituteurs sur la voi e d'en préparer d'analogues pour<br />
l'enseignement de leurs élèves .<br />
Premier problème.<br />
On achète 10 fi'ancs un petit cochon ; cet animal consoium e 164- mesure s de<br />
son à 25 centime s la mesure . ïiié e t vidé , il pès e 120 livres . A combien re -<br />
vient la livre de cette viande?<br />
j t . IVJH J Ai^ J Llult^V^i J M n L 1LIX LLlVj LI ^ U C , j<br />
M. Saigey. 1 vol. in-IS , contenan t plu s d e '150 0 questions. Paris , '1834- . édition .<br />
Librairie d e L . Hachette . Prix , broché , 7 5 c . ; le s mêmes , suivi s de s réponses ,<br />
prix, broch é , - 1 fr. 2 0 c .
EXERCICES , ETC . 1518<br />
Raisonnement e t solution .<br />
164 mesures de son à 25 centime s la mesure, coûtent franc s ; et, comm e<br />
le prix d'achat es t de 10 francs, le coclion revient à 5 1 francs . Tue' et vide', i l<br />
pèse 120 livres ; don c les 1S O livres coûtent 51 franc s , e t par conse'quent une<br />
seule livr e coût e 120 foi s moins ; don c il fau t diviser 5 1 pa r 120. L e quotient<br />
0 f . 42 5 indiqu e le prix d e la livr e de coclion qui es t de 42 centime s et<br />
demi.<br />
Deuxième pvohlème.<br />
La livre de sucre vau t 1 fran c 15 centime s , e t la livre de café' 1 franc 83<br />
centimes. On veut de'pense r 100 franc s pour acha t d'une c'gale quantité' de sucre<br />
et de cafe . Combien d e livres aiira-t-on de l'une e t de l'autre denre' e ?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
Il est e'vidcnt que puisque le caf e coûte plus cEe r que le sucre , o n n'aura n i<br />
autant d e livre s d e sucr e qu e 1.15 es t conten u dan s 5 0 franc s moitié<br />
de 100 franc s n i autan t d e livres d e cafe ' que 1 . 85 es t contenu dan s 50 fr.<br />
Si nou s ajouton s 1 f . 1 5 c. à 1-f . 8 5 c . nou s auron s 3 francs pour le pri x<br />
d'une livre d e sucre e t d'un e livre de cafe'. Or, nou s avons autant d e livres de<br />
sucre et d e cafe ' que 3 ser a contenu d e foi s dan s 100 . I l faudr a donc acheter<br />
53 livre s 1/3 d e sucre et 33 livres 1/ 3 d e cafe . Eî î effe t 33 livre s 1/ 3 de<br />
sucre à 1 fr . 15 c. produisent 3 8 fr. 3 3 c., e t 33 livre s 1/3 d e suci'e à 1 fr.<br />
85|c. produisen t 6 1 fr . 6 7 c . O r 58 fr. 3 3 c . e t 61 fr . 67 c. donnen t exac -<br />
tement pour somm e 100 francs .<br />
Troisième problème.<br />
Quelqu'un achèt e u n ballo t d e marchandise s pou r '56 0 franc s payables<br />
dans 4 mois ^ e t le reven d aussitô t 580 franc s payables dans 6 mois . L'inte'rê l<br />
de l'argent étan t compte'à raison de 6 pour cent par an, o n demand e quel est<br />
lebc'ne'fice duvendeur?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
560 franc s payable s dan s 4 mois , n e valen t pa s re'ellemen t 56 0 franc s<br />
mais seulemen t 56 0 diminue' s d e l'inte'rêt d e 56 0 franc s pendant 4 moi s à 6<br />
pour cent pa r a n ( inte'rêt léga l d u commerce . ) O r 550 franc s à 6 pour cen t<br />
donnent 33 franc s 60 c . pou r un e anne'e d'intérêts , et par conse'quent le tiers<br />
de 55 fr. 60 c . o u 11 fr . 20 c . pou r 4 moi s don c 560 franc s payables dans<br />
4 moi s valent dans le moment actuel 548 francs 80 centimes . 580 francs payables<br />
dan s 6 moi s repre'senten t 580 franc s diminue' s d e l'inte'rê t pendan t 6<br />
mois; or , 58 0 à 6 pou r cen t donnen t pou r l'anné e 5 4 fr . 80 c . d'intérê t<br />
dont la moiti é pou r 6 moi s es t d e 1 7 fr . 4 0 c . Retranchan t '1 7 fr , 40 c .<br />
de 580 fr. nous voyon s qu e 580 fr . payable s dan s 6 mois, n e valent en réalité<br />
qu e 56 2 fr . 40 c . L e problèm e se trouv e don c rédui t à celui-c i : uB<br />
marchand qui achèt e u n ballo t d e marchandise s pou r 54 8 fr . 8 0 c., l e revend<br />
pour 56 2 fr . 6 0 c., combie n gagne-t-il ? O r , c e dernier problème s e<br />
résout par un e simple soustraction e t donne pou r solutio n 13 fr . 80 c .<br />
Quatrième problème.<br />
Un marchan d achèt e un e douzain e d e vase s a n pri x d e 1 5 franc s l a
72 MÉTHODES ,<br />
douzaine. E n le s transportant ^ il cass e 5 vase s , à que l pri x doit-il reven -<br />
dre ceux qui lui resten t pour faire un be'ne'fic e total de 60 francs ?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
Le marchand ayant paye' 12 douzaine s de vases à 15 franc s la douzain e , a<br />
de'bourse' 180 francs, mai s comme il en a casse' 5, a u lie u d'avoir 12 fois 12<br />
ou •I44 - vases, i l n'en a plu s qu e 139. S'i l veu t gagne r 60 francs , i l devr a<br />
donc vendre 159 vase s 180 franc s plu s 60 franc s o u 2^0 francs. Il n e s'agit<br />
plus, pou r trouve r le prix d'un vase, qu e de diviser %âO par 159, e t le quotient<br />
1 franc 72 cent., indiqu e l e pris, d'u n vase.<br />
Cinquième proMème.<br />
On achète 100 kilogrammes d e marchandise s qu'o n espèr e revendr e dan s<br />
le courant d'un e anne'e. L e kilogramm e d e celte marchandis e coût e 5 franc s<br />
60 cent . ; et, pou r en faire l'acquisition , l'achetcu r a emprunte de l'argent à<br />
5 pou r cent par an. A quel prix doit-il revendre cette même marchandise pour<br />
faire u n be'ne'fice de 8 pour cent sur l e pri x d'achat ?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
Maigre' la complication d e l'énoncé', ce problème est assez simple. 100 kilogrammes<br />
à 5 francs 60 cent, coûtent 560 francs argent comptant, mais comme<br />
l'acheteur a e'te oblige d'emprunter à 5 pour cent, il a donne' 28 franc s d'intérêt,<br />
pa r conse'quent les 100 kilogramme s lui reviennen t à 588 francs , mais il<br />
veut fair e u n be'ne'fic e d e 8 pou r cen t sur l e prix d'achat , c e qui doit aug -<br />
menter les 588 franc s de 8 pou r cen t ou d e 47 francs , c'est-à-dir e le s porter<br />
à 635 francs . S i 100 kilogramme s doiven t s e vendr e 635 francs , un seul kilogramme<br />
coûtera 6 franc s 35 cent .<br />
Sixième problème.<br />
Un libraire,voulant calcule r la dépensé d'impression d'u n livre de 35 feuilles<br />
, fai t le compte suivant : 50 f i ancs de composition et 5 francs de corrcctiou<br />
par feuille; l a rame de papier de 500 feuille s à 12 francs , l e brochag e à 30<br />
centimes le volume , l a couverture à 5 centimes, e t 85 franc s de menus frais.<br />
D'après ce s donne'es ^ o n veu t savoi r l e pri x coûtan t d e l'e'ditio n tire' e à<br />
1,000 exemplaire s e t les prix coûtants de chaque volume. L e libraire vendra<br />
l'ouvrage au double du prix coûtant . Quel ser a le prix d u volume ?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
35 feuille s à 1,000 exemplaire s fon t 35,000 feuille s qui exigeron t 70 ra -<br />
mes à 12 franc s o u 84-0 francs : 55 franc s pa r feuilles de compositio n et de<br />
correction, fon t pour l'ouvrag e entie r 3 5 foi s 5 5 franc s o u 122 5 francs ;<br />
1,000 volume s à 50 centime s d e brochag e coûten t 500 francs ; 1,000 cou -<br />
vertures à 5 centime s coûtent 50 francs ; si o n ajout e à toutes ces sommes partielles<br />
85 francs de menus frais on aura u n total de dépens e de 2,500 francs,<br />
ce qui mettra à 2 franc s 50 cent., pri x coûtant, l'exemplair e qu e l e librair e<br />
vendra 5 francs.
EXERCICES , ETC . 1520<br />
Septième prohlème-<br />
Une bonne femme tricote de s bas d e laine qu'ell e vend a u prix de 56 sou s<br />
la paire . La lain e lui coût e 32 sou s la livre, e t 8 paires pèsent juste 3 livres .<br />
On demande c e qu'ell e gagn e par pair e de bas e t c e qu'elle gagn e par jour,<br />
sachant qu'elle fait 5 bas par semaine?<br />
liaisonnement e t solution .<br />
Si 8 paire s de bas pèsen t juste 5 livres , o n emploie pour i franc s 80 cent ,<br />
de laine pour faire l Ô bas, e t le seizième d e i franc s 80 cent , pou r fair e u n<br />
seul bas o u 5 0 centimes . Elle fai t 5 ba s dan s un e semain e et de'pens e pa r<br />
conséquent pou r 1 francs 50 centime s d e laine . Puisqu'ell e ven d la pair e d e<br />
bas 56 sous, elle vend u n bas 28 sous , e t par conséquent ell e vend le travai l<br />
de sa semaine 7 francs. Si nou s déduison s de cette somm e 1 franc 50 centimes<br />
débourses pour achat d e laine, il lui restera 5 francs 50 cent, pour so n travail.<br />
Il n e rester a plu s qu' à diviser 550 pa r 6 , nombr e de s jours ouvrables et o n<br />
aura pour le prix , de chaqu e journée O l centime s ou 18 sou s 4- deniers. D'u n<br />
autre côté, comm e elle ven d chaqu e paire de bas 56 sous et 'qu'elle y emploi e<br />
1 % sous de laine, nou s voyons qu'ell e gagn e iA sou s par paire de bas.<br />
Huitième prohlème.<br />
Un ouvrie r étai t employ é depui s 6 jour s à u n certain ouvrag e lorsqu e s a<br />
femme es t venu e à so n aide ; 3 jours après leurs 2 enfant s se sont aussi em -<br />
ployés à ce travail qu i a ét é termin é l e lendemai n d e leu r arrivée, ensort e<br />
que ces derniers n' y on t pris part qu e deux jours. L'homm e es t payé à raison<br />
de A francs pa r jour, l a femm e à raison d e 3 francs , et chacun des enfant s à<br />
raison de 75 centimes . O n demande c e qu'il revient à cette famille.<br />
Raisonuement e t solution .<br />
Nous allons cherche r d'abord le nombre de jours que les enfants, la mère ,<br />
et le pèr e on t travaillé. Le s enfants ont travaillé 2 jours, l a femm e a travaillé<br />
5 jours e t le mar i 1 1 jours . 1 1 journée s du mari à -4 franc s font U A francs;<br />
5 journée s d e l a femm e à 3 franc s fon t \ 5 francs j 2 journée s d'enfant s à<br />
1 fran c 50 cent. , pou r le s deux font 3 francs . En ajoutan t toutes ces somme s<br />
le tota l 62 franc s indique c e qui est dû à la famille.<br />
Neuvième prohlème.<br />
Un ménag e consomm e deux foi s plu s de sucr e qu e d e café . L a dépense ,<br />
pour ces deux objets , es t d e 9 franc s pa r semaine. Quell e es t alor s l a con -<br />
sommation d u sucr e e t celle du caf é durant ce temps-là, l e sucr e étan t payé<br />
1 fran c la livre , e t le café 1 franc 60 cent. P<br />
Raisonnemeat e t solution .<br />
Si le sucre et le café coûtaient la mêm e somme, i l serait facile de détermi -<br />
ner immédiatement l a quantit é de chacun e d e ce s marchandise s consommé e<br />
dans une semaine -,mais comme il n'e n est pas ainsi, voici le raisonnement que<br />
nous employons pou r arrive r au résultat. Quan d o n dépense 1 franc 60 cent .
MÉTHODES,<br />
de caf e on depense 2 franc s de sucre, o u en totalité ' 5 franc s 60 cent . Or , je<br />
vois qu'i l y a le même rappor t entre 3 franc s 60 cent., pri x d'un e livr e d e<br />
café et de deu x livre s de sucre , e t 9, pri x d'u n certain nombr e d e livre s d e<br />
cafe' et du double d e ce nombr e de livres d e sucre qu'eptre â franc s de sucre ,<br />
et l e . ve'ritable nombr e de livres d e sucre , c e qu i m e donn e la proportio n<br />
3.60 : 9 ' : : 2 : X = ^^ o u 5 livres; et comme on de'pensait la moitié'moins<br />
de cafe , on consommai t don c seulement 2 livre s e t demie d e cafe. Or, 5livres<br />
de sucre à 1 franc donnent 5 francs ^ et 2 livre s e t demie d e cafe' à 1 franc 60<br />
cent, donnen t i francs , c e qui form e le total d e la depense ou 9 francs .<br />
Dixième i>rohUme.<br />
Quand o n ne donn e que les troi s côte's d'u n triangle voic i commen t o n e n<br />
calcule la surfac e : on fait la somm e de s troi s côte's et on e n prend la moitié'^<br />
puis on retrancb e tour à tour d e cett e dem i somm e cliacu n des côté s j ensuit e<br />
on fait le produit de cette dem i somme par ces trois différences successives^ pour<br />
en prendr e enfi n l a racin e carré e ^ laquelle exprimer a l a surfac e cherchée .<br />
D'après cela , o n demand e la surfac e d'u n triangl e don t le s trois côté s son t<br />
de 5, d e 9 e t de 10 mètres.<br />
Détail (lu calcul .<br />
5 1 2 1 2 1 2 7<br />
9 5 9 1 0 3<br />
10<br />
7 3 2 2 1<br />
24 2<br />
moitié' 1 2 —<br />
S04 22.45<br />
A<br />
12<br />
10.4<br />
8 4<br />
84<br />
44.4 4 2<br />
TÔÔÔ 50 4<br />
1 77 6 •<br />
22400<br />
22425<br />
La surface est don c d e 22 mètre s carré s 45 décimètre s carrés .<br />
Autre supposition .<br />
Si le s troi s côté s d u tria"ngl e étaient d e 24 mètre s 5 0 centimètres , d e 26<br />
mètres 65 centimètre s e t d e 21 mètre s 80 centimètre s , quell e serai t l a sur -<br />
face en mètres carrés , décimètre s carré s et centimètres carrés ?
EXERCICES, ETC .<br />
75<br />
24.50<br />
26.65<br />
21.80<br />
72.95<br />
moitié 36.4 7<br />
36.47<br />
24.50<br />
11.97<br />
1724"<br />
36<br />
12070<br />
68975<br />
1034634<br />
517317<br />
59<br />
47<br />
Détail du calcul .<br />
36.47<br />
26.65<br />
9.^<br />
73<br />
.6 6.S<br />
4<br />
2.8<br />
62888.50 3 3 2 2<br />
36.47<br />
21.80<br />
14.67<br />
3885.0<br />
3504.9<br />
5.50.33<br />
'380133<br />
351029<br />
291040.0<br />
250772.5<br />
4026750.0<br />
3510854.9<br />
11.97<br />
9 8 2<br />
2394<br />
9576<br />
10773<br />
117.5454<br />
117.5454<br />
14 6 7<br />
8228178<br />
'7052724<br />
4701816<br />
1175454<br />
1724.391018<br />
250.7757<br />
45<br />
5007<br />
50147<br />
501545<br />
.5015507<br />
5158951<br />
La superfici e d u triangl e es t doU c de 250 mètre s carrés , 77 décimètre s<br />
carrés j 57 centimètre s carrés .<br />
Onzième problème.<br />
Un petit marchand aclièt c à 9 franc s la douzain e des objets qu'il revend en<br />
détail 18 sou s l a pièce. E n outre, o n lui fait une remis e de 5 pour cen t sur le<br />
prix d'achat e t on lu i donne l e treizième par-dessus l a douzaine . Que l es t l e<br />
bénéfice de ce petit trafiquant sur la vente de chaque objet ?<br />
Raisonnement e t solution .<br />
Puisqu'on lui fait un e remise d e 5 pou r cent sur le prix d'achat, i l ne paie<br />
donc qu e 8 livre s 1 1 sous , e t par conséquen t u n seu l obje t lu i revien t à<br />
13 sou s e t I3, c e qu e l'o n trouv e e n divisan t 8 livre s 1 1 sou s pa r 13. E t<br />
comme il revend en détail chaque objet 18 sous, i l a donc pour bénéfice 4 sou s<br />
et —<br />
13'<br />
Douzième problème.<br />
Un rentier refuse de prêter 1,500 franc s pour un an , à un e personn e qu i<br />
offrait 5 pour cent d'intérê t j cett e pei'sonne revien t a u Isou t de 5 mois offri r<br />
6 pou r cent d'intérê t pa r a n pou r l e mêm e capita l rest é san s placemen t e t<br />
qu'elle devr a rembourser a u bout d e 9 mois . L e rentie r a'ura-t-i l perd u o u<br />
gagné en différant le placement d e soi caj)rtal ?
7-8.. MÉLANGES .<br />
Kaisonnement e t solulion .<br />
Pour appre'cier l a diffc'rcncc , s'i l y e n a iine ^ nous allons leduir e f e problême<br />
à une plu s simple expression . 5 pou r cent sur 1,500 franc s forment-il s<br />
un intérê t plu s considérabl e o u moin s considérabl e qu e 6 pou r cen t su r l a<br />
même somme pendant 9 mois . Or , 5 pour cen t sur 1 ^500 franc s pendan t u n<br />
an donn e 7 5 franc s d'intérêt ; 6 pou r cen t su r 1 5 franc s pendan t u n a n<br />
donne 90 franc s d'intérêt ; pa r conséquent, 4 5 franc s pou r 6 moi s , e t fr .<br />
50 cent , pou r troi s mois, o u 67 franc s 5 0 cent , pou r 9 mois . L e rentie r a<br />
donc perd u 7 franc s 50 cent , à ne pa s conclure d e suit e l e premier contra t de<br />
prêt.<br />
MELANGES.<br />
r DOCUMENT S SU R L'INSTRUCTIO N PRIMAIR E A L'ÉTRANGER .<br />
RUSSIE.<br />
RÈGLEMENT SU R L'ÉDUCATIO N PARTICULIÈR E E N RUSSIE .<br />
Le Journal d e St-Pe'tcrsbour g a publi é dernièremen t u n Ukns e d e S . M .<br />
l'empereur d e Russie su r l'éducatio n particulière . Nou s nou s empresson s d e<br />
faire connaîtr e ce documen t dan s se s partie s qu i nou s on t par u le s plu s inté -<br />
ressantes.<br />
« En soumettan t successivement à un mûr examen toutes les parties qu i constituent<br />
l'éducatio n nationale , e t en invitant tou s nos fidèles sujet s à concourir<br />
au but que nou s nou s proposon s d'atteindre , e t qu i es t si intimemen t li é au<br />
bien-être d e tou s e t d e chacun , nou s avon s reconn u l a nécessit é d'établi r<br />
une liaiso n direct e entr e l'éducatio n domestique , et l'éducatio n publique . A<br />
cet effet, nou s avons ordonné au Ministre d e l'instruction publique de rédiger<br />
un règlemen t e n vert u duquel , d'un e part , le s individu s qu i s e consacren t<br />
avec honneu r e t utilité à l'éducatio n domestiqu e son t appelés à prendr e place<br />
parmi le s fonctionnaire s d e l'Éta t attaché s a u di t ministère , d e l'autre , s e<br />
trouvent déterminée s le s règle s d'admissio n e t les devoir s qu e l e gouverne -<br />
ment leur impos e e n échang e de s droit s e t des privilèges qu'i l leu r accorde .<br />
« C e règlement ci-annexé , confirm é par nous, es t un e nouvell e manifes -<br />
tation d e notr e invariabl e volont é d'organise r su r de s principe s solide s u a<br />
système comple t qu i embrass e toute s le s branche s d e l'éducatio n nationale ,<br />
et lu i imprim e un e directio n constante , analogu e au x vœu x d e tou s le s<br />
hommes éclairé s e t conform e à notr e sollicitud e pou r l a prospérit é moral e<br />
de notr e chèr e patrie . »<br />
Principales disposition s d u règleineu t su r l'éducatioa domestique .<br />
Art. 1. I l es t établi, pou r ceu x qu i s e vouen t à l'éducation domestiqu e ,<br />
deux catégorie s sou s le titr e à'inslituteurs e t de précepteurs.<br />
Art. 5 . Ceu x qu i désiren t participer au x avantage s énoncé s dan s l e règle -
MÉLANGES. 8-1<br />
ment doivent cir e sujets russes. — §7. Le s sujets e'tranger s qui auront obten u<br />
le droit d'exerce r ce s fonctions, e t qu i néanmoin s n e de'sireront pas prêter le<br />
serment d e sujet s russes , pourron t liljremen t jouir d u droi t qu i leu r aur a<br />
e'te' accorde'^ san s participer toutefoi s au x avantage s e t privilèges énoncé s ci -<br />
après.<br />
Art. 8 . Le s personne s de s deu x sexe s qu i s e bornen t à donner de s soin s<br />
à l'e'ducatio n physique , n e son t soumis à aucu n exame n d e capacité' . O n s e<br />
bornera à leu r demander le s témoignage s usités de moralité ' et d e bonne con -<br />
duite.<br />
Art. 9. L e titr e d'instituteu r appartien t exclusivemen t à ceux qu i auron t<br />
aclieve' leurs cours dan s l'un e de s universite's d e l'empir e e t reç u leu r ins -<br />
cription d'étudian t o u l e diplôm e d'u n degre ' universitaire. — L e titre d e<br />
pre'cepteur s'accorde à ceu x qui , san s avoir fai t leu r cour s d'universite ' o u<br />
sans êtr e gradue's, auron t sub i un exame n d e capacité , à l'effe t d e prouve r<br />
qu'ils possèdent, no n seulement une connaissance ge'ne'ral e des objets ne'cessai -<br />
res, mai s encore une connaissance exacte de s parties d e l'enseignemen t aux -<br />
quelles ils voudront se livrer .<br />
Art. 17 . Le s e'trangers qui voudront venir en Russi e pour exercer quelques<br />
unes de s fonctions d e l'e'ducatio n domestiqu e auront à s e pourvoi r d'u n attes -<br />
tai particulier d e l a le'gatio n impe'rial e e'tabli e dan s le s lieux o u ils résident .<br />
— Ceu x qui, e n vert u d e c e règlement , auron t acqui s l e titr e d'instituteu r<br />
ou de précepteur pou r l'éducatio n domestique , son t comptés a u service effectif<br />
e t attachés a u ministèr e de l'instructio n publique . Auss i long-temps qu'il s<br />
exercent ce s fonctions,, il obtiennen t l e droi t de porter le petit uniforme du di t<br />
ministère.<br />
Les article s 29, 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 3 7 règlen t l'admissio n e t l'a -<br />
vancement de s instituteur s e t des précepteur s dan s l'ordre du service effectif.<br />
Art. 36 . Di x année s d e servic e irréprochable e t dûment attest é donnen t l e<br />
droit d'obteni r un e médaille qui ser a d'o r pou r le s instituteurs , e t d'argen t<br />
pour les précepteurs. Cett e médaille , attaché e au ruban d e l'ordr e de Saint -<br />
Alexandre-Nevski, s e port e à l a boutonnière .<br />
Art. 40. I l ser a accord é à ceux qui auron t 15, 2 0 e t 25 an s de fonction s<br />
honorablement exercées, l a croix de Sainte-Anne e t cell e d e l'ordr e de Saint-<br />
Stanislas.<br />
Art. . 35 an s de service donnen t la facult é d'obtenir , à l'instar des fonctionnaires<br />
civil s , la croi x de l'ordre de Saint-Vladimir .<br />
Art. 42 . Le tilTC à^Instituteur émérite ser a accord é à ceu x qui , dan s u n<br />
espace de 25 année s utilement vouées à l'éducation domestique , auron t fourni<br />
au moin s troi s étudian s reçu s ave c ce titre dans une des université s d e J'em -<br />
pire.<br />
Art. 46 . L'instituteu r e t le précepteur qui auron t vieilli dans l'exercice de<br />
leiu's fonctions,ou qu'un e maladie incurable aura mis hors d'état de les exercer,<br />
obtiendront un e subvention viagèr e su r la caiss e de secour s établie à cet effe t<br />
à la caisse de l'instruction publique .<br />
L'article 47 port e que les orphelins des deux sexe s pourront être placés, au x<br />
frais d e l a couronne , dan s le s établissements d'instructio n publique .<br />
Les articles 5 1 e t 53 renden t commune s au x femmes qui s e vouen t à l'éducation<br />
domestiqu e le s disposition s d u règlemen t concernan t le s examen s e t<br />
certificats à fournir .
7-8.. MÉLANGES .<br />
Le titre VI traite de la formatio n de la caiss e de secours.<br />
Le titre YII traite de la pénalité attacWeaiix infraction s de ce règlement. Le s<br />
personnes, soi t d u pays, soi t e'trangères , qu i exerceron t le s fonctions , soi t<br />
d'instituteurs, so M de précepteurs dan s les maisons de s particulier s san s l'autorisation<br />
d u gouvernement , seron t pou r l a premièr e fois condamnée s à un e<br />
amende de 250 rouble s au profit de l a caiss e d e secours. Une pareille somm e<br />
sera payée à la même caiss e par les parents, qui auront gardé chez eux u n instituteur<br />
san s attestai. L a récidive ser a punie, quan t aux étrangers , pa r l'expulsion<br />
lior s du pays, quan t aux Russes, pa r des poursuites judiciaires. L e Mi -<br />
nistre de l'instriiction puljliqu e porter a à l a connaissance de S . M . Impérial e<br />
les noms des parents o u des tuteurs qui auron t enfreint, à cet égar d , le s règles<br />
énoncées dans c e règlement.<br />
2° DOCDMENT S StFU L'INSTRUCTION PRIMAIRE E N FRANCE.<br />
Nous allon s extrair e du tableau général de l'emploi des fonds affectés<br />
h Finstruction primaire^ pendant Vannée 1834._ , quelque s notes qu'iln'ei t<br />
pas. sans intérêt d e comparer ave c le s résultats obtenu s l'anné e précédente .<br />
I. L'articl e 15 d e l a lo i d u 28 jui n 183 3 impos e â l'Eta t l'obligatio n d e<br />
fournir des subventions au x communes , pour acquitte r le complément de s dé -<br />
penses ordinaire s de s école s primaire s communale s e t les dépense s de s écoles<br />
normales , lorsque les ressources locales qu'elle met à leur dispositio n pou r cet<br />
objet sont insuffisantes.<br />
Dix département s seulemen t on t e u à demande r de s subvention s à l'Eta t<br />
pour acquitter les dépenses ordinaire s d e leur s école s primaire s communales .<br />
Ces subventions s e son t élevée s à 183,588 fr . 34 - c. A u fu r e t à mesur e qu e<br />
de nouvelle s écoles seront établies , ce s subventions devron t êtr e plus considé -<br />
rables. Cett e dépense n'avait pa s lieu les année s précédentes .<br />
Dans l a vu e d'accélére r rétablissemen t de s école s normale s primaire s e t<br />
d'améliorer l'organisatio n d e celle s qu i existaien t déj à , i l avai t par u néces -<br />
saire de fonder des bourses dans ce s école s , e t d e leu r accorde r un e subven -<br />
tion annuell e pour servir à acquitte r l e traitemen t d u directeu r e t de s maî -<br />
tres-adjoints , indépendemmen t de s secour s accordé s pou r frai s d e premie r<br />
établissement. L e Ministre n' a pa s cr u devoi r modifie r ce t éta t d e chose s<br />
après la promulgation d e la loi d u 28 juin 1833 , e t il a continué à entretenir<br />
le mêm e nombr e de bourse s e t à fournir le s même s subvention s à ce s écoles ,<br />
même lorsqu e le s département s auxquel s elle s appartiennen t pouvaien t ac -<br />
quitter toute s le s dépense s d e l'instructio n primair e ave c leur s propre s ressources.<br />
Les subvention s accordée s e n 183 4 pou r ce s école s s e son t élevée s<br />
à 261,83 7 fr . 0 2 c .<br />
En 1833 , elle s n'avaien t ét é que de.... 238^06 1 7 5<br />
Différence e n plus. 23,77 5 fr . 27 c .
MÉLANGES. 8-1<br />
Celte différenc e provient d e ce que donz e nouvelles éèolc s on t été récem -<br />
ment ouvertes. ]j e nombre de ce s e'tablissement s n'e'tait , i l y a un an, qu e d e<br />
soixante-deux. I l s'élève aujourd'iiui àsoixante^quatorze. Deu x départements<br />
n'ont pas encor e rempli les obligation s qu e leur impose la lo i relativemea t à<br />
l'entretien d'un e e'col e normal e : ce-son t le s Bouches du-Rhôn e e t l a Seine .<br />
Le conseil généra l du Doub s a voté le s fond s nécessaire s pou r l'entretien d e<br />
son école normale ^ mai s ell e n'est pas encore ouverte , parc e qu e des difficultés<br />
se sont élevées sur le cboix de la vill e dan s laquelle ell e serai t établie. L e<br />
conseil général sera appelé à émettre un nouvel avi s su r cet obje t dans sa prochaine<br />
session . Le s neu f autre s département s son t réuni s à u n départemen t<br />
voisin pour l'entretien d'une écol e normal e primaire .<br />
Le nombr e de s élèves de s écoles normales primaires , qu i n'étai t e n 183 4<br />
que de... 1,94 4<br />
s'élève e n 183 5 à. ^,56 7<br />
Différence en plus 62 3<br />
IL, Neuf cen t quatre-vingt-seiz e commune s on t reç u en 183 4 de s secours<br />
pour acquisition , constructio n e t réparatio n de maison s d'école . Ce s secours<br />
se sont élevés à 760,57T fr . 98 c . : terme moyen par commune , 764 fr .<br />
En 1833 , douz e cen t soixante-douz e commune s avaien t reç u pour l e<br />
même obje t des secours qui s'élevaient à 856,782 fr . : terme moyen, 67 4 fr.<br />
Ainsi la différence e n moins que présentent les allocation s d e 1834, com -<br />
parées à celles de i 833, est , pou r le nombr e de s commune s , d e deux cen t<br />
soixante-seize, et , pou r le montan t des subventions, d e 96,204 fr. 0 2 c .<br />
Cette différenc e est expliquée par l'obligation o ù l'o n s'es t trouv é de fournir<br />
aux communes , pou r le s dépense s ordinaire s d e leur s école s primaire s<br />
communales d e 1834, un e subvention de 183,588 fr. 34 c . Ains i qu'il a été<br />
dit ci-dessus , cett e dépens e n'existai t pas pou r le s année s antérieures . S i o n<br />
n'avait pas dû la faire , cett e somme aurait été consacré e au x secours pour acquisition<br />
, constructio n e t réparation de maisons d'école, qu i s e seraient alors<br />
trouvés de 87,384 fr. 32 c . plu s élevés qu'e n 1833 .<br />
D'après le s dernier s relevé s transmi s pa r le s préfets , l e nombr e de s<br />
maisons d'écol e appartenan t au x communes , qu i n'était ^ e n 1833 , qu e<br />
de...,c. 10,31 6<br />
s'est élevé, e n 1834, à. ' 11,27 9<br />
Différence e n plus. 96 3<br />
nombre à peu prè s e'ga l à celu i de s commune s qui on t reç u des secours pou r<br />
cet objet en 1834.<br />
III. Cent trente-une commune s ont reçu e n 1834 de s secours pou r frais de<br />
premier établissement , acquisitio n o u entretien d u mobilie r de s écoles . Ce s<br />
secours s e son t élevé s à 31,180fr. 5 0 c.term e moye n pa r commune ,<br />
238 francs .<br />
En 1833, trois cent (juarante-deux commune s avaient rey u pou r le m^mç
7-8.. MÉLANGES .<br />
objet de s secours qui s'élevaien t à 15^,574 fr. 82 c. : terme moyen pa r com -<br />
mune , 587 francs.<br />
Ainsi, l a différenc e e n moins qu e présentent le s allocations de i 834, com -<br />
parées à celle de 1855 ^ est, pou r l e nombr e de s communes , d e deu x cen t<br />
onze, et , pour le montant de s secours , d e 101,194- fr. 32 c .<br />
On remarquera peut-être que dans quelques départements les communes n'ont<br />
reçu aucun e allocation , o u n'on t obten u qu'un e faible allocation poiu ' acqui -<br />
sition , construction et réparation d e maisons d'écolc et achat de mobilier. L'intention<br />
d e l'administratio n étai t d e distribue r dan s chaque département un e<br />
somme égal e au centième de l a dépense qu'auraien t à faire pou r s e procure r<br />
des maisons d'école le s commune s qu i n'en possèdent pas. Mai s il n'es t arrivé<br />
aucune demande d e secour s pou r quelques département s , e t on s'es t trouvé<br />
dans la nécessité de reporter à d'autres départements les allocations qu'on avait<br />
réservées pou r ceux qu i n'ont reç u que de faibles secour s o u mêm e qu i n'e n<br />
ont point reçu. D e nouvelles recommandations seront adressées aux préfets d e<br />
ces départements, pou r qu'ils invitent le s communes à se mettre en mesure de<br />
devenir propriétaires d e maison s d'école.<br />
IV. Dix-huit cent vingt-trois instituteurs et institutrices en exercice, o u qui<br />
ont cessé leurs fonctions e t se trouvent dans l'indigence, ont reçu, e n 183-4, des<br />
encouragements o u des secour s qu i s'élèvent ensembl e à 110,715 fr . 9 7 c . :<br />
terme moyen, 6 1 francs.<br />
En 1833 , o n avait accordé pour le mêm e obje t à neuf cent trente-un instituteurs<br />
et institutrices 68,680 fr . 8 1 c . : terme moyen , 74 francs.<br />
Ainsi, l a différence en plus que présentent les encouragements et les secour s<br />
distribués e n 1834 comparé s à ceu x distribué s en 183 3 est , pou r le nombr e<br />
des instituteur s e t des institutrices , d e cent quatre-vingt-douz e , et, pou r le<br />
montant des allocations , de 42,035 fr . 1 6 c .<br />
Les allocation s qu e l'on a cru devoir accorder à plusieurs instituteurs communaux<br />
trè s âgé s e t pe u capables , pou r le s détermine r à renoncer à leur s<br />
fonctions, sont cause de cette différence. Les place s de ces anciens instituteur s<br />
ont ét é remplie s par de s élèves-maîtres récemmefa t sortis des écoles normale s<br />
primaires.<br />
Cette nature d e dépense éprouver a une fort e réduction à partir de 1835 .<br />
V. L a loi a voulu procure r aux enfant s des famille s indigentes l a fréquentation<br />
entièrement gratuit e de s école s primaires. L'administratio n devait dès<br />
lors prendr e des mesures pour qu'ils reçussent gratuitement le s livre s dont ils<br />
ont besoin pour suivre les cours de ces écoles.Unc somm e de 130,604 fr. 75 c .<br />
a été affectée à cette dépense en 1834, ains i qu'à l'acha t d e cartes géographiques<br />
e t de globes aérophyses , pou r le s écoles normales et les écoles primaire s<br />
communales. Celt e dépense n'avai t étéquede 86,292, fr.62c. e n 1833. Le s<br />
communes et le s département s doivent concouri r à cette œuvre. L'administra -<br />
tion les y a invités : les allocations qu'ils fourniront pour ce t objet diminueront<br />
d'autant celles qu'a, jusqu'à présent, donnée s l e gouvernement .<br />
Le surplu s du crédit port é dan s le budget d e l'Éta t pour l'instruction pri -<br />
maire a été employé en secours pou r créatio n d e salles d'asile, d e cour s d'a -<br />
dultes ou e n allocation s à des établissements normau x destiné s à forme r des<br />
instituteurs et des institutrices. Ce s diverses allocations sont détaillées dans l e<br />
jableau généra l qu i suit l a présente note.
MÉLANGES. 8- 1<br />
Les conseil s généraux ont répondu ave c le plu s honorable empressement à<br />
l'appel de l'administration , e t lu i on t fourn i les moyen s d e donner une plus<br />
forte impulsion à la propagation e t à l'amélioration d e l'instructio n primaire.<br />
Aucun département n' a ét é imposé d'office en 1854, tandi s qu'on avait dû recourir<br />
à cette mesur e pou r quatre départements e n 1835. Le s allocation s des<br />
conseils généraux pour les dépense s d e l'instruction primair e d e 1835 s e sont<br />
élevées à :. , 5,758,58 3 fr. 82 c .<br />
Elles ne s'étaient élevées pour 1834 qu' à 2,903,69 5 1 2<br />
Différence en plus 854.88 8 fr . T O c.<br />
qui revien t à 29 p. "/o - " '<br />
INSTRUCTION PRIMAIR E E N FRANCE .<br />
RAPPORT D U NOMBR E DE S ÉLÈVE S A L A POPULATIOi N TOTAL E (-1) .<br />
ACADÉMIES. Ei r -1817 . E N 1820 . E N -1823 . E N 1829 . E M 1833 .<br />
Aix l e 50" = l e 43 " l e 40'- ' l e 56 ° l e âS "<br />
Amiens 18 " 12 " i r 11 ° 10 °<br />
Angers 110 ° Ti " 58 ° 61 ° 40 °<br />
Besançon 15 ° 11 ° 10 ° 10 ° 10 °<br />
Bordeaux 66 ° 69 ° 69 ° 44 ° 51 °<br />
Bourges 126 ° 68 ° 51 ° 75 ° 48 °<br />
Caen 45 ° 52 ° 27 ° 58 ° 22 °<br />
Cahors 45 ° 47 ° 46 ° 58 ° 54 °<br />
Clermont 190 ° 189 ° 187 ° 109 ° 52 °<br />
Dijon 17 ° 15 ° 13 ° 16 ° 12 °<br />
Douai 18 ° 17 ° 14 ° 14 ° 13 °<br />
Grenoble 158 ° 80 ° 52 ° 43 ° 19 °<br />
Limoges 91 ° 92 ° 93 ° 110 ° 52 °<br />
Lyon 115 ° 45 ° 27 ° 51 ° 28 °<br />
Metz 14 ° 11 ° 10 ° 10 ° 9 °<br />
Montpellier 42 ° 46 ° 59 ° 47 ° 25 °<br />
Nancy 17 ° 15 ° 11 ° 10 ° 10 °<br />
Nîmes 56 ° 55 ° 28 ° 40 ° 25 °<br />
Orléans 95 ° 128 ° 42 ° 54 ° 28 °<br />
Paris 23 ° 18 ° 15 ° 24 ° 13 °<br />
Pau 27 ° 18 ° 25 ° 55 ° 17 "<br />
Poitiers 65 ° 59 ° 58 ° 50 ° 26 °<br />
Rennes 567 ° 150 ° 115 ° 96 ° 80 °<br />
Rouen 30 ° 24 ° 20 ° 15 ° 18 °<br />
Strasbourg 14 ° 12 ° 9 ° 9 ° 9 °<br />
Toulouse. 75 ° 69 ° 52 ° 54 ° 35 °<br />
Ces proportion s on t ét é établies , pou r le s quatr e première s époque s ,<br />
(1) Ce s renseignements son t extrait s des page s 22 2 et 922 du Code universitaire,<br />
publié pa r M . Ambroise Rend u , 2 " édit. Nou s rendron s prochainemen t u n compt e<br />
détaillé d e cet ouvrage important .<br />
Le Code imiversiLaire s e vend chez Hachette, libraire, vu e Pierre-Sarrazin, n " 12.<br />
VI. G
7-8.. MÉLANGES .<br />
d'après le s tableau x envoyas par le s recteur s , et , pou r 183 3 ^ d'aprè s tou s<br />
les document s recueilli s dans le Rapport au Roi.<br />
BASSES-PYRÉNÉES.<br />
Note su v la disciplin e e t les étude s d e l'École normal e primair e d e Pau .<br />
Le travail es t distriljue ' e n liui t parties , don t cliacun e es t dirigé e pa r u n<br />
moniteur, sou s l a surveillanc e imme'diat e d u directeur . Apre s l a leço n pa r<br />
groupes, le directeur donne alternativement une leçon gene'rale de cliacune des<br />
branches qu i composen t le s cours . C e mode d'enseignemen t perme t a u direc -<br />
teur d e recevoir de s élèves à toutes le s époque s d e l'anné e ^ en mêm e temps<br />
qu'il excite au plus haut degré l'émulation des élèves. Chaque samedi, de s paroles<br />
bienveillante s son t adressée s à ceu x qui, aprè s examen , on t ét é recon -<br />
nus capable s d e passer à une division supérieure . C'es t à cette distribution d e<br />
travail, qu i a reçu l'approbation de s personne s les plus distinguées , qu e le s<br />
élèves doivent une grande économie de temps. Ceu x qu i son t intelligent s fon t<br />
des progrè s rapides, parc e qu'il s on t la faculté de passe r d'u n cercl e a u sui -<br />
vant j ceu x qu i on t moin s d'aptitud e metten t plus d e temps à surmonte r le s<br />
difficultés qu'ils rencontrent, mai s n e son t jamais découragés, parc e qu'on ne<br />
leur parle que des choses qui sont à la hauteur d e leurs connaissances acquises ;<br />
enfin, ceu x qu i s'absentent momentanément, soi t pour cause de maladie, soi t<br />
faute d e moyen s d'existence , peuven t reprendr e le s cour s o ù ils le s on t laissés<br />
, parc e qu'il s entren t dan s les cercle s o ù il s étaien t a u momen t d e l'in -<br />
terruption.<br />
Le term e moye n d u séjou r à l'écol e n'excèd e guèr e u n an , bie n qu e le s<br />
matières exigées pou r l'obtentio n du brevet d e capacité y reçoiven t d e grand s<br />
développements. Le s élève s maître s y trouven t d e plu s un e véritalil e écol e<br />
d'application , puisqu'ils n e peuvent êtr e admi s au x examen s qu'aprè s avoi r<br />
été moniteurs de tous les cercles.<br />
Quelques personnes , frappée s des résultats obtenu s par la simultanéité de s<br />
méthodes introduites dan s celte écol e e t pa r le mode en usag e pou r le s trans -<br />
mettre au x élèves , on t pens é qu e l'o n pourrai t e n fair e l'applicatio n ave c<br />
succès dans toutes les localités et dans tous les genres d'études . C e qu'il y a de<br />
certain, c'es t que cette méthode est , e n quelque sorte, indispcnsaljl e dan s les<br />
Basses-Pyrénées. I l serai t difficile, e n effet ^ d'obliger le s jeunes gens qu i s e<br />
destinent à l'enseignement à se rendre à un e époqu e déterminée ^ eux qui on t<br />
besoin d'attendre que leurs parents aient réuni le peu d'argent qui leur est nécessaire<br />
pour s'entretenir à Pau pendant quelques mois. D'ailleurs , sur cent élèves<br />
qui s e présentent, i l n e s'e n trouve pas quatre e n éta t de suivre un cour s gé -<br />
néral , o u qu i réunissen t le s connaissance s nécessaire s pou r l'admissio n à<br />
l'école normale. Faut-il les repousser de l'école, lorsqu'o n est convaincu qu'ils<br />
ne trouveraient pas encore, hors de cet établissement, le s moyens d'instruction<br />
dont ils auraien t besoin pou r y entre r ? Dan s cet éta t d e choses, l a commis -<br />
sion d e surveillanc e a cru devoir admettr e provisoiremen t le s plu s capable s<br />
de ceux qu i s e sont présentés, san s les dispense r toutefoi s d e l'exame n exig é<br />
par le s instructions, lorsqu'il s veulent êtr e admis définitivement et jouir de s<br />
bénéfices attachés à la qualité d'élèves de l'école normale.
MÉLANGES. 8-1<br />
C'est donc une ne'cessite' locale qui a fait naître le mode d'enseignement suiri<br />
par le directeur de l'e'cole. I l n' a été adopte' qu'après les e'preiive s les plus sa -<br />
tisfaisantes , e t ave c l'approbatio n d e M . l e recteu r d e l'acadcmi e e t d e l a<br />
commission d e surveillance . O n n'a pas espe're ' e n vai n qu e le s re'sultat s re' -<br />
pondraient à l'efficacité ' de l a me'tliode . L a grammair e française , l'analys e<br />
grammaticale e t l'analys e logiqu e compi'ise s ^ le dessi n line'air e appliqu é a u<br />
trace ge'ome'triqu e e t à l a mesur e de s surface s e t de s solides, l'arithme'tiqu e<br />
raisonue'e, y compri s l à the'ori e d u nouvea u systèm e de s poid s e t mesure s<br />
déduite d'observations astronomiques , l a théori e des progressions et des logarithmes<br />
, e t l'extraction de s racines à u n degré quelconque , l a géographi e e t<br />
la cosmographie, son t expliquée s dan s les cercles e t mi s e n pratiqu e pa r les<br />
moniteurs. L e chant , selo n l a méthod e Wilhe m , y es t ensei-gn é pa r l e<br />
même moyen . Le s cour s d'instructio n moral e e t religieuse, d'histoir e e t d e<br />
physique, y son t fait s pa r de s leçon s générales. L e premier d e ce s cour s es t<br />
professé par M . l'aumônie r du collèg e royal; i l a lieu-deux foi s par semaine<br />
à l a chapell e d e ce t établissemen t : les élèves l e suiven t ave c plaisir ; il s y<br />
sont sérieux, e t paraissent bien pénétrés de-son efficacité.<br />
L'école doi t continue r à êtr e un externat jusqu'au 'P''janvier 1836. Quoi -<br />
que , e n thèse générale, i l soit vrai de dire que cette organisation es t peu favorable<br />
à la discipline , à Pau , du moins, ell e n' a pas le s inconvénient s qu'ell e<br />
)ourrait avoi r ailleurs . Dè s qu e le s élève s son t admis à suivre le s cour s d e<br />
.'école, il s son t placé s dan s des maisons agréées par l'autorité locale , e t son t<br />
souvent visité s à domicile, soi t pa r le directeur, soi t par les maîtres-adjoints .<br />
Jusqu'à présent leur conduite n'a donné lieu à aucune plainte ; ell e leur a, a u<br />
contraire, attir é l a bienveillanc e de s autorité s locales , e t leu r a donn é a u<br />
dehors un e réputation telle, qu e les commune s qui manquent d'instituteurs s e<br />
disputent ceux qu i sortent de cette école.<br />
Il es t souven t arriv é que les demande s excédaien t le s admission s a u brevet<br />
de capacité, et , dan s c e cas, le s communes, qu i ne pouvaient êtr e satisfaites,<br />
attendaient jusqu'au prochai n exame n pou r n'êtr e pa s obligée s de se pourvoir<br />
ailleurs. L a dernière sessio n d e l a commissio n d'examen , e n 1834- , a dur é<br />
depiùs l e 1 8 décembr e jusqu'a u 24- ; su r 18 candidat s admis , 1 7 appar -<br />
tenaient à l'école. E n somme, ell e a fourni, depui s 1831;, plu s d e cen t ins -<br />
tituteurs intelligents , qu i exercent leurs fonctions à l a grand e satisfaction de s<br />
pères de famille. Ce s résultats ne sont pa s le s seul s qu e cette école ait obtenus .<br />
Quelques légère s prévention s s'étaient élevées contr e ell e de la par t de l'autorité<br />
ecclésiastiqu e : non seulement l'écol e est parvenue à les fair e cesser, mai s<br />
déjà ies instituteurs sortis de son sein sont recherché s par MM. le s desservants<br />
du département, e t il règne entre eux la plus parfaite intelligence.<br />
Q.
84. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
BULLETII^ BIBLIOGRAPHIQUE ,<br />
1.<br />
Premières connaissances, ym Théodor e Soulice, sous-clie f Je burea u a u mi -<br />
nistère de l'instruction publique , membr e d e la société pou r l'instructio n élémen -<br />
taire. Ouvrag e recommand é pour les écoles primaires pa r le Consei l royal d e l'Uui -<br />
•versité ; 3 ® édition, i vol . in-'l8. Paris, 483^1 . chez L . Hachette, ru e Pierre-Sarrazi u ,<br />
n" '12 . Prix broché 2 0 cent., e t cartouné , 25 cent .<br />
L'approbation d u Conseil royal de l'Universite' est l a meilleure recomman -<br />
dation qu'o n puiss e fair e valoi r e n faveur de ce t ouvrage . Dan s u n peti t<br />
norahrede pages, il renferme beaucoup de choses utiles dont la connaissance ne<br />
pourra qu'inspire r au x enfants le de'si r d'en acquéri r d e plus e'tendues . Il est<br />
divise' en 7 chapitre s , don t l e 1 donn e un e idée succinct e d e Die u , d e l a<br />
religion e t d e l a moral e ; l e â", de s cin q sens, d e leur s organe s e t de s sen -<br />
sations ) l e o", de s noms de nombre, des chiffre s , d u calcu l suivi de la table<br />
de multiplication ; le A", du temp s e t de ses parties , de l'anne'e , de s saison s ,<br />
des moi s e t des jour s ) l e 5 ° et le 6° contiennent l a descriptio n général e d e<br />
l'univers , astronomie , corp s ce'lestes , l e soleil, le s étoile s , les planètes , le s<br />
comètes , l a lune , les principalix . phénomène s athmosphériques , le s nuages,<br />
la pluie , l a rose' e , l a neige , l e vent ^ le s éclairs, l e tonnerr e , la terre , le s<br />
points cardinaux, l'ea u , le s grandes parties de la terre caractérisées pa r leui-s<br />
principales productions e t par leurs habitants j enfi n le 7 " donn e de s notions<br />
sur les troi s règnes d e l a nature , le s ressource s qu e l'homme y trouv e pour<br />
les besoins de la vie, le s arts e t métiers, les métaux , les monnaies e t les poids<br />
et mesures .<br />
2.<br />
Leçons éldmenlaires , méljiocliques et pratiques de grammaire française, pa r<br />
M._ A. ïhiel, membre ducomité gratui t pour l a surveillance et encourageme'ut de l'en -<br />
seignement primaire, professeu r au collèg e royal d e Metz , et à l'école normale pri -<br />
maire d e l a Moselle , membr e d e l'académi e royal e d e Metz . ' I vol . iu-'12 . Prix ,<br />
cart. , 4 fr. Che z Thiel , librair e ; e t â Paris, olït z L . Ilaclielle. 5 = édition (-1) ,<br />
revue et considérablemen t augmentée .<br />
On lit entêt e d e celt e nouvelle éditon :<br />
« EXTRAI T D'UN E LETTR E D U MIKISTH E D E L'INSTRUCTIO N PUBLIQUE .<br />
l'aiis , l e 7 ma i i833 .<br />
; L e Consei l royal , dan s s a séanc e du 2 G avril, a pris l a délibératio n<br />
suivante, qu e j'a i revêt u d e mo n approbatio n : le Conseil royal ddcide que<br />
les leçon s élémentaire s d e grammaire française de M' ' Thiel sont admises pour<br />
l'usage des classes élémentaires<br />
Pour l e Ministr e : -<br />
le conseiller, vice-présiden t<br />
YILLEMAIÏÎ.<br />
Pour se rendre de plus e n plu s digne des honorables suffrage s que son tra -<br />
(4) Voi r l e compte rend u d e l a deuxième édition , dan s le numéro d e janvie r d u<br />
Manuel ge'n&al, p . 4I H e t p. 5 .
BULLETIN BIBLIOGRAPfflQUE . 8 5<br />
vail consciencieiiTî : lui a valus, l'auteu r a revu son ouvrag e tou t entier, il y a<br />
fyit de s cliangeracnt s et clos addition s considérables . « j'ai lâche' , dit-il, d'é -<br />
claircir plusieur s point s et, e n particidier , c e qu i concern e l a nature e t le s<br />
règles de s participes , l'emplo i d e l'indicati f et d u subjonctif . J'a i parle' de s<br />
degrés de qualification dans les adjectifs, de s compléments ge'ne'raux , du compellatif<br />
j enfi n j'a i donne ' au x observation s particulière s su r cliaqu e espèc e<br />
de mo t l e de'veloppemen t qu e re'clamen t le s nouveau x progrè s d e leurs tra -<br />
ductions éle'mentaires. »<br />
Nous avon s e n effet remarque' dans cett e '5 " e'dition d'importante s ame'lio -<br />
rations , e t nous nou s faisons u n Véritabl e plaisir d e les signale r : mai s notr e<br />
devoir d e critiqu e nous oblig e à dir e qu e tout n'es t pas fai t encore, e t qu e<br />
l'auteur aura, dan s les e'dition s subse'quentes , beaucou p à retouche r e t à rectifier.<br />
Pourquoi ^ pa r exemple, nou s donne r comm e règle géne'ral e que les ad -<br />
jectifs en ais e t e n os doublent a u fe'minin la consonne finale avan t d e recevoir<br />
l'e muet, mai s mauvais, mais frais, anglais, français e t tutti quanti; clos,<br />
éclos, etc . n e peuven t suivre cett e règle , qu i n'es t fait e qu e pou r deu x ad -<br />
jectifs , éj}ais e t gros : tou t grammairien doi t s e garder avant tout d e prendre<br />
l'exception pou r l a règle , surtou t quan d i l n' y a qu'un e seul e exception .<br />
L'auteur s'est encor e trompe' à la pag e 40, ( orthograph e de s verbe s ) j il pre'-<br />
tcnd que la troisièm e personne des verbes e n pre, s e termine pa r p. a u pre'sent<br />
de l'indicatif: i l romp. San s doute , dira-t-il , d e même qu e nous conjuguon s ,<br />
je rends, tu rends, il rend; nou s devon s dire auss i : je romps , tu romps,<br />
il romp. C e serait l à d e l'analogi e d e mots, tandi s qu'e n pareille matière,<br />
c'est l'analogi e de s son s , l'analogi e de s lettres , de s finales, qu i doi t nou s<br />
guider : Or, d'après ce principe, i l faut e'crir e : il rompt , ains i que nou s e'crivons<br />
prompt.<br />
Pourquoi maintenan t n'e'crivons-nous pa s il rendt ? c'es t qu'i l n' y a pas<br />
un seul mot dans notre langue, ains i orthographié ; c'est, e n second lieu , qu e<br />
devant un e voyelle , l e a l e so n du t, e t alor s cett e dernièr e lettr e serai t<br />
tout-à-fait inutile. Puisqu e nou s e n somme s su r ce chapitr e , nou s ferons re -<br />
marquer à M. Thiel, qu e tou s le s verbe s en dre n e terminen t pas , comm e<br />
il l'avance, leu r dernièr e syllab e pa r u n d : il e n faut excepte r tou s ceu x<br />
qui ont le participe en int : ainsi, joindre , plaindre, peindre, fon t : i7joint,<br />
il plaint, il peint ; e t ce s même s verbe s ont déjà perd u le à la première personne.<br />
Absoudre , dissoudre, résoudre, s e conjuguent égalemen t san s cett e<br />
lettre.<br />
Nous aurions encor e à faire bien de s observation s d e détail, qu i ne seraient<br />
peut-être pas sans quelque utilité pou r nos lecteur s : mais obligés de nou s renfermer<br />
dans des bornes raisonnables , nous avons hâte d'arriver à quelque chose<br />
de sérieux, d e plus intéressant.<br />
Y a-t-il réellememen t u n passi f dan s les langues analytique s , ( les idiomes<br />
modernes sont à peu près tou s de ce genre )? C'es t une grand e question : elle a<br />
déjà été traité e dans c e journa l et résolue par la négative. Mais , e n admettan t<br />
qu'il n'y ai t à ce suje t aucun e décision, e n concédant mêm e qu'il y a en français<br />
un passif ou quelqu e chos e qu i y ressembl e e t en tient lie u , o n n e serai t<br />
pas amené par là mêm e à reconnaîtr e une voix passive. Effectivement , aucun e<br />
langue n' a l a voi x passive , ca r l e passi f n e peu t s'exprime r qu e pa r u n<br />
auxiliaire et un participe.<br />
Qu''cst-ce qu^o n appelle voix e n terme d e grammaire ? vois signifi e son}
86. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
de là l e So m de voyelle donn é à un e espèc e d e lettres. D'aprè s cette de'linition,<br />
voi x activ e signifi e l e son , le s finales, l a terminaiso n qu i annonc e<br />
l'actif, l a significatio n activ e : par l a mêm e raison , voi x passiv e veu t dir e<br />
terminaison qui fait connaître la signification passive. Ains i e n latin.<br />
Am-o. J'aime .<br />
Am-as. T u aimes.<br />
Am-or, J e suis aime'.<br />
Am-aris. T u e s aime' .<br />
Les terminaison s e n o, as, nou s fon t voi r u n verbe actif ; or, ans nou s<br />
annonce tout l e contraire, l e passif : le radical , am n' a e'prouv é aucun e modification<br />
:<br />
Mais, dan s ces phrases françaises :<br />
Le ministre a proposé c e projet :<br />
Ce proj et a été proposé pa r le ministre.<br />
Quel es t le . son, quell e es t la vois , quell e es t la modification d e l a dernière<br />
syllabe qui fasse entendre qu e la premièr e phrase es t à Y actif e t la se -<br />
conde au passif?<br />
Cependant, M . Thie l n'adme t pa s seulement un passi f en français ; mais il<br />
reconnaît e t enseign e l a voix active et la voix passive . S i du moins i l s'e n fût<br />
tenu là , ce ne serait qu'une erreu r qu e l e grand nombre de ceux qui la partagent<br />
rendrai t excusable. Mai s l e moye n d e s'arrêter e n si bea u chemi n ! M.<br />
Thiel a donc été conduit à ajouter la voix moyenne à la voix active e t à la voix<br />
passive, e t c'est l à un non-sen s , pou r ne pas employe r u n terme plu s désobligeant;<br />
l e lati n mêm e n'a pas d e voi x réfléchie ^ bien qu e quelque s un s de s<br />
verbes dcponens , tel s qu e invehi et pasci , soien t d e véritables verbe s réfléchis<br />
pou r le sens , d e véritable s verbe s moyen s ; mai s le s forme s son t le s<br />
mêmes que dan s les deu x autre s voix, e t alor s pas de voix particulière . L e<br />
grec au contraire , offr e des désinences spéciale s pour ces sortes de verbes a u<br />
moins à certains temp s ^ e t voil à pourquoi , e n grec , o n reconnaît un e voix<br />
moyenne. Nou s avon s u n autr e point à examinei\ Dan s le s verbe s français ,<br />
il exist e deu x participe s , aimant, aimé, o n es t convenu d'appele r le pre -<br />
mier part, présent , e t ici M. Thie l n' a point innov é ; comm e tout le mond e ,<br />
il reconnaî t un particip e présen t -, ici don c jwin t de difficulté. I l n'e n es t pas<br />
de mêm e d u particip e àimé ; l'auteu r y trouv e tantô t u n particip e passé,<br />
ayant aimé, tantô t u n particip e passif; aimé, fa i aimé, je suis aimé ;<br />
il y a erreu r évident e su r ce point ; ca r commen t le s participe s aitné, fini,<br />
pourraient-ils être passif s dans f ai fini, j'avais aimé, puisqu e ces temps appartiennent<br />
exclusivemen t à la conjugaison active ? De plus, si, par impossible,<br />
c'étaientde véritables participes passifs, dan s les exemple s ci-dessus , i l fau -<br />
drait aussi conveni r qu e àm'Bj'ai dormi, je suis allé, le s participe s dormi,<br />
n?/e,sont auss i participe s passifs , c e qu i n e serai t pa s soutenable ; c e<br />
que M . Thie l s e gard e bie n d'avance r ; mai s alors , nou s dir a l'auteu r ,<br />
quelle dénomination employe r ? Si je désign e ce participe sous le nom vulgaire<br />
de particip e passé, je m'exprim e trè s inexactemen t ; ca r i l es t impossible ,<br />
par exempl e d'apercevoi r u n participe passé dans je suis aimé e t encore bien<br />
moins dans je serai aimé.<br />
Nous répondrons d'abor d qu'i l n e faut pas que<br />
La craint e d'u n défaut nous iett e dans un pire .
BULLETIN BIBLIOGRAPfflQUE . 1534<br />
et qu'i l n e faut jamai s quitle v le s sentier s battu s qu' à bonn e enseign e et en<br />
parfaite connaissance d e cause; qu'i l ne fau t innover ou suivi' e les novateur s<br />
que quand i l es t bien prouvé, rigoureusemen t démontré' , qu'i l y a de grands<br />
inconvénients à suivre l'usage e t d'incontestables avantage s à adopter quelque<br />
chose de nouveau.<br />
Continuons don c à dire particip e passe' , tan t qu e nou s n'auron s rie n d e<br />
mieux à substituer à cette dénominatio n , e t pour e'vite r un e légèr e inexacti -<br />
tude , ne nous jetons pas dans une erreur plus grave .<br />
Allons plus loin , puisque nou s avon s ét é appel é sur ce terrain ; e t voyon s<br />
si ce s pauvre s grammairiens , qu e l'o n accus e aujourd'hu i s i souvent , son t<br />
dans leur tort, à c e sujet.<br />
Ceux quij che z nous, s e son t les premiers occupé s d e grammaire, prenan t<br />
pour point d e départ le s langue s savantes, on t dû nous gratifie r d'un participe<br />
futur , qu e notre idiome n e possède pas . Entr e l e particip e présen t et le<br />
participe futur venait se placer nécessairemen t e t forcément le particip e passé<br />
et cela était d'aulantplus raisonnable que, la plupart du temps^ ce participe désigne<br />
effectivemen t un temp s passé. Cel a seul pourrai t suffir e , c e semble ^<br />
pour la justification des grammairiens.<br />
Mais pénétron s plu s avan t dan s l a question , puisqu e réellement elle n'es t<br />
pas sans importance et qu'elle est vivement débattue depui s quelque s années .<br />
Dans les verbes actifs, les verbes neutres et les verbes réfléchis, ce particip e<br />
marque toujour s le pass é (1) . Seulemen t dan s c e qu'on appell e l e i l<br />
sert, combin é avec le verbe être , à marquer tantôt le présent, tantô t la futur,<br />
le plus souvent encore le paMe^ mais d'abord tout l e monde n'admetpas Itpassif<br />
: et poiu'les personnes qu i le rejettent, aimé, frappé, etc . ne son t qu e des<br />
adjectifs verbau x , essentiellemen t dépendan t d e c e qui le s entoure . Qu e si<br />
on regarde le passif comm e appartenan t incontestablemen t à notre langue , i l<br />
faut encore conveni r qu e dan s le passif , aimé, frappé, reçu, n'exprimen t<br />
aucun temps par eux-mêmes, et qu'ils sont entièrement, sous ce rapport, subordonnés<br />
au verbe être , qui seu l reste charg é d e rendre les différences de temps<br />
et de-personnes.<br />
Ainsi, e n examinant ce s choses attentivement , l e particip e passé, est, o n ne<br />
peut mieux, o n ne peut plus exactement , plu s heureusement dénommé , soi t<br />
qu'on reconnaisse u n passif à notre langue, soi t qu'o n le rejette . Il n' y a don c<br />
pas lieu d'accuse)' les grammairiens ^ il n' y a donc aucun e raison de cherche r<br />
une dénomination nouvelle .<br />
Toutes ce s observation s n'empêchen t pa s que le livre d e M . Thie l ne soit<br />
un bon ouvrag e e t sa méthod e excellent e : mais il lu i reste beaucoup à rectifier,<br />
à retoucher, à augmenter. Ave c le zèl e dont il a donné tant de preuves, ,<br />
avec des études plus approfondie s dans son art, il viendra facilement à bout d e<br />
cette tâch e qu i ser a auss i honorable pou r lui qu e profitable à l'enseignement.<br />
3.<br />
Exercices orthographiques, o u métliode simpl e e t facil e Je créer , san s avoi r re -<br />
(•I) C e serai t subtilise r outr e mesur e qu e d e prétendr e que , Jaii s certains cas, il<br />
marque l e futur, comme daii s cette plirate : ayant fini ce t ouvrage,' j'e n entrepren -<br />
drai u n autre . Ce s exemple s son t asse z rares , el, déplus , l e particip e annonc e<br />
encore ici l e passé, a u moin s relativemen t ; c e n'ei t don c pa s l a pein e d'e n fair e<br />
une exception .
88. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
cours à la cacographie , Forlhographe du mot qui es t l'objet d e la règle don t chaqu e<br />
exercice es t précédé , pa r A . Cliampalbert , professeu r d e grammaire . Paris , Ha -<br />
chette , libraire , ru e Pierre-Sarrazin , n" -1 2 ; Poillenx , quai de s Augustiu s , n" 5 7 ;<br />
Chamerot, mêm e quai, n " -1 3 ; Nancy , Vidar t e t Julieu , libraire s . — '183 ^ : Troi -<br />
sième édition .<br />
Les suffrages de ceux qui ne sont pas partisans de s cacographie s et des cacologies,<br />
son t acquis d'avance à l'ouvrage qu e nous annonçons ; pa r conséquent ,<br />
il n e peut manque r d'avoi r un succès toujour s croissant . O n pourrait de'sire r<br />
cependant qu e le s suppression s portassen t exclusivemen t su r le s syllabe s<br />
qui s e rapportent à la règle qu'o n veu t enseigner : o n pourrait de'sire r encore<br />
que l'auteu r revin t plu s souven t su r se s pas, pa r de s récapitulations , don t<br />
la ne'cessite ' n' a pa s besoin d'êtr e prouvée à ceux qu i on t quelqu e expe'rienc e<br />
de l'enseignement . E n somme , nou s dirons qu e l e travai l d e M . Ghampal -<br />
bcrt nous a paru rationnel , inge'nieu x même : il n e peut donc manquer d'être<br />
utile. Voic i comm e l'auteu r s'exprime, e n annonçan t cette nouvelle édition .<br />
« L a première e'ditio n de s exercice s orthographique s ayan t e'te ' favora-<br />
« blemen t accueillie , j'e n publiai un e seconde, où , selo n l'avis d e plusieur s<br />
« homme s instruits , je cru s devoir fair e sentir la liaison de s différente s par-<br />
« tie s d u discours, démontrer l'identité de plusieurs d'entre elles , et prouver<br />
« qu e la grammair e est , no n un chaos de règles abstraite s , mai s la première<br />
« de s sciences exactes e t l'acheminement naturel à toutes les autres. La plupart<br />
« de s instituteurs goûtèrent ce plan; quelques uns même daignèrent avouer qu e<br />
« mo n ouvrage ne leur avai t pa s ét é inutile ; mais , e n général, o n l e trouv a<br />
« tro p abstrait pour l'âge auquel i l était destiné. Dan s cett e 5 ° édition, je m e<br />
« sui s appliqué à simplifier l'énoncé de s règles e t à multiplier le s exemples.<br />
« Ains i chaque exercic e sera précédé d'une règle exprimée en peu de mot s e t<br />
« facil e à comprendre.<br />
4.<br />
Traité tics traites des participes français, suiv i de remarque s sur le s sentiment s<br />
de quelques célèbres grammairiens qu i ont traité cell e matière, ctde plusieur s exer -<br />
cices sur l'accord di' s ailjeclirs vi-rl)aux e l de s ]nu licipes présents e t passés ; à l'usag e<br />
des maison s d'éducatio n de s deux sexe s e t tie s école s ]>rimaire. s d e France, ains i<br />
que de s personne s qu i n'on t pa s fai t d'éUidi-s; jia r J. li . Nciëllat père , ancie n pro -<br />
fesseur e t membr e d e l'Universil é royale . Paris , che z Uoret , libraire , ru e Haute -<br />
feuille, a u coin d e la ru e du Battoir , e t aux bureau x d u Journal de s Connaissance s<br />
utiles, ru e des Moulins, n " 18 . 183^ . Prix, - 1 f'r. 25 c .<br />
Après un e courte préface, dan s l.-iqucll e i l expos e l e bu t e t l e pla n d e son<br />
ouvrage, M . Noella t donire succinctement quelque s notion s préliminaire s su r<br />
le verb e en général, su r les (.lilï'rcnte s sortes de verbes, su r la place d u suje t<br />
et de s régime s direct s e t indirects . 1 1 passe ensuit e à so n obje t spécial , le s<br />
participes, qu'i l a divisé s e n quair e c lapitrcs. L e premier trail e d u participe<br />
présent ; i l établit , pa r un e règl e générale , un e lign e d e démarcatio n<br />
entre l e participe présent e t V adjectif verbal ; i l donn e ensuit e l a list e de s<br />
verbes don t l e pariicip c présen t es t l e plu s généralemen t susceptibl e d'êtr e<br />
employé comm e adjecti f verba l ; pui s i l cit c u n certai n nombr e d'entr e eu x<br />
dont le sens est le plus difficile à saisir, e t est terminé pa r une courte observa -<br />
tion su r l e gérondifs qu'i l n e considèr e qu e comm e u n particip e présent ,<br />
précédé d e en.<br />
Le deuxième traite d u participe passé ; il indiqu e les cas où c e participe,<br />
conservant s a dénomination , doi t êtr e invariable, e t ceu x où , prenan t l a
BULLETIN BIBLIOGRAP fflQUE. 8 9<br />
dénomination i'adjectif verbal, i l doi t êtr e variable; i l fait ensuite la même<br />
distinction pou r le s participe s suiri s d e l a pi-e'positio n à o u de e t d'u n infi -<br />
nitif, e t pou r ceu x qu i son t suivis immédiatement d'un infinitif; pui s i l<br />
passe awX verbes auxiliaires, auxquel s i l a joute l e verbe/aire , au x verbes<br />
d'état, au x verbes d'action o u transitifs-directs, transitifs-indirects,<br />
intransitifs, réfléchis et réciproques, e t au x verbes impersonnels ; i l ter -<br />
mine par des oEservation s su r le participe actif employe ' impersonnellement .<br />
Le troisième es t la récapitulation d e la syntaxe du participe passe' j i l e'tabli t<br />
les règles générale s d e c e particip e , employe ' sans auxiliaire , join t à l'auxi -<br />
liaire être o u avoir, e t d e celu i de s différent s verbes re'fle'chi s , selo n le s di -<br />
verses positions dans lesquelles c e particip e s e trouv e employe' .<br />
Le quatrièm e contien t l a solution - des principale s difiiculte' s que peut pre' -<br />
scnter l'emplo i d u participe passé suiv i d'u n infinitif , e t particulièremen t<br />
des participe s fait e t laissé ; i l es t termine ' pa r douz e exercice s propre s à<br />
mettre le s élève s à mêm e d e fair e l'applicatio n de s règle s établie s pou r le s<br />
participes pre'sent et passé dan s leurs différente s acceptions .<br />
Dans c e dernie r chapitre , l'auteu r discut e l'opinio n d e plusieur s gram -<br />
mairiens don t i l n'approuv e pa s le s principes j il fai t lui-même l'observatio n<br />
que le s élève s pourron t s e contente r d e lir e attentivemen t c e chapitre , le s<br />
autres contenan t des règle s suffisantes pour résoudre le s question s qu i s e trou -<br />
vent dan s celui-ci .<br />
On désirerait des exemples mieu x choisi s , e t peut-êtr e , dan s u n trait é qu i<br />
ne serai t pa s déplac é entr e le s main s de s jeunes gens , aurait-o n p u néglige r<br />
cette citation de Boinvilliers :<br />
« S i vous versez de s larme s de sang sur le sein d'un e épous e qui s'est laissée<br />
« violer pa r des monstres, pour vou s sauve r l a vie , accusez-e n les athées qu i<br />
« on t bouleversé la terre . »<br />
Le styl e n'es t pa s no n plu s toujour s asse z correc t j témoi n cett e phrase ,<br />
lirée d e l a mêm e pag e (99) : D'où vien t don c que , jusqu' à présent, l a gram -<br />
maire ne nous donne-f-eZ/e pas une règle générale?.. .<br />
8.<br />
Nouvelle géographie e'iemenlaire, rédigé e sur lu i plan méthodiqu e , et mise à la<br />
poitée de.senfautà ; pa r Méric , principal . Paris , ISSiJ . Che z Faucheux , libraire ,<br />
nie de s Deiix-Ponts, n " 12. Prix ^ fr. 25 c.<br />
« Le s ouvrage s qu i s e parent d u titr e de Géographie élémentaire n e l e<br />
« justifien t pa s , di t l'auteur dan s son avertissement... . Il s surabondent, dè s<br />
« l e débu t même , e n détail s minutieu x et arides Le s préliminaire s d e la<br />
« scienc e n' y consisten t qu e dan s u n échafaudag e d e mots, o u dans de s ex -<br />
« plication s d e chose s qui n e sont n i claires , n i exacte s , n i complètes , n i<br />
« méthodiques . L e gran d défau t de ce s livres, c'es t de ne pa s être à la portée<br />
« de s enfant s et de supposer en eu x de s connaissances et une intelligence qu'il s<br />
« n'on t point . » D'aprè s s a manière devoi r , prenant une marche qu'il trouve<br />
plus rationnelle, i l fai t partir l'enfan t du pays qu'il habite et qu'il connaît<br />
, pour lui expliquer , dan s le 1 chapitr e , comment il existe beaucoup<br />
d'autres pays comme le sien, et comment l'ensemble de tous ces pays<br />
forme un vaste globe qu'onnomme L A TERRE.,I l lu i fai t connaître, dan s<br />
leâ'etleS'^, so n mouvement ets a surface^ dansle^-", le s dénonciations affectées<br />
à quelque s formes de l a terre et des eaux , le s montagnes, le s cour s d'eau , les
90. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
îles , continents , arciipels , caps , etc . I l lu i donne ensuit e la de'finitio n de la<br />
terre , pui s des notions sur le s globes.et carte s géograplùques . L e chapitr e<br />
contient l a divisio n du glob e terrestre : Le s 8% 9 % 10% 11 e t 1 S" traitent de<br />
l'Europe, d e l'Asie, d e l'Afrique^ de l'Ameriqu e e t de l'Oceani e don t ils de' -<br />
. signent les bornes , le s contre'es, les mers et golfes, îles, montagnes , plateau x ,<br />
volcans, etc . L e 15 " contient des considération s générale s sur le s peuple s e t<br />
sur le s e'tat s ; l e 1les principau x e'tat s des différente s partie s d u glob e e t<br />
leurs capitales -, le 1 S", les point s et cercles important s d u globe . Enfin le i 6°<br />
contient la géographi e d e l a France, qu i est , di t l'auteur , en dehors de son<br />
ouvrage e t qu'il donn e soit comme appendice utile, soit comme commencement<br />
obligé, selo n lui , de tout développement ultérieur ; car il y aurait<br />
quelque ridicule à visiter le pays des autres avant de connaître le sien.<br />
Au fond, le s éléments de géographi e de M . Méri c son t les mêmes que ceux<br />
des autres géographies élémentaires j l'ordr e seu l est changé , e t l'o n n e voi t<br />
pas tro p qu e les définitions ^ pou r arrive r u n pe u plu s tard ^ soient beaucoup<br />
plus claires , plu s exactes, plus complètes e t plus méthodiques .<br />
6.<br />
Eléments de Chronologie, pour servir d'introduction à Vétude de Vhistoire ,<br />
par M . Théodore Soulice , auteu r d e plusieurs ouvrage s d'éducation . 4 vol . iii-'18 .<br />
Paris, '183(1 . Prix broché, H sous, e t cartonné 5 sousjParis, cliezL . Hachette , ru e<br />
Pierre-Sarraziu, n " -12 .<br />
Ce petit ouvragedivisé e n 12 chapitres donnera aux enfants dos notion s pré -<br />
liminaires qu i pourront leu r être, plu s tard ^ d'une grand e utilité , e t qu i son t<br />
exprimées d'une manièr e claire , à la porté e d e leu r intelligence . I l leu r fer a<br />
connaître : 1 " la signification des mots chronologie e t temps, e t les différente s<br />
divisions d u temp s ; le s diverses dénomination s de l'année ; 5 ° les chan -<br />
gements qu' a éprouvé s l e calcndi'ie r depui s Romulu s jusqu' à no s jour s j<br />
l'origine de s noms donnés au x mois et au x jours d e l a semaine j 5 ° l'ex -<br />
plication de s mot s siècle , luslre, olympiade et indiction ; 6 ° cell e de s<br />
cycles, d u nombre d'or, de s lettres dominicales et de s épactes ; 7 ° cell e<br />
des mot s époque , ère et période ; 8 ° les événement s le s plu s remarquable s<br />
do l a lpériode depui s la création jusqu'au déluge j 9 ° ceux d'un e parti e d e<br />
la période , depui s l e délug e jusqu'à la constructio n d u templ e d e Jérusalem<br />
pa r Salomon ; \ 0° ceu x d u rest e de la période , jusqu'à la naissance de<br />
Jésus-Christ; 1 1 "ceux d e l'histoire modern e depuis l a naissanc e d e Jésus -<br />
Christ jusqu'à l a fin d u 10" siècle , époqu e de l'avènemen t de la dynastie des<br />
Capétiens a u trône de Franc e ; 1enfi n ceu x qui son t compris dan s l'espac e<br />
ccoulé depuis cette époqu e jusqu'à nos jours.<br />
7.<br />
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire universelle , pa r M , l'abb é Daniel ,<br />
proviseur d u collèg e royal de Caen, membr e de la légio n d'honneur e t de plusieurs<br />
sociétés savante s , ouvrage adopt é pa r l e Consei l royal d e l'instruction publique .<br />
r'= partie . édition-Pari s , chev/L . Hachette , ru e Pierre-Sarrazin , n" ÎS. Paris ,<br />
•18311. Prix , br. 6 0 cent., e t cart. 7 0 cent.<br />
L'auteur, dan s s a préfac e ^ expose e n pe u d e mots le bu t e t l'utilité d e so n<br />
ouvrage, e t le s motifs qui l'ont détermin é dan s le choi x d e l a march e qu'i l a<br />
suivie. Dan s u n premier article , qu i réuni t le s dix-sep t premier s siècle s de »
BULLETIN BIBLIOGRAPfflQUE . 9 1<br />
puis la créatio n , il rapporte succinctemen t les trois grands fait s qu e pre'sente<br />
celte pe'riod e ^ l a création, l a clmt e d u premier homm e e t l e déluge . I l par -<br />
court ensuite , siècl e pa r siècle , jusqu' à Auguste, le s annale s du monde ; i l<br />
rapporte les événements les plus remarquables qu i sont arrivés che z les différents<br />
peuples, l a formatio n de s gouvernement s e t l'origin e de s nation s di -<br />
verses qui ont successivement paru , e t fait connaître les progrès et le développement<br />
de la civilisation . Il désigne à chaqu e époqu e le s personnage s qu i se<br />
sont distingués et les rnonuments qui se sont élevés.<br />
Ce petit ouvrage est une introduction utile à l'étude de l'histoire, don t il est<br />
un appendice sommaire.<br />
8.<br />
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire universelle, à l'usag e de s collège s e t<br />
autres maisons d'éducation ; pa v M . l'abbé Danie l , pi-oviseur d u collèg e roya l d e<br />
Caen , membr e d e plusieur s société s savantes . 2 ° partie . 2 ° édition. Pari s , 4 8211.<br />
chez L. Hachette, rue Pierre-Sarrazin, n ° 42 . Pri x , br. 6 0 cent. , et cart. 7 0 cent .<br />
Cette seconde parti e renferm e les cin q premier s siècle s d e l'ère chrétienne.<br />
Les première s pages son t consacrée s au récit sommaire de la naissance , d e la<br />
vie, d e la mort de Jésus-Christ et de l'établissement d e la religio n chrétienne .<br />
L'auteur donne ensuit e succinctemen t l'abrégé des principaux événement s ar -<br />
rivés pendan t le 1 siècl e , sou s le s différent s empereur s romain s qui se sont<br />
succédé -, puis il rapporte ceux qui eurent lie u dan s l'Ind e e t e n Chin e , pen -<br />
dant le même temps; enfin , il fait l'énumération de s découvertes, de s progrès,<br />
des sciences et des arts, e t désign e les personnages célèbres de cette époque. Il<br />
suit l a mêm e march e pou r le s 3° , i' e t 5 ° siècles . Cett e dernièr e parti e<br />
contient le s commencement s d e l a monarchi e français e e t finit e n .496 , a u<br />
baptême de Clovis^ e n indiquant ce qu'étaient, avan t lui, le s rois francs.<br />
L'ouvrage es t suiv i d'un e tabl e des matières, divisée , d e même, e n cin q<br />
parties, dont chacune contient un siècle, e t terminée par une seconde table^ par<br />
questions ^ divisée également par siècle.<br />
9-<br />
HisLoire abrégée des principales inventions et dêcouveHes faites en Europe depuis<br />
l'ère chrétienne jusqu^au XIX siècle, parti . Roux-Ferran d ; S ® édition. 1 vol.<br />
in-IS. Paris , chez L . Hachette, ru e Pierre-Sarrazin , n " 12 . Pri x , broché , 9 0 cent .<br />
« L'histoir e , di t l'auteur, n'es t pas tout e dan s les faits, dan s le réci t de s<br />
» événements ; ell e est aussi dans les progrès d e l'industrie e t d u commercé .<br />
» Un e inventio n , un e découverte, un e industrie nouvelle on t souven t influé<br />
» su r la destinée d'un empire ; la transportation d'une plante comm e la vigne,<br />
» d'u n insecte comme le ver à soie, o u d'un simple procédé agricole , es t suf-<br />
» fisante pou r change r le sor t d e toute un e population. »<br />
Après ce court début qui fait connaître le but qu'il se propose, i l entr e tou t<br />
de suite en matière ^ et, aprè s quelques explication s sur la naissance et les progrès<br />
de la civilisation ^ i l passe en revue, dan s les 14 chapitre s qui composent<br />
son ouvrage, le s invention s e t découverte s faite s dans chaque siècl e ; il fai t<br />
connaître le s circonstance s qu i les on t amenées, e t e n indique le s avantage s<br />
ou l'utilité. C e peti t recueil de notions curieuse s e t intéressante s es t termin é<br />
par u n coup d'œil rapide sur le dix-neuvième siècl e dont les première s années<br />
donnent lieu d'espére r de nouvelles meiTeille s e t ne laissen t à personne l a fa -
92. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
culte d e devine r quelles ressource s nouvelles la science doit donner à l'homme<br />
dans les siècle s qu i suivront .<br />
Il n'es t pas inutil e de rappeler à no s lecteur s qu e M. Roux—Ferrand , déj à<br />
si avantageusemen t conn u dans le monde litte'raire par des ouvrages d'un ordre<br />
plus sérieux , es t en même temp s u n de s hommes les plu s zélés pour la propa -<br />
gation d e l'instructio n primaire , e t que le département du Gard lu i doi t plu s<br />
particulièrement quelqu e reconnaissance sous ce rapport.<br />
10.<br />
Talleau de VHistoire du Bas-Empire, d'aprè s Lebea u , Gibhon et l'iir f d e vérilici'les<br />
BULLETIN BIBLIOGRAPfflQUE . 9 3<br />
5» jusquà nos jours. Chacun e d e ce s troi s subdivisions contien t c e qu i es t<br />
an'ive d'importan t pendan t l a pe'riod e qu'ell e embrasse ; o n voi t , surtou t<br />
dans l a troisième , l e rôl e remarquabl e qu' a joué l a Champagn e pendan t l a<br />
révolution e t sous l'empire.<br />
L'ouvrage es t termine ' pa r u n préci s géographique , qu i contien t des no -<br />
lions essentielle s su r l a position , l a statistiqu e e t le s localité s d e cett e pro -<br />
vince ^ sur le s production s e t l e plu s o u moin s d e fertilité ' de s pay s qu i l a<br />
composent. ^<br />
12.<br />
Précis de l'histoire de Bourgogne et de Franche- Cotnlè, pa r M . F. Ragou , professeur<br />
au collègeBourboa . - 1 vol. ia-IS. Paris,1833 - Che z L . Hachette, ruePierre -<br />
Sarrazin, n" 12. pri x broché, 7 5 c.<br />
L'auteur, dan s un court avertissement , expos e le but e t l'utilité' d e ce petit<br />
ouvrage qu'il dédie à la Bourgogne , s a province natale. Il es t divisé en 6 épo -<br />
ques : la 1 depuis Vétablissement des Bourguignons dans les Gaules<br />
jusquà la conquête du royaume de Bourgogne par les Francs, donn e<br />
des renseignements su r les anciens habitants ^ l'origin e , le s mœur s de s Bourguignons^<br />
le s principau x événement s e t le s usage s d e eett e époque : l a S® ,<br />
depuis cette époque jusqu'aux ducs bénéficiaires, indiqu e le s changement s<br />
survenus, le s établissement s institué s e t diver s usage s admi s dan s c e temps :<br />
la 5" , la, Bourgogne sous les ducs bénéficiaires , rapport e égalemen t le s<br />
faits le s plu s remarquable s e t indiqu e c e qu'étai t alor s l a Franche-Comté :<br />
la la Bourgogne, duché-pairie, sous les ducs de la première race<br />
royale. —la Franche-Comté, pendant le même temps, es t subdivisé e<br />
en 3 section s : 1 ° Z e duché de Bourgogne, de 103 2 à 155 0 , notion s su r<br />
la pairi e , origin e de s communes , fait s divei-s ; la Franche-Comté, de<br />
•1027 à 1550; changement s survenu s pendan t cett e période ; 3 ° depuis la<br />
réunion du comté de Bourgogne au duché, jusquà la mort de Philippe<br />
de Rouvre ; guerres , usage s et établissement s introduit s pendan t ce t inter -<br />
valle : l a 5", la Bourgogne et la Franche-Comté sous les ducs de la 2 ®<br />
race royale; 1 ° Philippe-le-Hardi et Jean-sans-Peur. Notice s sur ces deux<br />
seigneurs, séparatio n momentané e et nouvell e réunio n d e la Bourgogn e e t d e<br />
la Franche-Comté ; Philippe-le-Bon et Charles-le-Téméraire, guerres ,<br />
institutions et coutumes diverses : la 6®, la Bourgogne et la Franche-Comté,<br />
depuis la réunion du duché à la couronne, jusquà la réunion du Comté;<br />
1 ° depuis la réunion du duché jusqu'au traité de neutralité pour les deux<br />
Bourgognes;'^" depuis ce traité jusqu à sa rupture; depuis sa rupture<br />
jusquà la réunion de la Franche-Comté au royaume de France; situation s<br />
diverses des deux pay s , guerres , événement s principau x d e cett e époque. I l<br />
est terminé par u n précis géographiqu e indiquan t le s département s qu i com -<br />
posent les anciennes provinces .<br />
15.<br />
Précis de l'histoire d'Jlsace. pa r M . F. Ragou , professeu r au collèg e Bourbon.<br />
•1 vol . in-IS. Paris, -ISôïi. Chez L . Hachette, rue Pierre-Sarrazin, n° '12. Prix, broch .<br />
75 c.<br />
Cet ouvrage , précéd é , comm e le Précis de l'Histoire de Bourgogne et<br />
de Franche-Comtéf d'u n cour t avertissemen t qu i e n expose l e bu t e t l'u -
1541. BULLETI N BIBLIOGRAPHIQUE .<br />
tilité, es t divisé e n 6 e'poque s : la VAlsace, sous les Romains èt sous<br />
les Francs, jusqu'à son premier duo;l3L â® depuis son premier duc jusqu'à<br />
sa réunion à V Allemagne; l a depuis cette réunion jusqu'à V avènement<br />
de la maison de Hauen-Stoffen aux duchés de Souabe et d'Alsace ; l a<br />
Â-" depuis Tavènement de la maison Hauen-Stoffen, jusqu'à son extinction-,<br />
l a 5° depuis son extinction jusqu au traité de Munster, es t subdivi -<br />
sée en 3 sections, 1 ° jusqu à la réunion du landgraviat de la Basse-Alsace<br />
à l'évêché de Strasbourg; 'H" depuis cette réunion jusqu à l'origine delà<br />
réforme; 3 ° depuis la réforme jusqu'au traité de Munster ; l a 6° contien t<br />
la Période Française. Ce s différentes e'poque s fon t connaîtr e l'origin e de s<br />
anciens habitant s de cett e province, le s eVenéments principau x e t les change -<br />
ments qu'ell e a subis pendan t chaque péiiode . L'ouvrag e es t termin e par u n<br />
précis géographiqu e de s départements qu i composen t cette province.<br />
14.<br />
Précis de l'histoire de Lorraine , par M . F. Ragon , professeur a u collèg e Bour -<br />
bon. Pari s , -183S . Chez L. Hachette , rue Pierre èarrazin , n° 12. Prix, brocli c 76 c.<br />
La marche de cet ouvrage est tout à fait semblable à celle de l'histoire d'Alsace j<br />
il est divise en 5 périodes dont chacune indique également l'origine, lesmœurs,<br />
usages e t faits remarquable s dan s cett e provinc e : la depuis la conquête<br />
de la Gaule parles Romains, jusqu'à la formation du royaume de Lorraine:<br />
laâ" depuis la formation du royaume de Lorraine jusqu'à l'avènement<br />
de la maison d'Alsace au duché de Lorraine, es t sulidivisé e e n 2<br />
sections', \ ° le royaume de Lorraine jusqu'aux ducs bénéficiaires; S " la<br />
Lon'aine sous les ducs bénéficiaires, jusqu à l'avènement de la maison<br />
d'Alsace -: la depuis cet avènement jusqu'à la réunion des deux duchés<br />
de Lorraine et de Bar, et l'avènement de la maison d'Anjou, es t su]}di -<br />
visée e n 2 sections , 1 " jusqu'à la mort de Simon II; jusqu'à l'avènement<br />
de la branche de Bar: l a depuis l'avènement de la maison de<br />
Bar et d'Anjou, jusqu'à la première réunion de la Lorraine à la France,<br />
est subdivisé e e n 3 sections , 1 ° jusqu'à V avènement de René II et de la<br />
maison de Faudemont; jusqu'à l'extinction delà branche ainée de<br />
cette maison; 'o" jusqu'à la première réunion à la France: l a 5 ® depids la<br />
première réunion jusqu'à la rèunion'dèfinitive, es t subdivisée en S sections ,<br />
jusqu à la fin de la domination de la maison de Gèi-ard d'Alsace;<br />
depuis l'avènement du roi de Pologne Stanislas jusqu'à la réunion définitive<br />
à la France. I l es t terminé auss i pa r u n précis géographiqu e de s dé -<br />
partements qu i composen t .cette province .<br />
18.<br />
Le dessin linéaire des demoiselles ave c les applications à l'ornement e t à la composition<br />
, à la broderie, a u dessi n de s schalls , au x fleur s et a u paysage ; ouvrage<br />
disposé pour l'enseignement de s jeunes personne s élevées dans leur famille ou dan s<br />
les pensionnats , avec une instruction pour l'application d u dessi n linéaire aux mé -<br />
thodes simultané e e t mutuell e ; par M. LAMOTTE , auteur d u cours niAhodique de<br />
dessin linéaire , adopt é pa r l'Université pour l'enseignement des écoles ; 4 vol. in-8 "<br />
avec un atla s d e 1 2 planches su r demi-jésus, gravée s par Adnra , Paris , -1835 . A i a<br />
librairie élémeutaire .de L. Hachette, rue Pierre-Sarrazin , n " 12 . Prix broché, 6 fr.<br />
L'étude du dessin linéaire est-elle utile au x demoiselle s de tonte.s In s classes
BULLETIN BIBLIOGRAPfflQUE . 9 5<br />
de la société ? tell e es t la premièr e questio n qu e nous avon s dû nous faire, e t<br />
que nous n'ayons pa s lie'site' à résoudra affirmativement.<br />
Les jeunes personne s qu i son t dans l'aisanc e apprennen t presqu e toute s à<br />
dessiner la figure, le s fleurs ou le paysage. Or , les plus liabiles maîtres de dessin,<br />
comm e le s plus grands peintres ^ ont reconnu e t reconnaissent encor e qu e<br />
le trace ' des figures géome'triques , base du dessin lineaire , es t une excellent e<br />
)re'paration au dessin des objets naturêîs j et que, e n y exerçan t d e bonne heure<br />
es élève s , o n leu r épargne beaucoup d e tâtonnements, d e dégoûts , e t qu'o n<br />
hâte singulièrement leurs progrès. Ainsi, e n considérant l e dessin d'imitatio n<br />
comme u n ar t d e pu r agrément , l e dessi n linéair e doi t e n êtr e le premie r<br />
degré.<br />
Mais combien il es t plus nécessaire encore au x jeune s filles san s fortune, à<br />
qui le dessin doi t procurer un e existence honorable! Pou r celles mêmes qui ne<br />
sont pas destinées à devenir artiste s , l e dessin linéaire es t une ressourc e pré -<br />
cieuse. N'est-i l pa s fâcheu x e n effe t qu e le s dessin s d e broderie , ceu x de s<br />
étoffes imprimées, de s schall s , etc . ^ soient fait s presqu e exclusivement pa r<br />
des hommes , tandi s qu e le s habitude s sédentaire s de s femme s , leur adress e ,<br />
leur bo n goût, le s rendent si propres à c e genr e d e travail ? Eh bien , c'es t<br />
presque toujour s à quelque s notion s élémentaire s d e géométri e qu e les dessi -<br />
nateurs doiven t ces faciles connaissances -, et c'es t en les acquérant qu e les femmes<br />
parviendront à lutter contr e eux avec avantag e -, et à s'ouvrir un e carrièr e<br />
honnête, agréabl e e t lucrative.<br />
En demandan t ave c l'honorabl e auteu r d e l'ouvrage qu e nou s annonçons ,<br />
la prompte introductio n d e l'enseignemen t d u dessi n linéair e dan s le s école s<br />
primaires e t dan s les maison s d'éducatio n d e jeune s filles, nou s formôn s u n<br />
vœu qu'approuveron t e t qu'appuieron t certainemen t les personnes qui s'occupent<br />
d u bie n êtr e et de la moralité de cett e classe, toujour s s i intéressant e e t<br />
souvent s i malheureuse dan s nos grandes villes .<br />
Il fau t avouer qu'il existait jusqu'ici un grand obstacle à cette introduction :<br />
c'était l'absence d'un bon traité élémentaire. Le s cours de dessin linéaire de<br />
MM. Laniotte et Francœur son t de très bons ouvrages; mais ils ont été rédigés<br />
exclusivement pou r les écoles de garçons , e t la plupart des applications qu'il s<br />
contiennent seraient complèteïnent inutiles aux demoiselles.<br />
Il appartenai t surtou t à M. Lamott e d e rempli r cett e lacun e e t d e rendr e<br />
ce nouvea u servic e à la jeunesse. So n dessin linéaire des demoiselles nou s<br />
parait u n livre bien conçu, rédig é avec clarté, e t renfermé dans de sages limites.<br />
Le s planche s sont bien graduée s e t gravée s ave c l a décisio n e t l a nettet é<br />
qui distinguen t les travaux d e M. Adam . Ave c ce guide ^ un e institutrice, un e<br />
sous-maîtresse, un e mère de famille peuvent facilemen t enseigner le dessi n linéaire<br />
, san s avoir recour s à u n professeur spécial. C'es t partout u n avantag e<br />
important, mai s particulièrement dans u n grand jiombr e d e localités o ù l'o n<br />
chercherait vainemen t u n maître ou une maîtresse de dessin.
96 TABLE .<br />
TABLE DE S MATIERE S<br />
DU NUMER O 2 .<br />
PARTIE OFFICIEI.I.E .<br />
Création d'école s f) 9<br />
Nominations.— 1 " fnspecteur s Je s école s primaire s f| 9<br />
2° Commission s d'instructio n primair e 5 0<br />
3° Comité s d'arrondissement 5 1<br />
tl-f Ecole s normales primaires. . 5 1<br />
5° Instilution s données pa r l e Ministr e au x instituteurs ,<br />
par arrêté s des 3 0 septembre et 3 0 octobre 5 3<br />
PARTIE NO N <strong>OFFICIELLE</strong> .<br />
SIÉTHOSES.<br />
De l a politess e e n généra l e t principalemen t dan s le s enfant s 6<br />
t<br />
De l'enseignemen t d u calcul . (-1= ' article. ) 6 0<br />
Exercices d'arithmétique , ave c solution s e t rai.sonnement s 7 0<br />
A° DOCTTMENT S SU R L'INSTRUCTIO N PHIMAIR E A L'ÉTRANGER .<br />
Russie. — Règlement su r l'éducatio n particulièr e e n Russi e 7 6<br />
2° DOCUMENT S SU R L'INSTRUCTIO N PRIMAIR E E N FRANCE .<br />
Extrait d u tablea u généra l d e l'emplo i de s fond s afïecte' s à l'instructio n<br />
primaire , pendant l'anné e 1831 1 7 8<br />
Rapport d u nombr e de s e'iève s à l a population total e 8 1<br />
Basses-Pyrénées. — Note su r la discipline et le s étude s d e l'écol e normal e<br />
primaire d e Pau 8 2<br />
BUIIXIETIKT BIBIILOGELAFHIGUE .<br />
Publications nouvelle s relatives à l'instruction primair e 8 1<br />
IMPRIMERIE D E J. GRATIO T ,<br />
Rue du Foin Saiol-J'acqties, pisifou du U Reine Ëlanclie.
-Momael ^Éne^c^. jrom^ &. -/if^S.<br />
©<br />
A<br />
upn/<br />
a/Kiff.l,<br />
/Â-^. lid ele.J'.Bin.ttlexay K.des TTiaifvarmj,