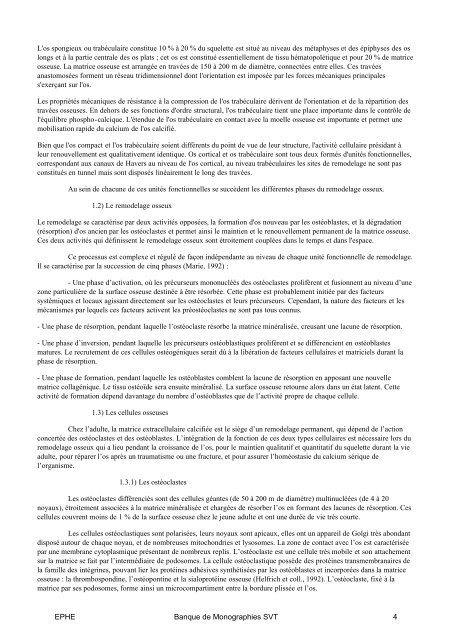Philippe DELANNOY - EPHE
Philippe DELANNOY - EPHE
Philippe DELANNOY - EPHE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L'os spongieux ou trabéculaire constitue 10 % à 20 % du squelette est situé au niveau des métaphyses et des épiphyses des os<br />
longs et à la partie centrale des os plats ; cet os est constitué essentiellement de tissu hématopoïétique et pour 20 % de matrice<br />
osseuse. La matrice osseuse est arrangée en travées de 150 à 200 m de diamètre, connectées entre elles. Ces travées<br />
anastomosées forment un réseau tridimensionnel dont l'orientation est imposée par les forces mécaniques principales<br />
s'exerçant sur l'os.<br />
Les propriétés mécaniques de résistance à la compression de l'os trabéculaire dérivent de l'orientation et de la répartition des<br />
travées osseuses. En dehors de ses fonctions d'ordre structural, l'os trabéculaire tient une place importante dans le contrôle de<br />
l'équilibre phospho-calcique. L'étendue de l'os trabéculaire en contact avec la moelle osseuse est importante et permet une<br />
mobilisation rapide du calcium de l'os calcifié.<br />
Bien que l'os compact et l'os trabéculaire soient différents du point de vue de leur structure, l'activité cellulaire présidant à<br />
leur renouvellement est qualitativement identique. Os cortical et os trabéculaire sont tous deux formés d'unités fonctionnelles,<br />
correspondant aux canaux de Havers au niveau de l'os cortical, au niveau trabéculaires les sites de remodelage ne sont pas<br />
constitués en tunnel mais sont disposés linéairement le long des travées.<br />
Au sein de chacune de ces unités fonctionnelles se succèdent les différentes phases du remodelage osseux.<br />
1.2) Le remodelage osseux<br />
Le remodelage se caractérise par deux activités opposées, la formation d'os nouveau par les ostéoblastes, et la dégradation<br />
(résorption) d'os ancien par les ostéoclastes et permet ainsi le maintien et le renouvellement permanent de la matrice osseuse.<br />
Ces deux activités qui définissent le remodelage osseux sont étroitement couplées dans le temps et dans l'espace.<br />
Ce processus est complexe et régulé de façon indépendante au niveau de chaque unité fonctionnelle de remodelage.<br />
Il se caractérise par la succession de cinq phases (Marie, 1992) :<br />
- Une phase d’activation, où les précurseurs mononucléés des ostéoclastes prolifèrent et fusionnent au niveau d’une<br />
zone particulière de la surface osseuse destinée à être résorbée. Cette phase est probablement initiée par des facteurs<br />
systémiques et locaux agissant directement sur les ostéoclastes et leurs précurseurs. Cependant, la nature des facteurs et les<br />
mécanismes par lequels ces facteurs activent les préostéoclastes ne sont pas tous connus.<br />
- Une phase de résorption, pendant laquelle l’ostéoclaste résorbe la matrice minéralisée, creusant une lacune de résorption.<br />
- Une phase d’inversion, pendant laquelle les précurseurs ostéoblastiques prolifèrent et se différencient en ostéoblastes<br />
matures. Le recrutement de ces cellules ostéogéniques serait dû à la libération de facteurs cellulaires et matriciels durant la<br />
phase de résorption.<br />
- Une phase de formation, pendant laquelle les ostéoblastes comblent la lacune de résorption en apposant une nouvelle<br />
matrice collagénique. Le tissu ostéoïde sera ensuite minéralisé. La surface osseuse retourne alors dans un état latent. Cette<br />
activité de formation dépend davantage du nombre d’ostéoblastes que de l’activité propre de chaque cellule.<br />
1.3) Les cellules osseuses<br />
Chez l’adulte, la matrice extracellulaire calcifiée est le siège d’un remodelage permanent, qui dépend de l’action<br />
concertée des ostéoclastes et des ostéoblastes. L’intégration de la fonction de ces deux types cellulaires est nécessaire lors du<br />
remodelage osseux qui a lieu pendant la croissance de l’os, pour le maintien qualitatif et quantitatif du squelette durant la vie<br />
adulte, pour réparer l’os après un traumatisme ou une fracture, et pour assurer l’homéostasie du calcium sérique de<br />
l’organisme.<br />
1.3.1) Les ostéoclastes<br />
Les ostéoclastes différenciés sont des cellules géantes (de 50 à 200 m de diamètre) multinucléées (de 4 à 20<br />
noyaux), étroitement associées à la matrice minéralisée et chargées de résorber l’os en formant des lacunes de résorption. Ces<br />
cellules couvrent moins de 1 % de la surface osseuse chez le jeune adulte et ont une durée de vie très courte.<br />
Les cellules ostéoclastiques sont polarisées, leurs noyaux sont apicaux, elles ont un appareil de Golgi très abondant<br />
disposé autour de chaque noyau, et de nombreuses mitochondries et lysosomes. La zone de contact avec l’os est caractérisée<br />
par une membrane cytoplasmique présentant de nombreux replis. L’ostéoclaste est une cellule très mobile et son attachement<br />
sur la matrice se fait par l’intermédiaire de podosomes. La cellule ostéoclastique possède des protéines transmembranaires de<br />
la famille des intégrines, pouvant lier les protéines adhésives synthétisées par les ostéoblastes et incorporées dans la matrice<br />
osseuse : la thrombospondine, l’ostéopontine et la sialoprotéine osseuse (Helfrich et coll., 1992). L’ostéoclaste, fixé à la<br />
matrice par ses podosomes, forme ainsi un microcompartiment entre la bordure plissée et l’os.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 4