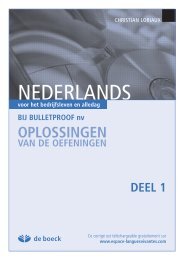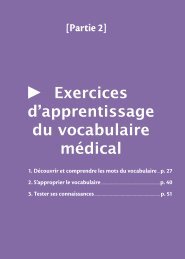Quelles sont les origines du cerveau et du comportement? - De Boeck
Quelles sont les origines du cerveau et du comportement? - De Boeck
Quelles sont les origines du cerveau et du comportement? - De Boeck
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
34 <strong>Quel<strong>les</strong></strong> <strong>sont</strong> <strong>les</strong> <strong>origines</strong> <strong>du</strong> <strong>cerveau</strong> <strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> ?<br />
E. Lessing / Art Resource, New York<br />
François Gérard,<br />
Psyché <strong>et</strong> Cupidon (1798)<br />
1.2 Points de vue sur la relation entre <strong>cerveau</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>comportement</strong><br />
Revenons à la question principale concernant l’étude <strong>du</strong> <strong>cerveau</strong> <strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>comportement</strong>, à<br />
savoir celle <strong>du</strong> lien entre l’un <strong>et</strong> l’autre. Nous abordons à présent la description de trois<br />
théories classiques sur le déterminisme <strong>du</strong> <strong>comportement</strong>, en évoquant un représentant<br />
majeur de chaque école de pensée – celle <strong>du</strong> mentalisme, celle <strong>du</strong> <strong>du</strong>alisme <strong>et</strong> celle <strong>du</strong><br />
matérialisme. Nous verrons aussi comment on peut rattacher la contribution de chacune<br />
d’entre el<strong>les</strong> au domaine des neurosciences. Vous ne manquerez pas de reconnaître que<br />
certaines des idées de l’ordre <strong>du</strong> bon sens que vous pourriez avoir au suj<strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>comportement</strong><br />
peuvent se rattacher à l’une ou l’autre des contributions de ces trois éco<strong>les</strong>.<br />
1.2.1 Aristote <strong>et</strong> le mentalisme<br />
Aristote<br />
(384-322 avant JC)<br />
Il y a plus de 2000 ans, dans la Grèce Antique, Aristote a proposé<br />
qu’une chose appelée l’esprit, l’âme ou la psyché était<br />
l’entité responsable de la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>comportement</strong>.<br />
Dans la mythologie classique, Psyché était une jeune<br />
fille qui voulut épouser le jeune dieu Cupidon. Vénus, la mère<br />
de Cupidon, s’opposa à ce que son fils épousât une mortelle, <strong>et</strong><br />
se mit à harceler Psyché en lui imposant des tâches réputées<br />
impossib<strong>les</strong> pour une mortelle.<br />
Psyché réalisa ces tâches avec un tel acharnement, une<br />
telle intelligence <strong>et</strong> une telle abnégation, qu’elle fut faite immortelle ; l’objection de<br />
Vénus n’avait donc plus lieu d’être. Le philosophe de la Grèce Antique, Aristote, faisait<br />
allusion à c<strong>et</strong>te histoire lorsqu’il suggéra que toutes <strong>les</strong> fonctions intellectuel<strong>les</strong> de<br />
l’Homme étaient le pro<strong>du</strong>it de sa propre psyché. La psyché, disait Aristote, est responsable<br />
de la vie, <strong>et</strong> lorsqu’elle quitte le corps, c’est la vie qui s’en va, ne laissant que la mort.<br />
Les considérations d’Aristote sur le <strong>comportement</strong> ne reconnaissaient aucun rôle<br />
au <strong>cerveau</strong>, dont il pensait que la seule fonction était de refroidir le sang. Pour Aristote,<br />
c’est la psyché, immatérielle qui était responsable des pensées humaines, des perceptions<br />
<strong>et</strong> des émotions, ainsi que de processus tels que l’imagination, l’opinion, le désir, le plaisir,<br />
la souffrance, la mémoire <strong>et</strong> la raison. La psyché était une entité, ou « substance<br />
formelle » comme l’appellent <strong>les</strong> philosophes, indépendante <strong>du</strong> corps. Le point de vue<br />
d’Aristote, selon lequel une psyché non matérielle gouverne tous nos <strong>comportement</strong>s, fut<br />
adopté par le christianisme dans sa façon de concevoir l’âme. Ce point de vue fit l’obj<strong>et</strong><br />
d’une vaste diffusion dans le monde occidental.<br />
Le terme anglo-saxon pour désigner l’âme est mind, un mot également utilisé au<br />
sens de mémoire, <strong>et</strong> lorsque le terme « psyché » fut tra<strong>du</strong>it en anglais, c’est par esprit<br />
(mind) qu’il fut tra<strong>du</strong>it. Le point de vue philosophique qui stipule que l’âme ou la psyché<br />
d’une personne est responsable de son <strong>comportement</strong> est appelé « mentalisme », un<br />
terme qui signifie « de l’âme » ou « de l’esprit ». Le mentalisme n’est pas une conception<br />
scientifique. Parce que l’esprit n’est pas matériel, il ne peut faire l’obj<strong>et</strong> d’une étude reposant<br />
sur l’usage de méthodes scientifiques d’investigation. Toutefois, malgré ce rej<strong>et</strong> <strong>du</strong><br />
mentalisme de la part des scientifiques, des termes typiquement hérités <strong>du</strong> mentalisme,<br />
tels que sensation, perception, attention, imagination, émotion, motivation, mémoire <strong>et</strong><br />
volonté, <strong>sont</strong> toujours utilisés de nos jours pour désigner différents aspects <strong>du</strong><br />
<strong>comportement</strong>, qui tous demeurent des centres d’intérêt pour la recherche contemporaine<br />
en psychologie.