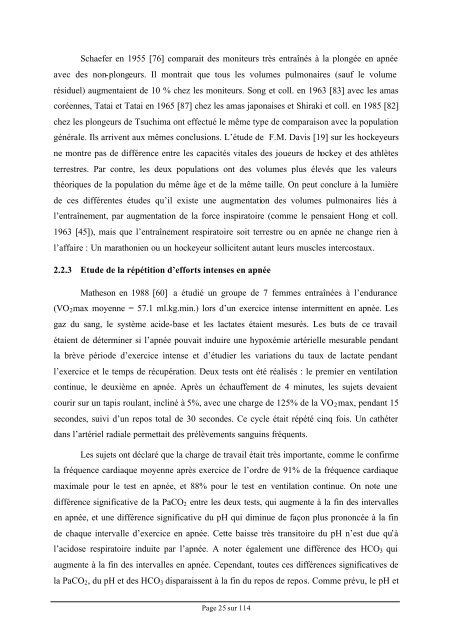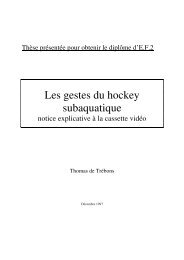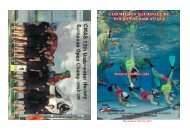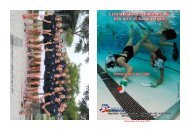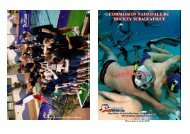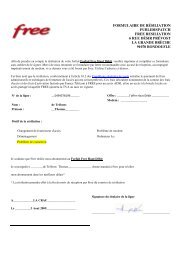redac finale modif 20 10 - Association Hockey Sub
redac finale modif 20 10 - Association Hockey Sub
redac finale modif 20 10 - Association Hockey Sub
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Schaefer en 1955 [76] comparait des moniteurs très entraînés à la plongée en apnée<br />
avec des non-plongeurs. Il montrait que tous les volumes pulmonaires (sauf le volume<br />
résiduel) augmentaient de <strong>10</strong> % chez les moniteurs. Song et coll. en 1963 [83] avec les amas<br />
coréennes, Tatai et Tatai en 1965 [87] chez les amas japonaises et Shiraki et coll. en 1985 [82]<br />
chez les plongeurs de Tsuchima ont effectué le même type de comparaison avec la population<br />
générale. Ils arrivent aux mêmes conclusions. L’étude de F.M. Davis [19] sur les hockeyeurs<br />
ne montre pas de différence entre les capacités vitales des joueurs de hockey et des athlètes<br />
terrestres. Par contre, les deux populations ont des volumes plus élevés que les valeurs<br />
théoriques de la population du même âge et de la même taille. On peut conclure à la lumière<br />
de ces différentes études qu’il existe une augmentation des volumes pulmonaires liés à<br />
l’entraînement, par augmentation de la force inspiratoire (comme le pensaient Hong et coll.<br />
1963 [45]), mais que l’entraînement respiratoire soit terrestre ou en apnée ne change rien à<br />
l’affaire : Un marathonien ou un hockeyeur sollicitent autant leurs muscles intercostaux.<br />
2.2.3 Etude de la répétition d’efforts intenses en apnée<br />
Matheson en 1988 [60] a étudié un groupe de 7 femmes entraînées à l’endurance<br />
(VO 2 max moyenne = 57.1 ml.kg.min.) lors d’un exercice intense intermittent en apnée. Les<br />
gaz du sang, le système acide-base et les lactates étaient mesurés. Les buts de ce travail<br />
étaient de déterminer si l’apnée pouvait induire une hypoxémie artérielle mesurable pendant<br />
la brève période d’exercice intense et d’étudier les variations du taux de lactate pendant<br />
l’exercice et le temps de récupération. Deux tests ont été réalisés : le premier en ventilation<br />
continue, le deuxième en apnée. Après un échauffement de 4 minutes, les sujets devaient<br />
courir sur un tapis roulant, incliné à 5%, avec une charge de 125% de la VO 2 max, pendant 15<br />
secondes, suivi d’un repos total de 30 secondes. Ce cycle était répété cinq fois. Un cathéter<br />
dans l’artériel radiale permettait des prélèvements sanguins fréquents.<br />
Les sujets ont déclaré que la charge de travail était très importante, comme le confirme<br />
la fréquence cardiaque moyenne après exercice de l’ordre de 91% de la fréquence cardiaque<br />
maximale pour le test en apnée, et 88% pour le test en ventilation continue. On note une<br />
différence significative de la PaCO 2 entre les deux tests, qui augmente à la fin des intervalles<br />
en apnée, et une différence significative du pH qui diminue de façon plus prononcée à la fin<br />
de chaque intervalle d’exercice en apnée. Cette baisse très transitoire du pH n’est due qu’à<br />
l’acidose respiratoire induite par l’apnée. A noter également une différence des HCO 3 qui<br />
augmente à la fin des intervalles en apnée. Cependant, toutes ces différences significatives de<br />
la PaCO 2 , du pH et des HCO 3 disparaissent à la fin du repos de repos. Comme prévu, le pH et<br />
Page 25 sur 114