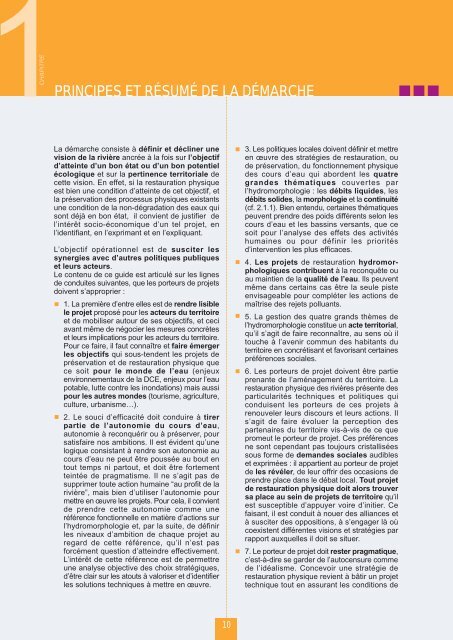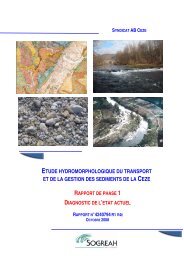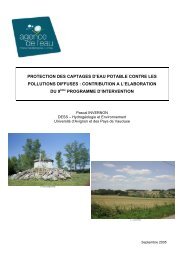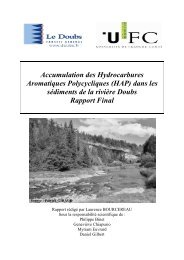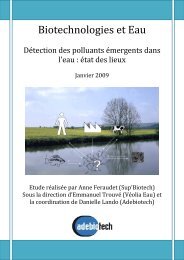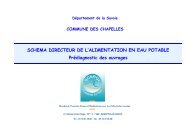guide technique - Les documents techniques sur l'eau
guide technique - Les documents techniques sur l'eau
guide technique - Les documents techniques sur l'eau
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CHAPITRE<br />
PRINCIPES ET RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE<br />
La démarche consiste à définir et décliner une<br />
vision de la rivière ancrée à la fois <strong>sur</strong> l’objectif<br />
d’atteinte d’un bon état ou d’un bon potentiel<br />
écologique et <strong>sur</strong> la pertinence territoriale de<br />
cette vision. En effet, si la restauration physique<br />
est bien une condition d’atteinte de cet objectif, et<br />
la préservation des processus physiques existants<br />
une condition de la non-dégradation des eaux qui<br />
sont déjà en bon état, il convient de justifier de<br />
l’intérêt socio-économique d’un tel projet, en<br />
l’identifiant, en l’exprimant et en l’expliquant.<br />
L’objectif opérationnel est de susciter les<br />
synergies avec d’autres politiques publiques<br />
et leurs acteurs.<br />
Le contenu de ce <strong>guide</strong> est articulé <strong>sur</strong> les lignes<br />
de conduites suivantes, que les porteurs de projets<br />
doivent s’approprier :<br />
1. La première d’entre elles est de rendre lisible<br />
le projet proposé pour les acteurs du territoire<br />
et de mobiliser autour de ses objectifs, et ceci<br />
avant même de négocier les me<strong>sur</strong>es concrètes<br />
et leurs implications pour les acteurs du territoire.<br />
Pour ce faire, il faut connaître et faire émerger<br />
les objectifs qui sous-tendent les projets de<br />
préservation et de restauration physique que<br />
ce soit pour le monde de l’eau (enjeux<br />
environnementaux de la DCE, enjeux pour l’eau<br />
potable, lutte contre les inondations) mais aussi<br />
pour les autres mondes (tourisme, agriculture,<br />
culture, urbanisme…).<br />
2. Le souci d’efficacité doit conduire à tirer<br />
partie de l’autonomie du cours d’eau,<br />
autonomie à reconquérir ou à préserver, pour<br />
satisfaire nos ambitions. Il est évident qu’une<br />
logique consistant à rendre son autonomie au<br />
cours d’eau ne peut être poussée au bout en<br />
tout temps ni partout, et doit être fortement<br />
teintée de pragmatisme. Il ne s’agit pas de<br />
supprimer toute action humaine “au profit de la<br />
rivière”, mais bien d’utiliser l’autonomie pour<br />
mettre en œuvre les projets. Pour cela, il convient<br />
de prendre cette autonomie comme une<br />
référence fonctionnelle en matière d’actions <strong>sur</strong><br />
l’hydromorphologie et, par la suite, de définir<br />
les niveaux d’ambition de chaque projet au<br />
regard de cette référence, qu’il n’est pas<br />
forcément question d’atteindre effectivement.<br />
L’intérêt de cette référence est de permettre<br />
une analyse objective des choix stratégiques,<br />
d’être clair <strong>sur</strong> les atouts à valoriser et d’identifier<br />
les solutions <strong>technique</strong>s à mettre en œuvre.<br />
3. <strong>Les</strong> politiques locales doivent définir et mettre<br />
en œuvre des stratégies de restauration, ou<br />
de préservation, du fonctionnement physique<br />
des cours d’eau qui abordent les quatre<br />
grandes thématiques couvertes par<br />
l’hydromorphologie : les débits liquides, les<br />
débits solides, la morphologie et la continuité<br />
(cf. 2.1.1). Bien entendu, certaines thématiques<br />
peuvent prendre des poids différents selon les<br />
cours d’eau et les bassins versants, que ce<br />
soit pour l’analyse des effets des activités<br />
humaines ou pour définir les priorités<br />
d’intervention les plus efficaces.<br />
4. <strong>Les</strong> projets de restauration hydromorphologiques<br />
contribuent à la reconquête ou<br />
au maintien de la qualité de l’eau. Ils peuvent<br />
même dans certains cas être la seule piste<br />
envisageable pour compléter les actions de<br />
maîtrise des rejets polluants.<br />
5. La gestion des quatre grands thèmes de<br />
l’hydromorphologie constitue un acte territorial,<br />
qu’il s’agit de faire reconnaître, au sens où il<br />
touche à l’avenir commun des habitants du<br />
territoire en concrétisant et favorisant certaines<br />
préférences sociales.<br />
6. <strong>Les</strong> porteurs de projet doivent être partie<br />
prenante de l’aménagement du territoire. La<br />
restauration physique des rivières présente des<br />
particularités <strong>technique</strong>s et politiques qui<br />
conduisent les porteurs de ces projets à<br />
renouveler leurs discours et leurs actions. Il<br />
s’agit de faire évoluer la perception des<br />
partenaires du territoire vis-à-vis de ce que<br />
promeut le porteur de projet. Ces préférences<br />
ne sont cependant pas toujours cristallisées<br />
sous forme de demandes sociales audibles<br />
et exprimées : il appartient au porteur de projet<br />
de les révéler, de leur offrir des occasions de<br />
prendre place dans le débat local. Tout projet<br />
de restauration physique doit alors trouver<br />
sa place au sein de projets de territoire qu’il<br />
est susceptible d’appuyer voire d’initier. Ce<br />
faisant, il est conduit à nouer des alliances et<br />
à susciter des oppositions, à s’engager là où<br />
coexistent différentes visions et stratégies par<br />
rapport auxquelles il doit se situer.<br />
7. Le porteur de projet doit rester pragmatique,<br />
c’est-à-dire se garder de l’autocen<strong>sur</strong>e comme<br />
de l’idéalisme. Concevoir une stratégie de<br />
restauration physique revient à bâtir un projet<br />
<strong>technique</strong> tout en as<strong>sur</strong>ant les conditions de<br />
10