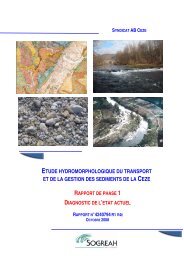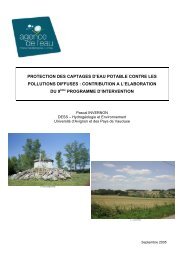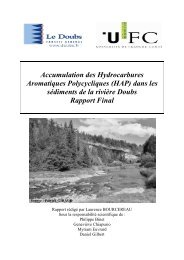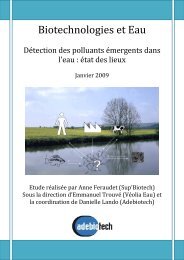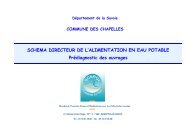guide technique - Les documents techniques sur l'eau
guide technique - Les documents techniques sur l'eau
guide technique - Les documents techniques sur l'eau
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
_ Chapitre 2 : Concevoir une stratégie de préservation et de restauration<br />
_<br />
Mais la démarche a pu avoir quelques effets<br />
indésirables : des périmètres calqués <strong>sur</strong> les<br />
structures de gestion qui ne sont pas toujours<br />
<strong>technique</strong>ment pertinents. Pour exemple, un bassin<br />
versant peut contenir des entités géographiques<br />
indépendantes, et inversement, la problématique<br />
d’une confluence et la relation au cours d’eau aval<br />
peuvent être mal traitées pour cause de<br />
compétence territoriale.<br />
L’approche classique d’une étude est de définir un<br />
périmètre, puis d’identifier les thèmes à étudier,<br />
qui seront traités de manière homogène <strong>sur</strong> le<br />
périmètre.<br />
Cette approche a deux inconvénients :<br />
il y a un effet de frontière qui peut conduire à<br />
mal appréhender un phénomène parce qu’il sort<br />
du périmètre fixé, même s’il peut avoir de<br />
l’importance ;<br />
il y a une perte d’énergie à vouloir traiter de<br />
manière homogène tous les thèmes <strong>sur</strong> tout le<br />
territoire.<br />
La démarche de construction des périmètres<br />
<strong>technique</strong>s pertinents proposée ici se décline en<br />
trois temps.<br />
1. En premier lieu, bien définir les thématiques<br />
à aborder pour répondre aux enjeux et aux objectifs<br />
visés par l’analyse physique sommaire et l’analyse<br />
territoriale.<br />
2. Ensuite, déterminer les espaces et les<br />
linéaires à prendre en compte par thématique.<br />
Il s’agit de définir les unités géographiques de<br />
bases selon une double approche, <strong>technique</strong> et<br />
territoriale.<br />
Pour l’approche <strong>technique</strong>, il faut définir la bonne<br />
maille de réflexion : la cohérence du fonctionnement<br />
global du cours d’eau interdit bien sûr de travailler<br />
<strong>sur</strong> des unités trop petites ; mais il n’est pas non<br />
plus efficace de vouloir manier de grands territoires<br />
si le fonctionnement physique ne l’impose pas. Il<br />
faudra toutefois rester conscient que la bonne<br />
maille <strong>technique</strong> n’est pas nécessairement la bonne<br />
maille socio-politique. L’une et l’autre ont leur<br />
pertinence.<br />
La masse d’eau définie dans le cadre de la DCE<br />
est une unité d’évaluation et de planification, mais<br />
pas une unité de gestion. La définition des masses<br />
d’eau intègre de nombreux paramètres, et les<br />
besoins précis de la restauration physique peuvent<br />
conduire à envisager une autre unité de gestion :<br />
certains paramètres de la restauration physique<br />
(continuité sédimentaire, continuité biologique)<br />
pourront nécessiter de rassembler dans l’analyse<br />
plusieurs masses d’eau : c’est le cas notamment<br />
de la continuité <strong>sur</strong> les cours d’eau à migrateurs,<br />
ou des rivières dont la continuité du transit des<br />
graviers doit être étudiée <strong>sur</strong> de longues<br />
distances (Drôme, Var, Durance, etc.) ;<br />
la bonne échelle <strong>technique</strong> peut être plus réduite<br />
que la masse d’eau, mais il faudra alors s’as<strong>sur</strong>er<br />
de la cohérence des actions envisagées à<br />
l’échelle de la masse d’eau, par rapport à ses<br />
objectifs et au programme de me<strong>sur</strong>es ;<br />
en matière de continuité biologique certains<br />
éléments de stratégie sont déjà définis et doivent<br />
être pris en compte : plan anguilles, ouvrages<br />
prioritaires “Grenelle” (lot 1 , lot 2), classements<br />
des cours d’eau (article L. 214 -17 du code de<br />
l’environnement, liste 1 et liste 2) ;<br />
et en tout état de cause, il faut toujours<br />
s’interroger <strong>sur</strong> le comportement aux frontières<br />
entre deux masses d’eau (notamment,<br />
interrelations entre affluents et cours d’eau<br />
principaux).<br />
Pour l’approche<br />
territoriale, la réflexion<br />
doit aussi s’interroger<br />
<strong>sur</strong> les bonnes échelles<br />
“humaines”. Pour cela,<br />
l’analyse territoriale<br />
sommaire de la rubrique<br />
B doit être mobilisée,<br />
pour déterminer<br />
notamment les espaces<br />
“vécus” par les riverains,<br />
la géographie des<br />
usages dominants, les<br />
territoires de décision.<br />
Le croisement des deux<br />
approches ( <strong>technique</strong><br />
et territoriale) doit<br />
permettre de proposer<br />
en première approche<br />
des unités d’analyse de<br />
base.<br />
L’étape suivante va<br />
permettre d’étendre<br />
l’analyse à tout ce qui est<br />
nécessaire pour as<strong>sur</strong>er la<br />
cohérence de la réflexion : il<br />
n’est donc pas gênant que les unités<br />
soient relativement petites. Il faut toutefois rester<br />
à une maille suffisante pour que le projet ait un<br />
sens vis-à-vis de l’objectif biologique de bon état,<br />
qu’il s’agisse de sa restauration ou de sa<br />
pérennisation lorsque le bon état est atteint ou en<br />
voie de l’être.<br />
34