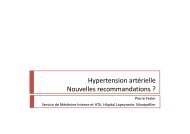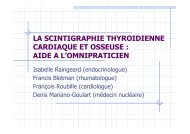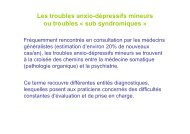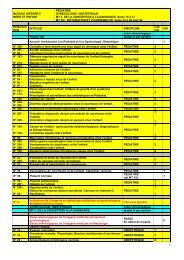Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1
Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1
Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Université MONTPELLIER I<br />
Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Montpellier -Nimes<br />
-----<br />
DFGSM 3<br />
L’Appareil <strong>Digestif</strong><br />
A° Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
- Rappel sur l’organogenèse<br />
-L’histogenèse<br />
- Les malformations<br />
B° <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
- Généralités<br />
- La cavité buccale: La muqueuse buccale<br />
La langue<br />
<strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong><br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
- Le tube digestif La structure générale du tube digestif<br />
L’œsophage<br />
L’estomac<br />
L’intestin grêle<br />
Le gros intestin et le rectum<br />
C° Les glan<strong>de</strong>s annexes <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
- Les glan<strong>de</strong>s salivaires: Les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
-Le pancréas<br />
-Le foie<br />
- Les voies biliaires<br />
Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
L’Organogenèse<br />
Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
L’Organogenèse<br />
La gastrulation (15 -21ème jours) : . Embryon tri<strong>de</strong>rmique<br />
. 3 feuillets : ectoblaste, endoblaste, chordo-mésoblaste<br />
La gastrulation (15 -21ème jours) : . Embryon tri<strong>de</strong>rmique<br />
. 3 feuillets : ectoblaste, endoblaste, chordo-mésoblaste<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
1
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
L’Organogenèse<br />
L’Organogenèse<br />
4ème semaine:<br />
Organogenèse<br />
Morphogenèse<br />
Délimitation <strong>de</strong> l’embryon<br />
Mo<strong>de</strong>lage du corps embryonnaire<br />
4ème semaine: Intestin primitif Intestin antérieur<br />
Intestin moyen<br />
Intestin postérieur<br />
Intestin antérieur : pharynx<br />
la cavité bucco-pharyngienne<br />
l’œsophage<br />
l’estomac<br />
sup. duodénum<br />
foie<br />
pancréas<br />
Intestin moyen :<br />
inf. duodénum<br />
jéjunum, iléon, colon ascendant<br />
et début du colon transverse<br />
Intestin postérieur : fin du colon transverse<br />
colon sigmoï<strong>de</strong><br />
rectum<br />
partie sup. du canal anal<br />
L’Histogenèse<br />
• Origine mixte <strong>de</strong> l’épithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cavité buccale: épiblastique en avant et<br />
entoblastique en arrière<br />
• La paroi <strong>de</strong> l’intestin primitif est constitué d’un revêtement épithélial simple d’origine<br />
entoblatique, entouré du mésenchyme <strong>de</strong> la splanchnopleure. Aux 2 extrémités, on trouve un<br />
revêtement épiblastique<br />
• Au cours <strong>de</strong> la 6 ième semaine <strong>de</strong> développement, prolifération <strong>de</strong> l’épithélium endo<strong>de</strong>rmique<br />
et obstruction complète <strong>de</strong> la lumière intestinale. Puis, recanalisation et différentiation <strong>de</strong><br />
l’épithélium définitif.<br />
Malformations<br />
Une sténose: rétrécissement d’un orifice ou <strong>de</strong> la lumière d’un organe creux<br />
Une atrésie: absence <strong>de</strong> la lumière d’un organe creux.<br />
Atrésies et sténoses du tube digestif :<br />
•Atrésie é i <strong>de</strong> l’œsophage (1/3000)<br />
•Sténose hypertrophique du pylore<br />
•Atrésie et sténose duodénale (1/4000) (dans 1/3 <strong>de</strong>s cas associées à une T21)<br />
•Atrésie et sténose du jéjunum<br />
•Atrésie ano-rectale (1/5000) fistule<br />
• Les cellules mésoblastiques du mésenchyme environnant se différencient en fibres<br />
musculaires lisses, sauf dans la partie proximale <strong>de</strong> l’oesophage qui renferme <strong>de</strong>s fibres<br />
musculaires striées<br />
• L’innervation intrinsèque dérive <strong>de</strong>s crêtes neurales par migration <strong>de</strong> cellules à l’origine <strong>de</strong>s<br />
neurones dès la 8ème semaine.<br />
•Défaut <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong> l’anse intestinale<br />
•Occlusions fonctionnelles<br />
•Malformations congénitales par défauts <strong>de</strong> plicatures<br />
(hernie ombilicale, laparoschisis, omphalocèle …)<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
2
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
La cavité buccale<br />
Généralités<br />
La cavité buccale est tapissé par une tunique muqueuse<br />
D’un point <strong>de</strong> vue fonctionnel<br />
L’appareil digestif a une double fonction,<br />
- il assure la réduction <strong>de</strong>s aliments en molécules<br />
simples qui pourront alors être absorbées<br />
- il permet le transport et l’évacuation <strong>de</strong>s déchets<br />
<strong>de</strong> la digestion<br />
La muqueuse buccale<br />
• Un épithélium epi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> (malpighien)<br />
cad stratifié pavimenteux non kératinisé<br />
D’un point <strong>de</strong> vue histologique<br />
• Un chorion papillaire très vascularisé,<br />
avec infiltrats lymphoï<strong>de</strong>s<br />
On distingue 3 parties :<br />
- la cavité buccale (langue, <strong>de</strong>nts, organes du goût,<br />
glan<strong>de</strong>s salivaires)<br />
- le tube digestif proprement dit (série <strong>de</strong> cavités et d’organes creux)<br />
La muqueuse buccale repose sur un tissus conjonctif<br />
sous-muqueux lâche et très vascularisé<br />
- les organes glandulaires annexes (le pancréas et le foie)<br />
La langue<br />
La langue<br />
• Organe musculo-conjonctif<br />
attaché au plancher <strong>de</strong> la cavité buccale par le frein<br />
Trois types <strong>de</strong> papilles linguales<br />
• Formé <strong>de</strong> faisceaux <strong>de</strong> fibres musculaires à<br />
disposition i i plexiforme<br />
• Limitée par la muqueuse linguale (epithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> + chorion)<br />
• En surface, présence <strong>de</strong>s papilles linguales<br />
Papilles caliciformes<br />
Muqueuse linguale<br />
Papilles fongiformes<br />
Papilles filiformes<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
3
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
La langue<br />
La langue<br />
Les papilles filiformes<br />
Les plus nombreuses et dépourvues <strong>de</strong> bourgeons du goût<br />
Rôle essentiellement tactile<br />
L’axe conjonctico-vasculaire contient <strong>de</strong> nombreuses terminaisons<br />
nerveuses<br />
Les papilles fongiformes (fungiques)<br />
Plus volumineuses, mais moins nombreuses<br />
Peuvent contenir <strong>de</strong>s bourgeons du goût<br />
L’axe conjonctico-vasculaire contient <strong>de</strong>s fibres<br />
nerveuses en relation avec les bourgeons du goût<br />
Les papilles caliciforme (circumvallées)<br />
Peu nombreuses (7 à 12)<br />
Exclusivement sur les branches du V lingual<br />
La langue<br />
Limitées par un sillon circulaire: le vallum, au fond duquel<br />
s’abouchent les canaux excréteurs <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />
Les bourgeons du goût<br />
Chémo-récepteurs <strong>de</strong> forme ovoï<strong>de</strong><br />
2000 environ chez l’homme<br />
Au pôle apical, un pore gustatif occupé par<br />
la substance <strong>de</strong> Ranvier<br />
La langue<br />
Epithelium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> avec bourgeons du goût<br />
Trois types cellulaires :<br />
-les cellules périphériques<br />
-les cellules basales<br />
-les cellules centrales speudo-sensorielles<br />
renfermant les bâtonnets gustatifs<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
4
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Le tube digestif<br />
Structure générale du tube digestif<br />
Structure générale du tube digestif<br />
5 tuniques concentriques :<br />
-la muqueuse<br />
-la musculaire muqueuse<br />
-la sous-muqueuse<br />
-la musculeuse<br />
-une adventice ou une séreuse<br />
5 tuniques<br />
Defense immunologique:<br />
lymphocyte,<br />
plasmocytes,<br />
GALT<br />
Sur le plan anatomique, le tube digestif comporte successivement: l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle<br />
(duodénum, jéjunum, l’iléon), puis le gros intestin (colon ascendant, transverse, <strong>de</strong>scendant, sigmoï<strong>de</strong>),<br />
l’appendice, le rectum, le canal anal.<br />
Innervation intrinsèque :<br />
Neurones moteurs<br />
Neurones sensoriels<br />
Neurones sensitifs<br />
Sécréto-vaso-neurones<br />
Structure générale du tube digestif<br />
L’oesophage<br />
5 tuniques<br />
- La musculeuse est constituée <strong>de</strong> fibres musculaires striées<br />
au tiers supérieur, progressivement remplacées par <strong>de</strong>s fibres<br />
musculaires lisses<br />
- La tunique externe est une adventice<br />
Lumière<br />
Sous-muqueuse<br />
Muqueuse<br />
Adventice<br />
Musculeuse<br />
Musculaire muqueuse<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
5
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
L’oesophage<br />
L’estomac<br />
Organe vecteur et propulseur du bol alimentaire<br />
Les aliments y subissent une dégradation mécanique et enzymatique<br />
On y trouve:<br />
- une musculature développée, avec présence d’une 3ème couche <strong>de</strong> F.M.L. obliques<br />
- <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s pour sécréter les enzymes<br />
L’estomac<br />
Aspect macroscopique <strong>de</strong> la muqueuse gastrique<br />
L’estomac<br />
Architecture générale <strong>de</strong> la paroi gastrique: 5 tuniques<br />
Présence <strong>de</strong> petit soulèvement ou « lobules », criblés <strong>de</strong> petits orifices correspondant<br />
à l’ouverture <strong>de</strong>s cryptes (infundibulum)<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
6
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
L’estomac<br />
L’estomac<br />
Particularité régionales <strong>de</strong> la muqueuse gastrique<br />
La muqueuse fundique : Epithélium simple prismatique<br />
Le cardia: zone <strong>de</strong> transition<br />
Dans le chorion, glan<strong>de</strong>s cardiale<br />
qui sécrétent la mucine<br />
4 types cellulaires dans les glan<strong>de</strong>s<br />
fundiques:<br />
- les cellules mucoï<strong>de</strong>s (du collet)<br />
- les cellules bordaes (ou pariétales)<br />
- les cellules principales<br />
- les cellules endocrines<br />
La muqueuse gastrique est formée <strong>de</strong> 2 régions histologiquement différentes:<br />
- la muqueuse fundique<br />
- la muqueuse pylorique<br />
Glan<strong>de</strong>s séreuses en tube droit<br />
L’estomac<br />
L’intestin grêle<br />
La muqueuse pylorique :<br />
Epithélium simple prismatique<br />
Cryptes étroites et profon<strong>de</strong>s<br />
2 types cellulaires dans les<br />
glan<strong>de</strong>s pyloriques:<br />
- les cellules à mucus<br />
- les cellules endocrines<br />
Deux parties histologiques:<br />
- une partie fixe: le duodénum<br />
- une partie mobile: le jéjuno-iléon<br />
Caractérisé par la présence <strong>de</strong> dispositifs d’augmentation <strong>de</strong> la surface d’échange :<br />
Anses intestinales<br />
Valvules conniventes<br />
Villosités intestinales<br />
Microvillosités<br />
Glan<strong>de</strong>s pyloriques tubuleuses contournées<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
7
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
L’intestin grêle<br />
L’intestin grêle<br />
Structure histologique <strong>de</strong> la paroi <strong>de</strong> l’intestin grêle<br />
Deux couches dans la muqueuse:<br />
la couche <strong>de</strong>s villosités<br />
la couche <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s<br />
Les glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lieberkühn : glan<strong>de</strong>s tubuleuses simples, constituées <strong>de</strong> 5 types cellulaires :<br />
Cellules infifférenciées<br />
Entérocytes<br />
Cellules caliciformes<br />
Cell APUD<br />
Cellules <strong>de</strong> Paneth<br />
Quatre types <strong>de</strong> cellules dans les villosités :<br />
les entérocytes<br />
les cellules caliciformes<br />
les cellules « M »<br />
les cellules endocrines<br />
L’intestin grêle<br />
Le colon et le rectum<br />
La sous-muqueuse permet <strong>de</strong> distinguer le duodénum du jéjuno-iléon<br />
Absence <strong>de</strong> valvules conniventes<br />
Absence <strong>de</strong> villosités<br />
Valvules conniventes dans le jéjuno-iléon<br />
Pas <strong>de</strong> cellules <strong>de</strong> Paneth dans la muqueuse<br />
Nombreuses cellules caliciformes<br />
Les follicules lymphoï<strong>de</strong>s ne sont jamais regroupés<br />
en plaque <strong>de</strong> Peyer<br />
Glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Brunner dans le duodénum<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
8
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Le colon et le rectum<br />
Les glan<strong>de</strong>s annexes <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />
La musculeuse est formée d’une couche circulaire interne épaisse<br />
La couche longitudinale externe présente <strong>de</strong>s renforcements :<br />
les ban<strong>de</strong>lettes coeco-coliques<br />
Entre ces 2 couches, on observe les plexus d’Auerbach<br />
- les glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
-le pancréas<br />
- le foie et la vésicule biliaire<br />
Foie<br />
Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
Pancréas<br />
Ban<strong>de</strong>lettes coeco-coliques Plexus d’Auerbach<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires<br />
- les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires (ou microscopiques)<br />
- les glan<strong>de</strong>s salivaires principales (ou macroscopiques) :<br />
Elles sont :<br />
- séreuses : les glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />
- muqueuses : les glan<strong>de</strong>s palatines et <strong>de</strong> la racine <strong>de</strong> la langue<br />
- mixtes : les glan<strong>de</strong>s labiales, linguales<br />
- les paroti<strong>de</strong>s (1)<br />
- les sous maxillaires (2)<br />
- les sub-linguales (3)<br />
Leurs canaux excréteurs sont courts,<br />
peu ou pas ramifiès<br />
Glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />
Glan<strong>de</strong>s palatines<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
9
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Elles forment <strong>de</strong>s organes anatomiquement bien individualisés.<br />
Ce sont glan<strong>de</strong>s composées : lobules contenant <strong>de</strong>s unités sécrétrices et <strong>de</strong>s formations excrétrices<br />
Les unités sécrétrices<br />
Formées par <strong>de</strong>s acini ou <strong>de</strong>s tubulo-acini, entourés <strong>de</strong> cellules myo-épithéliales<br />
On distingue :<br />
- Les acini séreux (cellules pyramidales, lumière étroite)<br />
-les acini muqueux ou tubulo-acini (cellules pyramidales, lumière large)<br />
- les acini séro-muqueux (les cellules muqueuses limitent la lumière et<br />
les cellules séreuses sont disposées en croissant)<br />
Les canaux excréteurs sont longs et ramifiés :<br />
canaux intra-lobulaires, canaux inter-lobulaires, canaux principaux collecteurs<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Les formations excrétrices<br />
Trois types <strong>de</strong> canaux<br />
- les canaux intra-lobulaires<br />
Le canal intercalaire (Passage <strong>de</strong> Boll) fait suite à la formation sécrétrice<br />
et débouche dans le canal strié (<strong>de</strong> Pflüger)<br />
- les canaux inter-lobulaires (ou excréteurs purs)<br />
épithélium prismatique, pluri-stratifié<br />
- les canaux collecteurs<br />
épithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong>venant progressivement<br />
pavimenteux stratifié. Ils s’ouvrent dans la cavité buccale<br />
(A) Canaux intercalaire; (B) canaux striés<br />
Les glan<strong>de</strong>s paroti<strong>de</strong>s<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires les plus volumineuses<br />
Glan<strong>de</strong>s séreuses pures<br />
Les canaux collecteurs sont les canaux <strong>de</strong> Sténon<br />
Lumière étroite délimitée par une mono-couche<br />
<strong>de</strong> cellules pyramidales<br />
Présence <strong>de</strong> nombreux adipocytes<br />
(A) Canaux inter-lobulaires; (B) canaux collecteurs<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
10
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />
Les glan<strong>de</strong>s sous-maxillaires<br />
Les glan<strong>de</strong>s sub-linguales<br />
Glan<strong>de</strong>s principalement séreuses, mais présence <strong>de</strong><br />
quelques acini muqueux u et séro-muqueux<br />
u<br />
Glan<strong>de</strong>s séro-muqueuses, à prédominance muqueuse<br />
Présence d’adipocytes<br />
Canal principal <strong>de</strong> Wharton<br />
Canal principal <strong>de</strong> Rivinus<br />
(D) Canaux excréteurs; (SA) acini séreux; (MA) acini muqueux; (L) lumière<br />
(SD) Croissant <strong>de</strong> Gianuzzi;(MA) acini muqueux; (CT) Tissus conjonctif<br />
Fonctions <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
Le foie et les voies biliaires<br />
Exocrine<br />
Le Foie<br />
Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
Production <strong>de</strong> la salive, composée <strong>de</strong> :<br />
- eau, électrolytes, cellules <strong>de</strong>squamées<br />
- sécrétion séreuse (enzyme)<br />
- sécrétion muqueuse (mucines)<br />
-anticorps(IgA)<br />
- hormones (androgénes, corticoï<strong>de</strong>s)<br />
La salive exerce :<br />
- une action mécanique : dilution <strong>de</strong>s aliments, élimination <strong>de</strong>s débris alimentaires, humidification<br />
- une action digestive (amylase)<br />
- participe à la défense anti-microbienne (IgA, lysozyme, lactoferrine)<br />
Endocrine<br />
La plus volumineuse glan<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisme<br />
Glan<strong>de</strong> amphicrine dont les 2 fonctions sont assurées<br />
par un seul type cellulaire: l’hépatocyte<br />
Double polarité:<br />
- vasculaire correspondant à la fonction endocrine<br />
- canaliculaire correspondant à la sécrétion biliaire<br />
excocrine<br />
Foie<br />
Pancréas<br />
Sécrétions spécifiques: NGF, Parotine<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
11
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Embryogenèse<br />
Le foie<br />
Visible dès le 22éme jour sous l’ébauche cardiaque<br />
Epaississement épithélial endo<strong>de</strong>rmique<br />
Bourgeonnement endo<strong>de</strong>rmique <strong>de</strong> la paroi ventrale du futur duodénum<br />
Vascularisation hépatique<br />
Le foie<br />
Double vascularisation afférente, artérielle et portale<br />
Une vascularisation efférente par les veines sus-hépatiques<br />
Le système porte hépatique comprend 2 réseaux capillaires se<br />
succédant: un artério-veineux i et un veino-veineux<br />
i<br />
La partie craniale <strong>de</strong> l’ébauche forme le foie, la partie moyenne la vésicule<br />
biliaire et le canal cystique<br />
Une excroissance du canal biliaire est à l’origine <strong>de</strong> la vésicule biliaire et du canal<br />
cystique<br />
Interactions entre le méso<strong>de</strong>rme et le cellules <strong>de</strong> l’épithélium endo<strong>de</strong>rmique<br />
et formation <strong>de</strong>s cordons cellulaires qui se différencient en hépatocytes et<br />
en voies biliaires intra-hépatiques<br />
La structure définitive s’établie avec le développement <strong>de</strong> la veine porte<br />
Dans le foie, le sang circule dans un réseau <strong>de</strong><br />
capillaires sinusoï<strong>de</strong>s en étroite relation avec<br />
les hépatocytes organisés en travées <strong>de</strong> Remak<br />
Entre les hépatocytes et les capillaires se trouve<br />
une zone appelée espace <strong>de</strong> Disse<br />
Le parenchyme hépatique<br />
Le foie<br />
Le foie<br />
Le parenchyme hépatique : L’hépatocyte<br />
Structure basée sur la disposition <strong>de</strong>s hépatocytes en travées le long <strong>de</strong>s capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />
Cellule épithéliale polyédrique riche en organites intra-cellulaires<br />
avec noyau central volumineux<br />
Les hépatocytes présentent 3 faces fonctionnelles :<br />
-vasculaire (CS) au contact avec les capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />
Travées <strong>de</strong> Remak convergents vers la veine centro-lobulaire<br />
-face hépatocytaire (FIC)<br />
- face biliaire (CB) avec canalicules biliaires<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
12
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Le foie<br />
Le parenchyme hépatique : Les capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />
Le foie<br />
Le parenchyme hépatique : L’espace <strong>de</strong> Disse<br />
Situé entre les hépatocytes et les cellules endothéliales<br />
Capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />
Paroi constituée <strong>de</strong> cellules<br />
endothéliales fenêtrées<br />
Présence <strong>de</strong> cellules riche en graisse, les cellules <strong>de</strong> Ito ( ou fat storing cells) impliquées dans <strong>de</strong><br />
nombreux processus métaboliques, et activées lors <strong>de</strong> fibrose hépatique<br />
Entre la lame basale et<br />
l’endothélium : espace <strong>de</strong> Disse<br />
cellules <strong>de</strong> Ito<br />
Parmi les cellules endothéliales,<br />
cellules <strong>de</strong> Kupffer, et LAL<br />
cellules <strong>de</strong> Kupffer<br />
Le foie<br />
Organisation du parenchyme hépatique<br />
Le foie<br />
Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />
Organisé autour <strong>de</strong> la veine centro-lobulaire avec <strong>de</strong>s travées d’hépatocytes radiaires<br />
L’unité <strong>de</strong> structure et <strong>de</strong> fonction est le lobule hépatique.<br />
Chez le porc, le lobule est clairement délimité par du tissu<br />
conjonctif, alors que chez l’homme, les limites sont moins<br />
nettes.<br />
Le lobule hépatique classique<br />
Forme un hexagone centré sur une veine centro-lobulaire.<br />
Les angles sont occupés par les espaces portes<br />
(ou espace <strong>de</strong> Kienan).<br />
Cette architecture correspond à l’unité veineuse du foie<br />
Lobule hépatique <strong>de</strong> porc<br />
Lobule hépatique humain<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
13
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Le foie<br />
Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />
Le foie<br />
Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />
Le lobule hépatique classique<br />
Chaque espace porte, renferme:<br />
-une branche <strong>de</strong> la veine porte<br />
- une branche <strong>de</strong> l’artère hépatique<br />
- <strong>de</strong>s capillaires lymphatiques<br />
- une ou <strong>de</strong>ux sections d’un canal biliaire<br />
- <strong>de</strong>s fibres nerveuses<br />
Le lobule portale<br />
Triangulaire, centré sur l’espace porte<br />
Il caractérise une portion <strong>de</strong> parenchyme<br />
dont la bile s’écoule vers une espace porte<br />
Il reflète l’unité <strong>de</strong> sécrétion biliaire,<br />
puisque tous les canalicules biliaires y sont<br />
drainés par un même canal excréteur.<br />
Le foie<br />
Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />
Activité métabolique du foie<br />
Le foie<br />
L’acinus hépatique<br />
Forme <strong>de</strong> losange<br />
Correspond à la plus petite unité fonctionnelle<br />
du foie, c.a.d. au territoire irrigué par<br />
les artères et les veines <strong>de</strong> 2 espaces portes<br />
voisins.<br />
Trois zones dans l’acinus hépatique en<br />
fonction du <strong>de</strong>gré d’oxygénation du sang<br />
circulant dans les sinusoï<strong>de</strong>s.<br />
Métabolisme <strong>de</strong>s gluci<strong>de</strong>s<br />
Métabolisme <strong>de</strong>s lipi<strong>de</strong>s<br />
Métabolisme <strong>de</strong>s proti<strong>de</strong>s<br />
Détoxification<br />
Sécrétion biliaire<br />
Hématopoïèse<br />
Fonction <strong>de</strong> stockage<br />
Défense immunitaire<br />
Régénération hépatique<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
14
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Les voies biliaires<br />
Les voies biliaires<br />
Les voies biliaires intra-hépatiques<br />
Les voies biliaires extra-hépatiques<br />
Canalicule biliaire<br />
Veine porte<br />
Canal biliaire<br />
Passage <strong>de</strong> Hering<br />
Les voies principales: canal hépatique et canal cholédoque<br />
(épithélium prismatique simple,<br />
chorion très vascularisé)<br />
Artère hépatique<br />
Les voies accessoires: canal cystique et vésicule biliaire<br />
Les voies biliaires<br />
Le Pancréas<br />
Les voies biliaires extra-hépatiques<br />
La vésicule biliaire<br />
De 8 à 10 cm <strong>de</strong> long<br />
Elle reçoit la bile aqueuse dilué, l’emmagasine, la concentre,<br />
et évacue une bile épaisse par le canal cholédoque<br />
Sa paroi est formée <strong>de</strong> 3 tuniques : muqueuse, musculeuse, séreuse<br />
Glan<strong>de</strong> mixte, amphicrine.<br />
Les fonctions exocrines et endocrines sont assurées<br />
par <strong>de</strong>s cellules distinctes.<br />
Le pancréas exocrine représente la quasi-totalité <strong>de</strong> la glan<strong>de</strong>.<br />
Formé <strong>de</strong> tubulo-acini séreux et <strong>de</strong> canaux excréteurs.<br />
Foie<br />
Le pancréas endocrine est formée par les ilôts <strong>de</strong> Langerhans.<br />
Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />
Pancréas<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
15
DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
Le Pancréas<br />
Le Pancréas Exocrine<br />
<strong>Histologie</strong> générale<br />
Limitée par une fine cloison conjonctive d’où partent <strong>de</strong>s travées<br />
Parenchyme divisé en lobules<br />
Glan<strong>de</strong> acineuse composée ramifiée, formée <strong>de</strong> :<br />
-acini séreux<br />
- canaux excréteurs ramifiés<br />
• intercalaires<br />
• intralobulaires<br />
• interlobulaires<br />
• collecteurs<br />
-adipocytes<br />
Synthèse <strong>de</strong>s enzymes pancréatiques<br />
Le parenchyme endocrine est formé <strong>de</strong>s ilôts <strong>de</strong> Langerhans<br />
Le parenchyme exocrine est une glan<strong>de</strong> acineuse composée,<br />
(glan<strong>de</strong> <strong>de</strong> type cordonal réticulé)<br />
Le Pancréas Exocrine<br />
- les acini pancréatiques formé <strong>de</strong> cellules séreuses pyramidales<br />
avec <strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> zymogène aux pôles apicaux, et vésicules <strong>de</strong><br />
sécrétion (protéases, lipases, amylase)<br />
Au centre <strong>de</strong> l’acinus, cellules centro-acineuses<br />
Pas <strong>de</strong> cellules myo-épithéliales<br />
-les canaux excréteurs:<br />
les canalicules intercalaires<br />
les canaux intra-lobulaires<br />
les canaux inter-lobulaires<br />
les canaux collecteurs (Wirsung et Santorini) qui rejoignent le canal cholédoque<br />
(A) Canal intercalaire; (B) canal intra-lobulaire; (C canal inter-lobulaire<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />
16