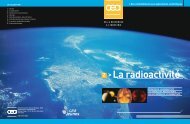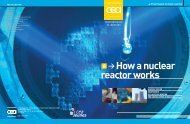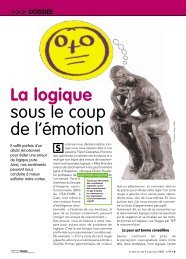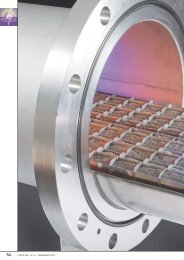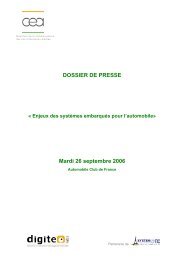La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA
La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA
La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à ... - CEA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CEA</strong> i Décembre 2012<br />
d’étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> d’expériences d’irradiation menées en France <strong>et</strong> en<br />
Europe. Cependant, compte tenu <strong>des</strong> difficultés rencontrées <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> questions restant en suspens, c<strong>et</strong>te voie est aujourd’hui<br />
considérée comme moins attractive que celle m<strong>et</strong>tant en œuvre<br />
une matrice uranium, présentée dans le chapitre suivant.<br />
Figure 23 : schéma du dispositif<br />
d’irradiation expérimental<br />
3.2.2.2. Mode hétérogène en couvertures<br />
(CCAM)<br />
[DTS-15]<br />
Au vu <strong>des</strong> nombreuses inconnues demeurant quant <strong>à</strong> l’utilisation<br />
d’une matrice inerte, son remp<strong>la</strong>cement par de l’uranium<br />
offre <strong>des</strong> avantages évidents en termes de connaissance<br />
<strong>des</strong> combustibles <strong>et</strong> de faisabilité de traitement. Aussi, <strong>la</strong><br />
<strong>transmutation</strong> hétérogène dans <strong>des</strong> couvertures chargées en<br />
actini<strong>des</strong> mineurs (CCAM) a été considérée comme une voie<br />
plus accessible. Néanmoins, c<strong>et</strong>te proposition est re<strong>la</strong>tivement<br />
récente <strong>et</strong> ne bénéficie pour l’heure d’aucune étude expérimentale<br />
apportant <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> de validation.<br />
Le comportement sous irradiation de couvertures contenant<br />
une quantité significative d’actini<strong>des</strong> mineurs, reste empreint<br />
d’incertitu<strong>des</strong>. En eff<strong>et</strong>, les évaluations neutroniques <strong>et</strong> thermomécaniques<br />
re<strong>la</strong>tives aux assemb<strong>la</strong>ges CCAM ont mis en<br />
évidence une forte production de gaz sous irradiation, combinée<br />
<strong>à</strong> <strong>des</strong> niveaux de température modérés dans les pastilles<br />
(500 <strong>à</strong> 1500° C). Une telle combinaison pourrait être propice<br />
<strong>à</strong> un gonflement significatif <strong>des</strong> pastilles d’oxyde d’uranium<br />
chargées en AM <strong>et</strong> conduire <strong>à</strong> une interaction mécanique<br />
forte avec le matériau de gainage <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> combustibles.<br />
En eff<strong>et</strong>, <strong>la</strong> chaîne de <strong>transmutation</strong> <strong>des</strong> AM (<strong>et</strong> en particulier<br />
celle de l’ 241 Am) comporte <strong>des</strong> ém<strong>et</strong>teurs alpha <strong>à</strong> vie courte<br />
dont <strong>la</strong> désintégration va entraîner une production importante<br />
d’hélium (les particules α) s’ajoutant aux produits de<br />
fission gazeux (Xe, Kr). Ces gaz, peu ou pas solubles dans le<br />
combustible, participent dans un premier temps au gonflement<br />
du solide, puis diffusent plus ou moins rapidement,<br />
selon <strong>la</strong> température, vers le volume libre du crayon combustible.<br />
En même temps, <strong>des</strong> défauts créés par l’irradiation perm<strong>et</strong>tent<br />
<strong>la</strong> création de cavités qui vont piéger les gaz <strong>et</strong><br />
conduire <strong>à</strong> <strong>la</strong> formation de bulles intra ou intergranu<strong>la</strong>ires,<br />
responsables du gonflement gazeux du combustible. <strong>La</strong> modélisation<br />
de tous ces mécanismes est très complexe <strong>et</strong> nécessite<br />
<strong>des</strong> données généralement peu disponibles dans les<br />
gammes de concentrations en hélium, d’endommagement <strong>et</strong><br />
de températures propres au fonctionnement <strong>des</strong> CCAM.<br />
Dans le but d’apporter rapidement <strong>des</strong> <strong>éléments</strong> de faisabilité <strong>et</strong> <strong>à</strong><br />
défaut de pouvoir réaliser en France <strong>des</strong> irradiations en RNR, <strong>des</strong><br />
premières irradiations de CCAM seront effectuées en réacteur<br />
d’essais MTR 14 qui, grâce <strong>à</strong> leurs caractéristiques neutroniques <strong>et</strong><br />
leur capacité d’instrumentation, perm<strong>et</strong>tent de réaliser <strong>des</strong> expériences<br />
<strong>à</strong> caractère analytique ou « semi-intégral ». L’objectif est<br />
d’acquérir <strong>des</strong> premières données sur le relâchement d’hélium <strong>et</strong><br />
sur le gonflement <strong>des</strong> pastilles de combustible sous irradiation<br />
dans les conditions de fonctionnement propres aux CCAM.<br />
14 – MTR : acronyme de Material Testing Reactor (réacteur d’essai <strong>des</strong> matériaux<br />
comme le réacteur Osiris de Sac<strong>la</strong>y ou le réacteur Jules Horowitz (RJH) en construction<br />
<strong>à</strong> Cadarache)<br />
Un dispositif d’irradiation spécifique (appelé « mini-aiguille ») a<br />
été conçu pour réaliser <strong>des</strong> expériences analytiques en se rapprochant<br />
de conditions isothermes (cf. Figure 23). Il est constitué de<br />
p<strong>et</strong>its disques (4,5 mm de diamètre, 1 mm d’épaisseur) d’oxyde<br />
(U, AM)O 2<br />
(en rose) disposés dans <strong>des</strong> creus<strong>et</strong>s métalliques en<br />
alliage de molybdène (en bleu). Ces derniers absorbent le rayonnement<br />
gamma qu’ils transforment en chaleur de sorte <strong>à</strong> porter<br />
l’ensemble <strong>à</strong> <strong>la</strong> température voulue.<br />
En cohérence avec les teneurs en AM attendues dans les CCAM,<br />
les échantillons contiennent 15 % d’ 241 Am. Plusieurs températures<br />
sont testées (de 500 <strong>à</strong> 1500° C) <strong>et</strong> deux microstructures sont utilisées<br />
pour déterminer l’eff<strong>et</strong> du taux de porosité ouverte sur le relâchement<br />
d’hélium. Enfin, deux vitesses de production d’hélium<br />
sont également testées (en diminuant <strong>la</strong> teneur en 241 Am) de façon<br />
<strong>à</strong> déterminer l’eff<strong>et</strong> de ce paramètre sur le gonflement. Il est en<br />
eff<strong>et</strong> nécessaire de vérifier que le gonflement <strong>des</strong> CCAM irradiées<br />
dans un spectre de MTR est « enveloppe » de celui attendu en<br />
spectre rapide afin de pouvoir ultérieurement exploiter <strong>à</strong> <strong>des</strong> fins<br />
de dimensionnement, les lois qui seront tirées de ces expériences.<br />
Pour tester l’ensemble <strong>des</strong> configurations correspondant <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />
grille expérimentale dans un p<strong>la</strong>nning serré, deux irradiations<br />
successives <strong>et</strong> complémentaires ont été programmées <strong>à</strong> un an<br />
d’intervalle : l’irradiation Marios faite dans le réacteur HFR 15<br />
(dans le cadre du proj<strong>et</strong> européen Fairfuels) <strong>et</strong> l’irradiation Diamino<br />
menée dans le réacteur Osiris <strong>à</strong> Sac<strong>la</strong>y, comportant respectivement<br />
quatre <strong>et</strong> six mini-aiguilles, chaque mini-aiguille étant<br />
dédiée <strong>à</strong> l’étude d’une configuration expérimentale.<br />
L’irradiation Marios dans le HFR a débuté en mars 2011 <strong>et</strong> s’est<br />
terminée en mai 2012. Les premiers examens non <strong>des</strong>tructifs sont<br />
attendus en fin d’année 2012. L’irradiation Diamino, initialement<br />
programmée début 2012, a été décalée de quelques mois suite <strong>à</strong><br />
<strong>des</strong> difficultés de fabrication <strong>des</strong> mini-aiguilles. L’ensemble <strong>des</strong><br />
examens post-irradiatoires sera réalisé dans <strong>la</strong> période 2012-2016.<br />
Au-del<strong>à</strong> de ces premiers essais, il est proj<strong>et</strong>é de réaliser <strong>des</strong> irradiations<br />
semi-intégrales sur <strong>des</strong> tronçons d’aiguilles comportant<br />
quelques pastilles : une irradiation dans le réacteur américain<br />
ATR est <strong>à</strong> l’étude dans le cadre d’une col<strong>la</strong>boration avec le DOE<br />
<strong>et</strong> une irradiation dans le réacteur HFR (irradiation Marine) a<br />
été initiée dans le cadre du proj<strong>et</strong> européen Pelgrimm.<br />
Les étapes suivantes comporteront <strong>des</strong> expériences d’irradiation<br />
sur <strong>des</strong> aiguilles complètes représentatives du concept<br />
final, al<strong>la</strong>nt jusqu’<strong>à</strong> une qualification <strong>à</strong> l’échelle d’un ou plusieurs<br />
assemb<strong>la</strong>ges. Le réacteur Astrid sera conçu pour perm<strong>et</strong>tre<br />
<strong>la</strong> réalisation de ces expériences [DTS-16].<br />
15 – High Flux Reactor : réacteur <strong>à</strong> haut flux situé <strong>à</strong> P<strong>et</strong>ten (Pays-Bas).<br />
33