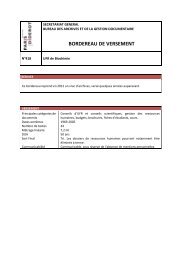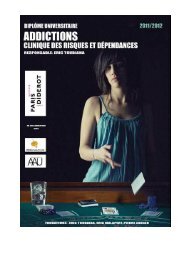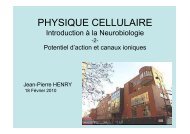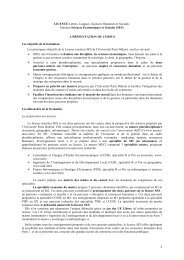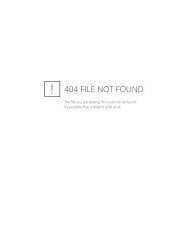Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Document scientifique associé 2008<br />
Cette réflexion théorique et générale sur les enjeux de la pratique philologique sera mise en regard<br />
avec une archéologie de cette pratique. Dans un séminaire coorganisé par Sophie Rabau et l’université<br />
de Chicago (« Sur les commentaires de Racine à l’Odyssée »), donnant lieu à une journée d’études, on<br />
analysera le lieu par excellence de la lecture philologique, les commentaires des textes anciens et<br />
modernes que nous ont laissés les siècles classiques. Les commentaires de Jean Racine à l’Odyssée<br />
constituent en effet un précieux témoignage sur l’histoire de l’interprétation des textes anciens, d’autant<br />
qu’il convient de les replacer dans le contexte de la Querelle des Anciens et des Modernes. Cette<br />
approche historique est indissociable de la construction d’une poétique et d’une théorie <strong>du</strong> commentaire :<br />
parce qu’elles lient étroitement la paraphrase, la tra<strong>du</strong>ction et l’exégèse, ces notes sur l’Odyssée offrent un<br />
cas d’école privilégié pour préciser les liens entre métatexte et hypertexte, mais aussi pour interroger la<br />
frontière entre la restitution <strong>du</strong> texte et son interprétation. Dans la même optique, elles permettent, si on<br />
les replace dans l’histoire large de l’interprétation <strong>du</strong> texte homérique, une réflexion sur la notion de<br />
difficulté textuelle (ce qu’Aristote nommait déjà les « problèmes homériques »), et bien évidemment sur<br />
les présupposés critiques qui peuvent expliquer la construction de ces difficultés. Enfin, ces notes<br />
confectionnées par le jeune Racine ont été très vite reçues comme des reliques précieuses où il faudrait<br />
deviner sous la plume <strong>du</strong> lecteur la marque <strong>du</strong> futur écrivain. Existe-il une auctorialité <strong>du</strong> commentaire <br />
Et dans ce cas, faut-il commenter les commentaires de Racine pour y rencontrer Racine avant qu’il ne<br />
devienne Racine (C1)<br />
On se propose également d’étudier, dans un ouvrage collectif dirigé par Christine Noille-Cauzade<br />
(Les commentaires classiques de l’Enéide : entre rhétorique et interprétation), la tradition <strong>du</strong><br />
commentaire rhétorique, totalement ignoré des historiens et des théoriciens contemporains de la<br />
littérature. Cette longue tradition (XVIe-XIXe), qui a laissé un corpus abondant, a transmis la mémoire et<br />
le culte des modèles antiques. On montrera que le commentaire classique des œuvres littéraires profanes<br />
est ten<strong>du</strong> entre une explicitation <strong>du</strong> sens littéral (grammatical, historique et rhétorique) et un<br />
approfondissement <strong>du</strong> sens spirituel (allégorique et moral), entre une perspective globalement<br />
philologique et rhétoricienne et une approche interprétative. En se focalisant sur l’analyse <strong>du</strong> corpus<br />
critique sur les commentaires classiques (en néo-latin ou en langues vernaculaires) consacrés à l’Enéide<br />
de Virgile, modèle à la fois narratif et discursif pour toute la culture européenne de la Renaissance et des<br />
XVIIe-XVIIIe siècles, l’équipe chargée de cette action se demandera quel type de savoir est mis en<br />
œuvre dans les commentaires, savoir rhétorique et/ou savoir herméneutique (C5).<br />
Enfin, cet axe propose un travail sur la relation entre interprétation et tra<strong>du</strong>ction, sans<br />
présupposer que l’acte de comprendre ou l’interprétation viennent seuls à bout de l’acte de tra<strong>du</strong>ire. Ce<br />
croisement suscite plusieurs questions : a) celle <strong>du</strong> degré zéro de la signification : une tra<strong>du</strong>ction sans<br />
interprétation a-t-elle un sens b) La question des tra<strong>du</strong>ctions contre-interprétatives ou tra<strong>du</strong>ctionsreconstructions<br />
(re-tra<strong>du</strong>ction des textes canoniques, Bible, Homère, Dante, Cervantès, Mille et une nuits,<br />
Coran, Poe, Melville, etc.) ; c) celle <strong>du</strong> niveau infra interprétatif par le biais de la physique <strong>du</strong> langage et<br />
de ton, dont Jean Paulhan disait que c’était la part la plus impardonnable d’un discours qu’un tra<strong>du</strong>cteur<br />
puisse rater. Enfin d), se pose la question heuristiquement générique au sens où l’on pourrait se demander<br />
à quel régime d’interprétation les différents « genres » de discours font appel et selon quelles variations et<br />
comment un texte peut commander un régime interprétatif singulier (C4, « Enjeux interprétatifs de la<br />
tra<strong>du</strong>ction »). Ce travail, comprenant séminaires et journées d’études, sera coordonné par Régis Salado<br />
et Jean-Patrice Courtois.<br />
Cette réflexion collective sera également nourrie par deux conférences données sur le<br />
changement de sens, dans le cadre <strong>du</strong> travail sur les théories de la signification mené par V. Nyckees<br />
(C6).<br />
IV Usages et effets de l’interprétation<br />
On travaillera dans cet axe, à se demander ce que fait l’interprétation : quelle est son efficacité <br />
Dans quels territoires – mentaux, existentiels, sociaux, politiques, esthétiques… – ses gestes débouchentils<br />
Comment son action se développe-t-elle dans la <strong>du</strong>rée Avec quels effets, à la fois sur ses objets et<br />
sur ses acteurs Il s’agira<br />
HERMES<br />
12