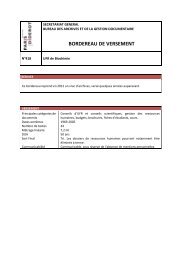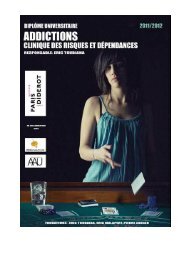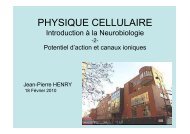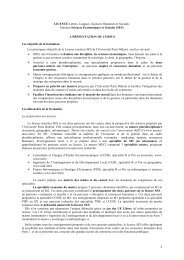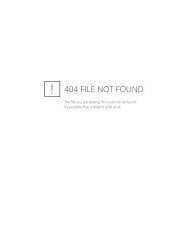Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Document scientifique associé 2008<br />
ses enjeux. On se propose, par exemple de confronter des représentants de la philologie et de<br />
l’herméneutique modernes (C2). En partenariat avec l’université de Chicago et la revue Modern<br />
Philology, on dégagera les implications herméneutiques d’une « poétique de la philologie » (C3). On<br />
confrontera les différentes théories de la réception (D1, D2) et l’interaction entre interprétation et<br />
lecture (B2, D4). Sera également évaluée la pertinence des concepts d’auctorialité et d’intentionnalité<br />
(B2), en droit en en littérature (B3). On s’intéressera à l’état <strong>du</strong> débat sur l’interprétation en sciences<br />
religieuses (A8) ; on procèdera à mise en relation de ces problématiques.<br />
Le troisième objectif consiste à éclairer, l’un par l’autre, débat contemporain et textes anciens, en<br />
privilégiant une perspective comparatiste, diachronique et une réflexion sur les anciens partages<br />
disciplinaires :<br />
- Cette mise en perspective privilégie la période dite moderne (<strong>du</strong> seizième au dix-huitième siècle), et<br />
les auteurs français, italiens (pour l’histoire de la médecine et l’histoire de l’art) et anglais (pour<br />
l’histoire des sciences). Cette période, et tout particulièrement la Renaissance, est en effet marquée<br />
par la construction d’outils nouveaux pour encoder et déchiffrer le sens, souvent en relation avec la<br />
polémique religieuse (A7, D5) et les contraintes de la censure (D7). La relation de l’interprétation au<br />
corps, rarement envisagée, retiendra particulièrement l’attention (D6). On se propose aussi de<br />
revisiter, dans une perspective méta-critique, la notion foucaldienne d’épistémé de la Renaissance,<br />
comme pratique herméneutique enfermée dans un système figé de lecture des signes (A3). Seront<br />
envisagés de façon privilégiée les rapports entre sciences et littérature (A3), médecine, philosophie et<br />
littérature (A4). Ces recherches figurent parmi les points forts <strong>du</strong> <strong>projet</strong>, car l’histoire de la sémiotique<br />
médicale et humaniste reste à faire, et nous espérons en poser les jalons.<br />
- Deux actions auront enfin pour objet d’éclairer l’archéologie de la philologie. L’une consistera en<br />
une étude de la tradition <strong>du</strong> commentaire rhétorique (en particulier sur l’Enéide, C5); l’autre portera<br />
sur les commentaires de Racine à l’Odyssée, dans le but d’interroger la frontière entre la restitution <strong>du</strong><br />
texte et son interprétation (C1).<br />
Ces études n’ont en effet pas pour unique objectif la connaissance d’un pan méconnu <strong>du</strong> passé, mais<br />
visent à enrichir le questionnement collectif sur l’interprétation grâce à l’apport d’un éclairage<br />
diachronique.<br />
Un des objectifs majeurs <strong>du</strong> <strong>projet</strong> est d’œuvrer en faveur d’une reconfiguration interdisciplinaire.<br />
- On confrontera le débat actuel sur l’interprétation dans les domaines des études littéraires, <strong>du</strong> droit et<br />
des sciences religieuses. Outre la réflexion conceptuelle, qui mobilisera des chercheurs éminents<br />
venus de ces disciplines (B6, B10), quelques points spécifiques (comme le rôle de l’intentionnalité<br />
auctoriale) seront traités conjointement par des juristes et des spécialistes de littérature. L’absence de<br />
tradition française, dans ce domaine, exige la collaboration de chercheurs américains.<br />
- On se demandera également si la psychanalyse continue à offrir un modèle herméneutique aux<br />
études littéraires (B9). En collaboration avec un praticien et spécialiste dans cette discipline on<br />
s’interrogera sur les enjeux de son éventuelle substitution par les sciences cognitives, en s’efforçant de<br />
répertorier, d’analyser et de diffuser les résultats obtenus jusqu’ici par la rencontre entre les études<br />
littéraires et les sciences cognitives (B6). La résistance qu’elles rencontrent vient-elle de la possibilité<br />
d’instauration, perçue comme une menace, d’un nouveau positivisme, qui ferait perdre toute<br />
spécificité aux sciences humaines, si ce n’est à l’homme lui-même (Schaeffer, La Fin de l’exception<br />
humaine, 2007) Risquent-t-elles de classer le débat sur l’interprétation, ou peuvent-elles au<br />
contraire lui apporter un éclairage nouveau C’est en tout cas dans cette interrogation et dans la<br />
tentative pour instaurer un dialogue informé entre ces disciplines que résident la difficulté et l’enjeu<br />
majeur de la recherche que nous souhaitons entreprendre.<br />
HERMES<br />
6