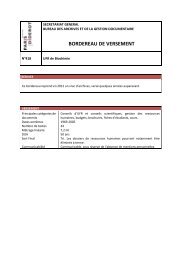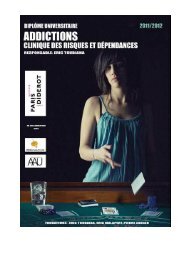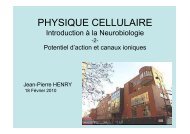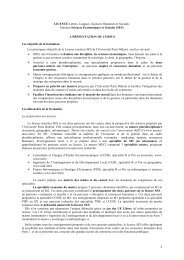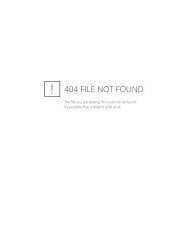Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
Texte du projet - Université Paris Diderot-Paris 7
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Document scientifique associé 2008<br />
métaphore <strong>du</strong> « livre de la nature » définit un rapport à l’investigation de la nature qui doit beaucoup<br />
aux techniques proprement littéraires et exégétiques de l’interprétation. Mais avec Galilée, et sa<br />
fameuse mention d’un livre écrit « en langage mathématique », la validité même <strong>du</strong> rapprochement<br />
traditionnel entre exégèse et philosophie naturelle, entre Livre de Dieu et Livre de la Nature, est<br />
remise en cause. Replacée au sein d’une large réflexion sur l’interprétation à la même période, la<br />
notion de « livre de la nature » apparaît comme une métaphore centrale, capable d’éclairer les rapports<br />
<strong>du</strong> littéraire et <strong>du</strong> scientifique dans un effort encore commun d’élucidation <strong>du</strong> monde, mais aussi de<br />
mettre en lumière l’évolution des techniques de la pratique interprétative d’une discipline à l’autre.<br />
En relation étroite avec cette problématique, une autre action (A4 « Interpréter les signes,<br />
interpréter les faits : herméneutique et discours médical, XVI-XVIIe siècles »), coordonnée par<br />
Andrea Carlino, se propose de poser les jalons d’une histoire de la sémiotique médicale et humaniste.<br />
En médecine, la question de savoir comment les signes <strong>du</strong> corps sont observés, récoltés, organisés et<br />
interprétés est cruciale ; elle est reconnue comme une interrogation préalable à toute action<br />
thérapeutique (par exemple chez Galien). Au-delà de très nombreuses occurrences de cette question<br />
dans les textes de théorie et de pratique médicales, une littérature spécifique sur la sémiotique en<br />
médecine existe déjà au XVIe et XVIIe siècles, qui n’a pas été étudiée. Il est proposé a) de constituer<br />
un corpus cohérent d’ouvrages médicaux (surtout français et italiens) consacrés à la sémiotique et à la<br />
relation entre interprétation et action, b) de tracer les rapports multiples et variés qu’implique la (les)<br />
théorie(s) de la sémiotique à la Renaissance (philologie, philosophie, droit et médecine), c) d’étudier<br />
l’intégration d’une démarche épistémologique fondée sur l’observation et l’évidence empirique dans<br />
la tradition dogmatique de la médecine classique. Une des hypothèses est que l’émergence d’une<br />
herméneutique des faits (vs. l’herméneutique des signes) dans la médecine <strong>du</strong> XVIe et XVIIe siècles a<br />
pu impliquer une reconfiguration des pratiques discursives et des opérations langagières dans la<br />
construction des récits médicaux. Cette action, qui se déroulera pendant plusieurs années, consistera<br />
en séminaires, journées d’études, publications et consitution d’un fonds documentaire.<br />
Cet axe de recherche soulève aussi la question <strong>du</strong> renouvellement de l’hérméneutique, entre XVIe<br />
et XVIIIe siècles, à la lumière des polémiques et politiques religieuses. On a beaucoup spéculé, et<br />
depuis longtemps, sur les effets de la Réforme dans le champ herméneutique et en particulier sur la<br />
mise en place de nouvelles normes, philologiques, rhétoriques et historiques. On a moins examiné<br />
pour eux-mêmes les nouveaux dispositifs typographiques et iconographiques que les exégètes<br />
développent, souvent dans des visées qui sont ouvertement ou implicitement polémiques ; c’est ce que<br />
l’on se propose d’étudier dans une recherche collective, menée par François Lecercle, sur l’inscription<br />
et la programmation de l’exégèse dans les textes et les images dans la période moderne, <strong>du</strong> XVIe au<br />
XVIIIe siècles (A7, Les nouvelles armes exégétiques : dispositifs typographiques et<br />
iconographiques (XVIe-XVIIe s.). Cette action, qui prendra la forme d’un séminaire, d’un colloque<br />
et de la constitution d’un fonds documentaire sera mise en résonance avec la récapitulation des<br />
grandes évolutions de l’interprétation religieuse, dans les religions juives et chrétiennes, dans une<br />
perspective diachronique (A8). Elle reposera sur une série de conférences assurées par Suzanne Last<br />
Stone.<br />
Cette recherche comprendra une interrogation spécifique sur le rôle de l’image dans l’évolution<br />
des dispositifs exégétiques à l’âge moderne (A7), que l’on confrontera avec une réflexion<br />
d’ensemble sur l’histoire de l’interprétation de l’image (au cours d’une université d’été organisée<br />
par Marc Vernet : « Les modalités d’interprétation de l’image, de la sculpture antique à l’image<br />
numérique :de la description à l’interprétation »).<br />
Enfin, de même que le <strong>projet</strong> sur la sémiologie médicale (A4) entend réexaminer la notion<br />
foucaldienne d’épistémè de la Renaissance (dans la lignée de I. Mac Lean, Le monde et les hommes,<br />
<strong>Paris</strong> 2006), on s’interrogera sur l’actualité, pour la période qui nous occupe, des concepts<br />
bakhtiniens de « chronotope », de « dialogisme » et de « carnavalesque » (A6), au cours d’une<br />
journée organisée par Chantal Liaroutzos et Marc Hersant.<br />
Ainsi, l’ensemble de ces actions devrait apporter un éclairage nouveau sur la façon est envisagée<br />
l’interprétation « au seuil de la modernité », et les enjeux de ces évolutions majeures, en interrogeant<br />
aussi la manière dont elles ont été pensées et comprises depuis les années 70.<br />
HERMES<br />
8