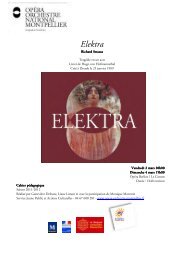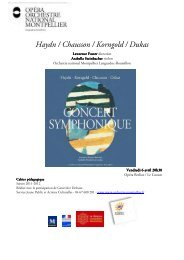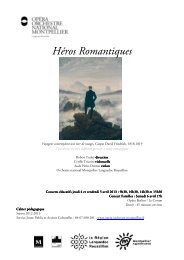Wagner / Lutoslawski / Schubert - Opéra Orchestre National ...
Wagner / Lutoslawski / Schubert - Opéra Orchestre National ...
Wagner / Lutoslawski / Schubert - Opéra Orchestre National ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Julius Schmidt (1854-1935) – <strong>Schubert</strong>iade (1897)<br />
Tous droits réservés, diffusion limitée et gratuite à l’usage pédagogique<br />
<strong>Wagner</strong> / <strong>Lutoslawski</strong> / <strong>Schubert</strong><br />
David Afkham direction<br />
<strong>Orchestre</strong> national Montpellier Languedoc Roussillon<br />
Vendredi 16 Novembre 20h<br />
Concert découverte famille :<br />
Samedi 17 Novembre 17h<br />
Opéra Comédie<br />
Durée : 1h45 environ avec entracte<br />
Cahier pédagogique<br />
Saison 2012-2013<br />
Réalisé par Liane Limon<br />
Service Jeune Public et Actions Culturelles - 04 67 600 281 - www.opera-orchestre-montpellier.fr
Programme<br />
<strong>Wagner</strong> / <strong>Lutoslawski</strong> / <strong>Schubert</strong><br />
Richard <strong>Wagner</strong><br />
Siegfried Idyll, WWV 103<br />
Witld <strong>Lutoslawski</strong><br />
Trauermusik pour orchestre à cordes (à la mémoire de Bartók)<br />
Franz <strong>Schubert</strong><br />
S<br />
Symphonie n°9 en ut Majeur « La Grande » D.944<br />
David Afkham direction<br />
<strong>Orchestre</strong> national Montpellier Languedoc-Roussillon
Siegfried Idyll, , WWV 103 de Richard <strong>Wagner</strong><br />
<strong>Wagner</strong> a composé cette œuvre dans le calme de sa retraite de Tribschen, près de Lucerne où il s’était réfugié<br />
depuis 1866, fuyant les intrigues de la Cour de Bavière. C’est dans une ambiance de sérénité et de bonheur, retiré<br />
du monde, que <strong>Wagner</strong> composa cette idylle à l’origine pour sa seconde femme Cosima, à l’occasion de la<br />
naissance de leur fils Siegfried. Pour la première fois, en raison de difficultés financières, <strong>Wagner</strong> et son épouse<br />
avaient décidé de ne pas s’offrir de présents à Noël, il contourna l’obstacle en lui faisant don de l’Idyll. Elle fut<br />
jouée pour la première fois le 25 décembre 1870, pour la fête d’anniversaire de Cosima, par un ensemble d’une<br />
quinzaine de musiciens dans la villa des <strong>Wagner</strong> à Tribschen. <strong>Wagner</strong> intitula l’œuvre « Hommage d’anniversaire<br />
symphonique », souvent il la nommait Tribschen-Idyll (musique d’escalier). Le titre de Siegfried-Idyll date de la<br />
première véritable exécution publique de l’œuvre à Meiningen le 10 mars 1877.<br />
Après cette date, <strong>Wagner</strong> l’arrangea pour orchestre symphonique afin de la jouer en public. Il reprend un<br />
mouvement de son quatuor en mi majeur en changeant le rythme du second thème en valse, le tout agrémenté de<br />
plusieurs motifs, extraits de Siegfried, drame musical du même nom, sur lequel <strong>Wagner</strong> travaillait depuis plusieurs<br />
années.<br />
Orchestration<br />
1 Flûte<br />
1 Hautbois<br />
2 Clarinettes<br />
tes<br />
1 Basson<br />
2 Cors<br />
1 Trompette<br />
Violon 1<br />
Violon 2<br />
Alto<br />
Violoncelle<br />
Contrebasse<br />
Pour l’effectif symphonique, les pupitres de cordes sont doublés.<br />
Forme 1<br />
La section d’ouverture confiée au quatuor à cordes est assez développée, on y retrouve entre autres, le thème<br />
ascendant de l’ « Immortelle bien-aimée » extrait de Siegfried :<br />
1<br />
Guide de la musique symphonique, ed. Fayard
Puis à la flûte on entend le thème du « Sommeil de Brünnhilde » repris ensuite par les bois et se mêlant au thème<br />
précédent.<br />
Le hautbois murmure la berceuse, composée d’un thème populaire et d’un motif plus lyrique et tendre.<br />
L’accompagnement des cordes divisées, sautillantes évoque des images de comptine.<br />
Tous ces éléments s’entremêlent jusqu’au thème du « Trésor du monde » (chanté par Brünnhilde dans Siegfried)<br />
triomphant et conquérant.
Il est interrompu par des appels de l’Oiseau cités par les cors et à la clarinette puis la flûte :<br />
Le thème du « Trésor du monde » revient encore plus guerrier, avant l’élan de tendresse final :<br />
Un long et doux final reprend les thèmes de l’œuvre avant de terminer sur une tenue pianissimo et sereine.
Richard <strong>Wagner</strong><br />
Wilhelm Richard <strong>Wagner</strong> occupe une place importante dans l'histoire de la musique occidentale par<br />
l'intermédiaire de ses opéras qui bousculent délibérément les habitudes de l'époque pour aller, selon ses propres<br />
termes, vers un « art total » : spectacle complet, mélodie continue et emploi du leitmotiv.<br />
Sa vie bohème et fantasque lui fait endosser de multiples habits : révolutionnaire sans le sou, fugitif traqué par la<br />
police, homme à femmes, confident intime du roi Louis II de Bavière, critique et analyste musical, son<br />
comportement et ses œuvres ne laissent personne indifférent. Ses conceptions artistiques avant-gardistes ont eu<br />
une influence déterminante dans l'évolution de la musique dès le milieu de sa vie.<br />
Richard <strong>Wagner</strong> est né à Leipzig le 22 mai 1813. Son père meurt six mois après sa naissance. Au mois d'août de<br />
l'année 1814, sa mère épouse l'acteur Ludwig Geyer. Il nourrit d'abord l'ambition de devenir dramaturge, puis<br />
vers l'âge de quinze ans, il découvre la musique qu'il décide d'étudier en s'inscrivant à l'université de Leipzig en<br />
1831. Parmi les compositeurs qui exercent sur lui une influence notable, on peut citer Carl Maria von Weber,<br />
Ludwig van Beethoven et Franz Liszt. En 1834, <strong>Wagner</strong> achève l'un de ses premiers opéras, Les Fées. Cette œuvre<br />
ne sera pas jouée avant plus d'un demi-siècle, en 1888. À la même époque, <strong>Wagner</strong> réussit à décrocher un poste<br />
de directeur musical à l'opéra de Wurzbourg puis à celui de Magdebourg, ce qui le sort de quelques ennuis<br />
pécuniaires. La même année, <strong>Wagner</strong> épouse l'actrice Minna Planer. Le couple emménage alors à Königsberg<br />
puis à Rīga, où <strong>Wagner</strong> occupe le poste de directeur musical. Avant même 1839, le couple est criblé de dettes et<br />
doit fuir Riga pour échapper aux créanciers, ils passent quelques années à Paris où <strong>Wagner</strong> gagne sa vie en<br />
réorchestrant les opéras d'autres compositeurs.<br />
En 1942, il retourne en Allemagne avec Minna à Dresde, où il rencontre un succès considérable. Pendant six ans,<br />
<strong>Wagner</strong> exerce avec brio le métier de chef d'orchestre du grand théâtre de la ville et compose et met en scène ses<br />
premiers chefs-d'œuvre (Tannhäuser, le Vaisseau fantôme…). Pour des raisons politiques, <strong>Wagner</strong> est forcé de<br />
fuir, d’abord à Paris puis à Zurich.<br />
C'est en exil que <strong>Wagner</strong> passe les douze années suivantes évoluant dans une situation très précaire, à l'écart du<br />
monde musical allemand, sans revenu et avec peu d'espoir de pouvoir faire représenter les œuvres qu'il compose.<br />
Pendant les premières années qu'il passe à Zurich, <strong>Wagner</strong> produit des essais.<br />
Durant ces années, deux sources d’inspiration l’ont influencé en particulier pour la composition de Tristan et<br />
Isolde. La philosophie de Schopenhauer, axée sur une vision pessimiste de la condition humaine, est très vite<br />
adoptée par <strong>Wagner</strong> et de nombreux aspects de cette doctrine transparaîtront dans ses livrets. La seconde source<br />
d’inspiration est le poète et écrivain, Mathilde Wesendonck, femme du riche commerçant Otto von<br />
Wesendonck. Suite à un amour impossible avec le poète, <strong>Wagner</strong> entame la composition de son opéra. Cette<br />
œuvre, issue donc d’une crise déclenchée par cet amour impossible, correspond à la perfection au modèle<br />
romantique d’une création inspirée par des sentiments contrariés.<br />
Lorsqu’il peut enfin retourner en Allemagne, <strong>Wagner</strong> s’installe à Biebrich, où il commence à travailler sur Les<br />
Maîtres Chanteurs de Nuremberg. Cet opéra est de loin son œuvre la plus joyeuse. La carrière de <strong>Wagner</strong> prend un<br />
virage spectaculaire en 1864, lorsque le roi Louis II accède au trône de Bavière, à l'âge de 18 ans. Le jeune roi, qui<br />
admire les opéras de <strong>Wagner</strong> depuis son enfance, décide en effet de faire venir le compositeur à Munich. Il règle<br />
ses dettes considérables et s'arrange pour que son nouvel opéra, Tristan et Isolde, puisse être monté. Malgré les<br />
énormes difficultés rencontrées lors des répétitions, la première a lieu le 10 juin 1865 et rencontre un succès<br />
retentissant. <strong>Wagner</strong> se trouve ensuite mêlé à un scandale du fait de sa liaison avec Cosima von Bülow, femme de<br />
Hans von Bülow, un fervent partisan de <strong>Wagner</strong>. Cosima est la fille de Franz Liszt et de la comtesse Marie<br />
d'Agoult. En avril 1965, elle donne naissance à une fille prénommée Isolde. La nouvelle s'ébruite rapidement et<br />
scandalise tout Munich. Pour ne rien arranger, <strong>Wagner</strong> tombe en disgrâce auprès des membres de la Cour qui le<br />
soupçonnent d'influencer le jeune roi. En décembre 1865, Louis II est contraint de demander au compositeur de<br />
quitter Munich. <strong>Wagner</strong> part s'installer à Tribschen, près de Lucerne, sur les bords du lac des Quatre-Cantons.<br />
En octobre, Cosima convainc finalement son mari de divorcer. Le 25 août 1870, elle épouse <strong>Wagner</strong> et ce second<br />
mariage dure jusqu'à la mort du compositeur. Ils auront une autre fille, Eva, et un fils prénommé Siegfried.
Une fois installé dans sa nouvelle vie de famille, <strong>Wagner</strong> met toute son énergie à terminer la Tétralogie.<br />
En 1871, il choisit la petite ville de Bayreuth pour accueillir sa nouvelle salle d'opéra. Les <strong>Wagner</strong> s'y rendent<br />
l'année suivante et la première pierre du Festspielhaus (« Palais des festivals ») est posée. Louis II et la baronne<br />
Marie von Schleinitz s'investissent pour aider à financer le bâtiment. Afin de rassembler les fonds pour la<br />
construction, <strong>Wagner</strong> entreprend également une tournée de concerts à travers l'Allemagne et diverses associations<br />
de soutien sont créées dans plusieurs villes. Il faut cependant attendre une donation du roi Louis II en 1874 pour<br />
que l'argent nécessaire soit enfin rassemblé. Un peu plus tard dans l'année, les <strong>Wagner</strong> emménagent à Bayreuth<br />
dans une villa que Richard surnomme Wahnfried (« Paix des illusions »). Le Palais des festivals ouvre ses portes le<br />
13 août 1876, à l'occasion de la représentation de L'Or du Rhin, début d'exécution de trois cycles complets de la<br />
Tétralogie. D'illustres invités sont conviés à ce premier festival : l'empereur Guillaume Ier, l'empereur Pierre II du<br />
Brésil, le roi Louis II ainsi que les compositeurs Bruckner, Grieg, Vincent d'Indy, Liszt, Saint-Saëns,<br />
Tchaïkovski...<br />
D'un point de vue artistique, ce festival est un succès remarquable, financièrement, c'est toutefois un désastre<br />
absolu. <strong>Wagner</strong> doit renoncer à organiser un second festival l'année suivante et tente de réduire le déficit en<br />
donnant une série de concerts à Londres.<br />
En 1877, <strong>Wagner</strong> s'attelle à son dernier opéra, Parsifal, qu'il finit à Palerme pendant l'hiver 1881-82. Pendant la<br />
composition, il écrit également une série d'essais réactionnaires sur la religion et l'art. Il met la dernière main à<br />
Parsifal en janvier 1882, et le présente lors du second Festival de Bayreuth. À cette époque, <strong>Wagner</strong> est<br />
gravement malade. Le mardi 13 février 1883, il est emporté par une crise cardiaque, au palais Vendramin Calergi<br />
de Venise. Son corps est rapatrié et inhumé dans le jardin de sa maison de Wahnfried, à Bayreuth.<br />
Portrait de Richard <strong>Wagner</strong><br />
Tous droits réservés, diffusion gratuite à l’usage pédagogique
Trauermusik pour orchestre à cordes (à la mémoire de Bartók)<br />
de Witold <strong>Lutoslawski</strong><br />
L’attention fut attirée sur <strong>Lutoslawski</strong> en Europe occidentale dans le milieu des années 1950, peu après la<br />
création de son Concerto pour orchestre en novembre 1954 à Varsovie. Dans cette œuvre, on percevait déjà une<br />
envie de rompre avec les stéréotypes du réalisme et du néoclassicisme. D’ailleurs on ne peut éviter d’évoquer<br />
Bartók dans ses compositions de par son langage et les caractéristiques de son orchestration. Cependant c’est sa<br />
Musique funèbre qui montre l’édification d’une écriture nouvelle par l’apport d’une élaboration sérielle simple<br />
mais efficace.<br />
En 1954, le chef d’orchestre, Jan Krenz avait suggéré à <strong>Lutoslawski</strong> d’écrire une pièce qui serait jouée l’année<br />
suivante pour le dixième anniversaire de la mort de Bartók mais l’œuvre ne vit le jour qu’en 1958. C’est la<br />
première fois qu’il utilise la série de douze sons mais en fait un usage très différent de celui de Schönberg. Il a<br />
d’ailleurs toujours refusé toute parenté avec l’école de Vienne et ses compositeurs.<br />
Il affirme ceci à propos de ses œuvres postérieures au Concerto pour orchestre :<br />
Orchestration<br />
« C’est Musique funèbre qui a donné le premier résultat de mes travaux sur l’écriture »<br />
Witold <strong>Lutoslawski</strong> 2<br />
12 violons<br />
12 violons II<br />
8 altos<br />
8 violoncelles<br />
6 contrebasses<br />
Un orchestre à cordes est un ensemble formé exclusivement d'instruments à cordes : violons, altos, violoncelles<br />
et contrebasses. Selon les périodes de l’histoire ou les genres musicaux abordés, à cette formation fondamentale<br />
peuvent être ajoutés un clavecin, une harpe, plus rarement un piano. Le nombre d'instrumentistes par pupitre<br />
peut être très variable d'une œuvre à l'autre. Au XXe siècle, les compositeurs ont continué à enrichir ce répertoire<br />
spécifique : Andante Festivo de Jean Sibelius, Divertimento de Béla Bartók, Apollon Musagète d'Igor Stravinsky,<br />
Funeral Music de Witold <strong>Lutoslawski</strong>, Simple Symphony de Benjamin Britten etc. Ralph Vaughan Williams et<br />
Michael Tippett réalisent même des œuvres pour double orchestre à cordes.<br />
2<br />
DARMSTADT, Cinquante ans de modernité musicale, IRCAM 2003, Chapitre 28.2
Forme<br />
Cette pièce est composée de quatre parties s’enchainant :<br />
- Prologue<br />
- Métamorphoses<br />
- Apogée<br />
- Epilogue<br />
Le Prologue, grave et lent est entièrement contrapuntique, ce qui constitue l’hommage à Bartók. <strong>Lutoslawski</strong> y<br />
procède par canons divers, renversements de thèmes etc., sur un rythme simple et régulier. On redécouvre la<br />
talea 3 du XIVème siècle transcrite en valeurs longues. Ce matériel musical est traité en six canons se déployant<br />
progressivement de deux à six voix, chacune étant fondée sur une série de 12 sons et son renversement transposé<br />
au triton.<br />
Cette série dérive de Bartók si on la considère dans son aspect mélodique ou thématique, cependant elle se<br />
rapproche de Webern par ses intervalles mais non dans ses usages.<br />
Métamorphoses développe le matériel du Prologue de façon moins contrainte. Débutant en pizzicati, ces<br />
métamorphoses sont au nombre de douze et utilisent une grande diversité de moyens d’écriture. <strong>Lutoslawski</strong> met<br />
en évidence le contraste entre les dimensions horizontales et verticales en parlant d’un « continuo harmonique »<br />
opposé à une ligne mélodique, ceci désigne bien un travail non sériel. Le diatonisme demeure sous-jacent à<br />
l’ensemble, les métamorphoses se succèdent par transpositions de la série de base. Le mouvement et les valeurs<br />
rythmiques vont se resserrant et les parties de violon atteignent une virtuosité considérable.<br />
La tension nerveuse et sonore éclate ensuite dans l’Apogée où l’écriture, jusque là linéaire, cède la place à des<br />
accords rassemblant les douze sons, répétés rapidement avec une extrême violence.<br />
Après ce cri de désespoir, une méditation sombre et recueillie clôt l’œuvre : l’Epilogue débute à l’unisson, puis<br />
trouve une écriture contrapuntique rigoureuse, très dépouillée, avec une notation en rondes et blanches<br />
uniquement.<br />
3<br />
La talea détermine le rythme et se trouve complétée par le color qui détermine le mouvement mélodique. Le terme a été transporté dans<br />
le domaine des tessitures, et en est venu à désigner la tessiture de la teneur, c'est-à-dire le registre de ténor ou de baryton, placé entre le<br />
bassus et l'altus.
Witold <strong>Lutoslawski</strong> 4<br />
Witold <strong>Lutoslawski</strong> est né en 1913 à Varsovie qui faisait, à l’époque, partie de l’Empire Russe. Il étudie d’abord<br />
le piano et le violon puis la composition et la théorie au Conservatoire de Varsovie avec Witold Maliszewski, un<br />
ancien élève de Nikolaï Rimski-Korsakov et conservateur notoire. Il obtient son diplôme de piano en 1936 et<br />
l’année suivante celui de composition.<br />
A la fin de ses études, son souhait de prolonger sa formation à Paris est contrarié par la situation politique. Il est<br />
fait prisonnier de guerre par les allemands en 1939 mais s’échappe et travaille comme pianiste dans les cafés de<br />
Varsovie de 1940 à 1945.<br />
Le Sacre du Printemps de Stravinsky et la 3ème Symphonie de Szymanowski influencent ses premières orientations,<br />
mais sa première partition, la Symphonie n°1, créée avec retard après la guerre (1948), est accusée de<br />
« formalisme » et elle est interdite sous Staline. Il faut attendre le début de la détente des relations internationales<br />
entre l'Est et l'Ouest (après les révoltes d'Octobre 1956) pour que son style trouve sa vraie dimension personnelle<br />
et que ses compositions, qu'il dirige lui-même, s'exportent et connaissent la notoriété et les honneurs, comme<br />
Musique Funèbre en 1958. Même s'il a bénéficié progressivement d'un statut favorable, de nombreuses pièces<br />
d'avant 1967 sont marquées par l'allégeance au régime politique en place. Curieusement, c'est l'audition à la<br />
Radio Polonaise du Concerto de Piano de John Cage qui l'a poussé vers l'aléatoire à la fin des années 50. Sa<br />
personnalité est modeste, délicate, intimiste, affable et généreuse, la longue « gestation » de ses grandes œuvres<br />
montre son perfectionnisme.<br />
Il a été choqué à 4 ans par l'emprisonnement puis l'exécution par les Soviets (1917) de son père et de son oncle,<br />
activistes politiques réfugiés à Moscou pendant la 1ère Guerre Mondiale. Ses premières œuvres sont significatives,<br />
la plupart des pièces d'avant guerre ont été détruites lors d'un incendie à Varsovie lors de la libération de 1944.<br />
Witold <strong>Lutoslawski</strong> est un compositeur au langage personnel et cohérent, un musicien essentiel et le plus<br />
important contemporain de Pologne. Son langage, à l'opposé de tout système, dans la continuité de la tradition,<br />
ne dédaigne pas une dimension raisonnée de modernité (clusters, quarts de ton, dodécaphonisme). Son style est<br />
marqué par la couleur, plutôt sombre, formé de changements constants par les rythmes et les mélodies<br />
« expansives » à forte dominante tonale, voire folklorique, qu’il utilise agrémenté parfois de dodécaphonisme.<br />
Outre ses instruments de prédilection le piano, le violon et les bois, il a aussi beaucoup composé pour la voix,<br />
poèmes polonais ou français dans une approche fusionnelle avec les instruments. Il recevra le Premier Prix<br />
Grawemeyer, la Médaille d’or de la Royal Philarmonic Society, le Prix Ferrar Salat de la Reine d’Espagne et en<br />
1993 le Polar Music Prize ainsi que le Prix Inamori de la Fondation Kyoto.<br />
Portrait de Witold <strong>Lutoslawski</strong><br />
Tous droits réservés, diffusion gratuite à l’usage pédagogique<br />
4 Sources : Ircam-Centre Pompidou 2010 http://brahms.ircam.fr/witold-lutoslawski<br />
Site « musique contemporaine » : http://www.musiquecontemporaine.info/acompo-<strong>Lutoslawski</strong>.php
Symphonie n°9 en ut Majeur « La Grande » D.944 de Franz <strong>Schubert</strong><br />
Avec sa dernière symphonie, cette neuvième symphonie que compose <strong>Schubert</strong> est un monument de la musique<br />
symphonique du XIXeme siècle. Des recherches récentes tendent à montrer que cette « Grande symphonie » a été<br />
composée au cours des années 1825-26. Cette œuvre est si monumentale que sa durée dépasse l’heure lorsqu’elle<br />
est jouée avec toutes ses reprises, d’ailleurs quasi-indispensables. Cette symphonie ne reçut pas un accueil favorable<br />
à son début. Les musiciens de la Gesellschaft der Musikfreunde la jugèrent « difficile et pompeuse » (« schwierig<br />
und schwülstig »), au point que lors du concert posthume du 14 décembre 1828, elle fut remplacée par la<br />
« Petite ». En 1838, dix ans après la mort de <strong>Schubert</strong>, Robert Schumann se rendit sur la tombe du compositeur<br />
puis rencontra son frère aîné Ferdinand <strong>Schubert</strong>, qui disposait des manuscrits inédits. Schumann ramena la<br />
symphonie à Leipzig, où il la fit exécuter par Felix Mendelssohn. Elle fut donc créée le 21 mars 1839 à Leipzig sous<br />
la direction de Mendelssohn, soit onze ans après la mort du compositeur. Souvent considérée comme la meilleure<br />
pièce symphonique de <strong>Schubert</strong>, la Grande Symphonie en ut majeur est aussi l'une de ses œuvres les plus novatrices.<br />
Orchestration<br />
2 flûtes<br />
2 hautbois<br />
2 clarinettes<br />
2 bassons<br />
2 cors<br />
2 trompettes<br />
3 trombones<br />
Timbales<br />
Cordes<br />
Forme 5<br />
Cette pièce est composée quatre parties :<br />
- Andante-allegretto ma non troppo<br />
- Andante con moto<br />
- Scherzo allegro vivace<br />
- Allegro vivace<br />
Andante et Allegretto A<br />
ma non troppo en ut majeur (à 2/2) :<br />
Un premier thème plein de noblesse énoncé par les cors à l’unisson dès le début de ce mouvement. C’est la pierre<br />
angulaire de cet Andante.<br />
Un thème qui évolue avec assurance, repris par les bois, puis par tout l’orchestre, les cordes répondant aux bois et<br />
aux vents. Après un motif ascendant en rythme pointé, le thème revient sur le contrpoint des cordes en triolets, il<br />
s’élargit jusqu’à un accord d’ut majeur, après lequel débute l’Allegretto ma non troppo sur un dessin énergique confié<br />
aux trompettes et aux cordes.<br />
5<br />
Guide de la musique symphonique, ed. Fayard
Le rythme pointé domine jusqu’à l’accord fortissimo après lequel les cordes modulent vers mi mineur pour le<br />
second sujet, plus tourmenté, ponctué d’interventions du hautbois, et dans lequel la tension s’accroît, accentuée par<br />
les contrastes rythmiques binaires et ternaires.<br />
C’est maintenant la tonalité de mi bémol majeur qui règne pour un nouvel épisode. Avant la fin de l’exposition, les<br />
trombones, sous le frémissement des cordes, font retentir un motif dérivé de celui de l’Andante alors que cette<br />
exposition se termine dans la tonalité de dominante sol majeur.<br />
Cependant c’est en la bémol majeur que commence le développement qui, comme l’ensemble de ce mouvement,<br />
déborde de vitalité, enrichi de différents motifs et de tonalités riches. Un effet est produit par la soudaine<br />
interruption de la cadence fortissimo, laissant aux clarinettes le soin de se charger des accords d’accompagnement.<br />
Une autre cadence, aboutissant en ut majeur après avoir frôlé l’ut mineur, précède la réexposition. Un rappel du<br />
début de l’Allegro clôt ce morceau mais une éblouissante coda Più moto voit revenir le thème de l’Andante dans<br />
toute sa splendeur.<br />
Andante con moto en la mineur (à 2/4) :<br />
Sept mesures des cordes donnent à ce second mouvement son assise rythmique avant que le hautbois n’en expose<br />
la mélodie conclue par une courte phrase en la majeur :<br />
Repris par les clarinettes et les hautbois, le thème poursuit sa route avec animation, les bois répondent aux cordes,<br />
le thème mineur, nostalgique, trouvant son apaisement dans la phrase conclusive majeure. Soudain cors et bassons,<br />
en longues notes tenues, introduisent un nouvel épisode en fa majeur : vent et cordes chantent une mélodie<br />
empreinte de sérénité et d’apaisement.
Ce sont les sonneries de cors qui retentissent à nouveau pour clore ce moment de rêve et ramener le premier<br />
épisode encore plus décidé, enrichi d’appels des trompettes, des cors et de variations diverses. La marche reprend<br />
jusqu’à un point culminant fortissimo, atteignant son paroxysme sur un accord de septième diminuée auquel<br />
succède brutalement le silence. Doucement, les cordes pizzicato vont ouvrir l’épisode suivant, alors que se déploie<br />
une nouvelle mélodie en si bémol aux violoncelles. Les hautbois les rejoignent et la mélodie module vers la mineur,<br />
avant le retour des violoncelles et d’un lumineux si bémol, suivis à nouveau des hautbois.<br />
Leur duo se poursuit en la majeur, alors que s’achève cet intermède chargé d’émotion et que revient le thème du<br />
second passage, en la majeur cette fois, superbement enrichi de dessins des cordes en contrepoint et de pizzicati. Il<br />
s’évanouit peu à peu laissant la place à la coda et au thème initial dont la phrase conclusive apparait pour la<br />
première fois en mineur. Le rythme de marche, lui, disparait.<br />
Scherzo Allegro vivace en ut majeur (à 3/4) :<br />
Ce troisième mouvement, basé sur la forme sonate, se situe dans la lignée des deux précédents par la variété de ses<br />
thèmes et l’ampleur de ses proportions. Il s’ouvre sur un dessin rythmique d’une forte énergie, exposé par les cordes<br />
auxquelles répondent les vents. Ce rythme va servir d’accompagnement au passage mélodique en sol majeur des<br />
premiers violons, suivi en canons par les violoncelles se terminant fortissimo avant de reprendre la première partie.<br />
La deuxième section débute en la bémol par de lourds accords assombris par les sonorités des trombones<br />
contrastant avec le thème de valse chanté par les bois et souligné par les violoncelles. Simultanément, la flûte fait<br />
entendre une nouvelle mélodie mais le rythme initial revient en un somptueux tutti, suivi d’un passage au<br />
contrepoint serré avant une dernière reprise du thème premier.
Appelé par les cors puis le reste des vents, le trio démarre en la majeur. Les bois dominent dans l’exposé du thème,<br />
un chant nostalgique, brillamment orchestré, doucement conduit par un accompagnement fourni. C’est de cette<br />
ambiguïté que naît l’émotion de ces perpétuels changements de couleur, de ces modulations soudaines du majeur<br />
au mineur. La marche se poursuit jusqu’à un nouvel appel des cors ramenant le trio, ses deux thèmes et son<br />
ampleur dynamique qui ne se relâche plus menant à la fin de ce mouvement.<br />
Allegro vivace en ut majeur (à 2/4) :<br />
C’est l’un des finals les plus monumentaux du répertoire, il comporte 1154 mesures. Divers éléments du thème<br />
principal vont se retrouver tout au long du mouvement. Un appel du tutti puis une réponse des cordes sur les notes<br />
de l’accord parfait en un motif ascendant plein d’énergie, précédant une longue phrase animée en triolets de<br />
croches, menée par les hautbois et les violons.<br />
Après cette section qui se termine sur la dominante de sol majeur, deux mesures de silence avant le second sujet<br />
introduit par quatre ré des cors et des clarinettes. Ce second thème est une mélodie pleine de grâce confiée aux bois<br />
sur l’accompagnement persistant des cordes en triolets de croches. Sans transition, ce sujet est repris en si majeur.<br />
Un dessin ascendant vient accroître la tension, décuplée par le retour des appels du début en croches<br />
pointées/doubles croches. Sur l’accompagnement mouvant des triolets. Mais peu à peu, les contrastes de<br />
dynamique se font moins marqués, alors qu’une phrase conclusive descendante marque la fin de l’exposition. De sol<br />
sur un trémolo des violoncelles, on passe à fa puis à mi bémol, tonalité dans laquelle s’ouvre le développement.<br />
La première partie de ce développement repose sur des phrases mélodiques venues du second sujet, confiées aux<br />
bois et traitées en imitation à travers les tonalités de la bémol, ré bémol et ut dièse mineur. La première de ces<br />
phrases évoquant fugitivement le début de l’« Hymne à la joie » qui conclut la Neuvième symphonie de L.W.<br />
Beethoven. Curieux passage que ces cent-treize mesures rendues momentanément instables par le jeu fluctuant des<br />
tonalités. Bien vite, une transition frémissante sur des accords massifs des timbales, des cors, des bassons et des<br />
trombones, fait entrer à nouveau le thème qui ouvre le second sujet, repris en canon par les violons. C’est sur un<br />
relatif retour au calme que se termine le développement, le rythme pointé (premières mesures du mouvement)<br />
introduit la réexposition qui débute en mi bémol majeur.
Quelque peu écourtée, la première partie se termine en mi majeur puis est suivie de la seconde en ut, tonalité qui<br />
dominera jusqu’à un éclatant fortissimo. C’est à nouveau le trémolo très doux des violoncelles qui annoncera la<br />
coda finale. C’est une apothéose de deux cents mesures, dont le rythme persistant de quatre notes et la pulsation<br />
irrésistible marqueront le triomphe de la marche.
Franz <strong>Schubert</strong><br />
<strong>Schubert</strong> est né le 31 janvier 1797 à Lichtental (ville indépendante à l’époque mais faisant depuis 1850 partie de<br />
Vienne). Son père, Franz Theodor Florian <strong>Schubert</strong>, est maître d'école et sa mère, Elisabeth Vietz, cuisinière. Le<br />
chef de choeur de l'eglise Liechtental, Michael Holzer, prit <strong>Schubert</strong> en charge pour lui apprendre l'orgue, tout<br />
en lui donnant des leçons de chant mais aussi d'harmonie et de contrepoint. C'est ainsi qu'à l'âge de 10 ans,<br />
<strong>Schubert</strong> manifestait déjà un grand talent pour le chant et se vit confier la place de premier soprane du chœur. En<br />
Mai 1808, <strong>Schubert</strong> eut la possibilité d'intégrer le chœur de la Cour de la Chapelle Impériale et Royale et de<br />
recevoir dans le même temps une éducation gratuite au séminaire : Mathématiques, Latin, Grec, Sciences<br />
naturelles, Religion, Géographie, Histoire et, bien sûr, Musique lui furent imposés.<br />
Plus les années passent au sein du séminaire, plus <strong>Schubert</strong> se démotive de ses études, en faveur de son<br />
dévouement musical. Il compose en cachette pour ne pas contrevenir aux choix de son père. Sa plus ancienne<br />
composition connue et la Fantaisie en sol pour piano à quatre mains, datée d'avril-mai 1810. Il peut entendre ses<br />
œuvres jouées par l'orchestre du collège (dirigé par Wenzel Rudiczjka, organiste de la cour) ou le petit orchestre<br />
familial.<br />
Vers la fin de l'année 1813, <strong>Schubert</strong> quitte le séminaire pour intégrer la Normal-Hauptschule, une institution<br />
spécialisée dans la formation d'enseignants. Il obtient son certificat de sous-maître d'école à l'automne 1814.<br />
Pendant cette année il achève sa Première symphonie en ré majeur, le Septième quatuor, le Huitième, et le Dixième<br />
quatuor à cordes en mi bémol majeur, des Lieder sur des poèmes de Matthisson, esquisse un opéra et termine sa<br />
Messe en fa majeur qui est jouée le 16 octobre à l'église de Lichtental où Thérèse Gotlob, qu'il pense épouser,<br />
chante le soprano.<br />
Le 19 octobre il signe la Marguerite au rouet sur un poème de Goethe. Dans ce climat de romantisme exalté, il<br />
multiplie à un rythme frénétique la composition de lieder ; on estime qu'il en aurait composé au moins 145, rien<br />
qu'en une seule année. Ajoutez à cela une autre symphonie, des oeuvres de scène, deux messes, des pièces sacrées,<br />
des danses pour piano, deux sonates, un quatuor à cordes en sol mineur ; au total <strong>Schubert</strong> aurait écrit 200<br />
compositions durant l'année 1815, soit plus d'une tous les deux jours ! C'est de l'automne 1815 que date le<br />
fameux lied Erlkönig.<br />
En juin 1816, il reçoit sa première commande : une cantate rémunérée cent florins (le double de son salaire<br />
annuel). En 1817, il obtient un congé d'une année. Il donne des cours de musique à Marie Esterhazy, et<br />
accompagne la famille dans son château de Zelesz en Hongrie, l'été 1818. A son retour, il refuse de reprendre son<br />
emploi de maître d'école. Les commandes, l'aide de ses amis, l'édition de ses œuvres, le mettent à l'abri du<br />
besoin. A partir de 1819, Ignaz Sonnleithner, l'ami des musiciens, l'introduit dans la maison des soeurs Fröhlich<br />
et s'emploie à faire connaître la musique de <strong>Schubert</strong> qui gagne en notoriété dans les salons viennois où l'on<br />
organise les fameuses <strong>Schubert</strong>iades, des soirées musicales autour de ses pièces.<br />
En 1919, il compose le quintette La Truite. En 1820, ses opéras La Harpe enchantée et Les Frères Jumeaux sont<br />
des échecs. Il n'aura jamais de succès sur la scène lyrique. En 1823, les premiers symptômes de la syphilis, alors<br />
incurable, se déclarent. En 1826, il achève son quatuor en ré mineur, La Jeune fille et la mort. Il est à Graz en<br />
1827. Le 29 mars, il participe comme porteur de torche à l'enterrement de Beethoven. Un an après la mort de<br />
Beethoven, le 28 mars 1828, a lieu le premier concert totalement consacré à ses œuvres, c'est un grand succès.
À l'automne, <strong>Schubert</strong> emménage chez son frère Ferdinand. Après deux semaines de maladie, il meurt de la fièvre<br />
typhoïde (ou typhus abdominal) le 19 novembre 1828 à 31 ans. Sa dépouille reposa d'abord au cimetière de<br />
Währing, non loin de celle de Beethoven, avant d'être transférée en grande pompe en 1888 dans le « carré des<br />
musiciens » du cimetière central de Vienne, où sa tombe voisine aujourd'hui celles de Gluck, Beethoven,<br />
Johannes Brahms et Hugo Wolf.<br />
Portrait de Franz <strong>Schubert</strong> par Wilhelm August Rieder, Historisches Museum der Stadt Vienne<br />
Tous droits réservés, diffusion gratuite à l’usage pédagogique
Les grandes dates du 19 ème siècle en Europe<br />
Les évènements politico-sociaux<br />
:<br />
- 9 juin 1815 : L’acte final du Congrès de Vienne est signé. Après la défaite de Napoléon, les pays<br />
européens se réunissent pour rédiger et signer les conditions de paix sur le continent.<br />
- 5 mai 1821 : Napoléon 1 er meurt à Sainte-Hélène.<br />
- 29 mai 1825 : Charles X est le dernier roi couronné de France.<br />
- 5 juillet 1830 : La France colonise la ville d’Alger.<br />
- 27-28<br />
28-29 29 juillet 1830 : Les trois Glorieuses. Charles X est chassé et c’est la fin de la Restauration.<br />
- 9 août 1830 : Louis-Philippe d’Orléans devient roi des français. C’est le début de la Monarchie de<br />
Juillet.<br />
- 27 avril 1848 : Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, à l’initiative de Victor Schoelcher.<br />
- 1 er mai 1851 : Ouverture de la première Exposition Universelle à Londres.<br />
- 2 décembre 1851 : Coup d’Etat de Napoléon Bonaparte.<br />
- 2 décembre 1852 : Proclamation du Second Empire.<br />
- 21 avril 1854 : Mariage en Autriche de l’empereur François Joseph avec Elisabeth de Wittelsbach (Sissi).<br />
- Décembre 1869 : Concile du Vatican, sous la volonté de Pie IX.<br />
- 19 juillet 1870 : Déclaration de la guerre franco-prussienne.<br />
- 4 septembre 1870 : Proclamation de la République à Paris.<br />
- 28 janvier – 10 mai 1871 : Signature de l’armistice franco-allemand, le 28 janvier. La France a perdu la<br />
guerre. La paix, Traité de Francfort, est signée le 10 mai.<br />
- 28 mars 1871 : Mise en place de la Commune de Paris.<br />
- Juin 1881 : L’enseignement en France devient laïc, gratuit et obligatoire.<br />
- 6 juillet 1885 : Un jeune enfant de neuf ans reçoit le premier vaccin contre la rage, sous la surveillance<br />
de Louis Pasteur à Paris.<br />
- 31 mars 1889 : Inauguration de la Tour Eiffel à Paris à l’occasion de l’Exposition Universelle.<br />
- Décembre 1894 : Procès et condamnation du capitaine Dreyfus.<br />
- Avril 1900 : Exposition universelle à Paris.<br />
Et dans le milieu artistique :<br />
- 25 février 1830 : La Bataille d’Hernani confronte les partisans du classicisme et du romantisme, suite à<br />
la publication du roman de Victor Hugo.<br />
- 13 novembre 1830 : Publication du roman Le rouge et le noir de Stendhal<br />
- Mars-juillet 1844 : Alexandre Dumas publie, sous forme de feuilleton, Les trois mousquetaires.<br />
- 6 mars 1853 : La Traviata, de G. Verdi, est créée à la Fenice de Venise.<br />
- 25 juin 1857 : Publication de l’œuvre de Baudelaire, Les fleurs du mal.<br />
- 30 mars 1867 : Victor Hugo publie Les Misérables.<br />
- 14 septembre 1867 : Publication du premier tome de l’ouvrage de Karl Marx, Du capital, développement<br />
de la production capitalistique.<br />
- 22 mai 1872 : Début de la construction du théâtre de Bayreuth, destiné à accueillir les œuvres de<br />
<strong>Wagner</strong>.<br />
- 15 avril<br />
a<br />
vril-15 mai 1874 : Première exposition officielle des peintres impressionnistes à Paris. Claude<br />
Monet présente son Impression soleil levant.<br />
- Décembre 1880 : Auguste Rodin crée le Penseur.<br />
- Février 1885 : Emile Zola publie Germinal.<br />
- 1899 : Publication de La science des rêves de Sigmund Freud.<br />
- 30 avril 1902 : Pelléas et Mélisande, opéra de Claude Debussy, est créé à l’opéra Comique de Paris.<br />
- 10 mai 1902 : Première projection cinématographique du Voyage dans la lune du Georges Méliès.
Biographie<br />
David Afkham<br />
direction<br />
Né en 1983 à Fribourg, David Afkham a reçu ses premières leçons de piano et de violon à l'âge de six ans. À 15<br />
ans, il entre à l'Université de musique de sa ville natale et poursuit des études de piano, solfège et direction. En<br />
2002, il remporte le premier prix du Jugend Musiziert German <strong>National</strong> Piano Competition dans la catégorie<br />
piano-solo. Il a ensuite complété ses études de direction à l'école de musique Liszt de Weimar. David Afkham fut<br />
le premier gagnant du « Bernard Haitink Fund for Young Talent ».<br />
Ces dernières années en Allemagne, David Afkham est reconnu comme l'un des chefs d’orchestre les plus prisés.<br />
La saison 2011/12 marque ses débuts avec l'<strong>Orchestre</strong> du Concertgebouw, le Philharmonia Orchestra, Wiener<br />
Symphoniker, Filarmonica della Scala, DSO-Berlin, Philharmonique de Munich, la Staatskapelle de Dresde,<br />
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, RTÉ <strong>National</strong> Symphony of Ireland, Deutsche Kammerphilharmonie à<br />
Brême, le NHK Symphony à Tokyo, ainsi que les <strong>Orchestre</strong>s symphoniques de Seattle et Houston. Il dirige<br />
également l'<strong>Orchestre</strong> de Cleveland, l'<strong>Orchestre</strong> national de France, l’<strong>Orchestre</strong> national d'Espagne, Gothenburg<br />
Symphony, Mozarteumorchester Salzbourg, Residentie Orchestra, Gustav Mahler Jungendorchester, Mahler<br />
Chamber Orchestra et l'<strong>Orchestre</strong> de Chambre de Lausanne.<br />
David Afkham occupe actuellement le poste de chef d'orchestre adjoint à la Gustav Mahler Jugendorchester. En<br />
Août 2010, il reçoit le Premier Prix « Jeune Chef d'<strong>Orchestre</strong> » du Nestlé and Salzburg Festival. Il a également<br />
été le lauréat du Donatella Flick Conducting Competition 2008 à Londres, lui permettant de devenir, pendant<br />
deux ans, chef d'orchestre adjoint de l'<strong>Orchestre</strong> symphonique de Londres.<br />
Chef d’orchestre de l’Association Richard <strong>Wagner</strong> à Bayreuth et membre du « Forum de chef d'orchestre » au<br />
Conseil de la musique allemande. Il continue à travailler régulièrement avec Bernard Haitink. Il l’a assisté pour<br />
bon nombre de projets y compris les cycles majeurs avec l'<strong>Orchestre</strong> symphonique de Chicago, l’<strong>Orchestre</strong> du<br />
Concertgebouw, et le London Symphony Orchestra.