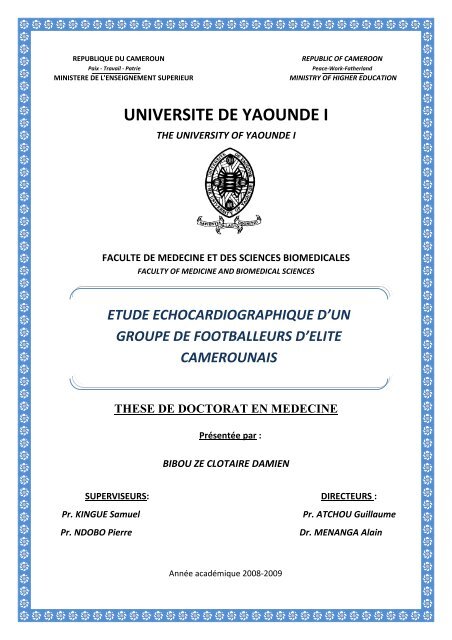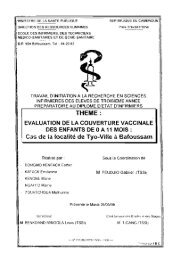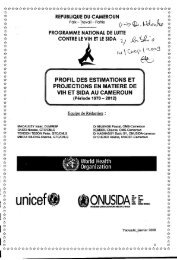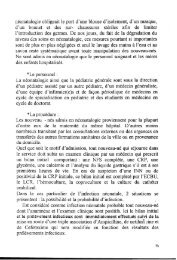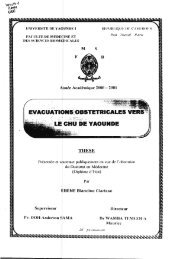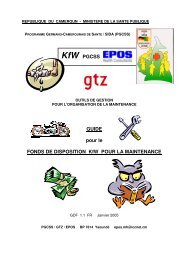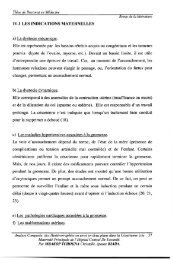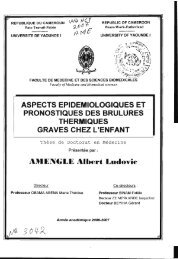UNIVERSITE DE YAOUNDE I - minsante-cdnss.cm
UNIVERSITE DE YAOUNDE I - minsante-cdnss.cm
UNIVERSITE DE YAOUNDE I - minsante-cdnss.cm
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON<br />
Paix ‐ Travail ‐ Patrie<br />
Peace‐Work‐Fatherland<br />
MINISTERE <strong>DE</strong> L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR<br />
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION<br />
<strong>UNIVERSITE</strong> <strong>DE</strong> YAOUN<strong>DE</strong> I<br />
THE UNIVERSITY OF YAOUN<strong>DE</strong> I<br />
FACULTE <strong>DE</strong> ME<strong>DE</strong>CINE ET <strong>DE</strong>S SCIENCES BIOMEDICALES<br />
FACULTY OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN<br />
GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE<br />
CAMEROUNAIS<br />
THESE <strong>DE</strong> DOCTORAT EN ME<strong>DE</strong>CINE<br />
Présentée par :<br />
BIBOU ZE CLOTAIRE DAMIEN<br />
SUPERVISEURS: DIRECTEURS :<br />
Pr. KINGUE Samuel<br />
Pr. NDOBO Pierre<br />
Pr. ATCHOU Guillaume<br />
Dr. MENANGA Alain<br />
Année académique 2008‐2009
SOMMAIRE<br />
SOMMAIRE<br />
SOMMAIRE ............................................................................................................................................... I<br />
<strong>DE</strong>DICACE ................................................................................................................................................ V<br />
REMERCIEMENTS ................................................................................................................................... VI<br />
SERMENT D’HIPPOCRATE ...................................................................................................................... XV<br />
LISTE <strong>DE</strong>S ABREVIATIONS ..................................................................................................................... XVI<br />
LISTE <strong>DE</strong>S FIGURES ................................................................................................................................ XIX<br />
LISTE <strong>DE</strong>S TABLEAUX ............................................................................................................................. XX<br />
RESUME ................................................................................................................................................ XXI<br />
SUMMARY ........................................................................................................................................... XXV<br />
INTRODUCTION ................................................................................................................................... ‐ 1 ‐<br />
OBJECTIFS ............................................................................................................................................ ‐ 6 ‐<br />
A) Objectif général.......................................................................................................................... - 6 -<br />
B) Objectifs spécifiques .................................................................................................................. - 6 -<br />
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE ................................................................................................................. ‐ 8 ‐<br />
I- RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE ....... - 8 -<br />
A-SITUATION ET LIMITES DU CŒUR [10] ............................................................................. - 8 -<br />
B- ANATOMIE DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE [10] ................................................... - 9 -<br />
1- Configuration externe .............................................................................................- 9 -<br />
2- Configuration interne [11] ....................................................................................- 11 -<br />
3- Tuniques des parois du coeur [10]. ......................................................................- 15 -<br />
4- Vascularisation du coeur ......................................................................................- 16 -<br />
5- Le systeme nodal et sa vascularisation [11] .........................................................- 18 -<br />
6- Innervation du coeur [10] .....................................................................................- 18 -<br />
C- PHYSIOLOGIE <strong>DE</strong> L’APPAREIL CARDIOVASCULAIRE [13] ........................................ - 19 -<br />
1- Le cycle cardiaque ................................................................................................- 20 -<br />
2- Le débit cardiaque et sa régulation .......................................................................- 22 -<br />
II ECHOCARDIOGRAPHIE ....................................................................................................... - 32 -<br />
A)<strong>DE</strong>FINITION ET PRINCIPES ................................................................................................. - 32 -<br />
B) DIFFERENTS MO<strong>DE</strong>S D’ECHOCARDIOGRAPHIE .......................................................... - 33 -<br />
1- Mode unidimensionnel (TM) [14] ........................................................................- 33 -<br />
2- Mode bidimensionnel (2D) [14] ...........................................................................- 33 -<br />
3- Mode Doppler ......................................................................................................- 33 -<br />
C- APPAREILLAGE ECHOGRAPHIQUE [14] ......................................................................... - 35 -<br />
D- TECHNIQUE D’EXAMEN .................................................................................................... - 35 -<br />
E) ECHOCARDIOGRAMME NORMAL <strong>DE</strong> L’ADULTE [14] ................................................. - 36 -<br />
1- Tracé unidimensionnel(TM) ....................................................................................- 36 -<br />
2- Tracé bidimensionnel (2D) ...................................................................................- 38 -<br />
I<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
SOMMAIRE<br />
3- Tracé Doppler .......................................................................................................- 40 -<br />
4- Intérêt de l’échocardiographie ................................................................................- 43 -<br />
5- Limitations de l'examen ..........................................................................................- 44 -<br />
III CŒUR ET SPORT................................................................................................................... - 45 -<br />
A-CLASSIFICATION <strong>DE</strong>S SPORTS .......................................................................................... - 45 -<br />
B- ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES CHRONIQUES DU SPORTIF : LE CŒUR<br />
D’ATHLETE. ............................................................................................................................... - 47 -<br />
1- Facteurs hémodynamiques ...................................................................................- 47 -<br />
2- Facteurs nerveux ..................................................................................................- 48 -<br />
3- Facteurs hormonaux .............................................................................................- 50 -<br />
4- Facteurs génétiques ..............................................................................................- 51 -<br />
1- Modifications structurales du cœur d’athlète ...........................................................- 54 -<br />
2- Fonctions systolique et diastolique du ventricule gauche ........................................- 57 -<br />
C- LES LIMITES DU CŒUR D’ATHLETE ............................................................................... - 58 -<br />
1- L’électrocardiogramme ...........................................................................................- 58 -<br />
2- L’échocardiogramme ..............................................................................................- 59 -<br />
D) DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS DU CŒUR D’ATHLETE [59] ...................................... - 62 -<br />
1- Diagnostics différentiels de l’hypertrophie pariétale du VG ...............................- 62 -<br />
2- Diagnostics différentiels d’une dilatation du VG chez le sportif ........................- 67 -<br />
3- Diagnostic différentiel d’une dilatation ventriculaire droite chez le sportif ...........- 68 -<br />
METHODOLOGIE ................................................................................................................................ ‐ 71 ‐<br />
1- Type d’étude : il s’agit d’une étude descriptive et transversale. .............................- 71 -<br />
2- Période : de septembre 2008 à Février 2009 ...........................................................- 71 -<br />
3- Lieu de l’étude : elle a eu lieu l’Hôpital Général de Yaoundé. ...............................- 71 -<br />
4- Echantillonnage : ....................................................................................................- 71 -<br />
5- Procédure : ............................................................................................................- 72 -<br />
6- Analyse statistique : .............................................................................................- 75 -<br />
7- Matériel d’étude : ....................................................................................................- 75 -<br />
8- Considérations éthiques ..........................................................................................- 76 -<br />
RESULTATS ......................................................................................................................................... ‐ 78 ‐<br />
DISCUSSION ....................................................................................................................................... ‐ 96 ‐<br />
I-CARACTERISTIQUES GENERALES <strong>DE</strong>S GROUPES ETUDIES .......................................- 96 -<br />
1- AGE ......................................................................................................................- 96 -<br />
2- SURFACE CORPORELLE .................................................................................- 97 -<br />
3- FREQUENCE CARDIAQUE ..............................................................................- 97 -<br />
4- PRESSION ARTERIELLE ..................................................................................- 97 -<br />
II- MODIFICATIONS ECHOCARDIOGRAPHIQUES ..............................................................- 98 -<br />
1- Epaisseur pariétale diastolique du ventricule gauche (SIVD et PPD) .................- 98 -<br />
2- Epaisseur Pariétale Relative .................................................................................- 98 -<br />
3- LES CAVITES VENTRICULAIRES GAUCHES ..............................................- 99 -<br />
4- MASSE VENTRICULAIRE GAUCHE ............................................................- 100 -<br />
III- LES FONCTIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE DU VENTRICULE GAUCHE ..- 102 -<br />
1- FONCTION SYSTOLIQUE ..............................................................................- 102 -<br />
2- FONCTION DIASTOLIQUE ............................................................................- 102 -<br />
IV-MORPHOLOGIE <strong>DE</strong>S VD, OG, AORTE. ...........................................................................- 103 -<br />
CONCLUSION ................................................................................................................................... ‐ 106 ‐<br />
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................... ‐ 107 ‐<br />
II<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
SOMMAIRE<br />
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ ‐ 109 ‐<br />
ANNEXES…………………………………………………………………………………………………………………………‐116‐<br />
III<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
IV<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
<strong>DE</strong>DICACE<br />
Qu’il me soit permit de faire cette dédicace :<br />
‐ A mes parents :<br />
Mon très regretté père ZE ARCIN CA<strong>DE</strong>T, décédé au cours de ce<br />
travail, mais dont l’héritage éducationnel, les innombrables conseils,<br />
l’amour et toute l’affection me guideront toute ma vie.<br />
Ma mère ONGMALELA JULIENNE, merci maman pour toute la<br />
tendresse, l’attention et ton implication sans réserve dans ma réussite.<br />
Puisse Dieu t’accorder longueur de jour pour apprécier l’homme que tu as<br />
fais de moi.<br />
‐ A mes frères et sœurs : ELEO, PRISCA, CLAU<strong>DE</strong>, NA<strong>DE</strong>GE,<br />
LEONCE, NARCISSE et JULIEN. pour leurs inconditionnels efforts,<br />
leur aide aussi bien matérielle que morale, leur confiance et leur patience.<br />
Voici l’expression de ma grande reconnaissance.<br />
‐ PAPA NONGWE, tu as été pour moi un père et ton implication dans la<br />
réalisation de ce travail tant matériellement qu’affectivement, m’honore.<br />
Merci "papé"!<br />
A vous tous, la vie entière ne suffirait pas pour vous dire merci ; je<br />
vous dois tout! Puisse Dieu vous accorder encore beaucoup d’années<br />
pour jouir de tout le bonheur que vous méritez !<br />
V<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
REMERCIEMENTS<br />
Ma gratitude s’adresse :<br />
‣ Au Souverain DIEU Tout Puissant, puisse tu m’aider, père à te<br />
rester fidele ; tu feras de moi le Docteur en Médecine que tu veux<br />
que je sois.<br />
‣ A mes Superviseurs de thèse,<br />
• Professeur KINGUE SAMUEL:<br />
Merci, pour le suivi permanent de ce travail. J’ai beaucoup<br />
d’admiration pour vos qualités humaines et votre rigueur<br />
professionnelle, je m’efforcerai d’appliquer tout ce que j’ai appris<br />
auprès de vous, et j’espère continuer à vous côtoyer pour<br />
apprendre encore.<br />
• Professeur NDOBO PIERRE :<br />
Je ne vous dirai jamais assez merci pour l’élaboration et le suivi<br />
permanent de ce travail. J’espère apprendre encore de vous.<br />
‣ A mes Directeurs de thèse,<br />
• Professeur ATCHOU GUILLAUME :<br />
Merci, de m’avoir accueilli avec simplicité et d’avoir accepté de<br />
diriger ce travail. L’humanisme, la rigueur professionnelle et la<br />
disponibilité dont vous avez fait preuve pendant l’élaboration et le<br />
suivi de ce travail m’honorent.<br />
• Docteur MENANGA ALAIN :<br />
Cher maître, Votre contribution a été capitale dans la réalisation<br />
de ce travail. Je n’oublierai jamais vos conseils et votre soutien<br />
permanent.<br />
VI<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
‣ Au Dr KOUAM, pour sa précieuse contribution à la réalisation de<br />
ce travail.<br />
‣ Aux Honorables membres du jury d’évaluation de ce travail pour<br />
les critiques et remarques constructives qui permettront<br />
l’amélioration de la copie finale.<br />
‣ A tous les enseignants et au personnel administratif et d’appui de<br />
la FMSB pour l’enseignement et l’encadrement.<br />
‣ Aux personnes qui ont acceptés de participer à cette étude, merci<br />
pour votre contribution à l’évolution de la science.<br />
‣ A tout le personnel du CHUY, de l’HGY, de l’HCY, de l’HGOPY,<br />
des Hôpitaux ad lucem de Mbouda et d’Obobogo, du CSI<br />
d’Edingding, du CMA d’Awae et du cabinet CINSOL, pour leur<br />
disponibilité et leur contribution à ma formation.<br />
‣ A la famille YUH, pour son amour.<br />
‣ A ma famille : chers oncles, tantes, cousins, cousines, frères et<br />
sœurs vous savez que vous êtes pour beaucoup dans la réalisation<br />
de ce travail. Merci pour le soutien physique et moral et l’amour<br />
que vous ne cessez de me témoigner.<br />
‣ A tous mes camarades de la 34 ème Promotion de la FMSB pour la<br />
chaleureuse compagnie et nos discussions scientifiques. Vous allez<br />
beaucoup me manquer !<br />
‣ A mes camarades et à mes amis NGONO Sylvain, NONGWE<br />
Amos, OBILA Francis, YEFOUO Maurice, NJAB Christian,<br />
KENFACK Pierre, SONWA Job, YIMGNA Renvy, DIPANDA<br />
André, MAMBAP Alex, NZAMEYO Mathy-Caryl, FOUOGUE<br />
Jovanny, ZOA Michel, TOMPEEN Isidore, RISSIA Ferdinand,<br />
PAJIP Alexis ,TALA MEDZOGO Rémy, VOUNDI Esther,<br />
VII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
DIBOG ange et Gabriel Loni, pour leur compagnie et surtout pour<br />
leur amitié sincère !<br />
‣ A tous ceux que j’aurais oublié, blâmez ma tête mais pas mon<br />
cœur, car je suis arrivée jusqu’ici grâce à vous, et partout où je<br />
serai vous y serez, car je vous porte dans mon cœur !<br />
VIII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
LISTE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT <strong>DE</strong><br />
LA FACULTE <strong>DE</strong> ME<strong>DE</strong>CINE ET <strong>DE</strong>S SCIENCES<br />
BIOMEDICALES<br />
(Année académique 2008/2009)<br />
1. Personnel administratif<br />
Pr. TETANYE EKOE<br />
Doyen<br />
Pr. NKO'O AMVENE Samuel<br />
Vice‐Doyen chargé de la programmation<br />
et du suivi des activités académiques<br />
Pr. NJAMNSHI Alfred KONGNYU<br />
Vice‐Doyen chargé de la Scolarité et du<br />
suivi des étudiants<br />
Pr. ABENA OBAMA Marie Thérèse<br />
Vice‐Doyen chargé de la recherche et de<br />
la Coopération<br />
Pr. KUABAN Christopher<br />
Coordonnateur Général du cycle de<br />
spécialisation<br />
M. ZOAH Michel Directeur des affaires administratives et<br />
Financières<br />
M. MODO ASSE Chef de service des Programmes<br />
d'Enseignement et de la Recherche<br />
M. BEYENE Fernand Dieudonné Chef de service Financier<br />
IX<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
M. ABESSOLO Dieudonné Chef de service de l'Administration<br />
Générale et du Personnel<br />
M. ENYEGUE ABANDA Julien Justin Chef de service de la Scolarité et<br />
des Statistiques<br />
M. AKOLATOU MENYE Augustin Chef de service du matériel et de la<br />
Maintenance<br />
Mme ANDONG Elisabeth<br />
Bibliothécaire en chef<br />
Mme FANDIE . Comptable‐Matière<br />
2. Personnel enseignant<br />
a) Professeurs<br />
1. ABENA OBAMA Marie Thérèse Pédiatrie<br />
2. ANGWAFO III FRU Chirurgie/Urologie<br />
3. ASONGANYI TAZOACHA Biochimie/Immunologie<br />
4. BENGONO TOURE Geneviève O. R. L.<br />
5. BINAM Fidèle Anesthésie/Réanimation<br />
6. DOH Anderson SAMA Gynécologie/Obstétrique<br />
7. GONSU FOTSIN Joseph Radiologie/Imagerie Médicale<br />
8. EBANA MVOGO Côme Ophtalmologie<br />
9. ESSAME OYONO Jean‐Louis Anatomie/Pathologique<br />
10. JUIMO Alain Georges Radiologie/Imagerie Médicale<br />
11. KINGUE Samuel Médecine Interne/Cardiologie<br />
12. KOUEKE Paul Dermatologie/Vénérologie<br />
13. KUABAN Christopher Médecine Interne/Pneumologie<br />
14. KOULLA SINATA SHIRO Microbiologie/Maladies infectieuses<br />
15. LEKE Rose Parasitologie/Immunologie<br />
X<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
16. LOHOUE Julienne Parasitologie/Mycologie<br />
17. MBANYA Dora Hématologie<br />
18. MBANYA Jean Claude Médecine Interne/Endocrinologie<br />
19. MOYOU SOMO Roger Parasitologie<br />
20. MUNA WALINJOM Médecine Interne/Cardiologie<br />
21. NDUMBE Peter Martins Microbiologie/immunologie<br />
22. NGADJUI TCHALEU Bonaventure Chimie des Substances Naturelles<br />
23. NGOGANG Jeanne Biochimie<br />
24. NJITOYAP NDAM Elie Claude Médecine Interne/Gastro‐entérologie<br />
25. NKO'O AMVENE Samuel Radiologie/Imagerie Médicale<br />
26. SAME EKOBO Albert Parasitologie<br />
27. SIMO MOYO Justin Anesthésie/Réanimation<br />
28. SOSSO Maurice Aurélien Chirurgie Générale<br />
29. TETANYE EKOE Pédiatrie<br />
b) Maîtres de Conférences<br />
1. ABOLO MBENTI Louis Chirurgie Générale<br />
2. AFANE ELA Anatole Anesthésie/ Réanimation<br />
3. AFANE ZE Emmanuel Médecine Interne/Pneumologie<br />
4. ATCHOU Guillaume Physiologie Humaine<br />
5. BAHEBECK Jean Chirurgie Orthopédique<br />
6. BELLA HIAG ASSUMPTA Ophtalmologie<br />
7. BIWOLE SIDA Magloire Médecine Interne/Gastro‐entérologie<br />
8. BOB'OYONO Jean Marie Anatomie/Chirurgie pédiatrique<br />
9. DJIENTCHEU Vincent de Paul Neurochirurgie<br />
10. DOUMBE Pierre Pédiatrie<br />
11. ESSOMBA Arthur Chirurgie Générale<br />
12. FOMULU Joseph Gynécologie/Obstétrique<br />
13. KAGO Innocent Pédiatrie<br />
14. KASIA Jean Marie Gynécologie/Obstétrique<br />
15. MASSO MISSE Pierre Chirurgie Générale<br />
16. MBONDA Elie Pédiatrie<br />
17. MBU ENOW Robinson Gynécologie/Obstétrique<br />
18. MOUELLE SONE Albert Radiothérapie<br />
19. MOUSSALA Michel Ophtalmologie<br />
20. NDJOLO Alexis O. R. L.<br />
21. NDOBO Pierre Médecine Interne/Cardiologie<br />
22. NJAMNSHI Alfred KONGNYU Neurologie<br />
23. NJOYA OUDOU Médecine Interne/Gastro‐entérologie<br />
24. NKAM Maurice Pharmacologie et Thérapeutique<br />
25. NOUEDOUI Christophe Médecine Interne/Endocrinologie<br />
26. ONDOBO ANDZE Gervais Chirurgie Pédiatrique<br />
27. OYONO ENGUELLE Samuel Physiologie Humaine<br />
XI<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
28. SOW Mamadou Chirurgie/Urologie<br />
29. TAKONGMO Samuel Chirurgie Générale<br />
30. TAKOUGANG Innocent Santé Publique<br />
31. TCHOKOTEU Pierre Fernand Pédiatrie<br />
32. TIETCHE Félix Pédiatrie<br />
33. YOMI Jean Radiothérapie.<br />
34. ZE MINKAN<strong>DE</strong> Jacqueline Anesthésie/Réanimation<br />
c) Chargés de Cours<br />
1. ADIOGO Dieudonné Microbiologie<br />
2. AHANDA ASSIGA Chirurgie Générale<br />
3. ASONGALEM Emmanuel ACHA Pharmacologie<br />
4. ASHUTANTANG Gloria Néphrologie<br />
5. ATANGANA René Anesthésie/Réanimation<br />
6. BELLEY PRISO Eugène Gynécologie/Obstétrique<br />
7. BENGONDO MESSANGA Charles Stomatologie<br />
8. BEYIHA Gérard Anesthésie/Réanimation<br />
9. BISSEK Anne Cécile Dermatologie/Vénérologie<br />
10. CHIABI Andreas Pédiatrie<br />
11. DONG A ZOCK Faustin Biophysique/Médecine nucléaire<br />
12. ELLONG Augustin Ophtalmologie<br />
13. ELOUNDOU NGAH Joseph Neurochirurgie<br />
14. ESIENE Agnès Anesthésie/Réanimation<br />
15. EYENGA Victor Claude Neurochirurgie<br />
16. FARIKOU Ibrahima Chirurgie orthopédique<br />
17. FEWOU Amadou Anatomie Pathologie<br />
18. FOKUNANG Charles Biologie Moléculaire<br />
19. FOUDA Pierre Chirurgie/Urologie<br />
20. KOBELA née MBOLLO Marie Pédiatrie<br />
21. KOLLO Basile Santé Publique<br />
22. LOBE Emmanuel Médecine Interne/Néphrologie<br />
23. LUMA Henry NAMME Bactériologie/Virologie<br />
24. MBOPI KEOU François‐Xavier Bactériologie/Virologie<br />
25. MBOUDOU Emile Télesphore Gynécologie/Obstétrique<br />
26. MONEBENIMP Francisca Pédiatrie<br />
27. MONNY LOBE Marcel Hématologie<br />
28. MOUKOURI Ernest Ophtalmologie<br />
29. NANA Philip NJOTANG Gynécologie/Obstétrique<br />
30. NDOM Paul Oncologie Médicale<br />
31. NGABA OLIVE NICOLE O.R.L.<br />
32. NGO NONGA Bernadette Chirurgie Générale<br />
33. NGOUNOU NOUBISSIE N.S. épse DOUALLA Médecine Rhumatologie<br />
34. NGOWE NGOWE Marcellin Chirurgie Générale<br />
XII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
35. NJOCK Richard Fiacre O. R. L.<br />
36. NKOA Thérèse Sciences Physiologiques<br />
37. NSANGOU Inoussa Pédiatrie<br />
38. NTONE ENYIME Félicien Psychiatrie<br />
39. OKOMO ASSOUMOU Marie Claire Bactériologie/Virologie<br />
40. ONDOA MEKONGO Martin Pédiatrie<br />
41. ONGOLO ZOGO Pierre Radiologie/Imagerie médicale<br />
42. OWONO Didier Ophtalmologie<br />
43. PISOH Christopher Chirurgie Générale<br />
44. SEN<strong>DE</strong> Charlotte Radiologie/Imagerie médicale<br />
45. SINGWE Madeleine épse NGAN<strong>DE</strong>U Médecine Rhumatologie<br />
46. TANYA née NGUTI KIEN Agatha Nutrition<br />
47. TOUKAM Michel Microbiologie<br />
48. WANKAH Christian Santé Publique<br />
d) Assistants<br />
1. ANKOUANE ANDOLOU Gastro‐entérologie<br />
2. ABABA désiré Anatomie macroscopique<br />
3. AZABJI KENFACK Marcel Physiologie<br />
4. BILLONG Serges Clotaire Administration, Planification, Monitoring<br />
et Evaluation<br />
5. CHELO David Pédiatrie<br />
6. CHETCHA CHEMEGNI Bernard Hématologie<br />
7. DJOMOU François ORL<br />
8. DOH BIT Julius Gynéco‐obstétrique<br />
9. ESSI Micheline Josée Santé Publique<br />
10. ETOM EMPIME Neurochirurgie<br />
11. EPEE Emilienne Ophtalmologie<br />
12. ETOUNDI MBALLA Georges Alain Médecine Interne/Pneumologie<br />
13. FOUMANE Pascal Gynéco‐obstétrique<br />
14. AGEM KECHIA Fréderick Mycologie<br />
15. GUEGANG GOUDJOU Emilienne Neuroradiologie<br />
16. GUEDJE Nicole Marie Ethnopharmacologie<br />
17. GONSU née KAMGA Hortense Bactériologie<br />
18. GUIFFO Marc Leroy Chirurgie générale<br />
19. HAMADOU BA Cardiologie<br />
20. KABEYENE OKONO Angèle Histo‐Embryologie<br />
21. KAMGNO Joseph Epidémiologie<br />
22. KAGMENI Gilles Ophtalmologie<br />
23. KAZE FOLEFACK François Néphrologie<br />
24. KEMFANG NGOWA Jean Dupont Gynéco‐obstétrique<br />
25. KINGE NJIE Thompson Maladies infectieuses<br />
26. KUATE TEGUEU Calixte Neurologie<br />
XIII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
27. KOUOTOU Emmanuel Armand Dermatologie<br />
28. LOE LOUMOU Clarisse Pédiatrie<br />
29. MAH Eveline Pédiatrie<br />
30. MBASSI AWA Hubert Désiré Pédiatrie<br />
31. MENANGA Alain Patrick Cardiologie<br />
32. MENDIMI NKODO Joseph Histo Embryologie<br />
33. MINDJA EKO David Chirurgie maxillo faciale<br />
34. MOIFO Boniface Radio pédiatrie ; neuro pédiatrie<br />
35. MONABANG ZOE Cathy Radiologie<br />
36. MOUAFO TAMBO Faustin Chirurgie<br />
37. NANA OUMAROU DJAM Blondel Chirurgie<br />
38. NDIKUM Valentine Pharmacologie<br />
39. NDONGO EMBOLA épse TOMIRIMO Judith Biologie moléculaire<br />
40. NDOUMBE Aurélien Neurochirurgie<br />
41. NGAMENI Barthélémy Phytochimie<br />
42. NGUEFACK Séraphin Pédiatrie<br />
43. NGUEFACK épse DONGMO Félicité Pédiatrie<br />
44. NGUEFACK TSAGUE Biostatistique/Informatique<br />
45. NJOUMEMI Zachariou Economie et Gestion sanitaire<br />
46. NGOUPAYOU Joseph Phytochimie<br />
47. NKWABONG Elie Gynéco‐obstétrique<br />
48. NNOMOKO née BILOUNGA Eliane Anesthésie‐Réanimation<br />
49. OLINGA OLINGA Alain Chirurgie cardiaque<br />
50. OWONO ETOUNDI Paul Anesthésie‐Réanimation<br />
51. ONGOTSOYI Angèle Hermine Pédiatrie<br />
52. PIEME Constant Anatole Biochimie<br />
53. SANDO Zacharie Anatomie pathologique<br />
54. SOBNGWI Eugène Endocrinologie<br />
55. TABI OMGBA Yves Parasitologie.<br />
56. TAGNOU TAGNY Claude Parasitologie<br />
57. TEBEU Pierre Marie Gynéco‐obstétrique<br />
58. WAWO YONTA épse GUELA SIMO Cardiologie<br />
59. WONKAM Ambroise Génétique<br />
60. YONE PEFURA Eric Pneumologie<br />
61. ZEH Odile Fernande Radiologie/Imagerie Médicale<br />
e) Cycle d'Etudes Biomédicales et Médicosanitaires<br />
Coordinateur général :<br />
Pr. BINAM Fidèle<br />
Coordinateur général adjoint : Dr TANYA NGUTI K.<br />
Coordinateur général du cycle Biomédical : Dr MONNY LOBE Marcel<br />
Coordinateur général du cycle Médicosanitaires : Pr MBU ENOW Robinson<br />
XIV<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
SERMENT D’HIPPOCRATE<br />
Déclaration de Genève<br />
Au moment de l’admission comme membre de la profession médicale<br />
Je m’engage solennellement à consacrer toute ma vie au service de<br />
l’humanité.<br />
Je réserverai à mes Maîtres le respect et la gratitude qui leurs sont dus.<br />
J’exercerai consciencieusement et avec dignité ma profession.<br />
La santé du malade sera ma seule préoccupation.<br />
Je garderai les secrets qui me sont confiés.<br />
Je sauvegarderai par tous les moyens possibles, l’honneur et la noble<br />
tradition de la profession médicale.<br />
Je ne permettrai pas que les considérations d’ordre religieux, national,<br />
racial, politique ou social, aillent à l’encontre de mon devoir vis-à-vis du<br />
malade.<br />
Mes collègues seront mes frères.<br />
Je respecterai au plus haut degré la vie humaine et ceci dès la conception ;<br />
même sous des menaces, je n’utiliserai point mes connaissances médicales<br />
contre les lois de l’humanité.<br />
Je m’engage solennellement sur l’honneur et en toute liberté à garder<br />
scrupuleusement ces promesses.<br />
XV<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
LISTE <strong>DE</strong>S ABREVIATIONS<br />
2D : Bidimensionnel<br />
A : Pic de vélocité de l’onde A mitrale de remplissage télédiastolique<br />
Am : Durée de l’onde A mitrale<br />
Ao : Diamètre de la racine aortique<br />
Ap : Durée de l’onde A pulmonaire télédiastolique<br />
CMD : Cardiomyopathie dilatée<br />
CMH : Cardiomyopathie Hypertrophique<br />
CPS : Contrainte pariétale systolique<br />
D : Pic de vélocité de l’onde D protodiastolique<br />
DTD : Diamètre télédiastolique du ventricule gauche<br />
DTDi : Diamètre télédiastolique du ventricule gauche indexé à la surface<br />
corporelle<br />
DTDVD : Diamètre télédiastolique du ventricule droit<br />
DTS : Diamètre télésystolique du ventricule gauche<br />
E : Pic de vélocité de l’onde E de remplissage protodiastolique mitrale<br />
EPR : Epaisseur pariétale relative<br />
E .T : Ecart type<br />
FC : Fréquence cardiaque<br />
FE: Fraction d’éjection du ventricule gauche selon la méthode de Teicholz<br />
XVI<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
FR : Fraction de raccourcissement<br />
HVG : Hypertrophie ventriculaire gauche<br />
IMC : Indice de masse corporelle<br />
MVG : Masse ventriculaire gauche<br />
MVGi : Index de masse ventriculaire gauche<br />
ms : milliseconde<br />
m/s : mètre par seconde<br />
OD : Taille de la cavité auriculaire droite<br />
OG : Diamètre antéro – postérieur de l’oreillette gauche<br />
OGi: Diamètre antéro – postérieur de l’oreillette gauche indexé à la surface<br />
corporelle<br />
PAD : Pression artérielle diastolique<br />
PAS : Pression artérielle systolique<br />
PPd : Epaisseur de la paroi postérieure en diastole<br />
PPs : Epaisseur de la paroi postérieure en systole<br />
RE : Rythme d’entraînement<br />
S : Pic de vélocité de l’onde S systolique<br />
SC : Surface corporelle<br />
SIVd : Epaisseur du septum interventriculaire en diastole<br />
SIVs : Epaisseur du septum interventriculaire en systole<br />
XVII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
SOD : Surface de l’oreillette droite<br />
SOG : Surface de l’oreillette gauche<br />
T<strong>DE</strong> : Temps de décélération de l’onde E<br />
TE : Temps d’éjection systolique<br />
VES : Volume d’éjection systolique<br />
VG : Ventricule gauche<br />
Vmax Ao : Vitesse maximale du flux aortique<br />
VTD : Volume télédiastolique du ventricule gauche<br />
VTS : Volume télésystolique du ventricule gauche.<br />
XVIII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
LISTE <strong>DE</strong>S FIGURES<br />
FIG 1 Footballeurs avec dilatation du VG (DTDi > 31mm) ................................................................. ‐ 84 ‐<br />
FIG 2 Footballeurs avec HVG (MVG i) > 125g/m² .............................................................................. ‐ 85 ‐<br />
FIG 3 Footballeurs avec hypertrophie extrême du VG (MVGi>134g/m²) ......................................... ‐ 88 ‐<br />
FIG 4 Footballeurs avec dilatation et hypertrophie du ventricule gauche ........................................ ‐ 91 ‐<br />
FIG 5 Footballeurs avec hypertrophie sans dilatation du ventricule gauche .................................... ‐ 91 ‐<br />
FIG 6 Footballeurs avec hypertrophie pariétale asymétrique (sivd/ppd>1.3).................................. ‐ 94 ‐<br />
XIX<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
LISTE <strong>DE</strong>S TABLEAUX<br />
Tableau 1 Classification de Christopher APPLETON. ......................................................................... ‐ 42 ‐<br />
TABLEAU 2 Classification des sport. .................................................................................................. ‐ 46 ‐<br />
Tableau 3 Répartition des footballeurs et témoins par tranche d’âge. ............................................ ‐ 78 ‐<br />
Tableau 4 Quantification de l’entraînement sportif des footballeurs. ............................................. ‐ 78 ‐<br />
Tableau 5 Caractéristiques anthropométriques et physiologiques des 2 groupes sujets. ............... ‐ 79 ‐<br />
Tableau 6 Paramètres morphologiques du ventricule gauche chez les 2 groupes sujets. ............... ‐ 80 ‐<br />
Tableau 7 Paramètres morphologiques du ventricule droit, de l’oreillette gauche et de la racine de<br />
l’aorte chez les footballeurs et les témoins. ..................................................................................... ‐ 81 ‐<br />
Tableau 8 Fonction systolique du VG chez les footballeurs et les témoins. ..................................... ‐ 82 ‐<br />
Tableau 9 Fonction diastolique du VG chez les Footballeurs et témoins. ........................................ ‐ 83 ‐<br />
Tableau 10 Paramètres anthropométriques et physiologiques des footballeurs avec et sans HVG. ‐ 86<br />
‐<br />
Tableau 11 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec et sans HVG. ....................... ‐ 87 ‐<br />
Tableau 12 Caractéristiques physiologiques des footballeurs avec hypertrophie extrême du VG<br />
(MVGi>134g/m²). .............................................................................................................................. ‐ 89 ‐<br />
Tableau 13 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec hypertrophie extrême du VG<br />
(MVGi>134g/m²). .............................................................................................................................. ‐ 90 ‐<br />
Tableau 14 Caractéristiques physiologiques des footballeurs avec hypertrophie sans dilatation du<br />
ventricule gauche. ............................................................................................................................. ‐ 92 ‐<br />
Tableau 15 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec hypertrophie sans dilatation du<br />
ventricule gauche. ............................................................................................................................. ‐ 93 ‐<br />
XX<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
RESUME<br />
INTRODUCTION<br />
Le « cœur d’athlète » est cette adaptation cardiaque chronique et<br />
physiologique à l’exercice physique. Il concerne généralement les sportifs très<br />
entraînés ayant au moins huit à dix heures d’entraînement par semaine. Par<br />
ailleurs, il existe deux formes de « cœur d’athlète » selon le type d’activité<br />
sportive pratiquée : le cœur d’athlète d’endurance et le cœur d’athlète de<br />
résistance qui s’observent respectivement chez les sportifs des disciplines<br />
dynamiques et statiques. Les footballeurs, selon la classification de Bethesda<br />
réalisent un exercice musculaire qui réunit les deux composantes dynamique et<br />
statique mais avec une forte consonance dynamique et une statique faible. Le<br />
football, comme les autres disciplines sportives à dynamique forte, a la<br />
particularité de favoriser des variations physiologiques extrêmes de la masse<br />
ventriculaire gauche. Ces variations posent le diagnostic différentiel des formes<br />
de cardiomyopathies (CMH). Au Cameroun, l’adaptation cardiovasculaire<br />
chronique à l‘exercice musculaire n’a jamais été objectivée chez les<br />
footballeurs. C’est ainsi que nous avons mené une étude échocardiographique<br />
chez un groupe de footballeurs professionnels camerounais pour contribuer<br />
d’une part à la connaissance de cette adaptation cardiovasculaire et d’autre part<br />
pour déceler d’éventuelles anomalies cardiaques pouvant concourir à la mort<br />
subite.<br />
OBJECTIFS<br />
Le principal objectif de ce travail est de décrire l’aspect<br />
échocardiographique au repos chez les footballeurs professionnels<br />
camerounais. Pour l’atteindre, nous nous sommes fixés comme objectifs<br />
spécifiques de : déterminer et comparer les paramètres échocardiographiques<br />
XXI<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
morphologiques (épaisseurs et tailles des cavités cardiaques) et fonctionnels<br />
(fonctions systolique et diastolique) au repos chez les footballeurs<br />
professionnels camerounais et les témoins ; de rechercher d’éventuelles<br />
anomalies échocardiographiques chez les footballeurs professionnels<br />
camerounais ; de rechercher les facteurs influençant les modifications<br />
cardiaques éventuelles observées chez les footballeurs professionnels<br />
camerounais.<br />
METHODOLOGIE<br />
Il s’agissait d’une étude descriptive et transversale. Elle s’est déroulée à<br />
l’Hôpital Général de Yaoundé. Vingt trois footballeurs d’une équipe d’élite de<br />
sexe masculin âgés de 21 ans à 35 ans ont pris part à notre étude. Un nombre<br />
équivalent de témoins appariés par âge, taille et poids ont également été soumis<br />
à un interrogatoire, un examen physique et une échocardiographie au repos en<br />
décubitus latéral gauche. Nous disposions d’un échocardiographe de marque<br />
GENERAL ELECTRICS CP710 LOGIQ 500 MD auquel était reliée une sonde<br />
de 2,22 Mégahertz placée au contact de la paroi thoracique (échocardiographie<br />
transthoracique).<br />
RESULTATS<br />
Les sportifs avaient un âge moyen de 26.91 ±3.67ans. Leur surface<br />
corporelle était moyenne avec une valeur de 1.99m². Une légère bradycardie a<br />
été observée chez les sportifs avec une fréquence cardiaque moyenne de 58.56<br />
battements par minute et significativement plus basse de 20 % comparée aux<br />
sujets contrôles (p
PRELIMINAIRES<br />
8.46±1.10mm). Ces valeurs étaient significativement plus grandes chez nos<br />
footballeurs par rapport au groupe témoin (p
PRELIMINAIRES<br />
aux dilatations ; aucun footballeur n’a une dilatation ventriculaire gauche<br />
extrême associée à une hypertension artérielle systolique et une dysfonction<br />
diastolique faisant suspecter une cardiomyopathie dilatée ; aucun footballeur ne<br />
présentait une élévation de la MVGi au dessus de 134g/m² associé à un rapport<br />
SIVD/PPD anormalement élevé au dessus de 1.3 et une épaisseur du septum<br />
interventriculaire au dessus de 13mm faisant suspecter une cardiomyopathie<br />
hypertrophique primitive.<br />
Nous formulons par conséquent les recommandations suivantes : aux<br />
footballeurs professionnels, amateurs et toute personne désireuse de pratiquer ce<br />
sport, de faire un bilan médical incluant un suivi cardiovasculaire ; à la FMSB<br />
de réfléchir à la mise sur pied d’une unité de formation en médecine de sport<br />
compte tenu de la demande de plus en plus grande dans ce domaine ; au<br />
ministère des sports et de l’éducation physique de travailler en collaboration<br />
avec le ministère de la santé publique pour mettre sur pied un programme<br />
permettant la réalisation systématique et régulière d’un bilan cardiovasculaire<br />
chez les sportifs camerounais très entraînés.<br />
XXIV<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
SUMMARY<br />
INTRODUCTION<br />
The “athlete’s heart” is this chronic and physiological adaptation to<br />
physical exercise. It generally concerns well trained athletes having at least eight<br />
to ten hours of training every week. Two types of “athlete’s heart” are defined<br />
depending on the type of athletic discipline practiced: the “athlete’s heart” of<br />
endurance sports and the "athlete’s heart" of resistance sports which is found in<br />
athletes in dynamic and static disciplines. Footballer accordingh to the Bethesda<br />
clasification carry out muscular exercises that combine the two components, but<br />
more of dynamic than static. Football, like other sporting disciplines with a<br />
strong dynamic component, particularly favors extreme physiological variations<br />
of left ventricular dimensions. These variations are amongst the differential<br />
diagnosis of cardiomyopathies (HCM). In Cameroon cardiovascular adaptation<br />
to chronic muscular exercise has never been evaluated in footballers. That is<br />
why we carried out a cardiac ultrasound study in professional Cameroonian<br />
footballers to contribute to existing knowledge concerning this cardiovascular<br />
adaptation on one hand, and to detect the presence of cardiac abnormalities that<br />
could lead to sudden death.<br />
OBJECTIVES<br />
The main objective of this study is to describe the cardiac ultrasound<br />
aspects of professional Cameroonian footballers at rest. To achieve this we set<br />
as specific objectives: determine and compare the morphological (thickness and<br />
size of cardiac cavities) and functional (systolic and diastolic function) cardiac<br />
ultrasound aspects at rest between professional Cameroonian footballers and<br />
controls; Identify any cardiac ultrasound abnormality in professional<br />
XXV<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
Cameroonian footballers; Identify the factors that influence the observed cardiac<br />
modifications in professional Cameroonian footballers.<br />
METHODOLOGY<br />
We carried out a cross sectional and descriptive study in the Yaounde<br />
General Hospital. Twenty three males professionals footballers, aged from 21 to<br />
35 years have taken part in the study. An equivalent number of controls matched<br />
for age, height and weight were also questioned, underwent physical<br />
examination and had a cardiac ultrasound done at rest in the left lateral<br />
decubitus position. We used a cardiac ultrasound (GENERAL ELECTRICS<br />
CP710 LOGIQ 500 MD) to which a 2.22 megahertz probe placed on the<br />
thoracic cage. (trans thoracic cardiac ultrasound).<br />
RESULTS<br />
The mean age of the athletes was 26.91 ± 3.67 years. Their body surface<br />
area was average with a value of 1.99m2. A slight bradycardia was observed in<br />
the athletes with a mean heart rate of 58.56 beats per minute and significantly<br />
lower by 20% compared to the control subjects (p < 0.05). We also observed a<br />
significant decrease of the diastolic blood pressure of the footballers compared<br />
to controls (p < 0.05) but this remained within the normal limits. Concerning the<br />
cardiac ultrasound variables of the footballers of our series, the mean value of<br />
the SIVD and PPd was normal (9.60±1.14mm and 8.46±1.10mm respectively).<br />
These values were significantly greater in the footballers compared to the<br />
control group (p < 0.05). However it remained within the normal limits. The<br />
DTDi of Cameroonian footballers was significantly greater by 8% compared to<br />
the controls (p < 0.05) but remained within the normal limits. However, only<br />
one of studied athletes had a left ventricular dilatation. None of these athletes<br />
XXVI<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
had a greatly increased DTDi (above 32mm). In general the problem of a<br />
differential diagnosis with DCM was not present.<br />
The left ventricular mass of the athletes was normal. Their mean MVGi was<br />
123.05 g/m2 and significantly greater by 27.64% compared to controls (p <<br />
0.05). Meanwhile, 47.8% of the athletes of our series had a LVH with conserved<br />
systolic and diastolic function. 30.4% of the athletes had an extreme rise in the<br />
MVGi without systolic or diastolic dysfunction. It should be noted that four that<br />
is 17.4% of the footballers had a SIVDS/PPD ratio that was abnormally<br />
increased, above 1.3, one case of these athletes had simultaneously an MVGi ><br />
134 g/m², and a septal thickness below 13mm.<br />
We found no systolic or diastolic dysfunction in footballers.<br />
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS<br />
At the end of our study we can conclude that: The parietal thickness, the<br />
telediastolic diameter and the left ventricular mass were statistically greater in<br />
footballers compared to controls; The systolic and diastolic functions of the LV<br />
are conserved in footballers; The hypertrophy ad the dilatation of the left<br />
ventricle observed in some players is the consequence of cardiovascular<br />
adaptation to chronic exercise with a clear predominance of hypertrophy over<br />
dilatations; No footballer had an extreme left ventricular dilatation associated to<br />
systolic hypertension and diastolic dysfunction suggesting a dilated<br />
cardiomyopathy; No footballer had an increase in the MVGi above 134g/m²<br />
associated to an abnormally elevated SIVD/PPD ratio above 1.3 and a septal<br />
thickness above 13mm, suggesting the presence of a primary hypertrophic<br />
cardiomyopathy. We therefore recommend: to professional footballers, novices<br />
and all those who desire to practice this sporting discipline to carry out a<br />
medical check up including a cardiovascular workup; to the FMBS to think<br />
about the creation of a specialized unit in the training of medical doctors in the<br />
XXVII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
PRELIMINAIRES<br />
domain of athletics; to the Ministry of sports and physical education, to work in<br />
collaboration with the Ministry of Public Health to set up a program that will<br />
enable regular and systematic cardiovascular check up in well trained<br />
Cameroonian athletes.<br />
XXVIII<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
INTRODUCTION<br />
‐ 1 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
INTRODUCTION<br />
INTRODUCTION<br />
Pour fonctionner durablement et de manière optimale, nos cellules<br />
réclament la présence d’oxygène. Ce métabolisme aérobie est analysable et<br />
quantifiable par la mesure de la consommation d’oxygène (VO2 l/min).Si au<br />
repos les muscles squelettiques ont une activité métabolique faible, lors d’un<br />
exercice d’intensité maximale celle ci peut-être multipliée par dix. Les<br />
augmentations d’apport en O2 par le sang et d’extraction d’O2 par le muscle<br />
permettent de répondre à cette demande accrue. L’apport sanguin dépend surtout<br />
du débit cardiaque (DC, l/min) et de la vascularisation en particulier locale ;<br />
l’extraction ou différence artério-veineuse en O2 dépend de la qualité<br />
musculaire. Le rôle des adaptations cardiovasculaires aux contraintes de<br />
l’exercice musculaire est donc majeur. Ces adaptations cardiovasculaires sont de<br />
deux types : aiguës, dont le but est l’apport suffisant d’oxygène aux muscles en<br />
activité, et chroniques en réponse à la pratique sportive répétée dont le but est<br />
d’améliorer l’efficacité des réponses aiguës [1]. Un entraînement physique<br />
régulier génère donc des adaptations cardiovasculaires physiologiques,<br />
notamment un accroissement du tonus vagal et une hypertrophie – dilatation de<br />
la masse du cœur préférentiellement celle du ventricule gauche. Cette<br />
hypertrophie du VG résulte soit d’une augmentation du diamètre télédiastolique<br />
de la cavité du ventricule gauche, soit d’un épaississement pariétal du ventricule<br />
gauche soit des deux [2,3]. Lorsque ces modifications sont franches, elles<br />
peuvent entraîner des conséquences cliniques, électrocardiographiques,<br />
échocardiographiques, connues sous le nom de syndrome du cœur d’athlète [4].<br />
La classification, proposée lors de la 26e conférence de Bethesda [5] distingue<br />
les sports selon le type d’activité physique (dynamique, statique ou mixte) et<br />
l’intensité (élevée, moyenne ou faible). Un deuxième groupe inclut les sports à<br />
risque de collision et/ou en cas de syncope [2]. L’exercice dynamique (aérobie,<br />
‐ 2 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
INTRODUCTION<br />
endurance) avec une alternance de phases de contraction et de relaxation<br />
d’importantes masses musculaires, est réalisée en ventilation libre et impose une<br />
contrainte cardiaque principalement volumétrique. L’emphase est mise ici sur le<br />
mouvement avec développement d’un effort de faible intensité. L’exercice<br />
statique (anaérobie, isométrique) quant à lui, est caractérisé par une contraction<br />
sans changement de longueur d’un ou de quelques groupes musculaires. Ici la<br />
force développée est d’intensité élevée avec un mouvement minime ou absent<br />
[6 ; 7]. Dans la pratique, la plupart des sports sont mixtes avec des composantes<br />
dynamique ou statique plus ou moins prépondérantes, pourvoyeuses de légères<br />
adaptations selon le type de sport. Le football est un sport mixte à statique faible<br />
et dynamique fort pouvant être responsable de diverses modifications<br />
cardiovasculaires chez le sportif entrainé, chez qui les aspects<br />
électrocardiographique et échographique posent un problème diagnostic des<br />
formes bénignes de cardiopathies notamment la cardiomyopathie<br />
hypertrophique et la cardiomyopathie dilatée, lesquelles sont les étiologies les<br />
plus fréquentes de mort subite chez le sportif [8].<br />
Selon les résultats d'une étude menée auprès des SAMU d'Aquitaine entre<br />
mars 2005 et février 2006, 127 personnes ont été victimes d'un accident<br />
cardiovasculaire pendant ou dans l'heure qui a suivi une activité sportive. Ont<br />
notamment été enregistrés, 47 infarctus du myocarde et 34 décès. Ces imprévus<br />
inhérents au sport peuvent notamment être évités. Ceci passe par la<br />
compréhension des modifications cardiovasculaires induites par le sport, la<br />
détermination des facteurs prédisposant aux accidents cardiovasculaires chez le<br />
sportif et l’élaboration de stratégies préventives [2]. Par conséquent, tout athlète<br />
très entraîné doit être soumis à un bilan cardiovasculaire incluant une<br />
échocardiographie pour poser le diagnostic positif de ces pathologies et ainsi<br />
prévenir les cas de mort subite [9]. C’est dans cette optique que nous avons<br />
‐ 3 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
INTRODUCTION<br />
mené une étude échocardiographique chez les footballeurs camerounais affiliés<br />
dans des championnats d’élite européens.<br />
‐ 4 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
OBJECTIFS<br />
‐ 5 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
OBJECTIFS<br />
OBJECTIFS<br />
A) Objectif général<br />
Le principal objectif de ce travail est de décrire l’échocardiographie au<br />
repos des footballeurs camerounais. Pour l’atteindre nous nous sommes fixés<br />
quelques objectifs spécifiques :<br />
B) Objectifs spécifiques<br />
- déterminer et comparer les paramètres échocardiographiques morphologiques<br />
(épaisseurs et tailles des cavités cardiaques) et fonctionnels (fonctions systolique<br />
et diastolique) au repos chez les footballeurs camerounais et les témoins.<br />
- rechercher d’éventuelles anomalies échocardiographiques chez les footballeurs<br />
camerounais.<br />
- rechercher les facteurs influençant les modifications cardiaques éventuelles<br />
observées chez les footballeurs camerounais.<br />
‐ 6 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
‐ 7 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
I- RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE<br />
A-SITUATION ET LIMITES DU CŒUR [10]<br />
Le cœur est situé dans le médiastin, un tiers à droite et deux tiers à gauche de la<br />
ligne médiane ; le médiastin étant un espace de tissu conjonctif du thorax délimitée<br />
par les deux poumons, le sternum et la colonne vertébrale. En haut le médiastin<br />
s’étend jusqu’à la hauteur de l’ouverture supérieure du thorax où il se prolonge en<br />
continuité avec l’espace tissulaire du cou. En bas le médiastin se limite par le<br />
diaphragme. Il est par ailleurs en arrière du sternum et en avant de la colonne<br />
vertébrale. De chaque côté il est limité par la plèvre médiastinale. Il est divisé en<br />
médiastin supérieur, inférieur et moyen dans lequel se loge le cœur. Chez le sujet<br />
sain, les limites du cœur varient en fonction de l’âge, du sexe, de la corpulence et de<br />
la condition physique. En situation normale les deux tiers de la masse cardiaque sont<br />
situés à gauche de la partie médiane. En projection sur la partie thoracique<br />
antérieure, les limites du cœur forment un trapèze. Le bord droit s’étend de<br />
l’insertion sternale de la 3 e côte à l’insertion de la 6 e côte parallèlement au bord droit<br />
du sternum. Cette ligne correspond au profil latéral de l’oreillette droite. Le<br />
prolongement supérieur de cette ligne correspond au bord droit de la veine cave<br />
supérieure alors que le prolongement inférieur correspond au bord droit de la veine<br />
cave inférieure. Le bord gauche du cœur s’étend depuis sa pointe (dans le cinquième<br />
espace intercostal en dedans de la ligne médioclaviculaire) le long d’un arc convexe<br />
vers la gauche vers un point situé à 2 <strong>cm</strong> en dehors de l’insertion de la deuxième<br />
côte.<br />
‐ 8 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
B- ANATOMIE DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE [10]<br />
Le cœur est un organe creux musculaire qui a la forme d’une quille arrondie.<br />
Incliné par rapport à l’axe du corps, il repose dans le thorax de telle sorte que sa<br />
pointe (apex) est orientée en bas et à gauche, tandis que sa base regarde vers la<br />
droite, l’arrière et le haut. La taille du cœur dépend du sexe, de l’âge et de la<br />
condition physique de l’individu ; cependant, Le cœur mesure habituellement de 14<br />
à 16 <strong>cm</strong> et son diamètre de 12 à 14 <strong>cm</strong>. Sa taille est d'environ 1,5 fois la taille du<br />
poing fermé de la personne. Son volume vaut environ 50 à 60 <strong>cm</strong>³. Un peu moins<br />
gros chez la femme que chez l'homme, il mesure en moyenne chez celui-ci 105 mm<br />
de largeur, 98 mm de hauteur, 205 mm de circonférence. Le cœur d'un adulte pèse<br />
de 300 à 350 grammes.<br />
1- CONFIGURATION EXTERNE<br />
a- Vue ventrale [10]<br />
Si l’on observe le cœur après ouverture du péricarde dans sa disposition<br />
naturelle par l’avant, on voit la face sterno-costale. Elle est constituée par la paroi<br />
antérieure du ventricule droit et par une portion de la paroi du ventricule gauche. Le<br />
ventricule gauche se prolonge sur la gauche par la pointe du cœur. La limite entre<br />
les deux ventricules est formée par le sillon interventriculaire antérieur qui lui est<br />
rempli par une branche de l’artère coronaire gauche et de sa veine satellite, de telle<br />
sorte que la surface du cœur apparait lisse. Sur le bord droit, le contour du cœur est<br />
formé par l’oreillette droite et par la veine cave supérieure. La veine cave inférieure<br />
n’est pas visible dans cet axe. L’oreillette droite possède un diverticule appelé<br />
auricule droit qui remplit l’espace qui sépare la veine cave supérieure de la racine de<br />
l’aorte. L’oreillette et l’auricule droites sont séparées du ventricule droit par le sillon<br />
coronaire qui est rempli par les vaisseaux coronaire et la graisse. Le contour du bord<br />
‐ 9 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
gauche cardiaque est formé par une petite partie de l’auricule gauche et par le<br />
ventricule gauche.<br />
En observant cette face sterno-costale, il apparait nettement que Le tronc<br />
pulmonaire émerge du ventricule droit en avant de l’aorte laquelle naît du ventricule<br />
gauche. L’aorte et le tronc pulmonaire sont enroulés l’un autour de l’autre en<br />
spirale. La partie initiale de l’aorte située immédiatement en arrière, l’aorte<br />
ascendante, se dirige ventralement, surcroise le tronc pulmonaire en formant un arc<br />
aortique et cache ainsi en partie sa bifurcation en une artère pulmonaire gauche et<br />
une artère pulmonaire droite. Les sections des voies veineuses pulmonaires gauches<br />
apparaissent sous l’artère pulmonaire gauche. De l’arc aortique naissent les<br />
vaisseaux destinés à la tête et aux bras, le tronc brachiocéphalique avec les artères<br />
sous-clavières droite et gauche et les artères carotides communes droite et gauche.<br />
La limite entre la face ventrale et celle diaphragmatique est marquée sur le<br />
ventricule droit par le bord droit.<br />
b- Vue dorsale [10]<br />
Il s’agit de la base et d’une partie de la face inférieure du cœur appelée face<br />
diaphragmatique. L’on aperçoit les abouchements des veines caves supérieure et<br />
inférieure dans l’oreillette droite qui se dispose presque verticalement. Les veines<br />
caves sont séparées de la base de l’auricule droite par un sillon, le sulcus terminalis.<br />
Dans l’oreillette gauche étendue horizontalement, se terminent les voies veineuses<br />
pulmonaires droites et gauches.<br />
Sur la paroi postérieure de l’oreillette gauche s’étend le cul-de sac de<br />
réflexion du péricarde. Au-dessus de l’oreillette gauche, le tronc pulmonaire se<br />
divise en artères pulmonaires droite et gauche. La bifurcation du tronc pulmonaire<br />
est enjambée par l’arc aortique qui se continue avec la partie descendante de l’aorte.<br />
Dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche, court la grande veine coronaire puis le<br />
‐ 10 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
sinus veineux coronaire. L’artère inter-ventriculaire inférieure occupe le sillon de<br />
même nom. [11]<br />
c- Vue caudale [10]<br />
La face diaphragmatique du cœur repose grossièrement sur le diaphragme et<br />
ne peut donc pas être vue en totalité lorsqu’on regarde le cœur caudalement. Cette<br />
face diaphragmatique est en grande partie occupée par le ventricule gauche. Celuici<br />
est séparé de l’oreillette gauche par le sillon coronaire dans lequel sont présents le<br />
sinus veineux coronaire et une branche de l’artère coronaire gauche. Le sillon<br />
interventriculaire postérieur contenant l’artère et la veine interventriculaires<br />
postérieures, sépare le ventricule gauche du ventricule droit lequel n’est vu qu’en<br />
partie sur cette face.<br />
2- CONFIGURATION INTERNE [11]<br />
a- Cavités cardiaques<br />
- Oreillette droite<br />
Sur une vue droite du cœur, l’oreillette droite (atrium droit) est ouverte en<br />
découpant et en réclinant en avant sa paroi externe à la face profonde de laquelle<br />
apparaissent des colonnes charnues, les muscles pectinés. Cette oreillette a<br />
grossièrement la forme d’un fût vertical, mais on lui décrit schématiquement six<br />
parois. Outre la paroi externe réclinée apparaît la paroi antérieure où s’ouvre<br />
l’orifice auriculo-ventriculaire droit ou tricuspide dont on aperçoit la valve interne<br />
ou septale. Dans le plancher de l’oreillette droite, s’ouvre le sinus veineux coronaire<br />
avec sa valvule de Thebesius et la veine cave inférieure avec sa valvule d’Eustachi.<br />
La paroi postérieure est située entre les abouchements des deux veines caves. Au<br />
plafond, s’ouvre l’orifice de la veine cave supérieure et celui de l’auricule droite en<br />
partie obstrué par des colonnes charnues. La paroi interne correspond à la cloison<br />
‐ 11 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
inter-auriculaire. On aperçoit en son centre une dépression ovalaire, la fosse ovale,<br />
limitée en haut par un bord plus épais, l’anneau de Vieussens.<br />
- Ventricule droit<br />
Sur une vue antérieure du cœur, le ventricule droit est ouvert en découpant et en<br />
réclinant en bas sa paroi antérieure. Ce ventricule a trois parois : outre la paroi<br />
antérieure réclinée, une paroi inférieure ou diaphragmatique et une paroi interne ou<br />
septale. Cette paroi est soulevée à sa partie moyenne par une saillie musculaire,<br />
l’éperon de Wolf. Au dessus de l’éperon et de son prolongement antéro-inférieur, la<br />
bandelette ansiforme, se situe la chambre de chasse du ventricule avec<br />
l’infundibulum qui mène à l’orifice pulmonaire et à sa valve faite de trois valves<br />
sigmoïdes. Au dessous de l’éperon, c’est la chambre de remplissage occupée surtout<br />
par la valve tricuspide. Celle-ci comporte trois valves, comme les trois parois :<br />
interne ou septale, antérieure et inférieure. Sur le bord libre et la face ventriculaire<br />
des valves, s’attachent les cordages issus de trois piliers : septal ou muscle papillaire<br />
du cône artériel, antérieur auquel aboutit la bandelette ansiforme, et inférieur. La<br />
pointe du ventricule droit située à droite de la pointe du cœur est occupée par de<br />
nombreuses colonnes charnues. Sur une vue gauche du cœur, l’oreillette gauche, en<br />
arrière, est ouverte par résection de sa paroi gauche. Cette oreillette a la forme d’un<br />
fût horizontal, mais on lui décrit traditionnellement six parois : outre la paroi gauche<br />
ici réséquée, une paroi postérieure entre les quatre veines pulmonaires, un plafond<br />
où s’ouvre, en avant, l’orifice de l’auricule gauche ; Le plancher est lisse, concave ;<br />
La paroi droite est formée par la cloison inter-auriculaire qui présente le repli semilunaire,<br />
limitant à gauche une fente qui s’ouvre parfois dans l’oreillette droite sous<br />
l’anneau de Vieussens.<br />
‐ 12 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
- Oreillette gauche<br />
La cavité auriculaire gauche est plus petite que celle de l’oreillette droite. Cette<br />
cavité est en majeure partie occupée par les voies veineuses pulmonaires droites et<br />
gauches. Quatre veines pulmonaires, deux de chaque côté, se jettent dans la partie<br />
supérieure de l’oreillette gauche. Il n’y a pas de valvule à l’abouchement des veines<br />
pulmonaires. L’oreillette gauche se prolonge ventralement par l’auricule gauche<br />
dont la paroi est hérissée de petits muscles pectinés. Au niveau de la paroi séparant<br />
les deux oreillettes (le septum interauriculaire), on peut trouver une valvule du<br />
foramen ovale qui correspond à la fosse ovale de l’oreillette droite.<br />
- Ventricule gauche<br />
Le ventricule gauche est ouvert en découpant et en réclinant vers le haut sa<br />
paroi gauche. Ce ventricule a une forme conique, mais on lui décrit habituellement<br />
deux parois, une paroi droite qui correspond au septum inter-ventriculaire, une paroi<br />
gauche qui correspond à la face gauche du cœur, un bord supérieur et un bord<br />
inférieur. Son sommet est à la pointe du cœur. Sa base est occupée, en bas et à<br />
gauche par la valvule mitrale, en haut et à droite par l’orifice aortique. La valvule<br />
mitrale comporte deux valves, la grande valve à droite, la petite valve à gauche. Sur<br />
la face ventriculaire et le bord libre de ces valves, s’attachent les cordages issus de<br />
deux piliers, l’un antéro-supérieur inséré au bord antérieur du ventricule gauche,<br />
l’autre antéro-inférieur inséré au bord inférieur du ventricule. La chambre de<br />
remplissage du ventricule gauche est limitée par la paroi gauche, la grande valve<br />
mitrale, ses cordages et les deux piliers. La chambre de chasse ou canal aortique est<br />
située entre la grande valve à gauche et le septum à droite.<br />
‐ 13 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
b- Valves cardiaques [10]<br />
b-1- Valves atrioventriculaires<br />
On distingue deux valves auriculo-ventriculaires :<br />
-la valve tricuspide<br />
Elle est composée de trois valvules situées en avant, cuspis anterior, en arrière<br />
cuspis posterior et le long de la paroi septale, cuspis septalis. La valvule antérieure<br />
est la plus grande ; ses cordages sont fixés au puissant muscle papillaire antérieur.<br />
L’insertion de la valvule septale se situe à la hauteur la paroi septale et la divise en<br />
une partie antérieure interventriculaire et une partie postérieure auriculoventriculaire<br />
entre l’oreillette droite et le ventricule gauche. Entre les trois grandes<br />
valvules, il existe de petites valvules de connexion qui n’atteignent pas l’anneau<br />
fibreux.<br />
-La valve mitrale (bicuspide)<br />
Elle comporte une valvule médiale antérieure, cuspis anterior, et une valvule<br />
latérale postérieure, cuspis posterior. Les cordages courts et puissants sont fixés à un<br />
muscle papillaire antérieur et un postérieur de telle sorte que chaque muscle<br />
papillaire soutient les parties adjacentes de ces deux valvules. La valvule antérieure<br />
a son origine septale dans la paroi de l’aorte. En plus des deux grandes valvules,<br />
cette valve possède deux petites valvules, cuspides commissurales, qui ne vont pas<br />
jusqu’à l’anneau fibreux.<br />
b-2- Valves artérielles<br />
Il s’agit des valves du tronc pulmonaire et aortique. Elles sont constituées de<br />
trois grandes valvules à peu près semblables, les valvules semi-lunaires, qui sont des<br />
prolongements endocardiques. L’insertion des valves artérielles est arciforme. Le<br />
bord libre de chaque valvule possède en son milieu un nodule fibreux.<br />
‐ 14 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
-La valve pulmonaire<br />
Elle est composée d’une valvule antérieure, d’une valvule droite et d’une<br />
valvule gauche. La paroi du tronc pulmonaire est dilatée à la hauteur de la valve<br />
par un sinus peu profond.<br />
-La valve aortique<br />
Elle comporte les valvules postérieure, droite et gauche. La paroi artérielle est à<br />
la hauteur de la valve dilatée vers l’extérieur par un sinus aortique qui en agrandit<br />
ainsi le diamètre transversal. Dans le sinus aortique de la valvule gauche naît l’artère<br />
coronaire gauche et dans celui de la valvule droite, prend naissance l’artère<br />
coronaire droite.<br />
3- TUNIQUES <strong>DE</strong>S PAROIS DU COEUR [10].<br />
La paroi cardiaque est constituée de trois tuniques. De l’intérieur vers<br />
l’extérieur l’on distingue : l’endocarde, le myocarde, le péricarde. L’épaisseur de la<br />
paroi est déterminée par le muscle cardiaque, le myocarde. La paroi auriculaire est<br />
faiblement musculaire tandis que celle du ventricule droit est considérablement plus<br />
fine que celle du gauche.<br />
La musculature des oreillettes comprend une couche superficielle et une<br />
couche profonde. La couche superficielle s’étend sur les deux oreillettes et est plus<br />
développée ventralement que dorsalement. La couche profonde, caractéristique de<br />
chaque oreillette, contient des faisceaux musculaires torsadés ou circulaires qui<br />
rejoignent l’orifice auriculo-ventriculaire correspondant.<br />
La musculature des ventricules comporte de dedans en dehors les couches sousendocardique,<br />
moyenne, sous-épicardique. Dans la couche externe sous-épicardique,<br />
les faisceaux musculaires entourent la surface du ventricule droit en position<br />
horizontale, alors que ceux du ventricule gauche se dirigent presque<br />
‐ 15 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
longitudinalement vers la face diaphragmatique. Le ventricule gauche et la paroi<br />
septale possèdent une couche musculaire moyenne formée de fibres en majorité<br />
circulaires et qui n’existe pas dans la paroi du ventricule droit. La couche sousendocardique<br />
participe à la constitution des colonnes charnues et des muscles<br />
papillaires.<br />
Le myocarde est recouvert en dedans par l’endocarde qui est le prolongement<br />
de la paroi endothéliale vasculaire et est constitué d’une couche endothéliale et<br />
d’une fine couche de tissu conjonctif.<br />
Le péricarde entoure le cœur et la partie des gros vaisseaux située près de la<br />
base du cœur. Il est composé de deux parties : le péricarde fibreux externe et le<br />
péricarde séreux interne. Le péricarde séreux a deux feuillets : un feuillet viscéral ou<br />
épicarde et un feuillet pariétal qui constitue la face interne du péricarde fibreux.<br />
4- VASCULARISATION DU COEUR<br />
Le tissu musculaire du cœur possède sa propre circulation artérielle et<br />
veineuse systémique. Les artères coronaires droites et gauches prennent naissance<br />
dans le sinus aortique des valvules droite et gauche. L'artère gauche est plus<br />
importante que l'artère droite; elle comporte deux rameaux l'artère interventriculaire<br />
antérieure et l'artère circonflexe. Chaque branche artérielle vascularise son propre<br />
territoire. Il peut se développer une circulation collatérale composée de petites<br />
ramifications pour contourner un étranglement artériel du fait d'un dépôt (athérome).<br />
[12]<br />
a- Les artères coronaires [11]<br />
a-1- Artère coronaire droite<br />
Elle est recouverte par l’auricule droite et donne naissance à plusieurs<br />
branches dont le rameau interventriculaire postérieur dans le sillon coronaire (vers le<br />
sillon interventriculaire postérieur). L’artère coronaire droite irrigue l’oreillette<br />
‐ 16 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
droite, le système excito-conducteur, la majeure partie du ventricule droit, la partie<br />
dorsale de la paroi septale ventriculaire et la face diaphragmatique avoisinante.<br />
a-2- Artère coronaire gauche<br />
Du sinus de Valsalva aortique gauche, naît l’artère coronaire gauche qui se<br />
divise bientôt en deux branches. L’une, l’artère circonflexe, chemine dans le sillon<br />
auriculo-ventriculaire gauche, donnant une série de branches latérales pour le<br />
ventricule gauche et se terminant en général à la face inférieure du ventricule gauche<br />
sans atteindre la croix des sillons. La deuxième branche de l’artère coronaire<br />
gauche, l’artère inter-ventriculaire antérieure, descend dans le sillon de même nom<br />
et donne des branches perforantes pour le septum, des branches ventriculaires<br />
droites et, surtout, des branches ventriculaires gauches ou diagonales. Elle contourne<br />
la pointe du cœur et se termine dans le sillon inter-ventriculaire inférieur.<br />
b) Les veines coronaires [10]<br />
La plus grande partie du sang dépourvu d’oxygène provenant des parois<br />
cardiaques est conduit vers le sinus coronaire qui est situé à la partie postérieure du<br />
sillon coronaire. La veine interventriculaire antérieure est l’un des plus gros<br />
affluents du sinus coronaire qui se divise en deux branches à gauche du sillon<br />
coronaire et une seule branche à droite. Pendant que deux tiers du sang veineux<br />
rejoint l’oreillette droite par ces grandes veines et le sinus coronaire, les un tiers<br />
restant se jettent directement dans l’oreillette droite par des veines plus petites.<br />
c) Vaisseaux lymphatiques [10]<br />
Le réseau lymphatique du cœur est épais et se divise en un réseau profond<br />
endocardique, un réseau moyen myocardique et un réseau superficiel épicardique.<br />
‐ 17 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
5- LE SYSTEME NODAL ET SA VASCULARISATION [11]<br />
A la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette droite, est situé le<br />
nœud sino auriculaire de Keith et Flack. Au dessus de l’orifice du sinus coronaire,<br />
près de l’insertion de la valve septale de la tricuspide, apparaît sous l’endocarde le<br />
nœud auriculo-ventriculaire d’Aschoff-Tawara. Trois faisceaux unissent ces deux<br />
noeuds ; l’antérieur et le moyen passent dans la cloison inter-auriculaire, le<br />
postérieur suit le sulcus terminalis et contourne en dehors l’orifice de la veine cave<br />
inférieure. Du nœud auriculo-ventriculaire, part le faisceau de His qui, après avoir<br />
donné ses branches gauches, se continue par la branche droite. Celle-ci passe sous<br />
l’éperon de Wolf et, certaines de ses fibres s’engagent dans la bandelette ansiforme.<br />
Le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et ses branches sont vascularisés<br />
par les artères septales antérieures venues de l’artère inter-ventriculaire antérieure et,<br />
par les branches septales inférieures venues de l’artère inter-ventriculaire inférieure.<br />
La première de ces branches, née à la croix des sillons, parfois d’ailleurs de l’artère<br />
rétro-ventriculaire gauche, est l’artère du nœud de Tawara.<br />
6- INNERVATION DU COEUR [10]<br />
Le rythme cardiaque induit par le nœud sinusal est sous l’influence du système<br />
nerveux végétatif ou autonome. Celui-ci comporte une innervation sympathique et<br />
une innervation parasympathique. Les nerfs du cœur conduisent des fibres efférentes<br />
autonomes et des fibres afférentes viscérosensibles. La stimulation des nerfs<br />
cardiaques sympathiques conduit à une accélération de la fréquence cardiaque, une<br />
augmentation de la puissance de contraction et d’excitabilité et à une conduction<br />
accélérée vers le nœud auriculo-ventriculaire d’Aschoff-Tawara. La stimulation des<br />
nerfs cardiaques parasympathiques conduit à un ralentissement de la fréquence<br />
cardiaque, à une baisse de l’amplitude des battements cardiaques, à une diminution<br />
de l’excitabilité et à un ralentissement de la conduction vers le nœud auriculoventriculaire.<br />
‐ 18 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
C- PHYSIOLOGIE <strong>DE</strong> L’APPAREIL CARDIOVASCULAIRE [13]<br />
Le fonctionnement du cœur fait appel à des éléments histologiques,<br />
biochimiques et électriques qu’il sera important de rappeler. Du point de vue<br />
histologique le muscle est un syncytium c'est-à-dire que les fibres musculaires sont<br />
reliées entre elles par des jonctions appelées disques intercalaires qui contiennent<br />
des desmosomes empêchant les fibres de se séparer et maintenant de ce fait un<br />
véritable pont permanent qui rend le fonctionnement de chaque fibre totalement<br />
dépendant des autres fibres. En effet tout phénomène qui parvient à une fibre est<br />
transmis à l’ensemble des autres fibres cela suppose que pour avoir une réponse<br />
électrique, l’intensité du stimulus cardiaque doit être grande. Ceci a pour<br />
conséquence le fait que la réponse électrique est maximale ou nulle : c’est la loi « du<br />
tout ou rien ».<br />
Le cœur est constitué de deux pompes séparées l’une de l’autre : le cœur droit<br />
qui éjecte le sang à travers les poumons et le cœur gauche qui l’éjecte vers les<br />
organes périphériques. Ces deux pompes sont chacune composées de deux cavités<br />
l’oreillette et le ventricule. L’oreillette qui fonctionne comme un réservoir, est une<br />
voie d’accès vers le ventricule mais elle est également une pompe de faible<br />
puissance participant au remplissage du ventricule. Ce dernier génère<br />
périodiquement la force qui propulse le sang dans la circulation pulmonaire ou<br />
périphérique.<br />
Le cœur est formé de trois types de fibres musculaires : les fibres musculaires<br />
auriculaires, ventriculaires et différenciées excitatrices ou conductrices. Les fibres<br />
auriculaires ou ventriculaires se contractent comme les fibres du muscle<br />
squelettique. Les fibres spécialisées excitatrices ou conductrices, qui contiennent<br />
peu de fibres contractiles, ne se contractent que faiblement ; elles sont à l’origine de<br />
la rythmicité et transmettent le signal excitateur à l’ensemble des autres fibres<br />
cardiaques. Le nœud sinusal, situé dans la paroi latérale haute auriculaire droite et<br />
‐ 19 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
d’où naissent les impulsions automatiques du cœur, les transmet au nœud auriculoventriculaire.<br />
Ce dernier ralentit la vitesse de conduction de ces impulsions avant de<br />
les transmettre également aux ventricules par le biais du tronc du faisceau de His et<br />
de ses branches droite et gauche, puis des fibres du tissu de Purkinje.<br />
Pour que le cœur fonctionne de façon optimale, les conditions biochimiques<br />
sont nécessaires : le cœur est le siège d’un métabolisme énergétique élevé. En effet<br />
le myocarde est particulièrement riche en mitochondries qui représentent 25 % de<br />
l’ensemble ; et est également le siège d’une grande consommation d’oxygène (il<br />
utilise seul 5% de l’ensemble de l’oxygène retenu dans l’organisme). Pour cela le<br />
muscle cardiaque utilise de façon importante et préférentielle : glucose, lactate et<br />
purivate. A cela on ajoute les acides gras, les corps cétoniques et les acides aminés ;<br />
pour les acides aminés et les corps cétoniques l’utilisation se fait de façon<br />
préférentielle par rapport à la concentration plasmatique. Le catabolisme se fait par<br />
trois voies : la glycolyse anaérobie, la glycolyse aérobie et la bêta oxydation des<br />
acides gras (en cas d’une sollicitation de longue durée).<br />
1- Le cycle cardiaque<br />
Le fonctionnement du cœur se fait de façon cyclique et régulière, sous l’égide<br />
de deux facteurs la pression et le volume. Ce cycle se définit en deux phases ; une<br />
phase active qui est la phase de contraction : la systole et la seconde phase la<br />
diastole ou phase de repos. Ces phases se suivent dans le temps et dans l’espace de<br />
façon indéfinie.<br />
Harvey en 1628 a décrit la révolution cardiaque de la manière suivante :<br />
«l’oreillette se contracte en premier et ce faisant envoie le sang qu’elle contient dans<br />
le ventricule. Quand le ventricule est plein, le cœur se soulève, tend instantanément<br />
toutes ses fibres et produit un battement. De cette façon il éjecte aussitôt dans les<br />
artères le sang qu’il a reçu des oreillettes. Ces deux mouvements, l’un des oreillettes<br />
et l’autre des ventricules ont lieu successivement… » La compréhension de la<br />
‐ 20 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
séquence des événements a permis de distinguer le cycle des phénomènes<br />
électriques qui commencent avec la dépolarisation des oreillettes induite par les<br />
cellules du pace maker ; et le cycle des phénomènes mécaniques constitué de quatre<br />
phase : la mise en tension, l’éjection systolique, la relaxation et le remplissage<br />
diastolique.<br />
Ces phases se succèdent en mois d’une seconde. Nous prendrons comme point<br />
de départ la contraction du ventricule ; et le cœur gauche qui est la principale<br />
source d’énergie mécanique servira d’exemple, les mêmes événements se produisant<br />
à droite.<br />
a- Mise en tension<br />
On parle ici de contraction isovolémique du ventricule. Au cours de cette phase<br />
on assiste à la fermeture de la valve mitrale, le volume de sang du ventricule est<br />
maximal (200ml) ; c’est le volume télédiastolique. La pression commence à monter<br />
dans le ventricule et la valve mitrale achève de se fermer. Le sang ventriculaire est<br />
pris au piège. La pression baisse progressivement dans l’aorte et au moment ou la<br />
pression ventriculaire dépasse celle-ci, la valve aortique s’ouvre et l’éjection<br />
systolique commence alors que la pression aortique est à sa valeur minimum (60-<br />
70mmhg).<br />
b- L’éjection systolique<br />
Pendant la première partie de l’éjection, l’écoulement du sang est lié à la<br />
différence de pression entre le ventricule gauche et l’aorte. A la fin de l’éjection les<br />
pressions s’inversent mais le sang continue de s’écouler par inertie due à l’ondée<br />
sanguine. Mais la forte pression intra aortique force les valvules à se fermer, le sang<br />
tendant à refluer dans le ventricule. Au cours de cette phase le volume de sang<br />
contenu dans le ventricule diminue rapidement puis lentement par la suite. A la fin<br />
de l’éjection il persiste un résidu appelé volume télé-systolique.<br />
‐ 21 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
c- Phase de relaxation<br />
Pour cette phase on parle de relâchement isovolumétrique, car au début de<br />
cette phase rien ne sort et rien n’entre. Ici on a deux phénomènes :<br />
‐ la chute de la pression intraventiculaire : à la fermeture de la valve aortique,<br />
les fibres des parois ventriculaires sont en plein relâchement. Les deux valves<br />
aortique et mitrale demeurent fermées et le sang contenu dans le ventricule<br />
reste intacte.<br />
‐ ouverture de la valve mitrale due à l’augmentation de pression dans<br />
l’oreillette gauche.<br />
d- Phase de remplissage<br />
On lui décrit trois phases :<br />
-la protodiastole : le remplissage est rapide et cela du fait du fort gradient de<br />
pression entre l’oreillette et le ventricule.<br />
-la mésodiastole : on a l’impression ici que l’écoulement s’est arrêté.<br />
-la télédiastole : elle est contemporaine de la contraction de l’oreillette<br />
gauche. On dit que la contraction achève de remplir le ventricule.<br />
On est tenté de définir une cinquième phase qui est tout simplement le début la<br />
révolution suivante et cycle recommence…<br />
2- Le débit cardiaque et sa régulation<br />
Le débit cardiaque représente le volume sanguin que le cœur éjecte chaque<br />
minute dans l’aorte. C’est également le volume de sang qui passe dans la circulation<br />
pour nourrir les tissus et les débarrasser de leurs déchets.<br />
Le retour veineux représente le volume de sang qui chaque minute revient<br />
dans l’oreillette droite. Le débit cardiaque et le retour veineux sont équivalents l’un<br />
de l’autre exception faite de quelques battements au cours desquels le sang peut être<br />
stocké ou au contraire remis dans la circulation.<br />
‐ 22 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
a- Valeurs du débit cardiaque au repos et à l’exercice<br />
Le débit cardiaque varie de façon importante avec le niveau d’activité de<br />
l’organisme. Le métabolisme, l’exercice ou le repos, l’âge, la corpulence et de<br />
nombreux autres facteurs influent sur sa valeur.<br />
La valeur du débit cardiaque de repos se situe aux environs de 5,6l /mn si l’on<br />
considère une population de jeunes adultes sains et de sexe masculin chez laquelle le<br />
plus grand nombre de mesures ont été effectuées. Chez la femme, le débit cardiaque<br />
est de 10 à 20% inférieur et le débit cardiaque moyen de l’adulte en arrondissant les<br />
chiffres est donc de 5l/mn.<br />
Pour pouvoir comparer les débits cardiaques des sujets de corpulence<br />
différente, l’on utilise un paramètre appelé index cardiaque, qui est le débit<br />
cardiaque par mètre carré de surface corporelle. L’augmentation du débit cardiaque<br />
est approximativement proportionnelle à celle de la surface corporelle. Un individu<br />
standard qui pèse 70 kg a une surface corporelle d’environ 1,70m². En moyenne,<br />
l’index cardiaque normal d’un adulte est aux alentours de 3litres par minute par m²<br />
de surface corporelle. Le débit cardiaque augmente rapidement et dépasse 4l/mn à<br />
10 ans, et diminue de 2,4l/mn à l’âge de 80 ans. Le cœur, au cours d’un exercice<br />
physique important, peut éjecter 4 à 7 fois son volume de repos.<br />
b- Concepts de précharge et de post-charge<br />
Selon la loi de Starling, une fibre myocardique développe une force après<br />
activation qui est proportionnelle à sa longueur initiale pré-activation. Cette<br />
longueur initiale caractérise la précharge. Elle est habituellement assimilée au<br />
volume sanguin présent dans le ventricule à la fin de la diastole (volume<br />
télédiastolique). La post-charge représente la force que doit vaincre le muscle<br />
cardiaque lors de sa contraction. Elle est la pression artérielle systémique et est<br />
généralement assimilée aux résistances vasculaires. )<br />
‐ 23 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
c- Facteurs intrinsèques de régulation du débit cardiaque<br />
Le débit cardiaque n’est pas contrôlé de façon principale par le cœur luimême,<br />
mais par divers facteurs de la circulation périphérique qui agissent sur le flux<br />
sanguin veineux qui revient au cœur et qui est appelé le retour veineux.<br />
Les facteurs périphériques sont au premier plan dans la régulation du débit<br />
cardiaque car le cœur possède un mécanisme intrinsèque qui lui permet de pomper<br />
automatiquement la quantité de sang reçue quelque soit son importance. Ce<br />
mécanisme est appelé la loi de Franck Starling du cœur. En effet, lorsqu’une<br />
quantité importante de sang arrive au cœur, les parois des cavités cardiaques<br />
s’étirent ; En réponse à cet étirement, le muscle se contracte avec une force accrue et<br />
éjecte outre la quantité normale de sang l’excédent. Le cœur évacue donc tout<br />
apport sanguin supplémentaire dans l’aorte pendant la systole et dans les limites<br />
physiologiques est capable de remettre en circulation tout volume sanguin<br />
correspondant au retour veineux, ce qui évite tout stockage important de sang dans<br />
les veines. L’étirement des parois influe également sur le rythme cardiaque.<br />
L’étirement du nœud sinusal dans la paroi auriculaire droite entraine une<br />
augmentation de la fréquence cardiaque de 10 à 15%. L’oreillette droite étirée est de<br />
surcroît à l’origine d’un réflexe nerveux dit de Brainbridge ; l’influx se dirige<br />
d’abord vers le centre vasomoteur du cerveau puis revient au cœur en empruntant<br />
les nerfs sympathiques et le vague.<br />
L’une des conséquences les plus importantes du mécanisme de Franck Starling<br />
est que, dans des limites raisonnables, les modifications de pression artérielle ou de<br />
la post-charge ont un impact insignifiant sur le débit cardiaque.<br />
La somme de tous les débits locaux de la circulation périphérique correspond<br />
au retour veineux dans l’oreillette droite. Le débit cardiaque est surtout contrôlé par<br />
l’ensemble des facteurs qui déterminent les flux sanguins locaux. À long terme,<br />
lorsque la pression artérielle est normale, le débit cardiaque varie de façon<br />
‐ 24 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
inversement proportionnelle aux résistances périphériques totales. Lorsque les<br />
résistances périphériques totales sont normales, le débit cardiaque l’est également.<br />
En revanche lorsqu’elles s’accroissent ou diminuent, le débit cardiaque<br />
respectivement chute ou augmente. Cela s’explique par la loi d’Ohm :<br />
Débit cardiaque = pression artérielle / résistances périphériques totales<br />
d- Les limites de l’augmentation du débit cardiaque<br />
Il existe des limites à la quantité de sang que le cœur est capable d’éjecter. En<br />
l’absence de stimulation nerveuse supplémentaire, le cœur peut supporter un retour<br />
veineux de deux fois et demi supérieur au retour veineux normal avant de devenir<br />
par lui-même un facteur limitant du contrôle de son débit.<br />
e- Facteurs extrinsèques de régulation du débit cardiaque : rôle du système<br />
nerveux autonome<br />
Le système nerveux contrôlant les fonctions viscérales est le système nerveux<br />
autonome. Il intervient dans le contrôle de la pression artérielle et de la fréquence<br />
cardiaque en l’occurrence.<br />
e-1- Organisation générale du système nerveux autonome(SNA)<br />
Le système nerveux autonome est principalement activé par les centres<br />
localisés dans la moelle épinière, le cerveau et l’hypothalamus. Le SNA est souvent<br />
associé à des réflexes viscéraux. Une information issue d’un organe est d’une part<br />
transmise vers les centres nerveux via le ganglion du SNA, et d’autre part déclenche<br />
une réponse réflexe vers l’organe afin de contrôler son activité. Les efférences du<br />
SNA cheminent dans deux systèmes prédominants qui sont les systèmes<br />
sympathique et parasympathique.<br />
‐ 25 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
e-2- Distribution des systèmes nerveux sympathique et parasympathique<br />
Les fibres sympathiques sont issues de la moelle épinière au niveau des<br />
segments T1 et L2 puis font relais dans les ganglions de la chaîne sympathique.<br />
Chaque fibre sympathique de son origine à l’effecteur est composée de deux<br />
neurones : un neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Ce dernier<br />
naît d’un ganglion des chaînes paravertébrales ou prévertébrales. À partir du<br />
ganglion, les fibres post ganglionnaires innervent différents organes. La distribution<br />
des neurones sympathiques vers les organes cibles dépend de l’origine<br />
embryonnaire de ces organes. Le cœur reçoit de nombreuses fibres sympathiques de<br />
la chaîne sympathique au niveau du cou car le cœur se développe à partir du cou de<br />
l’embryon.<br />
Les neurones préganglionnaires sympathiques naissent dans la corne<br />
intermédiolatérale de la moelle épinière et cheminent sans faire relais dans les<br />
chaînes sympathiques et les nerfs splanchniques pour se terminer au niveau de la<br />
médullo-surrénale. Dans la glande, les neurones préganglionnaires sympathiques<br />
font relais avec les cellules neuronales capables de synthétiser l’adrénaline et la<br />
noradrénaline dans les cellules sanguines.<br />
Les fibres parasympathiques quittent le système nerveux central par les paires<br />
crâniennes 3, 7, 9 et 10 ; et par les 2e et 3e nerfs sacrés. Environ 75 % des fibres<br />
nerveuses parasympathiques cheminent dans le nerf vague qui innervent plusieurs<br />
viscères parmi lesquels le cœur. L’innervation parasympathique est constituée de<br />
neurones pré et postganglionnaires. Outre quelques fibres parasympathiques des<br />
paires crâniennes, les fibres préganglionnnaires se dirigent directement vers l’organe<br />
qu’elles contrôlent. Les fibres postganglionnaires sont situées dans l’organe.<br />
‐ 26 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
e-3- Caractéristiques des fonctions sympathiques et parasympathiques<br />
Les fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques sécrètent<br />
respectivement la noradrénaline et l’acétylcholine. Tous les neurones<br />
préganglionnaires sont cholinergiques dans les systèmes nerveux sympathiques et<br />
parasympathiques. La différence de neurotransmetteur intervient au niveau des<br />
fibres postganglionnaires.<br />
L’acétylcholine active deux types différents de récepteurs : les récepteurs<br />
muscariniques et nicotiniques. Il existe deux groupes de récepteurs adrénergiques :<br />
les récepteurs α ou β divisés en 2 sous –groupes chacun.<br />
La stimulation du sympathique augmente l’activité globale du cœur. Cet effet<br />
est dû à l’augmentation de la force contractile du myocarde et de la fréquence<br />
cardiaque. La stimulation parasympathique a un effet inverse. Il faut noter que les<br />
oreillettes sont richement innervées en fibres parasympathiques tandis que les<br />
ventricules le sont faiblement.<br />
e-4- Régulation nerveuse de la pression artérielle et de la circulation<br />
Tout comme chaque tissu possède la fonction essentielle de réguler son propre<br />
débit sanguin (par des facteurs hormonaux, humoraux et métaboliques), le système<br />
nerveux exerce un contrôle supplémentaire sur la circulation. Normalement, le<br />
système nerveux n’est pas concerné par l’ajustement du débit sanguin local. Par<br />
contre il agit sur des fonctions plus globales comme la redistribution du débit<br />
sanguin entre différents territoires, l’augmentation de l’activité contractile du cœur<br />
et la régulation de la pression artérielle. La partie du SNA qui occupe une place<br />
prépondérante dans le contrôle de la circulation est le système nerveux sympathique<br />
alors que le système nerveux parasympathique intervient davantage dans la<br />
régulation de la fonction cardiaque.<br />
‐ 27 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Les fibres nerveuses sympathiques innervent tous les vaisseaux exceptés les<br />
capillaires, permettant ainsi d’augmenter leur résistance et de modifier le débit<br />
sanguin tissulaire. La stimulation sympathique des gros vaisseaux favorise la<br />
modification de leur calibre et par conséquent du volume du système circulatoire<br />
périphérique. La stimulation sympathique cardiaque quant à elle augmente l’activité<br />
du cœur.<br />
Les nerfs sympathiques transportent un grand nombre de fibres<br />
vasoconstrictrices et seulement quelques fibres vasodilatatrices. Le centre<br />
vasomoteur est situé dans la substance réticulée du bulbe et du 1/ 3 inférieur du<br />
pont, de façon bilatérale. Ce centre envoie des impulsions aux vaisseaux de<br />
l’organisme à travers la moelle épinière puis les fibres sympathiques<br />
vasoconstrictrices. L’on distingue trois zones importantes du centre nerveux :<br />
- une aire vasoconstrictrice située bilatéralement dans la partie antéro-latérale<br />
de la partie haute du bulbe<br />
- une aire vasodilatatrice située bilatéralement dans la partie antéro-latérale de<br />
la moitié inférieure du bulbe<br />
- une aire sensorielle située bilatéralement dans le tractus solitaire, dans les<br />
parties postéro-latérales du bulbe et de la partie basse du pont. Les neurones<br />
de cette zone reçoivent des messages nerveux sensitifs, surtout par les nerfs<br />
vague et glossopharyngien, et les signaux émis par cette aire sensorielle<br />
contribuent au contrôle de l’activité des aires vasoconstrictrices et<br />
vasodilatatrices ; ce qui réalise un contrôle réflexe. C’est le cas du réflexe issu<br />
des barorécepteurs qui détermine la pression artérielle.<br />
Dans les conditions normales, l’aire vasoconstrictrice du centre vasomoteur<br />
envoie des signaux en permanence aux fibres sympathiques vasoconstrictrices qui<br />
de ce fait ont une décharge continue appelée tonus vasoconstricteur sympathique.<br />
‐ 28 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Ces impulsions maintiennent les vaisseaux sanguins en état de contraction partielle<br />
que l’on appelle tonus vasomoteur.<br />
Le centre vasomoteur contrôle non seulement le degré de constriction des<br />
vaisseaux, mais aussi l’activité cardiaque. Les parties latérales du centre vasomoteur<br />
envoie des influx excitateurs, par les fibres nerveuses sympathiques, jusqu’au cœur<br />
où ils augmentent la fréquence et la contractilité cardiaques. ; Alors que la partie<br />
médiane du centre vasomoteur envoie par le nerf vague des influx au cœur qui<br />
diminuent sa fréquence.<br />
Des zones disséminées dans la substance réticulée du pont, du mésencéphale<br />
et du diencéphale peuvent soit exciter, soit inhiber le centre vasomoteur.<br />
L’hypothalamus exerce des effets excitateurs et inhibiteurs puissants sur le<br />
centre vasomoteur.<br />
La stimulation du cortex moteur excite le centre vasomoteur par des influx qui<br />
se dirigent jusqu’à celui-ci par l’hypothalamus. De même la stimulation de la partie<br />
antérieure du lobe temporal, des zones orbitaires du cortex frontal, de la partie<br />
antérieure du gyrus cingulaire , de l’amygdale, du septum et de l’hyppocampe peut<br />
dans chaque cas exciter ou inhiber le centre vasomoteur.<br />
Une des plus grandes fonctions du contrôle nerveux de la circulation est sa<br />
capacité à augmenter rapidement la pression artérielle. Pour se faire, les fonctions<br />
vasoconstrictrices et cardioaccélératrices du système nerveux sympathique sont<br />
stimulées en bloc. En même temps se produit une inhibition réciproque des influx<br />
vagaux normaux au cœur. Trois changements majeurs surviennent simultanément,<br />
chacun d’eux contribuant à augmenter la pression artérielle :<br />
- toutes les artérioles de l’organisme se contractent entraînant une augmentation<br />
de la résistance périphérique locale<br />
- les gros vaisseaux et spécialement les veines se contractent. Il en résulte un<br />
déplacement de sang de la circulation périphérique vers le cœur d’où<br />
‐ 29 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
l’augmentation du volume sanguin dans les cavités cardiaques. Ceci accroît le<br />
débit cardiaque et donc la pression artérielle<br />
- le cœur est stimulé directement par le système nerveux autonome, d’où une<br />
augmentation supplémentaire du débit cardiaque.<br />
e-5- Le système de contrôle de la pression artérielle par les barorécepteurs<br />
Les barorécepteurs ou pressorécepteurs sont des terminaisons nerveuses de<br />
type ramifié situées dans la paroi des artères et qui sont stimulées par leur propre<br />
étirement. Presque toutes les grosses artères du thorax et du cou sont pourvues de<br />
barorécepteurs. Mais ceux-ci sont plus nombreux dans les parois du sinus carotidien<br />
et de la crosse de l’aorte. Les signaux sont transmis à partir de chaque sinus<br />
carotidien, par la voie du nerf de Herring puis du nerf glossopharyngien, au tractus<br />
solitaire situé dans le bulbe rachidien. Les signaux issus de la crosse aortique sont<br />
également transmis à cette même aire du bulbe par l’intermédiaire des nerfs vagues.<br />
Les barorécepteurs du sinus carotidien ne sont pas stimulés lorsque la pression<br />
est inférieure à 60 mmHg. La réponse des barorécepteurs aortiques est similaire à<br />
celle des barorécepteurs carotidiens excepté qu’ils fonctionnent en général à des<br />
niveaux de pression d’environ 30mmHg plus élevés. La réponse des barorécepteurs<br />
est plus forte si la pression change rapidement que si elle est stable.<br />
Une fois que les signaux issus des barorécepteurs ont pénétré dans le tractus<br />
solitaire du bulbe, des signaux secondaires vont inhiber le centre vasoconstricteur du<br />
bulbe et exciter le centre vagal. Les effets qui en résultent sont une dilatation des<br />
veines et des artérioles, une diminution de la fréquence et de la force contractile<br />
cardiaques. Par conséquent, l’excitation des barorécepteurs par la pression régnant<br />
dans les artères déclenche par voie réflexe une diminution de la pression artérielle<br />
en diminuant la résistance périphérique et le débit cardiaque. À l’inverse une<br />
pression basse a des effets opposés et déclenche par voie réflexe une remontée de la<br />
pression vers la normale.<br />
‐ 30 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Le système des barorécepteurs a un rôle quasi nul dans la régulation à long<br />
terme de la pression artérielle car ils s’adaptent en un ou deux jours à la pression à<br />
laquelle ils sont exposés. La régulation à long terme de la pression artérielle requiert<br />
d’autres systèmes tels que le rein (avec ses mécanismes hormonaux).<br />
e-6- Contrôle de la pression artérielle par les chémorécepteurs<br />
Il existe un réflexe chémorécepteur qui fonctionne de façon analogue à celui<br />
des barorécepteurs. Les chémorécepteurs sont des cellules chémosensibles<br />
(sensibles au manque d’oxygène et à l’excès de dioxyde de carbone ou d’ions<br />
hydrogène).<br />
‐ 31 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
II - ECHOCARDIOGRAPHIE<br />
<strong>DE</strong>FINITION ET PRINCIPES<br />
L’échocardiographie est une technique externe non invasive, qui applique les<br />
ultrasons à l’exploration du cœur (ultrasonographie) .Elle s’impose actuellement<br />
comme un examen complémentaire fondamental en cardiologie.<br />
Les ultrasons sont des vibrations mécaniques transmises par la matière, de<br />
fréquence supérieure à 20 000 Hertz, donc audibles à l’oreille humaine. Leur<br />
utilisation médicale est basée sur le principe du sonar, c’est –à-dire sur la réflexion<br />
de l’onde ultrasonore émise par un cristal piézo-électrique [14].L’effet piézoélectrique<br />
est le pouvoir qu’a une substance de transformer l’énergie mécanique de<br />
déformation en énergie électrique ou vice –versa [15].<br />
L’écho réfléchie au niveau des différentes structures cardiaques est convertie<br />
par un système électronique en une impulsion électrique amplifiée secondairement<br />
et visualisée sur l’écran d’oscilloscope [14].L’appareil d’échocardiographie ou<br />
échocardiographe se comporte comme un émetteur et un récepteur d’ultrasons. Il<br />
émet pendant un court laps de temps et ensuite « écoute » les sons réfléchis. Le<br />
temps d’émission est généralement de 1 /1000 du temps de réception et ne dure<br />
qu’une micro- seconde. Il y a une émission chaque milliseconde : il s’agit<br />
d’ultrasons pulsés.<br />
Les ultrasons se propagent schématiquement comme les rayons lumineux et<br />
obéissent aux mêmes lois physiques. Pour que les échos soient réfléchis, le faisceau<br />
ultrasonique doit être perpendiculaire aux structures étudiées au risque de ne pas<br />
être capté. Ses rayons sont d’abord parallèles (champ proximal) puis à une certaine<br />
distance de l’émetteur deviennent divergents (champ distal) [15].<br />
‐ 32 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
B) DIFFERENTS MO<strong>DE</strong>S D’ECHOCARDIOGRAPHIE<br />
Trois modes d’exploration ultrasonore sont utilisés en cardiologie :<br />
unidimensionnel, bidimensionnel, et Doppler chacun donnant une imagerie<br />
échographique différente .Ces trois modes se complètent et doivent être utilisés<br />
conjointement lors de l’examen échographique.<br />
1- Mode unidimensionnel (TM) [14]<br />
Ce mode permet d’explorer le cœur dans une seule dimension, car l’émission<br />
d’ultrasons se fait uniquement dans un seul axe. Chaque structure cardiaque<br />
rencontrée par le faisceau étroit d’ultrasons sélectionné réfléchit un écho<br />
caractéristique par sa position et sa mobilité. L’échocardiographie<br />
unidimensionnelle donne ainsi une représentation graphique des mouvements des<br />
structures cardiaques en fonction du temps, d’où la dénomination de cette<br />
technique : « Temps-Mouvement » (mode TM).<br />
2- Mode bidimensionnel (2D) [14]<br />
Dans ce mode, le cœur est exploré simultanément en deux dimensions (2D) et<br />
en temps réel. Le faisceau ultrasonore balaie les structures cardiaques dans un<br />
secteur angulaire choisi entre 30 et 90°, ce qui permet d’obtenir une coupe<br />
anatomique et dynamique du cœur en forme d’arc de cercle.<br />
3- Mode Doppler<br />
Quand un faisceau ultrasonique traverse un flux sanguin, la fréquence du<br />
signal revenant à l’émetteur peut être augmentée ou diminuée, en fonction de la<br />
direction et de la vitesse de ce flux par rapport à l’incidence du faisceau<br />
ultrasonique : c’est l’effet Doppler. Un mouvement liquidien vers la sonde élèvera la<br />
fréquence de retour, tandis qu’un mouvement s’en éloignant en diminuera la<br />
fréquence. L’amplitude du changement de fréquence est proportionnelle à la vitesse<br />
‐ 33 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
du flux sanguin ainsi qu’à l’angle d’attaque du faisceau ultrasonique. Si la direction<br />
du flux est perpendiculaire au rayon, la vitesse du flux ne peut être enregistrée [15].<br />
L’échographie Doppler permet d’explorer les flux sanguins intracardiaques en<br />
mesurant les vélocités sanguines. Il mesure la différence entre les ultrasons émis et<br />
celle des ultrasons réfléchis par une interface mobile qui est le flux sanguin,<br />
permettant d’appréhender la vitesse de déplacement de celui-ci. Le signal du<br />
Doppler recueilli est matérialisé sous la forme d’un graphique de vélocité en<br />
fonction du temps (courbe de flux spectral).<br />
Il existe deux procédés Doppler utilisés en cardiologie : Doppler pulsé et Doppler<br />
continu. Le Doppler couleur constitue une modalité particulière du Doppler<br />
pulsé (Doppler pulsé codé couleur) [14].<br />
a- Doppler pulsé [14]<br />
Dans ce procédé, l’émission des ultrasons est discontinue. Le même cristal<br />
piézo-électrique, l’élément principal de la sonde ultrasonore, fonctionne en<br />
alternance comme émetteur et récepteur. Le Doppler pulsé ne permet pas de mesurer<br />
les vitesses sanguines supérieures à1m/s du fait du phénomène d’ambiguïté en<br />
vitesse, dû au principe physique de l’émission pulsée. Il en résulte une amputation<br />
de la courbe spectrale de ses hautes vitesses qui s’inscrivent en miroir dans le sens<br />
inverse (phénomène du repliement spectral).<br />
b- Doppler continu [14]<br />
Il s’agit d’une émission d’ultrasons continue. La sonde sonore est composée<br />
de deux cristaux piézo-électriques : l’un émetteur et l’autre récepteur. En effet,<br />
toutes les vitesses sanguines des flux rencontrés sur le trajet du faisceau ultrasonore<br />
sont intégrées et enregistrées. Le Doppler continu, à l’opposé du Doppler pulsé,<br />
permet de mesurer les vitesses sanguines les plus élevées sans aucune limitation.<br />
‐ 34 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
c- Doppler couleur [14]<br />
Le Doppler couleur permet de reconstruire les flux sanguins intracardiaques<br />
et de les visualiser grâce au système de codage en couleur. Par convention, le flux se<br />
rapprochant de la sonde ultrasonore, donc antérograde, est représenté en rouge, et le<br />
flux s’en éloignant dit rétrograde est coloré en bleu. Le flux turbulent s’inscrit en<br />
vert. Le Doppler couleur permet ainsi d’étudier en temps réel, les flux<br />
intracardiaques superposés sur l’imagerie bidimensionnelle.<br />
C- APPAREILLAGE ECHOGRAPHIQUE [14]<br />
L’appareil appliqué à l’étude ultrasonore du cœur, l’échocardiographe, permet<br />
de coupler les trois modes d’exploration : TM, 2D, Doppler. La sonde sectorielle à<br />
balayage automatique donne une imagerie bidimensionnelle, dans laquelle un<br />
dispositif permet de sélectionner un faisceau linéaire pour analyser selon le mode<br />
TM ou Doppler. Les tracés échographiques enregistrés sur papiers photosensibles<br />
sont synchronisés à l’électrocardiogramme (ECG) qui sert de référence<br />
chronologique dans le cycle cardiaque.<br />
D- TECHNIQUE D’EXAMEN<br />
L’examen échographique est réalisé chez le patient en décubitus dorsal ou en<br />
décubitus latéral gauche. La sonde, préalablement enduite d’un gel facilitant la<br />
transmission des ultrasons, est placée au contact de la paroi thoracique<br />
(échocardiographie transthoracique). Pour des raisons mécaniques, on considère que<br />
le contact entre la sonde et le ventre ne peut pas être parfait et qu'il existe donc une<br />
fine couche d'air entre la sonde et le ventre. C'est pour remédier à ce problème que<br />
le médecin applique un gel, dont l'impédance acoustique est proche de celle de la<br />
peau, pour obtenir une atténuation plus faible.<br />
Il existe 4 voies d’abord classiques possibles :<br />
-parasternale gauche utilisée systématiquement,<br />
‐ 35 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
-apicale au niveau du choc de pointe,<br />
-sous-costale réalisée surtout en cas de mauvaises incidences précédentes,<br />
-sus- sternale pour l’étude de la crosse de l’aorte.<br />
La multiplication des voies d’abord permet d’explorer le cœur de façon précise et<br />
d’obtenir le maximum d’informations. La qualité de l’imagerie est souvent dégradée<br />
en cas de déformation thoracique, d’obésité du patient, d’emphysème.<br />
L’échocardiographie transoesophagienne est une technique particulière réalisée<br />
avec une sonde montée sur un fibroscope flexible introduit dans l’œsophage du<br />
patient. Elle apporte une haute définition de l’imagerie échographique et augmente<br />
la précision diagnostique [14].<br />
E) ECHOCARDIOGRAMME NORMALE <strong>DE</strong> L’ADULTE [14]<br />
1- Tracé unidimensionnel(TM)<br />
En orientant le faisceau linéaire d’ultrasons de l’apex vers la base du cœur, les<br />
structures cardiaques peuvent être étudiées selon trois incidences classiques :<br />
transventriculaire, transmitrale et transaortique.<br />
a- Incidence transventriculaire<br />
L’enregistrement est réalisé au-dessous de la valve mitrale. Les structures<br />
cardiaques visualisées d’avant en arrière sont :<br />
-la paroi thoracique antérieure<br />
-la paroi antérieure du ventricule droit<br />
-la cavité du ventricule droit<br />
-le septum interventriculaire<br />
-la cavité du ventricule gauche<br />
-la paroi postérieure du ventricule gauche<br />
Cette incidence permet de mesurer les paramètres suivants :<br />
‐ 36 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
-le diamètre diastolique du ventricule droit (n : 9-26mm),<br />
-l’épaisseur diastolique du septum interventriculaire (n : 6-11mm),<br />
-les diamètres endocavitaires du ventricule gauche, diastolique (n : 38-56mm) et<br />
systolique (n : 22-40mm),<br />
-l’épaisseur diastolique de la paroi postérieure (n : 6-11mm).<br />
Les diamètres et les épaisseurs diastoliques se mesurent au début de l’onde Q de<br />
QRS, donc en télédiastole. Le diamètre systolique du ventricule gauche est mesuré<br />
en télésystole c’est-à-dire au maximum de la contraction septale [14].<br />
Les diamètres télédiastolique (DTD) et télésystolique (DTS) du ventricule<br />
gauche permettent de calculer la fraction de raccourcissement (FR) selon la formule<br />
100* (DTD-DTS)/ DTD. Cet indice évalue la fonction systolique ventriculaire<br />
gauche et admet une valeur normale de 35±5 % [16]. Les DTD et DTS sont<br />
également impliqués dans l’estimation de la fraction d’éjection ventriculaire selon la<br />
méthode de Teicholz (FE Teicholz).<br />
b- Incidence transmitrale<br />
Le faisceau ultrasonore traverse les mêmes structures cardiaques avec la valve<br />
mitrale à l’intérieur du ventricule gauche (VG).Les échos de la grande valve mitrale<br />
et de la petite valve mitrale se séparent l’un de l’autre en diastole et s’accolent en<br />
systole.<br />
On décrit deux ondes diastoliques de la grande valve mitrale :<br />
-onde E d’ouverture mitrale protodiastolique lors du remplissage rapide du VG<br />
-onde A de réouverture mitrale pré-systolique due à la contraction auriculaire<br />
L’onde A est de moindre amplitude que l’onde E.<br />
c- Incidence transaortique<br />
Le faisceau ultrasonore est orienté vers la base du cœur. On enregistre<br />
successivement :<br />
‐ 37 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
-la paroi thoracique antérieure,<br />
-la paroi antérieure du ventricule droit(VD)<br />
-la chambre de chasse du VD,<br />
-la paroi antérieure de l’aorte,<br />
-les sigmoïdes aortiques,<br />
-la paroi postérieure de l’aorte,<br />
-l’oreillette gauche(OG),<br />
-la paroi postérieure de l’OG.<br />
Dans cette incidence on mesure :<br />
-le diamètre télédiastolique de l’aorte (n : 20-38mm),<br />
-l’écartement protosystolique des sigmoïdes aortiques (n : 16-25mm),<br />
-le diamètre télésystolique de l’OG (n : 18-40mm) [14]<br />
Cette incidence permet également d’évaluer la fonction systolique ventriculaire<br />
gauche par la mesure du temps d’éjection systolique (TE). La durée normale de la<br />
phase d’éjection est de 295± 19 ms. Le TE va du début de l’ouverture à la fermeture<br />
de la valve aortique [16].<br />
2- Tracé bidimensionnel (2D)<br />
Plusieurs coupes échographiques du cœur peuvent être réalisées à partir des 4<br />
voies d’abord précédemment citées.<br />
a- Incidence parasternale gauche<br />
La sonde est lacée au 4e espace intercostal gauche le long du sternum, ce qui<br />
permet d’explorer le cœur selon le grand axe (coupe longitudinale) et le petit axe<br />
(coupes transverses).<br />
‐ 38 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
• Coupe longitudinale<br />
Cette coupe passe par les cavités cardiaques gauches. La racine de l’aorte<br />
ascendante surplombe l’OG. Deux sigmoïdes aortiques et les valves mitrales sont<br />
visualisées dans cette coupe de même que l’appareil mitral sous-valvulaire (pilier<br />
postéro- médian,cordages).<br />
• Coupes transverses<br />
La sonde subit une rotation de 90° par rapport à l’incidence longitudinale.<br />
Trois coupes échographiques peuvent être obtenues par une inclinaison successive<br />
de la sonde, de la base vers l’apex :<br />
-Coupe transaortique<br />
L’image est centrée sur l’aorte dont trois sigmoïdes. Les valves tricuspides et<br />
pulmonaires sont également visibles dans cette incidence.<br />
-Coupe transmitrale<br />
Cette coupe visualise au centre du VG deux valves mitrales. Il est possible de<br />
mesurer par planimétrie la surface de l’orifice mitral en protodiastole (n : 4-6<strong>cm</strong>²).<br />
-Coupe transventriculaire<br />
Sont visibles le VG, les deux piliers de la valve mitrale.<br />
b- Incidence apicale<br />
La sonde placée au niveau du choc de pointe permet d’obtenir deux coupes du<br />
cœur : des 4 cavités et des 2 cavités gauches.<br />
Elle permet de calculer la fraction d’éjection ventriculaire selon Simpson (FE<br />
Simpson) dont la valeur normale est 65± 5%. Elle est tirée des surfaces<br />
ventriculaires gauches en télédiastole et en télésystole lesquelles permettent<br />
l’évaluation des volumes ventriculaires gauches télédiastolique (VTD) et<br />
‐ 39 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
télésystolique (VTS). L’équation utilisée est FE Simpson =100* (VTD- VTS)/ VTD<br />
[16].<br />
• Coupe des 4 cavités<br />
Cette coupe visualise simultanément les deux ventricules selon leur grand axe,<br />
séparés par le septum interventriculaire(SIV) et plus postérieurement les deux<br />
oreillettes séparées par le septum interauriculaire(SIA). L’on peut également<br />
explorer les valves auriculo-ventriculaires.<br />
• Coupe des 2 cavités gauches<br />
La rotation de la sonde de 30° fait disparaître les cavités droites et apparaître la<br />
racine de l’aorte qui émerge du VG.<br />
c- Incidence sous costale ou sous xiphoïdienne<br />
En plaçant la sonde dans le creux épigastrique, il est possible de réaliser les<br />
coupes cardiaques suivantes :<br />
- la coupe des 4 cavités, superposable à celle obtenue par voie apicale<br />
- plusieurs coupes sagittales et en particulier celle de la veine cave inférieure<br />
avec son abouchement dans l’oreillette droite.<br />
d- Incidence sus-sternale<br />
Par cette voie on peut visualiser la crosse de l’aorte en coupe longitudinale et<br />
transverse et l’origine des gros vaisseaux du cou.<br />
3- Tracé Doppler<br />
IL existe deux moyens d’analyser le signal Doppler :<br />
-le son Doppler qui permet de séparer les flux laminaires (tonalité sonore douce)<br />
des flux turbulents (tonalité sonore rude)<br />
‐ 40 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
-la courbe de flux spectral composée de différentes vitesses du flux sanguin<br />
échantillonné. Ces vitesses se répartissent sur écran en temps réel selon leur<br />
valeur absolue exprimée en mètre par seconde et selon leur direction de part et<br />
d’autre de la ligne de zéro prise comme référence. Les flux sanguins qui<br />
s’approchent de la sonde, dits antérogrades, s’inscrivent positivement, au-dessus<br />
de la ligne de zéro ; ceux qui s’éloignent de la sonde, dits rétrogrades,<br />
s’inscrivent négativement au-dessous de la ligne de zéro.<br />
L’enregistrement simultané de l’ECG permet de repérer les phases systolique et<br />
diastolique du cycle cardiaque [14].<br />
a- Flux valvulaires normaux<br />
La courbe du flux sanguin enregistrée en Doppler pulsé délimite un espace vide à<br />
l’intérieur du spectre ; celle du Doppler continu est pleine du fait de l’intégration de<br />
l’ensemble des vélocités mesurées. Le pic de la courbe détermine la vélocité<br />
maximale (Vmax) du flux exploré.<br />
• Flux mitral<br />
Enregistré habituellement par voie apicale, il est positif et biphasique en diastole,<br />
composé de l’onde E de remplissage rapide du VG et de l’onde A due à la<br />
contraction auriculaire (onde E supérieure à l’onde A). En systole la courbe longe la<br />
ligne de zéro (valve mitrale fermée). Vmax : 0,9m /sec (0,6-1, 3) [14]<br />
La performance diastolique est la sommation de deux composantes<br />
successives : la relaxation et la compliance ventriculaires qui sont respectivement<br />
des phénomènes actif et passif. La relaxation ventriculaire débute avant la fermeture<br />
de la valve aortique (c'est-à-dire pendant la période d’éjection), se poursuit jusqu’au<br />
pic de vélocité de l’onde E ; la compliance termine la diastole, allant du pic de<br />
l’onde E à la fermeture mitrale. Les indices de fonction diastolique sont tous<br />
‐ 41 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
dépendants des conditions de charge et de la fréquence cardiaque [17]. Le pic de<br />
l’onde E normal est approximativement de 0,8m/s tandis que celui de l’onde A est<br />
d’environ 0,5 m/s, avec un ratio E/A >1 [18].<br />
La durée de la phase de relaxation isovolumétrique reflète en partie la relaxation<br />
active des cellules myocardiques. La valeur normale du temps de relaxation<br />
isovolumétrique (TRIV) est de 76± 11 ms avant l’âge de 50 ans. Le temps de<br />
décélération de l’onde E(T<strong>DE</strong>) est de 180ms (140-220) [19].<br />
Appleton [20] a décrit trois types de flux transmitral en fonction des gradients de<br />
pression entre l’oreillette et le ventricule en diastole (voir tableau sur la<br />
classification de Christopher Appleton)<br />
Tableau 1 Classification de Christopher APPLETON.<br />
Normal<br />
Anomalie de<br />
Pseudo-normal<br />
relaxation (type 1) (type 2)<br />
Anomalie de la<br />
compliance (type 3)<br />
Rapport E/A > 1 < 1 > 1 > 2<br />
Temps de décélération de<br />
l’onde E<br />
160-240 > 240 160-240 < 160<br />
TRIV ms) 70-120 > 120 70-120 < 70<br />
Rapport S/D Positif Positif Négatif Négatif<br />
Durée Ap/Am Am>Ap Am>Ap Am
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
(voie apicale, sous-costale ou sus-sternale centrée sur l’aorte descendante), soit<br />
positive (voie parasternale droite ou sus-sternale centrée sur l’aorte ascendante).<br />
En diastole le flux est nul (sigmoïdes fermées). Vmax : 1,35m/sec (0,1-1,7).<br />
• Flux tricuspide<br />
Son enregistrement est possible par voies : parasternale gauche, apicale ou souscostale.<br />
Il a le même aspect biphasique que celui de la valve mitrale.<br />
• Flux pulmonaire<br />
Il est enregistré à partir de la coupe parasternale transverse, centrée sur la voie<br />
d’éjection pulmonaire. Il présente une onde systolique négative suivie d’un retour à<br />
la ligne de zéro en diastole.<br />
L’analyse du flux veineux pulmonaire peut renseigner sur la fonction diastolique.<br />
Normalement ce flux comporte trois ondes successives : Une onde S systolique, une<br />
onde D protodiastolique et une onde Ap télédiastolique [21]. Le pic de l’onde S<br />
normal est de 0,48m/s (0,3-0,66) et celui de l’onde D est de 0,5 m/s (0,3-0,7) avec<br />
un rapport S/D égal à 1(0,5-1,5) [19].<br />
La différence entre la durée de l’onde Ap du flux veineux pulmonaire et celle de<br />
l’onde A du flux transmitral (Am) permet d’estimer la pression télédiastolique du<br />
ventricule gauche. Une différence positive ( Ap -Am >30ms) prédit ainsi d’une<br />
pression télédiastolique > 20mmHg [21].<br />
4- Intérêt de l’échocardiographie<br />
a- modes uni- et bidimensionnels<br />
Ils permettent :<br />
‐ L’étude de la morphologie et de la cinétique des valves cardiaques<br />
‐ La détermination des dimensions et de la géométrie des cavités cardiaques<br />
‐ L’étude de la taille de l’aorte initiale, des artères pulmonaires et de la veine<br />
cave inférieure<br />
‐ 43 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
‐ L’évaluation de l’épaisseur, de la structure et de la cinétique des parois<br />
ventriculaires<br />
‐ L’étude du péricarde<br />
b- mode Doppler<br />
Le Doppler, en mesurant la vélocité des flux intracardiaques, apporte des<br />
renseignements hémodynamiques qui complètent les informations anatomiques<br />
fournies par les deux modes précédents.<br />
Cette technique permet :<br />
- l’évaluation de la sévérité des sténoses valvulaires par la mesure du gradient de<br />
pression transvalvulaire et le calcul de la surface fonctionnelle de l’orifice sténosé<br />
- la détection des fuites valvulaires<br />
-la mesure du débit cardiaque<br />
-l’évaluation des pressions artérielles pulmonaires<br />
5- Limitations de l'examen<br />
Du fait de la présence à proximité de l'organe, d'air et d'os, les fenêtres<br />
permettant de visualiser cet organe peuvent être extrêmement réduites, voire<br />
inexistantes : le compte-rendu spécifie alors "masse battante intra thoracique" sans<br />
pouvoir en dire plus ! C'est le problème de l’échogénéicité. Cette dernière est<br />
particulièrement faible chez les sujets obèses ou ayant une maladie pulmonaire<br />
(emphysème, maladie pulmonaire obstructive chronique), mais également chez le<br />
sujet trop maigre (l'espace entre les côtes étant alors "creux" avec interposition d'air<br />
entre la sonde et la peau). Le cœur est un organe tridimensionnel battant.<br />
L'échocardiographie effectue des coupes de cet organe et les résultats peuvent varier<br />
suivant le plan de coupe choisi. L'examen reste dépendant de l'expérience de<br />
l'examinateur.<br />
‐ 44 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
III - CŒUR ET SPORT<br />
CLASSIFICATION <strong>DE</strong>S SPORTS<br />
‐ LÉGISLATION FRANÇAISE<br />
La législation française classe les sports en deux catégories : à risque ou non.<br />
Les sports à risque sont : les sports sous-marins, les sports motorisés et aériens,<br />
l’alpinisme de haute altitude, les sports de combat lorsqu’il y a risque d’être mis<br />
hors combat. Une visite médicale est obligatoire tous les ans ou deux pour tout<br />
licencié à l’une de ces fédérations donnant délivrance d’un certificat de non contreindication.<br />
Il en est de même pour les autres sports, si une compétition est<br />
envisagée.<br />
‐ CLASSIFICATION <strong>DE</strong> BETHESDA<br />
Cette classification, proposée lors de la 26e conférence de Bethesda [5] est la<br />
référence la plus communément acceptée. Elle distingue les sports selon le type<br />
d’activité physique (dynamique, statique ou mixte) et l’intensité (élevée, moyenne<br />
ou faible). Un deuxième groupe inclut les sports à risque de collision et/ou à risque<br />
de syncope. Les auteurs reconnaissent que cette classification est incomplète : elle<br />
ne tient pas compte du stress, des contraintes de l’entraînement parfois différentes<br />
ou supérieures à celles du sport lui-même, des conditions climatiques extrêmes qui<br />
peuvent modifier radicalement la physiologie d’un effort physique, des qualités<br />
techniques individuelles ou de l’âge qui, à effort d’intensité égale, peuvent<br />
également modifier la charge de travail. D’un intérêt théorique certain, les auteurs<br />
s’interrogeaient, lors de sa parution en 1994, sur son intérêt pratique en matière de<br />
pathologie cardiovasculaire. Cependant avec le recul cette classification est la<br />
moins imparfaite et facilite la démarche quotidienne de tout médecin amené à<br />
donner des conseils précis à un patient, cardiaque ou non, désireux de pratiquer des<br />
activités physiques. Elle est la référence (guidelines) en cas de litige juridique [22].<br />
‐ 45 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Dans cette classification le football est classé IC c'est-à-dire un sport à statique<br />
faible et à dynamique forte avec entre autre un risque important de collision<br />
corporelle et un risque faible de syncope.<br />
Tableau 2 Classification des sport.<br />
A<br />
Dynamique faible<br />
B<br />
Dynamique modéré<br />
C<br />
Dynamique fort<br />
I<br />
Statique faible<br />
Billard<br />
Boules-Bowling<br />
Cricket<br />
Golf<br />
Tir<br />
Base-ball<br />
Tennis<br />
Tennis de table<br />
Volley Ball<br />
Badminton<br />
Course de fond<br />
(athlétisme)<br />
Course d’orientation<br />
Football *<br />
Hockey sur gazon *<br />
Marche athlétique<br />
Ski de fond (technique<br />
classique)<br />
Squash<br />
Tennis (simple)<br />
II<br />
Statique modérée<br />
Automobile (course) *+<br />
Équitation *+<br />
Motocyclisme *+<br />
Plongeon *+<br />
Tir à l’arc<br />
Course à pied (sprint)<br />
Escrime<br />
Football américain *<br />
Natation synchronisée +<br />
Patinage artistique *<br />
Rodéo *+<br />
Rugby *<br />
Sauts (athlétisme)<br />
Surf *+<br />
Basket-ball *<br />
Course de demi-fond<br />
(athlétisme)<br />
Handball *<br />
Hockey sur glace *<br />
Natation +<br />
Ski de fond (« pas du<br />
patineur »)<br />
III<br />
Statique fort<br />
Bobsleigh *+<br />
Escalade *+<br />
Gymnastique *+<br />
Haltérophilie *+<br />
Karaté-Judo *<br />
Luge *+<br />
Lancers (athlétisme)<br />
Ski nautique *+<br />
Planche à voile *+<br />
Voile +<br />
Culturisme<br />
Lutte *<br />
Ski (alpin) *+<br />
Aviron +<br />
Boxe *<br />
Canoë-kayak *+<br />
Cyclisme *+<br />
Décathlon<br />
Patinage (vitesse) +<br />
* : risque de collision corporelle.<br />
+ : risque de syncope.<br />
‐ 46 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
B- ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES CHRONIQUES DU<br />
SPORTIF : LE CŒUR D’ATHLETE.<br />
1- Les déterminants du cœur d’athlète [23]<br />
L’hypertrophie cardiaque (HC) du sportif répond à différents déterminants<br />
hémodynamiques, neuro-hormonaux, et génétiques qui agissent en synergie [24].<br />
Elle est par définition non pathologique et par conséquent ne présente aucune<br />
complication. Cependant, certains auteurs l’ont associée à un risque accru<br />
d’arythmie supra-ventriculaire et même ventriculaire [25].<br />
a- Facteurs hémodynamiques<br />
L’exercice physique intense et régulier est associé à des modifications<br />
hémodynamiques avec une altération des conditions de charge du cœur. C’est ainsi<br />
dans les sports aérobies (disciplines dynamiques), le cœur du sportif est<br />
initialement soumis à une augmentation de volume (surcharge volumique ou<br />
augmentation de la précharge) à l’origine d’un mécanisme adaptatif en deux temps :<br />
augmentation de la taille des cavités puis augmentation de l’épaisseur pariétale afin<br />
de maintenir constante la contrainte pariétale (loi de Laplace). En effet, d’après cette<br />
loi, l’augmentation de tension (T) due à l’élévation de pression ventriculaire gauche<br />
(P) est compensée par une diminution du rayon cavitaire (R) et une augmentation de<br />
l’épaisseur de la paroi ventriculaire gauche(e) : T= (P×R)/ e [26]. Ainsi la surcharge<br />
volumique conduit à un accroissement du diamètre de la cavité du ventricule gauche<br />
(VG) et à une augmentation proportionnelle de l’épaisseur pariétale : c’est<br />
l’hypertrophie ventriculaire excentrique [27]. En revanche dans les sports<br />
anaérobies (disciplines isométriques), le cœur du sportif est d’abord soumis à une<br />
élévation brutale de la pression artérielle (surcharge barométrique ou augmentation<br />
de la post-charge) ; l’adaptation se fait par une augmentation de l’épaisseur pariétale<br />
avec des dimensions cavitaires quasi inchangées : c’est l’HVG concentrique [26].<br />
‐ 47 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Lorsque le cœur entraîné est au repos, sa dilatation cavitaire lui permet de<br />
maintenir son rythme afin de maintenir un débit de repos suffisant [28]<br />
À l’effort, les muscles squelettiques se contractent et compriment les vaisseaux<br />
sanguins dans tout l’organisme. Ce qui a pour effet de déplacer de grandes quantités<br />
de sang des vaisseaux périphériques vers le cœur (retour veineux accru) et les<br />
poumons, et donc d’augmenter le débit cardiaque. Cet effet contribue<br />
essentiellement à l’augmentation du débit cardiaque, qui est parfois multiplié par<br />
cinq ou six lors d’un exercice musculaire intense. . Lors d’un effort physique sous –<br />
maximal, l’athlète utilise surtout son volume d’éjection systolique et épargne sa<br />
fréquence cardiaque pour des exercices musculaires d’intensité plus élevée [23].<br />
L’augmentation du débit cardiaque est à son tour un facteur essentiel de<br />
l’augmentation de la pression artérielle durant l’exercice. Au cours d’un effort<br />
maximal, la pression artérielle augmente de 30 à 40%, ce qui entraîne une<br />
augmentation supplémentaire du débit sanguin d’environ deux fois la valeur de<br />
repos [13]. Le débit cardiaque maximal est en grande partie lié au VO2 max pendant<br />
l’entraînement et peut être mesuré par la méthode de Fick selon la formule :DC =<br />
VO2 / D(A-V)O2 où DC est le débit cardiaque, VO2 le volume d’oxygène absorbé<br />
au niveau pulmonaire par minute et D(A-V)O2 la différence artério-veineuse<br />
d’oxygène [29]Tandis que le VO2 max chez un jeune sédentaire est<br />
approximativement de 35ml/kg/mn celle des athlètes d’endurance augmente<br />
significativement, pouvant dépasser 70 ml/kg/mn [30].<br />
b- Facteurs nerveux<br />
L’entraînement régulier diminue la balance sympathique/parasympathique par<br />
hypertonie vagale mais aussi et surtout par baisse du tonus sympathique. Ces<br />
modifications expliquent certaines particularités électrocardiographiques observées<br />
chez le sportif au repos notamment la bradycardie, les troubles de conduction et<br />
probablement de repolarisation [23].<br />
‐ 48 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
À l’effort, l’augmentation du flux sanguin local est assurée par la stimulation<br />
sympathique dans tout l’organisme ayant pour conséquence l’augmentation du débit<br />
cardiaque et celle de la pression artérielle. Dès le début de l’activité sportive, les<br />
aires motrices du système nerveux central entrent en activité pour commander<br />
l’exercice ; la majeure partie de la substance réticulée activatrice du cerveau est<br />
aussi activée, ce qui implique une stimulation importante des aires<br />
vasoconstrictrices et cardio-accélératrices du centre vasomoteur favorisant une<br />
décharge sympathique. De façon simultanée le tonus parasympathique diminue<br />
aboutissant :<br />
‐ Premièrement à une stimulation cardiaque qui résulte de la décharge<br />
sympathique et de l’inhibition du système parasympathique avec accélération<br />
de la fréquence et augmentation de la force contractile du cœur<br />
‐ Deuxièmement à une vasoconstriction intense des vaisseaux périphériques à<br />
l’exception des artérioles destinées aux muscles actifs qui sont dilatées sous<br />
l’effet des mécanismes de régulation locale<br />
‐ Troisièmement à une puissante contraction de la musculature veineuse qui<br />
permet une élévation marquée de la pression moyenne de remplissage<br />
systémique. Cette dernière est le déterminant majeur du retour veineux et par<br />
conséquent du débit cardiaque.<br />
Des réflexes à point de départ musculaire pourraient également stimuler le<br />
système nerveux sympathique. Ces signaux proviendraient de l’irritation de petites<br />
terminaisons nerveuses sensitives du tissu musculaire en activité par les produits de<br />
son métabolisme. Ils atteindraient les centres vasomoteurs après passage médullaire<br />
et stimuleraient le sympathique.<br />
Le cœur stimulé assure l’approvisionnement des muscles en oxygène et en<br />
nutriments. Le débit sanguin augmente considérablement dans les muscles en<br />
activité au détriment des autres tissus de l’organisme (excepté les tissus<br />
‐ 49 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
myocardique, cérébral et cutané). IL peut ainsi être multiplié par vingt cinq au cours<br />
d’exercices extrêmes. La moitié de cet accroissement est due à la vasodilatation<br />
intramusculaire et l’autre moitié est due à plusieurs facteurs dont le plus important<br />
est une élévation de la pression artérielle de 30% qui se produit pendant l’exercice.<br />
La force du sang dans les vaisseaux, en distend les parois et diminue la résistance<br />
vasculaire.<br />
L’augmentation de la pression artérielle secondaire à la stimulation<br />
sympathique est due à :<br />
‐ La vasoconstriction des artérioles et des petites artères dans la plupart des<br />
tissus ;<br />
‐ L’augmentation de l’activité de la pompe cardiaque ;<br />
‐ L’élévation de la pression moyenne de remplissage systémique.<br />
La contraction musculaire comprime les vaisseaux sanguins musculaires et<br />
diminue momentanément la perfusion sanguine. Le sujet non entraîné peut accroître<br />
son débit cardiaque de quatre fois tandis que le sportif bien entraîné peut<br />
l’augmenter de six fois la valeur de repos [13].<br />
c- Facteurs hormonaux<br />
L’exercice musculaire favorise la sécrétion de différentes hormones<br />
(catécholamines, hormone de croissance,…) et de facteurs de croissance<br />
(interleukine,…). Les catécholamines (adrénaline et noradrénaline) sont synthétisées<br />
par la médullo-surrénale sous l’action des nerfs sympathiques et ont les mêmes<br />
effets excitateurs que ces derniers. Ces hormones permettent l’anabolisme protéique<br />
et donc l’hypertrophie cardiaque et la néovascularisation. D’autres modifications<br />
hormonales favorisent le développement d’une hypervolémie qui aura un effet<br />
indirect sur le système cardiovasculaire. Au niveau vasculaire, les variations<br />
humorales ont également un rôle important et la réponse aux substances vaso-<br />
‐ 50 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
actives est changée après entraînement avec une vasodilatation accrue et<br />
augmentation de la libération des métabolites locaux [23].<br />
d- Facteurs génétiques<br />
Tous les sujets soumis à un niveau d’entraînement comparable ne présentent pas<br />
les mêmes adaptations myocardiques. Le rôle évoqué de la prédisposition génétique<br />
individuelle a été confirmé par des études réalisées sur des jumeaux. Récemment<br />
un phénotype particulier concernant les gènes codant pour l’angiotensinogène et<br />
l’enzyme de conversion a été associé au développement d’une hypertrophie<br />
cardiaque chez le sportif [23].Il s’agit du génotype ACE (angiotensine converting<br />
enzyme) qui a été identifié chez des athlètes d’endurance [8].<br />
2- Examen clinique cardiovasculaire du sportif [2].<br />
Aucun signe fonctionnel anormal n’est admis. Si des signes fonctionnels<br />
anormaux sont le motif de la consultation ou décelés par l’interrogatoire, le<br />
syndrome du cœur d’athlète est d’emblée improbable. Le seul élément particulier de<br />
l’examen physique est une bradycardie, parfois inférieure à 40 et/ou abaissée de 10-<br />
15 % par un entraînement régulier. Un troisième ou quatrième bruit est banal, de<br />
même un souffle systolique bref qui ne doit pas augmenter en inspiration profonde.<br />
La pression artérielle (PA) est normale. Cependant l’athlète peut présenter des<br />
symptômes en rapport avec l’exercice physique : vertiges causées par la<br />
déshydratation ou à l’hypotension post- exercice, douleur thoracique, palpitations<br />
qui s’expliqueraient par des extrasystoles, dyspnée.<br />
‐ 51 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
3-Examens paracliniques cardiovasculaires du sportif.<br />
Électrocardiogramme [2]<br />
Les caractéristiques ECG du cœur d’athlète sont bien établies depuis la<br />
compilation faite par Lichtman il y a maintenant plus d’un quart de siècle [31].<br />
Outre le caractère sinusal de la bradycardie, l’ECG peut déceler des troubles du<br />
rythme ou de la conduction tels que bloc auriculoventriculaire du 1er degré (BAVI),<br />
périodes de Wenckebach, ondes P bloquées, rythme jonctionnel( Parfois le rythme<br />
n’est pas imprimé par le nœud sinusal mais par la jonction auriculo-ventriculaire ;les<br />
complexes QRS ne sont plus précédés d’une onde P ou ; plus rarement, directement<br />
du ventricule dans ce cas les complexes QRS sont élargis), aspect de wandering<br />
pacemaker. Liées à l’hypertonie vagale, ces anomalies disparaissent à l’effort ainsi<br />
qu’à l’arrêt de l’entraînement. Un aspect d’hypertrophie est possible, rarement une<br />
hypertrophie auriculaire gauche (HAG) ou droite (HAD), souvent un aspect de bloc<br />
incomplet droit (BID) mineur, plus rarement avec une onde R supérieure ou égale à<br />
7 mm, parfois une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG). Des anomalies de la<br />
repolarisation sont fréquentes avec modifications de ST ressemblant à celles de la<br />
repolarisation précoce (sus-décalage supérieur à 0,5 mm dans deux dérivations<br />
successives, le plus souvent précordiales, s’atténuant à l’effort) ou modifications de<br />
T, elles aussi banales lorsqu’il ne s’agit que d’ondes T géantes précordiales ou<br />
d’ondes T inversées asymétriques en V1-V3 de type juvénile, plus problématiques<br />
lorsque ces ondes T négatives s’étendent au-delà de V3-V4. Elles ne peuvent être<br />
acceptées comme faisant partie du syndrome du cœur d’athlète que si : le sujet est<br />
asymptomatique, pratiquant le sport très régulièrement et intensivement, l’ECG<br />
étant par ailleurs normal (QT non allongé, présence d’ondes q septales, absence de<br />
sous-décalage de ST de type ischémique) et le test d’effort d’un excellent niveau<br />
physique, avec atténuation ou disparition de la négativité.<br />
‐ 52 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Dans le syndrome du cœur d’athlète, l’ECG se normalise en 4 à 12 semaines<br />
d’arrêt des activités sportives. Il n’existe pas d’explications satisfaisantes à ces<br />
anomalies de la repolarisation [32, 33]. Elles sont imprévisibles, non dépendantes de<br />
la qualité du sportif, non prédictives de la performance, mais nous ne les avons<br />
jamais observées à moins de 12 heures d’activité physique soutenue par semaine.<br />
Elles sont reproductibles chez un sportif donné à la reprise de l’entraînement, et<br />
n’ont jamais été décrites chez le travailleur de force. Elles ne sont pas en règle<br />
corrélées aux données de l’échocardiographie. Entre autres hypothèses retenues :<br />
l’hypertrophie-dilatation du ventricule gauche (VG) [34] une asymétrie de la<br />
repolarisation se démasquant après baisse du tonus sympathique induite par<br />
l’entraînement [35].<br />
ECG d’effort<br />
L’exercice dynamique est associé à une augmentation de la commande<br />
sympathique et à une réduction du tonus vagal. Les troubles du rythme tels que la<br />
bradycardie sinusale, de même que ceux de la conduction auriculo-ventriculaire<br />
disparaissent avec l’exercice physique. C’est également le cas pour les anomalies de<br />
repolarisation. Ces observations permettent de conclure que ces altérations<br />
électrocardiographiques sont fonctionnelles et non structurelles [7].<br />
Echocardiogramme du sportif au repos<br />
Méthode d’analyse fiable, non invasive et facilement répétitive,<br />
l’échocardiographie est facile à pratiquer chez le sportif. Elle fut utilisée pour la<br />
première fois en 1972 lors des jeux olympiques de Munich pour décrire l’aspect<br />
morphologique du « cœur d’athlète » [23].L’échocardiogramme transthoracique de<br />
repos peut être normal ou révéler des particularités [27, 36]. Les modifications<br />
échocardiographiques observées chez le sportif de haut niveau sont essentiellement<br />
constituées d’un accroissement du volume des cavités ventriculaires, quelquefois<br />
‐ 53 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
associé à une augmentation de l’épaisseur pariétale du ventricule gauche et de la<br />
taille de l’oreillette gauche [37]. Elles sont retrouvées dans les deux sexes et à tout<br />
âge [38, 39,40]. Ces adaptations sont dans la majorité des cas modérées, dans les<br />
limites supérieures de la normale et éloignées des valeurs relevées en pathologie<br />
[27,41]. Ainsi, comparées aux valeurs observées dans une population sédentaire<br />
témoin, le diamètre ventriculaire gauche est en moyenne majoré de 3 à 6 mm et<br />
l’hypertrophie pariétale de 2 à 3 mm [27, 36, 41]; les fonctions systolique et<br />
diastolique étant relativement préservées [27]. Ce n’est que dans moins de 5 % des<br />
cas que des modifications importantes sont observées [42, 43].<br />
a- Modifications structurales du cœur d’athlète<br />
‣ Ventricule gauche<br />
Il s’agit d’une hypertrophie pariétale et /ou d’une dilatation cavitaire [27,36].<br />
• Epaisseur du septum interventriculaire et épaisseur de la paroi postérieure du<br />
ventricule gauche<br />
Le type de sport pratiqué a une influence majeure sur les dimensions<br />
ventriculaires gauches. C’est ainsi que les disciplines mixtes sont fréquemment<br />
associées à une épaisseur pariétale du ventricule gauche >=13mm. Inversement, les<br />
autres types de sport notamment les exercices isométriques ou statiques impliquent<br />
régulièrement une hypertrophie pariétale peu marquée avec une épaisseur de la paroi<br />
ventriculaire gauche
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
significative entre la paroi postérieure en diastole des athlètes et celle des sujets<br />
témoins.<br />
En 2000, un groupe de 78 footballeurs professionnels ont fait l’objet d’une étude<br />
par Lahady et al [46] à Madagascar. L’épaisseur du septum interventriculaire était<br />
significativement plus élevée (p
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
Dans l’étude menée par Urhausen et al sur l’adaptation spécifique du ventricule<br />
gauche au sport sur 22 footballeurs [49], les footballeurs avaient un diamètre<br />
télédiastolique ventriculaire gauche de 55.0 mm ±3.8.<br />
En 2006, Ouldzein et al [50] en Tunisie, ont réalisé une étude échographique et<br />
électrocardiographie sur 181 footballeurs professionnels. Ils ont retrouvé un<br />
diamètre télédiastolique à 53mm±4.<br />
Madeira et al [51] en 2008 au Portugal ont évalué l’effet de l’exercice chronique sur<br />
les dimensions du ventricule gauche chez 24 sportifs. La valeur moyenne du<br />
diamètre télédiastolique retrouvée chez les sportifs était de 47.59mm±3.32.<br />
• Masse ventriculaire gauche (MVG)<br />
Au-delà d’une masse ventriculaire gauche indexée à la surface corporelle de<br />
125g/m² chez l’homme, l’on peut affirmer une hypertrophie ventriculaire gauche<br />
échographique [52].<br />
La MVGi, chez Al Hazzaa et al [48], était de 117g/m²±21.2 pour les<br />
footballeurs. Une différence significative était par ailleurs observée avec la MVGi<br />
des non sportifs.<br />
La masse ventriculaire gauche indexée à la surface corporelle (MVGi) était<br />
significativement plus petite (p
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
surface auriculaire gauche chez les 24 joueurs de leur étude 20.16<strong>cm</strong>²±2.03 contre<br />
16.16 <strong>cm</strong>²±1.83 chez les témoins.<br />
b- Fonctions systolique et diastolique du ventricule gauche<br />
La fonction systolique du ventricule gauche d’athlète évaluée par<br />
échocardiographie peut être normale, modérément augmentée ou diminuée. La<br />
fonction diastolique, évaluée par échocardiographie Doppler peut être normale ou<br />
légèrement altérée [54].<br />
Les principaux déterminants de la fonction diastolique sont le pic de vélocité de<br />
l’onde E, le pic de vélocité de l’onde A, le ratio E/A et le flux veineux pulmonaire.<br />
D’après l’analyse de Bennani et al [45], la fonction systolique déterminée par la<br />
fraction d’éjection était normale chez les athlètes et identique à celle des témoins.<br />
De même il n’y avait pas de différence significative entre la fonction diastolique des<br />
sportifs (évaluée par le rapport E/A) et celle des témoins.<br />
Stefani et al en Italie [55], dans leur étude chez 25 footballeurs d’élite n’ont<br />
retrouvé aucune différence statistiquement significative entre la fraction d’éjection<br />
des sportifs (58% ± 2) et celle des témoins (57% ± 4).<br />
La fonction systolique était également préservée chez les athlètes dans l’étude de<br />
AP Adebola et al [47], avec une fraction d’éjection >50%.<br />
Il existe d’autres méthodes d’imagerie qui n’ont qu’un rôle complémentaire de<br />
l’échocardiographie et ne doivent pas être utilisées d’emblée : l’imagerie par<br />
résonance magnétique et Le scanner multibarettes.<br />
‐ 57 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
C- LES LIMITES DU CŒUR D’ATHLETE<br />
1- L’électrocardiogramme<br />
a- Hypervagotonie [23]<br />
Certains sportifs très endurants, généralement des vétérans, présentent des<br />
bradycardies majeures pouvant s’accompagner d’arythmies dites vagales et de<br />
malaises rarement syncopaux. La réduction de l’intensité d’entraînement améliore<br />
très souvent ces symptômes. Une tendance fréquente à l’hypotension orthostatique<br />
peut être un signe de surentraînement. De même une diminution de la tolérance à<br />
l’orthostatisme a été décrite chez des athlètes d’endurance très entraînés. Favorisée<br />
par une prédisposition génétique, elle s’explique par la coexistence Hypertrophie<br />
cardiaque et bradycardie. Lors du passage en position debout, la séquestration<br />
sanguine importante dans les veines des membres inférieurs induit une chute du<br />
volume d’éjection systolique, insuffisamment compensée par la réponse des<br />
barorécepteurs impliqués dans les mécanismes normaux de régulation.<br />
b- Troubles du rythme et de la repolarisation [23]<br />
Leur découverte sur un ECG de repos impose la réalisation d’un ECG<br />
d’effort avec une interprétation cardiologique qui montre généralement leur<br />
normalisation. Au contraire l’ECG d’effort révèle parfois des anomalies chez un<br />
sportif asymptomatique. Des arythmies bénignes, en particulier supraventriculaires<br />
peuvent être observées lors de l’arrêt brutal, temporaire ou définitif de<br />
l’entraînement chez des sportifs de haut niveau. Ces troubles du rythme peuvent être<br />
favorisés par la décharge catécholergique liée à l’effort ou par l’existence de foyers<br />
arythmogènes chroniques (séquelles de myocardites minimes souvent ignorées).<br />
Les troubles de repolarisation majeurs réclament également un avis<br />
cardiologique. Révélés par l’ECG d’effort ils font craindre une pathologie coronaire<br />
‐ 58 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
silencieuse. Celle –ci est en cause dans près de 15% des morts subites du sportif de<br />
moins de 30 ans.<br />
Des troubles du rythme et de la repolarisation de découverte récente ont pu être<br />
rattachés à un surentraînement. Cela doit rester un diagnostic d’élimination.<br />
2- L’échocardiogramme<br />
a- Hypertrophie ventriculaire gauche<br />
Il est question ici de déterminer les arguments échocardiographiques permettant<br />
de faire la distinction entre l’HVG physiologique (traduisant une adaptation<br />
cardiaque chronique à l’exercice physique) et sa composante pathologique chez le<br />
sportif :<br />
‐ L’épaisseur pariétale du ventricule gauche :<br />
Elle est la principale caractéristique qui contribue à distinguer l’HVG<br />
physiologique de l’HVG pathologique. L’entraînement sportif augmente d’une part<br />
l’épaisseur du septum interventriculaire (SIV) et d’autre part celui de la paroi<br />
postérieure (PP). Environ 2% des athlètes de haut niveau ont une épaisseur du SIV<br />
>= 13mm. En effet, ces derniers dont l’épaisseur pariétale est comprise entre 13mm<br />
et 15mm se trouvent dans une zone intermédiaire d’incertitude (« gray zone »), peu<br />
concluante qui peut à la fois traduire l’expression extrême de l’adaptation cardiaque<br />
physiologique de l’athlète (cœur d’athlète) et les formes bénignes d’une HVG<br />
pathologique (retrouvée dans la cardiomyopathie hypertrophique) [56].<br />
Le rapport de l’épaisseur du SIV à l’épaisseur de la PP est dans les limites de la<br />
normale (< 1,3) chez la plupart des athlètes, quoique l’on puisse retrouver une<br />
hypertrophie asymétrique (rapport SIV /PP>1,3) qui ferait initialement suspecter<br />
une HVG pathologique en rapport avec une cardiomyopathie hypertrophique.<br />
Cependant, le diagnostic positif d’une HVG pathologique repose également sur<br />
l’évaluation d’autres paramètres échocardiographiques.<br />
‐ 59 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
L’identification précise d’une HVG nécessite l’évaluation de l’index de masse<br />
ventriculaire gauche qui est obtenu en divisant la masse ventriculaire gauche par la<br />
surface corporelle du sujet. Ainsi, si l’épaisseur du SIV >=13mm, cet index doit être<br />
calculé. Si le résultat est strictement supérieur à 134g/m² chez l’homme et 110g/m²<br />
chez la femme, l’on peut affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une HVG<br />
pathologique traduite par une élévation anormale de l’index de masse ventriculaire<br />
gauche. Également chez le sportif, la surface corporelle doit être prise en<br />
considération dans le diagnostic d’une HVG car les spécialistes des disciplines<br />
anaérobies ont le plus souvent une surface corporelle importante pouvant conclure à<br />
une HVG erronée. Il faut néanmoins noter que cette valeur ne tient pas compte<br />
d’autres facteurs qui influencent la masse ventriculaire gauche à savoir l’âge et la<br />
race.<br />
‐ La taille de la cavité ventriculaire gauche :<br />
Les athlètes d’endurance, lesquels ont une surcharge volumétrique, développent<br />
une dilatation de la cavité du VG. Au repos, les diamètres télésystolique et<br />
télédiastolique du VG sont élevés. Le diamètre télédiastolique est augmenté de 10<br />
%, ce qui aboutit à un accroissement de la masse ventriculaire gauche. Environ 15%<br />
des athlètes de haut niveau ont un diamètre télédiastolique du VG au-delà de la<br />
limite supérieure de 60mm observée chez la plupart des sportifs [56]. C’est dans ce<br />
cas que se pose le problème de diagnostic différentiel entre le cœur d’athlète et la<br />
pathologie cardiaque (notamment la cardiomyopathie dilatée).<br />
Cependant 60 mm ne doit pas être pris comme la valeur absolue qui définit la<br />
limite supérieure normale de la taille cavitaire du VG chez chaque athlète. La limite<br />
supérieure du diamètre télédiastolique du VG est inférieure à 60 mm chez les<br />
sportifs dont la surface corporelle est relativement petite ou participant à des sports<br />
qui ont un effet mineur sur la taille de la cavité ventriculaire gauche. Au contraire<br />
pour les athlètes ayant une large surface corporelle ou pratiquant des sports qui ont<br />
‐ 60 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
un effet majeur sur le diamètre ventriculaire gauche (sports d’endurance), la limite<br />
supérieure de celui-ci est supérieure à 60mm.En somme, il est essentiel de tenir<br />
compte au préalable de la surface corporelle et du type de sport pour fixer la limite<br />
normale du diamètre télédiastolique du VG [57].<br />
‐ La masse ventriculaire gauche :<br />
L’augmentation de la masse ventriculaire gauche avec l’entraînement est le<br />
résultat d’une élévation de l’épaisseur pariétale et /ou du diamètre télédiastolique.<br />
Chez les athlètes de haut niveau cette augmentation atteint la moyenne de 40 à 50 %<br />
comparée à la masse ventriculaire gauche des sujets sédentaires, la limite supérieure<br />
physiologique étant approximativement de 500g.<br />
‐ Les fonctions systolique et diastolique :<br />
L’absence d’une dysfonction systolique ventriculaire gauche est habituellement<br />
suffisante pour affirmer qu’il s’agit d’une dilatation ventriculaire gauche<br />
physiologique induite par l’entraînement sportif .Elle peut être objectivée par une<br />
fraction d’éjection du VG >50 % [33]. La mesure échocardiographique de la<br />
fonction diastolique est primordiale pour faire la différence entre l’HVG<br />
physiologique et l’HVG pathologique. La dysfonction diastolique est absente dans<br />
l’HVG physiologique. Les principaux déterminants de la fonction diastolique sont le<br />
pic de vélocité de l’onde E, le pic de vélocité de l’onde A, le rapport E/A et le flux<br />
veineux pulmonaire. Dans la majorité des pathologies cardiaques, le trouble initial<br />
de remplissage ventriculaire survient dans la phase de relaxation. C’est ainsi que le<br />
temps de relaxation isovolumétrique de même que le temps de décélération de<br />
l’onde E sont prolongés. Si le rapport E/A 240ms et un temps de relaxation isovolumétrique >90ms, il est certain<br />
qu’il s’agit d’une HVG pathologique.<br />
‐ 61 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
‐ L’arrêt de l’entraînement<br />
L’interruption de la pratique sportive aboutit à une régression de l’HVG<br />
physiologique (réduction de l’épaisseur pariétale de 2mm à 5mm) dans les trois<br />
mois qui suivent cette suspension. Tel n’est pas le cas pour l’HVG pathologique.<br />
Si une dilatation ventriculaire gauche pathologique est évoquée, un arrêt de<br />
l’entraînement s’impose. Il faut toutefois savoir qu’une dilatation du VG<br />
physiologique chez un sportif ne s’accompagne pas toujours d’une régression du<br />
diamètre cavitaire à la suspension de l’entraînement et que par conséquent ce critère<br />
est peu fiable [33].<br />
b- Dilatation auriculaire gauche [58]<br />
Les limites supérieures de la taille auriculaire gauche permettent de faire la<br />
différence entre une dilatation de l’oreillette gauche physiologique c’est –à –dire<br />
associée à un entraînement sportif intense et une dilatation auriculaire gauche<br />
associée à une pathologie cardiaque telle que la cardiomyopathie hypertrophique ou<br />
dilatée.<br />
D’après une étude menée par Pellicia et al [58] sur 1777 athlètes de<br />
compétition, seuls 2% (38) avaient une dilatation de l’oreillette gauche marquée >=<br />
45mm pouvant faire évoquer une cardiopathie. Il faut éviter de tirer toute conclusion<br />
sur ce seul critère mais également prendre en considération la surface corporelle et<br />
le type de sport pratiqué comme pour l’HVG. Par ailleurs l’absence de dysfonction<br />
systolique et diastolique associée contribue à éliminer toute cardiopathie.<br />
D) DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS DU CŒUR D’ATHLETE [59]<br />
1- Diagnostics différentiels de l’hypertrophie pariétale du VG<br />
Chez le sédentaire sain, la masse du cœur dépend de l’âge, du sexe et de la<br />
surface corporelle. L’hypertrophie cardiaque est un mécanisme d’adaptation à une<br />
‐ 62 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
contrainte qui peut être physiologique (croissance, grossesse, pratique sportive<br />
intense) ou pathologique (hypertension artérielle, anomalie génétique,…).<br />
Chez un sportif asymptomatique, devant une hypertrophie pariétale supérieure à<br />
13mm, trois principales étiologies doivent être écartées à savoir l’hypertension<br />
artérielle, les valvulopathies et la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) qui<br />
représente un véritable problème diagnostique avec un risque vital important .<br />
La CMH<br />
• Définition et épidémiologie<br />
La CMH, encore appelée cardiomyopathie hypertrophique primitive ou<br />
idiopathique, est une maladie du myocarde caractérisée par une hypertrophie<br />
typiquement asymétrique du ventricule gauche et prédominant sur le septum<br />
interventriculaire(le ventricule droit peut également être affecté). C’est une<br />
pathologie génétique qui répond à un mode de transmission autosomique dominante.<br />
Seuls 55% des sujets porteurs de la mutation (mutation de gènes codant pour les<br />
protéines sarcomériques cardiaques) développeront la maladie avant l’âge de 30 ans.<br />
En Amérique du Nord, la mort subite des sportifs jeunes est due dans 35 à 45%<br />
des cas à la CMH [60].Plusieurs études récentes, notamment prospectives indiquent<br />
une prévalence de la maladie d’environ 1/500 habitants.<br />
• Description anatomo-pathologique<br />
Sur le plan macroscopique, la masse cardiaque est augmentée en raison d’une<br />
hypertrophie myocardique touchant préférentiellement le VG avec une<br />
prédominance sur le septum interventriculaire. L’hypertrophie touche parfois le<br />
ventricule droit. Le volume ventriculaire gauche est normal ou réduit. Les oreillettes<br />
sont souvent dilatées.<br />
‐ 63 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
L’examen histologique du myocarde retrouve une hypertrophie des myocytes, la<br />
présence de fibrose et surtout une désorganisation myocytaire hautement évocatrice<br />
de la maladie.<br />
• Physiopathologie<br />
La fonction diastolique est anormale chez la majorité des patients, avec à la fois une<br />
altération de la relaxation et de la compliance du VG qui est à l’origine d’une<br />
augmentation des pressions en amont. Un gradient de pression intraventriculaire en<br />
systole est retrouvé dans environ 25% des cas. IL est lié à un mouvement systolique<br />
antérieur de la grande valve mitrale (SAM), venant au contact du septum<br />
interventriculaire hypertrophié. La CMH est alors dite obstructive. La fonction<br />
systolique du VG est généralement normale ou supranormale avec une fraction<br />
d’éjection augmentée.<br />
• Examen clinique<br />
A l’interrogatoire, il faut rechercher des antécédents familiaux de CMH et/ou de<br />
mort subite précoce d’étiologie cardiaque.<br />
La découverte de la maladie se fait le plus souvent chez l’enfant ou l’adulte jeune.<br />
Le patient est asymptomatique et dans ce cas la maladie est découverte lors d’un<br />
examen systématique (présence d’un souffle systolique, anomalie de l’ECG). Les<br />
symptômes, très variables et non spécifiques, peuvent être rencontrés. Il s’agit d’une<br />
dyspnée d’effort, de palpitations, de douleur angineuse, de lipothymie (malaise) et<br />
de syncope (perte de connaissance). La survenue d’une syncope au cours ou au<br />
décours d’un effort est évocatrice de la maladie. L’examen physique peut être<br />
normal ou déceler un souffle systolique au foyer pulmonaire (bord gauche du<br />
sternum). Le diagnostic repose sur les résultats de l’ECG et/ou de<br />
l’échocardiographie.<br />
‐ 64 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
• L’ECG<br />
Sur l’ECG, les anomalies les plus fréquentes et suggestives sont :<br />
‐ Une HVG<br />
‐ Des anomalies primaires de la repolarisation avec sous –décalage du segment<br />
ST, ondes T plates ou négatives,<br />
‐ Des ondes Q profondes ou larges (en territoire inférieur ou latéral)<br />
• Diagnostic échocardiographique<br />
L’échocardiographie représente l’outil essentiel du diagnostic de la CMH.<br />
L’examen objective l’hypertrophie ventriculaire et son caractère asymétrique, en<br />
précise le degré et la distribution. Chez l’adulte, l’on confirme une hypertrophie de<br />
la paroi lorsque son épaisseur en télédiastole est > 13mm en présence d’un contexte<br />
familial de CMH ou à partir de 15mm en dehors de tout contexte familial. Dans la<br />
zone d’incertitude (« gray zone ») entre 13 et 15 mm d’épaisseur pariétale<br />
ventriculaire gauche, le diagnostic de CMH doit être systématiquement évoqué chez<br />
le sportif. Le caractère asymétrique de l’hypertrophie est défini par un rapport du<br />
septum interventriculaire sur la paroi postérieure du VG > 1,3 (ou > 1,5). La cavité<br />
ventriculaire gauche est de taille réduite, généralement < 45mm chez la plupart des<br />
patients atteints de CMH.<br />
L’examen doppler permet parfois de retrouver un gradient de pression<br />
systolique intraventriculaire gauche (flux d’éjection accéléré dans la chambre de<br />
chasse). Il peut également permettre de visualiser une oreillette gauche dilatée, une<br />
insuffisance mitrale souvent modérée, des anomalies de fonction diastolique<br />
ventriculaire (inversion du rapport E/A, allongement du temps de relaxation<br />
isovolumétrique)<br />
La pénétrance échographique de la CMH étant incomplète et variable avec le<br />
sexe, le gène ou la mutation en cause, un examen normal ne permet pas d’exclure<br />
‐ 65 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
formellement la maladie. Cette pénétrance augmente chez l’adulte avec l’âge,<br />
suggérant que l’HVG peut apparaître dans certains cas entre 20 et 30 ans<br />
• ECG ambulatoire (Holter)<br />
L’ECG de 24 heures montre une tachycardie ventriculaire.<br />
• Évolution<br />
L’évolution de la maladie est très variable. De nombreux patients restent<br />
asymptomatiques ou peu symptomatiques. Dans d’autres cas les signes fonctionnels<br />
s’aggravent et deviennent invalidants. La gravité de la CMH est représentée par le<br />
risque de mort subite qui survient le plus souvent après un effort physique<br />
important. Le taux de mortalité totale est évalué entre 1 et 2% par an.<br />
• Prise en charge thérapeutique<br />
Les efforts physiques intenses et la pratique de sports de compétition sont<br />
proscrits. Le traitement est médical ou chirurgical. Les principales classes<br />
pharmacologiques utilisées sont les Beta –bloquants (en l’occurrence le propanolol)<br />
et les inhibiteurs calciques (notamment le vérapamil). L’amiodarone quant à elle est<br />
utilisée en cas de fibrillation auriculaire pour obtenir le retour au rythme sinusal, en<br />
association avec un anticoagulant. Le traitement chirurgical consiste à la résection<br />
partielle du septum interventriculaire (myotomie- myectomie). Un remplacement de<br />
la valve mitrale peut être fait en cas d’insuffisance mitrale importante. La myotomie<br />
–myectomie est indiquée en cas de symptômes invalidants, malgré un traitement<br />
médicamenteux bien conduit, chez des patients présentant un gradient<br />
intraventriculaire gauche important >50mmHg.<br />
Deux techniques ont été récemment proposées comme alternative à la chirurgie<br />
myotomie –myectomie. Il s’agit d’une part de l’implantation de pace-maker avec<br />
stimulation double chambre et d’autre part de l’injection intracoronaire d’éthanol<br />
‐ 66 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
(créant un «mini-infarctus » dans une zone ciblée correspondant à l’obstruction).<br />
Au pire des cas l’on a recours à la transplantation cardiaque dans les formes<br />
hypokinétiques de CMH avec insuffisance cardiaque congestive réfractaire.<br />
2- Diagnostics différentiels d’une dilatation du VG chez le sportif<br />
Dans ce cadre, le diagnostic différentiel principal est la cardiomyopathie dilatée<br />
(CMD) qui est la cause de 3% des morts subites survenant lors de la pratique<br />
sportive [56].<br />
a- LA CMD<br />
C’est une affection dont la contractilité ventriculaire est altérée (souvent celle<br />
des deux ventricules) et qui conduit à une insuffisance ventriculaire gauche, puis<br />
droite. Elle atteint deux fois plus d’hommes que de femmes, et est héritée sur le<br />
mode autosomique dominant dans environ 20% des cas. Elle se traduit<br />
habituellement par une défaillance cardiaque inexpliquée. Une douleur thoracique<br />
sporadique est l’un des symptômes les plus fréquents .Des arythmies, des thromboembolies<br />
et la mort subite sont fréquentes. L’ECG montre des modifications non<br />
spécifiques.<br />
L’échocardiographie est l’examen clé qui permet de recueillir tous les<br />
paramètres indispensables à l’évaluation morphologique et hémodynamique<br />
cardiovasculaire. La CMD se caractérise par une dilatation ventriculaire gauche<br />
(définie par un diamètre télédiastolique ventriculaire gauche indexé mesuré en mode<br />
M supérieur à 32mm/m² de surface corporelle associée à une altération de la<br />
contractilité (FE
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
fuite valvulaire significative et d’anomalie des fonctions de remplissage (E
REVUE <strong>DE</strong> LA LITTERATURE<br />
anomalies de conduction et de repolarisation électrocardiographiques, il se pose le<br />
problème de diagnostic différentiel entre le cœur d’athlète et la dysplasie<br />
ventriculaire droite. L’identification de cette pathologie par échocardiographie est<br />
difficile du fait des limites de cette technique d’imagerie dans l’évaluation<br />
morphologique et fonctionnelle du ventricule droit. En revanche, l’imagerie par<br />
résonance magnétique (IRM) est une technique non invasive qui permet de mettre<br />
en évidence la dysfonction ventriculaire droite ou la dilatation cavitaire du<br />
ventricule droit.<br />
‐ 69 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
‐ 70 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
METHODOLOGIE<br />
1- Type d’étude : il s’agit d’une étude descriptive et transversale.<br />
2- Période : de septembre 2008 à Février 2009<br />
3- Lieu de l’étude : Hôpital Général de Yaoundé.<br />
4- Echantillonnage :<br />
Il s’agissait d’un échantillonnage consécutif non probabiliste. Nous n’avons pas<br />
procédé à un calcul de la taille de l’échantillon nécessaire, car la taille nous était<br />
imposée par le nombre de joueurs de l’équipe d’élite.<br />
Critères de sélection<br />
• Critères d’inclusion<br />
a- footballeurs :<br />
Etaient inclus dans notre étude, tous les footballeurs de sexe masculin<br />
sélectionnés pour faire partie de l’équipe nationale d’élite étudiée durant la<br />
période d’étude.<br />
b- Témoins<br />
Etaient également inclus dans notre étude les sujets de sexe masculin<br />
consentants, ne pratiquant pas d’activité sportive ou ayant une activité physique<br />
inférieure ou égale à 2 heures par semaine et appariés par âge, taille et poids<br />
aux footballeurs.<br />
‐ 71 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
• Critères d’exclusion<br />
- Témoins<br />
Les sujets non consentants ou porteurs soit d’une affection cardiovasculaire<br />
soit d’une autre pathologie au terme de leur évaluation clinique ou<br />
échocardiographique étaient exclus de notre étude.<br />
5- Procédure :<br />
Nous avons répertorié vingt trois footballeurs camerounais répondant aux<br />
critères d’inclusion. Ils étaient affiliés à des clubs de football professionnels. Par<br />
ailleurs vingt trois témoins sélectionnés selon les critères ci – dessus ont été<br />
recrutés.<br />
Les sujets étaient soumis à un interrogatoire, un examen physique et une<br />
échocardiographie au repos. Les résultats étaient consignés sur une fiche<br />
technique (voir annexes) préalablement élaborée à cet effet.<br />
Les footballeurs et les témoins étaient programmés par groupes de deux à<br />
cinq personnes pour les séances d’échocardiographie. Une fois introduit dans la<br />
salle d’examen, le patient était installé torse nu sur un lit à une hauteur telle que<br />
l’examinateur assis pouvait pratiquer confortablement l’enregistrement.<br />
L’examen était fait en décubitus latéral gauche. L’examinateur était placé à la<br />
droite du malade, tenant la sonde (préalablement induite d’un gel hydrosoluble)<br />
de sa main droite et réglant l’ajustement de l’échocardiographe de sa main<br />
gauche. Il s’agissait d’un appareil de marque GENERAL ELECTRICS CP710<br />
LOGIQ 500 MD auquel était reliée une sonde de 2,22 Mégahertz placée au<br />
contact de la paroi thoracique (échocardiographie transthoracique).<br />
Les voies d’abord utilisées étaient les voies parasternale gauche et apicale,<br />
le transducteur étant placé entre le 3e et le 5e espace intercostal gauche. Les<br />
trois modes d’exploration, que sont les modes TM, 2D et Doppler, ont été<br />
‐ 72 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
utilisés. Les enregistrements TM étaient effectués après visualisation et repérage<br />
des structures en échographie bidimensionnelle sur une coupe parasternale grand<br />
axe ou petit axe. L’analyse des tracés s’est faite sur trois cycles cardiaques, en<br />
moyennant les valeurs déterminées et en respectant les recommandations de la<br />
société américaine d’échocardiographie [61].<br />
- L’indice de masse corporelle (IMC) était déterminé selon la formule :<br />
IMC (en kg/m²) = Poids / Taille ²<br />
- La surface corporelle SC était calculée selon la formule :<br />
SC = Poids^0.425 × Taille^0.725 ×71.84.<br />
Une SC 2m² était<br />
considérée comme élevée. La valeur d’une SC moyenne était comprise entre<br />
1,8 m² et 2 m² [23].<br />
Les modes TM et 2D ont permis de recueillir les paramètres suivants : OG,<br />
DTVD, SIVd, DTD, PPd , SIVs , DTS, PPs , Ao, VTD, VTS, FE selon la<br />
méthode de Teicholz,<br />
-Le diamètre télédiastolique du ventricule gauche indexé à la surface corporelle<br />
DTDi = DTD/SC (en mm/m²)<br />
Un DTD > 56mm traduisait une dilatation cavitaire du ventricule gauche chez<br />
les sujets dont la surface corporelle était relativement petite [14].<br />
Un DTDi >31mm/m² définissait un ventricule gauche dilaté quelque soit<br />
l’étendue de la surface corporelle [62].<br />
Un DTD >=60mm définissait une dilatation pathologique du ventricule gauche<br />
chez les sujets dont la surface corporelle était peu étendue [56] tandis qu’un<br />
DTDi > 32mm/m² était considéré comme anormalement élevé quelque soit la<br />
valeur de la surface corporelle [62].<br />
- L’épaisseur pariétale relative (EPR) a été définie par le rapport h/r =<br />
(SIVD+PPD/DTD)<br />
‐ 73 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
-L’hypertrophie pariétale était définie par une PPd >11mm et / ou une SIVd ><br />
11mm [14].<br />
Le seuil pathologique de cette hypertrophie était de 13mm [62].<br />
Une Hypertrophie pariétale asymétrique était définie par un rapport SIVd / PPd<br />
supérieure à 1,3 [62].<br />
-La masse ventriculaire gauche (MVG) était déterminée selon la méthode de<br />
Devereux et Reichek :<br />
MVG = 1,04[(DTD+ SIVd+PPd )3 -(DTD)3] -13,6 (en grammes ) et indexée à<br />
la surface corporelle (en g/m²) [54].<br />
L’hypertrophie ventriculaire gauche était définie par un index de masse<br />
ventriculaire gauche (MVG i) > 125g/m² [52]. Une masse ventriculaire gauche<br />
indexée à la surface corporelle > 134 g/m² était considérée comme<br />
anormalement élevée [18].<br />
Une HVG concentrique était définie par une épaisseur pariétale relative >0,44<br />
alors qu’une HVG excentrique par une épaisseur < 0,44 [63].<br />
- La contrainte pariétale systolique était calculée selon deux formules<br />
retrouvées :<br />
STRESS1= [1.332-P×DTS]/ [4h (1+h/DTS)] ou P est la tension systolique et<br />
h= (SIVD+PPD) ²<br />
STRESS2 = (0,334×PAS × DTS) / (PPd × (1+PPd /DTS)) (en dynes / <strong>cm</strong>²).<br />
-La fraction de raccourcissement était calculée selon la formule :<br />
FR = 100× (DTD -DTS)/ DTD.<br />
Le flux mitral était enregistré en plaçant la fenêtre d’échantillonnage juste<br />
devant l’entonnoir mitral.<br />
L’enregistrement au Doppler a permis de déterminer les paramètres suivants :<br />
- le flux transmitral avec E, A, T<strong>DE</strong>, le rapport des vélocités maximales<br />
E/A<br />
‐ 74 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
- le flux veineux pulmonaire avec S, D, le rapport S/D<br />
- le flux aortique avec Vmax aortique, TE,<br />
Parmi tous ces indices, ceux qui ont permis d’évaluer la fonction diastolique du<br />
ventricule gauche étaient : E, A, E/A, S, D, S/D. Les indices impliqués dans la<br />
détermination de la fonction systolique du ventricule gauche étaient FR, FE<br />
Teicholz.<br />
Une FR < 28% et une FE < 50 % signaient la présence d’une dysfonction<br />
systolique.<br />
6- Analyse statistique :<br />
Les données recueillies sur la fiche technique ont été analysées avec les<br />
logiciels Excel 8.0 et épi info version 3.5. Les résultats ont été exprimés en<br />
valeur moyenne et écart-type et étaient présentés sous forme de tableaux et de<br />
figures. La comparaison des moyennes des différents paramètres entre les deux<br />
groupes (footballeurs et témoins) a été effectuée par le test t de Student. Une<br />
valeur de p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative.<br />
7- Matériel d’étude :<br />
a- Matériel de collecte des données<br />
Il s’agit ici d’une fiche technique.<br />
b- Matériel de consultation<br />
- Stéthoscope de marque Rappaport<br />
- Tensiomètre de marque Spengler<br />
- Toise<br />
- Pèse-personne<br />
- Chronomètre<br />
- Stylos et règle<br />
‐ 75 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
METHODOLOGIE<br />
c- Matériel d’exploration échocardiographique<br />
- Echocardiographe de marque GENERAL ELECTRICS CP710 LOGIQ<br />
500 MD.<br />
- Gel de transmission d’ultrasons<br />
- Papier hygiénique<br />
d- Matériel d’analyse des données<br />
- Ordinateur de marque LG 700 E.<br />
8- Considérations éthiques<br />
Tous les patients étudiés ont été préalablement informés sur la quintessence<br />
de notre travail. Puis ont donné leur consentement écrit sur un formulaire prévu<br />
à cet effet (annexes). La réalisation des examens échocardiographiques était<br />
gratuite. Les résultats de l’analyse leur ont été communiqués.<br />
‐ 76 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
‐ 77 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
RESULTATS<br />
Tableau 3 Répartition des footballeurs et témoins par tranche d’âge.<br />
Tranche d’Age footballeurs témoins Pourcentage (%)<br />
20 à 24 ans 7 7 30.4<br />
25 à 30 ans 13 13 56.5<br />
31 à 35 ans 3 3 13.1<br />
Total 23 23 100<br />
Les footballeurs et les témoins sont âgés de 21 à 35 ans avec une moyenne d’âge<br />
de 26 ans. La moitié de ces sujets sont âgés de 21 à 26 ans.<br />
Tableau 4 Quantification de l’entraînement sportif des footballeurs.<br />
Rythme d’entraînement<br />
(heures/semaine)<br />
Ancienneté (années)<br />
Moyenne 11.47 13.52<br />
E.T 2.17 3.46<br />
Minimum 8 6<br />
Maximum 16 20<br />
En moyenne chaque footballeur consacre au moins 8 heures à l’entraînement<br />
par semaine. L’ancienneté dans la pratique du football varie de 6 à 20 ans, avec<br />
une moyenne de 13.5 années.<br />
‐ 78 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
Tableau 5 Caractéristiques anthropométriques et physiologiques des 2<br />
groupes sujets.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs<br />
Témoins<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
p<br />
Age (années)<br />
26.91 3.67 26.91 3.66 (NS)<br />
Poids (kgs) 79.00 5.63 76.47 7.23 (NS)<br />
Taille (<strong>cm</strong>s) 181.21 6.06 180.08 7.23 (NS)<br />
IMC (kg/m²) 24.04 1.08 23.58 1.79 (NS)<br />
SC (m²) 1.99 0.10 1.95 0.12 (NS)<br />
Fc (battements/mn) 58.56 8.18 71.78 13.36
RESULTATS<br />
Tableau 6 Paramètres morphologiques du ventricule gauche chez les 2<br />
groupes sujets.<br />
PARAMETRES<br />
SIVD (mm)<br />
Footballeurs<br />
Témoins<br />
P<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
9.60 1.14 8.57 0.76
RESULTATS<br />
Tableau 7 Paramètres morphologiques du ventricule droit, de l’oreillette<br />
gauche et de la racine de l’aorte chez les footballeurs et les témoins.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs<br />
Témoins<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
P<br />
OG (mm)<br />
38.05 3.65 33.90 3.75
RESULTATS<br />
Tableau 8 Fonction systolique du VG chez les footballeurs et les témoins.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs<br />
Témoins<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
P<br />
FE (%)<br />
58.71 7.17 61.76 7.19 (NS)<br />
STRESS 1 (dynes/<strong>cm</strong>²) 45.79 24.38 55.65 21.58 (NS)<br />
STRESS 2 (dynes/<strong>cm</strong>²) 162.32 31.67 164.39 32.11 (NS)<br />
FR (%) 30.41 2.75 34.17 4.57
RESULTATS<br />
Tableau 9 Fonction diastolique du VG chez les Footballeurs et témoins.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs<br />
Témoins<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
P<br />
E (m/s) 0.70 0.10 0.72 0.13 (NS)<br />
A (m/s) 0.39 0.05 0.50 0.15
RESULTATS<br />
Footballeurs avec dilatation du VG<br />
VGD : ventricule gauche dilaté<br />
VGND : ventricule gauche non dilaté<br />
FIG 1 Footballeurs avec dilatation du VG (DTDi > 31mm)<br />
Un seul de nos sportifs présente une dilatation du ventricule gauche ; soit 4.3%<br />
de notre effectif (avec un DTDi=31.49mm). Par ailleurs aucun ne présente une<br />
dilatation extrême soit DTDi>32mm.<br />
‐ 84 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
Footballeurs avec hypertrophie du ventricule gauche<br />
FIG 2 Footballeurs avec HVG (MVG i) > 125g/m²<br />
11 sportifs soit 47% sont porteurs d’une hypertrophie ventriculaire gauche.<br />
‐ 85 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
Tableau 10 Paramètres anthropométriques et physiologiques des<br />
footballeurs avec et sans HVG.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs sans<br />
Footballeurs avec HVG<br />
HVG<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
P<br />
Age (années) 27.45 3.95 26.41 3.47 (NS)<br />
SC (m²) 1.98 0.10 2.00 0.10 (NS)<br />
IMC (kg/m²) 24.20 1.09 23.90 1.11 (NS)<br />
PAS (mmHg) 122.09 6.44 126.25 12.10 (NS)<br />
PAD (mmHg) 67.00 6.57 67.00 4.39
RESULTATS<br />
Tableau 11 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec et sans<br />
HVG.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs avec HVG<br />
Footballeurs sans HVG<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
P<br />
DTD (mm) 57.04 1.74 56.28 3.47 (NS)<br />
DTDi (mm/m²) 28.82 1.79 28.11 1.84 (NS)<br />
EPR 0.34 0.02 0.30 0.04
RESULTATS<br />
Footballeurs avec HVG extrême.<br />
FIG3 Footballeurs avec hypertrophie extrême du VG (MVGi>134g/m²)<br />
Le tiers des footballeurs ayant participés à l’étude ont une masse du ventricule<br />
gauche indexée supérieure à 134g/m², valeur réputée normale.<br />
‐ 88 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
Tableau 12 Caractéristiques physiologiques des footballeurs avec<br />
hypertrophie extrême du VG (MVGi>134g/m²).<br />
PARAMETRES<br />
Age (années)<br />
Footballeurs avec<br />
MVGi>134g/m²<br />
Footballeurs avec<br />
MVGi
RESULTATS<br />
Tableau 13 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec<br />
hypertrophie extrême du VG (MVGi>134g/m²).<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs avec MVGi<br />
>134g/m²<br />
Footballeurs avec MVGi<br />
RESULTATS<br />
Dilatation et Hypertrophie.<br />
DIL et HYP : dilatation et hypertrophie<br />
SANS DIL et HYP :sans dilatation et hypertrophie<br />
FIG 4 Footballeurs avec dilatation et hypertrophie du ventricule gauche<br />
Un seul des footballeurs étudiés présente simultanément une dilatation et une<br />
hypertrophie du ventricule gauche ; soit 4.3% des sportifs. Par ailleurs aucun des<br />
footballeurs ne présente une dilatation du VG sans HVG.<br />
FIG 5 Footballeurs avec hypertrophie sans dilatation du ventricule gauche<br />
‐ 91 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
43.5% de footballeurs soit 10 sujets présentent une hypertrophie du VG en<br />
absence de dilatation de ce dernier.<br />
Tableau 14 Caractéristiques physiologiques des footballeurs avec<br />
hypertrophie sans dilatation du ventricule gauche.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs avec<br />
hypertrop sans dilatat<br />
Autres footballeurs<br />
P<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
Age (années)<br />
27.50 4.17 26.46 3.33 (NS)<br />
SC (m²) 1.99 0.09 1.99 0.11 (NS)<br />
IMC (kg/m²) 24.09 1.08 24.01 1.13 (NS)<br />
PAS (mmHg) 122.30 6.75 125.76 11.72 (NS)<br />
PAD (mmHg) 66.90 6.91 67.07 4.21 (NS)<br />
Fc (battements/mn) 55.60 7.47 60.84 8.24 (NS)<br />
RA (heures/semaine) 11.20 2.14 11.69 2.25 (NS)<br />
ANCIENNETE (ans) 13.20 2.48 13.76 4.14 (NS)<br />
Les footballeurs avec HVG sans dilatation sont relativement plus âgés, avec une<br />
diminution non significative de leur fréquence cardiaque et de leur Pression<br />
artérielle comparé aux autres footballeurs. Aucune différence notoire n’est<br />
relevée dans leur rythme d’entrainement.<br />
‐ 92 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
RESULTATS<br />
Tableau 15 Paramètres échocardiographiques des footballeurs avec<br />
hypertrophie sans dilatation du ventricule gauche.<br />
PARAMETRES<br />
Footballeurs avec hypertrophie<br />
sans dilatation du ventricule<br />
gauche<br />
Autres footballeurs<br />
P<br />
Moyenne E.T Moyenne E.T<br />
DTD (mm)<br />
56.88<br />
1.76<br />
56.46<br />
3.38<br />
(NS)<br />
DTDi (mm/m²)<br />
28.55<br />
1.64<br />
28.37<br />
2.00<br />
(NS)<br />
MVGi (g/m²)<br />
137.49 10.02 111.94 12.18
RESULTATS<br />
Hypertrophie Pariétale Asymétrique.<br />
HPA :Hypertrophie parietale asymetrique<br />
FIG 6 Footballeurs avec hypertrophie pariétale asymétrique (sivd/ppd>1.3)<br />
Le rapport sivd/ppd est anormalement élevé au dessus de 1.3 chez 17.4%<br />
(4sujets) de footballeurs cependant aucun de ces footballeurs ne présentait une<br />
épaisseur du SIV au dessus de 12mm.<br />
Footballeurs avec sivd/ppd>1.3 et Mvgi>134g/m²<br />
Sivd/ppd + MVGi>134g/m² Fréquence Pourcentage<br />
non 22 95,7%<br />
oui 1 4,3%<br />
Total 23 100,0%<br />
Bien que 4 sportifs ont un rapport Sivd/ppd au dessus de 1.3, on note au vu de ce<br />
tableau qu’un seul présente simultanément une MVGi> à 134g/m². Néanmoins<br />
ce sportif reste avec une épaisseur du SIV< à 13mm ; soit 11mm.<br />
‐ 94 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
‐ 95 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
DISCUSSION<br />
L’adaptation cardiovasculaire chronique à l’exercice musculaire est fonction<br />
du type d’exercice pratiqué, de l’âge, du poids. Cette adaptation cardiovasculaire<br />
chez le footballeur n’a jamais fait l’objet d’une étude au Cameroun d’où<br />
l’intérêt de la présente étude que nous avons menée en soumettant le footballeur<br />
à un bilan échocardiographique dans le but d’évaluer cette adaptation et de<br />
déceler d’éventuelles anomalies cardiaques pouvant entrainer la mort subite.<br />
Vingt trois footballeurs ont pris part à l’étude, ils étaient tous de sexe masculin<br />
et ont été appariés à des sujets témoins en tenant compte de l’âge, le sexe, la<br />
taille et le poids.<br />
CARACTERISTIQUES GENERALES <strong>DE</strong>S GROUPES ETUDIES<br />
Les deux groupes (footballeurs et témoins) étaient comparables car étaient<br />
appariés par l’âge, le sexe, la taille et le poids.<br />
1- AGE<br />
Les footballeurs camerounais avaient un âge moyen de 26 ans ; Manetti P et<br />
al [64] ont étudiés les effets de l’entrainement sur la masse du muscle cardiaque<br />
chez 21 footballeurs professionnels âgés de 24±3.5 ans. OULDZEIN H et al [50]<br />
ont quant à eux réalisé une analyse électrocardiographique et<br />
échocardiographique chez 181 footballeurs professionnels tunisiens qui avaient<br />
un âge de 23.1±3.9 ans. Les footballeurs professionnels ivoiriens qui ont<br />
consenti à participer à l’étude de Siransy E et al [65] étaient eux âgés de<br />
22.8±2.3 ans. Par ailleurs Lahady et al [46] qui se sont intéressés à l’exploration<br />
du cœur du sportif de haut niveau en 1996 à Madagascar, ont suivi 100<br />
footballeurs âgés en moyenne de 25 ans.<br />
Toutes ces études se sont intéressées aux sportifs dont l’âge variait entre 21<br />
et 35 ans ; cette tranche d’âge est également celle de nos sportifs.<br />
‐ 96 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
2- SURFACE CORPORELLE<br />
La surface corporelle des footballeurs de notre étude était de 1.99m². Elle<br />
est très proche de celle retrouvée par Urhausen A et al [49] en Allemagne lors de<br />
son étude sur l’adaptation spécifique du ventricule gauche des footballeurs dont<br />
la surface corporelle moyenne était de 1.97±0.09m².<br />
Les footballeurs camerounais avaient une surface corporelle qui variait<br />
entre 1.89m² et 2.09m² comme la plupart des footballeurs étudiés par Manetti et<br />
al [64], Siransy et al [65], Ouldzein et al [50], Lahady et al [46].<br />
3- FREQUENCE CARDIAQUE<br />
La bradycardie à 58.56 battements par minute, observée chez 60% de nos<br />
sportifs a également été observée lors des travaux de Lahady et al [46]. De<br />
même, les footballeurs nigérians étudiés par Ap Adebola et al [47] à Lagos<br />
présentaient une prévalence significative à la bradycardie comparés aux non<br />
sportifs. De plus dans les travaux de Siransy et al[65] et ceux de Somauroo et<br />
al[66], la bradycardie était observée respectivement dans 29.03% et 39% des<br />
cas. Dans notre étude la fréquence cardiaque des sportifs comme dans les études<br />
précités était significativement plus basse que celle des témoins de 20% en<br />
moyenne.<br />
4- PRESSION ARTERIELLE<br />
La PAD était significativement plus basse chez les footballeurs camerounais<br />
en comparaison aux témoins (p
DISCUSSION<br />
II- MODIFICATIONS ECHOCARDIOGRAPHIQUES<br />
1- Epaisseur pariétale diastolique du ventricule gauche (SIVD et PPD)<br />
L’épaisseur du septum Interventriculaire en diastole (SIVD) et l’épaisseur<br />
pariétale postérieure en diastole (PPD) des footballeurs camerounais étudiés<br />
restaient normales (respectivement 9.60±1.14mm et 8.46±1.10mm). Ces valeurs<br />
étaient cependant significativement plus élevées que celles des témoins. Bennani<br />
et al dans leur étude sur l’évaluation échocardiographique du remodelage<br />
cardiaque des footballeurs de haut niveau au Maroc, ont également retrouvé une<br />
élévation significative de l’épaisseur pariétale soit 10.49±1.04mm contre<br />
7.5±2.04mm chez les témoins. Par contre aucune différence statistique de<br />
l’épaisseur pariétale en diastole entre les deux groupes n’a été retrouvée par Al<br />
Hazzaa et al [48] en Arabie Saoudite, chez qui les valeurs de la PPD indexées à<br />
la surface corporelle étaient 5.5±0.65 mm contre 5.2±0.59mm chez les non<br />
sportifs.<br />
Il reste cependant important de noter qu’aucun de ces auteurs n’a retrouvé<br />
une hypertrophie pariétale (SIVD ou PPD> 11mm), comme ce fut également le<br />
cas dans notre étude. Les différences entre les différentes équipes peuvent<br />
s’expliquer par la morphologie des joueurs et les variations individuelles à<br />
l’adaptation cardiovasculaire.<br />
2- Epaisseur Pariétale Relative<br />
Selon Morganroth et al [26], les athlètes impliqués dans des sports à<br />
composante dynamique élevée, développent davantage une dilatation de la<br />
cavité ventriculaire gauche avec un accroissement proportionnel de l’épaisseur<br />
pariétale causée par une surcharge volumique associée à une élévation du débit<br />
cardiaque secondaire à cette spécificité de l’entraînement. Il s’agit dans ce cas<br />
d’une hypertrophie ventriculaire excentrique caractérisée par une augmentation<br />
de la taille des cavités suivie de celle de l’épaisseur de la paroi afin de maintenir<br />
‐ 98 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
constante la contrainte pariétale (loi de Laplace). Ainsi, le rapport de l’épaisseur<br />
pariétale moyenne (h) au rayon cavitaire (R) demeure constant. Les athlètes<br />
pratiquant des exercices physiques principalement statiques, développent de<br />
manière prédominante une augmentation de l’épaisseur de la paroi ventriculaire<br />
gauche sans modification notable des dimensions cavitaires. Ceci est dû à une<br />
surcharge de pression ou surcharge barométrique associant une pression<br />
artérielle systémique élevée laquelle est présente dans ce type d’exercice. Il<br />
s’agit ici d’une hypertrophie ventriculaire concentrique avec une augmentation<br />
du rapport de l’épaisseur pariétale moyenne au rayon cavitaire. En somme, une<br />
hypertrophie ventriculaire gauche concentrique se définit par un accroissement<br />
de la masse ventriculaire gauche et de l’épaisseur pariétale relative. A l’opposé,<br />
l’hypertrophie ventriculaire gauche excentrique est une augmentation de la<br />
masse ventriculaire gauche avec une épaisseur pariétale relative normale soit<br />
DISCUSSION<br />
Les valeurs moyennes de DTD des footballeurs camerounais étaient<br />
significativement plus élevées que celles des témoins à savoir 56.64±2.75 mm<br />
contre 51.62±3.50mm chez les témoins. Cette différente a également été<br />
retrouvée par Urhaussen et al[49], ouldzein et al[50], Madeira et al[51], Bennani<br />
et al[45] chez qui les valeurs de DTD respectives sont 55.0±3.8mm, 53±4mm,<br />
47.59±3.8mm, 51.7±3.7mm.<br />
La valeur moyenne de DTD indexée à la surface corporelle des footballeurs<br />
camerounais était de 28.45±1.85mm/m². Cette valeur était significativement<br />
supérieure à celle des témoins mais restait largement inférieure à 31mm comme<br />
ce fut le cas dans les études suscitées. Ce fut aussi le cas pour Urhaussen et al en<br />
Allemagne qui retrouvèrent 27.8±1.9mm/m².<br />
65.2% de footballeurs avaient un DTD supérieur à 56mm ce qui à priori<br />
correspond à une dilatation de la cavité ventriculaire gauche. Cependant une fois<br />
indexée à la surface corporelle, seul un sportif avait un DTDi au dessus de<br />
31mm/m². De même 8.7% de footballeurs présentaient un DTD > à 60mm<br />
pourtant en tenant compte des valeurs indexées aucun cas de dilatation extrême<br />
du ventricule gauche n’a été retrouvé. On peut donc en déduire que la dilatation<br />
ventriculaire gauche observée chez ces footballeurs est plus liée à leur surface<br />
corporelle qu’à une adaptation cardiovasculaire inhérente à ce sport.<br />
4- MASSE VENTRICULAIRE GAUCHE<br />
La masse ventriculaire gauche indexée à la surface corporelle était<br />
significativement plus élevée chez nos sportifs que chez les témoins, avec des<br />
valeurs respectives de 123.05± 17.81g/m² contre 89.26±20.21g/m² ; soit une<br />
élévation de 27.64% de la MVGi des sportifs par rapport aux non sportifs. Dans<br />
les travaux d’Al Hazzaa et al en Arabie Saoudite en 2004 la différence observée<br />
entre les deux groupes était également significative avec des valeurs de MVGi<br />
‐ 100 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
de 117±21.2g/m² chez les sportifs contre 89±16.09g/m² pour les témoins.<br />
Tumuklu et al en turkie ont également retrouvé une élévation significative de la<br />
MVGi des sportifs par rapport aux témoins. De plus l’étude Nigériane de AP<br />
Adebola en 2005 confirme cette différence entre la MVGi des sportifs plus<br />
élevée que celle des non sportifs [47].<br />
D’une manière générale la moyenne de la MVGi des footballeurs<br />
camerounais était inférieure à 125g/m². Cependant 47.8% des footballeurs de<br />
notre étude avait une MVGi au dessus de 125g/m². Leur fonction diastolique et<br />
systolique étaient normales. Cette HVG était excentrique chez tous les sportifs<br />
avec un EPR inférieur à 0.44. Dans les travaux d’Ouldzein et al 23.20% des<br />
footballeurs présentaient une ''HVG'' qui était excentrique à 100% avec un EPR<br />
de 0.380.<br />
30.4% des footballeurs présentaient une élévation extrême de la MVGi au<br />
dessus de 134g/m² ; aucune dysfonction diastolique, ni systolique, ni une atteinte<br />
valvulaire n’a été notée chez ces sportifs. Leur PAS et leur contrainte pariétale<br />
étaient légèrement plus élevées que celles des autres footballeurs, mais<br />
demeuraient dans les limites valeurs normales.<br />
Il est à noter à ce niveau que bien que quatre soit 17.4% des footballeurs<br />
présentaient un rapport SIVD/PPD anormalement élevé au dessus de 1.3, un seul<br />
de ces sportifs avait simultanément une MVGi > à 134g/m² et présentait<br />
cependant une épaisseur du septum interventriculaire en dessous de 13mm. Tout<br />
ceci exclu donc une élévation pathologique de la MVG, telle que dans les<br />
cardiomyopathies primitives.<br />
Au total l’élévation de la MVG des footballeurs camerounais reflétait juste<br />
l’adaptation cardiovasculaire à ce type d’exercice avec forte consonance<br />
dynamique .<br />
‐ 101 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
III- LES FONCTIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE DU VENTRICULE<br />
GAUCHE<br />
1- FONCTION SYSTOLIQUE<br />
Généralement la fonction systolique du ventricule gauche de l’athlète<br />
évaluée par échocardiographie peut être normale, modérément augmentée ou<br />
diminuée. La fonction diastolique, évaluée par échocardiographie Doppler peut<br />
être normale ou légèrement altérée [54].<br />
Dans notre étude la fonction systolique a été évaluée par la fraction<br />
d’éjection ventriculaire gauche (FE) selon la méthode de Teicholz et la fraction<br />
de raccourcissement(FR).<br />
La FE ne présentait aucune différence significative avec celle des non<br />
sportifs et était supérieur à 50%. Cette trouvaille est similaire à celle de Bennani<br />
et al en 2006. Aussi Stefani et al en Italie [55], dans leur étude chez 25<br />
footballeurs d’élite n’ont retrouvé aucune différence statistiquement<br />
significative entre la fraction d’éjection des sportifs (58% ± 2) et celle des<br />
témoins (57% ± 4).<br />
La FR était diminuée chez les sportifs mais restait dans la limite de la<br />
normale.<br />
2- FONCTION DIASTOLIQUE<br />
L’étude de l’enveloppe de vélocité mitrale par le Doppler pulsé est une<br />
méthode non invasive permettant l’évaluation des paramètres de la relaxation et<br />
de la fonction diastolique du ventricule gauche. Le remplissage ventriculaire est<br />
déterminé par l’interaction de nombreux facteurs : vitesse et durée de la<br />
relaxation ventriculaire, compliance passive ventriculaire gauche, pression de<br />
remplissage ventriculaire gauche, conditions de charge et fréquence cardiaque.<br />
‐ 102 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
La vélocité transmitrale est une fonction du remplissage ventriculaire et donc de<br />
la différence de pression relative entre oreillette et ventricule gauches [54]<br />
Dans notre étude E et A étaient normales dans les deux groupes. La valeur<br />
de E n’était pas différente statistiquement entre les footballeurs et les témoins.<br />
Tandis que la vélocité de l’onde A était significativement plus basse que celle<br />
des non sportifs.<br />
Le rapport E/A bien significativement élevé chez les sportifs restait dans la<br />
limite de la normale ; et était proche des valeurs retrouvées par Tumuklu et al<br />
[53] chez qui ce rapport était de 1.96±0.41 contre 1.66±0.23. Il convient de noter<br />
que la diminution de l’onde A est responsable de l’augmentation de E/A et est<br />
probablement en rapport avec la baisse de la FC qui prolongerait la durée du<br />
remplissage ventriculaire et réduirait la contribution auriculaire à ce<br />
remplissage. L’allongement de la diastole favoriserait un remplissage<br />
ventriculaire plus efficace avant la systole auriculaire. Cette dernière<br />
composante constituerait alors une réserve disponible en cas d’exercice afin de<br />
maintenir ou d’accroître le volume d’éjection systolique [54].<br />
IV-MORPHOLOGIE <strong>DE</strong>S VD, OG, AORTE.<br />
Nous avons noté dans notre étude une augmentation significative du<br />
diamètre de l’OG et de la surface de l’OG chez les sportifs par rapport aux non<br />
sportifs.AL Hazzaa et al a également mis en évidence cette augmentation<br />
significative du diamètre indexé à la SC de l’OG avec des valeurs respectives de<br />
16.7±1.6mm/m² chez les sportifs contre 14.9±2.2mm/m² chez les témoins.<br />
Bennani et al quant à eux ont trouvés une augmentation significative de la SOG<br />
chez les 24 joueurs de son étude (20.16±2.03<strong>cm</strong>² contre 16.16±1.83<strong>cm</strong>²)<br />
Par ailleurs le DTDVD des sportifs étudiés par Bennani et al était<br />
significativement plus élevé que chez les non sportifs ; dans notre étude des<br />
‐ 103 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
DISCUSSION<br />
résultats similaires ont été retrouvés avec des valeurs de 24.85±4.70mm contre<br />
21.10±3.91mm. Pour Al Hazzaa et al et Bennani et al cette augmentation des<br />
cavités gauche et même droite sont le résultat d’une adaptation physiologique du<br />
fait du caractère dynamique du football. La conclusion similaire a été celle de<br />
notre étude.<br />
‐ 104 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS<br />
‐ 105 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS<br />
CONCLUSION<br />
‣ L’épaisseur en diastole du septum interventriculaire et de la paroi<br />
postérieure du ventricule gauche, bien qu’élevée, n’a jamais été<br />
supérieure à 11mm chez nos sportifs comme ce fut le cas dans les<br />
différentes études citées. Donc généralement, chez le footballeur on ne<br />
retrouve pas d’hypertrophie pariétale.<br />
‣ Nos footballeurs semblaient présenter des DTD élevés, mais une fois<br />
indexés à la surface corporelle aucun n’avait une dilatation extrême du<br />
ventricule gauche. Comme dans les autres études, on peut donc conclure<br />
que, la ''dilatation'' observée chez les footballeurs est liée à leur surface<br />
corporelle mais aussi à une adaptation cardiovasculaire inhérente à ce<br />
sport.<br />
‣ 47.8% des footballeurs de notre étude avaient une MVGi au dessus de<br />
125g/m² ; et 30.4% des footballeurs présentaient une élévation extrême de<br />
la MVGi au dessus de 134g/m², cependant aucune dysfonction systolique<br />
ou diastolique n’était associée à cette élévation de la masse ventriculaire<br />
gauche. Cette augmentation de la masse ventriculaire des footballeurs<br />
camerounais refléterait l’adaptation cardiovasculaire à ce type d’exercice<br />
et non des états pathologiques.<br />
‣ La fonction systolique et diastolique du footballeur camerounais était<br />
préservée, on a juste noté une élévation du rapport E/A qui pourrait<br />
s’expliquer par la baisse de la FC qui prolongerait la durée du remplissage<br />
ventriculaire et réduirait la contribution auriculaire à ce remplissage afin<br />
de maintenir ou d’accroître le volume d’éjection systolique.<br />
Le footballeur camerounais qui est soumis à une activité physique à<br />
composante dynamique forte, présente une adaptation similaire à celle des autres<br />
‐ 106 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS<br />
footballeurs africains et caucasiens chez qui ''hypertrophie ventriculaire gauche"<br />
est le fait majeur, restant néanmoins en dessous des valeurs pathologiques.<br />
RECOMMANDATIONS<br />
Nous formulons les recommandations suivantes :<br />
- aux footballeurs professionnels, amateurs et toute personne désireuse de<br />
pratiquer ce sport, de faire un bilan médical incluant un suivi<br />
cardiovasculaire ;<br />
- à la FMSB de réfléchir à la mise sur pied d’une unité de formation en<br />
médecine de sport ; compte tenu de la demande de plus en plus grande<br />
dans ce domaine.<br />
- au ministère des sports et de l’éducation physique de travailler en<br />
collaboration avec le ministère de la santé publique pour mettre sur pied<br />
un programme permettant la réalisation systématique et régulière d’un<br />
bilan cardiovasculaire chez les sportifs camerounais très entraînés.<br />
‐ 107 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
‐ 108 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1- Carré F. Adaptations cardio-vasculaires à l’exercice musculaire :<br />
L’observatoire du mouvement, N° 17 2006 : 1-4.<br />
2- Cousteau JP. Coeur et sport. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et<br />
Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés), Cardiologie, 11-052-C-10 2002,<br />
16 p<br />
3- Maron BJ. Structural features of the athlete’s heart as defined by<br />
echocardiography. J Am Coll Cardiol 1986; 7: 190-203.<br />
4- Bryan G, Ward A, Rippe JM. Athletic heart syndrome. Clin Sports Med 1992;<br />
11: 259-72.<br />
5- 26th Bethesda conference. Recommandations for determining eligibility for<br />
competition in athletes with cardiovascular abnormalities. Med Sci Sports Exerc<br />
1994; 26<br />
6- Pluim BM, Zwinderman AH, van der Laarse A, van der Wall ES. The<br />
athlete’s heart: a meta –analysis of cardiac structure and function. Circulation<br />
2000; 101: p 336-44.<br />
7- Fagard R. Athlete’s heart. Heart 2003; 89: 1455-1461]<br />
8- Maron BJ. Sudden death in young athletes .N Engl J Med 2003; 349: 1064-75<br />
9- Maron BJ, Douglas P, Graham T, Nishimura R, Thompson P.Preparticipation<br />
screening and diagnosis of cardiovascular disease in athletes. J Am Coll Cardiol<br />
2005; 45: 1322-1326.<br />
10- Fritsch H, Kühnel W. Atlas de poche d’anatomie. Flammarion Médecine-<br />
Sciences 2003; 3e édition: pp 10 -32.<br />
‐ 109 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
11- Cabrol C., Vialle R., Guérin-Surville H. : Anatomie du coeur humain 2002 -<br />
2003). 259-72,<br />
12- Thierry VERSON: Anatomo-physiologie. chapitres 5, 31- 44<br />
13- Guyton A. Textbook of medical physiology. WB Saunders Company 1991;<br />
8e édition: chapitres 9, 18, 20,21, 84<br />
14- Thomas D, Klimczak C. Cardiologie. Ed. Marketing / Ellipses 1994. ISBN-<br />
2-7298-9457-8: pp77-97.<br />
15- Laurenceau JL, Malergue MC. L’essentiel sur l’échocardiographie.<br />
Collection Tardieu 1990 ; pp11-35.<br />
16- Katz AM. Physiology of the heart.2 nd edition Raven Press, New York, 1992,<br />
400.<br />
17- Chen C, Rodriguez L, Lethor JP et al.Continuous wave Doppler<br />
echocardiography for non invasive assessment of left ventricular dP/dt and<br />
relaxation time constant from mitral regurgitant spectra in patients. J Am Coll<br />
Cardiol 1994; 23: 970-76.<br />
18- Hildick- Smith DJ, Shapiro LM. Echocardiographic differentiation of<br />
pathological and physiological left ventricular hypertrophy. Heart 2001; 85:<br />
615-19.<br />
19- Cohen GI, Pietrolungo JF, Thomas JD, Klein AL. A practical guide to<br />
assessment of ventricular diastolic function using Doppler echocardiography. J<br />
Am Coll Cardiol 1996; 27: 1753-60.<br />
20- Appleton CP. Relation of transmitral flow velocity patterns to left<br />
ventricular diastolic function : new insights from a combined haemodynamic<br />
and Doppler echocardiographic study. J Am Coll Cardiol 1988; 12: 426-40.<br />
‐ 110 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
21- Yamamoto K, Nishimura RA, Burnett JC et al. Assessment of left<br />
ventricular end –diastolic pressure by Doppler echocardiography : contribution<br />
of pulmonary venous versus mitral flow velocity curves at atrial contraction . J<br />
Am Soc Echocardiogr 1997; 10: 52-59.<br />
22- Maron BJ, Mitten MJ, Quandt EF. Competitive athletes with cardiovascular<br />
disease. The case of Nicholas Knapp. N Engl J Med 1998; 339: p1632-635<br />
23- Carré F. Les adaptations cardiovasculaires à l’exercice musculaire. 2e<br />
partie : les adaptations chroniques induites par l’exercice physique. Médecins du<br />
sport 2000 ; n° 35 :pp13-22.<br />
24- Lips DJ, deWindt LJ, van Kraaij DJW, Doevendans PA. Molecular<br />
determinants of myocardial hypertrophy and failure: alternative pathways for<br />
beneficial and maladaptive hypertrophy. Eur Heart J 2003; 24: 883-96.<br />
25- Estes NA 3rd, Link MS, Cannom D et al. Expert consensus conference on<br />
arrhythmias in the athlete of the North American Society of Pacing and<br />
Electrophysiology. Report of the NASPE policy conference on arrhythmias and<br />
the athlete. J Cardiovasc Electrophysiol. 2001; 12: 1208-19<br />
26- Morganroth J, Maron BJ, Henry WL, Epstein SE. Comparative left<br />
ventricular dimensions in trained athletes. Ann Intern Med 1975; 82: 521-24.<br />
27- Pluim BM, Zwinderman AH, van der Laarse A, van der Wall ES. The<br />
athlete’s heart: a Meta-analysis of cardiac structure and function. Circulation<br />
2000; 101: 336-44<br />
28- Bertrand Ed, Frances Y, Lafaly V. Le cœur du sportif. Médecine d’Afrique<br />
Noire 1990; 37 :p 630-33<br />
‐ 111 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
29- Arnaud P, Brohet C. Les hypertrophies ventriculaires, in : Diagnostic<br />
électrovectocardiographique, Nauwelaerts - Maloine, Beauvechain-Paris, pp.59-<br />
71, 1995<br />
30- Ghorayeb N, Batlouni M. Left ventricular hypertrophy of athletes.<br />
Adaptative physiologic response of the heart. Arq Bras Cardiol 2005; 85(3).<br />
31- Lichtman J, O’Rourke KA, Klein A. Electrocardiogram of the athlete.<br />
Alterations simulating those of organic heart disease. Arch Intern Med 1973;<br />
132: p763-70<br />
32- Pellicia A, Maron BJ, Culasso F. Clinical significance of abnormal<br />
electrocardiographic patterns in trained athletes. Circulation 2000; 102: p278-84<br />
33- Serra-Grima R, Estorch M, Carrio I. Marked ventricular repolarization<br />
abnormalities in highly trained athlete’s electrocardiograms: clinical and<br />
prognostic implications. J AmColl Cardiol 2000; 36: p1310-316<br />
34- Nishimura T, Kambara H, Chen CH. Noninvasive assessment of T wave<br />
abnormalities in precordial electrocardiograms in middle-aged professional<br />
bicyclists. J Electrocardiol 1981; 14: p357-64<br />
35- Zepilli P, Pirrami MM, Sassara M, Fenici R. Ventricular repolarization<br />
disturbances in athletes: standardization of terminology, etiopathogenetic<br />
spectrum and pathophysiological mechanisms. J Sports Med Phys Fitness 1981;<br />
21: p322-35<br />
36- Fagard RH. Athlete’s heart: a meta-analysis of the echocardiographic<br />
experience. Int J Sports Med 1996; 17: 140-44.<br />
‐ 112 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
37- Fagard RH, Aubert A, Staessen J, Van Den Eyden E, Vanhees L, Amery A.<br />
Cardiac structure and function in cyclists and runners : comparative<br />
echocardiographic study. Br Heart J 1984; 52: 124-9<br />
38- Whyte GP, George K, Sharma S, Firoozi S, Stephens N , Senior R, Mc<br />
Kenna WJ. The upper limit of physiological cardiac hypertrophy in elite male<br />
and female athletes: the British experience. Eur J Appl Physiol 2004; 92: 592-7.<br />
39- Pelliccia A, Maron BJ, Culasso F et al. Athlete’s heart in women .<br />
Echocardiographic characterization of highly trained elite female athletes .<br />
JAMA 1996; 276: 211- 5.<br />
40- Sharma S. Athlete’s heart-effect of age, sex, ethnicity and sporting<br />
discipline. Exp Physiol 2003 ; 88: 665- 9.<br />
41- Pellicia A., Maron B., Spataro A. et al. The upper limit of physiologic<br />
cardiac hypertrophy in highly trained elite athletes. JAMA 1996; 194: 363- 9.<br />
42- Sharma S, Maron BJ, Whyte G et al. Physiologic limits of left ventricular<br />
hypertrophy in elite junior athletes: relevance to differential diagnosis of<br />
athlete’s heart and hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2002; 40:<br />
1431-6.<br />
43- Pelliccia A, Culasso F, Di Paolo FM et al. Physiologic left ventricular cavity<br />
dilatation in elite athletes. Ann Intern Med 1999; 130: 23-31.<br />
44- Abergel E, Chatellier G, Hagege A, Oblak A, Linhart A. Serial left<br />
ventricular adaptations in world –class professional cyclists . J Am Coll Cardiol<br />
2004; 44: 144-149.<br />
‐ 113 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
45- Bennani M.;Carre F. ; Arsi M. ; Bennis A. Évaluation échocardiographique<br />
du remodelage cardiaque chez le footballeur de haut niveau. Archive des<br />
maladies du cœur et des vaisseaux 2006, vol. 99, no 11 (205 p.) pp. 964-968.<br />
46- Lahady R, Derason G, Andrianjafimanana CH, Ranaivo M., Michel F.,<br />
Ratsivalaka R. Exploration du cœur de sportif de haut niveau. Médecine<br />
d'Afrique Noire : 2000, 47 (6)<br />
47- Adebola AP. Electrocardiographic And Echocardiographic Findings Of<br />
Nigerian Athletes. Nigerian Medical Practitioner Vol. 48 (1) 2005: 3 - 9<br />
48- Al-Hazzaa Hm, Chukwuemeka Ac . Echocardiographic dimensions and<br />
maximal oxygen uptake in elite soccer players. J Am Soc Echocardiogr. 2004<br />
Mar; 17(3):205-11<br />
49- Urhausen A, Monz T, Kindermann W. Sports-specific adaptation of left<br />
ventricular muscle mass in athlete's heart. Echocardiography. 2007<br />
Feb;24(2):140-8.<br />
50- Ouldzein H., Azzouzi F., Ayadi-Koubaa D., Bartagi Z. , R. Cherradi,<br />
R. Mechmeche. Analyse de l'électrocardiogramme et de l'échocardiographie de<br />
181 footballeurs professionnels tunisiens. Science & sports 2007, vol. 22, no2,<br />
pp. 78-86<br />
51- Madeira R, Trabulo M, Alves F, Pereira J. Effects of chronic exercise<br />
training on left ventricular dimensions and function in young athletes. Rev Port<br />
Cardiol. 2008 Jul-Aug;27(7-8):909-22.<br />
52- De Simone G,Daniels SR, Devereux RB. Left ventricular mass and body<br />
size in normotensive children and adults : assessment of allometric relations and<br />
impact of overweight. J Am Coll Cardiol 1992; 20:1251-60.<br />
‐ 114 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
53-Tumuklu M, Ildizli M, Ceyhan K, Cinar C. Alterations in left ventricular<br />
structure and diastolic function in professional football players.<br />
Echocardiography. 2007 Feb;24(2):140-8.<br />
54- Cohen A, Diebold B, Raffoul H, et al .Evaluation par echocardiographie<br />
doppler des fonctions systolique et diastolique du ventricule gauche du cœur<br />
d’athlète. Arch Mal Cœur 1989 ; 82(Џ) : 55-62.<br />
55- Stefani L, Toncelli L, Di Tante V, Vono MC, Cappelli B, Pedrizzetti G,<br />
Galanti G. Supernormal functional reserve of apical segments in elite soccer<br />
players. Cardiovasc Ultrasound. 2008 Apr 16; 6:14.<br />
56- Maron BJ. Sudden death in young athletes .N Engl J Med 2003; 349: 1064-<br />
75<br />
57- Pelliccia A, Culasso F, Di Paolo F et al. Physiologic left ventricular cavity<br />
dilatation in elite athletes. Ann Intern Med 1999; 130: 23-31.<br />
58- Pelliccia A, Maron BJ, Biffi A et al. Prevalence and clinical significance of<br />
left atrial remodeling in competitive athletes. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 690-<br />
696<br />
59- Maron BJ, Pelliccia A , Spirito P. Cardiac disease in young trained athletes<br />
. Circulation 1995; 91: 1596-601.<br />
60- Casale PN., Devereux RB., Alonso DR. et al. Improved sex-specific criteria<br />
of left ventricular hypertrophy for clinical and computer interpretation of<br />
electrocardiograms : validation with autopsy findings, in : Circulation 75, 565-<br />
572, 1987.<br />
‐ 115 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
BIBLIOGRAPHIE<br />
61- Sahn DJ, DeMaria AN, Kisslo J, Weyman AE. The committee on M –mode<br />
standardization of the American Society of Echocardiography.<br />
Recommendations regarding quantitation in M- mode echocardiography: results<br />
of a survey of echocardiographic measurements. Circulation1978; 58:1072-83<br />
62- Cohen A, Abergel E, Blanchard B, Chauvel C. Recommandations de la<br />
société française de cardiologie concernant les indications de<br />
l’échocardiographie doppler. Arch Mal Cœur 2003 ; 96 :223-263.<br />
63- Guidelines committee 2003 ESH-ESC guidelines for management of<br />
essential hypertension. J Hypertens 2003; 21: 1011-53.<br />
64- Manetti P, Toncelli L, Vono Mc, Capalbo A, Boddi V, Rostagno C, Galanti<br />
G. The effects of training on skeletal and cardiac muscle mass in professional<br />
soccer players. Echocardiography. 2007 apr; 23(2):152-8.<br />
65- Siransy E, Coulibaly I, Brou M, Boka B, Ouattara S, Dah C, Bogui P.<br />
Comparaison des aspects électrocardiographiques des footballeurs<br />
professionnels et des sédentaires africains mélanodermes.<br />
66- J Somauroo, J Pyatt, M Jackson, R Perry, and D Ramsdale . An<br />
echocardiographic assessment of cardiac morphology and common ECG<br />
findings in teenage professional soccer players: reference ranges for use in<br />
screening. The Cardiothoracic Centre 2002; 56-70.<br />
67- Hoogsteen J,Hoogeveen A,Schaffers H, Wijn PFF, van der Wall EE. Left<br />
atrial and ventricular dimensions in highly trained cyclists. The International<br />
journal of Cardiovascular Imaging 2003; 19:211-217.<br />
‐ 116 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
‐ 117 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
REPUBLIQUE DU CAMEROUN<br />
MINISTERE <strong>DE</strong> LA SANTE PUBLIQUE<br />
HOPITAL GENERAL <strong>DE</strong> YAOUN<strong>DE</strong><br />
SERVICE <strong>DE</strong> ME<strong>DE</strong>CINE INTERNE<br />
Projet de Thèse de Doctorat d’Etat en Médecine<br />
Mené par BIBOU ZE CLOTAIRE, étudiant en septième année de médecine<br />
supervisé par Professeur KINGUE Samuel et Professeur NDOBO Pierre et dirigé<br />
par Pr ATCHOU Guillaume et Dr MENANGA Alain.<br />
Formulaire de consentement éclairé<br />
Le but de ce travail est d’étudier l’adaptation à l’effort du cœur du footballeur<br />
camerounais et de déceler d’éventuelles maladies cardiaques. Pour cela, il sera soumis<br />
à un examen échocardiographique lequel est non invasif.<br />
L’échocardiographie sera réalisée chez le patient en position couchée, torse nu. Il<br />
consistera à poser une sonde enduite d’un gel sur la paroi thoracique et à visualiser sur<br />
un écran les structures cardiaques en mouvement. Il s’étendra sur 30 minutes environ.<br />
Il est important de souligner que le sujet ne déboursera aucune somme d’argent pour<br />
bénéficier de ce bilan cardiovasculaire et que les résultats de l’analyse lui seront<br />
communiqués.<br />
Je soussigné M.……………………………………………………….<br />
Reconnais avoir lu et reçu des explications sur les termes de ce travail scientifique ; je<br />
donne ici mon consentement éclairé, libre et volontaire pour y participer.<br />
Fait à Yaoundé le………………….<br />
Le Superviseur L’investigateur Le participant<br />
‐ 117 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
FICHE TECHNIQUE<br />
I. Identification<br />
Numéro :<br />
Age :<br />
Sexe :<br />
Profession :<br />
Activité sportive : Oui<br />
Non<br />
Si oui laquelle ?<br />
Footballeur : Oui<br />
Non<br />
Si oui,<br />
Club :<br />
Ancienneté : Rythme d’entraînement (nombre d’heures /semaine) :<br />
Durée moyenne d’un entraînement :<br />
heures<br />
Nombre de compétitions :<br />
Détails : année<br />
| lieu<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
5)<br />
Autre activité sportive : Oui<br />
Non<br />
‐ 118 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
Si oui laquelle ?<br />
Rythme d’entraînement :<br />
heures/semaine<br />
II. Antécédents<br />
A. Personnels<br />
1. Médicaux<br />
Avez-vous été malade ces dernières années ? Oui<br />
Non<br />
Si oui préciser :<br />
Avez-vous déjà eu à subir une visite médicale ? Oui<br />
Non<br />
Si oui, date :<br />
Trouvailles :<br />
2. Médicamenteux<br />
Etes-vous actuellement sous un traitement quelconque ? Oui<br />
Non<br />
Si oui préciser : Nature :<br />
Durée :<br />
3. Toxicologiques<br />
Alcool : Oui<br />
Non<br />
Si oui<br />
Nature<br />
Durée<br />
Tabac : Oui Non<br />
Durée<br />
Si oui Nature :<br />
‐ 119 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
Café : Oui Non<br />
Si oui<br />
Durée<br />
B. Familiaux<br />
Existe-t-il une tare familiale quelconque ? Oui<br />
Non<br />
Si oui préciser :<br />
III. Enquête systémique<br />
Ressentez-vous actuellement une gêne physique quelconque ? Oui<br />
Non<br />
Si oui préciser :<br />
IV. Examen physique<br />
Poids : kg ; Taille : <strong>cm</strong><br />
Surface corporelle : m² Pouls :<br />
Tension artérielle : bras droit bras gauche<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Présence d’anomalies cliniques : Oui Non<br />
Si oui préciser<br />
‐ 120 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
V. Echocardiogramme<br />
Poids : Kg Taille : <strong>cm</strong><br />
Surface corporelle : m² Fréquence cardiaque : battements par<br />
minute<br />
VENTRICULE GAUCHE<br />
SIVd(mm)<br />
PPd (mm)<br />
DTD mm)<br />
SIVs(mm)<br />
PPs (mm)<br />
DTS(mm)<br />
VTS(ml)<br />
VTD(ml)<br />
FE Teicholz(%)<br />
FE Simpson(%)<br />
OREILLETTE GAUCHE<br />
OG (mm)<br />
SOG (<strong>cm</strong>²)<br />
‐ 121 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
VENTRICULE DROIT<br />
DTDVD (mm)<br />
OREILLETTE DROITE<br />
OD (mm)<br />
SOD (<strong>cm</strong>²)<br />
VALVE MITRALE<br />
E (m/s)<br />
A (m/s)<br />
T<strong>DE</strong> (ms)<br />
Am (ms)<br />
VALVE AORTIQUE<br />
Ao (mm)<br />
Vmax Ao (m/s)<br />
‐ 122 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire
ANNEXES<br />
VEINES PULMONAIRES<br />
S (m/s)<br />
D (m/s)<br />
AP (ms)<br />
‐ 123 ‐<br />
ETU<strong>DE</strong> ECHOCARDIOGRAPHIQUE D’UN GROUPE <strong>DE</strong> FOOTBALLEURS D’ELITE CAMEROUNAIS.<br />
Bibou Zé Clotaire