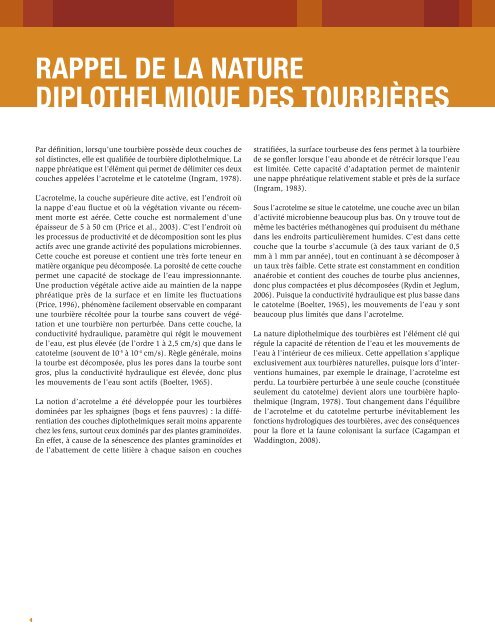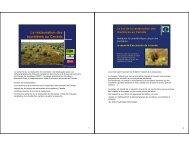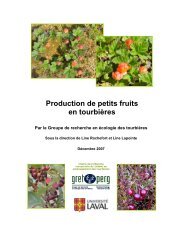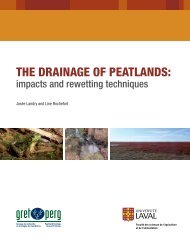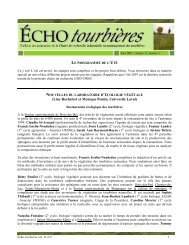le drainage des tourbières - Peatland Ecology Research Group
le drainage des tourbières - Peatland Ecology Research Group
le drainage des tourbières - Peatland Ecology Research Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RAPPEL DE LA NATURE<br />
DIPLOTHELMIQUE DES TOURBIÈRES<br />
Par définition, lorsqu’une tourbière possède deux couches de<br />
sol distinctes, el<strong>le</strong> est qualifiée de tourbière diplothelmique. La<br />
nappe phréatique est l’élément qui permet de délimiter ces deux<br />
couches appelées l’acrotelme et <strong>le</strong> catotelme (Ingram, 1978).<br />
L’acrotelme, la couche supérieure dite active, est l’endroit où<br />
la nappe d’eau fluctue et où la végétation vivante ou récemment<br />
morte est aérée. Cette couche est norma<strong>le</strong>ment d’une<br />
épaisseur de 5 à 50 cm (Price et al., 2003). C’est l’endroit où<br />
<strong>le</strong>s processus de productivité et de décomposition sont <strong>le</strong>s plus<br />
actifs avec une grande activité <strong>des</strong> populations microbiennes.<br />
Cette couche est poreuse et contient une très forte teneur en<br />
matière organique peu décomposée. La porosité de cette couche<br />
permet une capacité de stockage de l’eau impressionnante.<br />
Une production végéta<strong>le</strong> active aide au maintien de la nappe<br />
phréatique près de la surface et en limite <strong>le</strong>s fluctuations<br />
(Price, 1996), phénomène faci<strong>le</strong>ment observab<strong>le</strong> en comparant<br />
une tourbière récoltée pour la tourbe sans couvert de végétation<br />
et une tourbière non perturbée. Dans cette couche, la<br />
conductivité hydraulique, paramètre qui régit <strong>le</strong> mouvement<br />
de l’eau, est plus é<strong>le</strong>vée (de l’ordre 1 à 2,5 cm/s) que dans <strong>le</strong><br />
catotelme (souvent de 10 -5 à 10 -4 cm/s). Règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, moins<br />
la tourbe est décomposée, plus <strong>le</strong>s pores dans la tourbe sont<br />
gros, plus la conductivité hydraulique est é<strong>le</strong>vée, donc plus<br />
<strong>le</strong>s mouvements de l’eau sont actifs (Boelter, 1965).<br />
La notion d’acrotelme a été développée pour <strong>le</strong>s tourbières<br />
dominées par <strong>le</strong>s sphaignes (bogs et fens pauvres) : la différentiation<br />
<strong>des</strong> couches diplothelmiques serait moins apparente<br />
chez <strong>le</strong>s fens, surtout ceux dominés par <strong>des</strong> plantes graminoï<strong>des</strong>.<br />
En effet, à cause de la sénescence <strong>des</strong> plantes graminoï<strong>des</strong> et<br />
de l’abattement de cette litière à chaque saison en couches<br />
stratifiées, la surface tourbeuse <strong>des</strong> fens permet à la tourbière<br />
de se gonf<strong>le</strong>r lorsque l’eau abonde et de rétrécir lorsque l’eau<br />
est limitée. Cette capacité d’adaptation permet de maintenir<br />
une nappe phréatique relativement stab<strong>le</strong> et près de la surface<br />
(Ingram, 1983).<br />
Sous l’acrotelme se situe <strong>le</strong> catotelme, une couche avec un bilan<br />
d’activité microbienne beaucoup plus bas. On y trouve tout de<br />
même <strong>le</strong>s bactéries méthanogènes qui produisent du méthane<br />
dans <strong>le</strong>s endroits particulièrement humi<strong>des</strong>. C’est dans cette<br />
couche que la tourbe s’accumu<strong>le</strong> (à <strong>des</strong> taux variant de 0,5<br />
mm à 1 mm par année), tout en continuant à se décomposer à<br />
un taux très faib<strong>le</strong>. Cette strate est constamment en condition<br />
anaérobie et contient <strong>des</strong> couches de tourbe plus anciennes,<br />
donc plus compactées et plus décomposées (Rydin et Jeglum,<br />
2006). Puisque la conductivité hydraulique est plus basse dans<br />
<strong>le</strong> catotelme (Boelter, 1965), <strong>le</strong>s mouvements de l’eau y sont<br />
beaucoup plus limités que dans l’acrotelme.<br />
La nature diplothelmique <strong>des</strong> tourbières est l’élément clé qui<br />
régu<strong>le</strong> la capacité de rétention de l’eau et <strong>le</strong>s mouvements de<br />
l’eau à l’intérieur de ces milieux. Cette appellation s’applique<br />
exclusivement aux tourbières naturel<strong>le</strong>s, puisque lors d’interventions<br />
humaines, par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> <strong>drainage</strong>, l’acrotelme est<br />
perdu. La tourbière perturbée à une seu<strong>le</strong> couche (constituée<br />
seu<strong>le</strong>ment du catotelme) devient alors une tourbière haplothelmique<br />
(Ingram, 1978). Tout changement dans l’équilibre<br />
de l’acrotelme et du catotelme perturbe inévitab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s<br />
fonctions hydrologiques <strong>des</strong> tourbières, avec <strong>des</strong> conséquences<br />
pour la flore et la faune colonisant la surface (Cagampan et<br />
Waddington, 2008).<br />
4