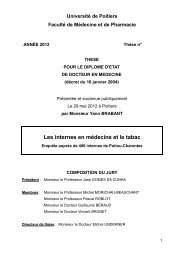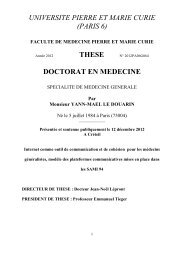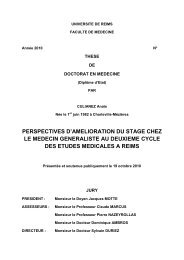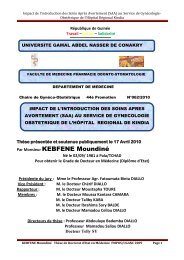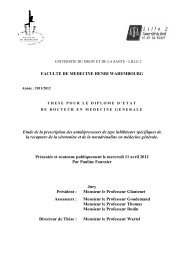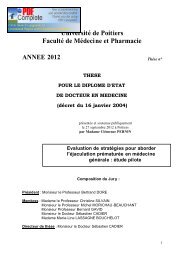Anne PLESSIS - Thèse IMG
Anne PLESSIS - Thèse IMG
Anne PLESSIS - Thèse IMG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITÉ D’ANGERSFACULTÉ DE MÉDECINEAnnée 2010 N° . . . . . . . . . .THÈSEpour leDIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINEQualification en : MÉDECINE GÉNÉRALEPar<strong>Anne</strong> <strong>PLESSIS</strong>Née le 18 août 1982 à ToursPrésentée et soutenue publiquement le : 12 octobre 2010LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES (MG) ET LA VACCINATION ANTI-PAPILLOMAVIRUSPrésident : Monsieur le Professeur FANELLO SergeDirecteur : Madame le Professeur BARON Cécile
UNIVERSITÉ D’ANGERSFACULTÉ DE MÉDECINEAnnée 2010 N°. . . . . . . . . . .THÈSEpour leDIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINEQualification en : MÉDECINE GÉNÉRALEPar<strong>Anne</strong> <strong>PLESSIS</strong>Née le 18 août 1982 à ToursPrésentée et soutenue publiquement le : 12 octobre 2010LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES (MG) ET LA VACCINATION ANTI-PAPILLOMAVIRUSPrésident : Monsieur le Professeur FANELLO SergeDirecteur : Madame le Professeur BARON Cécile
LISTE DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DEMÉDECINE D’ANGERSDoyenVice doyen rechercheVice doyen pédagogieDoyens Honoraires : Pr. BIGORGNE, Pr. EMILE, Pr. REBEL, Pr. RENIERProfesseurs Émérites : Pr. GUYPr. SAINT-ANDRÉPr. BAUFRETONPr. RICHARDProfesseurs Honoraires : Pr. ACHARD, Pr. ALLAIN, Pr. ALQUIER, Pr. BIGORGNE, Pr. BOASSON, Pr. BREGEON,Pr. CARBONNELLE, Pr. CARON-POITREAU, Pr. M. CAVELLAT, Pr. CHAUVET, Pr. DAUVER, Pr. DENIS, Pr. DESNOS,Pr. EMILE, Pr. FRANÇOIS, Pr. FRESNEAU, Pr. GROSIEUX, Pr. GUNTZ, Pr. HUREZ, Pr. JALLET, Pr. LARGET-PIET,Pr. LARRA, Pr. LIMAL, Pr. MARCAIS, Pr. PENNEAU, Pr. PIDHORZ, Pr. REBEL, Pr. RENIER, Pr. RONCERAY,Pr. SIMARD, Pr. SORET, Pr. TADEI, Pr. TRUELLE, Pr. TUCHAIS, Pr. WARTELPROFESSEURS DES UNIVERSITÉSMM ABRAHAM Pierre PhysiologieARNAUD Jean-PierreASFAR PierreAUBÉ ChristopheAUDRAN MauriceMmes BARON CélineBARTHELAIX AnnickChirurgie généraleRéanimation médicaleRadiologie et imagerie médicaleRhumatologieMédecine générale (professeur associé)Biologie cellulaireMM BASLÉ Michel Cytologie et histologieBAUFRETON ChristopheBEAUCHET OlivierBEYDON LaurentBIZOT PascalBONNEAU DominiqueBOYER JeanCALÈS PaulCAROLI-BOSC François-XavierCHABASSE DominiqueCHAPPARD DanielCOUPRIS LionelCOUTANT RégisCOUTURIER OlivierDARSONVAL Vincentde BRUX Jean-LouisDELHUMEAU AlainDESCAMPS PhilippeDIQUET BertrandDUBAS FrédéricDUBIN JacquesDUVERGER PhilippeENON BernardFANELLO SergeFOURNIÉ AlainFOURNIER Henri-DominiqueChirurgie thoracique et cardiovasculaireMédecine interne, gériatrie et biologie du vieillissementAnesthésiologie et réanimation chirurgicaleChirurgie orthopédique et traumatologiqueGénétiqueGastroentérologie ; hépatologieGastroentérologie ; hépatologieGastroentérologie ; hépatologieParasitologie et mycologieCytologie et histologieChirurgie infantilePédiatrieBiophysique et Médecine nucléaireChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologieChirurgie thoracique et cardiovasculaireAnesthésiologie et Réanimation chirurgicaleGynécologie-obstétrique ; gynécologie médicalePharmacologie fondamentale ; pharmacologie cliniqueNeurologieOto-rhino-laryngologiePédopsychiatrieChirurgie vasculaire ; médecine vasculaireÉpidémiologie, économie de la santé et préventionGynécologie-obstétrique ; gynécologie médicaleAnatomie2
MM FRESSINAUD Philippe Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissementFURBER AlainCardiologieGAGNADOUX FrédéricPneumologieGAMELIN ErickCancérologie ; radiothérapieGARNIER FrançoisMédecine générale (professeur associé)GARRÉ Jean-BernardPsychiatrie d’adultesGESLIN PhilippeCardiologieGINIÈS Jean-LouisPédiatrieGRANRY Jean-ClaudeAnesthésiologie et réanimation chirurgicaleHAMY AntoineChirurgie généraleHUEZ Jean-FrançoisMédecine générale (professeur associé)Mme HUNAULT-BERGER Mathilde Hématologie ; transfusionM. IFRAH Norbert Hématologie ; transfusionMmes JEANNIN PascaleImmunologieJOLY-GUILLOU Marie-Laure Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreMM LACCOURREYE Laurent Oto-rhino-laryngologieLAUMONIER FrédéricChirurgie infantileLE JEUNE Jean-JacquesBiophysique et médecine nucléaireLEFTHÉRIOTIS GeorgesPhysiologieLEGRAND ErickRhumatologieMme LUNEL-FABIANI Françoise Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreMM MALTHIÉRY Yves Biochimie et biologie moléculaireMENEI PhilippeNeurochirurgieMERCAT AlainRéanimation médicaleMERCIER PhilippeAnatomieMILEA DanOphtalmologiePARÉ FrançoisMédecine générale (professeur associé)Mme PENNEAU-FONTBONNE Dominique Médecine et santé au travailMM PICHARD Eric Maladies infectieuses ; maladies tropicalesPOUPLARD FrançoisPédiatriePROCACCIO VincentGénétiquePRUNIER FabriceCardiologieRACINEUX Jean-LouisPneumologieREYNIER PascalBiochimie et biologie moléculaireMme RICHARD IsabelleMédecine physique et de réadaptationMM RODIEN Patrice Endocrinologie et maladies métaboliquesROHMER VincentEndocrinologie et maladies métaboliquesROQUELAURE YvesMédecine et santé au travailMmes ROUGÉ-MAILLART Clotilde Médecine légale et droit de la santéROUSSELET Marie-Christine Anatomie et cytologie pathologiquesMM ROY Pierre-Marie Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologieSAINT-ANDRÉ Jean-Paul Anatomie et cytologie pathologiquesSUBRA Jean-FrançoisNéphrologieURBAN ThierryPneumologieVERRET Jean-LucDermato-vénéréologieWILLOTEAUX SergeRadiologie et imagerie médicaleZANDECKI MarcHématologie ; transfusion3
MAÎTRES DE CONFÉRENCESMM ANNAIX Claude Biophysique et médecine nucléaireAZZOUZI Abdel-RahmèneMmes BELIZNA CristinaBLANCHET OdileUrologieMédecine interne, gériatrie et biologie du vieillissementHématologie ; transfusionMM BOUCHARA Jean-Philippe Parasitologie et mycologieBOUYE PhilippeCAILLIEZ ÉricCHEVAILLER AlainMme CHEVALIER SylviePhysiologieMédecine générale (maître de conférences associé)ImmunologieBiologie cellulaireMM CRONIER Patrick AnatomieCUSTAUD Marc-AntoineMme DUCANCELLE AlexandraPhysiologieMM DUCLUZEAU Pierre-Henri NutritionEVEILLARD MatthieuFORTRAT Jacques-OlivierGALLOIS YvesHINDRE FrançoisJEANGUILLAUME ChristianMme JOUSSET-THULLIER NathalieBactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreBactériologie-virologie ; hygiène hospitalièrePhysiologieBiochimie et biologie moléculaireBiophysique et médecine nucléaireBiophysique et médecine nucléaireM. LETOURNEL Franck Biologie cellulaireMmes LIBOUBAN HélèneLOISEAU-MAINGOT DominiqueMédecine légale et droit de la santéBiologie cellulaireBiochimie et biologie moléculaireM. MARTIN Ludovic Dermato-vénéréologieMmes MAY-PANLOUP PascaleMESLIER NicoleBiologie et médecine du développement et de la reproductionPhysiologieMM MOUILLIE Jean-Marc PhilosophieNICOLAS GuillaumePAPON XavierMmes PASCO-PAPON <strong>Anne</strong>PELLIER IsabelleNeurologieAnatomieRadiologie et Imagerie médicalePédiatrieM PICQUET Jean Chirurgie vasculaire ; médecine vasculairePUISSANT HuguesMme SAVAGNER FrédériqueGénétiqueBiochimie et biologie moléculaireMM SIMARD Gilles Biochimie et biologie moléculaireSIX PatrickTURCANT AlainVERNY ChristopheBiostatistiques, informatique médicale et technologies decommunicationPharmacologie fondamentale ; pharmacologie cliniqueNeurologiedécembre 20094
Président du jury :Monsieur le Professeur Serge FANELLOCOMPOSITION DU JURYDirecteur de thèse :Madame le Professeur Céline BARONMembres du jury :Madame le Docteur <strong>Anne</strong> GANGLERMonsieur le Professeur François PAREMadame le Professeur Céline BARONMadame Pascale MOULEVRIERMonsieur le Professeur Eric PICHARD5
REMERCIEMENTSA Monsieur le Professeur Fanello qui, après m’avoir aidé à rédiger cette thèse sous formed’article, me fait l’honneur de présider ce jury. Soyez assuré de ma profonde reconnaissance.A Madame le Professeur Baron qui a accepté de diriger ce travail. La « thèse de médecinegénérale » si abstraite pour moi est devenue réalité et a pris corps grâce à vous. Je vousremercie de votre disponibilité, de vos conseils, et de votre esprit critique toujours constructif.Vous m’avez permis d’avancer pour aboutir enfin, merci.A Madame Moulévrier qui m’a accordé de son temps pour me donner les bases de laméthodologie qualitative et a accepté de participer à ce jury. Soyez-en sincèrement remerciée.A Monsieur le Professeur Pichard qui me fait l‘honneur de participer à ce jury sans meconnaître. Je vous remercie sincèrement de l’intérêt que vous portez à mon travail.A Monsieur le Professeur Paré qui a accepté de faire partie de ce jury. Merci de m’avoir unjour mis la puce à l’oreille, de m’avoir fait réfléchir sur la méthode d’enquête à utiliser pourma thèse.Aux Docteurs Foucat, Cailliez et Garnier, qui m’ont guidée et accompagnée dans ma pratiquede la médecine générale. Trouvez ici l’expression de tout mon respect et de mareconnaissance.A <strong>Anne</strong> qui me fait le grand plaisir et l’honneur de participer à ce jury. Je te remercie del’intérêt que tu as porté à ma thèse. Cet internat a été jalonné de nombreuses belles etinoubliables rencontres, tu en fais partie. Qui aurait cru que le train pour Saumur nousemmène jusqu’ici…Aux médecins généralistes qui m’ont accordé leur confiance et un peu de leur temps enacceptant de passer un entretien, sans eux ce travail n’aurait pas pu voir le jour.A Madame Milani pour sa précieuse aide technique et administrative.A tous ceux qui ont pris du temps pour relire et enrichir cette thèse.6
A tout ceux qui m’ont permis de grandir et de devenir ce que je suis aujourd’hui, toutparticulièrement à Monsieur Milani qui a été bien plus que mon professeur de hautbois.Aux amis de tous horizons métropolitains et réunionnais. A toutes ces belles personnes quej’ai rencontrées et qui m’enrichissent de leur amitié parfois malgré des milliers de kilomètres.De Tours à Angers, de Toulouse à Argentan en passant par La ravine des cabris et Saint-Pierre de la Réunion, j’en oublie sur le papier mais pas dans ma vie. Merci d’être vous etd’être là, prenez grand soin de vous surtout !Une pensée toute particulière pour les minis pouces, Annie aux beaux yeux bleus, toutes cesannées à vos côtés, sur les bancs de la fac de Tours et ailleurs, restent inoubliables ! Merci lescopines, longue route à notre amitié !A ma famille en Touraine, Hélène et Mathieu qui font de moi la plus fière des grandes soeurs,papi et mamie poule qui ont toujours été présents et que je remercie infiniment pour tout, lestias qui m’ont ouvert leur maison pendant de merveilleux mois et m’ont permis de reprendremon souffle, mes parents qui m’ont permis d’exister.A mon doudou qui depuis ce mois de novembre 2005 illumine ma vie de la sienne. Tabienveillance et ta patience, ton regard aimant m’ont soutenue durant ces longues annéesd’étude, pas toujours de tout repos. Merci pour ton aide dans la réalisation de cette thèse.J’adore la vie à tes côtés malgré nos différences, je ne pourrais pas m’en passer. Nosnombreux voyages ont été inoubliables, la vie réunionnaise intense. Une nouvelle libertés’offre à nous, en route pour de nouvelles aventures !7
SOMMAIRESOMMAIRE.......................................................................................................................................................... 8ABRÉVIATIONS.................................................................................................................................................. 9INTRODUCTION............................................................................................................................................... 10MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................................................ 11RÉSULTATS....................................................................................................................................................... 13DISCUSSION ...................................................................................................................................................... 20CONCLUSION.................................................................................................................................................... 27BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................. 28ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN.............................................................................................................. 31ANNEXE 2 : GRILLE D’ANALYSE................................................................................................................ 328
ABRÉVIATIONSAMM : Autorisation de mise sur le marchéCCU : Cancer du col de l’utérusDDI : Dé-Dés-InformationFCV : Frottis Cervico VaginalFMC : Formation médicale continueHAS : Haute Autorité de SantéHCSP : Haut Conseil de la Santé PubliqueHPV : Human Papilloma VirusIGAS : Inspection Générale des Affaires SocialesMG : Médecins GénéralistesMST : Maladie sexuellement transmissibleURML : Union Régionale des Médecins Libéraux9
INTRODUCTIONDepuis mars 2007 la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de proposer la vaccinationanti-papillomavirus à chaque jeune fille de 14 ans, ainsi qu’aux jeunes femmes jusqu’à 23 ansn’ayant pas initié leur vie sexuelle ou l’ayant initiée dans l’année. Intégrée au calendriervaccinal à titre de vaccin non obligatoire mais recommandé [1], elle est remboursée depuisjuillet 2007 [2].Les MG sont des acteurs privilégiés de la prévention auprès des jeunes qui les consultent pour80% d’entre eux au moins une fois par an [3].Cette vaccination, relativement récente, soulève des interrogations notamment autour de sonefficacité, son impact et donc du bénéfice réel qu’elle apporterait en terme de prévention ducancer du col de l’utérus [4] [5] [6] [7].Depuis 2008, on constate l’émergence de travaux abordant les pratiques, comportements, etperceptions des MG concernant cette vaccination [8] [9] [10] [11]. Ces études sont cependantquantitatives.Pour tenter d’apprécier l’adéquation d'une pratique à une politique vaccinale, qui doit êtreappliquée au plus grand nombre de personnes de la population cible [12], nous avons exploréles modalités de prescription de cette vaccination auprès des MG au décours d’entretienssemi-directifs.10
MÉTHODOLOGIELes entretiens semi-directifsNotre recherche qualitative propose de se concentrer sur les discours à partir d’entretiens.Nous cherchons à dégager des éléments de compréhension d’une pratique de prévention, ceque ne permettait pas un questionnaire quantitatif.Nous nous sommes présentés comme « interne faisant sa thèse sur les pratiques vaccinalesglobales des MG », sans dévoiler volontairement le sujet précis de l’étude afin de recueillir undiscours le plus spontané possible.Les entretiens ont été réalisés entre décembre 2008 et mars 2009 sur rendez vous. Allantd’une durée de quinze minutes à une heure, ils se sont déroulés à l’aide d’un même guided’entretien. L’ordre des questions n’a pas été systématiquement respecté, en revanche nousavons veillé à aborder l’ensemble des thèmes.Nous avons interrogés les MG sur le cadre de leur prescription, les arguments de leurdécision, et leurs propositions pour améliorer la prévention globale du cancer du col del’utérus.Le guide d’entretien (cf. annexe 1)Les publications concernant les facteurs influençant la prescription étaient peu nombreuses.Les hypothèses initiales ont été formulées à partir des recommandations officielles [12]. Lesitems du guide se sont enrichis au fur et à mesure de l’avancée de la recherche.Population de l’enquêteNous avons retenu trois principaux critères pour constituer notre population de MG : le sexe,la durée d’installation, et le lieu d’exercice. Pour former notre échantillon nous nous sommesbasés sur des réseaux humains de type « interconnaissances professionnelles » [12].Afin d’optimiser la faisabilité de l’enquête, nous avons ainsi privilégié une accessibilité à lafois géographique et relationnelle des personnes interrogées. Chaque médecin a été contactépar téléphone. Ce faisant, nous leur avons exposé le sujet de l’étude, le principe des entretiens,des modalités et du temps de passation, ainsi que de la nécessité d’enregistrer l’entretien [13].11
Sur les dix-neuf médecins contactés, seize MG exerçant en région Pays de Loire dont treizeen Maine et Loire et trois en Sarthe ont accepté, trois ont décliné la proposition avec commemotif le manque de disponibilités.Nous dénombrons :InstallationrécenteInstallationsupérieure àdix ansMilieu urbain Milieu rural Milieu semirural2 femmes2 femmes2 hommes 1 homme 1 homme2 femmes2 hommes1 femme1 homme1 femme1 hommeAnalyseDans un premier temps, nous avons exploité les entretiens en les intégrant dans une grilled’analyse (cf. annexe 2). Puis nous avons mis en exergue les discours les plus pertinents.Dans un second temps, nous avons croisé les informations, à l’aide d’un tableau de synthèse.12
RÉSULTATSLe cadre de prescription de la vaccination anti-HPVCertains médecins abordent ce sujet dès lors qu’ils voient une jeune fille en consultation,« dans n’importe quelle type de consultation, n’importe, que ce soit une angine, je dis au faitla petite là, il faudra… ».Une majorité l’évoque lors d’une (première) demande de contraception, ou au début deleur vie sexuelle.Les consultations dédiées à la prévention leur semblent également propices. Que cesoit lors des rappels de vaccination « quand on les voit à 16 ans pour un vaccin, c’est sûr quelà c’est plus facile d’y penser», ou lorsque la jeune fille vient avec son carnet de santé alors lemédecin « en profite toujours pour demander les vaccinations », ou encore lors des demandesde certificats d’aptitude au sport ou de rentrée scolaire.Les jeunes filles âgées de 14 à 23 ans sont les principales destinataires de l’information desmédecins traitants. Ces derniers pouvant proposer la vaccination avec plus ou moinsd’intensité en fonction de l’âge de la patiente :Les premières règles sont l’occasion d’aborder le sujet, et plus globalement àl’adolescence.Plusieurs praticiens commencent à en parler avant l’âge de 14 ans, « pour préparer leterrain » : « j’en parle, même à 12 ans, je leur dis dans deux ans on reparlera du vaccin ».Certains abordent le sujet soit directement avec les mères, (grand-mères parfois) quiont des jeunes filles pouvant être concernées, soit en présence de la mère lors de laconsultation avec la jeune fille afin « qu’elles puissent en rediscuter après ».Les informations diffusées dans un premier temps pour un grand nombre de praticiensconcernent le calendrier vaccinal mais également la possibilité d’un rappel : « laséroconversion est bonne, mais on ne sait pas combien de temps (ça dure) », tout en disantparfois « qu’il n’y a pas forcément d’urgence ».L’aspect financier peut être évoqué en disant, soit qu’ « il coûte cher », soit qu’il estremboursé, en annonçant alors les conditions de remboursement.Certains parlent de la « bonne tolérance » du vaccin qui est « sans effet secondaire ».Un des médecins prévient que le « vaccin fait mal à l’injection », un autre a contrario indiquequ’« il ne fait pas plus mal qu’un autre ».13
De nombreux arguments concernant le vaccin sont avancés. Certains le décrivent comme « unvaccin contre le papillomavirus », expliquent les modes de transmission du virus, puis font lelien entre le virus et le cancer du col de l’utérus. D’autres l’évoquent comme « un vaccincontre un cancer » de manière globale, ou plus précisément comme « un vaccin pour laprévention du cancer du col de l’utérus ». D’autres encore mettent en avant la protectioncontre les condylomes, les conisations, et « beaucoup de lésions qui peuvent être gênantesdans la vie sexuelle d’une femme ».Plusieurs praticiens donnent un pourcentage de « protection », en d’autres termes « çadiminue les risques à 90% on va dire, donc ce serait bête de ne pas le faire. ». Certainségalement utilisent la plaquette du laboratoire « ça me sert bien ce que m’a donné le labo, jetrouve que c’est bien conçu, ça renforce le message qu’on doit faire passer, ça le facilite ».Ce vaccin qui protège d’une MST devient une opportunité d’éducation à la sexualité. Pourcertains, parler du vaccin est un moment privilégié « ça permet aussi de parler de MST »,« d’anatomie intime », « de contraception »…De plus, il nécessite d’évoquer la question des rapports sexuels de leurs patientes. Nous avonsdégagé trois façons d’aborder ce sujet :Les médecins posent, globalement, facilement la question « est ce que vous avez déjàeu des rapports ? ». « Ça ne m’a jamais posé de problème d’aborder ça et je ne les sens pasgênées de me le dire. ». Pour certains, il est important de justifier sa question auprès de lajeune fille « je leur demande si elles ont eu des rapports sexuels à ce moment là, direct, je luidis tu sais je suis obligée de te poser la question pour le vaccin ». D’autres en parlentaisément à la condition de voir la patiente seule en consultation. La plupart le font avec unevolonté de « coller aux recommandations » de l’HAS.Il peut exister une gêne liée à différents facteurs :- La connaissance antérieure de la jeune fille : « Au début ce n’était pas facile mine de rien deposer cette question à une personne qu’on connaît, est ce que vous avez des rapportssexuels ? ».- La présence des parents peut créer un embarras chez le praticien. Il pose malgré tout laquestion, soit après avoir invité les parents à sortir, soit en leur présence.- L’âge de la patiente : « Je leur demande systématiquement si elles ont eu des rapports à 14ans, après c’est plus délicat ».Certains vont se servir d’un "artifice marketing" pour aborder la question. Ils donnentles conditions de remboursement de la vaccination à la jeune fille, soit en les expliquantoralement soit en donnant la plaquette distribuée par les laboratoires. Leur finalité étant de14
« laisser la jeune fille avec les infos, revenir ou pas », et ainsi permettre une secondeconsultation le plus souvent sans tiers.Les éléments intervenant dans le processus de décision de la prescriptionLes facteurs modérateursLa tranche d’âge concernée est large : entre 14 et 23 ans. Certains rapportent des difficultés àen parler après 14 ans : « plus difficile de l’aborder chez des jeunes de 19, 20 ans parce qu’ony pense un peu moins ». Ou a contrario : « j’y pense mais pas à 14 ans. A 14 ans ce sont desbébés, je n’arrive pas à y penser », et abordent le sujet « dès qu’elles commencent à faire unpeu femme ».La nécessité d’évoquer les rapports sexuels complexifie la démarche, soit le médecinconsidère la patiente trop jeune « Comment on va aborder la chose à 14 ans, parler déjà desexualité avec elle », soit, il perçoit la nécessité d’aborder le sujet avec des jeunes filles peuréceptives « celles qui n’ont pas de rapports (…) ne se sentent pas nécessairement pressées,concernées », entraînant « quelques réticences » chez les MG.L’existence de convictions religieuses sur la virginité et le mariage, chez les jeunesfilles ou leurs parents, peut également limiter la vaccination.La curabilité non morbide du cancer du col de l’utérus peut relativiser l’intérêt de lavaccination.Le souvenir de la polémique autour de la vaccination contre l’hépatite B réapparaît, certainsmédecins se trouvent face à des patients « qui freinent ou qui sont frileux et refusent legardasil par rapport à l’hépatite B ».De l’avis de plusieurs, le coût de la vaccination est élevé « Là on met plus de 400euros par personne sur la table », d’autant plus qu’ « on va quand même faire les frottis », cequi « augmente le coût ». Cette remarque, confrontée à l’incertitude sur les bénéfices duvaccin modère leur prescription, ils ne se « précipitent pas».Certains sont « déçus » par le « taux de couverture ». Ils critiquent le caractère« sélectif » de la vaccination « par rapport aux valences », et considèrent qu’elle « nefonctionne qu’à 70% ». Ils préfèrent alors se concentrer sur des vaccins avec une « couverturevaccinale à 95% ».Un autre MG pose le problème de l’atteinte de la cible des personnes non dépistées parle FCV. Il pense que l’ « on va avoir le même type de population qui se fait vacciner que celle15
qui se faisait suivre au niveau du frottis », et, par conséquent, se demande si « on vaaméliorer la couverture ».Le caractère nouveau du vaccin induit des craintes, un des médecins faisant « par principetoujours attention avec les nouveaux produits ».Certains ont peur que l’arrivée de ce mode préventif ne relativise la pratique dudépistage, ils ont « de grandes inquiétudes » « que les gens ne se fassent pas suivre ».L’augmentation des prises de risques en matière de sexualité représente une autrecrainte, « il ne faut pas que ça empêche de mettre des préservatifs … et puis d’être conscientaussi qu’on ne fait pas n’importe quoi ».Une des critiques majeures concerne la publicité faite par les laboratoires, qui véhicule unmessage de santé publique, et est financée par des fonds privés.De plus, certains perçoivent les messages publicitaires comme « racoleurs » voire« culpabilisants » notamment auprès des mères, ce qui décrédibilise à leurs yeux lavaccination « ça me dérange beaucoup et ça me fait douter très clairement de l’intérêtscientifique (du vaccin) ».L’intensité de la publicité a également été mal perçue : « le laboratoire, il est parti àfond sur le plan incitateur de façon trop prononcée ».Dans la même idée de partialité de ce choix de santé publique, un des médecins remet encause la neutralité de la HAS : elle « n’est pas non plus totalement la plus objective possible,il y a des lobbying même à la HAS ».La perception de doutes émanant même des pouvoirs publics : « continuons à faire les frottis(malgré le vaccin), et réévaluons les choses dans quelques années ».induit également unsentiment de suspicion chez le prescripteur lui- même.Plusieurs médecins se demandent enfin si « les cancers du col de l’utérus sont si nombreux »dans la mesure où les femmes sont bien suivies et font régulièrement un FCV. Un praticien vaplus loin en disant que « ce n’est pas une question majeure de santé publique », puisqu’ « onn’en voit pas tous les jours des cancers du col ». Ils soulèvent ainsi la question de l’intérêt dela vaccination en terme de santé publique.Les facteurs facilitateursDe nombreux praticiens ont confiance dans l’information donnée par les laboratoirescommercialisant le vaccin « que ce soit par un laboratoire ou dans un autre cadre, je veuxdire pour moi, c’est la même information ».16
L’avis de médecins dits experts peut avoir une indiscutable force de « conviction » surles médecins généralistes, ils adoptent leur point de vue « l’opinion que je vous ai soumisec’était un petit peu son opinion ». Nombreux se forgent leur avis après avoir « discuté avecles gynécos » par exemple.Le crédit accordé à l’HAS légitime le vaccin : « notre haute autorité de santé lepréconise (donc je le fais) ». Certains ayant pour « principe que si on nous l’a présenté et s’ilest étudié c’est qu’on considère qu’il est efficace, sinon on remet tout en cause ».Le remboursement justifie l’intérêt de ce vaccin, et facilite sa prescription « s’il a étéremboursé, coût santé par rapport au coût financier, il doit quand même y avoir un intérêt ».Certains le prescrivent parce que « c’est un vaccin, donc comme tout vaccin, il a unintérêt ». La vaccination est perçue comme « une chance », et sans elle « on n’est pas prèsd’éradiquer certaines maladies ». Un des médecins se décrit comme « pro vaccination », « unmédecin traitant » doit « véhiculer la bonne parole » et ainsi « motiver les patients afin qu’ilssoient pro vaccination ». De plus, il ne s’agit pas d’un vaccin « d’un type nouveau », lepraticien a confiance.L’outil de prévention FCV et sa répétition régulière peuvent être ressentis comme difficiles àpratiquer « on se bat tellement pour faire des frottis aux jeunes filles ». La vaccination estalors perçue comme une solution palliative à cette limite du FCV puisque « là on ne les verrapas plus souvent pour les frottis, et l’avantage c’est qu’on aura moins de risques ».La solution thérapeutique que représente la conisation peut avoir une image très négative dansl’esprit de certains prescripteurs, allant jusqu’à parler « d’amputation ». Par conséquent,l’arrivée de ce nouveau moyen de prévention primaire est très bien reçue. En effet « si on peuttravailler en amont et éviter ça, je trouve que c’est vraiment très bien ».Moyen de prévention primaire, elle permet d’éviter des lésions variées. L’aspect prioritaire,pour certains, est la lutte « contre un cancer » en général. Ils y voient là « une sacréerévolution ». L’intérêt réside également dans la protection contre les condylomes. Enfin, lavaccination « protège contre un virus », qui plus est « que tout le monde peut attraper ».Ainsi, « on est dans une médecine préventive » voire « terriblement préventive », comportantdes aspects médicolégaux. Cette obligation d’information au sens légale ressort, et devient unargument important pesant dans la prescription.La grande majorité ne perçoit pas de contre indication à ce vaccin ni d’effet secondaire, l’undes médecins affirme : « je ne vois pas d’argument, dans la mesure où il est bien toléré, pourne pas le proposer ».17
Pour certains, l’efficacité est prouvée « puisqu’au bout de six ans, on observe une diminutiondes lésions » sans qu’ils en précisent le type. Ces derniers pensent « qu’on est efficace ».L’anxiété des patientes est un facteur de facilitation de la prescription, « si vraiment vous avezdu stress par rapport à ça, il vaut mieux le faire », discours retrouvé chez un médecin quin’est pas convaincu de l’intérêt du vaccin.La demande des patients peut naître d’un effet de groupe. Lorsque des médecins d’un cabinetmédical sont très favorables, ceci permet de toucher un grand nombre de jeunes filles qui seconnaissent souvent entre elles. Le discours commun entraîne une meilleure adhésion. « Dansle cabinet, on est très gardasil, on les vaccine beaucoup, donc elles en parlent entre elles deplus en plus », et demandent à être vaccinées.Certains ressentent un besoin d’agir « Je ne vais pas attendre trente ans pour faire deschoses… », critiquant parfois un « principe de précaution à l’extrême » pouvant devenir« quelquefois excessif ».Les propositions faites par les MG pour améliorer la prévention globale ducancer du col de l’utérusNombreux sont ceux ayant des propositions :Favoriser la vaccination anti-HPV, « si effectivement tout le monde était vacciné ce seraitl’idéal quand même ».Un grand nombre pense qu’il serait intéressant de renforcer les campagnes de publicité faitespar les laboratoires pharmaceutiques. Ils citent, pour ce faire, plusieurs moyens : mettre « desgrandes affiches dans la salle d’attente pour qu’elles (les jeunes filles concernées) m’enparlent », ou bien « renouveler ces publicités TV (à propos du gardasil), mais au moment dela rentrée scolaire, quand elle voit le médecin », ou encore, mettre en place des campagnes depublicité des laboratoires dans le cadre scolaire.Favoriser le dépistage par le FCVDans un premier temps, plusieurs médecins suggèrent d’améliorer l’accessibilité matérielle auFCV, soit en autorisant de nouveau les laboratoires d’analyse à réaliser des FCV, soit enrenforçant les centres de planification, lieu de dépistage d’une population défavorisée enterme d’accès aux soins, « population qui de toute façon n’en n’aurait pas parlé à leurmédecin traitant ».18
Secondairement, certains praticiens proposent d’intensifier l’information sur le dépistage parFCV. En effet, ils souhaitent « une campagne » médiatique organisée par les pouvoirs publics« plus incitative au niveau du frottis », « en organisant plus les choses », prenant alorsl’exemple des campagnes réalisées dans le cadre du « cancer du sein, ou du cancercolorectal ».Privilégier l’éducation à la sexualité de la population de façon globaleL’école pourrait, entre autre, remplir ce rôle, être le lieu permettant de « renforcerl’information sur la prévention des MST, la contraception ».Nombreux sont ceux pensant que l’éducation à la sexualité est une fonction du médecintraitant : « c’est notre travail d’en parler assez tôt, de leur expliquer le pourquoi du comment,comment le corps marche », ajoutant que la relation avec le médecin traitant est favorable. Eneffet, « elle se construit avec le temps, c’est une relation de confiance ». L’éducation peut sefaire soit lors de chaque consultation en « prenant le temps d’expliquer, pour tout » ce quinécessite suffisamment de temps à chaque fois puisqu’ « il faut dire et redire », soit àl’occasion d’une consultation dédiée.19
DISCUSSIONCritique de la méthodeLe choix des médecins n’a pas été le fruit du hasard. La méthode de recrutement « parinterconnaissance » est un biais qui peut influencer le registre des opinions [3]. L’échantillonn’est pas représentatif de la population des médecins des Pays de Loire [14].Nous souhaitions rencontrer deux personnes pour chaque catégorie. En fin d’enquête, lesdonnées des entretiens n’apportaient plus d’élément déterminant nouveau. Nous n’avons parconséquent pas jugé nécessaire d’augmenter la taille de notre échantillon.Nous pouvons mettre en évidence des invariants, quelques tendances et des variables.Des invariantsNous avons relevé deux constantes. Aucun médecin ne refuse la vaccination anti-HPV. Tousprescrivent le vaccin quadrivalent, comme le recommande la HAS [12]. La protectionconjointe du cancer du col de l’utérus et des condylomes est sans doute à l’origine de cechoix. Les résultats de la thèse du Dr Piana Pech-Gourg [8] abondent dans ce sens : 87.5% desmédecins de son étude en région PACA prescrivent le quadrivalent avec pour objectifd’assurer cette protection conjointe.Nous remarquons que si globalement les MG tiennent le même discours sur le déroulé deleurs consultations, leurs pratiques divergent. Nous avons dégagé en particulier des liens aveccertaines caractéristiques de la population, des variables dans le processus de décision, et uneimplication dans la prévention.Des liens entre les caractéristiques de la population et les pratiques de lavaccination anti-HPVNous n’avons pas constaté de relation entre l’âge du praticien, le sexe, le lieu, la duréed’installation, le mode d’exercice (seul ou en groupe), et la pratique de cette vaccination.Notre analyse trouve écho dans une étude réalisée sur l’île de la Réunion en 2007 [9].L’existence de liens entre la pratique vaccinale globale du médecin et sa pratique de lavaccination anti-HPV n’a pas été mise en évidence. En effet, certains vaccinentsystématiquement dans les deux cas. D’autres n’aimant que peu vacciner, sont incisifs pour lavaccination anti-HPV. Inversement, des médecins systématiques dans leur pratique vaccinale20
en générale, ne le sont pas pour le vaccin anti-HPV. Ces résultats sont étonnants, d’autant quel’étude réunionnaise [9] montre qu’« il semblerait que plus les praticiens pratiquent devaccination, plus ils ont tendance à proposer le vaccin anti-HPV », sans différencestatistiquement significative toutefois.La vaccination contre l’hépatite B ne ressort pas fréquemment des discours des médecinslorsqu’ils évoquent la vaccination anti-HPV. Pourtant ces deux vaccinations participent de lamême problématique de prévention des MST chez les adolescents [15]. Seul un des praticiensen a fait part, trouvant cohérant d’associer quasi systématiquement les deux vaccinations. Unmédecin évoque quant à lui « le syndrome de l’hépatite B » au même titre qu’une étude où10% des MG ont signalé spontanément ce frein [16].La pratique du FCV et l’intensité de la proposition de la vaccination ne semblent pas liées.Une grande majorité, conformément aux recommandations [2], insiste sur l’importance dusuivi par FCV dans l’information qu’ils délivrent aux patients.Néanmoins dans notre étude, les médecins qui citent leur crainte d’abandon du FCV commefacteur limitant la prescription sont les moins incisifs dans la proposition de la vaccination.Cette observation rejoint les résultats de l’étude en région PACA [8] et nous retrouvons cetteinquiétude de l’abandon du dépistage par FCV dans la recherche effectuée sur l’île de laRéunion [9]. Ces deux études concluent qu’« il s’agit d’un risque que les praticiens peuventcontrôler », « il est donc fort probable qu’ils veilleront à ce que les patientes vaccinées (…)continuent à faire leur FCV ». Deux remarques permettent de nuancer ce point de vue : d’unepart la difficulté, rapportée par une des femmes médecins, de faire régulièrement un FCV àses patientes, et d’autre part un taux de 60 à 70% de survenue des décès par CCU en Francechez des femmes non ou mal dépistées [17].Dans leurs suggestions pour améliorer la prévention globale du cancer du col, les médecinsattachés au FCV ou craignant une négligence du dépistage ne proposent pas de favoriser lavaccination mais demandent plutôt d’accentuer le dépistage par FCV ou encore de renforcerplus largement l’éducation à la sexualité.Les liens entre les médecins et l’industrie pharmaceutique sont ambigus. Une rechercheréalisée sur les sources d’informations thérapeutiques en médecine générale [35] proposedeux hypothèses. Soit les médecins sont « réticents à admettre leur confiance dans l’industriepharmaceutique », soit « ils n’ont pas conscience d’une telle influence ». Aussi dans notreétude, nombreux médecins ont fait part de la presse médicale comme sources d’informations,ne distinguant que rarement la presse gratuite de la presse payante. De plus, des FMC ne sontpas toujours identifiées comme une réunion organisée par un laboratoire puisque ce sont des21
experts qui interviennent, et non pas un visiteur médical. Il n’est, malgré tout, jamais faitmention de conflits d’intérêts. Par conséquent, l’impact des firmes pharmaceutiques estprobablement minoré dans le discours des médecins.Il se dégage plus nettement dans notre travail que les avis d’experts ou de confrères ont del’influence. « Le réseau professionnel de proximité, joue un rôle prépondérant » [18] dans lesschémas de décisions.Des variables dans les éléments du processus de décisionLa méconnaissance des patientes était citée [8] [11]. Probablement suite à la large diffusiondes campagnes publicitaires ayant débuté pendant l’été 2008, ce facteur, hier modérateur, n’apas été rencontré au court de notre étude.Le non remboursement était présenté comme une entrave à la prescription [9] [11]. Larecherche réalisée à la Réunion [9] montre que le remboursement fait passer le nombre deprescripteurs de 20 à 80%. Malgré le remboursement, le prix de la vaccination reste critiquédans notre étude. Il est perçu, soit comme étant trop élevé dans l’absolu, soit comme ayant uncoût excessif par rapport au bénéfice attendu. Cet argument est exposé dans une propositionde loi [19]. Cette dernière formulée par un groupe de sénateurs en 2008, vise à la suppressionde la publicité pour les vaccins auprès du public, elle est centrée sur le vaccin anti-HPV. Cessénateurs constatent que l’« on peut craindre un progrès très marginal pour un coût très élevé(406,77 euros par vaccination) entre le groupe des femmes bien dépistées et le groupe desfemmes bien dépistées et vaccinées. ».Certains médecins de notre étude proposent d’en faire baisser le prix afin qu’il devienneacceptable en terme de santé publique.Plusieurs médecins de notre étude évoquent des incertitudes sur les effets à long terme,arguments également retrouvés dans les recherches antérieures concernant la perception de lavaccination anti-HPV [8] [9] [11]. L’étude réunionnaise met cependant en évidence que « cescraintes n’empêchent pas les médecins de prescrire ». Nous le constatons également.Certains se posent la question du bénéfice réel, baisse de la morbidité des condylomes et de lamorbi-mortalité lié au CCU. Ces propos se retrouvent dans un article de la Revue Prescrire,publié en février 2007 [20] qui compile les points de vue de plusieurs journaux étrangersspécialisés sur les médicaments : il rapporte l’existence d’un manque de recul sur l’efficacitéà long terme. Un article du Monde daté du 9 juillet 2008 [7] fait les mêmes constats : « Onsait seulement qu’il est efficace pour protéger les adolescentes et les jeunes femmes contre les22
infections liées aux deux souches les plus dangereuses des papillomavirus, parmi les douzequi induisent des risques élevés, mais on ne sait pas si cette protection réduit la fréquence ducancer du col utérin ».Dans une étude réalisée en Ille-et-Vilaine [11], la peur d’effets secondaires arrive en troisièmeposition des obstacles à la prescription, après le prix du vaccin et le non remboursement. Lerisque de sélection de nouvelles souches virales oncogènes est soulevé [5] [7]. Certainss’interrogent également sur l’atteinte, par la vaccination, de la cible des personnes non ou maldépistées par le FCV. Ces dernières, populations vivant notamment dans des conditions deprécarité, sont plus à risque de CCU que la population générale [17]. Ce cas de figure pose enfiligrane la question de son utilité. Plusieurs praticiens jugent les informations mises à leurdisposition, peu valides [6]. Les médecins rencontrés, pour la plupart, font confiance à la HAScomme le note le rapport de l’IGAS de 2007 [21]. Cependant, quelques uns la critiquent etremettent en cause sa légitimité, arguant l’existence de lobby en son sein.Les médecins de l’URML de l’Île de la Réunion se sont organisés pour diffuser uneinformation médicale indépendante, à travers une campagne intitulée « Dé-Dés-Information »(DDI) [22]. La prévention du CCU en a été une des cibles arguant que l’essentiel reste ledépistage régulier par FCV. Cette information a été réalisée auprès des médecins et du grandpublic au moyen notamment de publications dans la presse locale, financées exclusivementpar les cotisations des MG réunionnais.La peur d’une augmentation des prises de risques en matière de sexualité est un élémentmarginal, mais néanmoins présent. Les auteurs du moratoire espagnol [23] craignent que « cevaccin (…) ne remette en question les pratiques de prévention (utilisation du préservatif) et dedépistage (FCV) à l’efficacité démontrée ».La peur de voir le dépistage par FCV négligé reste l’élément dominant et cette crainte estconfirmée dans les références citées.L’intérêt en terme de prévention ressort du discours des médecins au moment de donnerl’information et conforte le MG dans une de ses missions essentielles [24]. Il est perçu commeun vaccin contre : un cancer au sens général, le CCU, les condylomes, des virus ... Lesexplications des médecins sont multiples et reprennent en substance les conclusions de lacommission de transparence de la HAS [12].Nous observons que la cible des praticiens dépasse la population recommandée par la HAS,ils en parlent à la fois aux mères et aux filles, ce qui avait déjà été constaté [10]. Certainsmédecins prescrivent même cette vaccination hors AMM, toujours dans un souci deprévention. L’information et la formation, de quelque nature qu’elles soient, influencent23
favorablement, de façon très majoritaire, les praticiens de notre étude qui se sentent légitiméspar la recommandation de l’HAS, tout comme le remboursement qui, outre le fait de rendreaccessible le vaccin, lui accorde du crédit. L’outil thérapeutique qu’il représente, peut êtreégalement un élément favorisant la prescription [25].Des facteurs modérateurs émergent :Le sentiment de précipitation dans la prise de décision de santé publique est un élémentintervenant dans la controverse sur la vaccination anti-HPV [26]. Concernant la prévention duCCU, l’existence de politiques de santé publique différentes ayant fait leur preuve en terme deréduction de la mortalité [17], amène certains praticiens à douter de l’intérêt de cettevaccination. En effet, cette dernière n’a pas actuellement fait ses preuves en matière deréduction de la mortalité contrairement aux programmes de dépistage organisés dans d’autrespays [17]. Il apparaît que la situation en France est différente. La très grande majorité desFCV est prélevée par les gynécologues et le taux de participation des MG est faible. Lacouverture de la population n’est pas optimale. Nous pouvons légitimement nous interrogersur l’absence, et ce malgré des recommandations et des observations favorables, deprogrammes de dépistage organisés du CCU élargis à l’ensemble du territoire [17] [27] [28].Il est à noter que notre département a été choisi par la Direction Générale de la Santé etl’Institut National de Cancer comme département pilote de ce dépistage.La publicité des laboratoires, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme que revêtent cescampagnes, est une des critiques des médecins rencontrés. Elle fait écho à plusieurs positionsdéjà prises comme celle du groupe de sénateurs en France en 2008, celui du moratoireespagnol et celle du comité pour la « DDI » [19] [22] [23].Cependant ces campagnes peuvent avoir un impact favorable. En effet, les patients sontsusceptibles d’être à l’origine de la demande. Il s’agit d’un avantage aux yeux de certainspraticiens qui n’ont pas encore ancré cette récente vaccination dans leur pratique. Cettemédiatisation leur permet également d’évoquer la vaccination anti-HPV avec un patientsensibilisé à ce sujet. Ainsi, elle facilite le dialogue.Le vécu et la peur du CCU peuvent influencer les pratiques des médecins :Plusieurs médecins s’interrogent sur la fréquence du CCU en France, dans la mesure où lesfemmes sont correctement dépistées. En France, il se place en dixième position des cancerschez la femme par sa fréquence, il est le quinzième cancer le plus meurtrier. Il est décritcomme « candidat idéal au dépistage par son évolution lente et l’existence de nombreuseslésions précancéreuses curables », et donc « un cancer pouvant potentiellement devenir, en24
de commencer tôt cette éducation [32] et l’impact important de celle-ci sur les comportementsdes adolescents [33].Deux projets de consultations dédiées semblent intéressants concernant l’éducation à lasexualité : une pour les enfants de 12 à 13 ans et une consultation « Jeune » pour les 16-25ans.Ce vaccin est cité par bon nombre de médecins comme une opportunité d’éducation. Cesrésultats corroborent les conclusions d’autres travaux. Ils rapportent qu’évoquer la vaccinationanti-HPV en consultation est « une bonne occasion » pour aborder le thème de la sexualité [8][9] [10] voire améliorer la prise en charge globale des adolescentes [34].26
CONCLUSIONNotre étude a permis de révéler des résultats touchant à la fois au cadre de prescription de lavaccination anti-HPV, aux facteurs intervenants dans le processus de cette prescription, et à laplace de cette dernière dans la prévention du CCU.Concernant le cadre de prescription, nous retiendrons que la vaccination anti-HPV estévoquée le plus souvent lors des consultations de contraception et des examens de prévention.En dehors de la population cible concernée, les MG donnent l’information à une populationconstituée des mères et jeunes filles de moins de 14 ans. Le message n’est pas univoque et sedécline au pluriel. Deux éléments retiennent particulièrement notre attention. D’une part, lesMG, tout en conseillant la vaccination, insistent sur l’importance du suivi, craignant de le voirnégligé. D’autre part, ils estiment que cette vaccination concernant une IST, représente uneopportunité d’éducation à la sexualité des jeunes filles.Les propositions pour améliorer la prévention du CCU comportent trois axes : unrenforcement de la vaccination notamment à travers l’élargissement des indications,l’amélioration de l’accessibilité au FCV, l’intensification de l’éducation de la population auxdifférentes modalités de prévention et plus globalement à la sexualité. Si l’exercice de lamédecine générale a une dimension de santé publique, force est de constater qu’elle n’est pasévidente à mettre en oeuvre dans la pratique quotidienne.27
BIBLIOGRAPHIE[1] Groupe de travail sur la vaccination contre les papillomavirus, comité technique desvaccinations. Conseil supérieur d’hygiène publique, 23 mars 2007http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_230307_papillomavirus.pdf[2] Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. Calendrier vaccinal 2007, avis du Haut Conseilde la Santé Publique. INVS, 24 juillet 2007, n°31-32http://www.invs.sante.fr/BEH/2007/31_32/beh_31_32_2007.pdf[3] CHOQUET M. Enquête nationale adolescents. Inserm U 169, 1993[4] ALVAREZ-DARDET C. Razones para no decidir con prisas .El Pais, 6 novembre 2007http://www.elpais.com/articulo/salud/Razones/decidir/prisas/elpepusocsal/20071106elpepisal_9/Tes[5] J HAUG C. Human Papillomavirus Vaccination — Reasons for Caution. NEJM, Volume359:861-862, 21 août 2008http://content.nejm.org/cgi/content/full/359/8/861[6] BERNDT C. Une arme vaccinale bâclée à précision douteuse « Schnellschuss mitfehlender Präzision ». Süddeutsche Zeitung, 26 novembre 2008http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2008/12/16/gardasil-et-cervarix-sur-lasellette-en-allemagne-13-medecin.html[7] BLANCHARD S. Cancer de l’utérus : le frottis plus efficace que le vaccin. Le Monde, 09juillet 2008http://www.urml-reunion.net/ddi/gardasil/le_Monde_Beraud.htm[8] PIANA PECH GOURG L. Opinions et pratiques vaccinales en médecine générale :« place de la vaccination anti-HPV ». Thèse de doctorat en médecine. Université d’Aix-Marseille, 2008[9] PLAISANTIN G. Évaluation des comportements des MG de l’île de la Réunion vis-à-visde la vaccination anti-HPV. Thèse de doctorat en médecine. Université de Bordeaux 2-VictorSegalen, 2008[10] URIBE L. La vaccination anti-papillomavirus en médecine générale : enquête de pratiqueauprès de 115 MG du Bas-Rhin. Thèse de doctorat en médecine. Université de Strasbourg,2008[11] LEOST A. Évaluation de la perception du vaccin anti-papillomavirus par les médecinsd’Ille-et-Vilaine. Thèse de doctorat en médecine. Université de Rennes, 2008[12] Recommandation du Collège de la Haute Autorité de Santé, 17 avril 2008cliniques/HAS/recommandation_college_has_cervarix_170408.pdf28
[13] BEAUD S, WEBER F. Guide de l’enquête de terrain. Ed. La Découverte, 1997, 327 p.(Collection guides repères)http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-[14] La santé observée dans les Pays de la Loire. Observatoire Régionale de la Santé des Paysde la Loire, Ed 2007[15] Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents. HauteAutorité de Santé, 2010http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/<strong>IMG</strong>/pdf/Calendrier_vac-tab_enfant_ados_2010.pdf[16] PELISSIER G, BASTIDES F. Vaccination anti-HPV dans le cadre de la prévention ducancer du col de l’utérus en médecine générale : Enquête réalisée auprès des MG d’Eure-et-Loir et du Cher. Rev Prat 2008; 58, 19 : 25-31[17] WALTER D. Le dépistage du cancer du col de l’utérus en France : réflexions à partir desexpériences Européennes et perspectives. Thèse de doctorat en médecine. Strasbourg :Université Louis-Pasteur, 2002[18] YEU C, Éléments intervenants dans la décision médicale en médecine générale :exemple du dépistage du cancer de la prostate par dosage des PSA. Thèse de doctorat enmédecine : Université de Bobigny, 2008http://www.esculape.com/cqfd/THESE_PROSTATE.pdf[19] AUTAIN F, DAVID A, FISCHER G, HOARAU G, « et al. ». Proposition de loi visant àla suppression de la publicité pour les vaccins auprès du public. <strong>Anne</strong>xe au procès-verbal dela séance du 15 janvier 2009http://www.senat.fr/leg/ppl08-171.html[20] Vu d’ailleurs : vaccin papillomavirus 6, 11, 16, 18 (Gardasil°), La Revue Prescrire, 2007; 27 (280) ; 89-93.[21] BRAS P-L, RICORDEAU P, ROUSSILLE B, SAINTOYANT V. L’information des MGsur le médicament. Rapport n°RM 2007, IGAS septembre 2007, 136 phttp://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000703/0000.pdf[22] DE CHAZOURNES P, HUMBERT P, DERKASBARIAN M, « et al. ». La DéDésinformation, URML de la Réunion, 2008http://www.urml-reunion.net/ddi/gardasil/Lettre-%20infos-Gardasil-20080811.htm[23] ALVAREZ-DARDET C, MARQUEZ-CALDERON S, GONZALEZ LOPEZ-VALAVARCEL B. RAZONES. Para una moratoria en la applicacion de la vacuna del virusdel papilloma humano en Espana.http://www.matriz.net/caps2/declaracion/[24] ALLEN J, CREBOLDER H, GAY B, « et al. ». La définition européenne de la médecinegénérale-médecine de famille. WONCA Europe, 2002http://www.woncaeurope.org/Web%20documents/European%20Definition%20of%20family%20medicine/WONCA%20definition%20French%20version.pdf29
[25] Sous la direction de GAUTIER A. Baromètre médecins/pharmaciens 2003, INPEShttp://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/793.pdf[26] Compte rendu SFTG. Vaccins contre les cancers : vraiment efficaces. 18 juillet 2008http://www.carevox.fr › Médicaments & Soins › Risques[27] Cahier des charges du dépistage organisé du cancer du col. HAShttp://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cancer_uterus/cctp.pdf[28] DUPORT N. Données épidémiologiques sur le cancer du col de l’utérus, état desconnaissances, actualisation. INVS, 2008http://www.invs.sante.fr/publications/2008/cancer_col_uterus_2008/cancer_col_uterus_2008.pdf[29] BOZON LE GALL C. Dépistage du cancer du col : l’expérience martiniquaise 1991-2004. Thèse de doctorat en médecine. Dijon : Université d’Antilles-Guyane, 2006[30] BAUDIER F, BERTHELOT N, MICHAUD C, CLEMENT M-C, JEANMAIRE T. Laconsultation de prévention en médecine générale, constats sur les pratiques actuelles enmédecine générale et propositions de développement, Haut conseil de la Santé Publique, mars2009http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20090325_ConsultPrev.pdf[31] Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Journal Officiel n° 190,17 août 2004, 14598phttp://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/loi_2004_810_du_13_aout2004.pdf[32] VERDURE F, ROUQUETTE A, DELORI M, ASPEELE F, FANELLO S.Connaissances, Besoins et attentes des adolescents en éducation sexuelle et affective. ArchPediatr Puer 2010 ; 17: 219- 25.[33] PRADEL J, BOUQUET E, FOUGAS JL, BARON C, DESCAMPS P, FANELLO S.Impact des séances d'éducation sexuelle et affective dans les collèges. Education et Société :2010 : sous presse.[34] THONGSAVANE J. La vaccination anti-papillomavirus humain : une opportunité pouraméliorer la prise en charge globale des adolescentes. Paris : Université Paris V Descartes,2010http://www.medecine.univ-paris5.fr/<strong>IMG</strong>/pdf/Thongsavane2010.pdf[35] ZACHARIE G. Les sources d’information thérapeutique en médecine générale, enquêteauprès des MG du département de la Drôme. Thèse de doctorat en médecine : Université deLyon, 200730
ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIENI. Parcours professionnelDepuis quand êtes vous installé comme médecin Généraliste ?Avez vous exercé auparavant ? Dans quelles conditions ?Qu’est ce qui a motivé le choix des études en médecine ?La médecine générale est-elle un choix pour vous ?Exercez-vous seul ou en groupe ?La région dans laquelle vous exercez est plutôt rurale, urbaine ?Depuis votre installation avez-vous suivi des formations ? Lesquelles ?II.Pratiques professionnellesQuel est votre rythme de travail ? (Nombre de jours travaillés ? Horaires ?)Pouvez-vous raconter une journée type ?Comment se déroule une consultation ?Y’a-t-il des types de patients qui sont difficiles pour vous?Au contraire y’a-t-il des types de patients avec lesquels vous êtes plus à l’aise ?Quels types d’activités préférez-vous ? Quels types d’actes ?Y’a-t-il des actes que vous n’aimez pas réaliser ? Des actes que vous appréhendez ?III.Pratiques de vaccination1- Quelles sont vos pratiques professionnelles en ce qui concerne lavaccination en générale ?Avez-vous une organisation du suivi pour chaque patient ?Y’a-t-il des vaccins qui suscitent des discussions, voire même des négociations avec lespatients ?2- Et en ce qui concerne la vaccination anti-papillomavirus en particulier ?Qu’en pensez-vous à titre personnel ?Comment l’abordez-vous ? Est-ce que vous en parlez spontanément en consultation ?Proposez-vous à chaque jeune fille « en âge d’être vaccinée » le vaccin de façonsystématique ? ou au contraire n’en parlez-vous que si le patient l’aborde en premier ?Dans quelles types de consultations le sujet est-il abordé ?Quelles informations donnez-vous à la jeune fille ou à ses parents ? Comment lui expliquezvousle bénéfice/risque de cette vaccination ?Quelles informations/formations avez-vous reçues ou êtes-vous allé chercher ?Pensez-vous avoir été bien informé à propos de cette vaccination ?Demandez-vous explicitement à la jeune fille si elle a déjà eu des rapports sexuels avant de luiprescrire le vaccin ?Qu’en pensez-vous en terme de santé publique au niveau de la prévention globale du cancerdu col de l’utérus ?Auriez-vous des propositions à faire, au regard de votre expérience, de votre réflexionpersonnelle pour améliorer cette prévention ?31
ANNEXE 2 : GRILLE D’ANALYSEIdentifiants sociauxPraticien Age Sexe StatutmatrimonialProfessiondesparentsDrNombred’enfantsPraticienDrMotivationchoix desétudesmédecineMotivationchoix desétudesmédecinegénéraleNombreannéed’exerciceIdentifiant sociaux liés à la professionLieu Mode Organisation dud’exercice d’exercice travailActivitésplaisantesActivitésdéplaisantesType deFMCIdentifiants sociaux liés à la vaccinationPraticien Intérêt Suivi des patients Organisation Vaccin et débatDrPraticienDrSur sapratiqueengénéraleSurleFCVSon avisglobal surlavaccinationanti-HPVSur letyped’infos surle vaccin :laboratoireSur letyped’infossur levaccin :presseSur letyped’infossur levaccin :avisexpertsSur letyped’infossur levaccin :HASSur saformationsur levaccin« penset-ilavoirété bieninformé »Sur quiaborde lavaccinationanti-HPVlors de laconsultationDiscoursSur quand estabordée cettevaccination :type deconsultation ?Sur lesinformationsdonnées lorsde laconsultationSur lesinformationsrecherchéeslors de laconsultationSur lequestionnementpersonnel faceà ce vaccinSur lavaccinationde lapopulationcibleSur sesréflexionsen termesde santépubliqueSur sespropositionspouraméliorer lapréventionCCU32
<strong>PLESSIS</strong> <strong>Anne</strong>Les médecins généralistes (MG) et la vaccination anti-papillomavirusRÉSUMÉLa vaccination anti-HPV est remboursée en France, pour une population ciblée, depuis juillet 2007.Elle soulève des interrogations qui dépassent les frontières de l’hexagone. Nous avons exploré lesmodalités de prescription de cette vaccination auprès des médecins généralistes (MG) au décoursd’entretiens semi-directifs. Notre échantillon est formé sur des réseaux humains de type «interconnaissances professionnelles ». Tous les entretiens se sont déroulés entre décembre 2008 etmars 2009.Les demandes de contraception et les examens de prévention sont les consultations où lavaccination est le plus souvent abordée. En dehors de la population cible concernée, les MG donnentl’information à une population constituée des mères et jeunes filles de moins de 14 ans. Ils insistent surl’importance du suivi. La tendance dominante des médecins rencontrés est de prescrire la vaccinationanti-HPV. L’amélioration de la prévention globale du cancer du col de l’utérus (CCU) passe, pour les MG,par trois axes que sont l’amélioration de l’information, la promotion des frottis cervico-vaginaux etl’éducation à la sexualité.Les pratiques de cette vaccination sont multiples. De nombreuses variables interviennent dans leprocessus de décision, à savoir le prix du vaccin, son mode de remboursement, ainsi que la publicité faiteautour de ce dernier.Cette vaccination est légitime aux yeux des MG. Elle peut revêtir un caractère médicolégal, maisprésente des incertitudes. Si le message de santé publique est parfois critiqué, les MG se sententimpliqués dans la prévention globale du CCU, et estiment que cette vaccination représente uneopportunité d’éducation à la sexualité des jeunes filles.Médecine généraleFrottis cervico-vaginalMOTS-CLÉSVaccination anti-papillomavirusPréventionFORMATMémoireArticle 1 : à soumettre soumis accepté pour publication publiésuivi par : Professeur Serge Fanello, Président du jury1 statut au moment de la soutenance34