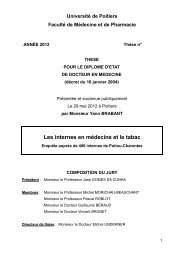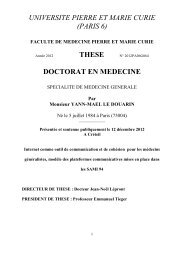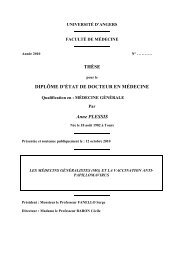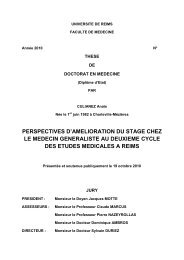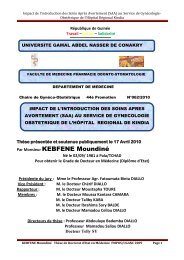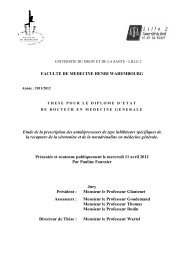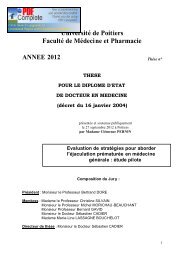Claire BEDOUET - Thèse IMG
Claire BEDOUET - Thèse IMG
Claire BEDOUET - Thèse IMG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITE D’ANGERSFACULTE DE MEDECINEAnnée 2012N°...........THESEpour leDIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINEQualification en : MEDECINE GENERALEPar<strong>Claire</strong> <strong>BEDOUET</strong>Née le 03/11/1983 à MayennePrésentée et soutenue publiquement le : 01 Mars 2012RECUEIL DE DONNEES SUR LES LOMBALGIES PAR LES MAITRES DESTAGE UNIVERSITAIRES DE MEDECINE GENERALE : ANALYSE DE LAMISE EN PLACEPrésident : Monsieur le Professeur HUEZ Jean-FrançoisDirecteur : Madame le Docteur
UNIVERSITE D’ANGERSFACULTE DE MEDECINEAnnée 2012N°...........THESEpour leDIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINEQualification en : MEDECINE GENERALEPar<strong>Claire</strong> <strong>BEDOUET</strong>Née le 03/11/1983 à MayennePrésentée et soutenue publiquement le : 01 Mars 2012RECUEIL DE DONNEES SUR LES LOMBALGIES PAR LES MAITRES DESTAGE UNIVERSITAIRES DE MEDECINE GENERALE : ANALYSE DE LAMISE EN PLACEPrésident : Monsieur le Professeur HUEZ Jean-FrançoisDirecteur : Madame le Docteur BOUTON Céline
LISTE DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DEMÉDECINE D’ANGERSDoyenVice doyen rechercheVice doyen pédagogiePr. RICHARDPr. BAUFRETONPr. COUTANTDoyens Honoraires : Pr. BIGORGNE, Pr. EMILE, Pr. REBEL, Pr. RENIER, Pr. SAINT-ANDRÉProfesseur Émérite : Pr. GUYProfesseurs Honoraires : Pr. ACHARD, Pr. ALLAIN, Pr. ALQUIER, Pr. BIGORGNE, Pr. BOASSON, Pr. BREGEON,Pr. CARBONNELLE, Pr. CARON-POITREAU, Pr. M. CAVELLAT, Pr. COUPRIS, Pr. DAUVER, Pr. DELHUMEAU,Pr. DENIS, Pr. EMILE, Pr. FOURNIÉ, Pr. FRANÇOIS, Pr. FRESSINAUD, Pr. GESLIN, Pr. GROSIEUX, Pr. GUY,Pr. HUREZ, Pr. JALLET, Pr. LARGET-PIET, Pr. LARRA, Pr. LIMAL, Pr. MARCAIS, Pr. PENNEAU, Pr. PIDHORZ,Pr. POUPLARD, Pr. REBEL, Pr. RENIER, Pr. RONCERAY, Pr. SIMARD, Pr. SORET, Pr. TADEI, Pr. TRUELLE,Pr. TUCHAIS, Pr. WARTELPROFESSEURS DES UNIVERSITÉSMM ABRAHAM Pierre PhysiologieARNAUD Jean-PierreASFAR PierreAUBÉ ChristopheAUDRAN MauriceAZZOUZI Abdel-RahmèneMmes BARON CélineBARTHELAIX AnnickChirurgie généraleRéanimation médicaleRadiologie et imagerie médicaleRhumatologieUrologieMédecine générale (professeur associé)Biologie cellulaireMM BASLÉ Michel Cytologie et histologieBATAILLE François-RégisBAUFRETON ChristopheBEAUCHET OlivierBEYDON LaurentBIZOT PascalBONNEAU DominiqueBOUCHARA Jean-PhilippeBOYER JeanCALÈS PaulCAROLI-BOSC François-XavierCHABASSE DominiqueCHAPPARD DanielCOUTANT RégisCOUTURIER OlivierDARSONVAL Vincentde BRUX Jean-LouisDESCAMPS PhilippeDIQUET BertrandDUBAS FrédéricDUBIN JacquesDUVERGER PhilippeENON BernardFANELLO SergeHématologie ; TransfusionChirurgie thoracique et cardiovasculaireMédecine interne, gériatrie et biologie du vieillissementAnesthésiologie et réanimation chirurgicaleChirurgie orthopédique et traumatologiqueGénétiqueParasitologie et mycologieGastroentérologie ; hépatologieGastroentérologie ; hépatologieGastroentérologie ; hépatologieParasitologie et mycologieCytologie et histologiePédiatrieBiophysique et Médecine nucléaireChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologieChirurgie thoracique et cardiovasculaireGynécologie-obstétrique ; gynécologie médicalePharmacologie fondamentale ; pharmacologie cliniqueNeurologieOto-rhino-laryngologiePédopsychiatrieChirurgie vasculaire ; médecine vasculaireÉpidémiologie, économie de la santé et prévention
MM FOURNIER Henri-Dominique AnatomieFURBER AlainCardiologieGAGNADOUX FrédéricPneumologieGARNIER FrançoisMédecine générale (professeur associé)GARRÉ Jean-BernardPsychiatrie d’adultesGINIÈS Jean-LouisPédiatrieGRANRY Jean-ClaudeAnesthésiologie et réanimation chirurgicaleHAMY AntoineChirurgie généraleHUEZ Jean-FrançoisMédecine généraleMme HUNAULT-BERGER Mathilde Hématologie ; transfusionM. IFRAH Norbert Hématologie ; transfusionMmes JEANNIN PascaleImmunologieJOLY-GUILLOU Marie-Laure Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreMM LACCOURREYE Laurent Oto-rhino-laryngologieLAUMONIER FrédéricChirurgie infantileLE JEUNE Jean-JacquesBiophysique et médecine nucléaireLEFTHÉRIOTIS GeorgesPhysiologieLEGRAND ErickRhumatologieLEROLLE NicolasRéanimation médicaleMme LUNEL-FABIANI Françoise Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreMM MALTHIÉRY Yves Biochimie et biologie moléculaireMARTIN LudovicDermato-vénéréologieMENEI PhilippeNeurochirurgieMERCAT AlainRéanimation médicaleMERCIER PhilippeAnatomieMILEA DanOphtalmologieMme NGUYEN Sylvie PédiatrieM. PARÉ François Médecine générale (professeur associé)Mme PENNEAU-FONTBONNE Dominique Médecine et santé au travailMM PICHARD Eric Maladies infectieuses ; maladies tropicalesPICQUET JeanChirurgie vasculaire ; médecine vasculairePODEVIN GuillaumeChirurgie infantilePROCACCIO VincentGénétiquePRUNIER FabriceCardiologieRACINEUX Jean-LouisPneumologieREYNIER PascalBiochimie et biologie moléculaireMme RICHARD Isabelle Médecine physique et de réadaptationMM RODIEN Patrice Endocrinologie et maladies métaboliquesROHMER VincentEndocrinologie et maladies métaboliquesROQUELAURE YvesMédecine et santé au travailMmes ROUGÉ-MAILLART ClotildeMédecine légale et droit de la santéROUSSELET Marie-Christine Anatomie et cytologie pathologiquesMM ROY Pierre-Marie Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologieSAINT-ANDRÉ Jean-PaulAnatomie et cytologie pathologiquesSENTILHES LoïcGynécologie-obstétriqueSUBRA Jean-FrançoisNéphrologieURBAN ThierryPneumologieVERRET Jean-LucDermato-vénéréologie
MM VERNY Christophe NeurologieWILLOTEAUX SergeZANDECKI MarcMAÎTRES DE CONFÉRENCESRadiologie et imagerie médicaleHématologie ; transfusionM. ANNAIX Claude Biophysique et médecine nucléaireMmes BEAUVILLAIN CélineBELIZNA CristinaBLANCHET OdileImmunologieMédecine interne, gériatrie et biologie du vieillissementHématologie ; transfusionM. BOURSIER Jérôme Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologieMme BOUTON Céline Médecine générale (maître de conférences associé)MM BOUYE Philippe PhysiologieCAILLIEZ ÉricCAPITAIN OlivierCHEVAILLER AlainMédecine générale (maître de conférences associé)Cancérologie ; radiothérapieImmunologieMme CHEVALIER Sylvie Biologie cellulaireMM CRONIER Patrick AnatomieCUSTAUD Marc-AntoinePhysiologieMme DUCANCELLE Alexandra Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalièreMM DUCLUZEAU Pierre-Henri NutritionEVEILLARD MatthieuFORTRAT Jacques-OlivierGALLOIS YvesHINDRE FrançoisJEANGUILLAUME ChristianBactériologie-virologie ; hygiène hospitalièrePhysiologieBiochimie et biologie moléculaireBiophysique et médecine nucléaireBiophysique et médecine nucléaireMme JOUSSET-THULLIER Nathalie Médecine légale et droit de la santéM. LETOURNEL Franck Biologie cellulaireMmes LIBOUBAN HélèneLOISEAU-MAINGOT DominiqueMAY-PANLOUP PascaleMESLIER NicoleBiologie cellulaireBiochimie et biologie moléculaireBiologie et médecine du développement et de lareproductionPhysiologieMM MOUILLIE Jean-Marc PhilosophieNICOLAS GuillaumePAPON XavierMmes PASCO-PAPON AnnePELLIER IsabellePENCHAUD Anne-LaurenceNeurologieAnatomieRadiologie et Imagerie médicalePédiatrieSociologieM. PIHET Marc Parasitologie et mycologieMme PRUNIER Delphine Biochimie et biologie moléculaireM. PUISSANT Hugues GénétiqueMmes ROUSSEAU AudreySAVAGNER FrédériqueAnatomie et cytologie pathologiquesBiochimie et biologie moléculaireMM SIMARD Gilles Biochimie et biologie moléculaireTURCANT AlainPharmacologie fondamentale ; pharmacologie cliniquejanvier 2012
Président du jury :COMPOSITION DU JURYMonsieur le Professeur HUEZ Jean-FrançoisDirecteur de thèse :Madame le Docteur BOUTON CélineMembres du jury :Madame le Professeur Richard IsabelleMadame le Docteur Ramond-Roquin AlineMadame le Docteur Petit-Lemach AudreyMonsieur le Docteur Marais Patrick
- 6 -REMERCIEMENTSA Mr le Professeur Huez : Je le remercie de l’honneur qu’il me fait en acceptant laprésidence de cette thèse. Qu’il veuille bien me permettre de lui exprimer toute mareconnaissance et mon profond respect.A Melle le Dr Bouton Céline : qui s’est proposée pour me diriger dans la réalisationde cette thèse. Merci pour tout le temps passé ces derniers mois, pour m’avoir soutenu toutau long de ce travail et m’avoir fait des remarques constructives.A Mme le Professeur Richard Isabelle : en tant que membres du jury, merci d’avoiraccepté d’évaluer le contenu de ma thèse.A Mr le Dr Marais, Mmmes les Dr Petit-Lemach et Ramond-Roquin qui m'ontfait l'honneur de participer au Jury de soutenance; je les en remercie profondément.A tous les médecins généralistes, internes et externes qui ont participé à l’enquêtePrélomb et sans qui ce travail n’aurait pu être réalisé: qu’ils soient assurés de mes sincèresremerciements.Aux autres thésards (notamment Hugues Terrien) qui m’ont apporté une grande aide etde précieux conseils.
- 7 -LISTE DES ABREVIATIONSDMG : Département de médecine généraleDUKE : Duke Health ProfileEIFEL : Echelle d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgiquesLEEST : Laboratoire d' Epidémiologie Ergonomie et Santé du TravailMDS : Maitre de stage AmbulatoireSASPAS : Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé
- 8 -PLANINTRODUCTION ........................................................................................................................................ 9MATERIEL ET METHODES ..................................................................................................... 11I. ETUDE PRELOMB ............................................................................................................................... 11II. EVALUATION DE LA FAISABILITE DE PRELOMB .................................................................................. 12RESULTATS ................................................................................................................................. 14I. CONTRAINTES MATERIELLES : ........................................................................................................... 14II. INCLUSION DES PATIENTS : ............................................................................................................... 151. Nombres de fiches remplies ................................................................................................................ 152. Oublis d’inclusion des patients ............................................................................................................ 163. Recrutement des patients lombalgiques ............................................................................................. 17III. INTERÊTS ET IMPLICATIONS ........................................................................................................... 17IV. AUTO-QUESTIONNAIRES : ............................................................................................................. 19V. CONSULTATIONS DE SUIVI ................................................................................................................ 191. Peu de patients revus .......................................................................................................................... 192. Suivi par différents médecins .............................................................................................................. 19VI. PARTICIPATION A LA RECHERCHE .................................................................................................. 19VII. ROLE DE L’ETUDIANT ..................................................................................................................... 20VIII. RELATIONS AVEC LE PROMOTEUR ................................................................................................. 21DISCUSSION ................................................................................................................................ 22CONCLUSION ............................................................................................................................... 25REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..................................................................................... 26LISTE DES FIGURES .................................................................................................................. 28LISTE DES TABLEAUX .............................................................................................................. 28TABLE DES MATIERES ............................................................................................................. 29ANNEXE 1: FICHE DE RECUEIL ...................................................................................... 30ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE A MI-PARCOURS INTERNES/ EXTERNES (B) ...................... 32ANNEXE 3: REUNION A MI-PARCOURS DE L’ENQUETE PRELOMB (C) ............................ 33ANNEXE 4: QUESTIONNAIRE FIN D’ENQUETE PRELOMB (D) ......................................... 35ANNEXE 5: ENTRETIENS TELEPHONIQUES (E) ............................................................... 37ANNEXE 6: LISTE DES MEDECINS AYANT PARTICIPE A PRELOMB .................................. 41
- 9 -INTRODUCTIONConcernant la problématique de la lombalgie, les données disponibles et lesrecommandations pour la pratique clinique sont partielles et peu adaptées (1,2). Lespraticiens se sentent souvent désemparés face à la prise en charge multidisciplinaire decette pathologie qui est pourtant fréquente dans la population générale (3) : 70 % de lapopulation en âge de travailler souffre ou a déjà souffert du dos. Et on sait que 5 à 10 %des lombalgies aigües vont devenir chroniques, c’est-à dire durer plus de 3 mois (4). Lalombalgie génère donc des coûts importants, dus à sa prise en charge directe(consommation de soins, examens complémentaires, séances de kinésithérapie.. .) et dusaux indemnités journalières des arrêts de travail (coût indirect) : C’est une prioritésocioéconomique (5). Les facteurs influençant l’évolution dans le temps de la lombalgiesont de natures très diverses, et imparfaitement connus (6,7). Dans ce contexte, leDépartement de médecine générale (DMG), en association avec le Laboratoired'Epidémiologie Ergonomie et Santé du Travail (LEEST) de l’Université d'Angers, ontchoisi d’explorer les déterminants précoces du passage à la chronicité des patientslombalgiques. Au préalable, il a paru nécessaire de déterminer la fréquence desconsultations pour lombalgie en médecine générale, et le nombre de patients quideviennent chroniques parmi celles-ci. Les données actuelles de la recherche en soinsprimaires sur ces questions épidémiologiques sont encore très parcellaires. Pourtant lerecueil de ce type de données permettra de planifier les études futures, et d’estimer laquantité de sujets à inclure pour d’éventuelles études d’intervention. Un moyen derecueillir ce type de données est de créer un observatoire en médecine générale.En France, différents observatoires sont déjà actifs (8). Mais, la plupart sont de petitetaille et il existe de nombreux obstacles à leur mise en place. D’après plusieurs enquêtesdéclaratives (9-11), les médecins généralistes sont prêts à s’impliquer sur des thèmes derecherche en rapport avec leur pratique clinique quotidienne. Ils ont envie d’améliorer laqualité de leurs soins en se basant sur des données solides (12). Mais, lors de leurparticipation aux études, le sentiment de n’être que des «collecteurs de données»prédomine alors que ces médecins souhaiteraient être intégrés dans tout le processus derecherche. Ils déplorent le manque de supports personnalisés et l’absence de véritablepartenariat avec les promoteurs. Les principaux freins à la participation à la surveillancesanitaire repérés par l’enquête Merveille (13) sont un manque de temps, une absence derémunération et une méconnaissance des réseaux. Les médecins généralistes exprimentl’intérêt d’avoir un retour sur les résultats des études (14). Ils craignent aussi une surcharge
- 10 -administrative et un engagement trop long (10). Une garantie sur la confidentialité(notamment par la sécurité informatique), une simplicité de recueil et un référent solide etdisponible semblent être les principaux critères de motivation à la participation à larecherche (15).Plusieurs études évoquaient que les médecins enseignants participaient plus à larecherche (16) et qu’il y avait un intérêt à impliquer les étudiants dans leurs travaux (17).Une des hypothèses locales pour la création d’un observatoire est basée sur cette actionprobablement facilitatrice des étudiants en stage. En effet, ils pourraient être une aideprécieuse au recueil et à la participation de leurs maitres de stage dans un réseau derecherche. Les étudiants pourraient servir d’interface entre les médecins et le DMGinvestigateur et faciliter leur interaction.Une première enquête sur les motivations des maitres de stage de médecine généralede la faculté d’Angers à participer à la recherche a été réalisée en 2009 (8). Les résultatsencourageants ont permis la mise en place expérimentale en 2010 d’un premierobservatoire à partir du réseau de maitres de stage (ECA) rattachés au DMG afin derecueillir un nombre important de données sur les patients lombalgiques.PRELOMB était une étude préliminaire réalisée du 15 novembre 2010 au 15 Mai2011. Son objectif scientifique était d’établir le profil des patients adultes consultant pourlombalgie en médecine générale. Son objectif opérationnel était d’explorer les difficultés etles avantages d’un observatoire reposant sur les maitres de stage universitaires et d’évaluerl’apport des étudiants en médecine, notamment pour atteindre une meilleure exhaustivité.Seul le 2 nd objectif est développé dans cette thèse. Le 1 er objectif fait l’objet d’unethèse menée par Camille Martin : « profil des adultes consultant pour lombalgiecommune : étude observationnelle basée sur l’activité de 35 médecins généralistes».
- 11 -MATERIEL ET METHODESI. ETUDE PRELOMBElle s’est déroulée sur 6 mois du 15 Novembre 2010 au 14 Mai 2011. Le but de cetteétude était d’évaluer le nombre de patients consultants pour un épisode de lombalgie dansl’activité quotidienne des médecins généralistes maitres de stage. Des donnéessociodémographiques et professionnelles étaient également recueillies pour chaque patient,ainsi que le nombre de consultations pour lombalgie pendant le reste de l’étude.Critères d’inclusion : patients âgés de 18 à 65 ans dont le motif principal deconsultation était une plainte lombalgique (douleur située entre la 12 ème vertèbre thoraciqueet le haut du pli interfessier).Les critères d’exclusion des patients étaient une lombalgie spécifique avérée(tumorale, inflammatoire, infectieuse, fracturaire), une lombosciatique associée à un déficitneurologique moteur ou à un syndrome de la queue de cheval, une grossesse, uneimpossibilité de donner son consentement ou de participer à l’étude (incapables majeurs,troubles psychiatriques importants, personnes ne maitrisant pas suffisamment la languefrançaise).Les 35 médecins généralistes participants étaient tous volontaires et répartis sur lesdépartements du Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Ils étaient maitres de stagesou enseignants du département de médecine générale d’Angers et tous leurs étudiants ontété sollicités : 14 internes sur 19 en SASPAS (Stage Autonome en Soins PrimairesAmbulatoire Supervisé), 6 internes en stage chez le praticien 1 er niveau (sur 36 en stage), 3externes (sur 35 en stage, changeant toutes les 9 semaines). Soit au total 23 étudiantsimpliqués à chaque moment. Les internes en SASPAS étaient régulièrement stimulés parles promoteurs lors de leurs séances de formation bimensuelles. Les externes et les internesen stage chez le praticien ont eu des rappels au début et au milieu de leur stage.Le matériel a été transmis directement par les étudiants. Chaque médecin a reçu unclasseur contenant 30 fiches de recueil (cf annexe 1) et 30 fiches d’information destinéesaux patients. Dans un second temps (à partir de mi-février 2011), des auto-questionnairespatients, utilisant les échelles de EIFEL (Echelle d’incapacité fonctionnelle pourl’évaluation des lombalgiques) et DUKE (Duke Health Profile) leur ont été distribués afind’explorer l’incapacité et la qualité de vie de leurs patients lombalgiques.Sur les fiches de recueil (cf annexe 1), l’investigateur (maitre de stage, interne ouexterne) remplissait les données administratives et socio-démographiques (date de
- 12 -consultations, nom du médecin, initiales et dates de naissance du patient) en questionnantdirectement le patient atteint d’une lombalgie commune. Il décrivait l’épisode actuel, lesantécédents de lombalgie du patient et les données professionnelles (arrêt de travail, statutprofessionnel) de manière qualitative (en classes). Pour les patients revus lors desconsultations ultérieures à la consultation d’inclusion, le médecin ou son étudiant précisaitla durée d’arrêt de travail et notait d’éventuels commentaires libres.II.EVALUATION DE LA FAISABILITE DE PRELOMBPour évaluer la mise en place expérimentale de l’observatoire, différents outils ontété créés et utilisés :-Un questionnaire à mi-parcours (A, cf annexe 2) a été remis à l’ensemble des internesparticipants à l’étude Prélomb, soit lors des réunions à la faculté de médecine d’Angers,soit par email. Ce questionnaire était composé de 5 questions ouvertes et de 6 questionsfermées. Il portait sur l’inclusion des patients, sur les contraintes rencontrées auremplissage du questionnaire prélomb et sur le ressenti des internes vis-à-vis de l’étude.- Un recueil qualitatif lors d’une première réunion à mi-parcours (B) a été réalisé. Cellecia eu lieu le 17 Février 2011 et était proposée à tous les médecins et étudiants participantà Prélomb. Le recueil a été fondé sur une observation et sur des prises de notes. Cetteréunion avait pour but de faire un premier état des lieux du vécu des médecins. Lesrésultats du questionnaire à mi-parcours des internes et les auto-questionnaires patient leursont été donnés.- Un questionnaire à mi-parcours (C,cf annexe 3) a été distribué à l’ensemble des maîtresde stage participants. Il portait sur la qualité de la transmission du matériel de l’étude, surl’inclusion des patients, sur les contraintes rencontrées au remplissage des fiches Prélombet sur leur vécu. Les médecins ne répondant pas spontanément ont eu des relancesinformatiques.- Un questionnaire de fin d’étude destiné aux internes (D, cf annexe 4) a évalué leurintérêt et leur implication vis-à-vis de Prélomb. Les difficultés rencontrées et lespropositions d’amélioration de l’observatoire ont également été recueillies. Il a été
- 13 -distribué à la fin du semestre d’hiver 2011 (en Avril 2011) lors des réunions de formationsd’internes ou par email pour les internes absents.- Des entretiens téléphoniques semi-directifs (E, cf annexe 5) ont été passés à 9 médecinsà la fin de l’étude prélomb (en Juin 2011), afin d’explorer leur sentiment général. 4médecins ayant rempli plus de 20 fiches, 2 médecins ayant rempli 15 fiches et 3 médecinsayant rempli moins de 10 fiches ont été sélectionnés. Ces entretiens visaient à explorer laforme de l’étude (organisation, perception de la communication, charge de travail,questionnaire, image du promoteur, …) ainsi que le fond (compréhension de la méthode,intérêt pour le sujet,…).- Des entretiens téléphoniques avec les externes (E) ont été réalisés au cours de l’étudePrélomb afin de connaître leur implication dans l’étude.- Une analyse rétrospective (F) du nombre de fiches d’inclusion, des auto-questionnaireset des erreurs de remplissage des questionnaires de l’étude PRELOMB a également étéaccomplie.Les données issues des enquêtes quantitatives (réponses aux questionnaires, nombrede questionnaire mal remplis, autoquestionnaires non distribués, ….) ont été saisies ettraitées dans un fichier excel (version 2007).
- 14 -RESULTATSLes résultats sont présentés à partir des 6 sources de données d’évaluation ci-dessous :Tableau I : outils d’évaluation de l’observatoireNombres de réponsesA Questionnaire à mi-parcours, étudiants 18 internes sur 20B Recueil qualitatif de la réunion du 17.02.201110 médecins sur 353 étudiants sur 231 externe sur 4C Questionnaire à mi-parcours, maitres de stage 32 médecins sur 35D Questionnaire de fin d’étude, internes 19 internes sur 20EFEntretiens téléphoniques semi-directifsAnalyse rétrospective des questionnaires9 médecins3 externes471 fiches analysées124 Auto-questionnairesI. CONTRAINTES MATERIELLES :Tableau II : réponses sur les contraintes matérielles (A+C)Médecins (C)Etudiants (A)Bonne transmission du matériel(avant le 15/11/2010)28/32 Non demandéBonne fonctionnalité du matériel 30/32 17/19Temps de remplissage du questionnaire correct 30/32 17/17Explications complémentaires 2/32 1/19Durée de participation satisfaisante 25/29 Non demandéPerturbation de la consultation ou de la relationmédecin/malade1/32 2/19Un interne a gardé le classeur avec lui pendant toute la durée de l’étude et unmédecin a reçu son matériel après le 15/11/2010 (E).Certains ont proposé d’informatiser l’étude (B+D+E) et de mettre un pense-bête ouune alarme dans leur ordinateur (B+D). Un médecin a évoqué que « le classeur prenait tropde place» et un autre «qu’il était difficile de le retrouver pendant les consultations» (B).
- 15 -L’«explication au patient était trop longue par rapport au contenu du questionnaire»pour un des investigateurs. Un médecin a affirmé «qu’il était assez enthousiaste car ça lui apris peu de temps» (E).La durée de l’enquête était trop longue pour un des maître de stage, mais un autrenous a déclaré qu’elle était «trop courte pour mettre des choses en évidence» (E) : «Je suisprêt à poursuivre ma participation aux projets du DMG, mais il ne faut vraiment pas que çadure plus longtemps que cette étude Prélomb» (E).Lors de la réunion (B), l’un des médecins nous expliquait qu’il était parfois difficilede prendre le rôle d’investigateur pour l’étude : «Parfois, on n’a pas envie de faire l’étudeen raison du contexte de consultation et du profil psychologique particulier du patient qui abesoin de parler et d’avoir le soutien du médecin».II. INCLUSION DES PATIENTS :1. Nombres de fiches rempliesTableau III : nombres de fiches recueilliesmédecins internes externes autres TOTALFiches recueillies 329 (69%) 123 (26%) 3 16 47116 fiches n’ont pas été rentrées dans la base de données en raison de mauvais critèresd’inclusion (erreur d’âge, irradiation, …) et de questionnaires incorrectement remplis.A mi-parcours, 16 médecins disaient avoir rempli plus de 10 fiches et 13 médecinsdisaient en avoir rempli moins (moyenne des fiches=11,41) (C). Au final, 15 fiches ont étéremplies par classeur en moyenne (avec un maximum de 30 fiches remplies et unminimum de 3). 3 médecins n’ont rempli aucune fiche par eux-même.
- 16 -2. Oublis d’inclusion des patientsTableau IV : Oublis d’inclusion des patients (D)Oublis d’inclusion des patients/ 19 internesoubli de l’étude 10manque de temps 8difficultés techniques (accessibilité du classeur...) 2perturbation de la consultation et de la relationmédecin/patient2manque d’intérêt pour l’enquête 0absence de valorisation du travail demandé 0Tous les médecins interrogés par téléphone ayant rempli moins de 10 fichespensaient qu’ils avaient inclus peu de patients et ceux ayant rempli plus de 20 fiches ontestimé en avoir inclus beaucoup (E).Les investigateurs nous ont souvent fait remarquer qu’ils avaient oublié desinclusions (D, E) : à mi-parcours, 72 % des internes (A) et 84 % des maitres de stage (C)pensaient avoir oublié d’inclure des patients.Le manque de temps était l’une des principales raisons évoquées aux oublis (D). Undes médecins révélait qu’«il aurait pu en faire plus, mais qu’il manquait de temps» (E) etun interne répondait que «sa participation pouvait améliorer l’enquête en raison d’une plusgrande disponibilité et qu’il avait beaucoup moins d’administratif que son maître destage» (A).La période hivernale était considérée comme «une période épidémique où on avaitplus de travail et donc moins de temps» (A). 8 internes sur 19 ont estimé que la périodehivernale était peu propice au recrutement (D). De même, l’un des médecins nous a révéléque sur le semestre d’été, il voyait plus de patients lombalgiques (activités de bricolage,jardinage…) et qu’il n’avait pas toujours le temps de remplir le questionnaire pendant lapériode hivernale où l’activité était intense (E). «Il y a moins de patients incluables enhiver en raison d’une plus forte activité dans les cabinets médicaux et d’une plus forteprévalence des pathologies infectieuses» (A,B).Le manque d’attention était aussi décrit: «Le plus difficile c’est d’y penser, deprendre l’habitude, je n’y pensais qu’au moment du départ du patient» (E), «Il ne faut pasrester concentré uniquement sur la consultation afin de garder à l’esprit l’étude» (E).«J’aioublié d’inclure des patients parce que j’ai tout simplement oublié l’étude!» (A)«Le surmenage» était à l’origine d’oublis chez un des médecins (C). Deux autresnous ont dit «avoir oublié le classeur dans un coin du cabinet» (A+B).
- 17 -3. Recrutement des patients lombalgiquesTableau V : Difficultés rencontrées (questionnaires C et D)internes/19 Médecins/32critères d'inclusion trop sélectifs 7peu de patients lombalgiques rencontrés 6manque de sollicitations 5Difficultés à obtenir le consentement 0 3Participation stable au fil des mois 10Sur aucune des fiches, la case «refus de participation des patients à l’enquête» n’a étécochée (F).Les médecins décrivaient que «la lombalgie n’était souvent pas le principal motif dela consultation» (A, B, C, E) et un interne nous faisait remarquer que «les patients nevenaient souvent pas que pour ça». De plus, «la lombalgie est une pathologie visiblementpas si fréquente que ça» (B) et «finalement, on ne voit pas autant de patients lombalgiquesque ce que je pensais» (E).III.INTERÊTS ET IMPLICATIONSFigure 1 : Intérêts et implications des étudiants (D)Cette étude correspondait à l’attente de 75 % des médecins (C). Les externes ontrépondu qu’ils étaient peu impliqués: «je n’ai rempli aucune fiche tout seul», «je n’étaismême pas au courant de l’enquête», «j’ai quand même rempli 2 fiches avec mon maître destage», «je lui ai fait des rappels de temps en temps» (E).Quelques remarques d’internes montraient qu’ils avaient vécu l’étude comme «peucontraignante et simple de réalisation» (A+D). Un l’a trouvée peu passionnante (A) et undes médecins regrettait que cette étude soit assez simple et ne soit qu’un travail« préliminaire » à une étude interventionnelle ultérieure, déjà annoncée par lespromoteurs(E).
- 18 -Tableau VI : Réponses des internes sur leur ressenti de l’étude (D)Réponses internes/ 19 réponsesparticiper à ce type d’étude fait partie de mon travail d’interne 17je suis un collecteur de données 12participer à ce type d'étude fait partie du rôle d'un médecin généraliste 12je pense qu’à l’avenir je participerai à ce type d’étude 11cette enquête m’initie au recueil de données et cela m’intéresse 8j’ai subi l’intérêt que porte mon maitre de stage à cette enquête 6j'apporte une aide au patient lombalgique 6j’ai un rôle dans la médiation entre le DMG et mon maître de stage 5j’ai eu l’impression d’encourager mon maitre de stage à remplir des fiches 4j'aide mon maitre de stage à participer à la recherche 4L’un des internes a témoigné qu’«il était bien motivé au départ, puis les épidémiessont arrivées, puis les auto-questionnaires; il y a eu un effet accumulation démotivant». Unautre a dit : «à la fin, l’interne doit reprendre tous les patients, même ceux vus par le maîtrede stage; c’est fastidieux et un peu injuste. Surtout pas très motivant» (D). Une baisse demotivation au fur et à mesure de l’étude et l’absence de rémunération étaient égalementévoquées comme un frein à la réalisation de cette étude (E).Figure 2 : Remplissage des fiches au fur et à mesure des mois (F)Dans les avantages de l’étude, on relevait qu’elle permettait d’avoir plus de suivi despatients par les étudiants (A). En commentaire libre, l’un d’eux disait que ça lui permettaitd’acquérir une plus grande sensibilité aux caractéristiques des lombalgiques (D).Trois internes déclaraient s’être impliqués dans l’étude par solidarité avec l’internequi coordonnait celle-ci.
- 19 -IV. AUTO-QUESTIONNAIRES :124 auto-questionnaires ont été récupérés sur les 206 qui auraient dû être distribués(132 auto-questionnaires ont effectivement été donnés aux patients). Six interneséprouvaient des difficultés avec les auto-questionnaires : «ils demandent trop de temps auxpatients qui sont pressés de partir: il serait plus judicieux de les remplir avec eux» (D).Lors des entretiens (E), 3 médecins révélaient que les auto-questionnaires étaientintervenus trop tardivement: «les auto-questionnaires se sont surajoutés, ce qui a alourdiles choses». Le médecin ayant rempli le plus de fiches, n’a rempli aucun autoquestionnaire(F).V. CONSULTATIONS DE SUIVI1. Peu de patients revus« Les patients sont perdus de vue après la première consultation » (B) : 11 internessur 19 ont évoqué que leur principale difficulté était de ne pas revoir les patients (D).Après leur inclusion dans l’étude, 147 patients ont eu au moins une consultation de suiviremplie par les médecins (sur 471 fiches, F). Un des médecins trouvait que l’étude avait ététrop courte et qu’il n’avait donc pas pu revoir les patients (E). Un autre avait du mal àpenser à renoter dans le classeur lors des consultations suivantes (E).2. Suivi par différents médecinsLe classeur unique au sein des cabinets posait problème pour les patients vus pardifférents médecins (B) : «le médecin qui voit le patient n’a pas forcément le classeur à sadisposition et ça complique le recueil». 8 internes sur 19 ont rencontré des difficultés avecces patients suivis par différents investigateurs (D).VI.PARTICIPATION A LA RECHERCHE«L’avantage de cette étude, c’est qu’elle impliquait les internes dans la recherche enmédecine générale» (A, E, tableau IV). Tous les médecins interrogés par téléphone ontdéclaré qu’ils poursuivraient leur investissement dans les projets de recherche duDMG (E). 2 d’entre-eux ont évoqué leurs difficultés lors de sollicitations multiples surdifférentes études (B, E).
- 20 -VII.ROLE DE L’ETUDIANTA mi-parcours, 18 médecins ont estimé qu’un quart ou moins des fiches avaient étéremplies par leur étudiant (C). Certains ont considéré qu’ils n’avaient «rien apporté deplus», voir les avait plutôt freinés : «on ne sait pas qui a été inclus par l’interne…»,« l’interne était peu présent (1 fois/semaine) et il incluait donc peu de patients » (A, B),« mon interne n’a pas beaucoup rempli de fiches, et il ne m’a pas fait de rappels» (E)…Alors que d’autres ont estimé qu’ils les avaient beaucoup aidé dans le recueil (E) : «laprésence de l’interne ou de l’externe au sein de cette étude permet une aide au recueil etdonc une meilleure exhaustivité». «J’ai trouvé qu’il y avait une bonne complémentarité, çan’a pas été un frein du tout» a répondu l’un des médecins dont le classeur contenait plus de20 fiches remplies. «L’étudiant contrôle et revoit les oublis» (E). «Il a plus de temps,moins d’administratif et est plus sensibilisé par le DMG» (A). «Il fait des rappels réguliersvis-à-vis de son maître de stage» (C).Lorsqu’on interrogeait les externes (E), on apprenait qu’ils n’avaient été confrontés enmoyenne qu’à 2 patients concernés par l’étude Prélomb. Le nombre de fiches remplies parles étudiants variait en fonction de leur niveau d’étude :Les 3 externes (1 MDS impliqué par externe) ont rempli 3 fiches(moyenne=1 fiche par externe, min=0, max=3).Les 6 internes en stage chez le praticien (1 MDS impliqué par interne) ontrempli 20 fiches au total, soit une moyenne de 3,33 fiches par interne(médiane=3,5, min=0, max=9).Les 14 internes en SASPAS avaient au total 22 MDS impliqués (1 à 3 parinterne) et ont rempli 103 fiches. Pour chaque MDS, ils ont rempli enmoyenne 4,7 fiches (médiane =4, min=0, max=20). A noter que l’interne deSASPAS qui a rempli le maximum de 20 fiches était en stage quasiment tousles jours de la semaine chez un des promoteurs de l’étude.Participer à ce type d’étude pourrait être un des objectifs du stage (C): «çapermettrait une discussion entre le maître de stage et son étudiant lors des supervisions eton pourrait travailler une situation clinique sur ce thème» (C). «On pourrait remplir unrécapitulatif en fin de journée du nombre de patients inclus pour y penser et coordonnernotre travail avec celui du maître de Stage » (A).Un médecin a proposé qu’un étudiant soit référent pour chaque groupe, afin qu’ilfasse le relais entre la faculté et les médecins (C).
- 21 -VIII.RELATIONS AVEC LE PROMOTEUR«C’est important d’avoir une véritable collaboration avec celui qui lance l’étude,d’avoir un lien et un contact fréquent» (E). «Il faudrait des rappels réguliers, notammentlors des réunions SASPAS à la fac afin d’avoir une plus grande implication desétudiants»(A, tableau 5). Par téléphone, 2 médecins ont déclaré qu’«il n’y avait pas euassez de relances, ce qui avait contribué à une baisse de motivation» (E) et qu’«il fallaittrouver le moyen de relancer les gens» (E). « Il faudrait peut-être transmettre des résultatsintermédiaires » (E). Un médecin a critiqué la mise en place de l’étude : «les règles du jeun’ont pas été présentées initialement. Comme si au départ on voulait nous convaincre departiciper alors qu’on a rajouté des choses après» (E). «Je pense qu’il faudrait nommer lesmédecins qui ont fait le recueil de données dans le résultat final, on a besoin d’unereconnaissance» (E).
- 22 -DISCUSSIONCe travail montre que l’observatoire en soins primaires mis en place par la facultéd’Angers autour de la thématique « lombalgie » permet de recueillir des données et demener des projets de recherche à bien. Les 471 inclusions et les 124 auto-questionnairesrecueillis sont un résultat positif et encourageant, même si les promoteurs avaient espéréinclure environ 900 patients. Le recueil de la moitié des fiches attendues semble donc unrésultat acceptable.Pour analyser la mise en place de cet observatoire, différents outils ont été utilisésnotamment des réunions et des entretiens auxquels seulement une partie des médecins aparticipé. L’analyse de données d’évaluation diverses (questionnaires, entretienstéléphoniques…) reste une des difficultés et, sans doute, un des biais de ce travail. Cesrésultats reflètent l’avis de médecins motivés par l’étude et intéressés pour nous répondre.Ceux-ci ont un lien étroit avec le DMG, ce qui a pu les influencer dans leurs réponses etinduire des avis plutôt positifs. Il existe quelques travaux concernant le déroulement d’uneétude dans les cabinets de médecine générale accueillant des étudiants(18). On sait que lesmaitres de stage participent souvent plus à la recherche (16). Cette particularité induit unbiais de sélection et empêche une extension de nos résultats à l’ensemble des médecinsgénéralistes.A l’opposé l’avantage de ce travail est l’implication des étudiants en tantqu’investigateurs. Leur rôle est intéressant à décrire car ils n’étaient pas volontairescontrairement à leurs maitres de stage et contrairement à l’étude australienne « combiningvocational and training » (19). Beaucoup d’internes ont participé de manière effective aurecueil. Nous espérions avoir une meilleure exhaustivité grâce à la participation desétudiants. Notre hypothèse était qu’ils auraient pu être amenés à voir plus de pathologiesaigües et donc plus de lombalgies aigües (urgence ressentie par le patient) du fait de leurfonction au sein des cabinets. Mais, le bilan est mitigé : 25 % des fiches ont été rempliespar les internes. Les MDS avaient des avis divergents concernant l’implication de leurétudiant. Certains ont considéré qu’ils n’avaient «rien apporté de plus», alors que d’autresont considéré qu’ils les avaient beaucoup aidés. En outre, il faut se rappeler que lesétudiants sont présents dans chaque cabinet 1 à 3 jours par semaine, en fonction du lieu destage, ce qui peut expliquer des disparités d’implication. Dans tous les cas l’intérêtpédagogique de leur implication dans ce type de travaux est indéniable, cela leur permetsans doute de se familiariser avec la recherche.
- 23 -Quasiment tous les internes en SASPAS étaient impliqués dans l’étude Prélomb. Ilsse regroupaient à la faculté tous les 15 jours pour travailler sur leur stage. L’un despromoteurs de cette étude et une des internes travaillant sur ce projet étaient égalementprésents à toutes ces réunions. La discussion concernant Prélomb était sûrement plus aiséegrâce à cet effet de groupe (20) et il est probable que ces internes étaient aussi impliquéspar solidarité avec les promoteurs. Pourtant on ne note pas de différence notable entre lenombre d’inclusions faites par ceux-ci et par les internes en stage chez le praticien. On nepeut donc pas affirmer qu’on améliore le recueil en sollicitant les internes.Les externes étaient trop peu nombreux et trop peu sollicités pour pouvoir participerde manière assidue au recueil. Leur faible durée de stage (2 mois) et leur éparpillementgéographique les ont peu impliqués dans cette enquête. Ils étaient isolés, difficiles àinformer et trop peu représentés sur l’ensemble de leurs collègues. On pourrait sûrementles impliquer plus si on élargissait le recueil à l’ensemble des externes en stage chez lesmédecins généralistes et qu’on mettait comme l’un des objectifs de validation du stage leurparticipation à la recherche (21). Mais, tant que l’ensemble des maîtres de stage neparticipera pas à ces travaux de recherche, on ne pourra pas envisager ce type decontrainte.Le recrutement des patients a été compliqué par des critères d’inclusion quisemblaient trop sélectifs : la lombalgie devant être le principal motif de consultation. Eneffet, beaucoup d’investigateurs nous ont décrit que les patients parlaient de leur«problème de dos» en même temps que d’autres motifs (renouvellement de médicaments,pathologie infectieuse, problèmes psychologiques…). La lombalgie semble être unepathologie de la « poignée de porte », en effet quand elle est chronique ou récurrente cetteplainte semble intervenir en fin de consultation après d’autres motifs. La période hivernalea aussi compliqué le recueil. Pour réaliser une prochaine enquête ouverte à l’ensemble desmédecins généralistes, il faudra préférablement la lancer au printemps, période où lescabinets sont moins chargés et où les gens font plus d’activités à risque de provoquer deslombalgies.Les auto-questionnaires remplis directement par les patients sont arrivés en milieud’enquête. Ils n’ont pas été très appréciés d’après les commentaires relevés. Ils étaient àpriori simples de réalisation puisque un grand nombre a été recueilli en peu de temps. Leurmise en place semble possible à condition qu’on informe les investigateurs de manièreprécoce. Il est probable que les investigateurs y adhéreront, surtout s’ils deviennent uneaide diagnostique et/ou thérapeutique à la prise en charge (22).
- 24 -La durée de participation de 6 mois semble avoir été bien acceptée par lesinvestigateurs, malgré quelques médecins qui déplorent le manque de relances. Unecertaine lassitude a été perçue avec une baisse du nombre de fiches remplies au fur et àmesure des mois. La communication autour de cette enquête ne s’est faite que par le biaisde réunions et par l’intermédiaire des étudiants. Peut-être serait-il souhaitable d’utiliser dessollicitations multiples : renvoyer des courriers ou des mails de rappels plus fréquents,donner les premiers résultats à mi-parcours, faire des rencontres directes au sein descabinets…Seulement 10 % des patients ont eu une consultation de suivi notée dans le classeur.Est-ce-que les patients étaient guéris ? Est-ce-que les praticiens ont oublié de noter dans lesdossiers ? Est-ce-que la durée de l’étude (6 mois) n’a pas permis de revoir les patients quiconsultaient plus tard ? On sait pourtant que 5 % des lombalgies deviennent chroniques etpeuvent entrainer des consultations de suivi régulières, notamment pour arrêt de travail (4).Cette étude, réalisée localement, était de petite échelle. Elle ne représente pasl’ensemble des médecins ni des étudiants. La proximité avec les investigateurs est sansdoute l’un des atouts de cette étude (14). Nous avons ainsi recueilli beaucoup detémoignages. D’ailleurs, lorsqu’on interroge ceux-ci sur leur envie de continuer àparticiper à ce type de recueil, une majorité nous répond affirmativement. Il existe doncune certaine motivation à la fois de la part des médecins, mais aussi des internes à qui cetteétude avait pourtant été imposée. Le nombre de fiches remplies par médecin a été trèsvariable. Le recueil a pu être perturbé par des contraintes professionnelles et personnelles :la participation des maitres de stage à cet observatoire est une activité parallèle à leurpratique clinique et à leur travail d’enseignement. Elle nécessite une autre méthode detravail, ce qui explique probablement les oublis, le manque d’attention et de temps (10).On peut espérer qu’après une certaine habitude, ces médecins auront moins de difficultés àgérer les trois activités dans leur quotidien.Cette enquête perturbait peu la consultation d’après la majorité des investigateurs ettrès peu de refus de consentement des patients ont été relevés (on peut se demander sitoutes les fiches ont bien été remplies, même lorsque que le patient refusait de participer àl’enquête). A priori, les patients semblent prêts à participer à la recherche dans les cabinetsde médecine générale. La réticence provient probablement plus des médecins que de leurspatients. Dans le cadre de la poursuite du travail de recherche sur la lombalgie, lesinvestigateurs accepteront-ils un travail un plus lourd ?Une poursuite des travaux assurera le suivi des 471 patients inclus dans prélomb.Elle se fera de façon longitudinale et régulière sur au moins un an.
- 25 -CONCLUSIONUn travail de recueil réalisé conjointement par les médecins et leurs stagiaires estpossible, mais demande un temps de coordination et de communication pour motiverl’ensemble des investigateurs. Le plus difficile est d’éviter les oublis (manque de temps,période de recueil peu propice…) chez des investigateurs peu habitués à ce type d’activitédans leur pratique quotidienne. Assurer le suivi sur le long terme des patients reste un défienvisageable si on respecte les contraintes matérielles de Prélomb (fonctionnalité duclasseur, temps de remplissage, durée de l’étude, déroulement de la consultation..). Unepartie des maitres de stage n’a pas trouvé d’intérêt au partage du recueil avec les étudiants.Pourtant, ceux-ci ont montré un certain désir d’implication dans la recherche en médecinegénérale.
- 26 -REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES1. Macfarlane GJ, Jones GT, Hannaford PC. Managing low back pain presenting toprimary care: where do we go from here? Pain. 2006;122(3):219-22.2. Guzman J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivaara A, Irvin E, Bombardier C.Multidisciplinary bio-psycho-social rehabilitation for chronic low back pain.Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD000963.3. J.gourmelen JC A. Ozguler. fréquence des lombalgies dans la population générale.ARMP. 2007;:633-639.4. Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville HC de la S publique. Lasanté en France, Rapport Général. La documentation française. Paris. Novembre1994:276-7.5. Dupont F. Medical and nonmedical direct costs of chronic low back pain in patientsconsulting primary care physicians in France. Fundamental & Clinical Pharmacology.2010;24:101-108.6. Truchon M. Determinants of chronic disability related to low back pain: towards anintegrative biopsychosocial model. Disabil Rehabil. 2001;23(17):758-67.7. Henschke N, Maher CG, Refshauge KM, Herbert RD, Cumming RG, Bleasel J, et al.Prognosis of acute low back pain: design of a prospective inception cohort study.BMC Musculoskelet Disord. 2006;7:54.8. Terrien H, Huez J-F, Richard I, Bouton C. Observatoire de maladies en soinsprimaires : étude de faisabilité auprès de médecins généralistes maîtres de stage,Thèse D med. 2009 nov;9. Robinson G, Gould M. What are the attitudes of general practitioners towardsresearch? Br J Gen Pract. 2000 mai;50(454):390-392.10. Supper I, Ecochard R, Bois C, Paumier F, Supper I, Ecochard R, Bois C, Paumier F,Bez N, Letrilliart L L. How do French GPs consider participating in primary careresearch: the DRIM study. Family Practice. 2011;(28(2)):226–3.11. Franke L, Kommers T, Van Weel E, Lucasson P, Beek M, Van den Hoogen H, et al.General practice registrars and research - attitudes toward participation. Aust FamPhysician. 2008 avr;37(4):276-279.12. Rosemann T, Szecsenyi J. General practitioners’ attitudes towards research inprimary care: qualitative results of a cross sectional study. BMC Family Practice.2004;5(1):31.13. Van Cauteren D, Loury P, Morel B, Durand C, Queriaux B, Demillac R, et al.Déterminants de la participation des médecins généralistes à la surveillancesanitaire : enquête Merveille, 2008. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 201012;(12 janvier).
- 27 -14. Hummers-Pradier E, Scheidt-Nave C, Martin H, Heinemann S, Kochen MM, HimmelW. Simply no time? Barriers to GPs’ participation in primary health care research.Family Practice. 2008 avr 1;25(2):105 -112.15. Graffy J. Engaging family practitioners in research: are we getting it right? FamilyPractice. 2008 avr 1;25(2):69 -70.16. giveon,MD, Ernesto Kahan, MD,MPH. factors associated with family physician’sinvolvment in resarch in Israël. academic medecine. 1997 mai;:vol 72, N°5.17. Ried K, Montgomery BD, Stocks NP, Farmer EA. General practice research training:impact of the Australian Registrar Research Workshop on research skills, confidence,interest and involvement of participants, 2002–2006. Family Practice. 2008 avr1;25(2):119 -126.18. Taillandier A. Angine et TDR: que font les MG des Pays de Loire? Revue dupraticien: médecine générale. 2008;(803):576.19. Olde Hartman TC. Combining vocational and research training.I. Aust FamPhysician. 2008 juin;(37(6)):486-8.20. Cogneau J, Warck R, Tichet J, Royer B, Cailleau M, Balkau B, et al. Enquête demotivation sur la participation des médecins à une recherche en santé publique. SantéPublique. 2002;14(2):191.21. Belinda J. Bateman. The experience of doing research. Current Paediatrics.2004;(14):540–545.22. Cario camille, Levesque. Test et échelles: frein des généralistes à leur utilisation. larevue du praticien. 2010 déc;:24-28.
- 28 -LISTE DES FIGURESFigure 1 : Intérêts et implications des étudiants (D) ............................................................ 17Figure 2 : Remplissage des fiches au fur et à mesure des mois (F) ..................................... 18LISTE DES TABLEAUXTableau I : outils d’évaluation de l’observatoire ................................................................. 15Tableau II : réponses sur les contraintes matérielles (B+C)................................................ 15Tableau III : nombres de fiches recueillies .......................................................................... 16Tableau IV : Motifs de non-inclusion des patients (D) ....................................................... 17Tableau V : Difficultés rencontrées (questionnaires C et D)............................................... 18Tableau VI : Réponses des internes sur leur ressenti de l’étude (D)................................... 19
- 29 -TABLE DES MATIERESMATERIEL ET METHODES ................................................................................................ 11I. ETUDE PRELOMB ...............................................................................................................................11II. EVALUATION DE LA FAISABILITE DE PRELOMB ....................................................................12RESULTATS ............................................................................................................................... 14I. CONTRAINTES MATERIELLES : ....................................................................................................14II. INCLUSION DES PATIENTS : ...........................................................................................................151. Nombres de fiches remplies .................................................................................................................152. Oublis d’inclusion des patients .............................................................................................................163. Recrutement des patients lombalgiques ................................................................................................17III.INTERÊTS ET IMPLICATIONS.....................................................................................................17IV. AUTO-QUESTIONNAIRES : ...........................................................................................................19V. CONSULTATIONS DE SUIVI .............................................................................................................191. Peu de patients revus ............................................................................................................................192. Suivi par différents médecins ...............................................................................................................19VI. PARTICIPATION A LA RECHERCHE .........................................................................................19VII. ROLE DE L’ETUDIANT ..................................................................................................................20VIII. RELATIONS AVEC LE PROMOTEUR .........................................................................................21DISCUSSION .............................................................................................................................. 22CONCLUSION ........................................................................................................................... 25REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................................. 26REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................................. 26LISTE DES FIGURES .............................................................................................................. 28LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... 28TABLE DES MATIERES ........................................................................................................ 29ANNEXE 1: FICHE DE RECUEIL ....................................................................................... 30ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE A MI-PARCOURS INTERNES/ EXTERNES (B) 32ANNEXE 3: REUNION A MI-PARCOURS DE L’ENQUETE PRELOMB (C) ....... 33ANNEXE 4: QUESTIONNAIRE FIN D’ENQUETE PRELOMB (D) .......................... 35ANNEXE 5: ENTRETIENS TELEPHONIQUES (E) ....................................................... 37ANNEXE 6: LISTE DES MEDECINS AYANT PARTICIPE A PRELOMB .. … 43
- 30 -ANNEXE 1 : FICHE DE RECUEILN° PATIENTCritères de non-inclusion / d’exclusion1) Motif principal de consultation autre que lombalgie: Oui □ Non □2) Age du patient < 18 ans ou > 65 ans : Oui □ Non □3) Irradiation douloureuse sous le genou : Oui □ Non □4) Signe clinique initial orientant vers une pathologie spécifique* : Oui □ Non □5) Refus de participation à l’enquête : Oui □ Non □* (fracture, pathologie inflammatoire, infectieuse, ou tumorale)AU MOINS 1 REPONSE « OUI » NE PAS REMPLIR CETTE FICHEFeuille d’information remise à votre patient ? Oui □ Non □--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : MDS □ <strong>IMG</strong> □ Externe □Patient :- Nom (3 1ères lettres) : Prénom (1ère lettre) :- Date de naissance : ……/……../19…. Sexe : F □ M □--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Description de l’épisode et des ATCD de lombalgie : questions à adresser au patient‣ D’après vous, quand a débuté cet épisode douloureux ?- moins d’1 semaine □- 1 semaine à moins de 1 mois □- 1 mois à moins de 3 mois □- 3 mois ou plus □‣ Depuis le début de cet épisode douloureux, êtes vous allé voir, pour ce motif ?- un médecin Oui □ Non □- un kiné Oui □ Non □- un ostéopathe Oui □ Non □- quelqu’un d’autre (préciser : ……….………………………….) Oui □ Non □‣ Avez-vous déjà souffert de lombalgie avant cet épisode ?Jamais □ Rarement □ Souvent □ Très souvent □‣ Etes-vous déjà allé voir un médecin, un kiné ou un ostéopathe lors d’un épisode précédent de lombalgie?Jamais □ Rarement □ Souvent □ Très souvent □--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions à remplir par le médecin effectuant la consultation :‣ accident de travail ? Oui □ Non □‣ maladie professionnelle ? Oui □ Non □‣ votre patient peut-il prétendre à un arrêt de travail, au niveau de sa couverture sociale ?Oui : salarié □ indépendant □ chômeur □ autre (préciser………………….……………….) □Non : étudiant □ au foyer □ retraité □ autre (préciser…………………….…………….) □‣ lui avez-vous prescrit un arrêt de travail ?Oui □ Si oui, durée : ……………………………Non □
- 31 -CONSULTATIONS ULTERIEURES DE CE PATIENT POUR LOMBALGIE (motif principal ou 1 desmotifs)Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : ………………………… MDS □<strong>IMG</strong> □ Externe □Prescription d’un arrêt de travail ?Oui □ Si oui, durée : ………………………………..Non □Commentaires libres : …………………………………………………………………………………………………….Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : ………………………… MDS □<strong>IMG</strong> □ Externe □Prescription d’un arrêt de travail ?Oui □ Si oui, durée : ………………………………..Non □Commentaires libres : …………………………………………………………………………………………………….Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : ………………………… MDS □<strong>IMG</strong> □ Externe □Prescription d’un arrêt de travail ?Oui □ Si oui, durée : ………………………………..Non □Commentaires libres : …………………………………………………………………………………………………….Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : ………………………… MDS □<strong>IMG</strong> □ Externe □Prescription d’un arrêt de travail ?Oui □ Si oui, durée : ………………………………..Non □Commentaires libres : …………………………………………………………………………………………………….En cas de nouvelle consultation pour lombalgie utiliser le feuillet supplémentaire de recueilCONSULTATIONS ULTERIEURES POUR AUTRE MOTIF (pour le patient ou accompagnant un proche)Date de la consultation : ……/……/20….Nom du médecin effectuant la consultation : ………………………… MDS □<strong>IMG</strong> □ Externe □Selon le patient, l’épisode de lombalgie est-il résolu ? …………...………………………………………………………Si oui, depuis quand ? …………………………………………………………………………………………………….Commentaires libres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 32 -ANNEXE 2Questionnaire à mi-parcours internes/ externes (B)1) Combien de patients ont été inclus (nombre de fiches) ?...........................2) Combien de patients ont refusé de donner leur consentement?………………………3) Pensez-vous que vous-même ou votre maître de stage avez oublié d’inclure des patients ?Oui □ Non □Si oui, combien environ et pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4) Le temps de remplissage vous parait-il :correct □ trop long □5) Est-ce que certains items ont demandé des explications complémentaires ?Oui □ Non □Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………6) Avez-vous l’impression que l’enquête est :- un obstacle au bon déroulement de la consultation □- une aide à la discussion □- ni l’un ni l’autre □7) En tant qu’interne, en quoi votre participation à l’enquête améliore-t-elle selon vous le recueil de données?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8) Avez-vous des idées qui permettraient une plus grande implication des internes/externes dans cette étude ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9) Avez-vous des commentaires à faire par rapport à votre implication dans cette étude ? Avantages ? Inconvénients ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 33 -ANNEXE 3Réunion à mi-parcours de l’enquête préLOMB (C)(Questionnaire médecin)TRANSMISSION DU MATERIEL :1) Le classeur vous a-t-il été remis avant le début de l’étude (01/11/2010) ?Oui □ Non □2) Trouvez-vous le matériel fonctionnel (format papier, taille du classeur,nombre de fiches,…) ?Oui □ Non □Si non, pourquoi ?................................................................................................................................................................INCLUSION DES PATIENTS :1) Combien de patients (nombre de fiches) avez-vous inclus dans l’enquête ?..............................................................................................................................................................................................2) D’après vous, combien de patients ont refusé de donner leur consentement pour participer à l’enquête ?- plus de 50 % □- entre 10 et 50 % □- moins de 10% □3) Pensez-vous avoir oublié d’inclure des patients ?Oui □ Non □Si oui, combien et pourquoi ?...............................................................................................................................................4) Combien de patients ont été inclus par votre interne/externe ?- la plupart □- la moitié □- un quart □- aucun □5) Selon vous, comment pourrait-on améliorer la faisabilité de l’étude grâce à la présence del’interne/externe ?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE :1) Le temps de remplissage vous parait-il :Correct □ Trop long □
- 34 -2) Est-ce que certains items ont demandé des explications complémentaires ?Oui □ Non □Si oui, lesquels ?..................................................................................................................................................................3) Avez-vous l’impression que l’enquête est :- un obstacle au bon déroulement de la consultation □- une aide à la discussion □- ni l’un ni l’autre □INFORMATIQUE :1) Quel type de logiciel métier utilisez-vous dans votre cabinet ? …………………………………………………2) Permet-il : de mettre une alarme ? Oui □ Non □d’indiquer le motif de consultation ? Oui □ Non □de retrouver les patients lombalgiques ? Oui □ Non □3) Connaissez-vous la CISP (Classification Internationale des Soins Primaires) ?Oui □ Non □Pouvez-vous l’utiliser avec votre logiciel ? Oui □ Non □L’utilisez-vous ? Oui □ Non □CONCERNANT VOTRE ENGAGEMENT :1) La durée de participation à l’étude (6 mois) vous parait-elle :- longue □- correcte □- courte □2) Cette étude correspond-elle à ce que vous en attendiez ?Oui □ Non □Si non, pourquoi ?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AUTRE :1) Avez-vous une secrétaire ?Oui □ Non □Si oui, pourrait-elle aider les patients à remplir des auto-questionnaires ? (leur fournir un crayon, les fiches, leurdonner quelques explications) ?Oui □Non □
- 35 -ANNEXE 4Questionnaire fin d’enquête préLOMB (internes/externes)(D)Nom de l’étudiant :1) Sur une échelle de 0 à 5, quel intérêt avez-vous porté à l’enquête ?(0 = aucun intérêt, 5 = très intéressant)0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □2) Sur une échelle de 0 à 5, quel est selon vous votre degré d’implication dans cette étude ?(0=pas d’implication du tout, 5=très grand implication de votre part)0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □3) Cocher les affirmations qui vous semblent vraies :- j’ai subi l’intérêt que porte mon maitre de stage à cette enquête □- participer à ce type d’étude fait partie de mon travail d’interne □- j’ai eu l’impression d’encourager mon maitre de stage à remplir des fiches □- j’ai un rôle dans la médiation entre le DMG et mon maître de stage □- participer à ce type d'étude fait partie du rôle d'un médecin généraliste □- j'aide mon maitre de stage à participer à la recherche □- j'apporte une aide au patient lombalgique □- je suis un collecteur de données □- cette enquête m’initie au recueil de données et cela m’intéresse □- je pense qu’à l’avenir je participerai à ce type d’étude □4) Si vous pensez ne pas avoir inclu tous les patients qui présentaient des critères d'inclusions, quelles en sont,selon vous, les principales raisons ?- absence de valorisation du travail demandé □- manque d’intérêt pour l’enquête □- oubli de l’étude □- manque de temps □- difficultés techniques (accessibilité du classeur...) □- perturbation de la consultation et de la relation médecin/patient □- autres □5) Au fur et à mesure des semaines, diriez-vous que vous avez participé à l’enquête :- de plus en plus □- de moins en moins □- de manière identique □
- 36 -6) Dans quels domaines avez-vous rencontré des difficultés au cours de cette étude ?le recrutement des patients• critères d’inclusion trop sélectifs (1 er motif de consultation, âge…) □• peu de patients lombalgiques □• Période hivernale peu propice au recrutement (étude réalisée de nov à mai) □l’obtention du consentementl’autoquestionnairele suivi des dossiers des patients inclus• Patients suivis par différents médecins• Peu de patients revus après la 1 ère consultation• Manque de sollicitations (classeur pas en vue, pas d’alarme dans le dossier…)□□□□□Avez-vous des propositions pour remédier à ces difficultés ?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- 37 -ANNEXE 5ENTRETIENS TELEPHONIQUES (E)Médecins ayant rempli plus de 20 fichesMédecin 1 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Oui, beaucoup de patients . peu d’oublis.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- C’est d’y penser : moi, j’ai pris l’habitude parce que j’ai participé à d’autres études. Il faut y penser dès ledébut. C’est un peu une question d’éducation. Et puis, il ne faut pas qu’il y ait d’autres études à remplir enmême temps.- Je n’ai commencé qu’un mois après le début (mon étudiant avait oublié de me rapporter le matériel)- Ceux qui oublient, c’est certainement lié à un manque de concentration : « ils sont dans leur truc » ou lié àun manque de temps ;3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Il apporte une aide au recueil. On en loupe moins grâce à l’étudiant car il est présent 1 fois/sem.4) Qu’avez-vous pensé de l’enquête prélomb ? (quel est votre sentiment général vis-à-vis de cette enquête ?)- Je suis assez enthousiaste car ça m’a pris peu de temps ; J’ai été agréablement surpris.5) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui, mais il ne faut vraiment pas que ça dure plus longtemps que cette enquête prélomb.Médecin 2 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Oui, au départ . Mais je me suis lassé, j’ai eu une baisse de motivation.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- Etude trop longue sur 6 mois avec peu de relances.- Auto-questionnaires intervenus trop tardivement.3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- il n’y a pas eu de stimulation réciproque. Mais l’interne a revu les dossiers des patients qui étaient revenuscar j’avais zappé les consultations de suivi. (je n’avais pas lu le recto des fiches)4) Qu’avez-vous pensé de l’enquête prélomb ? (quel est votre sentiment général vis-à-vis de cette enquête ?)- Ca ne va pas apporter beaucoup de données concernant les patients lombalgiques.5) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui. Mais, il faut trouver le moyen de relancer les gens ou faire une étude plus courte ou avec des résultatsintermédiaires.
- 38 -Médecin 3 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Oui, beaucoup de patients . peu d’oublis.2) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Il apporte une aide au recueil. On en loupe moins grâce à l’étudiant car il est présent 1 fois/sem.Médecin 4 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Oui, beaucoup de patients, mais je pense quand-même que j’en ai oublié. Intérêt du pense-bête surl’ordinateur.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- C’est d’y penser et d’avoir l’enquête tout le temps à l’esprit.3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Elle a bien travaillé. Ca n’a pas été un frein du tout. C’est complémentaire. Ca permet d’avoir des patientsvus par l’interne et pas par le maitre de stage. Chacun a fait son boulot.4) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui.Médecins ayant rempli 15 fichesMédecin 5 :1) Estimez-vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Peu, mais je n’en ai pas oublié beaucoup. Critères d’inclusion trop sélectifs et pas tant de patientslombalgiques que ça.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- Apprendre qu’il y a de nouvelles tâches au fur et a mesure. Les règles du jeu n’ont pas été présentéesinitialement. Comme si au départ on voulait nous convaincre de participer alors qu’on a rajouté des chosesavant.- Pas de rémunération.3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Ca n’apporte rien de plus, ca complique même les choses parce qu’on ne sait pas si l’interne a inclus telpatient…4) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui, mais j’espère qu’on ne nous annoncera pas de nouvelles taches en cours d’enquête. Il faut nousprévenir, qu’on sache à quelle sauce on va être mangé.
Médecin 6 :- 39 -1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Moyen. Quelques oublis, j’aurais pu en faire plus, mais manque de temps et parfois je n’y pensais qu’aumoment du départ du patient.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- D’y penser,- Auto-questionnaires alourdissant les choses qui s’est surajouté.- Beaucoup de patients consultaient pour de multiples motifs et pas que pour un problème de dos. Donc, onne les incluait pas.3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Ca a été plutôt une aide car il a inclu des patients en plus de ceux que j’ai vu.4) Qu’avez-vous pensé de l’enquête prélomb ? (quel est votre sentiment général vis-à-vis de cette enquête ?)- Contenu superficiel. Je ne voyais pas ce qui pouvait être déterminant pour le pronostic du patient.5) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui.Médecins ayant rempli moins de 10 fichesMédecin 7 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Non, seulement 6 ou 7.J’ai fait beaucoup d’oublis.2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- C’est d’y penser : peut-être aurais-je dû mettre un pense-bête sur l’ordinateur.- C’était ma première participation à une étude. « C’est un coup à prendre, j’étais dans ma consultationhabituelle et ne pensais pas forcément à l’enquête à coté» (activité parallèle à la consultation habituelle).3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Peu d’apport des étudiants au sein de l’étude. Ils étaient peu impliqués.4) Qu’avez-vous pensé de l’enquête prélomb ? (quel est votre sentiment général vis-à-vis de cette enquête ?)- Questionnaire peu complet. J’étais un peu frustré du contenu.5) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui.
Médecin 8 :- 40 -1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Peu de patients inclus en raison de la période épidémique hivernale (plus de travail, moins de temps). Surle semestre d’été, je vois plus de lombalgiques (activités de bricolage, jardinage…).- Les critères d’inclusion étaient trop sélectifs : les sciatiques et autres radiculalgies étaient écartées…2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- L’explication au patient m’a paru trop longue par rapport au contenu du questionnaire.- C’est important d’avoir une véritable collaboration avec celui qui lance l’étude, d’avoir un lien et uncontact fréquents.- Je regrette que cette étude soit faite en plusieurs parties.3) D’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Mon interne a plutôt freiné l’étude car elle n’a beaucoup rempli de fiches et ne m’a pas fait de rappel oude transmission, concernant les patients inclus.4) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui, mais je ne peux pas participer aux réunions à Angers en raison de la distance.- Mon thème d’intérêt serait plutôt la pédiatrie- J’aimerais beaucoup une version informatiqueMédecin 9 :1) Estimez vous avoir inclus beaucoup ou peu de patients ?- Peu, car j’ai vu peu de patients lombalgiques : faible recrutement du fait d’une trop bonne prise encharge antérieure ? (prise en charge en collaboration avec les kinés, conseils de gym…)2) Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de cette enquête ?- Etude trop courte, permettant peu de revoir les patients.- On a reçu les auto-questionnaires trop tardivement.3) d’après-vous, quel a été le rôle de votre étudiant au sein de cette étude ? Avez-vous plutôt ressenti sa présencecomme une aide ou plutôt comme un obstacle au bon déroulement de l’étude ?- Je ne vois pas ce que ça apporte en plus.3) Qu’avez-vous pensé de l’enquête prélomb ? (quel est votre sentiment général vis-à-vis de cette enquête ?)- Je n’ai pas très bien compris le but de l’étude. Elle était simple de réalisation.4) Seriez-vous prêt à poursuivre votre participation aux projets de recherche du DMG? (oui ? non ? pourquoi ?)- Oui.
- 41 -ANNEXE 6LISTE DES MEDECINS AYANT PARTICIPE A PRELOMBBARON CélineBELLANGER WilliamBENAZECH SandrineBOGAERT OlivierBOURCIER FrédériqueBOUTON CélineCAILLIEZ EricCHAUDON ChristianCHAUDON CorineCORMIER Jean-LucDAGUZAN BenoîtDELHOMMEAU MichèleDESBRAIS-HEMERY NellyFOUCAT JoëlFOUCHE LucFOURRIER Jean-MarcGABARD CatherineGARNIER FrançoisGRANIER Jean-ClaudeGUSTIN GillesHUEZ Jean-FrançoisJEROME MichelLA COMBE AntoineLA COMBE PascaleLAFOREST CatherineMARAIS PatrickMAURIER FrédéricMOUDENS GrégoryNEVEUR AlainNEVEUR MariannickNUEL JérômePY ThibautRAMOND AlineVEILLEROT FrançoiseVIDALENC Olivier
<strong>BEDOUET</strong> <strong>Claire</strong>RECUEIL DE DONNEES SUR LES LOMBALGIES PAR LES MAITRES DE STAGEUNIVERSITAIRES DE MEDECINE GENERALE : ANALYSE DE LA MISE EN PLACERESUMEContexte et objectif : « Prelomb » était une étude préliminaire réalisée par le Département de MédecineGénérale afin d’établir le profil des patients adultes consultant pour lombalgie commune. 35 maitres destage universitaires et leurs 23 étudiants incluaient et suivaient les patients lombalgiques pendant 6 mois.Le travail réalisé ici, parallèle à l’enquête PRELOMB, présente les difficultés et les facteurs favorisantsde cet observatoire et se demande quel est l’apport des étudiants dans ce recueil.Méthode : Différents outils ont permis une analyse globale (quantitative et qualitative) : questionnaires etinterviews des médecins et étudiants, analyse rétrospective des fiches d’inclusion des patients.Résultats : La durée de l’étude a été bien vécue, même si une certaine lassitude s’est fait sentir au fil desmois. Le déroulement de la consultation et la relation médecin/malade n’ont pas été perturbées. 25 % despatients ont été inclus par les internes. Leur travail a été facilité par l’effet groupe-SASPAS, mais unepartie des maitres de stage n’a pas trouvé d’intérêt au partage du recueil avec les étudiants. L’inclusion apâti d’un nombre important d’oublis du fait d’un manque de temps, d’un défaut de contact avec lespromoteurs et d’une période de recueil peu propice. Le questionnaire volontairement court a été ressenticomme peu intéressant. 152 patients sur les 471 inclus ont eu une consultation de suivi.Conclusion : Un travail de recueil réalisé conjointement par les médecins et leurs stagiaires est possible,mais demande un temps de coordination et de communication pour motiver l’ensemble des investigateurs.MOTS-CLESobservatoiresoins primairesrecherchelombalgiemaîtres de stage