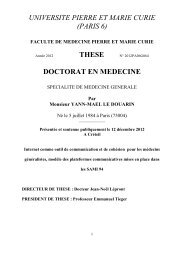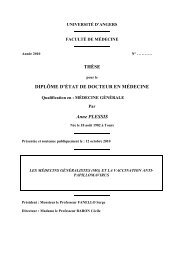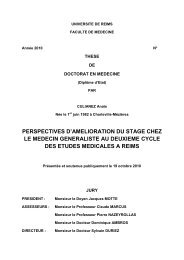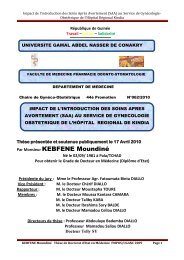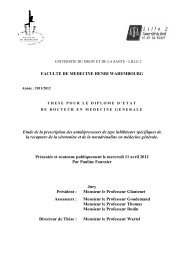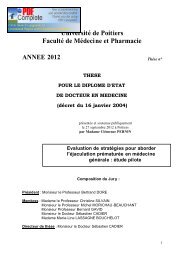BRABANT Yann.pdf
BRABANT Yann.pdf
BRABANT Yann.pdf
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Université de PoitiersFaculté de Médecine et de PharmacieANNÉE 2012 Thèse n°THESEPOUR LE DIPLOME D'ETATDE DOCTEUR EN MEDECINE(décret du 16 janvier 2004)Présentée et soutenue publiquementLe 29 mai 2012 à Poitierspar Monsieur <strong>Yann</strong> <strong>BRABANT</strong>Les internes en médecine et le tabacEnquête auprès de 406 internes de Poitou-CharentesCOMPOSITION DU JURYPrésident : Monsieur le Professeur José GOMES DA CUNHAMembres : Monsieur le Professeur Michel MORICHAU-BEAUCHANTMonsieur le Professeur Pascal ROBLOTMonsieur le Docteur Guillaume BÉRAUDMonsieur le Docteur Vincent BRUNETDirecteur de thèse : Monsieur le Docteur Michel UNDERNER1
UNIVERSITE DE POITIERSFaculté de Médecine et PharmacieAnnée universitaire 2011 – 2012LISTE DES ENSEIGNANTS DE MEDECINEProfesseurs des Universités-Praticiens Hospitaliers1. AGIUS Gérard, Bactériologie-Virologie2. ALLAL Joseph, Thérapeutique3. BATAILLE Benoît, Neurochirurgie4. BENSADOUN René-Jean, cancérologie radiothérapie5. BRIDOUX Frank, Néphrologie6. BURUCOA Christophe, Bactériologie-Virologie-Hygiène7. CARRETIER Michel, Chirurgie générale8. CHRISTIAENS Luc, cardiologie9. CORBI Pierre, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire10. DAGREGORIO Guy, Chirurgie plastique et Reconstructrice11. DEBAENE Bertrand, Anesthésiologie Réanimation Chirurgicale12. DEBIAIS Françoise, Rhumatologie13. DORE Bertrand, Urologie14. DUFOUR Xavier, Oto-Rhino-Laryngologie15. EUGENE Michel, Physiologie16. FAUCHERE Jean-Louis, Bactériologie- Virologie (surnombre)17. FAURE Jean-Pierre, Anatomie18. FRITEL Xavier, Gynécologie-obstétrique19. FROMONT-HANKARD Gaëlle, Anatomie et cytologie pathologiques20. GAYET Louis-Etienne, Chirurgie orthopédique et traumatologique21. GICQUEL Ludovic, pédopsychiatrie22. GILBERT Brigitte, Génétique23. GOMBERT Jean-Marc, Immunologie24. GOUJON Jean-Michel, Anatomie et Cytologie Pathologiques25. GUILHOT-GAUDEFFROY François, Hématologie et Transfusion26. GUILLET Gérard, Dermatologie27. HADJADJ Samy, Endocrinologie et Maladies métaboliques28. HANKARD Régis, Pédiatrie29. HAUET Thierry, Biochimie30. HERPIN Daniel, Cardiologie et Maladies vasculaires31. HOUETO Jean-Luc, Neurologie32. INGRAND Pierre, Biostatistiques, Informatique médicale33. IRANI Jacques, Urologie34. KEMOUN Gilles, Médecine physique et Réadaptation(détachement)35. KITZIS Alain, Biologie cellulaire36. KLOSSEK Jean-Michel, Oto-Rhino- Laryngologie37. KRAIMPS Jean-Louis, Chirurgie générale38. LECRON Jean-Claude, Biochimie et Biologie moléculaire39. LEVARD Guillaume, Chirurgie infantile40. LEVILLAIN Pierre, Anatomie et Cytologie pathologiques41. MAGNIN Guillaume, Gynécologie-obstétrique (surnombre)42. MARCELLI Daniel, Pédopsychiatrie (surnombre)43. MARECHAUD Richard, Médecine interne44. MAUCO Gérard, Biochimie et Biologie moléculaire45. MENU Paul, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire46. MEURICE Jean-Claude, Pneumologie47. MIMOZ Olivier, Anesthésiologie, Réanimationchirurgicale48. MORICHAU-BEAUCHANT Michel, Hépato-Gastro-Entérologie49. NEAU Jean-Philippe, Neurologie50. ORIOT Denis, Pédiatrie51. PACCALIN Marc, Gériatrie52. PAQUEREAU Joël, Physiologie53. PERAULT Marie-Christine, Pharmacologie clinique54. PERDRISOT Rémy, Biophysique et Traitement del'Image55. PIERRE Fabrice, Gynécologie et obstétrique56. POURRAT Olivier, Médecine interne57. PRIES Pierre, Chirurgie orthopédique ettraumatologique58. RICCO Jean-Baptiste, Chirurgie vasculaire59. RICHER Jean-Pierre, Anatomie60. ROBERT René, Réanimation médicale61. ROBLOT France, Maladies infectieuses, Maladiestropicales62. ROBLOT Pascal, Médecine interne63. RODIER Marie-Hélène, Parasitologie et Mycologie64. SENON Jean-Louis, Psychiatrie d'adultes65. SILVAIN Christine, Hépato-Gastro- Entérologie66. SOLAU-GERVAIS Elisabeth, Rhumatologie67. TASU Jean-Pierre, Radiologie et Imagerie médicale68. TOUCHARD Guy, Néphrologie69. TOURANI Jean-Marc, Cancérologie Radiothérapie,option Cancérologie (type clinique)70. TURHAN Ali, Hématologie-transfusion71. VANDERMARCQ Guy, Radiologie et Imagerie Médicale72. WAGER Michel, Neurochirurgie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 rue de la Milétrie , B.P. 199, 86034 POITIERS CEDEX, France 05.49.45.43.43 - 05.49.45.43.05 – e.mail : doyen.medecine@univ-poitiers.fr2
REMERCIEMENTSA Monsieur le Docteur Michel Underner,Vous m'avez accordé l'immense privilège de votre confiance en consentant àdiriger cette thèse. Votre disponibilité, vos conseils avisés et votre soutien m'ont ététrès précieux pour réaliser ce travail.A Monsieur le Docteur Guillaume Béraud,Merci infiniment de ton aide si précieuse pour la réalisation des statistiques.Je suis honoré d'être jugé par le médecin et l'homme que tu es.A Monsieur le Professeur José Gomes,J'ai été sensible à l'attention que vous m'avez portée en acceptant laprésidence de ce jury de thèse et aux conseils que vous m'avez prodigués pour saréalisation. Soyez assuré de mes remerciements respectueux.A Monsieur le Doyen Michel Morichau-Beauchant,Vous me faites l'honneur de juger ce travail. Je tiens à vous exprimer mesremerciements et mon profond respect.A Monsieur le Professeur Pascal Roblot,Vous m'avez accueilli et fait profiter de vos enseignements pendant les 6 moispassés dans le service de médecine interne. Je vous en remercie sincèrement ainsique les autres médecins du service.A Monsieur le Docteur Brunet,J'ai eu le plaisir de pouvoir bénéficier de votre écoute, votre soutien et votreexpérience en tant que « tuteur » pendant les 3 ans de mon internat et vous en suistrès reconnaissant.A Clémence, bientôt ma femme, pour son amour et sa patience,A mon père, pour avoir été un exemple de réussite par le travail et m'avoirtoujours encouragé à faire de mon mieux.A ma mère, Sébastien et Ombeline pour leur tendresse et leur confiance,Au Docteur Sansoucy et au Docteur Marzin ainsi qu'aux autres « médecins defamille » qui m'ont transmis l'amour de leur métier. Je leur en serai éternellementreconnaissant.4
SOMMAIRE1. INTRODUCTION.......................................................................................................82. GÉNÉRALITÉS.........................................................................................................92.1. Effets du tabagisme sur la santé........................................................................92.2. Un enjeu de santé publique.............................................................................102.3. Prévalence du tabagisme en France ..............................................................122.4. Le rôle du médecin..........................................................................................132.4.1. Pratiquer le conseil minimal......................................................................132.4.2. Le médecin généraliste : un acteur essentiel de prévention....................142.4.3. Place du spécialiste..................................................................................152.4.4. Rôle et formation de l'interne....................................................................173. LE PATIENT DEMANDANT UNE AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE....................193.1. Évaluer et renforcer sa motivation...................................................................193.2. Aborder le sevrage...........................................................................................213.3. Reconstituer l'histoire du tabagisme................................................................223.4. Évaluer la dépendance physique par le test de Fagerström...........................223.5. Tenir compte de la dépendance psycho-comportementale.............................223.6. Rechercher et prendre en charge les co-dépendances..................................233.7. Rechercher et traiter une anxiété et un syndrome dépressif...........................233.8. Anticiper les « tracas » du sevrage tabagique.................................................243.9. Proposer un traitement d'aide à l'arrêt du tabac..............................................253.9.1. Le traitement de la dépendance physique................................................253.9.2. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC)...................................283.9.3. Les thérapeutiques non-recommandées..................................................283.10. Réaliser un suivi rapproché, surveiller et anticiper la rechute.......................294. MATÉRIEL ET MÉTHODE......................................................................................314.1. Conduite de l'étude..........................................................................................314.2. Données recueillies et analysées....................................................................314.2.1. Données générales...................................................................................314.2.2. Pour étudier la prévalence du tabagisme.................................................314.2.3. Pour étudier les déterminants du tabagisme des internes.......................324.2.4. Pour étudier le tabagisme des internes fumeurs......................................324.2.5. Pour étudier la pratique des internes en matière de conseil minimal......334.2.6. Pour étudier le besoin de formation en aide au sevrage tabagique.........335
4.3. Saisie et analyse des données........................................................................335. RÉSULTATS............................................................................................................345.1. Caractéristiques de la population étudiée........................................................345.2. Prévalence du tabagisme chez les internes....................................................355.2.1. Prévalence selon le sexe..........................................................................355.2.2. Prévalence selon la spécialité..................................................................355.3. Déterminants du tabagisme des internes........................................................385.3.1. Déterminants du statut tabagique des internes........................................385.3.2. Influence de l'ENC....................................................................................385.3.3. Influence de la vie d'interne......................................................................395.3.4. Influence des grossesses.........................................................................405.4. Étude du tabagisme des internes fumeurs......................................................415.4.1. Initiation du tabagisme..............................................................................415.4.2. Déterminants de l'initiation du tabagisme chez les internes.....................425.4.3. Fumeurs quotidiens..................................................................................445.4.4. Souhait d'arrêt du tabac............................................................................445.5. Pratique du conseil minimal.............................................................................455.5.1. Influence du statut tabagique....................................................................465.5.2. Influence de la spécialité..........................................................................465.6. Maîtrise de la prescription des traitements de substitution nicotiniques.........485.6.1. Influence du statut tabagique....................................................................485.6.2. Influence de la spécialité..........................................................................495.7. Souhait de formation à l'aide au sevrage tabagique........................................506. DISCUSSION..........................................................................................................516.1. Biais possibles de l'étude.................................................................................516.2. Caractéristiques de la population étudiée........................................................526.3. Prévalence du tabagisme chez les internes....................................................526.3.1. Prévalence du tabagisme chez les internes selon le sexe.......................526.3.2. Prévalence du tabagisme chez les internes selon la spécialité...............536.4. Déterminants du tabagisme des internes........................................................536.5. Tabagisme des internes fumeurs.....................................................................546.5.1. Influence des grossesses.........................................................................546.5.2. Initiation du tabagisme des internes.........................................................546.5.3. Déterminants de l'initiation du tabagisme des internes............................546
6.5.4. Tabagisme quotidien.................................................................................556.5.5. Souhait d'arrêt du tabac............................................................................556.6. Pratique du conseil minimal.............................................................................556.6.1. Recherche du statut tabagique.................................................................556.6.2. Demande de l'éventuel projet d'arrêt du tabac.........................................566.6.3. Influence du statut tabagique sur la pratique du conseil minimal.............566.6.4. Influence de la spécialité sur la pratique du conseil minimal...................576.7. Maîtrise de la prescription des TSN.................................................................586.8. Souhait de formation à l'aide au sevrage tabagique........................................597. CONCLUSION.........................................................................................................62RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.......................................................................64ANNEXES....................................................................................................................691. Questionnaire......................................................................................................702. Test Q-MAT : .......................................................................................................723. Test de Fagerström : ..........................................................................................734. Test HAD : The Hospital Anxiety and Depression Scale. ...................................755. Guide à l'usage des internes pour l'abord du patient fumeur.............................76RÉSUMÉ.....................................................................................................................78SERMENT D'HIPPOCRATE........................................................................................797
1. INTRODUCTIONLes médecins jouent un rôle important dans le sevrage tabagique de leurspatients. Les internes en médecine, parce qu'ils constituent des interlocuteursprivilégiés pour les patients, souvent plus disponibles que les autres praticiens, ontun rôle essentiel à jouer dans la prévention du tabagisme. Un interne non-fumeur aune crédibilité renforcée auprès du patient dans son discours préventif. Pourtant, uneétude réalisée en 2001 par l'Office Français de Prévention du Tabagisme (OFT) amontré que le taux de prévalence du tabagisme était de 36 % parmi l'ensemble desinternes et que ceux-ci interrogeaient leurs patients systématiquement sur leur statuttabagique dans 76 % des cas (1).Le conseil minimal à l'arrêt du tabac est un élément essentiel de la préventiondu tabagisme. En France, si tous les médecins pratiquaient le conseil minimal,200 000 arrêts du tabac supplémentaires seraient obtenus chaque année (2). Cesdeux questions posées par un médecin généraliste doublent le taux de succès àl’arrêt, après un an, par rapport à l’arrêt spontané dans un groupe témoin (3) etl'AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)recommande son application systématique par tous les professionnels de santé (4).Qu'en est-il aujourd'hui de l'implication des internes en médecine en matièred'aide à l'arrêt du tabac et comment appliquent-ils au quotidien cesrecommandations ? Leur statut tabagique influence-t-il leur prise en charge despatients fumeurs ? Pratiquent-ils le conseil minimal et sont-ils formés à l'aide ausevrage tabagique ? Les internes de médecine générale, en tant que futursmédecins de premier recours, sont-ils mieux formés à l'aide au sevrage tabagiqueque les internes des autres spécialités ?Les objectifs principaux de cette étude étaient d'étudier le ressenti des internesen médecine du Poitou-Charentes en ce qui concerne leur besoin de formation en aideau sevrage tabagique et d'étudier l'influence de leur statut tabagique et de leur spécialitésur la pratique du conseil minimal. Les objectifs secondaires étaient de déterminer laprévalence du tabagisme chez les internes en médecine, d'en étudier l'histoire et d'encaractériser quelques déterminants.8
2. GÉNÉRALITÉS2.1. Effets du tabagisme sur la santéAlors même que le lien entre tabac et cancers est enseigné depuis le début duXIXe siècle, que les premiers travaux épidémiologiques évoquant la nocivité dutabac datent de 1950 (5), le tabagisme reste la première cause de mortalité évitabledans le monde. Il est à l'origine de 5,4 millions de décès par an et le bilan pourraitencore s'alourdir et atteindre 8 millions de morts par an d'ici 2030, estimel'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (6). Un fumeur sur deux décèdera d'unepathologie liée à son tabagisme.En France, le nombre de décès prématurés attribuables au tabagisme en2004 était estimé à environ 73 000 (59 000 chez les hommes et 14 000 décès chezles femmes) (7). La moitié des victimes du tabac meurt jeune, entre 35 et 69 ans, cequi correspond à une réduction de l’espérance de vie de 20 à 25 ans pour cesderniers par rapport à celle des non fumeurs (8).La fumée de tabac est la principale source de cancérogènes pour l’homme.Elle contient plus de 4 800 produits chimiques qui sont toxiques et irritants. Soixantedixd’entre eux sont cancérogènes (Benzène, Arsenic, Chrome, etc.).Ainsi, la consommation de tabac favorise de manière significative denombreux cancers : poumon (avec 28 000 décès par an), cavité buccale, pharynx,larynx, pancréas, vessie, reins, cavités nasales, sinus, œsophage, estomac, foie, colde l’utérus, leucémie myéloïde, colon, rectum, ovaire et sein (9).Par ailleurs, le tabagisme est également impliqué dans la survenue d'un grandnombre de pathologies cardio-vasculaires : coronaropathies, artériopathie oblitérantedes membres inférieurs (AOMI), accidents vasculaires cérébraux, mort subite,anévrisme de l'aorte abdominale.En terme de morbidité, les broncho-pneumopathies chroniques obstructives(BPCO) constituent la complication respiratoire la plus fréquente du tabagisme maiscelui-ci a également un impact sur le contrôle et la sévérité de l'asthme et lasurvenue d'infections respiratoires. De plus, il peut entraîner des conséquencesdélétères sur de nombreux autres aspects : fertilité, grossesse, mort subite dunourrisson, risque d'ostéoporose, parodontite, cataracte et dégénérescencemaculaire liée à l'âge, ulcère gastro-duodénal, complications chirurgicales, etc (10).9
2.2. Un enjeu de santé publiqueL'Organisation Mondiale de la Santé (6) affirme que la consommation de tabacentraîne la mort de 5,4 millions de personnes chaque année, et que l’épidémie necesse de s’aggraver, notamment dans les pays en voie de développement où plus de80 % des décès dus au tabac surviendront dans les prochaines décennies.Si aucune action d‘urgence n’est entreprise, la consommation de tabac tueraun milliard de personnes dans le monde au cours de ce siècle (6). La consommationde tabac est si dévastatrice pour l’organisme qu’elle constitue un facteur de risquepour six des huit principales causes de mortalité dans le monde.La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est le premier instrumentmondial de lutte contre le tabagisme (11). Ce texte, qui est le premier traité à avoirété négocié sous les auspices de l’OMS, représente une immense conquête enfaveur de la santé publique. Entré en vigueur en 2005 seulement, il est déjà, avecplus de 170 signataires (dont la France), l’un des traités à avoir été le plusrapidement et largement accepté dans toute l’histoire des Nations Unies. Établi sur labase de données factuelles, il réaffirme le droit de tous les peuples au plus hautniveau de santé qu’il est possible d’atteindre et apporte une dimension juridiquenouvelle à la coopération pour la lutte antitabac.Ces obligations sont notamment les suivantes :• mettre les politiques de santé publique à l’abri des intérêts commerciaux del’industrie du tabac ;• prendre des mesures financières et fiscales pour réduire la demande de tabac• protéger contre l’exposition à la fumée du tabac ;• réglementer la composition des produits du tabac ;• réglementer les informations à communiquer sur les produits du tabac ;• réglementer le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ;• mettre en garde contre les dangers du tabac ;• interdire la publicité ainsi que les activités de promotion et de parrainage enfaveur du tabac ;• proposer des moyens de s’affranchir de la dépendance à l’égard du tabac ;• combattre le commerce illicite des produits du tabac ;10
2.3. Prévalence du tabagisme en FranceSi l'OMS fixe un objectif de prévalence du tabagisme inférieur à 20%, lesrésultats du Baromètre Santé 2010 de l'Institut national de prévention et d'éducationpour la santé (INPES) nous apprennent qu'il n'est toujours pas atteint (12).Les différentes mesures de lutte contre le tabac mises en œuvre lors desdernières décennies (augmentation des prix, interdiction de fumer dans les lieuxpublics, mise en place d’avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, aideau sevrage, etc.) avaient permis une réduction de la consommation de tabac qui setraduit aujourd’hui par une diminution des cancers du poumon chez l’homme.Toutefois, les résultats du Baromètre santé de 2010 enregistrent pour lapremière fois depuis la loi Evin de 1991 une hausse du nombre de fumeurs (de 31,8à 33,7 % entre 2005 et 2010), même si le nombre moyen de cigarettes fuméesdiminue, la proportion de gros fumeurs ayant diminué entre 2005 et 2010. On estimeà quinze millions le nombre de fumeurs en France soit 33,7 % des français âgés de15 à 75 ans (29,1 % de fumeurs quotidiens et 4,6 % de fumeurs occasionnels). Leshommes sont encore et toujours plus souvent fumeurs (à 37,4 %) que les femmes(30,2 %). La consommation quotidienne concerne pour sa part 32,4 % des hommes(augmentation non significative en 5 ans) et 26,1 % des femmes (contre 23,3 % en2005, augmentation très significative ; p
2.4. Le rôle du médecin2.4.1. Pratiquer le conseil minimalLe conseil minimal d'aide au sevrage tabagique est une intervention brève etsystématique, d'une durée inférieure à trois minutes, que peut pratiquer tout médecinlorsqu'il est en présence d'un fumeur pendant une consultation. Si tous les médecinspeuvent conseiller l'arrêt du tabac, le conseil minimal est particulièrement adapté à lapratique de la médecine générale où le temps est un facteur important de contrainte.L'outil français de conduite du conseil minimal est décrit dans le tableau ci-dessous.Tableau I: Le conseil minimal à l'arrêt du tabacPremière question : « FUMEZ-VOUS ? »Réponse négative : encourager la poursuite de l'abstinenceRéponse positive : poser la deuxième questionDeuxième question : « ENVISAGEZ-VOUS L'ARRÊT DU TABAC ? »Réponse négative : saisir chaque occasion pour en reparler avec votre patient,sans le culpabiliser, sa décision d’essayer d’arrêter de fumer viendra peut-être plustard.Réponse positive : proposer une aide au sevrage et lui remettre une brochure« d'auto-assistance »*.*Ce type de brochure est disponible gratuitement sur le site de l'INPES.Tabac, pour faire le point ;J'arrête de fumer, le guide pratique pour y parvenir13
Des méta-analyses (14-15) de plus de vingt essais cliniques montrent que le conseilminimal pratiqué par un médecin augmente le nombre de fumeurs qui arrêtent defumer.Une étude française montre que ces deux questions posées par un médecingénéraliste doublent le taux de succès à l’arrêt, après un an, par rapport à l’arrêtspontané dans un groupe témoin (3). Même si l’effet absolu reste faible (entre 1 et3 %), cette intervention peut avoir un impact considérable sur la santé publique car,dans de nombreux pays, une grande majorité des fumeurs consultent leur médecinchaque année. En France, si tous les médecins pratiquaient le conseil minimal,200 000 arrêts du tabac supplémentaires seraient obtenus chaque année (2), c'estpourquoi l'AFSSAPS recommande son application systématique par tous lesprofessionnels de santé (4).Les médecins doivent demander le statut tabagique de tous leurs patients, lenoter dans le dossier médical, conseiller à tous les fumeurs d’arrêter de fumeret leur proposer une aide au sevrage à chaque occasion.2.4.2. Le médecin généraliste : un acteur essentiel de préventionLe médecin généraliste a une place bien particulière dans le système de soinfrançais. En 1998, l'ANAES a émis des recommandations professionnelles explicitesen insistant sur la reconnaissance de la place du médecin généraliste « comme unvéritable partenaire d'une politique de santé […] dans un contexte de mobilisationsociale et de sensibilisation » (16).La réforme du « médecin traitant » de 2004 a conforté sa place de pierreangulaire du réseau de soin. C’est à lui qu’appartiennent les fonctions de prise encharge globale, de continuité du suivi et de coordination des soins. Il dispose d’atoutsimportants dans la lutte contre le tabagisme : il connaît ses patients, leur statut socialet économique, leur état psychique, leurs autres dépendances, leurs problèmesfamiliaux. Rares sont les consultations de médecine générale ne touchant pas à unsujet de prévention. Ainsi une enquête de la SFMG a montré que 32 % desconsultations de médecine générale étaient des consultations de prévention (17)confirmant la prévention comme tenant une part importante dans l’activité dugénéraliste.En France, en 2003, les médecins généralistes étaient 97,8 % à déclarerprendre en charge eux mêmes leurs patients désirant arrêter de fumer, que ce soit14
seuls (86,5 %) ou avec l’aide d’une structure (11,3 %) (18).Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) (10) indiquent aumédecin généraliste d’interroger le patient fumeur sur son histoire tabagique, et denoter celle-ci dans le dossier médical. C’est cette étape qui constitue le pointd’ancrage du travail de prévention.Une étude de 2004 (19) a montré que les médecins généralistes rencontraientles fumeurs demandeurs d'une aide à l'arrêt environ 5 ans plus tôt que les centresd'aide au sevrage tabagique, leur action prend donc tout son sens en matière deprévention. Beaucoup de BPCO, cancers et décès prématurés pourraient être évitéssi la démarche d'aide à l'arrêt du tabac était systématique, répétée et de bonnequalité.Les patients consultant pour un sevrage tabagique sont rares, or dans denombreuses situations de consultation, le statut tabagique peut être abordé. Lerepérage des fumeurs est donc essentiel dans le processus de sevrage. Le conseilminimal et les interventions brèves (qui consistent en des conseils brefs et desencouragements) sont des méthodes efficaces et reconnues pour augmentersignificativement les sevrages tabagiques réussis. Leur principe : évaluer l’étatd’avancement psychologique vers le désir de sevrage, aider à modéliser unprocessus émergent. Ces méthodes nécessitent peu de temps et n’ont pas pour butde convaincre, mais d’aider à une prise de conscience. On peut comparer lesinterventions brèves à des graines à germer. Cela permet de situer le degré demotivation des personnes par rapport à l'arrêt du tabac, selon les stades de lamotivation dans le modèle de Prochaska et Di Clemente : pré-intention, intention,préparation, action, maintien et éventuellement rechute (cf figure 1 : Cycle deProchaska et Di Clemente).2.4.3. Place du spécialisteL'arrêt du tabac est bénéfique et recommandé chez les patients atteints depathologies cardio-vasculaires, notamment de maladies coronariennes (Grade A).Les substituts nicotiniques sont bien tolérés chez les patients coronariens et peuventêtre prescrits dès la sortie de l'unité de soins intensifs (Grade C) (4). Pour cela, il estimportant que les médecins cardiologues et les internes de cardiologie sachent lesutiliser.15
Au niveau pulmonaire, le risque de survenue d'un cancer broncho-pulmonairediminue après l'arrêt de la consommation tabagique (par rapport aux non-fumeurs, lerisque relatif est égal à 16 en cas d'arrêt inférieur à 5 ans, 5 en cas d'arrêt datant de10 à 19 ans et 1,5 au-delà de 40 ans). De plus, les patients atteints de BPCOd'intensité faible à modérée présentent une amélioration fonctionnelle respiratoiredans l'année suivant l'arrêt du tabac (10). L’arrêt du tabac constitue l’intervention laplus efficace (et la moins coûteuse) pour stopper la progression de la BPCO (niveaude preuve A).Chez la femme enceinte, la conférence de consensus « Grossesse et tabac »de 2004 recommande de proposer les différentes techniques d'aide à l'arrêt du tabacsystématiquement, «lors de toute rencontre d'une femme fumeuse avec unprofessionnel de santé».Selon la SFAR (Société Française d'Anesthésie et de Réanimation), dèsl'annonce d'une chirurgie, tout soignant doit mettre en œuvre les moyens à sadisposition pour aider le fumeur à s'arrêter (20). En effet, l'arrêt du tabac plus de 8semaines avant une intervention chirurgicale et dans la période post-opératoirejusqu'à la cicatrisation est associé à la disparition de l'excès de risque lié autabagisme (3 fois plus de complications du site opératoire, 2 fois plus de passagesen réanimation, sur-mortalité avec un risque relatif de 2,56) (21).L'arrêt du tabac apparaît également souhaitable chez des personnes atteintesde pathologies aggravées par le tabac (hypertension artérielle, diabète de type 1 ou2, insuffisance rénale, asthme) afin de stabiliser ou de ralentir l'évolution de cesmaladies (4).En 2009, la Fédération Française de Psychiatrie (FFP), à l'issue de laconférence « Arrêt du tabac chez les patients atteints d'affections psychiatriques »(22) émettent leurs recommandations communes, « en premier lieu destinées auxprofessionnels de santé du milieu psychiatrique, mais [pour] bon nombre d'entre ellespertinentes pour la médecine générale ». Chez les patients atteints de psychosecomme de troubles de l'humeur et de troubles anxieux, l'hospitalisation peut-être, dufait de l'interdiction de fumer, l'opportunité de conduire une forte réduction voire l'arrêtde l'intoxication tabagique sous couvert d'une substitution nicotinique efficace.16
Ainsi, tous les spécialistes d'organes sont concernés par l'arrêt du tabacde leurs patients. Ils devraient proposer le conseil minimalsystématiquement, donner des conseils simples et orienter si besoin versle médecin traitant ou une consultation de tabacologie. Il est importantque tout médecin maîtrise la prescription des substituts nicotiniquespour éviter un syndrome de sevrage inconfortable à ses patients.2.4.4. Rôle et formation de l'interneD’après le décret du 10 Novembre 1999, l’interne est « un praticien enformation spécialisée ». Il exerce « des fonctions de prévention, de diagnostic et desoins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».Théoriquement, les internes devraient être formés au cours du deuxième cycledes études médicales (DCEM), l'item n°45 du programme préparant à l'ExamenNational Classant (ENC) ayant pour thème la prise en charge des addictions (parl'arrêté du 2 mai 2007).N° 45. Addiction et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage.Morbidité, comorbidité et complications. Prise en charge, traitement substitutifet sevrage : alcool, tabac, psycho-actifs et substances illicites.– Expliquer les éléments de prévention et de dépistage des conduites àrisque pouvant amener à une dépendance vis-à-vis du tabac, de l’alcoolou de la drogue.– Diagnostiquer une conduite addictive (tabac, alcool, psychotropes,substances illicites, jeux, activités sportives intensives...).– Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.– Décrire les principes de la prise en charge au long cours.Pour les internes de médecine générale, cette formation théorique initialepourrait être renforcée dans le cadre du programme du DES. En effet, l'article 2 del'Arrêté du 19 octobre 2001 relatif à l'organisation du troisième cycle des étudesmédicales stipule que l'enseignement théorique du troisième cycle de médecinegénérale porte sur les domaines suivants :17
• la médecine générale et son champ d'application ;• les gestes et techniques en médecine générale ;• les situations courantes en médecine générale ; stratégies diagnostiqueset thérapeutiques, leur évaluation ;• les conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et la placedes médecins généralistes dans le système de santé ;• la formation à la prévention, l'éducation à la santé et l'éducationthérapeutique ;• la préparation du médecin généraliste au recueil des données enépidémiologie, à la documentation, à la gestion du cabinet, à la formationmédicale continue et à la recherche en médecine générale.En conséquence, l'aide au sevrage tabagique recoupe plusieurs descompétences à acquérir au cours du DES de Médecine Générale de Poitiers :• Prendre en charge un problème de santé en soins de premier recours ;• Éduquer le patient à la gestion de sa santé ;• Entreprendre et participer à des actions de santé publique ;Ainsi, il est établi l'importance de la formation à la prévention dans le cursusdes internes, et notamment des internes de médecine générale.Cette étude sera l'occasion de faire le point sur l'éventuel besoin de formationcomplémentaire pour les internes de Poitou-Charentes et notamment pour lesinternes de médecine générale.18
3. LE PATIENT DEMANDANT UNE AIDE AU SEVRAGETABAGIQUECe chapitre a pour but de proposer une prise en charge simple à tout interne oumédecin qui souhaite poursuivre la prise en charge du sevrage tabagique de sonpatient au-delà du conseil minimal. Il a été rédigé à partir des recommandations dela HAS de 2007 (10), du guide de l'INPES « La prise en charge du patient fumeur enpratique quotidienne » (23), du « Guide de bonne pratique pour l'arrêt du tabac »édité par le réseau d'addictologie ADDICA (24) (Addictions précarité Champagne-Ardenne) et des cours du DIU de Tabacologie et aide au sevrage tabagique de larégion Ouest.3.1. Évaluer et renforcer sa motivationIl apparaît essentiel de préciser chez tout patient fumeur son niveau demotivation à changer son comportement de consommation. Pour expliquer lesdifférentes étapes de changement de comportement, le modèle le plus utilisé estcelui de Prochaska et DiClemente (25) (figure 1). Le rôle du médecin est d'aider sonpatient à renforcer sa motivation jusqu'au stade d'action : «je veux arrêter de fumer».Il s'agit de l'aider à comprendre son tabagisme et son ambivalence (le fumeur voitsouvent des bénéfices pour arrêter mais aussi des difficultés qui le poussent àcontinuer son tabagisme) et ainsi à renforcer sa confiance dans ses capacités dechangement.Si le patient exprime des difficultés voire des freins à l'arrêt du tabagisme, untemps est alors nécessaire pour reprendre avec lui ses ambivalences et aider àmodifier la balance décisionnelle en faveur de l’arrêt. L’évaluation de sa motivationpeut être complétée à l’aide de l’échelle Q-MAT (Annexe 2).19
Figure 1: Le cycle de Prochaska et Di ClementeLes cinq stades de changement du modèle de Prochaska :1. LA PRÉ-INTENTIONLa personne n'envisage pas de changer son comportement dans les six prochainsmois. Les raisons en sont variées : manque d'information, manque de confiance ensoi, échecs antérieurs, peur des conséquences...Attitude conseillée : Ne pas insister, mais lui faire exprimer les bénéfices qu’ilpourrait avoir à arrêter. Revoir le problème à une prochaine consultation. Resterdisponible et soutenir toute nouvelle démarche. Renforcer la motivation à chaqueoccasion.2. L'INTENTIONLa personne envisage de modifier ses habitudes dans un avenir relativementproche. Elle pèse le pour et le contre.Attitude conseillée : Lever les obstacles et rassurer : il est utile de s’investir pouressayer de renforcer cette intention en cherchant les obstacles à l’arrêt et enessayant de rassurer le patient sur ses craintes. Informer le patient des consultationsspécialisées de tabacologie.3. LA PRÉPARATIONLa décision est prise et la personne se prépare au changement. Elle se renseigne,demande conseil, recherche des informations...Attitude conseillée : Valoriser ses chances de succès « Vous me semblez trèsmotivé. Avec une bonne aide, vous y arriverez ! ». Mettre en évidence les bénéfices20
essentis lors de tentatives d'arrêt précédentes et les enseignements tirés de cestentatives. Proposer une aide au sevrage (proposer un traitement de substitutionnicotinique, orienter vers le médecin généraliste ou une consultation de tabacologie).Fixer éventuellement une date d'arrêt et un rendez-vous.4. L'ACTIONC'est une période d'environ six mois au cours de laquelle la personne modifie seshabitudes. Cela demande beaucoup d'attention et d'efforts au quotidien. C'est lapériode la plus délicate où le risque de revenir au comportement antérieur est le plusimportant pour des raisons diverses *.5. LE MAINTIENIl s'agit d'éviter les rechutes. L'effort à fournir est moins intense, la réussite et le faitde se sentir mieux renforcent la motivation, la personne a davantage confiance enses moyens *.Petit à petit, la personne a moins de tentation à revenir à la situation antérieure,même si elle se retrouve dans des situations à risque (stress, anxiété, dépression,convivialité...).* Ces 2 stades seront détaillés dans le paragraphe 3. 10. Surveiller et anticiper larechute.3.2. Aborder le sevrageL'objectif est de fournir une information claire et appropriée au patient, dans lecadre d'une relation empathique, afin de renforcer son adhésion à la prise en charge.• Expliquer au patient ce qu’est le sevrage : un phénomène en rapport avec unedépendance physique (besoin de nicotine) et psycho-comportementale(associée à des rituels de gestes automatiques, répétitifs et à des momentsparticuliers de plaisir, de convivialité, de stress, de concentrationintellectuelle…)• Informer sur les symptômes du manque nicotinique (irritabilité, troubles ducaractère, humeur dépressive, somnolence, agitation souvent associée aubesoin de fumer, troubles du sommeil, difficultés de concentration,augmentation de l’appétit, troubles intestinaux). Expliquer qu’un traitementpharmaceutique bien conduit permet de les éviter.21
3.9. Proposer un traitement d'aide à l'arrêt du tabac3.9.1. Le traitement de la dépendance physiqueActuellement, trois types de médicaments ont l'AMM dans le traitement du sevragetabagique : les traitements de substitution nicotiniques (TSN), le Bupropion(Zyban®) et la Varénicline (Champix®).Nous avons choisi dans notre travail de ne détailler que la substitution nicotinique.En effet, c'est le traitement de première intention et le seul traitement de ladépendance tabagique qui est disponible dans les pharmacies des hôpitaux duPoitou-Charentes et donc disponibles à la prescription des internes dans lesservices.- La varénicline (Champix®) est un agoniste partiel des récepteursnicotiniques cérébraux à l’acétylcholine. En raison des effets indésirables, enparticulier psychiques (état dépressif, idées suicidaires), le rapport efficacité/effetsindésirables de la varénicline est moyen. Selon la HAS (29), il ne doit être utiliséqu'en seconde intention, après échec des TSN. Il a été exclu du forfait annuel deremboursement par la Sécurité Sociale en juin 2011 (30).- Le bupropion (Zyban®) est un antidépresseur atypique inhibant la recapturede la dopamine et de la noradrénaline. En raison d'effets indésirables importants(allergies, insomnie, convulsions, troubles psychiatriques) et d'une efficacité nonsupérieure à la substitution nicotinique, sa balance bénéfices/risques estdéfavorable (31). Il ne doit pas être prescrit en première intention. Il est actuellementtrès peu utilisé dans les centres de tabacologie.Le principe de la substitution nicotinique est simple : remplacer la dose denicotine inhalée pour éviter les phénomènes de sevrage et améliorer ainsi le confortlors de l'arrêt du tabac.Les TSN sont recommandés chez les patients dépendants (Grade A). Dansune méta-analyse portant sur 96 essais thérapeutiques (4), les traitements desubstitution nicotinique (TSN) ont permis de doubler le taux d'abstinence tabagique àsix mois par rapport au placebo. A un an, 18 % des fumeurs ayant été traités par desTSN étaient abstinents, contre 10 % dans le groupe placebo.Les TSN ne présentent pas de contre-indication à part l'utilisation chez l'enfantde moins de 15 ans. Ils doivent être proposés en cas d'échec des thérapies25
cognitivo-comportementales chez les femmes enceintes (32). De plus, ils sont bientolérés chez les patients coronariens et peuvent être prescrits dès la sortie de l'unitéde soins intensifs au décours immédiat d'un infarctus du myocarde (grade C).Dosage des timbres de nicotine :• Timbres de 24h (prescrire de la nicotine la nuit évite les fortes pulsions àfumer au réveil). Il existe 3 dosages : 21, 14 et 7 mg.• Timbres de 16h en cas de troubles du sommeil à type de rêves oucauchemars et chez la femme enceinte : il existe 3 dosages : 25, 15 et 10 mg.Les formes orales de nicotine :• Si elles sont données seules : demander au patient de les prendre de façonrégulière dans la journée afin qu'il obtienne un taux de nicotinémie presqueconstant.• Si elles sont données en complément des timbres : le patient les prendra à saconvenance lors des envies de fumer.• Différentes formes orales existent :▪ Les gommes à 2 ou 4 mg , aromatisées ou non. Les gommes ne semâchent pas comme un chewing-gum ordinaire mais se mâchent demanière discontinue en les laissant dans le sillon jugal.▪ Les comprimés sublinguaux à 1,5 mg, 2 mg ou 4 mg▪ Les comprimés à sucer à 1 mg, 1,5 mg, 2 mg, 2,5 mg ou 4 mg▪ Un inhaleur de nicotine existe également et se prend comme les formesorales. Il présente un intérêt en cas de dépendance comportementale(poursuite d'une gestuelle). Une cartouche contient 10 mg de nicotine.Choix de la dose initiale :Chaque fumeur a sa façon de fumer et « tire » différemment sur sa cigarette.On estime qu'une cigarette industrielle fumée par jour équivaut approximativement à1 mg de nicotine (1 cigarette = 1 mg/24h). La dose réellement inhalée par le fumeurest donc très variable selon les individus (elle peut être évaluée par la mesure dutaux de CO expiré mais nous ne développerons pas ce point en raison de l'absencede ces appareils dans la plupart des services hospitaliers et des cabinets demédecine générale). Pour le tabac à rouler, un paquet de 40 grammes est26
approximativement équivalent à 80 cigarettes industrielles (soit 80 mg de nicotine).Le principal facteur de rechute étant l'inconfort du sevrage, le médecin ne doitpas craindre de prescrire des fortes doses de TSN : on peut commencer par desdoses élevées et diminuer les doses en cas de signes de surdosage. Le tableau IIprésente des exemples de dose initiale à proposer.Tableau II : Exemples de dose initiale à proposer (d'après l'INPES (23))Fume < 10cigarettes/jour10-19cigarettes/jour20-30cigarettes/jour> 30cigarettes/jourPas tous lesjoursPas le matin< 60 min. après lelever< 30 min. après lelever< 5 min. après leleverRien ou formeoraleRien ou formeorale- -Rien ou forme Rien ou forme Forme orale -oraleoraleRien ou forme Forme orale Timbre forte dose Timbre forte doseorale+/- forme orale- Timbre forte dose Timbre forte dose+/- forme oraleTimbre forte dose+ forme orale- Timbre forte dose Timbre forte dose Timbre forte dose+/- forme orale + forme orale + moyenne dose+/- forme oraleLe dosage du TSN est à adapter en fonction des signes de sous-dosage et desurdosage (voir le tableau III). En cas de sous-dosage, il faut augmenter les timbrespar palier. A l'inverse, en cas de signes de surdosage, il faut enlever le timbre. Lessignes de surdosage disparaissent en quelques heures et il faut alors reprendre leTSN au palier du dessous.Tableau III : Signes de sous-dosage et de surdosageSignes de sous-dosage• Pulsions à fumer• Irritabilité et colère• Anxiété• Agitation et nervosité• Difficultés de concentration• Augmentation de l'appétitSignes de surdosage• Impression d'avoir trop fumé• Nausées• Bouche pâteuse• Céphalées• Palpitations• Douleurs musculaires27
Durée de la substitution nicotinique : elle dépend de la dépendance et du vécu dupatient : au moins trois mois avec diminution des doses progressivement chaquemois. Ce traitement est souvent de 6 mois chez les patients très dépendants.Les prix sont libres, fixés par chaque pharmacie. Le prix est d' environ 2 à 3 €par jour. L’assurance maladie rembourse un forfait de 50 € par année civile et parpersonne (150 € pour les femmes enceintes depuis septembre 2011), surprescription médicale. De nombreuses mutuelles ou complémentaires santéproposent des prises en charge supplémentaires.3.9.2. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC)Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont des techniquesvalidées et recommandées dans l'aide à l'arrêt du tabac (grade A). Cette approcheest recommandée en première intention au cours de la grossesse (Accordprofessionnel) mais les substituts nicotiniques peuvent être proposés en cas d'échec.Les TCC ont pour but de favoriser le maintien de l'abstinence par un nouvelapprentissage. Elles interviennent à un niveau comportemental, cognitif etémotionnel afin de retrouver le contrôle de la consommation et d'éviter la rechute.Elles sont souvent nécessaires pour aider les patients à trouver les ressources dechangement de fonctionnement psychique sans le tabac (ex : gestion du stress, del'impulsivité, des émotions, confiance en soi, etc.). Elles multiplient par deux leschances de succès de sevrage à douze mois.Cependant, peu de praticiens sont formés à ces techniques. Une approchepsychologique qui privilégie le conseil individuel est donc recommandée (grade C).Ce processus est long et nécessite plusieurs consultations approfondies.3.9.3. Les thérapeutiques non-recommandéesLes thérapeutiques non recommandées par l'AFSSAPS dans l'aide ausevrage tabagique sont :• La clonidine, les antidépresseurs tricycliques, la buspirone, les inhibiteurs dela mono-amine oxydase, les anorexigènes, les bêta-bloquants, le Nicoprive®,28
les benzodiazépines sont des médicaments inadaptés qui font courir un risqueiatrogène non négligeable pour le patient,• L'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie, l'auriculothérapie, l'hypnosen'ont pas fait la preuve de leur efficacité mais peuvent être acceptées enraison de leur innocuité pour respecter les croyances des patients et renforcerleur adhésion.• La cigarette électronique ou « e-cigarette ». Elle reproduit l'apparence descigarettes classiques : une diode rouge simule visuellement la combustion etune résistance au contact d'une cartouche imbibée d' « e-liquide » (contenantsouvent de la nicotine) qui s’échauffe lors de l'inspiration et produit une vapeurinhalée par l'utilisateur. L'Afssaps a recommandé de ne pas utiliser lescigarettes électroniques mi-2011 (33), en raison de la composition des« e-liquides », variable et non-controlée et contenant des irritants bronchiques(notamment le propylène glycol), parfois des carcinogènes (nitrosamines) etdes agents pro-convulsivants (le menthol et le linalol). De plus, comme pour lacigarette, il existe un risque d'induire une dépendance. Leur vente n'est pasautorisée en officine (34).3.10. Réaliser un suivi rapproché, surveiller et anticiper larechuteLa réussite de l'arrêt tient aussi dans le suivi du patient : celui-ci doit être revurégulièrement en adaptant le rythme du suivi au cas par cas, selon le désir dupatient.Il existe deux phases dans l'arrêt du tabac :• La première est celle de la disparition de la dépendance physique quicorrespond au sevrage en nicotine et qui peut durer de 15 jours à 3mois. Il faut rechercher les signes de manque (syndrome de sevrage)ou de surdosage, adapter et ne pas diminuer trop rapidement les dosesde nicotine, rechercher la prise de poids et les troubles digestifs telsque la constipation, renforcer à chaque fois la motivation en mettant enavant les effets positifs de l'arrêt.29
• La seconde est celle de la disparition progressive de la dépendancepsycho-comportementale et correspond à la prévention des récidives. Ilfaut faire une prévention des rechutes en positionnant bien l'arrêt dansune démarche d'arrêt définitif et complet (beaucoup de fumeursimaginent pouvoir garder trois cigarettes « plaisir » dans la journée). Lefumeur doit faire le deuil de la cigarette.En cas de rechute, il faut expliquer aux patients que le mieux est de seremotiver rapidement. Une rechute n'est pas synonyme d'échec et il faut ladédramatiser. Cela ne signifie pas un retour à « la case départ » (voir le schéma deProchaska [figure 1]). Toute tentative infructueuse est une étape vers l'arrêt définitif.Le fumeur ayant rechuté ne sera plus jamais un « fumeur satisfait » (stade de prédétermination).Son expérience d'arrêt pourra être analysée afin d'augmenter leschances de réussite des tentatives ultérieures.30
4. MATÉRIEL ET MÉTHODE4.1. Conduite de l'étudeCette étude transversale, quantitative, concernait tous les internes de Poitou-Charentes. Un auto-questionnaire était remis à chaque interne lors de la session dechoix de stage du semestre d'été 2011 du 31 mars au 04 avril 2011 à l'ARS (AgenceRégionale de Santé) de Poitou-Charentes. Les internes absents lors de ce choix ontété sollicités par l'intermédiaire des personnes les représentant (à l'aide d'uneenveloppe timbrée pour le retour). Devant le faible taux de réponse des internesabsents à la session de choix à l'ARS, ceux-ci ont été sollicités par annonce àl'internat de Poitiers.Les questionnaires ont été récupérés dans une urne à disposition à l'ARS ainsiqu'à l'internat de Poitiers. L'étude s'est ainsi poursuivie jusqu'au 30 avril 2011.Le questionnaire pouvait être anonyme mais le nom était recommandé pouréviter les sollicitations multiples et les doublons.4.2. Données recueillies et analysées4.2.1. Données généralesLes données recueillies concernaient l'interne :• son sexe, son année de naissance (pour calculer l'âge) et son ancienneté ;• son statut tabagique (pour étudier la prévalence du tabagisme) ;• sa spécialité (afin d'étudier l'influence de celle-ci sur le statut tabagique, lapratique du conseil minimal, le maniement des TSN et le désir deformation).4.2.2. Pour étudier la prévalence du tabagismeLe statut tabagique était défini selon les critères habituels :• les fumeurs : fumeurs quotidiens (si l'interne consommait au moins unecigarette tous les jours) et occasionnels (pas tous les jours),• les non-fumeurs : ex-fumeurs (arrêt du tabac depuis au moins 6 mois) et« jamais fumeurs » (s'il n'avait jamais fumé),En raison d'un petit nombre d'internes dans certaines spécialités, les internes31
ont été regroupés en spécialités à gardes (spécialités chirurgicales, gynécologieobstétriqueet anesthésie-réanimation) et comparés aux internes de spécialitésmédicales, de médecine générale et aux autres internes (pédiatrie, biologiemédicale, médecine du travail, psychiatrie, santé publique).4.2.3. Pour étudier les déterminants du tabagisme des internesPlusieurs facteurs ont été étudiés afin d'étudier leur influence sur le statuttabagique actuel des internes (fumeurs versus non-fumeurs). Il s'agit du sexemasculin, de la pratique d'une spécialité à gardes, du fait d'avoir au moins un enfant,d'avoir un fumeur dans le foyer et d'avoir ou d'avoir eu un parent fumeur. Pour lesfemmes, l'absence de grossesse a été étudiée également.Les internes fumeurs et ex-fumeurs ont décrit l'évolution de leurconsommation de cigarettes pendant la préparation de l'ENC et la vie d'interne afind'étudier si ces périodes ont un retentissement sur le statut tabagique actuel desinternes.4.2.4. Pour étudier le tabagisme des internes fumeursLes fumeurs ou ex-fumeurs renseignaient leur histoire tabagique :• âge de la première cigarette et contexte. Les propositions de réponseconcernant le contexte de la première cigarette sont issues des étudesconcernant l'initiation du tabagisme chez les jeunes (35) : pour essayer(curiosité), convivialité, intégration dans un groupe, imitation d'un modèle,période de stress, autre (en précisant),• âge du tabagisme quotidien,• influence de l'ENC, de la vie d'interne et de la grossesse sur laconsommation.De plus, il a été demandé aux fumeurs s'ils souhaitaient arrêter leurtabagisme, avec le délai (à court terme [moins de 6 mois] ou à long terme [plus de 6mois]).Pour l'étude des déterminants de l'initiation du tabagisme, la catégorie socioprofessionnelledes parents (selon les dénominations de l'INSEE) et le statuttabagique des parents ont été demandés et comparés entre les internes n'ayantjamais fumé et les internes ayant fumé (fumeurs et ex-fumeurs).32
4.2.5. Pour étudier la pratique des internes en matière de conseilminimalIl était demandé aux internes une estimation de la fréquence de pratique dechaque question du conseil minimal dans leur pratique quotidienne. Les réponsespossibles étaient relativement larges pour refléter au mieux la réalité : jamais,parfois, souvent ou systématiquement. Ces réponses ont été comparées selon lestatut tabagique actuel (fumeurs versus non-fumeurs) et selon la spécialité : lesinternes de médecine générale, en tant que spécialistes des soins primaires enpremière ligne avec les patients fumeurs, ont été comparés aux autres internes.4.2.6. Pour étudier le besoin de formation en aide au sevragetabagiqueLes internes donnaient :• leur impression de maîtrise des traitements de substitution nicotinique(TSN) : plutôt bien, partiellement ou pas du tout. A nouveau, l'influence dustatut tabagique actuel (fumeurs versus non-fumeurs) a été étudiée.Les autres traitements de la dépendance tabagique n'ont pas fait l'objet dequestions car la méconnaissance de leur utilisation par les internes estmoins importante : ils ne sont indiqués qu'en seconde intention etprésentent une balance bénéfices-risques défavorable (cf partie 3.9.1).• leur désir d'approfondir leurs connaissances en aide au sevragetabagique : non ou oui, pourquoi pas ou oui, absolument.Pour ces deux variables, nous avons voulu étudier l'influence de la spécialitémédecine générale et les internes de médecine générale ont été comparés auxautres internes.4.3. Saisie et analyse des donnéesLa saisie des données a été effectuée de manière anonyme à l'aide du logicielEpi-Info version 3.5.3. L'analyse a été réalisée avec IBM SPSS Statistics version 19(IBM, USA). Les variables qualitatives ont été comparées à l'aide d'un Chi². Lorsquele test du Chi² n'a pas été applicable, un test de Fisher a été utilisé, avec la valeur dep strictement inférieure à 0,05 comme seuil de significativité. Les variablesquantitatives sont exprimées en moyenne (SD).33
5. RÉSULTATS5.1. Caractéristiques de la population étudiéeQuatre cent six internes en médecine (sur 649) ont répondu au questionnairesoit un taux de participation de 62,6 % (tableau IV).L'âge médian des répondants est de 27 ans et le sex-ratio est de 0,7 hommepar femme (169 hommes et 236 femmes). La médiane d'ancienneté des répondantsest de 4 semestres au 1er mai 2011 (trois validés et un débutant).Tableau IV: Taux de réponse en fonction de la spécialité.Spécialité choisie Nombre totald'internes NNombre derépondants n (%)Taux de réponse(%)Anesthésie-36 22 (5,4) 61,1RéanimationBiologie médicale 9 7 (1,7) 77,7Gynécologie-23 15 (3,7) 65,2ObstétriqueMédecine du travail 1 1 (0,2) 100Médecine générale 283 182 (44,8) 64,3Pédiatrie 32 18 (4,4) 56,2Psychiatrie 44 29 (7,1) 65,9Santé publique 5 5 (1,2) 100Spécialités79 36 (8,9) 45,6chirurgicalesSpécialités137 91 (22,4) 66,4médicalesTOTAL 649 406 (100) 62,634
5.2. Prévalence du tabagisme chez les internes5.2.1. Prévalence selon le sexeLe taux de prévalence du tabagisme est de 28,8 % parmi l'ensemble desinternes (31,4 % chez les hommes et 27 % chez les femmes), qui se répartissent en11,6 % de fumeurs occasionnels et 17,2 % de fumeurs quotidiens ; 7,9 % ont arrêtéet 63,3 % déclarent n'avoir jamais fumé.Le statut tabagique des internes en fonction du sexe est détaillé dans letableau V. Le tabagisme quotidien semble plus fréquent chez les hommes (20,1 %)que chez les femmes (15,2 %), mais la différence n'est pas significative (p=0,16).Néanmoins, il semblerait qu'il y ait une plus grande proportion de fumeurs quotidienschez les hommes ainsi qu'une plus grande proportion d'ex-fumeurs chez les femmes.Tableau V : Statut tabagique des internes selon le sexe.Hommes (%) Femmes (%) Ensemble desinternes (%)Âge moyen (médiane) 28 ans (28) 27 ans (27) 27,6 ans (27)Ancienneté moyenne 4,7 semestres (4) 4,6 semestres (4) 4,65 semestres (4)(médiane)Statut tabagique (p=0,16)- Jamais fumeurs 108 (63,9) 149 (62,9) 257 (63,3)- Ex-fumeurs 8 (4,7) 24 (10,1) 32 (7,9)- Fumeurs actuels 53 (31,4) 64 (27) 117 (28,8)fumeurs quotidiens 34 (20,1) 36 (15,2) 70 (17,2)fumeurs occasionnels 19 (11,3) 28 (11,8) 47 (11,6)Total 169 (100) 237 (100) 406 (100)5.2.2. Prévalence selon la spécialitéLe statut tabagique semble influencé par la spécialité exercée. On observe degrandes différences de prévalence du tabagisme selon les spécialités,d'interprétation très délicate en raison d'une perte de puissance importante à causede très petits groupes d'internes dans certaines spécialités (tableau VI). Parexemple, 44,8 % des internes de Psychiatrie sont fumeurs, 41,7 % parmi ceux deChirurgie, 40,9 % en Anesthésie-Réanimation, 27,5 % des internes de Médecine35
générale, 24,2 % des Spécialités médicales, 22,2 % des internes de Pédiatrie et 20%de ceux de Gynécologie-obstétrique.Tableau VI: Statut tabagique en fonction de la spécialité.SpécialitéchoisieAnesthésie-RéanimationBiologiemédicaleGynécologie-ObstétriqueMédecine dutravailMédecinegénéraleNombre d'ex-fumeursn (%)Nombre dejamaisfumeursn (%)Nombre defumeursoccasionnelsn (%)Nombre de Totalfumeursquotidiensn (%) N (%)5 (22,7) 8 (36,4) 3 (13,6) 6 (27,3) 22 (100)0 7 (100) 0 0 7 (100)3 (20) 9 (60) 1 (6,7) 2 (13,3) 15 (100)0 1 (100) 0 0 1 (100)9 (4,9) 123 (67,6) 22 (12,1) 28 (15,4) 182 (100)Pédiatrie 2 (11,1) 12 (66,7) 0 4 (22,2) 18 (100)Psychiatrie 1 (3,4) 15 (51,7) 7 (24,1) 6 (20,7) 29 (100)Santé 1 (20) 3 (60) 0 1 (20) 5 (100)publiqueSpécialités 1 (2,8) 20 (55,6) 4 (11,1) 11 (30,6) 36 (100)chirurgicalesSpécialités 10 (11) 59 (64,8) 10 (11) 12 (13,2) 91 (100)médicalesTOTAL 32 (7,9) 257 (63,3) 47 (11,6) 70 (17,2) 406 (100)Afin de pouvoir comparer la prévalence selon la spécialité, les spécialités àgardes (spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique et anesthésie-réanimation)ont été regroupées et comparées aux internes de spécialités médicales, demédecine générale et aux autres internes (pédiatrie, biologie médicale, médecine dutravail, psychiatrie, santé publique) selon leur statut tabagique (non-fumeurs versusfumeurs). Les résultats sont reportés dans le tableau VII et la figure 2.36
Tableau VII : Statut tabagique des internes selon la spécialité (p=0,133).Non-fumeurs*actuelsn (%)Fumeursactuelsn (%)TotalN (%)Médecine générale 132 (72,5) 50 (27,5) 182 (100)Spécialités médicales 69 (75,8) 22 (24,2) 91 (100)Spécialités à gardes 34 (58,6) 24 (41,4) 58 (100)Autres spécialités 54 (72) 21 (28) 75 (100)Total 289 (71,2) 117 (28,8) 406 (100)*Les non-fumeurs actuels comprennent les « jamais fumeurs » et les ex-fumeursPrévalence du tabagisme (%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%27% 24%73% 76%Médecinegénérale(N=182)Spécialitésmédicales(N=91)41%59%Spécialitésà gardes(N=58)28%72%Autres(N=75)Fumeurs actuelsNon-Fumeurs actuelsFigure 2 : Statut tabagique en fonction de la spécialité (p=0,133).Pris globalement, il n'y a pas de différence significative de prévalence dutabagisme entre les différentes spécialités (p=0,133). En revanche, on observe unedifférence significative (p=0,02) en comparant le statut tabagique des spécialités àgarde (internes de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'anesthésie-réanimation)aux autres internes. Les internes des spécialités à garde étant fumeurs dans 41,4 %des cas versus 26,7 % des autres internes.Le taux de prévalence du tabagisme est de 28,8 % parmi l'ensemble desinternes qui se répartissent en 11,6 % de fumeurs occasionnels et 17,2 % defumeurs quotidiens. Le statut tabagique semble influencé par la spécialitéexercée mais la différence est non significative.37
5.3. Déterminants du tabagisme des internes5.3.1. Déterminants du statut tabagique des internesIl n'y a pas de différence significative en fonction du sexe (27 % des femmesinternes sont fumeuses contre 31,4 % des hommes, p=0,34), ni du statut parental(29,7 % des internes n'ayant pas d'enfant sont fumeurs contre 21,4 % des internesayant un/des enfants, p=0,26). De même, les femmes internes ayant eu une/desgrossesses ont une prévalence du tabagisme (23,3 %) moins élevée que les autresfemmes internes (27,5 %) mais cette différence n'est pas significative (p=0,62).En revanche, la prévalence du tabagisme augmente significativement lorsquel'interne exerce une spécialité à gardes (gynécologie-obstétrique, chirurgie,anesthésie-réanimation), et qu'il a un fumeur au sein de son foyer.On note une tendance proche de la significativité à l'augmentation de laprévalence du tabagisme des internes lorsque l'un de ses parents est ou était fumeur(32,6 % versus 22,9 %, p=0,07).Tableau VIII : Etude des déterminants du tabagisme des internes.Non-fumeurs* actuels Fumeurs actuels pn (%)N=289n (%)N=117Sexe masculin 116/289 (40,1) 53/117 (45,3) 0,34Spécialités à gardes 34/289 (11,8) 24/117 (20,5) 0,02Sans enfant 256/289 (88,6) 108/117 (92,3) 0,26Fumeur dans le foyer 52/288 (18,1) 47/117 (40,2)
moment (10,9 %). On note une différence significative (p=0,035) entre les exfumeursqui ont augmenté leur tabagisme pendant la préparation de l'ENC dans28,6 % des cas versus 49,1 % des fumeurs actuels.Tableau IX : Internes fumeurs : influence de l'ENC sur la consommation de tabacselon le sexe (p=0,016).Hommesn (%)N=56Femmesn (%)N=82Ensemble des internesn (%)N=138Augmentation 32 (57,1) 30 (36,6) 62 (44,9)Pas demodificationou diminution24 (42,9) 52 (63,4) 76 (55,1)Tableau X : Internes fumeurs : influence de l'ENC sur la consommation tabagiqueselon le statut tabagique actuel (p=0,035).Ex-fumeursn (%)N=29Fumeurs actuelsn (%)N=109Ensemble des internesn (%)N=138Augmentation 8 (28,6) 54 (49,5) 62 (44,9)Pas demodificationou diminution21 (72,4) 55 (50,5) 76 (55,1)5.3.3. Influence de la vie d'interneDepuis le début de leur vie d'interne, 41,7 % des internes ont augmenté leurconsommation, sans différence hommes/femmes (p=0,7).On observe un lien significatif (p
Tableau XI : Internes fumeurs : influence de la vie d'interne sur la consommationtabagique selon le sexe (p=0,7).HommesN (%)n=57FemmesN (%)n=82Ensemble des internesN (%)n=139Augmentation 23 (40,3) 35 (42,7) 58 (41,7)Pas de modificationou diminution34 (59,7) 47 (57,3) 81 (58,3)Tableau XII : Internes fumeurs : influence de la vie d'interne sur la consommationtabagique selon le statut tabagique actuel (p
5.4. Étude du tabagisme des internes fumeurs5.4.1. Initiation du tabagismeL'étude de l'initiation du tabac chez les internes porte sur les 142 internesayant répondu à cette partie du questionnaire (sur 150 se déclarant fumeurs ou exfumeurs).Les résultats sont reportés dans les tableaux XIII à XIV).Les internes ont fumé leur première cigarette à 15 ans en moyenne (15,3 anspour les hommes et 14,8 ans pour les femmes) mais leur tabagisme quotidien adébuté à 18,4 ans en moyenne (19,8 ans pour les hommes et 17,8 ans pour lesfemmes). Si les internes ont le plus souvent fumé leur première cigarette au collège(pour 44,4 % d'entre eux) ou au lycée (43,7 %), c'est bien souvent au lycée (pour45,6 % d'entre eux) ou en PCEM (24,8 %) que le tabagisme quotidien a débuté.Tableau XIII: Internes fumeurs (quotidiens, occasionnels ou ex-fumeurs) : premièrecigarette et contexte.Hommesn (%)Femmesn (%)Ensemble des internesn (%)Niveau scolaire de début- Collège 23/61 (37,7) 40/81 (49,4) 63/142 (44,4)- Lycée 27/61 (44,3) 35/81 (43,2) 62/142 (43,7)- PCEM* 8/61 (13,1) 4/81 (4,9) 12/142 (8,5)- DCEM* 3/61 (4,9) 2/81 (2,5) 5/142 (3,5)Contexte de la premièrecigarette- Pour essayer 31/61 (50,8) 40/82 (48,8) 71/143 (49,7)- Convivialité 16/61 (26,2) 14/82 (17,1) 30/143 (21)- Période de stress 6/61 (9,8) 10/82 (12,2) 16/143 (11,2)- Imitation d'un 3/61 (4,9) 6/82 (7,3) 9/143 (6,3)modèle- Intégration dans un 4/61 (6,6) 11/82 (13,4) 15/143 (10,5)groupe- Autre 1/61 (1,6) 1/82 (1,2) 2/143 (1,4)41
Tableau XIV : Internes fumeurs (quotidiens, occasionnels ou ex-fumeurs) : début dutabagisme et contexte.Hommesn (%)Femmesn (%)Ensemble des internesn (%)Niveau scolaire deconsommationquotidienne- Collège 2/51 (3,9) 3/74 (4,1) 5/125 (4)- Lycée 21/51 (41,2) 36/74 (48,6) 57/125 (45,6)- PCEM* 11/51 (21,6) 20/74 (27) 31/125 (24,8)- DCEM* 13/51 (25,5) 10/74 (13,5) 23/125 (18,4)- TCEM* 4/51 (7,8) 5/74 (6,8) 9/125 (7,2)*PCEM, DCEM, TCEM : Premier, Deuxième et Troisième Cycle des EtudesMédicales.5.4.2. Déterminants de l'initiation du tabagisme chez les internes– La catégorie socio-professionnelle des parents (tableau XV) joue un rôledans l'initiation du tabagisme des internes. Les enfants des cadres,professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises sont fumeurs ouex-fumeurs dans 43% des cas, contre 7 % pour les enfants des ouvriers(p=0,042).42
Tableau XV : Déterminants du tabagisme : Catégorie socio-professionnelle desparents (p=0,042).Jamais fumeursn (%)Fumeurs actuelsou ex-fumeursn (%)TotalN (%)Agriculteurs 9 (75) 3 (25) 12 (100)Artisans 24 (64,9) 13 (35,1) 37 (100)Cadres, Professions126 (57) 95 (43) 221 (100)intellectuelles supérieureset Chefs d'entreprisesEmployés 41 (74,5) 14 (25,5) 55 (100)Ouvriers 12 (92,3) 1 (7,7) 13 (100)Professions intermédiaires 40 (65,6) 21 (34,4) 61 (100)Inconnue 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (100)Total 254 (63,2) 148 (36,8) 402 (100)– Le tabagisme des parents (tableau XVI) est associé de manière significative(p
5.4.3. Fumeurs quotidiensSur les 70 fumeurs quotidiens, 67 ont répondu aux questions précisant leurtabagisme. Aucun interne n'a déclaré fumer plus d'un paquet (20 cigarettes) par jouret la consommation moyenne est de 9,8 cigarettes par jour (10,9 pour les hommes et8,8 pour les femmes).5.4.4. Souhait d'arrêt du tabacLes internes fumant quotidiennement envisagent un arrêt plus fréquemment(87,7 %) et à plus court terme que les internes fumant occasionnellement (arrêtsouhaité dans 52,6 % des cas), avec un p
5.5. Pratique du conseil minimalSur cette partie du questionnaire, 14 internes n'ont pas répondu à la questionrelative à leur pratique de la première question du conseil minimal et 25 n'ont pasrépondu à la question relative à leur pratique de la deuxième question du conseilminimal. Les résultats sont reportés dans le tableau XVII.Question 1 : « Fumez-vous ?».Les internes pensent à pratiquer la première partie du conseil minimal à l'arrêt dutabac en demandant le statut tabagique de leurs patients dans la plupart des cas(71,6 % des internes le demandent souvent ou systématiquement).Question 2 : « Envisagez-vous l'arrêt du tabac ?».En revanche, la deuxième question du conseil minimal est moins souvent posée(47,1 % des internes la posent souvent ou systématiquement).Tableau XVII: Pratique du conseil minimal, question 1 : "Fumez-vous ?" et question 2: «Envisagez-vous l'arrêt du tabac ?».Question 1 : n (%)Question 2 : n (%)N=392N=382Jamais 38 (9,7) 67 (17,5)Parfois 73 (18,6) 135 (35,3)Souvent 163 (41,6) 134 (35,1)Systématiquement 118 (30,1) 46 (12)Il y a un lien significatif (p
5.5.1. Influence du statut tabagiqueNotre étude montre qu'il n'y a pas de différence significative de fréquence depratique du conseil minimal pour la question 1 « Fumez-vous ? » (p=0,07) et pour laquestion 2 « Envisagez-vous l'arrêt du tabac ? » (p=0,56) selon le statut tabagique(tableaux XVIII et XIX).Tableau XVIII : Pratique du conseil minimal selon le statut tabagique, question 1 :"Fumez-vous ?" (p=0,07)."Fumez-vous ?"Non-fumeurs actuels*n (%)Fumeurs actuelsn (%)N=276N=116Jamais 33 (12) 5 (4,3)Parfois 49 (17,8) 24 (20,7)Souvent 108 (39,1) 55 (47,4)Systématiquement 86 (31,2) 32 (27,6)*Les non-fumeurs actuels comprennent les « jamais fumeurs » et les ex-fumeursTableau XIX : Pratique du conseil minimal selon le statut tabagique, question 2 :"Envisagez-vous l'arrêt du tabac ?" (p=0,56)."Envisagez-vous l'arrêt ?"Non-fumeurs actuels*n (%)Fumeurs actuelsn (%)N=267N=115Jamais 48 (18) 19 (16,5)Parfois 92 (34,5) 43 (37,4)Souvent 91 (34,1) 43 (37,4)Systématiquement 36 (13,5) 10 (8,7)*Les non-fumeurs actuels comprennent les « jamais fumeurs » et les ex-fumeurs5.5.2. Influence de la spécialitéOn observe dans le tableau XX une différence significative (p
En moyenne, les internes de médecine générale ont tendance à pratiquer plusfréquemment (76,4 %) cette question du conseil minimal que les internes des autresspécialités (67,6 %) avec un p =0,055.Tableau XX : Pratique du conseil minimal selon la spécialité, question 1 : "Fumezvous?" (p
5.6. Maîtrise de la prescription des traitements de substitutionnicotiniques5.6.1. Influence du statut tabagiqueTableau XXII : Maniement des TSN selon le statut tabagique (p=0,05).Jamais fumeursn (%)Fumeurs etex-fumeursn (%)Ensemble desinternesn (%)N=256N=149N=405Pas du tout 75 (29,3) 33 (22,1) 108 (26,7)Partiellement 149 (58,2) 85 (57) 234 (57,8)Plutôt bien 32 (12,5) 31 (20,8) 63 (15,6)Une grande majorité des internes (84,4 %) n'a pas l'impression de « plutôtbien » manier les TSN. Cependant, on observe une différence significative (p=0,05)entre les internes n'ayant jamais fumé (dont 12,5 % pensent savoir « plutôt bien »manier les TSN) et les internes ayant l'expérience du tabagisme (20,8 %).(tableauXXII et figure 3)Impression de maîtrise des TSN (%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%13%21%29%22%58% 57%Plutôt bienPas du toutPartiellement0%Jamais fumeurs (N=256)Fumeurs actuels et ex-fumeurs (N=149)Figure 3 : Maniement des TSN selon le statut tabagique (p=0,05).48
5.6.2. Influence de la spécialitéDans le tableau XXIII et la figure 4, on voit que les internes de médecinegénérale maîtrisent peut-être mieux les TSN que les internes de spécialités, mais ladifférence n'est pas significative (p=0,23). Parmi les internes de médecine générale,61% ont le sentiment de savoir manier partiellement les TSN et 22,5% ne savent pasdu tout les manier.Tableau XXIII : Maniement des TSN selon la spécialité (p=0,23).Internes demédecine généralen (%)Internes des autresspécialitésn (%)Ensemble desinternesn (%)N=182N=223N=405Pas du tout 41 (22,5) 67 (30) 108 (26,7)Partiellement 111 (61) 123 (55,2) 234 (57,8)Plutôt bien 30 (16,5) 33 (14,8) 63 (15,6)100%Impression de maîtrise des TSN (%)90%80%70%60%50%40%30%20%16% 15%23% 30%61%55%Plutôt bienPas du toutPartiellement10%0%Internes de médecine générale (N= 182) Internes des autres spécialités(N=223)Figure 4: Maniement des TSN selon la spécialité (p=0,23).49
5.7. Souhait de formation à l'aide au sevrage tabagiqueA la question «Souhaites-tu approfondir tes connaissances sur l'aide ausevrage tabagique ?», les internes répondent positivement dans 84,2 % des cas(Tableau XXIV et figure 5). Les internes de médecine générale souhaitent uneformation dans 94,5% des cas, et près d'un futur généraliste sur trois souhaite« absolument » cette formation (différence significative par rapport aux internes desautres spécialités avec p
6. DISCUSSION6.1. Biais possibles de l'étudeCette étude concerne uniquement les internes en médecine de Poitou-Charentes. Il est possible que cet échantillon ne soit pas représentatif des internesfrançais (l'enquête ESCAPAD de Poitou-Charentes montre une différencesignificative dans la prévalence du tabagisme chez les jeunes par rapport à lapopulation nationale) (36).L'étude reposant sur des données déclaratives, certains biais ne pouvaientêtre évités. Il s'agit d'une part du biais de désirabilité sociale, amenant au choix de laréponse conforme aux attentes sociales (notamment pour le projet d'arrêt du tabac,de la pratique du conseil minimal et de la maîtrise de la prescription des substitutsnicotiniques) et d'autre part du biais de mémoire concernant les questions relatives àl'initiation du tabagisme chez les fumeurs.En ce qui concerne l'étude des connaissances et pratiques des internes enmatière de tabacologie, nos questions concernaient la pratique du conseil minimal,l'impression subjective de maîtrise des TSN ainsi que le souhait d'approfondir leursconnaissances dans l' aide au sevrage. Nous aurions également pu nous intéresserà la connaissance de l'entretien motivationnel et à son application en pratiquequotidienne auprès des patients fumeurs et à l'utilisation de questionnaires pourévaluer la dépendance ou la motivation. Cependant, nos questions ont eu pour butd'évaluer des paramètres simples (pour obtenir un meilleur taux de réponse) et desnotions indispensables pour une bonne prise en charge des patients fumeurs.Dans l'étude des déterminants de l'initiation du tabagisme, seuls la catégoriesocio-professionnelle des parents, et le statut tabagique des parents étaientdemandés. Les études sur les adolescents étudient habituellement d'autres facteursde risque de tabagisme (divorce des parents, traumatisme dans l'enfance, statuttabagique des amis, nombres de fumeurs dans la famille, tolérance de l'entourage,etc.) (35 ; 37) Sur ce point, notre étude n'est pas exhaustive afin d'utiliser unquestionnaire facile à remplir et peu intrusif.51
6.2. Caractéristiques de la population étudiéeLe taux de participation à l'étude est satisfaisant (62,6 %) avec 100 % dequestionnaires exploitables. Toutes les spécialités sont représentées avec des tauxde participation variables mais toujours corrects. Certaines spécialités sont moinsbien représentées, notamment les internes de spécialités chirurgicales (45,6 %) etles internes de pédiatrie (56,2 %). Cela est probablement expliqué par un tauxd'absentéisme élevé lors de la session de choix des stages.6.3. Prévalence du tabagisme chez les internes6.3.1. Prévalence du tabagisme chez les internes selon le sexeA l'instar des études sur le statut tabagique des médecins généralistes (38)mais à l'inverse de la dernière étude sur la population générale (12), la prévalence dutabagisme chez les internes diminue. Elle est passée de 36 % en 2001 (1) à 28,8%dans notre étude. La prévalence du tabagisme quotidien chez les internes (17,2%,dont 20,1 % pour les hommes [27 % en 2001] et 15,2 % [19 % en 2001] pour lesfemmes) est inférieure à celle de la population générale de la même classe d'âge(47,5 % pour les hommes et 35,8 % chez les femmes) d'après le Baromètre SantéINPES 2010 pour les 26-34 ans (12) mais également inférieure à celle des cadres(23,8 %) et des étudiants (23,5 %). Si la prévalence du tabagisme quotidien desfemmes a augmenté dans la population générale entre 2005 et 2010 (de 31,7 % à 35% chez les 26-34 ans), elle a diminué chez les internes.En revanche, si le tabagisme occasionnel diminue également chez lesinternes en médecine (11,6 % [11,3 % des hommes et 11,8% des femmes] au lieu de13 % en 2001 (1), ce mode de consommation est plus répandu chez les internes quedans la population générale (4,6 % de la population de 15-75 ans (12). Il aurait étéintéressant d'interroger les internes fumant occasionnellement sur les circonstancesdans lesquelles ils fument mais on peut supposer que les fêtes et soirées,nombreuses pendant la vie d'interne, jouent un rôle.52
6.3.2. Prévalence du tabagisme chez les internes selon la spécialitéNous n'avons pas retrouvé d'étude sur ce sujet. Globalement, probablementen raison d'échantillons trop faibles par spécialité, il n'y a pas de différencesignificative de prévalence du tabagisme entre les différentes spécialités (p=0,133).En revanche, il existe une différence significative (p=0,02) en comparant le statuttabagique des spécialités à gardes (internes de chirurgie, de gynécologie-obstétriqueet d'anesthésie-réanimation) à celui des autres internes. Les internes des spécialitésà gardes étant fumeurs dans 41,4 % des cas versus 26,7 % chez les autres internes.Ceci peut être expliqué en partie par un stress au travail plus important, un effet degroupe, le rôle stimulant de la nicotine lors des gardes et éventuellement unemoindre relation de ces spécialités avec les pathologies induites par le tabac.6.4. Déterminants du tabagisme des internesNotre étude avait pour objectif secondaire de rechercher les déterminants dutabagisme des internes, cela afin de pouvoir éventuellement mettre en place desactions de prévention ciblées. Le statut de fumeur est influencé par l'exercice d'unespécialité à gardes et la présence d'un fumeur dans le foyer (par exemple le conjointou un colocataire). Il existe une tendance proche de la significativité si un parent estou était fumeur. En revanche, les différences de prévalence du tabagisme entre lesinternes fumeurs et non-fumeurs pour le sexe, le fait d'être parent, le fait d'avoir euune grossesse ne sont pas significatives, probablement en raison d'un échantillontrop petit mais respectent les tendances retrouvées dans des études sur lapopulation générale (39-40).Les internes ex-fumeurs étant plus fréquemment ceux qui ont réussi àcontrôler leur consommation tabagique au moment de la préparation de l'ENC et dela vie d'interne, il serait intéressant de sensibiliser les externes, et notamment leshommes, peut-être plus vulnérables, au contrôle de leur consommation tabagiquependant ces périodes très anxiogènes de leur formation.53
6.5. Tabagisme des internes fumeurs6.5.1. Influence des grossessesParmi les 9 internes fumeuses avant leur grossesse, toutes ont diminué leurconsommation tabagique pendant la grossesse et la majorité a arrêté, ce quitémoigne d'une responsabilisation importante des internes enceintes, informées desrisques de l'intoxication tabagique pendant la grossesse. Si toutes ont repris leurtabagisme après la grossesse, deux internes ont arrêté définitivement plus tard.6.5.2. Initiation du tabagisme des internesL'âge moyen de la première cigarette est de 15 ans chez les internes, soit unâge plus tardif que pour la population générale (41). Dans notre étude, les internesfumeuses fumaient leur première cigarette plus jeunes que les hommes (14,8 anscontre 15,3 ans pour les garçons) et débutaient également leur consommationquotidienne plus tôt (17,8 ans contre 19,8 ans pour les garçons). Le tabagisme chezles internes est donc plus tardif que chez les adolescents de la même génération. Eneffet, en 2002 (41), sur le plan national, les filles fumaient leur première cigarette à13,7 ans et les garçons à 13,6 ans. Les filles devenaient des fumeurs réguliers à14,8 ans et les garçons à 14,7 ans, le pic d'initiation au tabagisme correspondant à laclasse de troisième (37). Dans notre étude, le contexte de la première cigarette est leplus souvent « pour essayer » (49,7 %). En effet, la curiosité d'une nouvelleexpérimentation est le motif le plus fréquent dans les études chez l'adolescent (35).Puis, viennent « la convivialité » (21 %) ainsi qu'une « période de stress » (11,2 %). «L'intégration dans un groupe » semble plus importante pour les femmes (13,4 %) quepour les hommes (6,6 %) et «l'imitation d'un modèle» est peu exprimée dans notreétude, peut-être en raison d'une connotation plus négative.Si les internes ont le plus souvent expérimenté leur première cigarette aucollège (44,4 %) ou au lycée (43,7 %), c'est bien souvent au lycée (45,6 %) ou enPCEM (24,8 %) que le tabagisme quotidien a débuté. C'est donc à cette période queles campagnes de sensibilisation doivent être proposées pour éviter un éventuelcomportement addictif.6.5.3. Déterminants de l'initiation du tabagisme des internesLe tabagisme des parents et la catégorie socio-professionnelle des parents54
sont associés de manière significative (p
(44), 90 % des internes interrogés demandaient souvent ou systématiquement lestatut tabagique de leurs patients. Dans l'étude de l'Office Français de Prévention duTabagisme (OFT) de 2001 (1), ceux-ci interrogeaient leurs patientssystématiquement sur leur statut tabagique dans 76 % des cas. Nous pouvons doncestimer qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'identification des patients fumeurs en dixans et que les internes du Poitou-Charentes semblent poser cette question moinssystématiquement que leurs voisins de la région Centre.6.6.2. Demande de l'éventuel projet d'arrêt du tabacPour la deuxième question du conseil minimal, concernant l'intention d'arrêt dutabac, seulement 47,1 % des internes la posent souvent ou systématiquement et17,5 % ne la posent jamais. Ainsi, le conseil minimal n'est pratiqué dans sonintégralité de manière systématique que par 8,9 % des internes et seuls 36 % d'entreeux le pratiquent « souvent » dans son intégralité malgré les recommandations del'AFSSAPS de 2003 (4) et de la conférence de consensus sur l'arrêt du tabac de1998 (16) qui recommandent une pratique systématique par tous les médecins, afind'initier de nombreux arrêts du tabac supplémentaires chaque année. Au CHRU deTours, en 2010 (44), 78 % des internes interrogés connaissaient le « conseilminimal » avec ses deux questions. Il aurait été intéressant dans notre étude dedemander aux internes s'ils connaissaient le « conseil minimal » ou s'ils posaient cesquestions parce qu’elles leur semblaient pertinentes. En effet, pour expliquer lesdifférences importantes de pratique de la première question (statut tabagique) parrapport à la deuxième question (souhait d'arrêt du tabac), nous pouvons émettrel'hypothèse que le statut tabagique est demandé le plus souvent par habitude,donnée importante du dossier médical et donc pas du tout dans le concept du« conseil minimal ».6.6.3. Influence du statut tabagique sur la pratique du conseilminimalNotre étude ne retrouve pas de différence significative de fréquence depratique du conseil minimal selon le statut tabagique, à l'instar de l'étude de l'OFT de2001 (1).Cependant, de nombreuses études sur les médecins généralistes (45-49) etdeux études sur les internes en médecine (44;50) ont montré une influence du statut56
tabagique sur la pratique du conseil minimal. Dans ces études, les médecinsfumeurs étaient moins performants pour la pratique du conseil minimal que lesmédecins non-fumeurs.• Concernant les internes en médecine, une étude réalisée en Turquie (50) amontré que le statut tabagique de l'interne influence la prise en charge dusevrage tabagique de ses patients. Les internes fumeurs ont moinsconfiance en leur efficacité pour l'arrêt du tabac (14,5 % versus 34,2 %) etont tendance à moins conseiller leurs patients que les internes nonfumeurs.Les auteurs concluaient que la politique de santé publique enTurquie devrait encourager les étudiants en médecine et les internes àarrêter leur tabagisme et les entraîner à l'aide au sevrage tabagique afind'améliorer leur efficacité auprès des fumeurs.• Dans l'étude réalisée en 2010 au CHRU de Tours (44), une différence depratique significative dans la recherche du statut tabagique existaitégalement : 93,6 % des non-fumeurs identifiaient fréquemment les patientsfumeurs contre 79,5 % pour les fumeurs (p=0,02).• D'autres études ont montré que le statut tabagique du médecin influençait sapratique de l'abord du tabagisme en consultation (47-49). Dans l'étude STOP(46), étude internationale réalisée en 2006 portant sur 2836 médecinsgénéralistes de 16 pays, les médecins non-fumeurs abordaientsystématiquement le tabagisme dans 45 % des cas (contre 34 % pour lesfumeurs, p
Il est étonnant que les internes de médecine générale soient moinssystématiques pour poser cette question par rapport aux internes des autresspécialités. Cela peut s'expliquer par le mode de recueil de données (questionnaire)qui n'est pas objectif. Il est possible que certains internes de médecine généralesous-estiment leur pratique du conseil minimal, conscients de leur rôle importantdans ce domaine. En moyenne, même s'ils sont moins systématiques pour poser lapremière question du conseil minimal, les internes de médecine générale onttendance à pratiquer plus fréquemment cette question que les internes des autresspécialités (76,4 % versus 67,6 % ; p =0,055).En revanche, on observe une différence significative dans la pratique de laquestion 2 « Envisagez-vous l'arrêt du tabac ? » selon la spécialité ; les internes demédecine générale posant cette question à leurs patients plus fréquemment que lesautres internes.Aucune autre étude comparant la pratique du conseil minimal entre desinternes de médecine générale et des internes de spécialités n'a été trouvée dans lalittérature. Dans l'étude du CHRU de Tours (44), les internes des spécialitésradiologie et chirurgie digestive étaient les mauvais identifiants du statut tabagique.Toutefois, dans notre étude, certaines spécialités interrogées étaient non-cliniques(biologie, radiologie, anatomopathologie, santé publique) et font ainsi baisser lescore de pratique du conseil minimal de tous les internes de spécialités. Néanmoins,ce biais a été atténué par une absence de réponses à ces questions chez la plupartdes internes qui ne se sentaient pas concernés ; quatorze internes n'ont pasrépondu : les sept internes de biologie, trois de santé publique (sur les cinq ayantrépondu), un de radiologie (sur les treize ayant répondu) et un d’anatomopathologie(sur les cinq ayant répondu).6.7. Maîtrise de la prescription des TSNUne grande majorité d'internes (84,4 %) n'a pas l'impression de « plutôt bien »manier les TSN. Cependant, on observe une différence significative (p = 0,05) entreles internes n'ayant jamais fumé (12,5 % pensent savoir « plutôt bien » manier lesTSN) et les internes ayant l'expérience du tabagisme (20,8 %). Notre étude montreégalement que les internes de médecine générale maîtrisent peut-être mieux les58
TSN que les internes de spécialités, mais la différence n'est pas significative. Il estnécessaire que les internes de médecine générale, qui seront les intervenants depremier recours rencontrant les patients fumeurs avant la survenue de complicationspuissent prendre en charge leurs patients le mieux possible ; or 61 % d'entre eux ontle sentiment de savoir manier partiellement les TSN et 22,5 % ne savent pas du toutles manier. 30 % des internes des autres spécialités, les premiers prescripteurs dansleurs services respectifs ne savent pas du tout manier les TSN. Pourtant, un grandnombre de malades hospitalisés sont fumeurs et nécessiteraient une prévention dusyndrome de sevrage nicotinique.6.8. Souhait de formation à l'aide au sevrage tabagiqueDans notre étude, les internes souhaitent approfondir leurs connaissances surl'aide au sevrage tabagique dans 84,2 % des cas. Les internes de médecinegénérale souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce sujet dans 94,5 % descas et près d'un futur généraliste sur trois le souhaite « absolument ». Cela montrebien le sentiment de responsabilité de ces futurs médecins de premier recours dansla prévention secondaire auprès de leurs patients.En 2001 déjà, 81 % des internes ne s'estimaient pas formés à l'usage desTSN (1). Il n'y a donc pas eu de nets progrès dans ce domaine. Nos résultats sontcomparables à ceux de l'étude réalisée au CHRU de Tours (44) En 2010 : 28 % desinternes étaient très intéressés par une formation en tabacologie et 51 % étaient « unpeu » intéressés. Les résultats de l'enquête réalisée au CHRU de Tours ont permisl'élaboration d'un outil intranet comportant un guide pour l'abord des patients fumeurs(cf annexe 5), un guide destiné aux patients et des ordonnances pour la prescriptiondes substituts nicotiniques.Plusieurs études ont montré l'efficacité de la formation des internes enmédecine en aide au sevrage tabagique :• une étude de 1992 publiée dans la revue américaine Family Medicine (51)a montré que les internes de médecine générale et de médecine interneayant eu une formation courte (de trois heures, comportant des échangesen groupe et des vidéos de jeux de rôle) ont augmenté significativementleur compétence en conseil d' arrêt du tabac un an après avoir reçu cetteformation.59
• Une étude suisse publiée en 2002 dans Annals of Internal Medicine (52)montrait que les internes formés au sevrage tabagique (formation dite« active » de deux demi-journées comprenant l'analyse de vidéos depatients à différents stades de maturation vers l'arrêt, des jeux de rôleentre étudiants puis avec d'anciens fumeurs) réussissaientsignificativement mieux à faire arrêter le tabagisme à leurs patients que lesinternes non-formés (13 % d'arrêt à un an versus 5 %) et donnaient demeilleurs conseils.Cependant, si les programmes d'entrainement à l'arrêt du tabac ont amélioréla fréquence et la qualité des interventions réalisées par les internes (51-56) les tauxd'arrêt du tabagisme obtenus à distance n'ont été étudiés que dans une seule étude(52).De nombreuses études sur l'intérêt de former les médecins généralistes àl'aide au sevrage tabagique ont été réalisées. Toutes montraient que les formationsconcernant l' aide à l'arrêt du tabac augmentaient la fréquence et la qualité desinterventions réalisées par les médecins généralistes (57-59). Cependant, les tauxd'arrêt du tabagisme obtenus à six mois ou un an n'avaient augmentésignificativement que dans deux études (60-61) :• dans la première étude (60), 8,8 % des fumeurs ont arrêté leur tabagismeun an après la consultation quand les médecins étaient formés au conseilà l'arrêt, à la prescription des substituts, qu'ils fixaient une date d'arrêt etproposaient quatre consultations de suivi (versus 4,4 % en l'absence deformation).• dans la seconde étude (61), les médecins recevaient 2 cours sur lesstades de changement du comportement avec les conseils adaptés àchaque stade : 28,6 % des fumeurs ont arrêté à six mois (versus 4,3%pour les médecins non-formés) et plus de la moitié des autres patientsfumeurs ont diminué leur consommation.Les principaux freins à l'enseignement des addictions chez les internes ont étédécrits aux USA en 2003 (62) : manque d'intérêt des responsables des programmes60
des facultés, manque de temps d'enseignement, de matériel adapté et d'expertisesur ce sujet dans certaines facultés.Le DES de Médecine Générale de Poitou-Charentes ne propose pas deformation particulière à l'aide au sevrage tabagique. En effet, même si cettecompétence du médecin généraliste semble indispensable à maîtriser dans le butd'une amélioration de la santé publique, les internes devraient déjà être efficacementformés à la fin du DCEM. Ils devraient encore s'améliorer au cours de leur(s)stage(s) en ambulatoire et de leurs recherches personnelles (auto-apprentissage). Ilest donc légitime de ne pas proposer cet enseignement supplémentaire à unprogramme de séminaires et GEAPI (Groupe d’Échange et d'Analyse des Pratiquesentre Internes) déjà très riche.Cependant, devant le souhait massif des internes, et notamment de 94,5%des internes de médecine générale, d'approfondir leurs connaissances en aide ausevrage tabagique, il pourrait être intéressant de mettre en place une formation àproposer à tous ou d'inciter les internes à enrichir leurs connaissances en leurproposant des ressources adaptées. Si de telles actions amélioreraient certainementles connaissances et le sentiment d'efficacité des internes formés, il seraitintéressant d'en mesurer l'efficacité à long terme sur les taux d'arrêt de leurs patientsfumeurs.61
7. CONCLUSIONCette étude montre que la prévalence du tabagisme chez les internes enmédecine (28,8 % dont 11,6 % de fumeurs occasionnels et 17,2 % de fumeursquotidiens) est en nette diminution depuis 10 ans et inférieure à la prévalence dutabagisme dans la population générale. L'exercice d'une spécialité à gardes(spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique et anesthésie-réanimation) et laprésence d'un fumeur dans le foyer sont associés de manière significative autabagisme des internes. Les internes ayant arrêté leur tabagisme sont ceux qui ontpu contrôler leur consommation pendant la préparation de l'ENC et lors de la vied'interne. En moyenne, les internes fumeurs ont expérimenté leur première cigaretteà 15 ans, le plus souvent « pour essayer » et sont devenus fumeurs quotidiens à18,4 ans. Les internes fumant quotidiennement fument en moyenne 9,8cigarettes/jour et envisagent un arrêt plus fréquemment et à plus court terme que lesinternes fumant occasionnellement.Les internes ne sont pas suffisamment impliqués dans l'aide à l'arrêt du tabac,qui concerne pourtant toutes les spécialités cliniques. En ce qui concerne la pratiquedu conseil minimal, 71,6 % des internes demandent souvent ou systématiquement lestatut tabagique de leurs patients, et seulement 47,1 % leur intention d'arrêt dutabac. Ainsi, le conseil minimal n'est pratiqué dans son intégralité de manièresystématique que pour 8,9 % des internes, malgré les recommandations del'AFSSAPS pour une pratique systématique (4). Le statut tabagique des internesn'influence pas la pratique du conseil minimal dans notre étude. Une minorité desinternes a l'impression de maîtriser les TSN et 84,2 % d'entre eux souhaitent uneformation sur l'aide au sevrage tabagique.Les internes de médecine générale ont tendance à poser plus fréquemment lapremière question du conseil minimal « Fumez-vous ?» et pratiquent plusfréquemment la question 2 « Envisagez-vous l'arrêt du tabac ». Cependant, ils nemaîtrisent pas mieux les substituts nicotiniques que les autres internes et souhaitentapprofondir leurs connaissances sur ce sujet dans 94,5 % des cas. Cela montre lesentiment de responsabilité de ces futurs médecins de premier recours dans laprévention secondaire auprès de leurs patients.62
Ainsi, l'enseignement de tabacologie au cours du deuxième cycle des étudesmédicales doit être renforcé et une formation pratique complémentaire en débutd'internat pourrait être proposée pour améliorer la prise en charge des patientsfumeurs, notamment pour les internes de médecine générale. De plus, un guide deprise en charge des patients fumeurs à destination des internes des hôpitaux dePoitou-Charentes ainsi qu'un guide à l'usage du fumeur pourrait être édité etdisponible sur l'intranet des hôpitaux afin que toute hospitalisation d'un fumeur soitune opportunité pour initier une démarche de sevrage.Des actions de prévention et d'aide à l'arrêt du tabac à destination desétudiants en médecine pourraient cibler préférentiellement les internes pratiquantune spécialité à gardes et les externes qui préparent l'ENC pour une maîtrise de leurconsommation. Les fumeurs occasionnels devraient également être sensibilisés auxrisques du tabagisme intermittent.Les efforts de recherche portent davantage sur le traitement des cancers etdes maladies induites par le tabac, que sur les traitements du tabagisme, qui en estpourtant la cause. L'amélioration des pratiques professionnelles médicales enmatière de prévention est peut-être une façon moins coûteuse et plus efficace dediminuer la morbi-mortalité des maladies induites par le tabac.Des études complémentaires pourraient étudier l'efficacité éventuelle de cesactions de prévention et d'éducation sur la prévalence du tabagisme des internesmais aussi sur les taux d'arrêt du tabac de leurs patients à long terme.63
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES1. Salomon L, Levu S, Steffen C, Papy E, Blanchon T, Dautzenberg B, et al. Lesinternes et le tabagisme : connaissances et pratiques. BEH 2001;40:195-97.2. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Tabac :Ouvrons le dialogue. Paris : INPES, 2009:24.3. Slama K, Karsenty S, Hirsch A. Effectiveness of minimal intervention by generalpractitioners with their smoking patients: a randomised, controlled trial in France.Tob Control 1995;4:162-9.4. AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.Stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de l’aide àl’arrêt du tabac. Recommandations de bonne pratique 2003:39.5. Doll R. Mortality in relation to smoking : 50 years’ observations on male Britishdoctors. BMJ 2004;328:1519–30.6. OMS : Organisation mondiale de la santé. Rapport OMS sur l’épidémie mondialede tabagisme 2009 - Créer des espaces non fumeurs. Site internet de l'OMS, [Enligne]. (Page consultéele 26 janvier 2012)7. Hill C. Épidémiologie du tabagisme. Rev Prat 2012;62:325-329.8. Hill C. Conséquences du tabagisme sur la santé. Dans : Martinet Y, Bohadana A.Le tabagisme. Paris : Masson, 2004:62.9. Institut National du Cancer. Le tabac est le principal facteur de risque de cancersen France. Site de l'Institut National du Cancer, [En ligne].(Page consultée le 26 janvier 2012).10. Haute Autorité de Santé. Stratégies thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique :efficacité, efficience et prise en charge financière. Saint Denis : HAS, 2007:122.11. OMS. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Site internet de l'OMS,[En ligne]. (Page consultéele 26 janvier 2012)12. Beck F, Guignard R, Richard JB, Wilquin JL, Peretti-Watel P. Baromètre santéINPES 2010. Premiers résultats du baromètre santé 2010 : Evolutions récentesdu tabagisme en France. Site de l'INPES [En ligne](Page consultée le 12 mars 2012).13. Belot A, Velten M, Grosclaude P, Bossard N, Launoy G, Remontet L, et al.Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre1980 et 2005. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire, 2008:132.64
14. A U.S. Public Health Service report. A clinical practice guideline for treatingtobacco use and dependence: 2008 update. Am J Prev Med 2008;35:158-76.15. Stead LF, Bergson G, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation.Cochrane Database Syst Rev. 2008;CD000165.16. Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). L'arrêt de laconsommation de tabac. Conférence de consensus : Paris, 8-9 octobre 1998.Paris : Éditions EDK, 1998;412.17. Société Française de Médecine Générale (SFMG). Annuaire statistique del’Observatoire de la Médecine Générale. La lettre de la médecine générale1998;52:87.18. Léon C, Gautier A. Les professionnels de santé face au tabagisme : résultats del’enquête Baromètre santé médecins/pharmaciens 2003. BEH 2005;2:101-2.19. Vannobel R, Dépinoy D, Masure M. L’aide à l’arrêt du tabac en médecinegénérale, étude de pratique qualitative et prospective sur 24 patients. Exercer2006;77:54-60.20. Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), Association françaisede chirurgie, Office français de prévention du tabagisme. Conférence d'experts,texte court, 23 septembre 2005 à Paris : Tabagisme péri-opératoire. Dans :SFAR, eds. Ann Fr Anesth. Réanim, volume 25. Paris : Masson, 2006:479-481.21. Dautzenberg B, Dureuil B, Trosini V, Masquelet AJ. Le défi de la prise en chargedu tabagisme péri-opératoire. BEH 2006;21:142–5.22. Office français de prévention du tabagisme (OFT), Fédération française depsychiatrie (FFP). Arrêt du tabac chez les patients atteints d’affectionspsychiatriques. Conférence d’experts 2008. Texte long. Recommandations,janvier 2009. Paris : Office français de prévention du tabagisme (OFT), 2009:8.23. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). La prise encharge du patient fumeur en pratique quotidienne. Paris : INPES, 2005:4.24. Masure M, Dépinoy D. Guide de bonne pratique pour l’arrêt du tabac à l’usagedes médecins généralistes. Reims : ADDICA, 2008:15.25. Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change :Applications to the addictive behaviors. Am Psychol 1992;47:1102-1114.26. Fagerström KO. Measuring degree of physical dependence to tobacco smokingwith reference to individualization of treatment. Addict Behav 1978;3:235-41.27. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Testfor Nicotine Dependence : a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire.Br J Addict 1991;86:1119-27.28. Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. ActaPsychiatr Scand 1983,67:361-370.65
29. Haute Autorité de Santé (HAS). Champix, Intérêt clinique en seconde intentiondans le sevrage tabagique après échec des traitements nicotiniques desubstitution. Site de la HAS, 2009 [En ligne]. (Page consultée le 8 février2012)30. L'Assurance Maladie. Liste des substituts nicotiniques pris en charge parl’Assurance maladie au 15/12/2011. Site de l'Assurance Maladie [En ligne].(Page consultée le 3 janvier 2012)31. Prescrire Rédaction. Patients en cours de sevrage tabagique. Rev Prescrire2011;338:356-8.32. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Grossesse et tabac.Conférence de consensus, 7 et 8 octobre 2004. St Denis la Plaine : ANAES,2004:37.33. AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé).Cigarette électronique - Point d’information du 30 mai 2011. Site de l'AFSSAPS[En ligne].(Page consultée le 26 janvier 2012)34. Prescrire Rédaction. Cigarettes électroniques : gare au contenu « e-liquide » àinhaler, vente non autorisée en officine. Rev Prescrire 2012;340:103.35. Vivant A, Ambroise. Le tabagisme chez les collégiens : Etude dans quatrecollèges lorrains 1999-2000. [En ligne].(Page consultée le 12 septembre 2011)36. Spilka S, Le Nézet O, Laffiteau C, Legleye S. Analyse régionale ESCAPAD 2008.Paris : OFDT, 2009 [En ligne]. (Page consultée le 16mars 2012)37. Hastier N, Quinque K, Bonnel AS, Lemenager S, Le Roux P. Tabac etadolescence : Enquête sur les motivations et les connaissances des effets dutabac. Rev Mal Respir 2006;23:237-41.38. Trédaniel J, Karsenty S, Chastang C, Slama K, Hirsch A. Smoking habits ofFrench general practitioners. Results of a representative sample of 1,012physicians. Rev Mal Respir 1993;10:35-8.39. Shields M. Un pas en avant, un pas en arrière : abandon du tabac et rechute.Dans : Statistique Canada, eds. En santé aujourd’hui, en santé demain ?, volume1. Ottawa : Statistique Canada, 2004:16.66
40. Gouvernement du Canada. Genre de fumeur, selon le groupe d’âge et le sexe auCanada. Dans : Statistique Canada, eds. Usage du tabac / Indicateurs de mieuxêtreau Canada. Ottawa : Statistique Canada, 2006 [En ligne]. (Page consultée le 16mars 2012)41. Beck F, Legleye S. Tabac à l’adolescence : résultats de l’enquête Escapad 2002.BEH 2003 ;22:101-2.42. Bricard D, Jusot F, Tubeuf S. L’influence à long terme du milieu social d’origine etdu tabagisme des parents sur le tabagisme en France : les résultats de l’enquêteSanté et protection sociale 2006. BEH 2011;8:96-9.43. Göhlmann S, Schmidt CM, Tauchmann H. Smoking initiation in Germany : therole of intergenerational transmission. Health Econ 2010 ;19:227-42.44. Dansou A, et al. Abord et prise en charge du fumeur par 149 internes au CHRUde Tours. Rev Mal Respir ; à paraitre.45. Underner M, Ingrand P, Allouch A, Laforgue AV, Migeot V, Defossez G, et al.Influence du tabagisme des médecins généralistes sur leur pratique du conseilminimal d’aide à l’arrêt du tabac. Rev Mal Respir 2006;23:426-9.46. Pipe A, Sorensen M, Reid R. Physician smoking status, attitudes toward smoking,and cessation advice to patients : an international survey. Patient Educ Couns2009;74:118-23.47. Kawakami M, Nakamura S, Fumimoto H, Takizawa J, Baba M. Relation betweensmoking status of physicians and their enthusiasm to offer smoking cessationadvice. Intern Med 1997;36:162-5.48. Baron C, Guillaumin C, Bouquet E, Fanello S, De Col P. Le tabagisme desmédecins généralistes a-t-il une influence sur l’abord du tabac en consultation en2008 ? Enquête auprès de 332 médecins généralistes du Maine et Loire. RevMal Respir 2010;27:431-40.49. Sandström HP, Jormanainen VJ, Myllykangas MT, Barengo NC. Attitudes andbehaviours in smoking cessation among general practitioners in Finland 2001.Soz Praventiv Med 2005;50:355-60.50. Içli F, Içli T, Günel N, Arikan R. Cigarette smoking among young physicians andtheir approach to the smoking problem of their patients. J Cancer Educ1992;7:237-40.51. Quirk M, Ockene J, Kristeller J, Goldberg R, Donnelly G, Amick T, et al. Trainingfamily practice and internal medicine residents to counsel patients who smoke :improvement and retention of counseling skills. Fam Med 1991;23:108-11.52. Cornuz J, Humair JP, Seematter L, Stoianov R, Van Melle G, Stalder H, et al.Efficacy of Resident Training in Smoking Cessation: A Randomized ControlledTrial of a Program Based on Application of Behavioral Theory and Practice withStandardized Patients. Ann Intern Med 2002;136:429-37.67
53. Steinemann S, Roytman T, Chang J, Holzman J, Hishinuma E, Nagoshi M, et al.Impact of education on smoking cessation counseling by surgical residents. AmJ Surg. 2005;189:44-6.54. Kenney RD, Lyles MF, Turner RC, White ST, Gonzalez JJ, Irons TG, et al.Smoking cessation counseling by resident physicians in internal medicine, familypractice, and pediatrics. Arch Intern Med 1988;148:2469-73.55. Strecher VJ, O’Malley MS, Villagra VG, Campbell EE, Gonzalez JJ, Irons TG, etal. Can residents be trained to counsel patients about quitting smoking ? Resultsfrom a randomized trial. J Gen Intern Med 1991;6:9-17.56. Goldberg DN, Hoffman AM, Farinha MF, Marder DC, Tinson-Mitchem L, Burton D,et al. Physician delivery of smoking-cessation advice based on the stages-ofchangemodel. Am J Prev Med 1994;10:267-74.57. Lancaster T, Fowler G. Training health professionals in smoking cessation. In :The Cochrane Collaboration, Lancaster T, eds. Cochrane Database of SystematicReviews. Chichester, UK : John Wiley & Sons, 2000, [En ligne].(Page consultée le 23 mars 2012)58. Cummings SR, Richard RJ, Duncan CL, Hansen B, Martin R, Gerbert B, et al.Training physicians about smoking cessation. J Gen Intern Med 1989;4:482-9.59. Twardella D, Brenner H. Lack of training as a central barrier to the promotion ofsmoking cessation : a survey among general practitioners in Germany. Eur JPublic Health 2005;15:140-5.60. Wilson DM, Taylor DW, Gilbert JR, Best JA, Lindsay EA, Willms DG, et al. Arandomized trial of a family physician intervention for smoking cessation. JAMA1988;260:1570-4.61. Wang WD. Feasibility and effectiveness of a stages-of-change model in cigarettesmoking cessation counseling. J Formos Med Assoc 1994;93:752-7.62. Abrams Weintraub T, Saitz R, Samet JH. Education of preventive medicineresidents : alcohol, tobacco, and other drug abuse. Am J Prev Med 2003;24:101-5.63. Aubin HJ, Lagrue G, Legeron P, Azoulai G, Pelissolo S, Humbert R, et al.Questionnaire de motivation à l’arrêt du tabac (Q-MAT) : Construction etvalidation. Alcoologie et addictologie 2004;26:311-6.68
ANNEXES1. Questionnaire2. Échelle de motivation Q-MAT3. Test de Fagerström4. Test HAD : The Hospital Anxiety and Depression Scale5. Guide à l'usage des internes pour l'abord du patient fumeur(reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur)69
Tabagisme des internes et pratique du conseil minimal d'aide à l'arrêt dutabacEnquête auprès des Internes en Médecine de Poitou-Charentes.1. Sexe : Homme ; Femme2. Année de naissance : ________3. Combien d'enfants as-tu ? 0; 1; 2; 3; 4; >44. En quel semestre seras-tu en mai 2011 ? 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; >105. Spécialité choisie : Médecine Générale Anesthésie-Réanimation Biologie Médicale Gynécologie-Obstétrique Médecine du Travail Pédiatrie Psychiatrie Santé Publique Spécialités médicalesPrécise : Spécialités chirurgicalesPrécise :6. Statut tabagique : Fumeur quotidien (≥1 cigarette tous les jours). Fumeur occasionnel (pas tous les jours) Ex-fumeur (arrêt du tabac depuis au-moins 6 mois) Jamais fumeur (si tu n'as jamais fumé)7. Pratique du conseil minimalDans ta pratique quotidienne, à quelle fréquence estimes-tu poser ces questions à tes patients?- «Fumez-vous ?» Systématiquement; Souvent; Parfois; Jamais- «Envisagez-vous d'arrêter de fumer ?» Systématiquement; Souvent; Parfois; Jamais8. Sais-tu manier les substituts nicotiniques ? Plutôt bien Partiellement Pas du tout9. Souhaites-tu approfondir tes connaissances sur l'aide au sevrage tabagique ? Non Oui, pourquoi pas Oui, absolument10. Y a-t-il un fumeur dans ton foyer (une autre personne que toi si tu es fumeur)? Oui Non11. L'un de tes parents est-il fumeur ou ex-fumeur ? Oui Non12. Quel est la catégorie socio-professionnelle de tes parents (2 réponses possibles) ? Agriculteurs Artisans, commerçants ou chefs d'entreprises Cadres ou professions intellectuelles supérieures (Ex : Médecins, Avocats, etc) Employés Ouvriers Professions intermédiaires (Ex : Enseignement, Social, Contremaître, etc) Je ne sais pas (précise) : _______________________13. Où as-tu passé le Baccalauréat ? Code postal ou ville :__________70
Si tu es fumeur ou ex-fumeur :1. Combien de cigarettes consommes-tu en moyenne par jour (ou la moyenne de ton ancienneconsommation journalière si tu es ex-fumeur) :_______2. Si tu as arrêté de fumer, en quelle année t'es-tu arrêté ? Précise l'année :3. La préparation de l'ENC a t-elle modifiée ta consommation ? Augmentation Pas de modification Diminution4. La vie d'Interne a t-elle modifiée ta consommation ? Augmentation Pas de modification Diminution5. Envisages-tu d'arrêter de fumer ? Non Oui, à court terme(d'ici 6 mois) Oui, à long terme(plus de 6 mois)6. Si tu es une fumeuse qui a eu une ou plusieurs grossesses, quelle a été ta consommationpendant la ou les grossesses : Poursuite de la même consommation Diminution de la consommation Augmentation de la consommation Arrêt de la consommation7. A quel âge as-tu fumé ta première cigarette ? Précise l'âge : Collège ; Lycée ; PCEM ; DCEM; TCEM8. A quel âge as-tu commencé à fumer quotidiennement ? Précise l'âge : Collège ; Lycée ; PCEM ; DCEM; TCEM9. Quel est le contexte de ta première cigarette ? Pour essayer (curiosité) Intégration dans un groupe Imitation d'un modèle Convivialité Période de stress Autre (précise) :_________________Merci beaucoup de ta participation et de renvoyer ton questionnaire avant le 15 avril.Les données recueillies seront anonymisées, le recueil du nom permet de ne pas solliciter à nouveaules personnes ayant déjà répondu au questionnaire.Nom :Prénom :Courriel (uniquement si tu souhaites recevoir les résultats de l'étude) :Etude réalisée sous la direction du Dr UNDERNER, Service de Pneumologie et Unité de tabacologie, CHU dePoitierspar <strong>Yann</strong> <strong>BRABANT</strong>, Interne de Médecine Générale, Courriel : yannbrabant@free.fr, téléphone 06.98.10.10.85Adresse : 1 chemin de la Prantelle, 37230 St Étienne de Chigny71
2. Test Q-MAT :Questionnaire d'évaluation de la Motivation à l'Arrêt du Tabacd'après Aubin HJ, Lagrue G, et al. (63)1. Pensez-vous que dans 6 mois- Vous fumerez toujours ? 0- Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarette ? 2- Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarette ? 4- Vous aurez arrêté de fumer ? 82. Avez-vous actuellement envie d’arrêter de fumer ?- Pas du tout 0- Un peu 1- Beaucoup 2- Énormément 33. Pensez-vous que dans 4 semaines- Vous fumerez toujours ? 0- Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarette ? 2- Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarette ? 4- Vous aurez arrêté de fumer ? 64. Vous arrive-t-il de ne pas être content(e) de fumer?- Jamais 0- Quelquefois 1- Souvent 2- Très souvent 3Interprétation : Motivation à réussir le sevrage tabagique :• Moins de 6 points : Motivation insuffisante• 6 à 12 points : Motivation moyenne• Plus de 12 points : Bonne ou très bonne motivation72
3. Test de Fagerström :Questionnaire d'évaluation de la dépendance physiqued'après Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO (27).1. Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ?Dans les 5 premières minutes 3Entre 6 et 30 minutes 2Entre 31 et 60 minutes 1Après 60 minutes 02. Trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'estinterdit ?Oui 1Non 03. À quelle cigarette de la journée vous sera-t-il le plus difficile de renoncer ?La première le matin 1N'importe quelle autre 04. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?10 ou moins 011 à 20 121 à 30 231 ou plus 35. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l'après-midi ?Oui 1Non 06. Fumez-vous lorsque vous êtes malade et que vous devez rester au litpresque toute la journée ?Oui 1Non 073
Score de 0 à 2 : pas de dépendanceVotre patient peut arrêter de fumer sans avoir recours à des substituts nicotiniques.Si toutefois le patient redoute cet arrêt, vous pouvez lui apporter des conseils utilesde type comportemental (jeter les cendriers, boire un verre d’eau en cas d'envie defumer…).Score de 3 à 4 : dépendance faibleVotre patient peut arrêter de fumer sans avoir recours à des substituts nicotiniques,mais ils peuvent être nécessaires en cas d’apparition de symptômes de sevrage.Score de 5 à 6 : dépendance moyenneL’utilisation des substituts nicotiniques augmente les chances de réussite. Vosconseils seront utiles pour l’aider à choisir la forme galénique la mieux adaptée àson cas (cf tableau V).Score de 7 à 10 : dépendance forte ou très forteL’utilisation des traitements de substitution nicotinique (TSN) est essentielle. Cetraitement doit être utilisé avec une dose et une durée suffisante et adaptée (cftableau IV). En cas de difficulté, orienter le patient vers une consultation detabacologie.74
4. Test HAD : The Hospital Anxiety and Depression Scale.Questionnaire de dépistage des symptomatologies anxieuses et dépressivesd'après Zigmond A.S., Snaith R.P. (28)1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e) :- La plupart du temps 3- Souvent 2- De temps en temps 1- Jamais 02. Je prends plaisir aux mêmes chosesqu’autrefois :- Oui, tout autant 0- Pas autant 1- Un peu seulement 2- Presque plus 33. J’ai une sensation de peur comme si quelquechose d’horrible allait m’arriver :- Oui, très nettement 3- Oui, mais ce n’est pas trop grave 2- Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 1- Pas du tout 04. Je ris facilement et vois le bon côté des choses :- Autant que par le passé 0- Plus autant qu’avant 1- Vraiment moins qu’avant 2- Plus du tout 35. Je me fais du souci :- Très souvent 3- Assez souvent 2- Occasionnellement 1- Très occasionnellement 06. Je suis de bonne humeur :- Jamais 3- Rarement 2- Assez souvent 1- La plupart du temps 07. Je peux rester tranquillement assis(e) à nerien faire et me sentir décontracté(e) :- Oui, quoi qu’il arrive 0- Oui, en général 1- Rarement 2- Jamais 3Additionnez les points des réponses : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 : Total A = _______Additionnez les points des réponses : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 : Total D = _______8. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti :- Presque toujours 3- Très souvent 2- Parfois 1- Jamais 09. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomacnoué :- Jamais 0- Parfois 1- Assez souvent 2- Très souvent 310. Je ne m’intéresse plus à mon apparence :- Plus du tout 3- Je n’y accorde pas autant d’attentionque je devrais 2- Il se peut que je n’y fasse plus autantattention 1- J’y prête autant d’attention que parle passé 011. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place :- Oui, c’est tout à fait le cas 3- Un peu 2- Pas tellement 1- Pas du tout 012. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses :- Autant qu’avant 0- Un peu moins qu’avant 1- Bien moins qu’avant 2- Presque Jamais 313. J’éprouve des sensations soudaines de panique :- Vraiment très souvent 3- Assez souvent 2- Pas très souvent 1- Jamais 014. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonneémission de radio ou de télévision :- Souvent 0- Parfois 1- Raremen t 2- Très rarement 3Interprétation :Pour dépister des symptomatologies anxieuses et dépressives, l’interprétation suivante peut êtreproposée pour chacun des scores (A et D) :- 7 ou moins : absence de symptomatologie- 8 à 10 : symptomatologie douteuse- 11 et plus : symptomatologie certaine.75
Guide à l’usage des internespour l’abord du patient fumeurUnité de coordination de tabacologie - UCTÉvaluation de la dépendance à la nicotineTest de Fagerström1. Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ?□ Dans les 5 premières minutes 3□ Entre 6 et 30 minutes 2□ Entre 31 et 60 minutes 1□ Après 60 minutes 02. Trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c’est interdit ?□ Oui 1□ Non 03. À quelle cigarette de la journée vous serait-il le plus difficile de renoncer ?□ La première, le matin 1□ N’importe quelle autre 0Pour une meilleure prise en charge :- INFORMER :risques du tabac- DECULPABILISER :expliquer la dépendance- PROPOSER DE L’AIDE :UCT, Tabac info service…- MOTIVER :> Pourquoi voulez-vous arrêter de fumer ?> Que vous apportent ces cigarettes ?> Que comptez-vous faire par rapport au tabac ?> Quels seraient les avantages à arrêter de fumer ?> Quelles seraient vos craintes à arrêter de fumer ?> Parlez-moi de votre tabagisme.Pour en savoir plus- Unité de Coordination enTabacologie :Service de Pneumologie02 47 47 82 30CHRU Tours (7 82 30)- Tabac Info Service :39 894. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?□ 10 au moins 0□ 11 à 20 1□ 21 à 30 2□ 31 ou plus 35. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l’après-midi ?□ Oui 1□ Non 06. Fumez-vous lorsque vous êtes si malade que vous devez rester au lit toute la journée ?□ Oui 1□ Non 0RésultatScore de 0 à 2 : Pas de dépendance à la nicotine, pas de TSN.Score de 3 à 4 : Faible dépendance à la nicotine, TSN ? (selon cas).Score de 5 à 6 : Moyennement dépendant à la nicotine, utilisation de TSN conseillée.Score de 7 à 10 : Forte dépendance à la nicotine, TSN impératif.cf. la fiche COMED pour la délivrance de TSN chez les hospitalisés.76Cette plaquette est disponible sur le site intranet du CHRU
Évaluation de la motivation à l’arrêt du tabacTest du Q.MAT1. Pensez-vous que dans 6 mois :Vous fumerez toujours autant ? 0Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ? 2Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ? 4Vous aurez arrêté de fumer ? 82. Avez-vous, actuellement, envie d’arrêter de fumer ?Pas du tout 1Beaucoup 2Enormément 33. Pensez-vous, que dans 4 semaines :Vous fumerez toujours autant ? 0Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ? 2Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ? 4Vous aurez arrêté de fumer ? 6Score > 13 : Bonne motivation- Y a-t-il déjà eu des tentatives d’arrêt total ?- Quels bénéfices avait-il ressenti ?- Quels enseignements a-t-il tiré de ces différentesexpériences ?- Proposer une aide au sevrage :- Médecin généraliste- Consultation spécialisée- Groupes- Valoriser ses chances de succès :« Vous me semblez très motivé. Avec une bonne aide,vous y arriverez ! »- Fixer éventuellement un rendez-vous.Cycle de Prochaska et Di ClementLes stades de maturation vers l’arrêt du tabacFumeur satisfaitNe recommence pasRecommenceMaintienEnvisagede s’arrêterArrêteDécidede s’arrêterEssaie d’arrêterPréparation4. Vous arrive-t-il de ne pas être content(e) de fumer ?Jamais 0Quelquefois 1Souvent 2Très souvent 3Résultats Q.MAT et propositions du soignantScore < 6 : Motivation insuffisante- Ne pas pousser trop à l’arrêt immédiat- Dire qu’on accepte cette hésitation- Faire lister au fumeur ce qu’il ressent LUI :- Les bénéfices à fumer- Les inconvénients à fumer- Les avantages à ne pas fumer- Compte tenu de ces éléments, pense-t-il arrêter un jour ?- Informer de l’existence des aides (groupes, consultations…)Score de 7 à 13 : Motivation moyenne- Faire lister ce que le fumeur ressent comme :- Raisons de fumer- Bénéfices à l’arrêt- Ses craintes s’il arrêtait- Si on pouvait lui assurer un confort optimal à l’arrêt, faire évaluerde 0 à 10 son désir de se séparer du tabac.- Informer des groupes, des consultations- Peut-il fixer une date pour un éventuel arrêt ?77
RÉSUMÉIntroduction : Les internes en médecine ont un rôle important à jouer dans le sevragetabagique de leurs patients. Les objectifs principaux de cette étude étaient d'estimer leressenti des internes en médecine du Poitou-Charentes en ce qui concerne leur besoinde formation en aide à l'arrêt du tabac et d'étudier l'influence de leur statut tabagique etde leur spécialité sur la pratique du conseil minimal. Les objectifs secondaires étaient dedéterminer la prévalence du tabagisme chez les internes en médecine et d'encaractériser quelques déterminants.Méthode : Un auto-questionnaire était remis aux 649 internes lors de la session de choixde stage du semestre d'été 2011. Les données recueillies concernaient l'interne (sexe,âge, ancienneté, spécialité), son statut tabagique, sa pratique du conseil minimal, sonimpression de maîtrise des traitements de substitution nicotiniques (TSN), son souhaitd'approfondir ses connaissances en aide au sevrage tabagique et son histoire tabagiques'il était fumeur.Résultats : Avec 406 internes répondants (taux de participation de 63 %), la prévalencedu tabagisme est de 28,8 % (11,6 % de fumeurs occasionnels et 17,2 % de fumeursquotidiens) ; 7,9 % sont ex-fumeurs. L'exercice d'une spécialité à gardes et la présenced'un fumeur dans le foyer sont associés de manière significative au tabagisme. Lesinternes ayant arrêté leur tabagisme sont ceux qui ont pu contrôler leur consommationpendant la préparation de l'ENC et lors de la vie d'interne. Le conseil minimal est dit êtrepratiqué dans son intégralité de manière systématique par 8,9 % des internes. Uneminorité des internes (15,6 %) a l'impression de maîtriser les TSN et 84,2 % d'entre euxsouhaitent approfondir leurs connaissances sur l'aide au sevrage tabagique. Plus que lesinternes des autres spécialités, les internes de médecine générale souhaitentapprofondir leurs connaissances et ont tendance à pratiquer plus fréquemment le conseilminimal que les autres internes mais ne maîtrisent pas mieux les TSN.Discussion et conclusion : La prévalence du tabagisme chez les internes en médecineest en nette diminution depuis 10 ans et inférieure à la prévalence du tabagisme dans lapopulation générale. Le conseil minimal reste peu pratiqué malgré les recommandationsnationales. Les internes semblent réceptifs à un enseignement spécifique actuellementpeu développé. Une formation pratique complémentaire en début d'internat pourrait êtreproposée pour améliorer leurs compétences dans la prise en charge des patientsfumeurs.Mots clés : Tabagisme, sevrage tabagique, internes en médecine, conseil minimal, formation des internes.78
SERMENT D'HIPPOCRATEEn présence des Maîtres de cette école,de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate,je promets et je jure, au nom de l’Être Suprême,d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de lamédecine.Je donnerai mes soins gratuits à l'indigentet n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail.Admis dans l'intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s'ypasse ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés,et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime.Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres,je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mespromesses !Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque !79