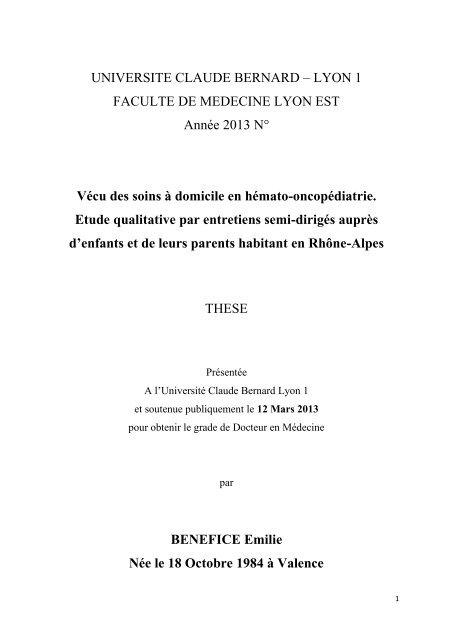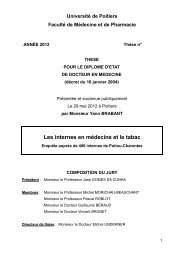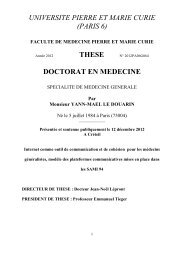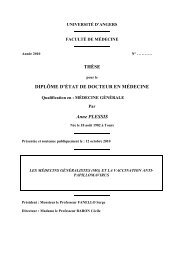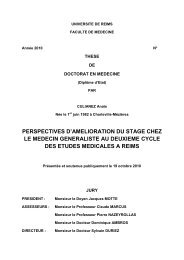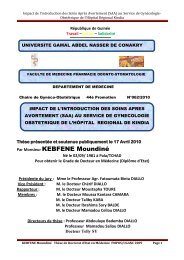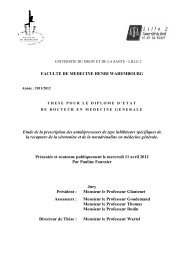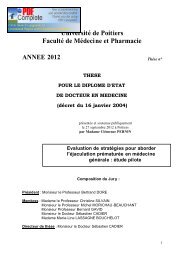Vécu des soins à domicile en oncopédiatrie version ... - Thèse IMG
Vécu des soins à domicile en oncopédiatrie version ... - Thèse IMG
Vécu des soins à domicile en oncopédiatrie version ... - Thèse IMG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON 1FACULTE DE MEDECINE LYON ESTAnnée 2013 N°Vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> hémato-oncopédiatrie.Etude qualitative par <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s semi-dirigés auprèsd’<strong>en</strong>fants et de leurs par<strong>en</strong>ts habitant <strong>en</strong> Rhône-AlpesTHESEPrés<strong>en</strong>téeA l’Université Claude Bernard Lyon 1et sout<strong>en</strong>ue publiquem<strong>en</strong>t le 12 Mars 2013pour obt<strong>en</strong>ir le grade de Docteur <strong>en</strong> MédecineparBENEFICE EmilieNée le 18 Octobre 1984 à Val<strong>en</strong>ce1
Le Serm<strong>en</strong>t d'HippocrateJe promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l'exercice de laMédecine.Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination.J'intervi<strong>en</strong>drai pour les protéger si elles sont vulnérables ou m<strong>en</strong>acées dans leur intégrité ouleur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre leslois de l'humanité.J'informerai les pati<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> décisions <strong>en</strong>visagées, de leurs raisons et de leurs conséqu<strong>en</strong>ces.Je ne tromperai jamais leur confiance.Je donnerai mes <strong>soins</strong> à l'indig<strong>en</strong>t et je n'exigerai pas un salaire au <strong>des</strong>sus de mon travail.Admis dans l'intimité <strong>des</strong> personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduit<strong>en</strong>e servira pas à corrompre les mœurs.Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivem<strong>en</strong>t la vie ni neprovoquerai délibérém<strong>en</strong>t la mort.Je préserverai l'indép<strong>en</strong>dance nécessaire et je n'<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>drai ri<strong>en</strong> qui dépasse mescompét<strong>en</strong>ces. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission.Que les hommes m'accord<strong>en</strong>t leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvertd'opprobre et méprisé si j'y manque.9
Composition du juryPrésid<strong>en</strong>t :Monsieur le Professeur Yves BERTRANDMembres :Monsieur Le Professeur Pierre FOURNERETMonsieur le Professeur Associé Yves ZERBIBMadame le Docteur Evelyne LASSERREMembre invité:Monsieur le Docteur Matthias SCHELL10
Remerciem<strong>en</strong>tsAu présid<strong>en</strong>t de jury,Monsieur le Professeur Yves BERTRANDJe vous remercie de me faire l’honneur de présider ma thèse et pour l’intérêt que vous y avezporté. Soyez assuré de mon profond respect.Aux membres du jury,Monsieur le Professeur Pierre FOURNERETJe vous remercie d’avoir accepté de juger ce travail sans me connaitre. Soyez assuré de toutema gratitude et de mon profond respect.Monsieur le Professeur Yves ZERBIBMerci d’avoir accepté la direction de cette thèse. Merci d’avoir cru <strong>en</strong> moi et de m’avoirlaissé porter ce projet à son terme. Merci pour le plaisir d’avoir pu travailler à vos cotés, pourvos précieux conseils, votre souti<strong>en</strong> et votre prés<strong>en</strong>ce infaillibles à mes cotés tout au long deces années de travail. Vous avoir comme directeur de thèse est un honneur.Madame le Docteur Evelyne LASSERREJe vous remercie de m’avoir guidée dans ce travail de thèse et d’<strong>en</strong> avoir accepté lacodirection. Merci pour votre disponibilité, vos <strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>ts, vos conseils judicieux. Cetravail n’aurait pas été aussi abouti sans votre aide. Soyez assurée de mon plus grand respectet de toute mon amitié.Monsieur le Docteur Matthias SCHELLJe vous remercie de m’avoir aidé à façonner ce projet et d’avoir donné de votre temps pourl’embellir. Merci d’avoir autorisé et permis la r<strong>en</strong>contre avec les familles. Soyez assuré demon plus grand respect et de toute ma gratitude.11
A l’équipe infirmière de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> de l’IHOPUn imm<strong>en</strong>se merci pour votre pati<strong>en</strong>ce (lors de mes nombreux coups de téléphone…), votreg<strong>en</strong>tillesse et votre dévouem<strong>en</strong>t pour m’aider dans mon recrutem<strong>en</strong>t. Sans votre interv<strong>en</strong>tionje n’aurais peut être pas pu m<strong>en</strong>er ce projet à terme.A tous les <strong>en</strong>fants et les par<strong>en</strong>ts que j’ai r<strong>en</strong>contrés au fil <strong>des</strong> mois qui m’ont tant apporté surles plans professionnel et humain. Je suis honorée d’avoir pu croiser votre chemin. Je p<strong>en</strong>sesouv<strong>en</strong>t à vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer le tortueux chemin <strong>des</strong><strong>soins</strong> qui je l’espère vous mènera vers la rémission. Merci du temps que vous m’avezconsacré, <strong>des</strong> mom<strong>en</strong>ts d’émotions partagés autour d’un café. Merci d’avoir contribué àr<strong>en</strong>dre ce travail aussi unique.J’<strong>en</strong>voie une p<strong>en</strong>sée très spéciale là haut vers les étoiles aux deux petites filles que je n’ai paseu le plaisir de r<strong>en</strong>contrer. Votre histoire me donne l’impression de vous connaitre. J’aisouv<strong>en</strong>t p<strong>en</strong>sé à vous et à votre courage tout au long de mon travail.A mon papa. Sans toi je ne serai pas là aujourd’hui à prés<strong>en</strong>ter ce travail. Merci de m’avoirdonné l’élan pour faire médecine. Merci de m’avoir sout<strong>en</strong>ue, <strong>en</strong>couragée et apaisée tout aulong de ces neuf ans. Merci pour tout le travail de relecture que tu as toujours réalisé pourmoi. Tu as l’amour du travail bi<strong>en</strong> fait et tu n’as pas oublié de me le transmettre. Merci.A ma maman merci pour ton souti<strong>en</strong> sa faille, tes <strong>en</strong>couragem<strong>en</strong>ts. Tu as contribué à faire demoi la personne que je suis aujourd’hui parmi les joies et les épreuves quotidi<strong>en</strong>nes. Tu merassures et tu m’as permis de croire <strong>en</strong> moi et <strong>en</strong> la vie depuis toutes ces années. Merci.A ma sœur Caroline, pour ton aide et ton souti<strong>en</strong> sans faille. Tu fais partie de mes petitesfourmis de l’ombre sans qui ce travail n’aurait pas été aussi complet. Tu as su m’apaiser dansmes mom<strong>en</strong>ts de doutes ou de découragem<strong>en</strong>ts p<strong>en</strong>dant ces deux ans de travail. MerciA Sarah et Eti<strong>en</strong>ne mes <strong>des</strong>sinateurs émérites… sans qui ce travail n’aurait pas été le même.A mon mari Baptiste, Merci pour ton souti<strong>en</strong>, ta pati<strong>en</strong>ce et ta compréh<strong>en</strong>sion tout au longde ce travail. Merci d’avoir accepté de sacrifier bon nombre de tes week-<strong>en</strong>ds depuis deux ansau profit de ce travail.12
A Bruno. Merci d’être là. Ton souti<strong>en</strong> me réchauffe le cœur et me rassure dans mes mom<strong>en</strong>tsde doutes.A Claire. Merci pour l’aide que tu m’as apportée lors du travail de retranscription. Merci pourta pati<strong>en</strong>ce lors de la relecture.A Agnès Augé pour votre prés<strong>en</strong>ce, votre investissem<strong>en</strong>t et votre souti<strong>en</strong> p<strong>en</strong>dant ce travail.Merci de m’avoir aidé à compr<strong>en</strong>dre mes émotions p<strong>en</strong>dant la période <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s.A Caroline, Charline et Maël. L’espoir de votre prés<strong>en</strong>ce à mes cotés me ravit. Merci d’êtrelà tout simplem<strong>en</strong>t depuis bi<strong>en</strong>tôt dix ans.A Béatrice Merci pour tes conseils, ton souti<strong>en</strong> et le temps passé à relire mon travail.A Maïa Merci de partager ce projet qui me porte et qui peut être je l’espère aboutira vers unebelle réalisation…A tous les médecins que j’ai croisés sur ma route et qui ont cru <strong>en</strong> mon projet,A ma famille,A mes Amis,13
II.3.1. Lieu de réalisation de l’étude -34-II.3.2. Le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> -34-II.3.3. Définition de la population : les critères d’inclusion -36-II.3.4. Méthode de recrutem<strong>en</strong>t -37-II.3.5. La retranscription <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s -38-II.4. L’analyse <strong>des</strong> données -39-II.4.1. Analyse observationnelle <strong>des</strong>criptive famille par famille -39-II.4.2. Analyse thématique transversale -39-II.4.3. Analyse <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins -39-II.5. Recherche bibliographique -40-II.5.1. Bases de données -40-II.5.2. Mots clés -40-II.6. Les forces et les limites de l’étude -40-II.6.1. Les forces -40-II.6.2. Les limites -41-III. Résultats bruts -43-III.1. Caractéristiques <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts interviewés -43-III.1.1. Les <strong>en</strong>fants -43-III.1.2. Les par<strong>en</strong>ts -44-III.2. Analyse observationnelle <strong>des</strong>criptive -44- Famille de Liliane 12 ans -45- Famille de Karine 6 ans -46- Famille de Mathilde 6 ans -47- Famille de Lilou 9 ans -48- Famille de Juli<strong>en</strong> 12 ans -49- Famille d’Anthony 4 ans -50- Famille de Marie 6 ans -51- Famille d’Anna 5 ans -52- Famille de Timéo 12 ans -53- Famille d’Hélène 14 ans -54-IV. Résultats et discussion -56-IV.1. Description de l’<strong>en</strong>fant -56-IV.2. Vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> -57-15
IV.2.1. Définition <strong>des</strong> <strong>soins</strong> -57-IV.2.2. Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> -59- Le choix du <strong>domicile</strong> -59- L’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> -63- Prise <strong>en</strong> charge soignante -66- Rôle <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts dans les <strong>soins</strong> -73-IV.2.3. Prise <strong>en</strong> charge hospitalière -82- Vision de l’équipe hospitalière -82- Représ<strong>en</strong>tation de l’IHOP -84- Les contraintes hospitalières -87-IV.2.4. Le souti<strong>en</strong> -87- Place <strong>des</strong> proches -87- Les « copains » -89- Les autres par<strong>en</strong>ts -89- Place <strong>des</strong> professionnels -90-IV.3. Conséqu<strong>en</strong>ces de la maladie et <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts -91-IV.3.1. La gestion du quotidi<strong>en</strong> -91- Adaptation quotidi<strong>en</strong>ne -91- Une certaine normalité -92- Maladie omniprés<strong>en</strong>te : Une vie c<strong>en</strong>trée sur l’<strong>en</strong>fant malade -93-IV.3.2. Conséqu<strong>en</strong>ces physiques -94- La maladie visible -94- Altération de l’image corporelle -95-IV.3.3. Conséqu<strong>en</strong>ces sociales -96- Socialisation de l’<strong>en</strong>fant -96- Lutte contre l’isolem<strong>en</strong>t -98- Modifications relationnelles -99- L’épreuve du regard <strong>des</strong> autres -100- Aménagem<strong>en</strong>ts professionnels -101- Une charge financière -102-IV.3.4. La maladie punition -103- La résignation <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants -104- Les limitations au quotidi<strong>en</strong> -104-16
IV.3.5. Les bénéfices secondaires -106- Les mom<strong>en</strong>ts d’exception -107- Les cadeaux -107- Les avantages par rapport à la fratrie -108- Les marques d’affection -108- Les visites -109-IV.3.6. Modifications comportem<strong>en</strong>tales -110- Maturité et responsabilisation -110- Modification <strong>des</strong> choix professionnels -111- Une nouvelle philosophie de vie -112-IV.4. Rôle du médecin généraliste -113-IV.4.1. Une implication nécessaire -113- Rôle médical diagnostique -113- L’écoute -114- Le souti<strong>en</strong> -115- La disponibilité -115- La gestion <strong>des</strong> événem<strong>en</strong>ts intercurr<strong>en</strong>ts -116- Le suivi -117-IV.4.2. Des caractéristiques souhaitées -117- Rôle générique -118- Une place à pr<strong>en</strong>dre -118-IV.4.3. Facteurs limitant l’implication du médecin traitant selon les par<strong>en</strong>ts -119-IV.5. Les <strong>des</strong>sins -121- Comm<strong>en</strong>taires généraux -121- Comparaison <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins à ceux <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants sains -123-Conclusions -141-Bibliographie -145-Annexes -149-1. Les gui<strong>des</strong> d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> -149-2. Les <strong>des</strong>sins <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants sains -157-3. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s (CD fourni) -162-17
Table <strong>des</strong> abréviationsDES : Diplôme d’étu<strong>des</strong> spécialiséesIHOP : Institut d’Hématologie et d’Oncologie PédiatriqueHAD : Hospitalisation A DomicileSAD : Soins A DomicileSROS : Schémas Régionaux d’Organisation <strong>des</strong> SoinsCHR : C<strong>en</strong>tre Hospitalier RégionalAPHP : Assistance Publique-Hôpitaux de ParisHCL : Hospices civils de LyonCLB : C<strong>en</strong>tre Léon BérardPMI : Protection Maternelle et infantilePICC : Peripherally Inserted C<strong>en</strong>tral Catheter ou Cathéter Veineux C<strong>en</strong>tral Inséré <strong>en</strong>PériphérieSNG : Sonde naso-gastriqueGR : Gymnastique RythmiqueHPST : Hôpital, pati<strong>en</strong>ts, santé et territoires18
IntroductionLes cancers de l’<strong>en</strong>fant, s’ils représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t moins de 1% de l’<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> cancers <strong>en</strong>France, atteign<strong>en</strong>t chaque année <strong>en</strong>viron deux milles <strong>en</strong>fants et adolesc<strong>en</strong>ts. Même si un grandnombre d’<strong>en</strong>fants va guérir (dans les années 2010 un adulte sur quatre c<strong>en</strong>t cinquante a eu uncancer dans l’<strong>en</strong>fance), le cancer ou les hémopathies demeur<strong>en</strong>t la deuxième cause de décèsdans la tranche d’âge de un à quinze ans. (1) De nos jours dans les pays industrialisés soixantequinze pour c<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants guériss<strong>en</strong>t de leur maladie (1) . Malgré tout l’annonce d’un cancerest toujours dévastatrice pour la famille touchée.Dans ce contexte, du fait de l’évolution actuelle du système de santé avec l’apparitionde la tarification à l’acte à l’hôpital et d’une augm<strong>en</strong>tation <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> familles, le<strong>domicile</strong> semble être une alternative intéressante. Il permet de conserver un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tconnu et sécurisant autour de l’<strong>en</strong>fant malade. Les solutions existantes pour rapprocher le pluspossible les <strong>en</strong>fants de leur <strong>domicile</strong> tout <strong>en</strong> conservant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de qualité techniquecomparable aux <strong>soins</strong> hospitaliers, sont nombreuses et variées <strong>en</strong> France. La prise <strong>en</strong> charge<strong>des</strong> <strong>en</strong>fants par les professionnels ambulatoires nécessite un investissem<strong>en</strong>t humain et <strong>des</strong>compét<strong>en</strong>ces spécifiques.Cette étude fait suite à un premier travail exploratoire, réalisé <strong>en</strong> 2009 dans le cadred’un mémoire de DES de médecine générale à Lyon, sur le vécu et les représ<strong>en</strong>tations <strong>des</strong><strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> oncopédiatrie chez les soignants (2). Face à leurs représ<strong>en</strong>tations etquestionnem<strong>en</strong>ts il existait un manque de données sur le vécu <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants atteints de cancer oud’hémopathie ayant bénéficiés de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. Leur parole, leur ress<strong>en</strong>ti, leur souffranc<strong>en</strong>e sont pas connus, ceux de leurs par<strong>en</strong>ts, premiers aidants et maillon indisp<strong>en</strong>sable dans laprise <strong>en</strong> charge pédiatrique, non plus.De ce fait, il m’a paru pertin<strong>en</strong>t de m’intéresser au vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>des</strong><strong>en</strong>fants atteints de cancer et de leurs par<strong>en</strong>ts. Pour l’explorer j’ai donc utilisé une méthode derecherche qualitative. Je suis partie de l’hypothèse <strong>des</strong> oncopédiatres qui p<strong>en</strong>sai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 2009que les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> étai<strong>en</strong>t vécus par les familles comme un « abandon » de la part dumilieu hospitalier. Mon objectif principal a été de déterminer la place <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong>19
hémato-oncopédiatrie <strong>en</strong> m’intéressant à l’expéri<strong>en</strong>ce vécue par les <strong>en</strong>fants et leurs par<strong>en</strong>tsainsi qu’aux difficultés qu’ils ont pu r<strong>en</strong>contrer dans cette prise <strong>en</strong> charge. Mon objectifsecondaire a été d’essayer de clarifier le rôle du médecin généraliste dans ces prises <strong>en</strong> chargeoncopédiatriques ambulatoires.20
I. ContexteI.1. Les cancers de l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong> France; principes de traitem<strong>en</strong>ts actuelsI.1.1. GénéralitésDepuis 2004 les <strong>soins</strong> <strong>en</strong> hémato-oncologie pédiatrique ont été organisés de manière àrépondre à <strong>des</strong> <strong>en</strong>jeux de santé publique mais égalem<strong>en</strong>t aux att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et de leurspar<strong>en</strong>ts.Même s’ils représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t moins de un pour c<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> cancers, <strong>en</strong> 2009,2123 cancers ont été diagnostiqués chez <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants de zéro à dix neuf ans dont 1700 pour latranche d’âge de zéro à quatorze ans. Un <strong>en</strong>fant sur cinq c<strong>en</strong>ts sera atteint d’un cancer avantsa seizième année et la moitié le sera avant l’âge de cinq ans. (3)Les cancers de l’<strong>en</strong>fant se répartiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre 30% d’hémopathies malignes (dont quatrevingt pour c<strong>en</strong>t de leucémies aiguës lymphoblastiques) et 70% de tumeurs soli<strong>des</strong> dont lesplus nombreuses sont les tumeurs cérébrales. A côté <strong>des</strong> leucémies et <strong>des</strong> lymphomes, lamajorité <strong>des</strong> tumeurs de l'<strong>en</strong>fant sont dites embryonnaires car elles reproduis<strong>en</strong>t l’architectured’un organe à un stade précoce de son embryog<strong>en</strong>èse (neuroblastome, néphroblastome,médulloblastome, hépatoblastome, rétinoblastome…). Les cancers pédiatriques sont d’unegrande hétérogénéité, plus de quarante sous types ont d’ailleurs été décrits pour les tumeurssoli<strong>des</strong>. (figure 1) (4)Ces cancers ont une croissance extrêmem<strong>en</strong>t rapide (quelques semaines voire quelquesjours) laissant à l’<strong>en</strong>fant un état général habituellem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> conservé qui peut être d’ailleurstrompeur, mais <strong>en</strong>traînant un risque vital ou fonctionnel à cours terme <strong>en</strong> fonction de lalocalisation de la tumeur.Avec 309 décès <strong>en</strong> 2007 (CépiDc-Inserm 2007), le cancer représ<strong>en</strong>te 7,6 % de lamortalité infantile <strong>en</strong>tre zéro et quinze ans, après les affections néonatales, les malformationscongénitales, les accid<strong>en</strong>ts et les causes inconnues, incluant la mort subite. Cette répartitionest très différ<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre la première année de la vie et la tranche d’âge d’un an à quatorze ans.Avant un an, les cancers représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t 1% <strong>des</strong> décès et 21% <strong>en</strong>tre un et quatorze ans, ce qui <strong>en</strong>fait la deuxième cause de décès après les accid<strong>en</strong>ts (32%) dans cette classe d’âge. (3)21
Figure 1 : Fréqu<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>ts cancers de l'<strong>en</strong>fant (4)Tumeurs du foie 1%Rétinoblastomes 3 %Tumeurs germinales 4%Tumeurs Osseuses 5%Sarcomes<strong>des</strong> tissus mous7%AutresLeucémies 30 %Néphroblastomes7%Neuroblastomes9%Lymphomes10%TumeursCérébrales20%I.1.2. Traitem<strong>en</strong>ts conv<strong>en</strong>tionnelsGrâce aux progrès actuels de la médecine les décès liés à la maladie cancéreuse del’<strong>en</strong>fant sont beaucoup moins fréqu<strong>en</strong>ts qu’il y a <strong>en</strong>core quelques déc<strong>en</strong>nies. Le taux deguérison actuel est d’<strong>en</strong>viron 75% contre 25% <strong>en</strong> 1970 lié ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t aux progrèsthérapeutiques et aux avancées de la recherche médicale (1) . La prise <strong>en</strong> charge <strong>des</strong> cancers del’<strong>en</strong>fant fait appel aux mêmes moy<strong>en</strong>s thérapeutiques que chez l’adulte (chimiothérapie,chirurgie, radiothérapie…). Ces traitem<strong>en</strong>ts conv<strong>en</strong>tionnels rest<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t lourds etcontraignants. Le choix d’un protocole thérapeutique, bi<strong>en</strong> qu’actuellem<strong>en</strong>t mondialem<strong>en</strong>tstandardisé, doit être réfléchi et défini au cas par cas <strong>en</strong> réunion de concertationpluridisciplinaire. Il est fonction de l’âge de l’<strong>en</strong>fant, du type d’atteinte (type de tumeur), <strong>des</strong>on ext<strong>en</strong>sion et <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>ts facteurs pronostics (5) . La croissance extrêmem<strong>en</strong>t rapide <strong>des</strong>tumeurs de l’<strong>en</strong>fant explique largem<strong>en</strong>t l’efficacité de la chimiothérapie puisque celle ci agitsur les cellules <strong>en</strong> division. Elle agit par voie systémique sur la tumeur primitive et sur lesmétastases qu'elles soi<strong>en</strong>t cliniques ou infra-cliniques. La chimiothérapie est proposée souv<strong>en</strong>t22
<strong>en</strong> première ligne thérapeutique (néo-adjuvante), c’est-à-dire, avant le geste chirurgical pourles tumeurs soli<strong>des</strong>. Après le geste local, la chimiothérapie est dite adjuvante et a comme rôleess<strong>en</strong>tiel d’éradiquer les foyers micro-métastatiques infra-cliniques. Sa durée est plus oumoins longue <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong> pathologies et <strong>des</strong> critères de gravité. Cette très grande chimios<strong>en</strong>sibilité<strong>des</strong> tumeurs de l’<strong>en</strong>fant a repositionné dans la stratégie thérapeutique la place de lachirurgie et de la radiothérapie (4) . Le traitem<strong>en</strong>t de leucémies est actuellem<strong>en</strong>t plutôtséqu<strong>en</strong>tiel avec un protocole comportant une phase d’induction, une consolidation, uneréint<strong>en</strong>sification à la 20 ème semaine suivi d'un traitem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> pour une durée totale de18 mois à 24 mois de traitem<strong>en</strong>t. Il est basé souv<strong>en</strong>t exclusivem<strong>en</strong>t sur de la chimiothérapie.Pour les tumeurs soli<strong>des</strong>, qu’elle soit néo adjuvante ou adjuvante, on parle plutôt de « blocs dechimiothérapie » administrés toutes les trois semaines <strong>en</strong>viron. Ces différ<strong>en</strong>tes cures impos<strong>en</strong>tdonc <strong>des</strong> allers-retours réguliers à l’hôpital. Actuellem<strong>en</strong>t les effets secondaires et les toxicitésà court, moy<strong>en</strong> et long termes sont <strong>en</strong>core souv<strong>en</strong>t très handicapants. La totalité <strong>des</strong> stratégiesthérapeutiques proposées chez les <strong>en</strong>fants sont ainsi marquées par le double souci de « guérirplus » et guérir « mieux » mais à un « prix » acceptable compromettant le moins possible ledéveloppem<strong>en</strong>t et l’épanouissem<strong>en</strong>t ultérieur de ce petit être <strong>en</strong> dev<strong>en</strong>ir.I.1.3. Impact de la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> dans l’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong>Les traitem<strong>en</strong>ts, que ce soit une chimiothérapie ou de la radiothérapie, sontnécessairem<strong>en</strong>t initiés <strong>en</strong> hospitalisation traditionnelle pour s’assurer de la bonne tolérancepar l’<strong>en</strong>fant. Cep<strong>en</strong>dant, la t<strong>en</strong>dance actuelle est de transférer l’<strong>en</strong>fant malade vers son<strong>domicile</strong> pour la poursuite <strong>des</strong> <strong>soins</strong> d’inter-cure ou pour le relais ambulatoire <strong>des</strong> <strong>soins</strong>hospitaliers, comme certaines cures de chimiothérapie (par exemple l’Aracytine) dans certainstypes de leucémies aiguës <strong>en</strong> Rhône-Alpes. Cette décision est justifiée par l’évolution actuelledu système de santé où la tarification à l’acte t<strong>en</strong>d à faire diminuer les durées d’hospitalisation(6). Il est égalem<strong>en</strong>t souhaitable pour le bi<strong>en</strong> être psycho affectif et l’épanouissem<strong>en</strong>t social del’<strong>en</strong>fant malade d’essayer de respecter son cadre de référ<strong>en</strong>ce qui n’est autre que son<strong>domicile</strong>. C’est au sein de sa famille qu’il pourra retrouver ses habitu<strong>des</strong> de vie, ses repères etson <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t scolaire habituel.23
I.2. Les Spécificités de la cancérologie pédiatriqueI.2.1. L’<strong>en</strong>fant pati<strong>en</strong>tUne <strong>des</strong> spécificités de l’hémato-oncopédiatrie est que les pati<strong>en</strong>ts sont <strong>des</strong> <strong>en</strong>fantspour la plupart mineurs et soumis à l’autorité par<strong>en</strong>tale. Pourtant ces derniers demeur<strong>en</strong>t <strong>des</strong>pati<strong>en</strong>ts à part <strong>en</strong>tière, ceux là même chez qui ont été découvert le cancer ou la leucémie. Ilsvont subir <strong>des</strong> exam<strong>en</strong>s et <strong>en</strong>durer <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts longs et douloureux, ils vont devoir sebattre contre « leur » maladie. Des <strong>en</strong>fants à qui il faudra expliquer la maladie et sesimplications, qui seront souv<strong>en</strong>t confrontés à l’idée de la mort, la leur ou celle de leurs« copains ». Des <strong>en</strong>fants qui vont être « l’objet » <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Mais égalem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts quiauront droit à un espace de parole, pour exprimer leur souhait et leur cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t sur lestraitem<strong>en</strong>ts à v<strong>en</strong>ir.I.2.2. La relation triangulaireLa pédiatrie est une spécialité dans laquelle le colloque singulier avec le pati<strong>en</strong>t estcompliqué à mettre <strong>en</strong> place. En effet, il va s’instaurer une relation triangulaire souv<strong>en</strong>tnécessaire, <strong>en</strong>tre l’<strong>en</strong>fant pati<strong>en</strong>t, ses par<strong>en</strong>ts et les soignants (5) . Il est indisp<strong>en</strong>sable quechacun trouve sa place dans cette relation, notamm<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>fant à qui il faut savoir laisser unespace de parole et un pouvoir décisionnel. Au sein de cette relation les par<strong>en</strong>ts rest<strong>en</strong>t garants<strong>des</strong> intérêts de leur <strong>en</strong>fant <strong>en</strong> matière de santé puisqu’ils déti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l’autorité par<strong>en</strong>talejusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’<strong>en</strong>fant (article 371-1 du code civil (7) ). Il faut bi<strong>en</strong><strong>en</strong>t<strong>en</strong>du t<strong>en</strong>ir compte <strong>des</strong> capacités propres de compréh<strong>en</strong>sion de chaque <strong>en</strong>fant liées à sonâge et à sa maturation cognitive au mom<strong>en</strong>t de la découverte de la maladie.I.2.3. Le rôle <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts : aidants principauxQu’ils le veuill<strong>en</strong>t ou non les par<strong>en</strong>ts se retrouv<strong>en</strong>t du jour au l<strong>en</strong>demain plongés dansla maladie de leur <strong>en</strong>fant et <strong>en</strong> première ligne pour l’aider, le sout<strong>en</strong>ir, l’informer etl’accompagner. Cette place d’aidant principal est difficile à t<strong>en</strong>ir mais obligatoire etindisp<strong>en</strong>sable pour l’<strong>en</strong>fant malade. Ce dernier est <strong>en</strong>core dép<strong>en</strong>dant de ses par<strong>en</strong>ts qui sontaux yeux de la loi l’autorité référ<strong>en</strong>te. Les par<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t ress<strong>en</strong>tir <strong>des</strong> difficultésà s’approprier ce rôle d’aidant alors qu’ils doiv<strong>en</strong>t déjà gérer le choc de l’annonce de la24
maladie grave. Souv<strong>en</strong>t très <strong>en</strong>tourés et épargnés de prises de décision à l’hôpital ils peuv<strong>en</strong>tse retrouver brutalem<strong>en</strong>t projetés <strong>en</strong> position de soignants décideurs à la maison. D’ailleurscomme l’explique G<strong>en</strong>eviève Cresson, Professeur <strong>en</strong> sociologie, aucune prise <strong>en</strong> charge à<strong>domicile</strong> ne serait possible <strong>en</strong> pédiatrie « sans la participation d’un adulte de la famille » (8).I.3. Spécificité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> hémato-oncopédiatriques à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> Rhône-Alpes.Exemple de l’équipe de coordination de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> de l’IHOPI.3.1. Organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong>Tout <strong>en</strong>fant de moins de 18 ans à qui l’on découvre un cancer ou une hémopathiemaligne doit être traité dans un c<strong>en</strong>tre de référ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> cancérologie pédiatrique au sein duschéma régional d’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> (SROS III) (9). Un c<strong>en</strong>tre de cancérologie pédiatriqueest id<strong>en</strong>tifié selon certains critères (la liste n’est pas exhaustive) : un seuil d’activité annueld’au moins 25 à 30 nouveaux pati<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>fants ou adolesc<strong>en</strong>ts par an et une participation auxprocédures d'audit et d'évaluation relevant <strong>des</strong> missions confiées à l'Institut national ducancer. Il assure égalem<strong>en</strong>t la continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> médicaux et paramédicaux de souti<strong>en</strong>, quece soit vis à vis <strong>des</strong> familles, <strong>des</strong> médecins traitants ou <strong>des</strong> établissem<strong>en</strong>ts de santé. Lepersonnel s’organise pour être disponible et apporter une réponse médicale et paramédicale ycompris les week-<strong>en</strong>ds et jours fériés. Ils doiv<strong>en</strong>t offrir l’accès à un plateau technique completadapté à l’<strong>en</strong>fant ainsi que <strong>des</strong> équipem<strong>en</strong>ts diagnostiques et thérapeutiques. L'organisation<strong>des</strong> <strong>soins</strong> dans le c<strong>en</strong>tre de référ<strong>en</strong>ce doit garantir la qualité <strong>des</strong> pratiques et inclure <strong>en</strong>particulier un exercice pluridisciplinaire, la mise <strong>en</strong> place du dispositif d'annonce et l'accès à<strong>des</strong> <strong>soins</strong> de support (souti<strong>en</strong> psychologique, gestion de la douleur, <strong>soins</strong> palliatifs et letraitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> autres symptômes notamm<strong>en</strong>t la dénutrition et les effets secondaires <strong>des</strong>traitem<strong>en</strong>ts …) (1) .A Lyon et dans la région Rhône-Alpes, l’Institut d’Hématologie et d’OncologiePédiatrique (IHOP) est le c<strong>en</strong>tre de référ<strong>en</strong>ce de la prise <strong>en</strong> charge dans <strong>des</strong> cancers ethémopathies de l’<strong>en</strong>fant.I.3.2. Exemples de réseaux de <strong>soins</strong> et d’HAD existants sur le territoire FrançaisLes solutions existantes sur le territoire français pour rapprocher le plus possible les<strong>en</strong>fants de leur <strong>domicile</strong> tout <strong>en</strong> assurant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de haute technicité avec un niveau de25
sécurité équival<strong>en</strong>t à celui de l’hôpital sont très diversifiées. Elles dép<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t de la structuregéographique de la région, de l’historique <strong>des</strong> fonctionnem<strong>en</strong>ts sanitaires et <strong>des</strong> part<strong>en</strong>ariatspréexistants <strong>en</strong>tre la structure hospitalière référ<strong>en</strong>te, les c<strong>en</strong>tres hospitaliers régionaux (CHR)et les acteurs de <strong>soins</strong> ambulatoires. Par exemple selon l’emplacem<strong>en</strong>t géographique lastructure d’hospitalisation à <strong>domicile</strong> (HAD) peut être hospitalière ou extra hospitalière. LesHAD peuv<strong>en</strong>t être « généralistes » organisant alors les suites de <strong>soins</strong> <strong>en</strong> continuité d’unehospitalisation ou spécialisées traitant d’une seule spécialité (oncologie par exemple). Enfinelles peuv<strong>en</strong>t s’adresser à un public majoritairem<strong>en</strong>t adulte et s’ét<strong>en</strong>dre au cas par cas à <strong>des</strong>prises <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> pédiatrie ou être spécialisées dans les prises <strong>en</strong> charge pédiatriques. Il <strong>en</strong>va de même pour l’oncologie et l’hémato-oncopédiatrie. D’ailleurs il existe probablem<strong>en</strong>tautant d’organisations que de service d’oncopédiatrie <strong>en</strong> France.Le Docteur Suc dans son article « Je voudrais r<strong>en</strong>trer à la maison. Prise <strong>en</strong> charge del’<strong>en</strong>fant à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> oncopédiatrie ». (6) développe les différ<strong>en</strong>ces de prise <strong>en</strong> charge quiexist<strong>en</strong>t dans certaines régions françaises notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre le réseau ONCOMIP de la régionMidi-Pyrénées, le réseau RESOP <strong>des</strong> régions Prov<strong>en</strong>ce Alpes Cote d’Azur et Corse et l’HADde l’Assistance Publique de Hôpitaux de Paris (APHP), de la fondation Croix Saint Simon.Tous trois sont <strong>des</strong> réseaux ou HAD c<strong>en</strong>trés sur l’oncopédiatrie et ayant réalisé un transfertd’activité soit vers les services de pédiatrie générale <strong>des</strong> c<strong>en</strong>tres hospitaliers régionaux (réseauOncomip), soit vers une équipe de soignants ambulatoires <strong>en</strong> li<strong>en</strong>s avec les CHR et le c<strong>en</strong>tred’oncopédiatrie de référ<strong>en</strong>ce (Réseau Resop). Enfin à Paris une équipe mobile hospitalière sedéplace à <strong>domicile</strong> dans le cadre de l’HAD. Qu’<strong>en</strong> est-il dans la région Rhône Alpes ?I.3.3. Les spécificités de l’HAD à l’IHOPL’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOP) est un établissem<strong>en</strong>thospitalier spécialisé, créé et géré conjointem<strong>en</strong>t par les Hospices Civils de Lyon (HCL),établissem<strong>en</strong>t public de santé, et le C<strong>en</strong>tre Léon Bérard (CLB), établissem<strong>en</strong>t privé participantau service public hospitalier (10) . L’IHOP reçoit <strong>en</strong>viron 200 nouveaux cas de cancers(tumeurs soli<strong>des</strong> ou hémopathies) et d’hémopathies bénignes par an et est donc à ce titre lec<strong>en</strong>tre de référ<strong>en</strong>ce de la région Rhône alpes <strong>en</strong> hémato-oncopédiatrie. Depuis 2008, année <strong>des</strong>on ouverture, une cellule de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> externes dédiée à l’oncopédiatrie existe àl’IHOP.26
L’équipe de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>Une équipe soignante dédiée à la coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> a été mise <strong>en</strong> placedepuis une dizaine d’année et individualisée au sein de l’IHOP depuis son ouverture <strong>en</strong> 2008.Cette équipe peut être assimilée à un service de <strong>soins</strong> à part <strong>en</strong>tière. Elle est composée d’unmédecin oncopédiatre coordinateur, d’une infirmière coordinatrice, et de trois infirmières deterrain tous issus de la spécialité hématologie et oncologie pédiatrique. Tous connaiss<strong>en</strong>t doncbi<strong>en</strong> la culture de <strong>soins</strong> de l’hôpital. Cette équipe a vocation à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge dèsl’hospitalisation les familles dont l’<strong>en</strong>fant va bénéficier de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>, de leur <strong>en</strong>expliquer le fonctionnem<strong>en</strong>t, d’organiser le retour à <strong>domicile</strong> et le suivi <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Lesinfirmières de terrain peuv<strong>en</strong>t se r<strong>en</strong>dre auprès du personnel ambulatoire pour leur délivrer<strong>des</strong> formations adaptées aux techniques, protocoles et matériels à utiliser. La cellule decoordination ne fait pas de <strong>soins</strong>. Toutes les compét<strong>en</strong>ces sont transférées au personnelsoignant ambulatoire. Dans certaines prises <strong>en</strong> charge spécifiques le médecin coordinateur,peut égalem<strong>en</strong>t être am<strong>en</strong>é à se déplacer au <strong>domicile</strong> de l’<strong>en</strong>fant afin d’adapter un traitem<strong>en</strong>tou d’évaluer l’évolution clinique de l’<strong>en</strong>fant. En plus de la formation la cellule decoordination s’occupe égalem<strong>en</strong>t de la gestion administrative et médicale à distance. Lesinfirmières sont les interlocuteurs privilégiés <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts ou du personnel soignantambulatoire. Le périmètre d’action de l’équipe est régional, il n’existe aujourd’hui pas delimite précise. Leur action peut même s’ét<strong>en</strong>dre aux départem<strong>en</strong>ts limitrophes (<strong>en</strong> Saône etLoire par exemple), dans la mesure où l’<strong>en</strong>fant est pris <strong>en</strong> charge à l’IHOP et nécessite <strong>des</strong><strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>.Mais tous les <strong>soins</strong> externes ne sont pas pris <strong>en</strong> charge par la cellule de coordination.Elle intervi<strong>en</strong>t dès lors que <strong>des</strong> <strong>soins</strong> plus invasifs ou plus techniques qu’une prise de sang ou<strong>des</strong> injections sous cutanées sont prescrits par le médecin oncologue.Dès que besoin, la cellule de coordination est informée par prescription informatiséedu souhait d’une prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong>. Le rôle <strong>des</strong> soignants de cette équipe est devérifier la faisabilité sur le plan logistique, technique de <strong>soins</strong> et disponibilité <strong>des</strong> soignantslibéraux (11) . En fonction de la demande deux grands mo<strong>des</strong> d’organisation peuv<strong>en</strong>t être mis<strong>en</strong> place.27
La prise <strong>en</strong> charge type « suite de <strong>soins</strong> »Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> s'adress<strong>en</strong>t aux <strong>en</strong>fants et adolesc<strong>en</strong>ts mala<strong>des</strong> à qui le médecinoncologue a prescrit <strong>des</strong> <strong>soins</strong> réalisables par une équipe d’infirmiers ambulatoires. Lastratégie thérapeutique est définie au sein <strong>des</strong> services d’hospitalisation traditionnelle. Lacellule de coordination de l’hôpital, <strong>en</strong> collaboration avec les soignants libéraux, assuresimplem<strong>en</strong>t la poursuite de cette prise <strong>en</strong> charge prédéfinie. Les <strong>soins</strong> qui peuv<strong>en</strong>t être mis <strong>en</strong>place sont par exemple la poursuite d’une antibiothérapie, d’antifongiques, d’une hydratationpost chimiothérapie ou <strong>en</strong>core une alim<strong>en</strong>tation artificielle (<strong>en</strong>térale ou par<strong>en</strong>térale). Il peutégalem<strong>en</strong>t s’agir de <strong>soins</strong> discontinus de type réfection de pansem<strong>en</strong>ts (pour le cathéterveineux c<strong>en</strong>tral inséré par voie périphérique (PICC) par exemple). L’équipe de coordinationévalue la faisabilité de la prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> définissant les be<strong>soins</strong> et les limites avec lessoignants hospitaliers, avec l’<strong>en</strong>fant et sa famille. Elle contacte les soignants libéraux etvérifie leur disponibilité. Enfin elle assure la fourniture de médicam<strong>en</strong>ts et de matériauxnécessaires à la réalisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. En général les familles sont r<strong>en</strong>contrées dans le serviceoù l’<strong>en</strong>fant est hospitalisé et les soignants libéraux contactés par téléphone. Un déplacem<strong>en</strong>t à<strong>domicile</strong> n’est prévu que s’il existe un besoin de formation spécifique <strong>des</strong> soignants libérauxqui diffère selon la complexité de la prise <strong>en</strong> charge (11) . Le médecin traitant est actuellem<strong>en</strong>tpeu informé et peu impliqué dans ce type de prise <strong>en</strong> charge. La file active <strong>en</strong> 2012 <strong>des</strong><strong>en</strong>fants <strong>en</strong> suite de <strong>soins</strong> était de vingt à tr<strong>en</strong>te pati<strong>en</strong>ts par jour. Le nombre de pati<strong>en</strong>ts eststable depuis 2010 <strong>en</strong>viron. La prise <strong>en</strong> charge type « alternative à l’hospitalisation »Lorsque les <strong>soins</strong> nécessit<strong>en</strong>t une interv<strong>en</strong>tion plus régulière ou plus globale (<strong>soins</strong>palliatifs par exemple) de l’équipe médicale, les <strong>en</strong>fants sont pris <strong>en</strong> charge dans le cadred’une hospitalisation à <strong>domicile</strong>. Il s’agit là d’un transfert de compét<strong>en</strong>ces de l’activité d’unservice hospitalier au <strong>domicile</strong> de l’<strong>en</strong>fant. L’HAD est <strong>en</strong>cadrée par un statut administratifprécis. Elle est définie dans la circulaire n°161DHOS/O/2004 du 29 mars 2004. « L’équiped’hospitalisation à <strong>domicile</strong> doit- être mobilisable 24 h/24- justifier d'une formation et d'un <strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t soignant dédié à la pédiatrie et à lacancérologie- pouvoir assurer les <strong>soins</strong> de support.28
- être <strong>en</strong> mesure de communiquer simplem<strong>en</strong>t et rapidem<strong>en</strong>t avec le c<strong>en</strong>tre (l’IHOP)afin de r<strong>en</strong>dre fluide le passage de l'hospitalisation conv<strong>en</strong>tionnelle à l'hospitalisation à<strong>domicile</strong>.Les chimiothérapies ne seront réalisées au <strong>domicile</strong> de l'<strong>en</strong>fant que dans <strong>des</strong> conditionsstrictes de sécurité, ceci incluant la prescription, la préparation, le stockage et le transport,l'administration, la surveillance et l'élimination <strong>des</strong> produits reconstitués. » (1)La cellule de coordination se situe non seulem<strong>en</strong>t comme organisatrice de la mise <strong>en</strong>place d’une stratégie thérapeutique prédéfinie mais égalem<strong>en</strong>t comme cellule de liaison.Chaque prise <strong>en</strong> charge doit être supervisée par le médecin coordonateur. La poursuite d’unechimiothérapie à <strong>domicile</strong>, la gestion post opératoire de la douleur de drains ou <strong>des</strong>pansem<strong>en</strong>ts complexes, une situation de <strong>soins</strong> palliatifs sont <strong>des</strong> <strong>soins</strong> pris <strong>en</strong> charge dans lecadre d’une HAD. Depuis 2004, pour <strong>des</strong> situations médicales ou psycho socialesparticulières souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec une prise <strong>en</strong> charge palliative, une r<strong>en</strong>contre <strong>en</strong>tre soignantshospitaliers et libéraux ainsi que <strong>des</strong> visites à <strong>domicile</strong>s, au plus près <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et de leursfamilles, ont été organisées (12) . Afin d’arriver à un élargissem<strong>en</strong>t de l’équipe soignante <strong>en</strong>intégrant les libéraux une « réunion de mise <strong>en</strong> place » est réalisée au début de la prise <strong>en</strong>charge le plus souv<strong>en</strong>t au cabinet du médecin traitant. Elle permet la r<strong>en</strong>contre de tous lessoignants hospitaliers et libéraux qui vont être impliqués dans la prise <strong>en</strong> charge de l’<strong>en</strong>fant.Les infirmiers libéraux qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> premier lieu sont secondés à <strong>domicile</strong> par <strong>des</strong>infirmiers référ<strong>en</strong>ts de l’IHOP et le médecin coordonateur pour <strong>des</strong> formations à l’utilisationd’un matériel spécialisé ou pour <strong>des</strong> bilans réguliers. Le médecin généraliste devi<strong>en</strong>t dans cecas là le pivot de cette collaboration sur le terrain, <strong>en</strong> évaluant l’état clinique et les be<strong>soins</strong> del’<strong>en</strong>fant, <strong>en</strong> adaptant si besoin les prescriptions avec ou sans l’aide du médecin decoordination pédiatrique. Il est égalem<strong>en</strong>t am<strong>en</strong>é à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge les par<strong>en</strong>ts et les frèreset sœurs <strong>en</strong> évaluant leurs angoisses et autres troubles somatiques associés…En cela il vadevoir mobiliser <strong>des</strong> compét<strong>en</strong>ces différ<strong>en</strong>tes de l’oncologue pédiatre qui connait moinsl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t familial au quotidi<strong>en</strong>. (11)29
II. Matériel et Métho<strong>des</strong>II.1.Choix de la méthodeII.1.1. Une étude qualitativeL’objectif de ma recherche est d’étudier la manière dont les <strong>en</strong>fants racont<strong>en</strong>t leurmaladie, les <strong>soins</strong> qu’ils ont reçus, les s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts qui <strong>en</strong> découl<strong>en</strong>t, de les comparer au vécu<strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts et à celui <strong>des</strong> soignants. La méthode de recherche qualitative m’a semblé la plusadaptée pour recueillir le vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et de leurs par<strong>en</strong>ts car <strong>en</strong>aucun cas ce dernier ne peut être quantifié.Parmi les différ<strong>en</strong>tes métho<strong>des</strong> utilisées <strong>en</strong> recherche qualitative je me suis basée surune approche compréh<strong>en</strong>sive de type socio anthropologique dont le but est de «compr<strong>en</strong>dre les<strong>en</strong>s ou la signification d’un phénomène à partir de l’expéri<strong>en</strong>ce de ceux qui le viv<strong>en</strong>t » (13), <strong>en</strong>interrogeant les personnes sur l’expéri<strong>en</strong>ce qu’on souhaite étudier, pour ma part les <strong>soins</strong> à<strong>domicile</strong> <strong>en</strong> hémato-oncopédiatrie.Le raisonnem<strong>en</strong>t inductif inhér<strong>en</strong>t à ce type de recherche permet de vérifier unehypothèse jusque là inconnue ou supposée.II.1.2. Méthode de recueil <strong>des</strong> donnéesDes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s semi dirigés (ou semi structurés) m’ont permis de recueillir les donnéesnécessaires à mon travail. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> semi dirigé a une structure souple constituée dequestions ouvertes définissant <strong>des</strong> champs à explorer, <strong>des</strong>quels l’interviewer ou l’interviewépeuv<strong>en</strong>t diverger p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> pour étudier une idée plus <strong>en</strong> détail (14). J’ai choisi cemode d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> pour les <strong>en</strong>fants et les par<strong>en</strong>ts car je voulais laisser aux <strong>en</strong>fants la libertéd’approfondir certains points de leur parcours de <strong>soins</strong> qui les aurai<strong>en</strong>t le plus marqués etpermettre aux par<strong>en</strong>ts de pouvoir exprimer leur vécu douloureux de la situation.30
II.1.3. Qualité de l’échantillonPour le recrutem<strong>en</strong>t j’ai appliqué le principe de l’échantillonnage raisonné.L’échantillon <strong>des</strong> personnes interrogées devait être le plus homogène possible pourreprés<strong>en</strong>ter au mieux la population étudiée (ici les <strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong> et leurs par<strong>en</strong>ts). Enrecherche qualitative, l’échantillon constitué ne vise pas une représ<strong>en</strong>tativité statistique de lapopulation étudiée. Toutefois, il est utile selon l’objectif de l’étude de pondérer la sélection<strong>des</strong> participants par certains critères reflétant la diversité de la population.II.1.4. Critères de sci<strong>en</strong>tificité« La valeur d’une recherche sci<strong>en</strong>tifique est <strong>en</strong> grande partie dép<strong>en</strong>dante de l’habiletédu chercheur à démontrer la crédibilité de ses découvertes » (15)Les critères de sci<strong>en</strong>tificité sont diversem<strong>en</strong>t décrits <strong>en</strong> recherche qualitative. Le pointle plus important est la rigueur du travail à tous les niveaux de la méthode à la prés<strong>en</strong>tation etl’analyse <strong>des</strong> résultats.Dans ce type de travail la validité interne consiste à vérifier si les données recueilliesreflèt<strong>en</strong>t la réalité. Un <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s d’y parv<strong>en</strong>ir est d’utiliser la technique de triangulation <strong>des</strong>données. La triangulation permet de comparer les résultats obt<strong>en</strong>us à partir d’au moins deuxtechniques différ<strong>en</strong>tes ou deux sources de recueil. Pour mon étude l’observation du contexteet les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont été utilisés. De plus j’ai recueilli et comparé le vécu <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts et <strong>des</strong><strong>en</strong>fants. Enfin pour les <strong>en</strong>fants les <strong>des</strong>sins ont été utilisés <strong>en</strong> plus <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s commematériel d’étude. Ces résultats sont <strong>en</strong>suite confrontés aux données de la littérature qui avai<strong>en</strong>tsous t<strong>en</strong>dues l’élaboration de l’hypothèse de départ du travail. La validité externe consiste àgénéraliser les données recueillies à d’autres objets ou contextes. L’échantillon utilisé doitdonc être ciblé et représ<strong>en</strong>tatif de la problématique (16) .II.2.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sII.2.1. Des <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s semi dirigésLa décision de réaliser <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s semi dirigés s’est imposée d’elle-même. Du faitdu contexte de maladie cancéreuse chez un <strong>en</strong>fant et du fort pot<strong>en</strong>tiel émotionnel que31
pouvai<strong>en</strong>t induire les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s la réalisation d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s libres ne semblait pas appropriée. Ilexistait un risque trop important d’extrapolation ou de recueil limité par une trop grandeexpression émotionnelle. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s directifs avec leurs questions fermées ne lepermettai<strong>en</strong>t pas non plus.Les gui<strong>des</strong> d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> ont été réalisés de manière aussi exhaustive que possible avec<strong>des</strong> questions ouvertes et <strong>des</strong> items de relance qui permettai<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>cadrer ou de recadrerl’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> au besoin.II.2.2. Le lieuLes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont tous été réalisés, sauf un, au <strong>domicile</strong> <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts. Je sollicitaisl’accord de la famille pour une visite à <strong>domicile</strong> et aucun autre choix n’était proposé si lespar<strong>en</strong>ts ou l’<strong>en</strong>fant n’émettai<strong>en</strong>t pas de rétic<strong>en</strong>ces concernant les modalités d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Il nem’a pas semblé pertin<strong>en</strong>t de proposer un autre lieu d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> que le <strong>domicile</strong> pour parler <strong>des</strong>oins à <strong>domicile</strong> et de l’organisation du quotidi<strong>en</strong>. Le contexte du <strong>domicile</strong> permettaitégalem<strong>en</strong>t de favoriser la participation et le confort <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants qui restai<strong>en</strong>t dans leur<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t familier mais aussi de limiter les déplacem<strong>en</strong>ts de la famille dontl’éloignem<strong>en</strong>t parfois conséqu<strong>en</strong>t de l’IHOP aurait pu être un frein à leur participation.Un seul <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec un <strong>en</strong>fant a été réalisé à l’IHOP alors qu’il était <strong>en</strong> cure dechimiothérapie du fait d’une demande explicite de la maman et de l’accord de l’<strong>en</strong>fant.II.2.3. Spécificité de réalisation <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sUn à trois <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s étai<strong>en</strong>t réalisés à chaque visite au <strong>domicile</strong> familial. Je m’adaptaisaux contraintes familiales et aux hospitalisations programmées ou non. Dans la mesure dupossible les deux par<strong>en</strong>ts et l’<strong>en</strong>fant étai<strong>en</strong>t interviewés le même jour les uns à la suite <strong>des</strong>autres. Pour ne pas ori<strong>en</strong>ter l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> je n’étais informée que du diagnostic et <strong>des</strong> <strong>soins</strong>réalisé à l’<strong>en</strong>fant à <strong>domicile</strong>. Je n’ai jamais eu accès au dossier médical de l’<strong>en</strong>fant.L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec l’<strong>en</strong>fant était proposé <strong>en</strong> deuxième position ou <strong>en</strong> dernier afin de mepermettre de compr<strong>en</strong>dre le contexte de la maladie et <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. La majeure partie <strong>des</strong><strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts a été réalisée <strong>en</strong> colloque singulier. Pour pouvoir mettre <strong>en</strong> confiancel’<strong>en</strong>fant il avait été décidé d’aménager la technique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> selon l’âge. J’ai donc introduitle jeu (jeux de société, playmobiles) et parfois le <strong>des</strong>sin au cours de mes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s pour créerun li<strong>en</strong> de confiance <strong>en</strong>tre l’<strong>en</strong>quêteur et l’<strong>en</strong>fant interviewé.32
Observation du contextePartie inhér<strong>en</strong>te à la réalisation d’une thèse qualitative, cette observation a été facilitéegrâce au temps passé au <strong>domicile</strong> de chaque famille. En l’espace de quelques heures j’étaisintégrée dans le rythme de vie <strong>des</strong> familles, toutes habituées à recevoir du personnel soignantà <strong>domicile</strong> et dont aucune n’avait changé ses habitu<strong>des</strong> pour me recevoir.Les contraintes du <strong>domicile</strong>Le <strong>domicile</strong> s’étant imposé comme lieu <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s, j’ai été confrontée à certainescontraintes organisationnelles. D’une part la disposition <strong>des</strong> pièces dans la maison nepermettait pas forcém<strong>en</strong>t de trouver un <strong>en</strong>droit calme et intimiste pour la réalisation del’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> dans <strong>des</strong> conditions optimales. D’autre part la difficulté pour les par<strong>en</strong>ts de laisserleur <strong>en</strong>fant <strong>en</strong> colloque singulier avec moi a parfois un peu limité l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.Modulation de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> selon le participant L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> « Classique »Pour recueillir le plus de données sans fermer le dialogue et <strong>en</strong> limitant les digressionspot<strong>en</strong>tielles d’un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> libre, j’ai choisi de réaliser <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s semi dirigés. Dans ce casle guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> ne correspondait pas à un questionnaire mais plutôt à un <strong>en</strong>semble dethèmes à aborder avec <strong>des</strong> questions ouvertes permettant de relancer la discussion. Le canevasdu guide (l’ordre <strong>des</strong> thèmes abordés) était modulable p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong>réponses évoquées par les par<strong>en</strong>ts et les <strong>en</strong>fants. Deux canevas d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s différ<strong>en</strong>ts ont étéétablis pour les par<strong>en</strong>ts et les <strong>en</strong>fants. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> par le jeuJ’ai décidé d’aménager la technique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> selon l’âge <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants interviewés.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont donc été réalisés soit comme ceux <strong>des</strong> adultes de manière semi directive« classique » (pour les grands <strong>en</strong>fants de douze ans) soit au cours de pério<strong>des</strong> de jeuxproposées à l’<strong>en</strong>fant (jeux de société, <strong>des</strong>sins, playmobiles). Les questions de rechercheétai<strong>en</strong>t toutes abordées. Le canevas d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> était souv<strong>en</strong>t aménagé pour une meilleurecompréh<strong>en</strong>sion de l’<strong>en</strong>fant. Les questions étai<strong>en</strong>t découpées ou reformulées de manière plus33
simple et plus directive puis une demande d’explications « Pourquoi ?… » de leur réponseleur était demandée. Les <strong>des</strong>sinsLes <strong>des</strong>sins sont le support et la scène d’un dialogue évolutif. Ils peuv<strong>en</strong>t exprimer lesquestions de l’<strong>en</strong>fant mais aussi transmettre celles de ses par<strong>en</strong>ts (17) . J’ai utilisé les <strong>des</strong>sinscomme support à l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et au dialogue avec l’<strong>en</strong>fant. De ce fait une partie du <strong>des</strong>sin étaitori<strong>en</strong>tée avec <strong>des</strong> consignes précises <strong>en</strong> rapport avec le sujet de l’étude. Des feuilles ainsiqu’un <strong>en</strong>semble de feutres et crayons de couleurs étai<strong>en</strong>t mis à disposition <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants <strong>en</strong> plusdu matériel qu’ils pouvai<strong>en</strong>t avoir à leur <strong>domicile</strong>. Les <strong>en</strong>fants avai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>suite le choix <strong>des</strong>couleurs, de l’ag<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t du <strong>des</strong>sin et de l’interprétation du thème. Le <strong>des</strong>sin était soitcomm<strong>en</strong>té p<strong>en</strong>dant sa réalisation soit après sa réalisation selon le souhait de l’<strong>en</strong>fant et ledéroulem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.II.2.4. Date de déroulem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sLes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont tous été réalisés <strong>en</strong>tre janvier à mai 2012.II.3.Mise <strong>en</strong> place de l’étudeII.3.1. Lieu de réalisation de l’étudeLa zone de recrutem<strong>en</strong>t était celle couverte par l’équipe de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> del’IHOP, c'est-à-dire ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t la région Rhône-Alpes. Pour ce travail les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ontété réalisés dans l’Ain, le Rhône, l’Isère, et la Drôme.II.3.2. Le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>ElaborationLe guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a été élaboré grâce à une bibliographie détaillée et ajusté pourrépondre au mieux à la question de recherche.34
Deux gui<strong>des</strong> d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> ont été réalisés: un premier pour les par<strong>en</strong>ts, le second pourles <strong>en</strong>fants. Le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> n’a pas été modifié <strong>en</strong> fonction du par<strong>en</strong>t interrogé. De mêmepour les <strong>en</strong>fants il a été décidé de réaliser une trame unique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> quel que soit l’âge del’<strong>en</strong>fant malade et le type de tumeur ou d’hémopathie. La formulation <strong>des</strong> questions a étésimplifiée pour les <strong>en</strong>fants et le tutoiem<strong>en</strong>t employé systématiquem<strong>en</strong>t afin de placer l’<strong>en</strong>fantdans un climat de confiance plus propice à l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.Une bonne maitrise de la technique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> était souhaitable pour obt<strong>en</strong>ir <strong>des</strong><strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s de qualité suffisante pour être analysables.Entreti<strong>en</strong> testUn <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> test a été organisé <strong>en</strong> décembre 2011 afin d’affiner les différ<strong>en</strong>ts gui<strong>des</strong>d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et de me permettre de me familiariser avec la technique. Le canevas du guide a<strong>en</strong>suite été relu et validé par Madame le Docteur E. Lasserre, Maitre de Confér<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>Anthropologie et Monsieur le Professeur Y. Zerbib, Professeur de Médecine Générale, tousdeux habitués à la méthodologie <strong>des</strong> thèses qualitatives.Les thèmes abordésTrois grands thèmes se sont d’emblée dégagés lors de l’élaboration du guided’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> :- La maladie- Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>- La vie quotidi<strong>en</strong>ne avec/pour un <strong>en</strong>fant maladeLes <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> ne correspond<strong>en</strong>t pas à la totalité <strong>des</strong> thèmes du guide car il m’asemblé difficile d’étudier les <strong>soins</strong> sans évoquer la maladie. Nous ne pouvions donc pasexclure l’analyse du vécu de la maladie cancéreuse alors même que les <strong>soins</strong> <strong>en</strong> font partieintégrante. D’autre part il est logique d’imaginer que la mise <strong>en</strong> place <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> vabouleverser la vie quotidi<strong>en</strong>ne de la famille. Compr<strong>en</strong>dre l’importance <strong>des</strong> changem<strong>en</strong>tsoccasionnés par ces <strong>soins</strong> sur la vie de famille, sur l’organisation au quotidi<strong>en</strong> et dans lesrelations intra familiales était égalem<strong>en</strong>t une priorité dans la réalisation de ce travail. Ceschangem<strong>en</strong>ts pouvai<strong>en</strong>t être vécus comme une conséqu<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>.35
II.3.3. Définition de la population : Les critères d’inclusionUne population spécifique d’<strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong>…La cancérologie pédiatrique est un pôle spécialisé qui regroupe la prise <strong>en</strong> charge <strong>des</strong>tumeurs soli<strong>des</strong> de l’<strong>en</strong>fant, l’oncologie au s<strong>en</strong>s étymologique du terme, et les hémopathiesmalignes. Les protocoles pédiatriques inclu<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants de la naissance aux grandsadolesc<strong>en</strong>ts de dix neuf ans, voire plus s’ils sont <strong>en</strong> rechute et ont déjà été traités <strong>en</strong> pédiatrie.Il existe une barrière nette <strong>en</strong>tre quatorze et quinze ans du fait d’une différ<strong>en</strong>ce de type decancer que prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les grands adolesc<strong>en</strong>ts. De nombreuses étu<strong>des</strong> de cancérologie adulteinclu<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>fants à partir de l’âge de quinze ans. Enfin du point de vue dudéveloppem<strong>en</strong>t psycho-social et de la maturation intellectuelle, la croissance <strong>en</strong> pédiatrie esttrès rapide si bi<strong>en</strong> que même si ces deux tranches d’âges font partie du cadre de la pédiatrie ilparaissait important de les individualiser.Après réflexion avec le Docteur Schell, oncopédiatre coordonateur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> externesà l’IHOP, il nous a semblé que les att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et <strong>des</strong> adolesc<strong>en</strong>ts mala<strong>des</strong> n’étai<strong>en</strong>tprobablem<strong>en</strong>t pas les mêmes. Il était donc indisp<strong>en</strong>sable de dissocier les tranches d’âge dezéro à quatorze ans <strong>des</strong> quinze à dix neuf ans afin de pouvoir étudier au mieux leurs att<strong>en</strong>tes.Pour cette étude, la tranche d’âge de quatre à quatorze ans a été choisie. Après avis auprès demédecins généralistes, oncopédiatres, pédiatres et psychothérapeutes, la limite d’âgeinférieure a été fixée à quatre ans car à cet âge là l’<strong>en</strong>fant est déjà socialisé avec sa premièreannée d’école. D’autre part avant cet âge un <strong>en</strong>fant n’a pas une consci<strong>en</strong>ce aigüe de ce qui luiarrive (maladie grave, concept de mort, inquiétude <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts) (17) et discuter avec lui d’unemaladie grave aurait pu être délicat voire délétère pour sa construction psychologique.… Et leurs par<strong>en</strong>tsLa nécessaire relation triangulaire qu’il existe <strong>en</strong>tre un médecin, l’<strong>en</strong>fant malade et sespar<strong>en</strong>ts se retrouve égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. En effet, l’<strong>en</strong>fant ne peut être dissocié <strong>des</strong>es par<strong>en</strong>ts p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong>. Il m’a donc paru indisp<strong>en</strong>sable de recueillir <strong>en</strong> plus du vécu <strong>des</strong><strong>en</strong>fants celui <strong>des</strong> premiers aidants: les par<strong>en</strong>ts. J’ai décidé de recueillir leurs vécus de manièreséparée souv<strong>en</strong>t l’un après l’autre, car même si pour les deux par<strong>en</strong>ts l’<strong>en</strong>fant a la mêmemaladie et le même traitem<strong>en</strong>t, leurs vécus et leurs rôles dans la maladie et les <strong>soins</strong> sontprobablem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ts.36
L’échantillonnage raisonnéNotre objectif de départ était d’interroger 10 <strong>en</strong>fants et 10 couples de par<strong>en</strong>ts. L<strong>en</strong>ombre de participants interrogés dans le cadre d’une étude qualitative, n’est pas un critère devalidité de l’étude. Le recueil d’information doit favoriser la « saturation <strong>des</strong> données » afinque le chercheur ait une compréh<strong>en</strong>sion la plus complète du problème étudié (13) . La saturationest apparue au bout du sixième <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> de par<strong>en</strong>ts mais il a été décidé, pour favoriser unemeilleure compréh<strong>en</strong>sion du contexte, de continuer les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts de manièreconcomitante à ceux <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Pour les <strong>en</strong>fants la saturation <strong>des</strong> données n’a pas vraim<strong>en</strong>tété atteinte avec toutes les réserves que l’on peut émettre sur la quantité <strong>des</strong> donnéesrecueillies au cours d’un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec un jeune <strong>en</strong>fant.L’inclusion d’autant de fille que de garçons était souhaitée. Le sexe ratiohomme/femme <strong>des</strong> cancers de l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong>tre 2000 et 2004 est de 1,2 garçons pour 1 fille (18) .Concernant les <strong>soins</strong>, il fallait que l’<strong>en</strong>fant bénéficie ou ait bénéficié de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. Ladéfinition de <strong>soins</strong> se résumait à l’interv<strong>en</strong>tion d’un professionnel médical ou paramédical, à<strong>domicile</strong>, pour réaliser un acte médical ou sur prescription à l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec sa maladie(prise de sang, pansem<strong>en</strong>t, toilette, injection de chimiothérapie…). Peu importait lacomplexité du ou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prodigués à l’<strong>en</strong>fant. A ce titre j’ai recruté <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants appart<strong>en</strong>antau cadre administratif <strong>des</strong> prises <strong>en</strong> charges de type « suite de <strong>soins</strong> » et de type « alternativeà l’hospitalisation » ou n’appart<strong>en</strong>ant ni à l’un ni à l’autre. Il n’y avait pas de distanceminimum à respecter <strong>en</strong>tre le <strong>domicile</strong> de l’<strong>en</strong>fant et l’IHOP. Pour augm<strong>en</strong>ter ladiversification nous souhaitions inclure <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants issus de milieu rural, semi rural et urbain,pour certains proches et pour d’autre beaucoup plus éloignés de l’IHOP.Tous les <strong>en</strong>fants étai<strong>en</strong>t ou avait été soignés à l’IHOP et tous sauf un avait été suivispar l’équipe de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>.II.3.4. Méthode de recrutem<strong>en</strong>tPlusieurs approches ont été utilisées:La majeure partie du recrutem<strong>en</strong>t a été faite par l’intermédiaire de l’équipe decoordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> de l’IHOP. Plusieurs réunions de concertation ont étéorganisées lors de la mise <strong>en</strong> place de l’étude puis lors de son déroulem<strong>en</strong>t.37
Le recrutem<strong>en</strong>t a aussi été réalisé par l’intermédiaire d’un médecin de PMI (ProtectionMaternelle et Infantile). Dans le cadre de mon <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> test, <strong>des</strong> proches non professionnelsde santé ont égalem<strong>en</strong>t pu me mettre <strong>en</strong> contact avec une participante pot<strong>en</strong>tielle.Dans tous les cas, une première information sur l’objectif de l’étude leur a étécommuniquée par la personne source qui recueillait par la même occasion l’accord oral <strong>des</strong>par<strong>en</strong>ts pour la participation à l’étude. Je les contactais <strong>en</strong>suite directem<strong>en</strong>t par téléphone pourobt<strong>en</strong>ir un second accord oral. Ce contact permettait de repréciser les objectifs de l’étude ainsique les modalités de réalisation <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s et de programmer un r<strong>en</strong>dez vous à leurconv<strong>en</strong>ance.L’accord <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants a été, dans la mesure du possible, recueilli par l’intermédiaire <strong>des</strong>par<strong>en</strong>ts lors de mon appel téléphonique. Les par<strong>en</strong>ts étai<strong>en</strong>t libres de poser toutes les questionsqu’ils souhaitai<strong>en</strong>t sur la réalisation et le but de l’étude. Je n’ai pas fait signer d’accord écritdans le cadre de mon <strong>en</strong>quête.II.3.5. La retranscription <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sLes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont été intégralem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>registrés à l’aide d’un magnétophone OlympusWS-450S avec l’accord de l’interviewé. L’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t permettait une retranscriptionintégrale sans perte significative de matériel. Je n’ai pas reformulé les propos <strong>des</strong> <strong>en</strong>quêtés nicherché à corriger les fautes de langage. J’ai transcrit les propos « mot à mot ». Chaque<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a été mis <strong>en</strong> forme et anonymisé. J’ai individualisé les propos de l’<strong>en</strong>quêteur et ceux<strong>des</strong> <strong>en</strong>quêtés, <strong>en</strong> utilisant un caractère italique pour les propos de l’<strong>en</strong>quêteur. J’ai décidéd’attribuer <strong>des</strong> prénoms fictifs aux <strong>en</strong>fants, à leurs par<strong>en</strong>ts et aux frères et sœurs de manière àrespecter l’anonymat tout <strong>en</strong> conservant un coté « humain » au récit. Tous les professionnelsde santé ont été anonymisés sous la même lettre « X ». D’une part le nombre deprofessionnels hospitaliers et ambulatoires différ<strong>en</strong>ts impliqués dans chaque prise <strong>en</strong> charger<strong>en</strong>dait délicat la numérotation d’autre part la différ<strong>en</strong>ciation de chaque professionneln’apportait ri<strong>en</strong> à mon étude. Le statut de soignant dans l’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> était le seulfacteur important à distinguer. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts n’ont pas été soumis à uneretranscription systématique. Un <strong>des</strong> deux par<strong>en</strong>ts était choisi, souv<strong>en</strong>t la maman la plusimpliquée dans les <strong>soins</strong> mais parfois de manière aléatoire le papa et retranscrit pour pourvoircomparer leur vécu à celui <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Les données analysées avec un seul <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> parcouple étai<strong>en</strong>t suffisamm<strong>en</strong>t pertin<strong>en</strong>tes et complètes pour répondre à ma question derecherche.38
II.4.L’analyse <strong>des</strong> donnéesII.4.1. Analyse observationnelle <strong>des</strong>criptive famille par familleCette partie va permettre de décrire le contexte de <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s réalisés et de donnerquelques repères tant sur la famille interviewée que sur mes ress<strong>en</strong>tis. Dans le cadre d’uneétude qualitative le vécu et les ress<strong>en</strong>tis d’une situation sont autant de paramètres clés qui vontpermettre l’analyse mais vont aussi pouvoir donner de la valeur à cette analyse. Le contextesera décrit famille par famille. Les familles ont été prés<strong>en</strong>tées dans un ordre aléatoire, parchoix, pour diversifier les différ<strong>en</strong>tes prises <strong>en</strong> charge au fil de la lecture.II.4.2. Analyse thématique transversaleL’analyse transversale permet de faire émerger les données issues de l’analyseobservationnelle et de la retranscription. Elle permet de croiser les thèmes ou occurr<strong>en</strong>cesévoqués par les <strong>en</strong>fants et par les par<strong>en</strong>ts qui selon les cas peuv<strong>en</strong>t se répondre, se compléterou s’opposer.II.4.3. Analyse <strong>des</strong> <strong>des</strong>sinsLes <strong>des</strong>sins d’<strong>en</strong>fants sont très souv<strong>en</strong>t utilisés comme un outil de communication etd’expression de l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong> support d’un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Dans le cadre de mon travail du fait del’âge <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants j’ai décidé d’utiliser le <strong>des</strong>sin comme outil complém<strong>en</strong>taire à l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>pour aborder la problématique <strong>des</strong> <strong>soins</strong> hospitaliers <strong>en</strong> opposition aux <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>.Les <strong>des</strong>sins ont tous été comm<strong>en</strong>tés p<strong>en</strong>dant la réalisation ou dans les suitesimmédiates par les <strong>en</strong>fants. Ils ont égalem<strong>en</strong>t été montrés à une psychologue clinici<strong>en</strong>nespécialisée <strong>en</strong> pédiatrie et à une psychothérapeute comportem<strong>en</strong>taliste afin d’avoir deux avisextérieurs objectifs. Il est important de rappeler que les <strong>des</strong>sins ont été <strong>en</strong>cadrés par <strong>des</strong>consignes précises et qu’ils ne sont pas l’expression libre de la p<strong>en</strong>sée de l’<strong>en</strong>fant. Ces <strong>des</strong>sinsne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t qu’une photographie instantanée du vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> par l’<strong>en</strong>fant àun instant T de sa prise ne charge.39
II.5.Recherche bibliographiqueII.5.1. Bases de donnéesLes recherches ont été majoritairem<strong>en</strong>t réalisées par le biais <strong>des</strong> moteurs de recherchesur internet : Google, Google Scholar, Doc Cismef, revue Bibliomed et de bases de données :Medline, Pubmed, CAIRN, BIUM Paris V, Sudoc, BU Lyon 1, …II.5.2. Mots clésLes mots clés utilisés pour la recherche ont été :- <strong>en</strong> français : Oncopédiatrie, <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>, <strong>en</strong>fant, cancer, <strong>domicile</strong>, <strong>soins</strong> palliatif- <strong>en</strong> anglais : palliative care, pediatric, childr<strong>en</strong>, cancer, pediatric homecareII.6.Les forces et les limites de l’étudeII.6.1. Les forcesL’aspect le plus intéressant de ce travail est son coté novateur. En effet il s’agit d’uneétude pilote autant dans son sujet que dans sa mise <strong>en</strong> œuvre <strong>en</strong> médecine générale. Recueillirle vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants atteints de cancer, et celui de leurs par<strong>en</strong>ts dans lecadre d’une recherche qualitative n’a <strong>en</strong>core jamais été réalisé <strong>en</strong> France. Pouvoir dégager lesavantages et les limites d’une prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> du point de vue <strong>des</strong> premiersconcernés par ces <strong>soins</strong> et de leurs aidants naturels peut donc être une réelle avancée dans lacompréh<strong>en</strong>sion de l’action de terrain et de son ajustem<strong>en</strong>t au plus près <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong>familles. Le sujet traité regroupe <strong>des</strong> thèmes médico-psycho-anthropologiques qui seretrouv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> médecine générale d’où mon intérêt pour cette étude.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s avec les par<strong>en</strong>ts ont souv<strong>en</strong>t été longs (jusqu’à une heure et quarantecinq minutes pour certains), ce qui semble correspondre à un souhait, pour le par<strong>en</strong>t interrogéde partager son expéri<strong>en</strong>ce. La longueur <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s prouv<strong>en</strong>t que les par<strong>en</strong>ts ont besoind’exprimer leur vécu sur les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>.40
II.6.2. Les LimitesConcernant les modalités de réalisation de l’étudeLa technique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> semi-dirigé dans les étu<strong>des</strong> qualitatives permet demodifier le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> au cours de l’étude <strong>en</strong> fonction du but de celle-ci et <strong>des</strong> premiersrésultats obt<strong>en</strong>us (19) . L’étude est donc évolutive dans sa réalisation. Il n’est pas question ici dereproductibilité <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s et la modification de technique d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> voire l’ajout dequestions de relance fait partie intégrante de la réalisation et de l’exploitation du guide.Cep<strong>en</strong>dant la qualité <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s pouvait varier selon les conditions de réalisation. Encoreune fois dans une étude qualitative, ri<strong>en</strong> n’est imposé au participant, j’ai donc essayé de faireau mieux <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong> conditions et de la configuration du <strong>domicile</strong>, pour obt<strong>en</strong>ir <strong>des</strong><strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s de qualité suffisante. L’installation dans <strong>des</strong> pièces ouvertes pour l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avecles <strong>en</strong>fants pouvai<strong>en</strong>t être un frein à leur libre expression. Ils n’exprim<strong>en</strong>t pas facilem<strong>en</strong>t leurscraintes mais il est possible qu’ils ne le fass<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core moins s’ils sav<strong>en</strong>t que leurs par<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t et écout<strong>en</strong>t la conversation. Enfin le lieu de réalisation influ<strong>en</strong>ce aussi beaucoup laqualité de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Timéo a été r<strong>en</strong>contré à l’IHOP dans une chambre double alors qu’ilétait <strong>en</strong> cure de chimiothérapie. L’intimité n’était pas possible, l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a été parasité par<strong>des</strong> visites de soignants régulières et donc la possibilité pour lui d’exprimer son ress<strong>en</strong>ti étaittrès limitée.La quantité <strong>des</strong> données recueillies au fil <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s peut laisser p<strong>en</strong>ser que cetteétude aurait pu aisém<strong>en</strong>t être scindée <strong>en</strong> deux, pour étudier séparém<strong>en</strong>t le vécu <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants etcelui <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts. Cette scission aurait pu permettre un travail plus approfondi de chacun <strong>des</strong>sujets de l’étude, pour <strong>en</strong>suite pouvoir les comparer.Concernant l’<strong>en</strong>quêteurLa principale limite me concernant était mon inexpéri<strong>en</strong>ce pour la réalisationd’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s qualitatifs. Mon expéri<strong>en</strong>ce limitée <strong>en</strong> oncopédiatrie aurait aussi pu être un frein àces <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s surtout que n’ayant pas accès au dossier médical de l’<strong>en</strong>fant je ne partais <strong>en</strong>visite à <strong>domicile</strong> qu’avec très peu de données. Il s’est avéré que les par<strong>en</strong>ts pr<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t le tempsde m’expliquer à leur manière, avec leurs connaissances mais avec force détails la maladie deleur <strong>en</strong>fant et qu’à aucun mom<strong>en</strong>t je ne me suis s<strong>en</strong>tie déroutée dans mes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s avec lespar<strong>en</strong>ts.41
Concernant les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sJ’avais fait le choix de réaliser les trois <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s de manière consécutive lorsque jeme r<strong>en</strong>dais à <strong>domicile</strong>. D’une part je ne souhaitais pas importuner plusieurs fois la famillepour <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s répétés alors qu’ils avai<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t un emploi du temps bi<strong>en</strong> chargé ;d’autre part je n’imaginais pas que les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s aurai<strong>en</strong>t pu être aussi longs. Réaliser <strong>des</strong><strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s p<strong>en</strong>dant plusieurs heures de suite, même avec une technique qui évoluait selon lapersonne interrogée, était souv<strong>en</strong>t difficile émotionnellem<strong>en</strong>t et intellectuellem<strong>en</strong>t pour moi. Ilest certain qu’au fil <strong>des</strong> heures je n’étais plus aussi conc<strong>en</strong>trée sur les subtilités du discours del’interviewé et que j’ai pu laisser passer <strong>des</strong> données importantes sans réaliser les relances aubon mom<strong>en</strong>t. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> par le jeu m’a souv<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> aidé à obt<strong>en</strong>ir la confiance <strong>des</strong> <strong>en</strong>fantsqui restai<strong>en</strong>t méfiants dans les premières minutes de la discussion. Pourtant ces jeuxsuccessifs ont pu contribuer à faire baisser ma vigilance p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et limiter l<strong>en</strong>ombre de relances adaptées.42
III. Résultats brutsIII.1.Caractéristiques <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts interviewésIII.1.1.Les <strong>en</strong>fantsPour une plus grande diversité je souhaitais une répartition uniforme <strong>des</strong> sexes <strong>en</strong>incluant autant de garçons que de filles mala<strong>des</strong>. J’étais cep<strong>en</strong>dant limitée par le recrutem<strong>en</strong>tde l’équipe de coordination de l’IHOP qui <strong>en</strong> aucun cas ne choisit les <strong>en</strong>fants <strong>en</strong> fonction dusexe mais de leur besoin de <strong>soins</strong> au cours de leur maladie. Cep<strong>en</strong>dant la période deréalisation <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s et l’efficacité de l’équipe de l’IHOP dans ses recherches m’a permisd’inclure quatre filles et trois garçons. Tous les âges étai<strong>en</strong>t représ<strong>en</strong>tés de quatre ans à douzeans, avec une moy<strong>en</strong>ne à huit ans et demi. La saturation <strong>des</strong> données a été difficile à affirmerpour les <strong>en</strong>fants dont les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s sont tous différ<strong>en</strong>ts les uns <strong>des</strong> autres. J’ai décidé d’arrêterau septième <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> devant l’ampleur <strong>des</strong> données déjà recueillies. De plus comme latranche d’âge choisie était conséqu<strong>en</strong>te il fallait s’assurer d’avoir une bonne représ<strong>en</strong>tation detous les âges (échantillonnage raisonné).Six <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s sur sept se sont déroulés au <strong>domicile</strong> <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Mon premier <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>avec Liliane a été réalisé dans la salle à manger, le cœur de la maison, donc peu propice àl’intimité et aux confid<strong>en</strong>ces. J’ai modifié par la suite ma technique et réalisé, autant quepossible, l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> seule avec l’<strong>en</strong>fant dans sa chambre. Quatre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont ainsi pu êtreréalisés dans ces conditions, un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> s’est déroulé seul avec l’<strong>en</strong>fant (Anthony quatre ans)dans la véranda de la maison <strong>des</strong> grands par<strong>en</strong>ts. Un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a égalem<strong>en</strong>t été réalisé àl’IHOP, dans <strong>des</strong> conditions sous optimales. Mais c’était le choix de la maman et de l’<strong>en</strong>fant.Un <strong>des</strong> principes de réalisation <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s était de respecter les choix et les deman<strong>des</strong> <strong>des</strong>familles. La durée <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s a varié de tr<strong>en</strong>te et une minutes à une heure dix minutes. J<strong>en</strong>’ai pas fait de distinction <strong>en</strong>tre un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> classique et les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s p<strong>en</strong>dant lesquels j’aijoué avec les <strong>en</strong>fants.Le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a été réalisé sous forme de questions ouvertes laissant lapossibilité à l’<strong>en</strong>fant d’exprimer librem<strong>en</strong>t ses p<strong>en</strong>sées. Cep<strong>en</strong>dant il s’est avéré que jusqu’àl’âge de 9 ans la technique <strong>des</strong> questions ouvertes n’était pas concluante avec les <strong>en</strong>fants. Jeme heurtais à <strong>des</strong> sil<strong>en</strong>ces répétés ou un mécanisme de déf<strong>en</strong>se de l’<strong>en</strong>fant qui éludait ma43
question : « Je ne sais pas… » « J’sais plus ce que c’est moi ça… » « Z’me rappelleplus. » « Je l’ai pas ret<strong>en</strong>u. ». J’ai donc adapté la manière de poser mes questions <strong>en</strong> étantsouv<strong>en</strong>t plus directive dans un premier temps pour redemander <strong>des</strong> explications « Pourquoi ?Explique-moi… » dans un second temps. L’autre solution a été d’utiliser les playmobiles quej’apportais lors de mes visites afin que l’<strong>en</strong>fant s’id<strong>en</strong>tifie à un personnage et puisse <strong>en</strong> parlerà la troisième personne. « Et elle a mal <strong>des</strong> fois à la maison et à l’hôpital la petite fille ? »III.1.2.Les par<strong>en</strong>tsNeufs mamans et neufs papas ont été interviewés séparém<strong>en</strong>t. Treize <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont étéintégralem<strong>en</strong>t retranscrits. Onze ont été analysés et <strong>en</strong>codés. J’ai délibérém<strong>en</strong>t choisi de nesélectionner qu’un seul <strong>des</strong> deux par<strong>en</strong>ts. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s étant souv<strong>en</strong>t longs voire très longs lamasse <strong>des</strong> données à traiter était telle que l’analyse d’un seul <strong>des</strong> deux <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s suffisait àr<strong>en</strong>dre mon étude pertin<strong>en</strong>te.Au total les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s de sept mamans et de quatre papas ont été <strong>en</strong>codés. Ce choix sejustifie par le fait que dans la majorité <strong>des</strong> cas la maman était le par<strong>en</strong>t le plus investi dans laprise <strong>en</strong> charge au quotidi<strong>en</strong> de leur <strong>en</strong>fant. La durée totale d’un <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> variait <strong>en</strong>tre tr<strong>en</strong>teminutes et une heure et quarante cinq minutes selon le par<strong>en</strong>t ou le couple interrogés. Pourintégrer les <strong>soins</strong> palliatifs à l’étude j’ai recruté 2 couples dont les petites filles Mathilde etKarine étai<strong>en</strong>t décédées pour l’une un mois et l’autre neufs mois avant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Unseul couple était séparé. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s se sont faits séparém<strong>en</strong>t au <strong>domicile</strong> de chacun à unequinzaine de jours d’intervalle.Les par<strong>en</strong>ts ont pu s’exprimer librem<strong>en</strong>t que ce soit sur le plan de l’expression verbaleou émotionnelle. Aucun d’<strong>en</strong>tre eux n’a souhaité interrompre l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> malgré les pleurs quipouvai<strong>en</strong>t ponctuer leurs propos et la proposition qui leur était faite systématiquem<strong>en</strong>t <strong>des</strong>topper l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.III.2.Analyse « observationnelle » <strong>des</strong>criptiveCe type d’analyse permet de compr<strong>en</strong>dre le cadre et le contexte <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s. Lasituation géographique, le cadre socio professionnel <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts ainsi que la situation familialesont ainsi évoqués pour permettre une « immersion » au sein <strong>des</strong> familles interrogées.44
Famille de Liliane 12 ansLiliane est une grande <strong>en</strong>fant de douze ans traitée pour un germinome. Elle a été prise<strong>en</strong> charge <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> pour <strong>des</strong> pansem<strong>en</strong>ts de PICC (peripherally inserted c<strong>en</strong>tralcatheter ou cathéter Veineux c<strong>en</strong>tral inséré <strong>en</strong> périphérie).Liliane est la « petite dernière » d’une fratrie de quatre <strong>en</strong>fants. Ses frères et sœursétant bi<strong>en</strong> plus âgés, elle vit seule avec ses par<strong>en</strong>ts actuellem<strong>en</strong>t. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts est estiméautour de cinquante ans.La famille habite <strong>en</strong> milieu rural dans une grande maison familiale dans l’Ain distanted’<strong>en</strong>viron quarante minutes <strong>en</strong> voiture de l’IHOP. Madame est aide soignante <strong>en</strong> clinique etmonsieur est ouvrier spécialisé. Depuis que Liliane est malade, madame ne travaille plus, elleest <strong>en</strong> arrêt de travail. Monsieur arrive <strong>en</strong>core à jongler <strong>en</strong>tre ses horaires de travail et lescontraintes hospitalières ou extra hospitalières <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts de sa fille car il a un rythmedécalé <strong>en</strong> trois fois huit heures.Les circonstances sont pénibles pour la famille car <strong>en</strong> plus du traitem<strong>en</strong>t de la tumeurcérébrale de Liliane dont les résultats ne sont pas aussi bons qu’espérés au mom<strong>en</strong>t où jer<strong>en</strong>contre cette famille, il existe une autre source d’angoisse liée à l’état de santé du grandpère paternel de Liliane. Effectivem<strong>en</strong>t ce dernier est hospitalisé <strong>en</strong> <strong>soins</strong> palliatifs dans unautre hôpital du départem<strong>en</strong>t ce qui mobilise d’autant plus l’énergie de la famille. Ils sontégalem<strong>en</strong>t sur le départ car le l<strong>en</strong>demain ils s’<strong>en</strong> vont tous les trois à Paris où Liliane doitcomm<strong>en</strong>cer un traitem<strong>en</strong>t de six semaines de protonthérapie (radiothérapie à base de protons).La r<strong>en</strong>contre se déroule le lundi 30 janvier 2012 à leur <strong>domicile</strong>. Je suis accueilliechaleureusem<strong>en</strong>t par la maman de Liliane seule à mon arrivée. Liliane et son papa r<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t ducollège quelques minutes plus tard. Je r<strong>en</strong>contre Liliane qui me fait l’impression d’une jeuneadolesc<strong>en</strong>te sur la réserve et peu <strong>en</strong>thousiaste. Sans plus de cérémonie elle <strong>en</strong>lève son bandanaet je découvre son crâne lisse et son impressionnante cicatrice. Je suis un peu inquiète car lafamille de Liliane est la deuxième famille interrogée mais l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec Liliane sera lepremier avec une <strong>en</strong>fant atteinte de cancer. Je n’ai presque pas de recul si ce n’est l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>test pour le bon déroulem<strong>en</strong>t de mon <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec Liliane.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s vont se dérouler dans la salle à manger. C’est une grande pièce ouverte,lieu de passage incontournable et donc dans lequel l’intimité est réduite. Ils auront une duréetotale de trois heures et vingt minutes dont quarante quatre minutes avec Liliane.45
D’un commun accord le papa de Liliane décide de comm<strong>en</strong>cer puis Liliane suivra carle temps presse. Ils doiv<strong>en</strong>t aller voir le grand père de Liliane à l’hôpital. La maman clôturerala série <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s.Je me s<strong>en</strong>s déjà beaucoup plus à l’aise avec les par<strong>en</strong>ts qui sont tout à fait disposés àlivrer leur ress<strong>en</strong>ti, leurs angoisses et la douleur que provoque la maladie de Liliane. Le lieun’est pas propices aux confid<strong>en</strong>ces car très ouvert mais chaque <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se déroule pour laplus grande partie <strong>en</strong> colloque singulier, chacun respectant l’intimité de celui qui s’exprime.Famille de Karine 6 ansKarine est une petite fille de six ans qui est décédée <strong>en</strong> Juin 2011 d’un gliome du tronccérébral. Elle a été prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> dans le cadre d’une hospitalisation à <strong>domicile</strong>pour <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs.Karine est la cadette d’une fratrie de deux <strong>en</strong>fants. Elle a un grand frère de douze ans.L’âge du couple est évalué <strong>en</strong>tre tr<strong>en</strong>te et quarante ans. Le couple n’a pas d’autre projetd’<strong>en</strong>fant actuellem<strong>en</strong>t.La famille habite un pavillon résid<strong>en</strong>tiel dans la campagne Bressane. La distance deleur lieu d’habitation à l’IHOP était d’<strong>en</strong>viron une heure de voiture. L’hôpital périphérique deproximité était situé à Bourg <strong>en</strong> Bresse. Madame est secrétaire et monsieur pompierprofessionnel. Les deux par<strong>en</strong>ts ont repris le travail depuis le décès de leur fille, monsieurdepuis six mois <strong>en</strong>viron et madame depuis quatre mois.Les par<strong>en</strong>ts de Karine sont le premier couple après l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> test que j’ai r<strong>en</strong>contré.L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> s’est déroulé le v<strong>en</strong>dredi 27 Janvier 2012 dans l’après midi.J’ai été reçue <strong>en</strong> premier lieu par la maman de Karine qui s’était libérée plus tôt de sontravail <strong>en</strong> prévision de ma visite. Monsieur était toujours à son travail à mon arrivée.J’étais particulièrem<strong>en</strong>t anxieuse à l’idée de ce premier <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. La problématique del’oncopédiatrie avec laquelle je n’étais pas familière et la situation de deuil dans laquelle setrouvait la famille contribuai<strong>en</strong>t à alim<strong>en</strong>ter cette anxiété. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et son déroulé étai<strong>en</strong>tconnus et testés mais les réactions émotionnelles <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts et le transfert qui pouvaits’effectuer restai<strong>en</strong>t la part d’inconnu de cet <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.Madame m’a conduite dans la salle à manger familiale et l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a comm<strong>en</strong>cé trèsrapidem<strong>en</strong>t. L’émotion a été très rapidem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>te puisque madame s’est mise à pleurer46
dès la première question, les rires et les pleurs ont <strong>en</strong>suite ponctué tout l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. J’aidécouvert une maman à fleur de peau et <strong>en</strong> souffrance à la moindre évocation du vécu de lamaladie de sa fille. Le contact a été aisé et probablem<strong>en</strong>t facilité par la proximité d’âgepuisque madame a rapidem<strong>en</strong>t utilisé le tutoiem<strong>en</strong>t lors de ses explications.Puis monsieur est arrivé interrompant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Cette interruption a été brève etn’a pas perturbé le déroulé de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.Les deux <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s se sont <strong>en</strong>chainés très rapidem<strong>en</strong>t sans pause. Monsieur m’a semblé plusdans la maitrise de ses émotions, détaillant de manière plus factuelle les problématiquesmédicales ne se laissant <strong>en</strong>vahir par sa tristesse qu’à l’évocation <strong>des</strong> activités de la viequotidi<strong>en</strong>ne.À aucun mom<strong>en</strong>t les par<strong>en</strong>ts de Karine n’ont souhaité stopper l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> même dansles mom<strong>en</strong>ts les plus difficiles pour eux. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont duré respectivem<strong>en</strong>t quarante etquarante cinq minutes.J’ai été touchée par l’histoire de cette famille, l’expression de leur souffrance et de lacompréh<strong>en</strong>sion de la maladie de leur fille. Cep<strong>en</strong>dant à aucun mom<strong>en</strong>t je ne me suis s<strong>en</strong>tiedébordée par mes émotions. Cette distance m’a permis de conduire les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s de manièrela plus empathique possible mais <strong>en</strong> essayant de garder le recul indisp<strong>en</strong>sable pour l’analyse<strong>en</strong> temps réel du discours et réaliser les relances quand cela était nécessaire.Famille de Mathilde 6 ansMathilde est une petite fille de six ans qui est décédée le 6 janvier 2012 d’un gliomeinfiltrant du Tronc cérébral. Mathilde a été prise <strong>en</strong> charge dans le cadre de l’hospitalisation à<strong>domicile</strong> pour <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs.Mathilde était fille unique. La famille habite une maison pavillonnaire dans un village du sudde la Drôme à 1 heure 30 minutes <strong>en</strong> voiture <strong>en</strong>viron de l’IHOP. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts est estimé<strong>en</strong>tre 30 et 35 ans.Madame est employée de banque et monsieur ouvrier spécialisé dans une usine agroalim<strong>en</strong>taire de la région. Ils sont toujours tous les deux <strong>en</strong> arrêt de travail lorsque je lesr<strong>en</strong>contre.L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se déroule le lundi 6 février 2012, un mois jour pour jour après le décès deMathilde. Les par<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong>core au cimetière lorsque j’arrive. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s vont se47
dérouler dans le salon <strong>en</strong> colloque singulier. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> débute rapidem<strong>en</strong>t avec la maman deMathilde. La discussion est aisée. J’appréh<strong>en</strong>dais cet <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> du fait du décès réc<strong>en</strong>t deMathilde. Madame est <strong>en</strong> fait <strong>en</strong>core dans l’ « agir » et le coté émotionnel du récit est mis decoté. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se conc<strong>en</strong>trera sur la <strong>des</strong>cription de la maladie ainsi que la prise <strong>en</strong> chargemédicale et soignante à <strong>domicile</strong>. Le discours de monsieur est plus dans les émotions. Ilbalaye plus largem<strong>en</strong>t le quotidi<strong>en</strong> de la famille p<strong>en</strong>dant la maladie. Tous deux évoqu<strong>en</strong>t trèspeu le dernier mois d’évolution de la maladie probablem<strong>en</strong>t trop proches et trop douloureux.La durée totale <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s est de trois heures et cinq minutes. (Une heure dix septminutes pour madame et une heure et quarante six minutes pour monsieur). J’ai été trèstouchée par l’histoire de cette famille, leur courage à tous les trois et leur combat m<strong>en</strong>é contrele temps.Famille de Lilou 9 ansLilou est une petite fille de neuf ans qui a été traitée par greffe de moelle osseuse pourune aplasie médullaire. Lilou a été prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> puis <strong>en</strong> hospitalisationà <strong>domicile</strong> pour de l’hydratation nocturne.Lilou est la cadette d’une fratrie de deux <strong>en</strong>fants. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts est estimé autourde quarante cinq ans. La famille habite <strong>en</strong> milieu rural dans les monts du Lyonnais au Nordouest de Lyon. La distance par rapport à l’IHOP est estimée à une heure de voiture <strong>en</strong>viron.Lilou est un cas déviant car l’aplasie médullaire n’est pas une maladie cancéreuse.Mais le traitem<strong>en</strong>t a été lourd et long, assez similaire à celui d’une pathologie maligne. Lilouva bi<strong>en</strong> actuellem<strong>en</strong>t car elle a été greffée et que la greffe est un succès. Les circonstancessont un peu différ<strong>en</strong>tes car la maladie de Lilou est « derrière eux » qu’elle n’est <strong>en</strong> contactrégulier avec l’IHOP que pour son suivi. La famille a néanmoins d’emblée accepté de mer<strong>en</strong>contrer. Je fais connaissance de Lilou à mon arrivée le mercredi 14 mars 2012 après midi.Lilou est une petite fille de neuf ans assez peu expressive sur sa maladie d’après ses par<strong>en</strong>ts etqui vi<strong>en</strong>t se prés<strong>en</strong>ter avec une certaine rétic<strong>en</strong>ce « Elle est déjà v<strong>en</strong>ue vous dire bonjour c’estbon signe » me dira sa maman. Il fait beau, elle préfère continuer à jouer et être interrogée <strong>en</strong>dernier. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s avec les par<strong>en</strong>ts s’<strong>en</strong>chain<strong>en</strong>t d’abord à l’extérieur puis dans la cuisine.L’un comme l’autre sont <strong>des</strong> lieux de passage. Mais l’intimité <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s sera plutôt bi<strong>en</strong>respectée. Le papa de Lilou qui est <strong>en</strong>core très affecté par la maladie de sa fille va avoir48
eaucoup de mal à se livrer et l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se cantonnera à <strong>des</strong> <strong>des</strong>criptions situationnelles trèsfactuelles.Je discute avec Lilou seule dans sa chambre à l’étage la porte fermée. Un mom<strong>en</strong>t« d’apprivoisem<strong>en</strong>t » est nécessaire p<strong>en</strong>dant lequel elle va me laisser <strong>en</strong>trer dans son univers<strong>en</strong> me « racontant » sa chambre (les posters au mur, les <strong>des</strong>sins, les photos…). L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> sedéroulera avec l’accord de Lilou p<strong>en</strong>dant <strong>des</strong> phases de jeux de sociétés. Lilou a réalisé son<strong>des</strong>sin avant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, la discussion s’amorcera autour de l’interprétation du <strong>des</strong>sin. Ellem’<strong>en</strong> refera un plus tard p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> bi<strong>en</strong> plus parlant sur l’évolution de la visionqu’elle a d’elle-même p<strong>en</strong>dant sa maladie. Lilou est d’abord plutôt fermée pour toute questionsur sa maladie ou les <strong>soins</strong> reçus « Non. » « Je sais plus ». Elle va finalem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> s’exprimerdès que les jeux comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t, qu’elle s’amuse et qu’elle est <strong>en</strong> confiance réussissant même àme décrire sa maladie « C’était ma moelle osseuse !! Ils m’ont changé ma moelle osseusecontre une autre parce qu’elle marchait plus. ».Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s ont une durée totale de trois heures et cinquante minutes <strong>en</strong>viron dontune heure et huit minutes avec Lilou, une heure tr<strong>en</strong>te avec sa maman et une heure dix avecson papa.Famille de Juli<strong>en</strong> 12 ansJuli<strong>en</strong> est un grand <strong>en</strong>fant de douze ans traité depuis un an pour un sarcome d’Ewing<strong>des</strong> parties molles. Il ne lui reste, lorsque je le r<strong>en</strong>contre, plus que deux cures dechimiothérapie. Juli<strong>en</strong> a été pris <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> puis <strong>en</strong> hospitalisation à<strong>domicile</strong> pour une alim<strong>en</strong>tation <strong>en</strong>térale par gastrostomie.Juli<strong>en</strong> est le cadet d’une fratrie de trois garçons.Son père est <strong>en</strong>seignant d’université et sa mère assistante sociale. Ils se sont séparéspeu avant la découverte du cancer de Juli<strong>en</strong>. Juli<strong>en</strong> et ses frères viv<strong>en</strong>t chez leur maman dansla proche banlieue lyonnaise. La distance avec l’IHOP est de ce fait raisonnable et estimée à<strong>en</strong>viron vingt minutes <strong>en</strong> voiture.Je r<strong>en</strong>contre cette famille <strong>en</strong> deux temps d’abord Juli<strong>en</strong> et sa maman au <strong>domicile</strong> demadame le lundi 19 mars 2012 et neuf jours plus tard le papa de Juli<strong>en</strong> à son <strong>domicile</strong>.Juli<strong>en</strong> est <strong>en</strong> aplasie le jour où je le r<strong>en</strong>contre donc asthénique et rapidem<strong>en</strong>t fatigable.Il a failli partir <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce le matin même à l’IHOP car il est subfébrile ce jour là. Sa maman49
débordée par la gestion du quotidi<strong>en</strong> de mère célibataire, avait oublié ma v<strong>en</strong>ue et medemande expressém<strong>en</strong>t de comm<strong>en</strong>cer ma série d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s par Juli<strong>en</strong> p<strong>en</strong>dant qu’elleprépare le repas du soir. Il accepte facilem<strong>en</strong>t la discussion. Je le r<strong>en</strong>contre dans le salon alorsqu’il est allongé sur le canapé. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se fera de manière confid<strong>en</strong>tielle la porte fermée.Nous ne serons pas dérangés. Je n’utilise pas de technique particulière pour cet <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>puisque Juli<strong>en</strong> est grand et tout à fait <strong>en</strong>clin à discuter de sa maladie. Il fera son <strong>des</strong>sin <strong>en</strong> find’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> tout seul <strong>en</strong>fermé dans le salon. Il me l’expliquera dans un second temps.Je r<strong>en</strong>contre <strong>en</strong>suite madame dans la chambre de Juli<strong>en</strong>. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> sera égalem<strong>en</strong>tconfid<strong>en</strong>tiel, la porte fermée. C’est l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec un adulte avec lequel j’ai le plus deproximité puisque nous sommes toutes les deux assises sur un petit canapé. C’est égalem<strong>en</strong>tl’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> qui me touchera le plus de tous ceux que j’ai réalisé.La durée totale de ces deux <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s est de deux heures et cinquante six minutes (uneheure onze minutes pour Juli<strong>en</strong>, et une heure et quarante cinq minutes pour madame)L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec monsieur se fera égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> colloque singulier. Monsieur a déjà eu<strong>des</strong> retours de la part de sa femme et de son fils sur mon interv<strong>en</strong>tion.Monsieur vit à <strong>en</strong>viron tr<strong>en</strong>te minutes du c<strong>en</strong>tre de Lyon. Malgré leur séparation il resteprés<strong>en</strong>t et aussi disponible que possible pour aider Madame dans la gestion de la viequotidi<strong>en</strong>ne depuis que Juli<strong>en</strong> est malade. Le dialogue est aisé, l’ambiance propice puisque lepapa de Juli<strong>en</strong> n’a aucun impératif ce matin là. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> se fera de manière très convivialeautour d’une tasse de café.Il aura une durée d’une heure et tr<strong>en</strong>te minutes.Famille d’Anthony 4 ansAnthony est un petit garçon de quatre ans <strong>en</strong> fin de traitem<strong>en</strong>t pour une leucémie aiguëlymphoblastique de type T. Anthony a été pris <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> hospitalisation à <strong>domicile</strong> pourcertaines de ses cures de chimiothérapies.Anthony est l’ainé d’une fratrie de deux <strong>en</strong>fants. Sa petite sœur est née quelquessemaines avant l’annonce de la maladie de son frère. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts est estimé <strong>en</strong>tre tr<strong>en</strong>teet tr<strong>en</strong>te cinq ans.50
Madame est secrétaire et monsieur ouvrier. Depuis qu’Anthony est malade sa mamanest <strong>en</strong> congés de prés<strong>en</strong>ce par<strong>en</strong>tale. Son papa a quant à lui, continué de travailler pour assurerles rev<strong>en</strong>us du foyer.La famille habite <strong>en</strong> milieu rural dans la Drôme. Ils sont à une heure et tr<strong>en</strong>te minutes<strong>en</strong>viron de l’IHOP.L’ambiance est plutôt décontractée et sereine car Anthony est <strong>en</strong> traitem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>pour sa leucémie. Les résultats intermédiaires du traitem<strong>en</strong>t sont bons. La famille habiteactuellem<strong>en</strong>t chez les grands par<strong>en</strong>ts car ils rénov<strong>en</strong>t une partie de la grande maison pour yhabiter prochainem<strong>en</strong>t.Je suis accueillie par toute la famille le 27 mars 2012. Il fait très beau ce jour là doncAnthony préfère continuer à jouer avec son tracteur plutôt que de v<strong>en</strong>ir discuter. Je comm<strong>en</strong>cedonc les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s à l’extérieur de la maison avec ses par<strong>en</strong>ts. Le colloque singulier estdifficile à obt<strong>en</strong>ir car nous n’avons pas de possibilité de réaliser l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> à l’écart de la viefamiliale. Les par<strong>en</strong>ts n’<strong>en</strong> émett<strong>en</strong>t pas le souhait non plus. Les travaux de rénovations de lamaison sont égalem<strong>en</strong>t un frein à ces <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s qui se déroul<strong>en</strong>t dans un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tsonore bruyant. Anthony sera vu <strong>en</strong> dernier seul dans la véranda avec moi mais surveillérégulièrem<strong>en</strong>t par l’œil inquiet de ses par<strong>en</strong>ts. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> est plus difficile et passerauniquem<strong>en</strong>t par le jeu car Anthony a beaucoup de déf<strong>en</strong>ses et ne veut pas raconter ce qui atrait à sa leucémie « Ze sais plus… » « Ze sais pas… » « Moi ze me rappelle plus ! ». Il <strong>en</strong>parlera donc par l’intermédiaire <strong>des</strong> playmobiles p<strong>en</strong>dant le jeu. La réalisation du <strong>des</strong>sinori<strong>en</strong>té ne va pas être possible, Anthony est <strong>en</strong>core jeune et l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> a déjà duré tr<strong>en</strong>te huitminutes. Je n’arrive plus à focaliser suffisamm<strong>en</strong>t son att<strong>en</strong>tion.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s auront une durée totale de deux heures et tr<strong>en</strong>te minutes <strong>en</strong>viron (tr<strong>en</strong>tehuit minutes pour Anthony, tr<strong>en</strong>te six minutes pour son papa et une heure et dix sept minutespour sa maman).51
Famille de Marie 6 ans et demiMarie est une petite fille de six ans et demi traitée pour un astrocytome pilocytique.Marie est actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> hospitalisation à <strong>domicile</strong> pour de la chimiothérapie (Velbé)hebdomadaire. Le diagnostic remonte à neuf mois <strong>en</strong>viron quand je les r<strong>en</strong>contre. Lediagnostic de la maladie de Marie a été long et laborieux et elle a actuellem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> séquellesvisuelles majeures. Marie est aveugle.Marie est la cadette d’une fratrie de trois <strong>en</strong>fants. C’est la seule fille. Elle a d’ailleurs uncaractère bi<strong>en</strong> affirmé.La famille habite <strong>en</strong> milieu urbain dans l’Isère à <strong>en</strong>viron tr<strong>en</strong>te minutes de voiture del’IHOP. Sa maman est infirmière puéricultrice et travaille <strong>en</strong> pédiatrie à l’hôpital deproximité. A sa demande c’est elle qui s’occupe <strong>des</strong> prélèvem<strong>en</strong>ts sanguins de Marie depuisplusieurs mois. Monsieur est <strong>en</strong>seignant et travaille <strong>en</strong> collège.Je suis accueillie chaleureusem<strong>en</strong>t par Marie et ses par<strong>en</strong>ts le 20 Avril 2012. Les<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s vont se dérouler de manière confid<strong>en</strong>tielle à l’étage dans la chambre du frère deMarie pour les deux par<strong>en</strong>ts. Ils seront interrompus une fois par le frère de Marie qui estinquiet de voir <strong>des</strong> adultes dans sa chambre. Marie va rester derrière la porte de la chambrep<strong>en</strong>dant tout le temps que dureront les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s. Je vois <strong>en</strong>suite Marie seule dans sa chambre.Elle est habituée à son univers et y est très habile. Sa cécité la r<strong>en</strong>d très tactile et câline et j<strong>en</strong>’aurai pas besoin de « l’apprivoiser » pour gagner sa confiance. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> va se construireautour de jeux que Marie va choisir. D’un naturel assez pétulant il sera nécessaire de recadrerplusieurs fois l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> car Marie parle surtout de Tout ce qui n’est pas sa maladie... Malgréson handicap Marie va réaliser les <strong>des</strong>sins que je lui demande et même d’autres p<strong>en</strong>dant notre<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Elle s’exprime assez facilem<strong>en</strong>t sur ses traitem<strong>en</strong>ts avec une grande maitrise <strong>des</strong>termes techniques. L’évocation de sa maladie qu’elle a nommée « Cruella » et <strong>des</strong> séquellesest plus difficile pour elle.La durée totale <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s est de trois heures et vingt minutes <strong>en</strong>viron dont uneheure avec Marie, une heure vingt pour sa maman et une heure pour son papa.52
Famille d’Anna 5 ans et demiAnna est une petite fille de cinq ans et demi traitée pour une leucémie aiguëlymphoblastique. Le diagnostic est réc<strong>en</strong>t et les traitem<strong>en</strong>ts ont comm<strong>en</strong>cé depuis 2 moislorsque je r<strong>en</strong>contre la famille. Anna est prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> hospitalisation à <strong>domicile</strong> pour <strong>des</strong>chimiothérapies (Aracytine) et récemm<strong>en</strong>t une antibiothérapie.Anna est l’ainée d’une fratrie de deux <strong>en</strong>fants, elle a une petite sœur. Sa maman étantd’origine américaine, Anna est parfaitem<strong>en</strong>t bilingue.La famille vit <strong>en</strong> plein c<strong>en</strong>tre d’une ville de la proche banlieue lyonnaise. L’accès àl’IHOP par le périphérique est aisé et à <strong>en</strong>viron dix et quinze minutes de voiture.Les par<strong>en</strong>ts d’Anna sont tous deux <strong>en</strong>seignants d’université. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts estestimé <strong>en</strong>tre tr<strong>en</strong>te cinq et quarante ans.Je r<strong>en</strong>contre cette famille <strong>en</strong> deux temps puisque le premier <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> prévu avec lepapa, la maman et Anna va être annulé dans l’urg<strong>en</strong>ce du fait de l’hospitalisation d’Anna àl’IHOP pour aplasie fébrile. Je ne r<strong>en</strong>contre dans un premier temps que le papa d’Anna le 05Avril 2012 puis reprogramme un second <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> le 03 Mai 2012 pour Anna et sa maman.Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts se pass<strong>en</strong>t dans le salon et sont bi<strong>en</strong> différ<strong>en</strong>ts. Monsieur mereçoit seul un matin alors que sa femme et sa fille sont à l’IHOP. Il a le temps etl’appartem<strong>en</strong>t vide est propice aux confid<strong>en</strong>ces. Madame, quant à elle, me reçoit dans la salleà manger <strong>en</strong>tourée de son mari et de ses filles qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t très régulièrem<strong>en</strong>t au fil del’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. C’est probablem<strong>en</strong>t un mécanisme de déf<strong>en</strong>se afin d’éviter de trop approfondir lesréponses à mes questions.Je vois Anna seule dans sa chambre après l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec sa maman. Elle m’a vu dansle salon avec sa maman m’a déjà prés<strong>en</strong>té ses poupées et accepte de rester seule avec moi etque l’on pousse la porte sans la fermer complètem<strong>en</strong>t. Nous ne sommes pas dérangées.L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> est construit autour du jeu par playmobiles et <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins. Ces derniers serontréalisés <strong>en</strong>tre deux phases de jeu. Anna plutôt timide va beaucoup investir les playmobilesreprés<strong>en</strong>tant l’<strong>en</strong>fant malade <strong>en</strong> <strong>soins</strong>. « Oui je l’aime beaucoup. Parce qu’il y a <strong>des</strong> trucscomme ça… y’a la chimio…tout… J’aime ça beaucoup ». Elle sera très expressive dans ses<strong>des</strong>sins qu’elle me décrira <strong>en</strong> détails.La durée totale <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s est de trois heures et vingt cinq minutes dont une heureet deux minutes avec Anna.53
Famille de Timéo 12 ansTiméo est un grand <strong>en</strong>fant de douze ans traité pour un sarcome d’Ewing de la cuisse.C’est le seul <strong>en</strong>fant que je r<strong>en</strong>contre selon le souhait de sa maman et avec son accord, àl’IHOP p<strong>en</strong>dant une cure de chimiothérapie le 10 mai 2012. Timéo n’a pas été suivi parl’équipe de l’HAD. Il a bénéficié d’injection de facteurs de croissance à <strong>domicile</strong>. Dupersonnel paramédical ambulatoire est interv<strong>en</strong>u à son <strong>domicile</strong>.Timéo est le cadet d’une fratrie de quatre <strong>en</strong>fants. L’âge <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts est estimé autour dequarante ans.La famille habite dans Lyon. Le temps de trajet jusqu’à l’IHOP est donc très courtestimé à dix à quinze minutes <strong>en</strong>viron, plus selon le trafic.Je r<strong>en</strong>contre ses par<strong>en</strong>ts 48 heures après à leur <strong>domicile</strong>, alors que Timéo et ses frèreset sœurs sont <strong>en</strong> week-<strong>en</strong>d chez leurs grands par<strong>en</strong>ts. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s vont se dérouler dans lasalle à manger familiale. La maison étant vide le colloque singulier sera assez bi<strong>en</strong> respecté.La maman de Timéo va cep<strong>en</strong>dant s’affairer un mom<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cuisine (qui est ouverte sur la salleà manger) p<strong>en</strong>dant que je discute avec son mari. Je r<strong>en</strong>contre pour la première fois depuis ledébut de mes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s beaucoup de ret<strong>en</strong>ue dans leur discours. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s sont trèsfactuels et j’éprouve de la difficulté à leur faire évoquer leur vécu. Madame est professeur depiano, monsieur travaille « dans le médical ». Pas une fois il ne me dira son métier. Comme ilne m’est pas indisp<strong>en</strong>sable pour la compréh<strong>en</strong>sion globale <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s je respecte son choixde ne pas me le révéler.Il <strong>en</strong> est de même avec Timéo, le dialogue sera difficile pour moi à <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ir. Timéoformule très souv<strong>en</strong>t <strong>des</strong> réponses fermées négatives qui vont me pousser au fil de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>à le surnommer « Monsieur Non ». Le contexte de l’IHOP n’est pas du tout propice à tellediscussion puisque Timéo est dans une chambre à deux lits et que l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> va être réalisé <strong>en</strong>prés<strong>en</strong>ce de son compagnon de chambre et de la maman de ce dernier. De plus l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> seracoupé plusieurs fois par du personnel médical et paramédical qui <strong>en</strong>tre dans la chambre pourvoir le voisin de Timéo. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec Timéo va être court et très souv<strong>en</strong>t <strong>des</strong>criptif. Le<strong>des</strong>sin est réalisé à la fin de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, alors que je suis assise sur un fauteuil au bout de sonlit. Timéo est l’<strong>en</strong>fant qui va mettre le plus de cœur et d’application à ses <strong>des</strong>sins.La durée de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> de Timéo est de tr<strong>en</strong>te et une minutes. Celle avec ses par<strong>en</strong>ts detr<strong>en</strong>te et tr<strong>en</strong>te six minutes.54
Famille d’Hélène 14 ansHélène est une jeune fille de quatorze ans. Elle est traitée pour une épiphysiolyse aiguëde hanche. Hélène est mon deuxième cas déviant puisque sa pathologie n’est pas cancéreuse.Elle n’a jamais été prise <strong>en</strong> charge à l’IHOP mais plusieurs fois à l’HFME dans lequel elle aun suivi régulier pour sa hanche. Du personnel para médical est interv<strong>en</strong>u à <strong>domicile</strong> pour untraitem<strong>en</strong>t de prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> thromboses veineuses profon<strong>des</strong>.Les par<strong>en</strong>ts d’Hélène sont séparés. Hélène et sa maman ont été interviewées. Ces deux<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s correspond<strong>en</strong>t aux <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s tests du guide. Ils m’ont permis de valider mon guided’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Ils ont été réalisés <strong>en</strong> décembre 2011. L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> d’Hélène a été intégralem<strong>en</strong>tretranscrit. Je ne détaillerai pas les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s puisqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’analysethématique. L’âge d’Hélène et sa pathologie nous éloignai<strong>en</strong>t trop <strong>des</strong> critères de l’étude.55
IV. Résultats et DiscussionIV.1.Description de l’<strong>en</strong>fantAvant de développer les thèmes, je vais laisser les par<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>ter leur <strong>en</strong>fant. Lavision de leur <strong>en</strong>fant avant la maladie correspond le plus souv<strong>en</strong>t à la <strong>des</strong>cription d’un <strong>en</strong>fantidéalisé, « sans problème ». Une vision que l’on peut mettre <strong>en</strong> parallèle avec la citation duProfesseur Rufo « Un <strong>en</strong>fant on l’aime, mais il n’est jamais aussi merveilleux que celui qu’onimaginait » (20) .Maman de Juli<strong>en</strong> :« Le p’tit garçon qui a toujours su faire la différ<strong>en</strong>ce, avec son caractère de cochonparce que vraim<strong>en</strong>t il a un caractère bi<strong>en</strong> trempé. »« Il est pertin<strong>en</strong>t, intellig<strong>en</strong>t, il se questionne, il est curieux, c’est un sportif… c’est ungarçon très attachant »Maman de Timéo :« Sans problème, assez facile, assez insouciant »« Normal, pas difficile »Maman de Mathilde : « Une petite fille très intellig<strong>en</strong>te, très ouverte, pleine de vie…Elle a du caractère »Maman de Marie : « C’est une <strong>en</strong>fant pleine de vie, avec un fort caractère,déterminée dans ses choix qui a toujours eu soif d’autonomie »Maman de Liliane : « Une petite fille pleine de vie, beaucoup de sport, qui aimerire, qui a un sacré caractère…bi<strong>en</strong> trempé (…) qui travaille super bi<strong>en</strong> à l’école,une intellig<strong>en</strong>ce extra ordinaire qui pose pas d’problème qui compr<strong>en</strong>d vite »Papa de Liliane : « C’était une gamine charmante » « C’est une <strong>en</strong>fant joyeuse,travailleuse, serviable… »Maman de Karine : « Joyeuse comme toutes les petites filles y’avait pasd’souci. C’était une bonne élève. Elle était féminine, très intellig<strong>en</strong>te, trèsmure. »Papa de Kathy : « Elle était vivante bi<strong>en</strong> sûr et elle bougeait beaucoup, actif, pleinede vie. » « Elle se partageait aux autres, elle était vachem<strong>en</strong>t mature déjà. »56
Papa d’Anthony : « Il était joyeux, plein de vie, cont<strong>en</strong>t, y’avait pasd’problème »Seule la maman de Lilou décrit sa fille comme une <strong>en</strong>fant déjà éprouvée par la vieavec un li<strong>en</strong> causal presque évid<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre le début de sa vie déjà difficile et son aplasiemédullaire. Pas une seule fois elle n’aura un regard positif sur Lilou sa fille d’avant lamaladie.Maman de Lilou :« La vie l’a pas épargnée… Dès la grossesse ils ont détecté un kyste du plexuschoroïdi<strong>en</strong>. » « Un bébé qui ne disait ri<strong>en</strong>, hypotonique. » « Une petite file isolée <strong>en</strong>échec scolaire total, elle a été dans la souffrance avec beaucoup de stress. Entre 3 et 6ans ça a été terrible pour l’école » « Elle est sur une dyslexie mixte sévère.» « La vieétait déjà très difficile. »IV.2.Vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong>IV.2.1.Définition <strong>des</strong> <strong>soins</strong>L’évocation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> par les <strong>en</strong>fants est apparue d’emblée avec les questions sur lamaladie et les traitem<strong>en</strong>ts. Au rappel de la définition <strong>des</strong> <strong>soins</strong> utilisée pour l’étude, les<strong>en</strong>fants ont rapidem<strong>en</strong>t réagi. Ils n’ont pas fait de distinction <strong>en</strong>tre les <strong>soins</strong> réalisés à l’hôpitalet ceux réalisés à la maison. Pour les par<strong>en</strong>ts, seuls les par<strong>en</strong>ts de Timéo m’ont posé laquestion. Timéo est le seul <strong>en</strong>fant à ne pas avoir eu de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> gérés par l’équipe decoordination de l’IHOP.Maman de Timéo : « Les prises de sang régulières, je ne sais pas si ça r<strong>en</strong>tre dans ledomaine <strong>des</strong> <strong>soins</strong> ?Papa de Timéo : « Les prises de sang je sais pas si c’est <strong>des</strong> <strong>soins</strong> mais bon c’est uneinterv<strong>en</strong>tion… d’un étranger. »57
La définition <strong>des</strong> <strong>soins</strong> évoqués dans le guide, correspondait à tout acte médical oupara médical réalisé à la maison, coordonné ou non par l’IHOP et <strong>en</strong> rapport avec la maladie.D’après le dictionnaire Larousse (2012), les <strong>soins</strong> sont <strong>des</strong> actes de thérapeutiques qui vis<strong>en</strong>t àla santé de quelqu’un. Les <strong>soins</strong> infirmiers correspond<strong>en</strong>t à l’<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> activités assuréespar le personnel infirmier et les auxiliaires de santé.Pour les grands <strong>en</strong>fants, la définition <strong>des</strong> <strong>soins</strong> était plus limitée et correspondait davantage àun acte pour guérir.Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Un truc par exemple pour monter mes globules ou arrêter de me faire mal »« Les prises de sang <strong>en</strong> fait j’ai jamais considéré ça comme <strong>des</strong> <strong>soins</strong> »Liliane 12 ans : « C’est quand on pose <strong>des</strong> chimios à la maison »Les <strong>soins</strong> n’étai<strong>en</strong>t parfois même pas associés à la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong>.Liliane 12 ans :« J’ai pas eu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à la maison »« C’était obligé pour l’PICC… juste pour me refaire le pansem<strong>en</strong>t »Les <strong>en</strong>fants ont été très expressifs sur leur ress<strong>en</strong>ti <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Les <strong>soins</strong> ont souv<strong>en</strong>t étévécus comme difficile ou douloureux.Anthony 4 ans :« Ça m’embêtait beaucoup ça… C’était pas rigolo »« Ouille, ouille, ouille !! »Lilou 9 ans : « Ils étai<strong>en</strong>t mauvais les médicam<strong>en</strong>ts »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Au début c’était pas rigolo et puis j’avais peur » (A propos <strong>des</strong> prises de sang)« La chimiothérapie… c’est affreux quoi… c’est monotone, c’est énervant à unpoint ! »« Et puis j’<strong>en</strong> ai marre et ça fait mal. »58
IV.2.2.Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>Le choix du <strong>domicile</strong> Une obligationPour une <strong>en</strong>fant et une maman la réalisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> ne relevait pas d’unchoix mais plutôt d’une obligation.Liliane 12 ans : « Il faut bi<strong>en</strong> qu’on me fasse les <strong>soins</strong> »Maman de Lilou : « Les reins ont comm<strong>en</strong>cé à dérouiller à cause de la ciclo… Donchydratation tous les jours, donc infirmières tous les jours. »Pour une autre maman le contexte de la maison trop peu médicalisé n’était pas propiceà l’acceptation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> par l’<strong>en</strong>fant.Maman de Timéo : « Les prises de sang c’est pas drôle, les piqures non plus. Timéoquand il est à l’hôpital il accepte plus facilem<strong>en</strong>t les choses parce qu’il sait… A lamaison c’est un peu plus pénible quoi. » Un souhaitLes <strong>en</strong>fants ont préféré que les <strong>soins</strong> se déroul<strong>en</strong>t à <strong>domicile</strong>, « à la maison ».Le cadre de référ<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants interrogés est le <strong>domicile</strong> par<strong>en</strong>tal. Un universde jeux mais aussi assez rassurant et cadrant pour leur permettre de grandir. Mala<strong>des</strong> ou pas,ils sont souv<strong>en</strong>t mieux à <strong>domicile</strong> puisqu’ils y trouv<strong>en</strong>t tous les rituels nécessaires pours’apaiser (21) .Lilou 9 ans : « On m’a dit qu’on pouvait r<strong>en</strong>trer… j’étais cont<strong>en</strong>te »Timéo 12 ans :« Je préfère dans mon chez moi. » « J’sais pas… On s’s<strong>en</strong>t mieux. »« C’est mieux à la maison »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « A LA MAISON C’EST MIEUX ! C’est beaucoup mieux !Vraim<strong>en</strong>t vraim<strong>en</strong>t beaucoup mieux ! »Anna 5 ans : « C’est beaucoup mieux à la maison »59
Liliane 12 ans :« J’me s<strong>en</strong>s chez moi, je suis chez moi »« J’fais c’que je veux » « J’cours partout »Pour les par<strong>en</strong>ts seuls les deux couples ayant connu les <strong>soins</strong> palliatifs ont clairem<strong>en</strong>témis la volonté de garder leur fille à la maison. Cette décision rappelle bi<strong>en</strong> le discours <strong>des</strong>oncopédiatres interrogés à l’IHOP <strong>en</strong> 2009 pour qui le retour à <strong>domicile</strong> de l’<strong>en</strong>fant, surtoutdans le cadre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs n’est possible que si les par<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> émett<strong>en</strong>t le souhait. (2)Maman de Mathilde :« J’voulais pas faire un concours de longévité, j’voulais que ce soit de qualité d’où lechoix de la garder à la maison et de faire b<strong>en</strong> les <strong>soins</strong> qu’y’avait à faire à la maisondonc du coup l’HAD »« Ça a été décidé naturellem<strong>en</strong>t, c’était notre choix de la garder à la maison »Maman de Karine : « C’est nous qui avons d’mandé… si ça faisait déjà ! Onn’aurait pas pris le risque… Puis l’HAD dirigé par X. a tout fait pour qu’ças’passe à la maison »Seulem<strong>en</strong>t pour les autres mamans la décision d’une prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> relèveplus d’une proposition de l’équipe soignante que d’un réel souhait de leur part.Maman Marie :« Ah pas du tout non. On savait même pas que ça pouvait se faire. »« On nous a proposé les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> »Maman Liliane :« C’est l’infirmière coordinatrice ! C’est elle qui m’a dit y’aura <strong>des</strong> pansem<strong>en</strong>ts,<strong>des</strong> prises de sang… »« C’est elle qui a tout pris <strong>en</strong> charge… »Maman Juli<strong>en</strong> : « On m’a donné les ordonnances et on m’a dit faut voustrouver quelqu’un qui puisse v<strong>en</strong>ir … Les ordonnances pour les <strong>soins</strong> de biopsie…derrière pour les facteurs de croissance. On a continué avec du coup lagastrostomie »60
Les <strong>en</strong>fants mettai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> avant le côté rassurant de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t familier se disantmême, pour l’une d’<strong>en</strong>tre elles, plus « <strong>en</strong> sécurité à la maison » (Lilou 9 ans) p<strong>en</strong>dant lespério<strong>des</strong> de <strong>soins</strong>.La réalisation de <strong>soins</strong> à la maison avait pour eux l’avantage de limiter leshospitalisations régulières et multiples. De plus l’att<strong>en</strong>te paraissait plus supportable à lamaison où l’<strong>en</strong>fant était <strong>en</strong>touré de ses jouets habituels.Anthony 4 ans : « A la maison… y’a beaucoup de jouets donc c’est pour ça »Anna 5 ans : « Tu sais pourquoi elles me branch<strong>en</strong>t ? Pour pas que j’allé àl’hôpital toujours ! »Timéo 12 ans : « Ça évite déjà de rev<strong>en</strong>ir… »Marie 6 ans : « A la maison… même si elle arrive pas j’ai <strong>des</strong> jeux et tout que àl’hôpital il faut att<strong>en</strong>dre. »Maman de Liliane : « Courir à Lyon chaque fois pour un pansem<strong>en</strong>t ou une prise <strong>des</strong>ang ! Financièrem<strong>en</strong>t pour la sécurité sociale c’est mieux qu’elle soit à la maison »Maman de Timéo : « C’est un truc de moins à gérer quand y’a les trajets <strong>en</strong>moins »Pour les mamans le coté financier et la gestion de l’emploi du temps quotidi<strong>en</strong> étai<strong>en</strong>tplutôt mis <strong>en</strong> avant. Le caractère paisible de la maison était égalem<strong>en</strong>t évoqué.Lilou 9 ans : « A l’hôpital y’a pleins de bruits… à la maison c’est calme. »De manière générale les par<strong>en</strong>ts étai<strong>en</strong>t très satisfaits <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> et <strong>des</strong>bi<strong>en</strong>faits constatés sur leurs <strong>en</strong>fants.Maman de Mathilde :« Pour nous c’était extraordinaire parce qu’elle était à la maison »« C’est que du bonheur puisqu’on a pu la garder jusqu’au dernier jour »Maman de Lilou :« C’était super, cette mise <strong>en</strong> place fait que ça a été supportable »« L’<strong>en</strong>fant qui r<strong>en</strong>tre, qui retrouve son chez soi y’a une énergie qui doit refaire partirla moelle moi j’sais pas !!! »61
Maman de Marie :« Au niveau sécurité affective, sommeil, fatigue, rythme normal… b<strong>en</strong> on estmieux à la maison »« Ça nous a quand même facilité la vie et allégé… Du coup on a presquel’impression qu’elle est moins malade »Maman de Karine : « C’est bi<strong>en</strong> parce qu’on est tous <strong>en</strong>sembles. On garde une viede famille. »Le confort de leur <strong>en</strong>fant était la priorité. « C’est plus confortable pour Liliane» medisait son papa. Pour les par<strong>en</strong>ts le confort de l’<strong>en</strong>fant s’explique par un rythme de viemoins sout<strong>en</strong>u, «ça lui évite les allers retour sur l’IHOP » et un bi<strong>en</strong> être matériel, d’être« dans son canapé ».Pour le Docteur Schell, oncopédiatre à l’IHOP, un <strong>en</strong>fant est <strong>en</strong> position confortabledans l’intimité de sa famille, « dans sa maison, dans sa chambre, avec son rythme et seshabitu<strong>des</strong> » (12) . Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> respect<strong>en</strong>t une « sécurité affective » pour l’<strong>en</strong>fant etaccord<strong>en</strong>t une certaine liberté d’action à la famille. Entre les pério<strong>des</strong> de <strong>soins</strong> la vie à lamaison poursuit son cours.Maman de Liliane :« On bouge moins, c’est plus confortable »« Liliane j’la levais, elle <strong>des</strong>c<strong>en</strong>dait <strong>en</strong> pyjama… même pour elle c’était mieux »Maman de Lilou : « C’est trop bi<strong>en</strong> la p’tite elle est chez elle, elle est dans soncanapé, elle regarde ses DVD, ça n’a pas de prix quoi… Il faut développer ça àfond !! »Maman de Marie : « Pour Marie c’est qu’une injection. Elle avait déjà unrythme de vie assez sout<strong>en</strong>u, c’est vrai que c’est beaucoup plus confortable à lamaison »Maman de Karine : « Pour l’<strong>en</strong>fant d’être dans son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t ça l’aidequand même, ça la rassure »Maman de Mathilde : « L’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t est complètem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>t, même siMathilde elle avait ses <strong>soins</strong> matin et soir b<strong>en</strong> on pouvait faire c’qu’on voulait dansla journée »62
Les par<strong>en</strong>ts et les soignants s’accord<strong>en</strong>t sur le fait de limiter au maximum les duréesd’hospitalisations. Ces affirmations sont superposables à celle du Professeur Cresson : « depermettre à l’<strong>en</strong>fant d’être au plus près de la vie « normale », à la maison » (21) .L’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> Organisation matérielle à <strong>domicile</strong>Que les <strong>soins</strong> soi<strong>en</strong>t de type « suite de <strong>soins</strong> » pour la réfection de pansem<strong>en</strong>ts ou« alternative à l’hospitalisation » pour l’administration de chimiothérapie, la maison t<strong>en</strong>d à setransformer <strong>en</strong> salle de soin. La logistique était assurée par les par<strong>en</strong>ts qui organisai<strong>en</strong>t le<strong>domicile</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong> <strong>soins</strong> et de manière à faciliter le travail <strong>des</strong> infirmières. C’estd’ailleurs un <strong>des</strong> points qui permet, incontestablem<strong>en</strong>t, que la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> soitréussie (21) .Ainsi, sur la bibliothèque, les livres côtoyai<strong>en</strong>t la boîte à aiguille et les kits depansem<strong>en</strong>ts. La pot<strong>en</strong>ce à perfusion trouvait sa place à la tête du lit de l’<strong>en</strong>fant faisant officede nouvelle table de chevet. Les masques de protection respiratoire étai<strong>en</strong>t rangés dansl’<strong>en</strong>trée à coté <strong>des</strong> écharpes. La médicalisation du <strong>domicile</strong> était visible et pourtant les <strong>en</strong>fantsn’y étai<strong>en</strong>t pas trop s<strong>en</strong>sibles. Ils l’avai<strong>en</strong>t intégrée dans leur quotidi<strong>en</strong> comme l’expliquaitAnna p<strong>en</strong>dant son <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> dans sa chambre. J’ai supposé que l’abs<strong>en</strong>ce d’évocation de lamédicalisation du <strong>domicile</strong> par les <strong>en</strong>fants pouvait être expliquée par la banalisation qu’ils <strong>en</strong>font.Anna 5 ans : « L’infirmière toujours elle me branche avec du médicam<strong>en</strong>t, ducancidas. Tu vois j’ai une pompe ici »Les par<strong>en</strong>ts, quant à eux, ont souv<strong>en</strong>t essayé d’aménager au mieux leur <strong>domicile</strong>jusqu’à parfois avoir l’impression de transposer l’hôpital à la maison…Tout était <strong>en</strong> place à lamaison «les cartons avec les pansem<strong>en</strong>ts, le matériel… » Pour certains une pièce dédiée avaitété libérée, « un estanco où on avait tout le stock », qui permettait d’<strong>en</strong>treposer le matériel <strong>des</strong>oins. Pour d’autres la chambre à coucher s’était transformées <strong>en</strong> véritable salle de <strong>soins</strong>libérant « une armoire et puis tous les tiroirs » pour le matériel dont les infirmières aurai<strong>en</strong>tbesoin. Puis leur rev<strong>en</strong>ait aussi la gestion <strong>des</strong> stocks, la logistique, « l’inv<strong>en</strong>taire » et lanécessité « d’anticiper » les comman<strong>des</strong> de consommables.63
Maman de Mathilde : « Notre chambre on l’avait un peu médicalisée quandmême… A disposition elles avai<strong>en</strong>t une armoire et puis tous les tiroirs pour mettreleurs affaires, <strong>des</strong> grands panneaux avec <strong>des</strong> ordonnances… on avait joué l’jeuaussi. »Papa de Mathilde : « Au début ça comm<strong>en</strong>ce les <strong>soins</strong> pfiou t’as noir de matériel… »Papa de Karine : « C’était vraim<strong>en</strong>t l’hôpital ici quoi… »Maman de Karine : « Faut organiser sa maison ! Elle avait un lit médicalisé eton avait acheté un lit d’camp comme ça tu l’déplies dans la journée et c’est l’top, ellepouvait rester avec nous tout l’temps »Maman de Lilou : « On était très médicalisé dans un estanco où on avait toutl’stock ça fait peur… les s’ringues, les trucs de stérilisation froide pour less’ringues… »Maman de Juli<strong>en</strong> : « On a un suivi dièt à la maison. Elle est <strong>en</strong>tre guillemets livréavec le prestataire » Contraintes organisationnellesMême si les <strong>soins</strong> font partie intégrante du quotidi<strong>en</strong> <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants, l’arrivée dupersonnel para médical était parfois vécue comme intrusive. Certains <strong>en</strong>fants vivai<strong>en</strong>t lepassage <strong>des</strong> infirmiers comme une contrainte, d’autres le relativisai<strong>en</strong>t… Liliane et Juli<strong>en</strong>l’ont bi<strong>en</strong> exprimé.Liliane 12 ans :« Ça gâche <strong>des</strong> mom<strong>en</strong>ts, ça gâche <strong>des</strong> cours, ça gâche <strong>des</strong> parties de MarioKart » « J’peux pas être tranquille »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Ça peut être n’importe quand, quand ils ont le temps libre »« C’est beaucoup mieux qu’elles vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t 10 minutes. Hop !! Et puis voilà… »Les <strong>soins</strong> dérang<strong>en</strong>t parfois les <strong>en</strong>fants dans leur vie quotidi<strong>en</strong>ne, cep<strong>en</strong>dantl’organisation et la gestion <strong>des</strong> <strong>soins</strong> et du quotidi<strong>en</strong> pour les par<strong>en</strong>ts peut se révéler êtreun véritable exercice de style. Une gestion qui peut parfois s’appar<strong>en</strong>ter au parcours ducombattant.64
Maman de Timéo :« C’était un peu lourd au niveau passage parce que les prises de sang il <strong>en</strong> fallait2 par semaine, les granocytes c’était 8 jours d’affilée »« C’est compliqué… C’est pas simple… ça t’demande une certaine att<strong>en</strong>tion, ilfallait pas qu’il y ait de microbes dans la maison. Fallait surveiller la fièvre assezrégulièrem<strong>en</strong>t… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« En temps que mère de famille toute seule avec 3 <strong>en</strong>fants j’ai trouvé vraim<strong>en</strong>t quel’organisation du quotidi<strong>en</strong>, de l’hebdomadaire c’était compliqué à gérer »« Il faut vraim<strong>en</strong>t essayer de t<strong>en</strong>ir le manche ne pas oublier de prév<strong>en</strong>ir quand onpart <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce, rappeler le labo à chaque fois, trouver les horaires avec lesprofs… y’a <strong>des</strong> semaines où j’avais 3, 4, 5, 7, 8…12 r<strong>en</strong>dez vous à pr<strong>en</strong>dre sur lasemaine »Maman de Lilou :« Vivre <strong>en</strong> stérile ça veut dire, j’me lève le matin j’ai 3 heures de ménage tous lesjours. J’aspire les gran<strong>des</strong> surface, je javellise les sanitaires, les sols, les rampes, lespoignées… je lave, je cuisine stérile. On s’lave les mains toutes les 5 minutes avec dupurel. » « Y’avait pas d’temps mort… On est retourné X fois à l’hôpital pour <strong>des</strong>coups de fièvre… C’était <strong>des</strong> départs comme ça la valise faite <strong>en</strong> 5 minutes <strong>en</strong>urg<strong>en</strong>ce… c’était loin d’être pépère ! »Maman de Liliane :« Y’a <strong>des</strong> jours où j’pète un câble !! Ouais ça a été très très dur !! J’me suisbataillée. »« Il faut gérer les aplasies, les problèmes d’infirmiers, les prises de sang que c’estbouché le Picc, faut r’partir à l’IHOP si y’a un problème… Il faut être dispo quoi !Il faut téléphoner les résultats sans arrêt, aller au collège juste pour les matièresprincipales, bon j’faisais la navette tout le temps, préparer <strong>des</strong> repas équilibrés,cuisiner <strong>des</strong> bon produits... Faut être là quoi !! »Cette gestion du quotidi<strong>en</strong> et toutes les contraintes qu’elle implique n’est pas évoquéepar les oncopédiatres interrogés sur les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> (2). Depuis que l’HAD a été mise <strong>en</strong>place dans les années quatre-vingt-dix, ni les tâches à remplir, ni la place ou le rôle de par<strong>en</strong>tsà <strong>domicile</strong> (2) n’ont été précisém<strong>en</strong>t décrits. Le champ d’action d’un par<strong>en</strong>t est probablem<strong>en</strong>ttrop vaste pour être décrit, d’autant plus lorsque la maladie s’invite dans le quotidi<strong>en</strong>. Mais si65
ce rôle n’a pas <strong>en</strong>core été formalisé l’étayage à mettre <strong>en</strong> place a déjà été proposé par leDocteur Suc : « On veillera à ce que la famille soit sout<strong>en</strong>ue et <strong>en</strong>tourée à <strong>domicile</strong> sur leplan matériel, financier, logistique ainsi que sur le plan psychique ». (6)La prise <strong>en</strong> charge soignante Les qualités humaines <strong>des</strong> interv<strong>en</strong>antsLes <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> ont égalem<strong>en</strong>t été une expéri<strong>en</strong>ce humaine inédite pour l’<strong>en</strong>fantet sa famille. En effet les <strong>soins</strong> et la surveillance <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts imposai<strong>en</strong>t une prés<strong>en</strong>ce paramédicale voire médicale nouvelle et régulière, parfois même pluriquotidi<strong>en</strong>ne à <strong>domicile</strong>.Le recrutem<strong>en</strong>t était plus ou moins facilité pour les par<strong>en</strong>ts, par l’équipe decoordination qui parfois se chargeait de trouver les interv<strong>en</strong>ants libéraux mais aussi par lesrelations personnelles et le réseau social que les par<strong>en</strong>ts pouvai<strong>en</strong>t avoir déjà tissé de leurcoté. Parfois le recrutem<strong>en</strong>t se faisait de manière un peu plus aléatoire « au pif » comme disaitla maman de Juli<strong>en</strong>.Maman de Mathilde : « Nos infirmières c’est <strong>des</strong> amies quand même… On lesconnait très très bi<strong>en</strong>. »Papa de Mathilde : « C’est nous qui les avons contactés parce que moi j’avais <strong>des</strong>connaissances… »Maman de Lilou : « Y’a une infirmière qui met <strong>en</strong> place l’HAD. Elle a priscontact avec les infirmières du secteur et franchem<strong>en</strong>t ça s’est bi<strong>en</strong> goupillé »Maman de Timéo : « J’suis prof, j’ai une élève qui est infirmière… y’a pas eu <strong>des</strong>ouci, pour moi c’était évid<strong>en</strong>t de lui demander pour elle c’était évid<strong>en</strong>t del’accepter… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« On m’a donné les ordonnances et on m’a dit il faut trouver quelqu’un quipuisse v<strong>en</strong>ir et j’ai fait au Pif ! Moi j’connaissais pas d’infirmiers ici »« J’ai été sout<strong>en</strong>ue dans le s<strong>en</strong>s où ils ont fait ce qu’il fallait pour le prestataire <strong>des</strong>ervice… Ils sont pas allés pour moi chercher l’infirmière qui pourrait v<strong>en</strong>ir »Papa d’Anthony : « Les infirmiers on les côtoie depuis… mes par<strong>en</strong>ts déjà lesfaisai<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>ir pour d’autres <strong>soins</strong> donc on les côtoie, on a confiance <strong>en</strong> elles »66
Maman de Liliane : « C’est l’infirmière coordinatrice… qui a tout pris <strong>en</strong>charge, qui a téléphoné, qui a cherché une infirmière à ma place … le plus près dechez moi … »La relation du personnel para médical avec l’<strong>en</strong>fant n’était pas toujours aisée du fait del’inconfort et de la douleur que les <strong>soins</strong> pouvai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drer. Les relations interpersonnelles,pouvai<strong>en</strong>t parfois s’avérer complexes et déplaire à l’<strong>en</strong>fant. De manière générale le li<strong>en</strong> crééétait fort avec la plupart <strong>des</strong> interv<strong>en</strong>ants qui étai<strong>en</strong>t qualifiés de « sympas », « g<strong>en</strong>tils ».Parfois même <strong>des</strong> relations dépassant le cadre strictem<strong>en</strong>t professionnel pouvai<strong>en</strong>t voir le jour,« <strong>des</strong> relations plus poussées que ne le demanderait le soin lui-même » décrit le ProfesseurCresson (8) . La question se pose de savoir si c’est la personne ou la fonction représ<strong>en</strong>tée parl’infirmier qui déplaisait le plus à l’<strong>en</strong>fant ?De même la qualité de l’interaction avec l’<strong>en</strong>fant pouvait varier <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong>s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts que r<strong>en</strong>voyait l’<strong>en</strong>fant à son « bourreau » d’infirmier v<strong>en</strong>u lui faire ses <strong>soins</strong>, la« ru<strong>des</strong>se » de certaines était d’ailleurs mise <strong>en</strong> avant… La notion de complexité de la prise <strong>en</strong>charge avec un <strong>en</strong>fant atteint de cancer ressortait clairem<strong>en</strong>t chez les infirmiers libérauxinterrogés <strong>en</strong> 2009 (2) . Ils expliquai<strong>en</strong>t ne pas pouvoir bi<strong>en</strong> maitriser leurs réactionspsychologiques.Juli<strong>en</strong> 12 ans :« C’était <strong>des</strong> super g<strong>en</strong>tilles infirmières »Timéo 12 ans : « Les deux ils étai<strong>en</strong>t g<strong>en</strong>tils »Lilou 9 ans : « X. elle allait doucem<strong>en</strong>t dans les trucs »Liliane 12 ans : « Y’<strong>en</strong> a une que j’aime pas, une que j’aime bi<strong>en</strong> » « Avec ma mèreon l’aimait pas trop » « Les infirmières à la maison… p’t’être un peu plus…agréables…’fin l’autre »Maman de Liliane :« Ça s’est mieux passé avec l’anci<strong>en</strong>ne. Bon après c’est <strong>des</strong> affinités maisLiliane elle l’aimait bi<strong>en</strong> madame X. »« L’anci<strong>en</strong>ne était beaucoup plus douce »Maman de Lilou : « Y’a une relation très privilégiée qui s’est instaurée avec lesinfirmières c’est énorme »Maman de Marie : « En fait les infirmières très sympas c’était pas du tout le soucimais Marie elle bloquait »67
Maman de Juli<strong>en</strong> :« C’est les 2 biologistes qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à la maison, y’<strong>en</strong> a un c’est un peu pluscompliqué pour lui… elle est rude… »« Elles sont 3 et on a bi<strong>en</strong> accroché vraim<strong>en</strong>t tout de suite…ça a très vite accrochéavec Juli<strong>en</strong> … comme ça avec un atome crochu »« X1 a ram<strong>en</strong>é <strong>des</strong> DVD à la maison, X2 <strong>des</strong> hamburgers… la troisième elle est plusjeune et plus rude X3… » « Elles ont été une écoute, un souti<strong>en</strong>… » Les craintesLes <strong>en</strong>fants, tout comme leur par<strong>en</strong>ts, ont quand même émis <strong>des</strong> craintes sur la prise<strong>en</strong> charge soignante à <strong>domicile</strong>.• Compét<strong>en</strong>ces techniquesS’occuper d’un <strong>en</strong>fant atteint de cancer n’est pas habituel pour les soignantsambulatoires. Les difficultés de prise <strong>en</strong> charge étai<strong>en</strong>t multiples puisqu’<strong>en</strong> plus d’interagiravec l’<strong>en</strong>fant et sa famille, le soignant était confronté à <strong>des</strong> gestes techniques spécialisés, doncsouv<strong>en</strong>t moins maitrisés. Les <strong>en</strong>fants relatai<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> la complexité, pour certains, deréaliser ces <strong>soins</strong> exceptionnels évoquant « du stress » voire même de la « panique »…Liliane 12 ans : « Pour l’pansem<strong>en</strong>t elle paniquait un peu »Lilou 9 ans : « … Les autres elles étai<strong>en</strong>t stressées là. »Timéo 12 ans : « A la maison on fait pas <strong>des</strong> gros trucs, c’est juste <strong>des</strong> p’titespiqures »Malgré la formation proposée par l’équipe de coordination de l’IHOP, quand les <strong>soins</strong>à <strong>domicile</strong> la r<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t nécessaire, la principale crainte <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts était les limites <strong>des</strong>compét<strong>en</strong>ces techniques <strong>des</strong> infirmiers. « Après b<strong>en</strong> y’a les compét<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> infirmières <strong>en</strong>libérales qui trait<strong>en</strong>t pas ce g<strong>en</strong>re de cas souv<strong>en</strong>t … » me disait le Papa de Liliane. Cescraintes résonnai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> écho avec celles <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Par contre la technicité et la formation neposai<strong>en</strong>t pas de problèmes pour les infirmiers libéraux interrogés <strong>en</strong> 2009. Ils considérai<strong>en</strong>tmême qu’ils n’avai<strong>en</strong>t pas de limite technique dans la prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> oncopédiatrie « Dumom<strong>en</strong>t où la technicité matérielle le permet nous on n’a pas de limite qui freine, on estformé » « On peut aller très loin. » (2)68
Maman de Liliane : « P’t’être que les pansem<strong>en</strong>ts … les filles elles ont plusl’habitude à l’hôpital… C’est ça les infirmières d’ici sont pas habituées »Maman de Marie :« En même temps les infirmières du cabinet on est souv<strong>en</strong>t confronté à ça … y’abeaucoup d’infirmières et surtout <strong>en</strong> libéral qui ont du mal avec les <strong>en</strong>fants, qui ontune certaine hésitation, appréh<strong>en</strong>sion… »« J’p<strong>en</strong>se qu’elles n’étai<strong>en</strong>t pas très à l’aise »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Elles m’ont dit « Vous savez on n’est pas trop au top <strong>en</strong> gastrostomie »« Mes infirmières à moi elles ne sont pas formées aux pompes »« Ça c’est pas fait parce qu’elles avai<strong>en</strong>t pas les compét<strong>en</strong>ces au mom<strong>en</strong>t où on leura demandé »Maman Mathilde : « Des craintes par rapports aux <strong>soins</strong> ? Pas du tout. »Papa de Karine : « Les infirmières non parce qu’elles ont été d’emblé formées parLéon Bérard et on a confiance »On peut remarquer une fois <strong>en</strong>core que les deux couples à n’émettre aucune crainteconcernant les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> sont les par<strong>en</strong>ts ayant vécu l’expéri<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs.Cette différ<strong>en</strong>ce peut s’expliquer par <strong>des</strong> passages de personnel hospitalier à <strong>domicile</strong> plusfréqu<strong>en</strong>ts dans le cadre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs. D’autre part la démarche de <strong>soins</strong> plus globale <strong>en</strong>palliatif, les <strong>soins</strong> de confort pour l’<strong>en</strong>fant, ne r<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t pas dans la même optique de technicitéque <strong>des</strong> <strong>soins</strong> curatifs réalisés à la maison donc ne génèr<strong>en</strong>t probablem<strong>en</strong>t pas la mêmeangoisse de performance.• La gestion de la douleurL’autre difficulté de la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> pour les <strong>en</strong>fants était les douleursliées aux <strong>soins</strong>. L’hôpital apparaissait souv<strong>en</strong>t plus adapté car pour <strong>des</strong> <strong>soins</strong> équival<strong>en</strong>ts,la douleur y était mieux maitrisée. C’est égalem<strong>en</strong>t ce que confirme la littérature etnotamm<strong>en</strong>t le Professeur Leverger <strong>en</strong> 2003. Même si un <strong>en</strong>fant se s<strong>en</strong>t mieux à <strong>domicile</strong>, ildemandera souv<strong>en</strong>t spontaném<strong>en</strong>t à être réhospitalisé <strong>en</strong> cas de non contrôle <strong>des</strong> symptômes àla maison (22) .69
Lilou 9 ans :« J’avais mal quand elles me re’fsai<strong>en</strong>t le pansem<strong>en</strong>t les infirmières du cathéter »« Les infirmières elles sont plus g<strong>en</strong>tilles là bas… Elles allai<strong>en</strong>t plus doucem<strong>en</strong>t. Enplus y’avait le kalinox »Liliane 12 ans :« En fait à cause du pansem<strong>en</strong>t ça m’a abimé la peau et la bétadine <strong>des</strong>sus ça faitmal. »« J’avais mal, mal, mal. »Anthony 4 ans :« Là z’avais mal…là où ils m’avai<strong>en</strong>t piqué <strong>en</strong> fait. C’est à cause du scotch »« Ouille, ouille, ouille !!! » « Ça fait Mal ! »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« C’était dur » « J’avais super mal » « C’était affreux »« La piqure ça fait pas mal, mais le produit il fait très mal ! Même si ils vont superdoucem<strong>en</strong>t… »« Souv<strong>en</strong>t quand j’ai <strong>en</strong>vie, quand je me s<strong>en</strong>s pas très bi<strong>en</strong> que j’ai très mal à la têteet que l’Cod<strong>en</strong>fan ça fait ri<strong>en</strong>, j’demande à maman d’aller à l’hôpital »« Ils ont du nubain, ils ont de la morphine aussi… »Maman de Timéo :« C’était très mal vécu chaque fois qu’il y avait une prise de sang et <strong>en</strong>core plus lesgranocytes parce que ça lui a fait mal donc il les appréh<strong>en</strong>dait énormém<strong>en</strong>t etc’était toute une histoire »« Très dur ouais tellem<strong>en</strong>t que quand les aplasies fallait partir à l’hôpital on disait« ti<strong>en</strong>s tu t’épargnes 2 piqures ». »Maman de Lilou :« Elle souffrait quoi, elle souffrait vraim<strong>en</strong>t voilà ça aussi c’est la limite del’hospitalisation à <strong>domicile</strong>, on est par<strong>en</strong>ts »« Une nuit où ça n’allait vraim<strong>en</strong>t plus… là elle me dit « maman ramène moi àl’hôpital » »Maman de Juli<strong>en</strong> : (Où Juli<strong>en</strong> est il le plus <strong>en</strong> sécurité ?) « Quand il est douloureuxà l’hôpital, quand il va bi<strong>en</strong> à la maison. »70
Les <strong>en</strong>fants expliquai<strong>en</strong>t par quels moy<strong>en</strong>s ils avai<strong>en</strong>t appris à gérer leur douleur. « Lespatchs » anesthésiants apparaissai<strong>en</strong>t comme une <strong>des</strong> solutions miracles pour supprimer lesdouleurs de prises de sang, un acte répété parfois jusqu’à deux fois par semaines pourcertains.Timéo 12 ans : « On mettait <strong>des</strong> patchs… On a trouvé aussi qu’il fallait que je medét<strong>en</strong>de beaucoup parce que j’étais, comme la première fois ça m’avait fait mal, aprèsj’étais… et ça faisait <strong>en</strong>core plus mal »Anna 5 ans : « Ça fait pas mal quand on met le patch. Parce que le patch y’a lacrème <strong>des</strong>sus. »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Une prise de sang… avec le patch tu piques tu s<strong>en</strong>s ri<strong>en</strong>… doncça fait pas mal ! »• Vécu de la fratrieDe manière générale les <strong>en</strong>fants ont peu parlé du vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> par leurs frères etsœurs. Seule Anna a précisé le vécu de sa sœur concernant les <strong>soins</strong> qu’elle recevait.Anna 5 ans : « Noëlle elle a peur <strong>des</strong> piqures… Elle a très très peur <strong>des</strong> piqures. » Les limites de la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong>Finalem<strong>en</strong>t outre les craintes liées à la prise <strong>en</strong> charge soignante certains par<strong>en</strong>tsreconnaiss<strong>en</strong>t que malgré tous les avantages que peut avoir pour l’<strong>en</strong>fant une hospitalisationou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>, il existe pour chacun <strong>des</strong> limites de tolérance et d’acceptation <strong>des</strong><strong>soins</strong>… Ces limites étai<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> rapport avec <strong>des</strong> angoisses concernant l’étatphysique de leur <strong>en</strong>fant.Maman de Liliane :« C’est quand même lourd hein, l’Picc à la fin il était bouché, y’<strong>en</strong> avait marre quoi.A deux mois ça a comm<strong>en</strong>cé à cafouiller »« Les pansem<strong>en</strong>ts ça dev<strong>en</strong>ait s<strong>en</strong>sible la peau autour… »« On a vécu du compliqué <strong>en</strong> hospitalisation à la maison à mon avis »71
Maman de Lilou : « Lilou… a pas d’plaquettes et là on est sur un déplacem<strong>en</strong>td’<strong>en</strong>fant. J’me disais « si j’ai un accid<strong>en</strong>t ma fille elle meure quoi »… Le stress que çaa pu <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drer ! Pour moi ça a été la limite ! J’me le suis dit souv<strong>en</strong>t « C’est paspossible de vivre ça » C’est chaud les marrons quoi !!! Du stress énorme. »Un couple a vécu le passage <strong>en</strong> soin à <strong>domicile</strong> comme un abandon de la part dumonde hospitalier.Maman de Marie : « Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> moi j’trouve que c’est super, c’est unpoint positif. Après y’a le passage au <strong>domicile</strong> a été un peu compliqué. On al’impression d’être abandonné, beaucoup d’angoisse »Ce vécu d’abandon recoupe bi<strong>en</strong> l’impression qu’avai<strong>en</strong>t certains oncopédiatres <strong>des</strong><strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> expliquant que les par<strong>en</strong>ts « se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t un peu abandonné » à<strong>domicile</strong> (2) . Les autres par<strong>en</strong>ts expliquai<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> les moy<strong>en</strong>s mis <strong>en</strong> œuvre par les soignantsde l’IHOP pour limiter ce s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t « d’abandon » à la maison : une coordinationefficace et « très disponible » avec la possibilité « d’appeler X. l’infirmière référ<strong>en</strong>te » etd’avoir une réponse, si ce n’est immédiate, au moins dans la journée.Maman de Mathilde :« X. nous a laissé son numéro, que j’avais pratiquem<strong>en</strong>t une fois par semaine. Dès quej’avais une question j’appelais X. qui <strong>en</strong> parlait au médecin et elle me rappelait dansla journée OU le médecin me rappelait dans la journée. »« Ils nous ont jamais ri<strong>en</strong> imposé… ça a toujours été un échange du début à la fin »Maman de Timéo :« Généralem<strong>en</strong>t je téléphone à X. l’infirmière référ<strong>en</strong>te »« Chaque fois qu’on appelle ils sont très disponibles… »Maman de Marie : « Quand y’a un truc vraim<strong>en</strong>t <strong>en</strong> li<strong>en</strong> vraim<strong>en</strong>t direct avec sapathologie, le traitem<strong>en</strong>t n’importe quoi… <strong>en</strong> général on appelle les infirmières del’IHOP »Maman de Juli<strong>en</strong> : « Je l’appelle régulièrem<strong>en</strong>t quand j’ai les résultats <strong>des</strong>prises de sang du labo… j’l’ai appelé parce que j’avais une question sur uneordonnance…du coup derrière j’ai eu le médecin. Elle a fait le li<strong>en</strong>… »72
Papa d’Anthony« C’est vrai qu’on pouvait appeler Lyon aussi au moindre souci… y’avait toujoursquelqu’un qui répondait »Rôles <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts dans les <strong>soins</strong> Des par<strong>en</strong>ts - par<strong>en</strong>ts• Informations <strong>des</strong> <strong>en</strong>fantsPour certains ce sont les par<strong>en</strong>ts qui ont eu le rôle d’annoncer les nouvelles.Anna 6 ans : « C’est ma maman. »Liliane 12 ans : « C’est maman qui m’a dit que j’avais une boule »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Ma mère et mon père ils m’ont annoncé… »Lilou 9 ans :« B<strong>en</strong> m’expliquer… Parce que lui il allait dans le bureau de X…. il discutait de tousles machins… »« Il m’expliquait… que on pouvait bi<strong>en</strong>tôt sortir »Parmi tous les rôles qu’ils vont jouer dans la maladie de leur <strong>en</strong>fant, la place depar<strong>en</strong>ts reste si ce n’est la plus importante, <strong>en</strong> tous cas la place générique, celle que leurdemand<strong>en</strong>t de t<strong>en</strong>ir les oncopédiatres. (2)Maman de Liliane :(A propos de l’annonce) « C’est moi. J’ai jamais voulu qu’ce soit… même pour laperte de cheveux c’était moi. »« Liliane elle a tout su, j’lui ai jamais ri<strong>en</strong> caché… j’l’ai préparé, j’ai anticipé… »Maman de Mathilde :« B<strong>en</strong> moi ‘fin nous quoi !!! J’crois pas qu’les médecins soi<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>usfranchem<strong>en</strong>t… avec <strong>des</strong> mots simples… Elle savait qu’elle avait une boule dans la têteque c’était très très grave, que ça guérissait pas »« C’était moi et mes p’tits mots de mamans »Maman de Timéo : « Un par<strong>en</strong>t voilà si on lui dit que pour le bi<strong>en</strong> de son<strong>en</strong>fant il fait faire <strong>des</strong> <strong>soins</strong> b<strong>en</strong> on les fait »73
Papa d’Anthony : « Pour moi c’est aussi le rôle de par<strong>en</strong>ts de donner <strong>des</strong>médicam<strong>en</strong>ts à un <strong>en</strong>fant »Maman de Lilou : (à propos de la prise de médicam<strong>en</strong>ts) « Et j’ai pas le choix j’suista maman et je suis obligée de te soigner »Maman de Marie :« On a toujours pris le parti de ri<strong>en</strong> lui cacher, de lui dire avec <strong>des</strong> mots simples maisde répondre à ses questions »« T’as une petite boule dans la tête, on l’avait même nommée c’était « Cruella » quiappuie sur les petits tuyaux de tes yeux »• L’écouteA <strong>domicile</strong> comme à l’hôpital les par<strong>en</strong>ts étai<strong>en</strong>t les personnes à qui l’<strong>en</strong>fant pouvaitconfier ses craintes, son désarroi. Le souti<strong>en</strong> que pouvai<strong>en</strong>t apporter les par<strong>en</strong>ts était apaisant,ou pas…Liliane 12 ans :« J’le dis à ma mère que je me trouve pas bi<strong>en</strong>. Ça me soulage pas moi. »« Quand j’ai <strong>des</strong> questions ? Pour les douleurs c’est à maman. »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« J’<strong>en</strong> parle à ma mère puis comme d’habitude ça passe avec ma mère… Supermaman ! »Maman de Marie : (à propos de l’expression de la souffrance de Marie) « ça m’apas fait plaisir quoi parce que c’est viol<strong>en</strong>t pour une maman de recevoir ça aussi etde s<strong>en</strong>tir que… on sait qu’elle souffre mais là elle le verbalisait <strong>en</strong>fin… »• Une prés<strong>en</strong>ce rassuranteLa prés<strong>en</strong>ce maternelle était plus souv<strong>en</strong>t sollicitée, que ce soit à l’hôpital ou à lamaison surtout p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong>.Lilou 9 ans : « La nuit j’dormais… « Maman j’ai <strong>en</strong>vie de faire pipi ! –Ok on y va »… tout l’temps, tout le temps »Timéo 12 ans : « Souv<strong>en</strong>t à maman parce qu’elle est plus souv<strong>en</strong>t là »74
Liliane 12 ans :(A l’hôpital) « Ils avai<strong>en</strong>t pas le droit de dormir avec moi. J’étais toute seule lesoir… C’était pas facile pour moi »« En général il travaille… Il aime pas trop me voir… Voir le sang »Seuls les plus grands ont pu exprimer leur besoin de réassurance. Pour les plus jeunescette expression est souv<strong>en</strong>t passée par le <strong>des</strong>sin. A la maison et pour les <strong>soins</strong> Anna et Marieont <strong>des</strong>siné leur maman, pour Lilou sa famille <strong>en</strong>tière l’<strong>en</strong>tourait.Pour les mamans leur prés<strong>en</strong>ce auprès de leur <strong>en</strong>fant est une évid<strong>en</strong>ce. « J’ail’impression qu’il n’y a que moi qui peut m’occuper d’elle » me disait même la maman deLiliane. Cette prés<strong>en</strong>ce et la réassurance de l’<strong>en</strong>fant qui <strong>en</strong> découle faisai<strong>en</strong>t partie deleur rôle de mamans. Elle débouche comme l’explique bi<strong>en</strong> la psychologue Evelyne Jossesur « une relation fusionnelle régressive proche du maternage » (23) . « J’ai r<strong>en</strong>oué un cordonque j’avais cassé » « j’ai repris mon bébé » m’expliquait la maman de Liliane. Ce besoin deprotection, au cours de la maladie, est d’ailleurs rev<strong>en</strong>diqué par les <strong>en</strong>fants eux-mêmes (24) .Maman de Liliane :« Liliane c’qu’elle voulait c’était moi à coté. »Maman de Mathilde :« Chaque fois qu’elle était piquée que ce soit ici ou à l’hôpital j’étais toujoursderrière elle. »«Elle me disait « j’ai pas peur » … C’est qu’on avait réussi « notre job » <strong>en</strong>treguillemets de l’apaiser… »Maman de Timéo : « Avant c’était quelqu’un de très indép<strong>en</strong>dant maint<strong>en</strong>ant sansarrêt il est <strong>en</strong> train de v<strong>en</strong>ir chercher <strong>des</strong> câlins, <strong>des</strong> bisous tout ça… »Maman de Marie : « Au début elle voulait que je lui caresse le v<strong>en</strong>tre, que je luiti<strong>en</strong>ne la main et puis maint<strong>en</strong>ant « maman tu sors, tu fermes la porte » »Maman de Juli<strong>en</strong> : « Dès qu’il y a les facteurs de croissance il fallait que je sois àcoté que j’ai la main dans la si<strong>en</strong>ne »Maman de Lilou :« On l’a jamais laissée Lilou pas une minute. »« J’ai dormi au pieds de Lilou p<strong>en</strong>dant 1 an et demi »75
• L’accompagnem<strong>en</strong>tSeule deux mamans ont parlé du combat de leur fille contre la maladie. Sans pourautant sous estimer leur rôle elles se plaçai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> position d’accompagnante, d’aidante…Maman de Mathilde : « L’combat c’est pas moi qui l’ai m<strong>en</strong>é quoi ! C’est ma fille !Moi j’l’ai juste accompagnée, j’ai juste été là. »Maman de Lilou : «Donc j’ai pris mon bâton, je me suis relevée et j’ai étéforte… Pour ma fille »• Maladie par procurationPourtant les par<strong>en</strong>ts sont souv<strong>en</strong>t tellem<strong>en</strong>t impliqués dans la maladie de leur<strong>en</strong>fant que cette maladie devi<strong>en</strong>t un peu la leur… La maladie est <strong>en</strong> effet celle de leur<strong>en</strong>fant mais son histoire leur apparti<strong>en</strong>t aussi (23). C’est leur combat…Maman de Liliane :« C’est moi c’est ma fille, c’est son cancer, c’est le mi<strong>en</strong> aussi »« On a mis la perruque au début »« J’p<strong>en</strong>se que j’aurai <strong>des</strong> contrôles IRM sur Lyon »« J’le fais pour Liliane, j’le fais aussi pour moi. J’ai l’impression de gérer mamaladie à moi… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Au début on a toutes les mêmes cures au même mom<strong>en</strong>t »« J’ai terminé la radiothérapie je crois c’était le 16 décembre » Des par<strong>en</strong>ts-soignantsDu fait de la maladie et <strong>des</strong> <strong>soins</strong> réalisés à <strong>domicile</strong> le statut <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts a eu t<strong>en</strong>danceà évoluer vers une place différ<strong>en</strong>te avec très souv<strong>en</strong>t un rôle de soignant.• Une implication volontaireLes par<strong>en</strong>ts étai<strong>en</strong>t partie pr<strong>en</strong>ante <strong>des</strong> <strong>soins</strong> notamm<strong>en</strong>t dans la gestion quotidi<strong>en</strong>ne<strong>des</strong> médicam<strong>en</strong>ts ou la préparation du matériel nécessaire aux infirmières pour les <strong>soins</strong>…Lilou 9 ans : « A l’hôpital c’était les infirmières, à la maison c’était soit papa, soitmaman»76
Maman de Liliane :« Oui je suis partie pr<strong>en</strong>ante… Moi j’trouve que c’est important pour le confort del’<strong>en</strong>fant »« C’est plus rapide, les <strong>soins</strong> étai<strong>en</strong>t plus vite faits »Maman de Mathilde :« On était dans la maladie non stop, on voulait savoir de quoi on parlait et c’qu’onfaisait à notre fille »Maman de Karine : « Mine de ri<strong>en</strong> c’est un boulot à plein temps, c’est épuisant.»Maman de Juli<strong>en</strong> :« On se découvre appr<strong>en</strong>ti biologiste, appr<strong>en</strong>ti médecin… »« Les équipes compt<strong>en</strong>t aussi sur nous ce qui est assez surpr<strong>en</strong>ant « C’est quoi letraitem<strong>en</strong>t de Juli<strong>en</strong> ? » Ils vont me demander… »« Etant donné que je suis assistante sociale de formation, j’aurais plutôt t<strong>en</strong>dance àpr<strong>en</strong>dre les choses fortem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> main »Maman de Lilou : « J’ai eu un gros défaut dans la maladie c’est que j’ai voulu toutsavoir… Mais du coup quand on compr<strong>en</strong>d, on compr<strong>en</strong>d les risques aussi. »• Une maîtrise techniqueLes <strong>en</strong>fants citai<strong>en</strong>t régulièrem<strong>en</strong>t leur maman comme une <strong>des</strong> principales actrices <strong>des</strong><strong>soins</strong> à la maison. Que ce soit pour brancher une poche d’alim<strong>en</strong>tation <strong>en</strong>térale ou débrancherune perfusion, mais aussi pour faire les prises de sang (la maman de Marie est infirmièrepuéricultrice).Leur rôle semblait complém<strong>en</strong>taire à celui <strong>des</strong> soignants, parfois elles lesremplaçai<strong>en</strong>t à la demande <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. L’acquisition <strong>des</strong> compét<strong>en</strong>ces techniques étaitsouv<strong>en</strong>t un appr<strong>en</strong>tissage de terrain pour les mamans.Marie 6 ans : « Au début c’était <strong>des</strong> infirmières à <strong>domicile</strong> mais après je disais toutle temps « non c’est maman » et finalem<strong>en</strong>t c’est maman qui les a fait » (à propos <strong>des</strong>prises de sang)Lilou 9 ans : « Le matin c’était maman parce qu’elle savait débrancher machin… »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« On nous a appris à faire » (A propos du branchem<strong>en</strong>t de la gastrostomie)« Au début on s’est gouré tous les 2… On <strong>en</strong> a foutu partout… Après ça c’esttoujours passé très bi<strong>en</strong> »77
Maman de Liliane :« Je suis du milieu donc ça ne me gène pas. Moi j’suis au boulot 24h sur 24 ici avecLiliane. »« Quand elles arrivai<strong>en</strong>t j’avais tout préparé… J’leur avançais le travail. »« On travaillait <strong>en</strong>semble. Les infirmières elles étai<strong>en</strong>t cont<strong>en</strong>tes… J’remplissais lestubes, j’les servais, j’leur donnais les trucs. »Maman de Mathilde :« On s’est intéressé aussi aux <strong>soins</strong>. »«On savait quel médicam<strong>en</strong>t servait à quoi, pourquoi, comm<strong>en</strong>t il s’appelait… »« On aidait les infirmières b<strong>en</strong> à régler le compte goute, à arrêter la machinequand ça sonnait, aider à faire le pansem<strong>en</strong>t parce que b<strong>en</strong> moi j’voulais que lepansem<strong>en</strong>t il soit comme ça et pas autrem<strong>en</strong>t. »Maman de Lilou :(A propos de l’administration <strong>des</strong> médicam<strong>en</strong>ts) « Avec la sonde naso-gastrique(SNG) y’avait plus ces contraintes de traitem<strong>en</strong>t, elle dort le matin j’l’a réveillaismême pas j’<strong>en</strong>filais la ciclo, j’rinçais et elle dormait. »(A propos de la prise de médicam<strong>en</strong>ts) « On a été formé tout de suite au R3 <strong>en</strong>sortant les premières fois »« Au mois d’Août on lui a <strong>en</strong>levé son cathéter mais on l’hydratait par la SNG. Ça c’estmoi qui le faisais, j’avais mes tubulures que j’mettais dans la sonde, je mettais legoutte à goutte, c’est pas dur. »« Y’a eu <strong>des</strong> pansem<strong>en</strong>ts à la maison… J’ai eu fait un pansem<strong>en</strong>t… parce queFranchem<strong>en</strong>t je savais le faire. »Maman de Marie :« Elles me disai<strong>en</strong>t « Mais vous êtes puer pourquoi vous ne la piquez pas ? »« J’ai dit à Marie je veux bi<strong>en</strong> essayer. Y’a jamais eu de souci »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Je p<strong>en</strong>se qu’effectivem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tant que maman j’ai fait mon appr<strong>en</strong>tissage oui. »« On a pris un cours de la mère qui était à coté. Ça a été tartiné, reconfituré par lamaman d’à coté et je trouve que c’est bi<strong>en</strong> »(A propos de la gastrostomie) « Finalem<strong>en</strong>t à l’HFME j’ai retrouvé ma petiteinfirmière qui m’avait fait un cours, l’infirmière m’a montré et donc on l’a fait icimais tout seul tous les deux. »78
(Maman de Juli<strong>en</strong> :)« C’est vrai que la gastrostomie c’est plutôt moi et puis y’avait pas d’danger de vieou de mort pour Juli<strong>en</strong> »Maman de Karine : « On savait tout… les doses… t’façon c’est nous qui faisions laplupart du temps les comman<strong>des</strong> de produits par téléphone »• Les limites de la compét<strong>en</strong>ce de soignantMais parfois la compét<strong>en</strong>ce acquise trouvait ses limites. Des limites techniquescertaines mais égalem<strong>en</strong>t affectives qui pouvait <strong>en</strong>trainer une confusion de rôle (25) , unesouffrance pour le par<strong>en</strong>t soignant et conduire à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> insuffisants.Liliane 12 ans : « Il fallait déboucher le bouchon anti reflux et prélever directem<strong>en</strong>tdans la voie. Et ma mère elle voulait pas le faire ca elle voulait pas mettre <strong>des</strong>microbes dedans. »Maman de Lilou :« C’qui est horrible dans cette hospitalisation à <strong>domicile</strong> c’est la relation quis’installe c'est-à-dire mon rôle de maman d’infliger <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts à ma fille. »« C’est horrible, on devi<strong>en</strong>t un bourreau. »« J’étais plus une maman, j’étais un bourreau, j’étais même plus uneinfirmière… »« On a un acharnem<strong>en</strong>t thérapeutique à faire <strong>en</strong>tre guillemets. »Maman de Juli<strong>en</strong> : « Je n’arrive plus aujourd’hui et c’est vrai que je ne le force pasà lui faire faire ses bains de bouche quand il est <strong>en</strong> aplasie. »Papa d’Anthony : « Y’a eu les <strong>soins</strong> de bouche qui étai<strong>en</strong>t très difficiles à faire parcequ’il crachait pas, fallait les faire à la compresse… ça devait peut être lui faire mal,c’était désagréable et ça c’était assez dur. »La notion de responsabilité du par<strong>en</strong>t soignant était égalem<strong>en</strong>t soulevée. Commel’explique Evelyne Josse, psychologue, « lorsque l’<strong>en</strong>fant regagne son foyer les par<strong>en</strong>ts sontmandatés d’une certaine autorité médicale » (23) . En effet les par<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t être att<strong>en</strong>tifs àl’état physique de leur <strong>en</strong>fant, surveiller l’apparition de signes cliniques, savoir <strong>en</strong> mesurer lagravité et pr<strong>en</strong>dre la décision d’alerter l’équipe soignante. Un rôle souv<strong>en</strong>t angoissant pourles par<strong>en</strong>ts à la maison, « un stress énorme » mais qu’ils accept<strong>en</strong>t pour préserver le bi<strong>en</strong>être de leur <strong>en</strong>fant. « Elle est tellem<strong>en</strong>t heureuse d’être r<strong>en</strong>trée… ça n’a pas de prix. »79
Maman de Liliane : « La maman elle est obligée de gérer pas mal à la maison pourles <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. »Maman de Lilou :« On fait quand même <strong>des</strong> allers-retours pour <strong>des</strong> coups d’fièvre ! Ça c’est dur on estresponsable. »« Quand même quand on part avec notre <strong>en</strong>fant avec tout ce que ça comporte, c’estpas facile, ça crée un stress énorme. Mais la gamine elle est tellem<strong>en</strong>t heureuse d’êtrer<strong>en</strong>trée que ça n’a pas de prix. On l’porte quoi cette responsabilité là. »« A la maison on est <strong>en</strong> veille. Faut tout surveiller, faut ri<strong>en</strong> louper, là y’a pas le droità l’erreur. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« C’est nous qui gérons derrière. »(À propos <strong>des</strong> biologies) « Au bout d’un mom<strong>en</strong>t on s’est dit non ça va pas decontrôler qu’une fois si on fait <strong>des</strong> facteurs de croissance donc j’ai pris sur moi derefaire contrôler deux fois »Papa d’Anthony : « A la maison c’était à nous de voir si y’a quelque chose quin’allait pas, pourquoi ça n’allait pas… On a toujours <strong>des</strong> doutes. »Et finalem<strong>en</strong>t à la lumière <strong>des</strong> paroles <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts et comme le suggère le ProfesseurCresson, peut-on parler de la « bonne infirmière » qui va savoir se faire accepter et apprécierdans cette prise <strong>en</strong> charge unique qu’est le soin à <strong>domicile</strong> d’un <strong>en</strong>fant atteint de cancer… Du« bon par<strong>en</strong>t » qui saura bon gré mal gré développer et mêler <strong>des</strong> aspects relationnels,logistiques et techniques suffisants à la création d’une relation fondée sur le partage de vécu etl’<strong>en</strong>traide dans les <strong>soins</strong> ? (8) N’y a-t-il pas surtout un <strong>en</strong>fant malade au cœur de la prise <strong>en</strong>charge et un réseau de professionnels et de par<strong>en</strong>ts autour de lui, qui <strong>en</strong> interagissant vontpouvoir proposer une prise <strong>en</strong> charge unique, modulable et adaptée à chaque <strong>en</strong>fant. Une prise<strong>en</strong> charge avec ses échanges parfois bi<strong>en</strong> plus développés qu’une simple relationprofessionnelle et ses difficultés qui vont souv<strong>en</strong>t émailler le parcours de <strong>soins</strong>… Des par<strong>en</strong>ts-adultes• Une vie occultée, un couple malm<strong>en</strong>éLes <strong>en</strong>fants n’ont pas évoqué le sujet sauf un, Juli<strong>en</strong>, un <strong>des</strong> plus âgés. Il a exprimél’idée que depuis le début de sa maladie sa maman occultait sa vie de femme. Pour la plupart80
<strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts leur vie d’adulte a été mise <strong>en</strong>tre par<strong>en</strong>thèse depuis le début de la maladie de leur<strong>en</strong>fant. Plus qu’une par<strong>en</strong>thèse il s’agit parfois d’une véritable tempête pour le couple.Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Y’a ma mère qui est pas TRES bi<strong>en</strong>. »« Ma mère elle fait tout pour moi, elle s’occupe jamais d’elle. »Maman de Liliane :« Au début ouais. J’<strong>en</strong> voulais à tout le monde… Plus de contact physiquej’pouvais plus quoi. Ça me r<strong>en</strong>voyait à la conception de Liliane. J’pouvais pasconcevoir d’avoir du plaisir quelque part. »« Ma fille malade, p’t’être qu’elle va mourir, j’peux pas m’amuser, j’peux pas rire,j’peux pas avoir du plaisir c’est pas possible. Ma vie s’arrête quoi ! »« Bi<strong>en</strong> sur qu’on s’aime mais ça a été dur, il a fallu du temps »(À propos du couple) « Ça l’a ébranlé oui. »Papa de Mathilde :« Après c’est dur pour un couple de vivre avec son <strong>en</strong>fant tout le temps aumilieu »« Tu p<strong>en</strong>ses à ton couple et tu te dis comm<strong>en</strong>t ça va se passer après… Soit tout bi<strong>en</strong>,soit tout mal, tu sais pas <strong>en</strong> fait. »« On sait pas comm<strong>en</strong>t on va réagir après aussi bi<strong>en</strong> on s’séparera, aussi bi<strong>en</strong> on vafaire un autre <strong>en</strong>fant, on sait pas. »Maman de Lilou : « On a vécu comme ça deux jours, deux jours, on s’est croisé, y’aplus eu d’vie de couple hein p<strong>en</strong>dant de longs mois. »Maman de Juli<strong>en</strong> : « B<strong>en</strong> on s’assoit <strong>des</strong>sus hein… J’ai arrêté la danse… J’airemplacé ça par le psy… »Papa d’Anthony :« On n’a plus le temps de p<strong>en</strong>ser au couple, on est par<strong>en</strong>ts et puis on n’est Quepar<strong>en</strong>ts aujourd’hui quoi. »« On n’a pas <strong>en</strong>core réfléchi à tout et discuté de tout avec sa mère j’p<strong>en</strong>sequ’y’a beaucoup de choses qu’on s’est pas dit… »« C’est pas fini… on n’a toujours pas pu pr<strong>en</strong>dre de recul… y’a <strong>des</strong> choses b<strong>en</strong> decouple, internes à nous qui ne sont pas réglées… »81
Maman de Marie :« J’ai dit à mon mari va falloir qu’on soit solide, va falloir qu’on se serre lescou<strong>des</strong>… »« J’te l’dis tout de suite, soit ça passera, soit ça cassera »« Ça ne laisse pas un couple neutre. »• R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> relationsPour une maman, l’expéri<strong>en</strong>ce de la maladie a été le cim<strong>en</strong>t de leur couple.Maman de Mathilde :« Ça nous a r<strong>en</strong>forcé vraim<strong>en</strong>t… »« On a vécu 24heures/24 <strong>en</strong>semble, chose qu’on n’avait jamais faite. On n’était passûr de se supporter et on s’est très bi<strong>en</strong> supporté »« L’amour qu’on lui porte b<strong>en</strong> c’est l’amour qu’on s’porte à nous aussi, lerespect et puis l’<strong>en</strong>vie d’avancer <strong>en</strong>semble… »IV.2.3.Prise <strong>en</strong> charge hospitalièreVision de l’équipe hospitalièreL’hôpital était pour les <strong>en</strong>fants le lieu <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, les « chimios », les « gros trucs ». Ilsétai<strong>en</strong>t pour la plupart accompagnés <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce par un de leur par<strong>en</strong>t. C’est à cetteoccasion qu’ils r<strong>en</strong>contrai<strong>en</strong>t l’équipe soignante hospitalière. Certaines caractéristiques del’équipe ont émergé à son évocation. Vision <strong>des</strong> médecinsSeule Lilou a évoqué les qualités de son médecin. De manière générale les <strong>en</strong>fantsutilisai<strong>en</strong>t le prénom <strong>des</strong> soignants lorsqu’ils <strong>en</strong> parlai<strong>en</strong>t.Lilou 9 ans : « X. elle était g<strong>en</strong>tille »Maman de Liliane :« J’avais tous les internes dans la chambre… Le Dr House là ils étai<strong>en</strong>t touslà… »« J’vois un espèce de papy aux cheveux blancs, j’dis c’est lui le médecin ? »82
Maman de Lilou : « En réa ils sont tous barbus, les cheveux blancs, ils ont tous 40ans de carrière… »Papa d’Anthony : « Ils se sont occupés de tout, ils nous ont tout expliqué, ils ont ététrès abordables… » Dialogue aiséDe plus pour les <strong>en</strong>fants le personnel hospitalier était bi<strong>en</strong> à l’écoute de leursquestionnem<strong>en</strong>ts. Le dialogue aisé avec les infirmières semblait faciliter leur acceptation <strong>des</strong><strong>soins</strong>.Lilou 9 ans : « Moi quand j’voyais les infirmières v<strong>en</strong>ir j’disais : -Tu faisquoi ?... »Liliane 12 ans : « Ils m’avai<strong>en</strong>t tout expliqué p<strong>en</strong>dant ½ heure. »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Ils m’ont expliqué, j’p<strong>en</strong>se que j’sais tout » « Au début j’avais du mal, j’posais pasde questions »« Puis il fallait bi<strong>en</strong> que je m’occupe quand j’étais <strong>en</strong> chimio… puis au fur et àmesure j’ai appris pleins de trucs et c’était plutôt rigolo. »Contrairem<strong>en</strong>t au <strong>domicile</strong>, les relations <strong>en</strong>tre les par<strong>en</strong>ts et les infirmiers hospitaliersne semblai<strong>en</strong>t pas aussi conviviales et personnalisées. Peut être que le cadre hospitalierinstaurait une distance nécessaire <strong>en</strong>tre les par<strong>en</strong>ts et les soignants pour que chacun garde saplace… Pour que les par<strong>en</strong>ts puiss<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>dre la responsabilité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> aux soignants etgarder leur place de par<strong>en</strong>ts (24) . Seule la maman de Liliane qui était « du milieu » a évoquéses longues discussions avec le personnel soignant.Maman de Liliane :« J’ai beaucoup discuté avec le personnel para médical… Ouais les ai<strong>des</strong>soignantes, <strong>en</strong>fin les auxiliaires, les infirmières… »« B<strong>en</strong> de ça, d’la maladie, de tout… Du médical parce que je suis du milieu alorson parlait d’mon boulot… on parlait <strong>des</strong> 12 heures… Voilà on papotait… »83
Représ<strong>en</strong>tation de l’IHOP Hôpital sécurisantLorsqu’ils se s<strong>en</strong>tai<strong>en</strong>t trop faibles ou trop douloureux, les <strong>en</strong>fants demandai<strong>en</strong>t àêtre hospitalisés. Le caractère sécurisant de la prise <strong>en</strong> charge était toujours associé àl’hôpital. Juli<strong>en</strong> a pu l’expliquer.Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Quand j’suis <strong>en</strong> aplasie, que j’ai très mal à la tête là j’me s<strong>en</strong>s plus<strong>en</strong> sécurité à l’hôpital »Les par<strong>en</strong>ts, aussi confortables que soi<strong>en</strong>t les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> pour leur <strong>en</strong>fant etmême si l’hôpital était loin de leur <strong>domicile</strong>, étai<strong>en</strong>t unanimem<strong>en</strong>t plus sécurisés dès lorsqu’ils étai<strong>en</strong>t dans les murs de l’IHOP. Ils pouvai<strong>en</strong>t alors laisser de coté leur casquette <strong>des</strong>oignant et toute la responsabilité qu’elle implique.Maman de Liliane : « A l’hôpital. Y’a plus de surveillance avec les médecins. Y’aplus de monde qui passe, les internes, les médecins… c’est sécurisant. Si j’ai <strong>des</strong>questions, tout de suite on m’donne la réponse. »Maman de Timéo :« Quand on veut quelque chose on demande à l’infirmière qui demande àl’interne si besoin. »« Vraim<strong>en</strong>t on s<strong>en</strong>t qu’on est une personne et qu’on n’est pas juste un numéro. »« Avec le recul c’est rassurant d’être dans un contexte où on sait que voilà ilsconnaiss<strong>en</strong>t exactem<strong>en</strong>t les effets secondaires. »« Si y’a quelque chose, la moindre chose, ils sont sur place donc c’est vrai çarassure »Maman de Lilou :« Quand je r<strong>en</strong>trais dans ce bâtim<strong>en</strong>t j’avais un bi<strong>en</strong> être, j’me disais ça y est j’suis<strong>en</strong> sécurité tout va bi<strong>en</strong> »« Ça y est j’étais <strong>en</strong> sécurité, ma fille est <strong>en</strong> sécurité »« Une nuit où ça n’allait vraim<strong>en</strong>t plus, elle me dit « Maman amène moi àl’hôpital ». »84
Maman de Marie :« Je ne souhaiterais pas par contre qu’on aille moins à l’IHOP. C’est un rythme… Sion faisait tous les 3 mois je p<strong>en</strong>se … <strong>en</strong>core plus angoissant. »« On a besoin d’avoir un regard extérieur. »« A l’hôpital, on est <strong>en</strong>touré par tous ces professionnels, ils sont vraim<strong>en</strong>t rivés sur sapathologie »« Sur l’IHOP on se s<strong>en</strong>t quand même bi<strong>en</strong> pris <strong>en</strong> charge, <strong>en</strong>tourés. On est plusrassurés là bas. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« On était à 80% à l’hôpital. On vivait dans la bulle de l’IHOP »« Je trouve qu’on a été avec l’hôpital <strong>en</strong> fusion. »« L’hôpital est très protecteur. »Papa d’Anthony : « C’est vrai qu’à Lyon tout est pris <strong>en</strong> charge… On craintri<strong>en</strong>… pour nous par<strong>en</strong>ts on n’avait ri<strong>en</strong> à gérer. »Seuls les par<strong>en</strong>ts ayant connu les <strong>soins</strong> palliatifs n’ont pas associé le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>des</strong>écurité avec l’hôpital. Peut être parce que même à l’hôpital leur <strong>en</strong>fant ne pouvait pas êtresauvé mais surtout parce que l’objectif <strong>des</strong> <strong>soins</strong> n’était pas le même… Hôpital c<strong>en</strong>tré sur les be<strong>soins</strong> de l’<strong>en</strong>fant malade…Les <strong>en</strong>fants n’ont généralem<strong>en</strong>t pas évoqué l’univers de l’hôpital pourtant construitautour et pour l’<strong>en</strong>fant malade. L’école et de nombreuses autres activités y étai<strong>en</strong>t proposées.Pour eux l’hôpital était le lieu <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts. Seule Lilou et la maman de Liliane ont évoquéces aspects.Lilou 9 ans : « C’était bi<strong>en</strong> parce qu’il y avait <strong>des</strong> blouses roses »Maman de Liliane :« Y’a un service extra ordinaire. Y’avait toujours quelqu’un qui r<strong>en</strong>trait c’est la folie !Les blouses roses, les machins, les éducatrices… Elle s’est éclatée là bas hein ! Ellevoulait y aller tous les lundis après midi pour faire de la couture parce qu’il y al’atelier stylisme… »« On a même été au noël <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. C’était super… <strong>des</strong> bûches, à boire, àmanger, <strong>des</strong> chanteurs, <strong>des</strong> karaokés… Faut voir c’qu’ils font pour ces <strong>en</strong>fants. »85
« Y’a pas qu’les <strong>soins</strong>… Y’a tout c’qu’ils ont apporté à coté à Liliane à l’hôpital,qu’y’aurait pas eu à la maison. Y’a le contact y’a les éducatrices, tout c’qui est jeux,occuper l’<strong>en</strong>fant… » … Mais où l’<strong>en</strong>fant n’est pas à sa placeL’hôpital a surtout été décrit par les <strong>en</strong>fants comme un lieu plutôt hostile moinsrassurant que la maison.Liliane 12 ans :« Là bas j’me s<strong>en</strong>s bizarre. »« J’aime pas trop être à l’hôpital » « Y’a pas trop de jeux de société »« Ils avai<strong>en</strong>t pas le droit de dormir avec moi dans la chambre…j’étais touteseule. » (À propos <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts)Anthony 4 ans : « Dans le lit tout au fond il a peur »Lilou 9 ans :« Y’avait pleins de bruits, les pompes elles arrêtai<strong>en</strong>t pas de sonner ! »« J’ai beaucoup pleuré »« C’qui est pas drôle c’est de rester dans la chambre »Marie 6 ans : « C’est un peu plus nul quoi »Timéo 12 ans : « Y’a plus de g<strong>en</strong>s à l’hôpital… T’es pas avec ta famille, tu lesconnais pas tous… »Maman de Liliane :« J’ai <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants pleurer la nuit, j’étais à coté, j’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dais « Maman ! » moiça me tordait les tripes. »« Liliane elle était fermée ! A l’hôpital c’était vraim<strong>en</strong>t une huitre quoi !… Les deuxpremières chimios elle était triste <strong>en</strong> fait. »Maman de Marie :« Y’a <strong>des</strong> fois on a été frustré sur la prise <strong>en</strong> charge. On att<strong>en</strong>d p<strong>en</strong>dant <strong>des</strong>heures on se dit « Mais vous avez consci<strong>en</strong>ce quoi ? La mi<strong>en</strong>ne elle est vraim<strong>en</strong>tfatiguée et malade quoi ! » . »86
Les contraintes hospitalièresLa maladie et les complications <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts imposai<strong>en</strong>t <strong>des</strong> hospitalisationsrégulières, avec toutes les contraintes inhér<strong>en</strong>tes à l’hôpital.Liliane 12 ans :« J’suis <strong>en</strong>fermée dans ma chambre toute la journée… Dans mon lit toute lajournée »« J’aime pas rester <strong>en</strong>fermée »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Tu retournes à l’hôpital quand tu as de la fièvre » « Tous les 21 jours tu doisretourner à l’hôpital »« Faire les allers retours tous les jours à l’hôpital c’est Chiant ! »Marie 6 ans : « Le mercredi j’allais pour le carboplatine et la vincristine, le jeudi j’yretournais pour la vincristine, le v<strong>en</strong>dredi aussi. »Timéo 12 ans : (Pour les <strong>soins</strong>) « J’aurais pris à la maison… ça évite de re-aller àl’hôpital <strong>en</strong> fait »Lilou 9 ans : « On avait l’droit de sortir de la chambre mais pas dehors del’hôpital »Les <strong>en</strong>fants rest<strong>en</strong>t donc très ambival<strong>en</strong>ts à l’évocation de l’hôpital. En effet unehostilité se dégage de ces lieux pourtant décrits aussi sécurisants et protecteurs. Maismalgré tous les intérêts qu’ils peuv<strong>en</strong>t trouver à l’hôpital y compris le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de sécurité,les <strong>en</strong>fants rest<strong>en</strong>t déterminés dans leur préfér<strong>en</strong>ce d’une prise <strong>en</strong> charge ambulatoire.IV.2.4.Le souti<strong>en</strong>Place <strong>des</strong> prochesL’<strong>en</strong>tourage familial était un <strong>des</strong> remparts pour lutter contre la maladie. L’<strong>en</strong>fant et sespar<strong>en</strong>ts y puisai<strong>en</strong>t leurs forces pour supporter le quotidi<strong>en</strong>.Lilou 9 ans : « Ma sœur… elle me disait « Allez pr<strong>en</strong>ds tes médicam<strong>en</strong>ts !Comme ça on sera débarrassé, comme ça on pourra jouer tranquille ! » »87
Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Ma mère elle le voit tout de suite. Après on parle. »« On parle pas souv<strong>en</strong>t de la maladie, on parle pas Très longtemps mais ‘fin voilà çafinit toujours par un câlin et puis le moral qui r’monte. »Liliane 12 ans :« Lili elle me fait tout le temps <strong>des</strong> câlins… »« J’<strong>en</strong> ai tout le temps quand je veux donc… » (À propos du plaisir de voir sesneveux)Maman de Mathilde : « On était très sout<strong>en</strong>u par notre famille, ‘fin tous les jours onavait nos par<strong>en</strong>ts, nos amis… »Maman de Timéo :« On a eu tous nos amis proches, la famille aussi qui ont tout fait pour nousaider »« Sur ses cures il a jamais été seul, ça se relayait tout le temps et c’était pastoujours nous hein ! Ils ont vraim<strong>en</strong>t été très disponibles »Maman de Marie : « J’appelle tous les jours ma mère, c’est mon psy… hein…maman »Papa d’Anthony :« J’avais une cousine, on est très proches, on a pu pas mal discuter… »« Y’a les grands par<strong>en</strong>ts qui ont vraim<strong>en</strong>t été supers, ils ont toujours été prés<strong>en</strong>ts etheureusem<strong>en</strong>t. Sans eux on s’<strong>en</strong> sortait pas. »Une maman évoque sa souffrance de n’avoir pas été plus <strong>en</strong>tourée. Il faut aussi noterque c’est la seule de toutes les familles à être séparée de son mari au mom<strong>en</strong>t de l’étude. Uneséparation qui n’est pas <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec la maladie de son fils.Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’aurais aimé être plus sout<strong>en</strong>ue par ma famille parce que je me suis s<strong>en</strong>tiefortem<strong>en</strong>t abandonnée »« J’aurais aimé que mon père vi<strong>en</strong>ne plus, j’aurais aimé que ma sœur vi<strong>en</strong>ne plussouv<strong>en</strong>t… »« J’aurais aimé ne pas être obligée de les solliciter tout le temps. »88
Les « Copains »L’hôpital était aussi un lieu de r<strong>en</strong>contre. Ils y côtoyai<strong>en</strong>t d’autres <strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong>.Mais le cadre de référ<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants restait les copains d’école, les <strong>en</strong>fants sans lamaladie.Anna 5 ans « J’ai un copain qui s’appelle Sami. Il est pas à l’hôpital, il est pasmalade. »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Des g<strong>en</strong>s… j’les croise. » « On est plutôt ami mais on n’est pascopain comme copain à l’école »Lilou 9 ans : (à l’IHOP) « J’ai pas d’copine. J’<strong>en</strong> avais une mais bon elle estmorte, parce qu’on n’a pas trouvé sa maladie. »Liliane 12 ans : « Ma meilleure amie Carole, j’la vois à l’école… »Les autres par<strong>en</strong>ts Entraide, groupe de par<strong>en</strong>tsMajoritairem<strong>en</strong>t, les par<strong>en</strong>ts interrogés trouvai<strong>en</strong>t du souti<strong>en</strong> <strong>en</strong> s’adressant auxautres par<strong>en</strong>ts frappés par la maladie d’un de leurs <strong>en</strong>fants. Des par<strong>en</strong>ts qui eux seuls,pouvai<strong>en</strong>t compr<strong>en</strong>dre et partager les difficultés traversées.Maman de Mathilde :« Je connais <strong>des</strong> familles qui ont vécu la même chose que nous. »Maman de Lilou :« C’est un univers qui fait souffrir mais qui apporte beaucoup de choses aussi… de ser’voir <strong>en</strong>tre mamans, c’est une grande famille, y’a <strong>des</strong> li<strong>en</strong>s qui se cré<strong>en</strong>t, c’est ununivers… même maint<strong>en</strong>ant j’ai du mal à décrocher »« Vous savez la meilleure psychologie dans ces trucs c’est le réseau de mamans »Maman de Karine :« A Bérard on parle beaucoup avec les g<strong>en</strong>s, déjà les autres par<strong>en</strong>ts ça aidebeaucoup hein… Honnêtem<strong>en</strong>t ça fait office de psy »« On s’appelle, on est ami et on pleure au téléphone mais <strong>des</strong> fois on rigole… »Maman de Juli<strong>en</strong> : « Les mamans <strong>en</strong> tous cas construis<strong>en</strong>t un monde là bas. Ons’connait toute. Y’a cette bulle, malgré tout on s’s<strong>en</strong>t sout<strong>en</strong>u. »89
Papa d’Anthony :« J’aurais eu besoin de plus parler, de poser <strong>des</strong> questions mais pas forcém<strong>en</strong>t à <strong>des</strong>psychologues p’t’être à <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts qui pouvai<strong>en</strong>t mieux me répondre »« J’aurais pu r<strong>en</strong>contrer d’autres par<strong>en</strong>ts qui sont passés par là, qui ont eu lesmêmes peurs, les mêmes angoisses, j’p<strong>en</strong>se que ça aurait pu m’aider… » Un combat solitaireLes par<strong>en</strong>ts de Liliane quant à eux n’ont pas trouvé de réconfort dans l’idée de discuteravec d’autres par<strong>en</strong>ts. L’idée de partager leur vécu, de demander <strong>des</strong> nouvelles d’autres<strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong> n’était ni <strong>en</strong>visageable ni souhaitée « on n’<strong>en</strong> a pas forcém<strong>en</strong>t <strong>en</strong>vie » disaitla maman de Liliane. Cela s’appar<strong>en</strong>tait même pour le papa de Liliane à du « voyeurisme ».Papa de Liliane :« C’est difficile <strong>en</strong>tre par<strong>en</strong>ts d’parler… ça fait un peu du voyeurisme quoi… »« De toutes façons si on est là c’est qu’c’est grave… hein tous, si on est là c’est qu’onest malheureux… »Maman de Liliane :« Les autres mamans elles sont occupées avec leur p’tit bout. »« J’ai beaucoup discuté avec le personnel médical, le personnel para médical…Beaucoup mais pas avec les par<strong>en</strong>ts… c’est très délicat très difficile, très dur. Onpeut pas. Qu’est ce que vous voulez dire ? »« Forcém<strong>en</strong>t elle est là elle a un cancer ! Et quand on voit l’mot cancer on voit mort.J’peux pas parler avec <strong>des</strong> mamans comme ça… Puis si elle se met à pleurer j’pleureavec elle ! »Place <strong>des</strong> professionnelsParfois malgré la « spirale infernale » dans laquelle viv<strong>en</strong>t les par<strong>en</strong>ts certainsévoqu<strong>en</strong>t le souti<strong>en</strong> qu’a pu leur apporter un professionnel de l’écoute, psychologue oupsychiatre.Maman de Lilou :« X. c’était une psychologue qu’on croisait dans les couloirs et <strong>en</strong> fait on faisait notrethérapie dans les couloirs »90
Papa d’Anthony : « J’ai vu <strong>des</strong> psychologues aussi p’t’être 4-5 séances mais j’ai pu<strong>en</strong> parler aussi »Maman de Mathilde : « On a un suivi psychologique quand même. On est suivi parun psychiatre tous les 2, par un psychiatre différ<strong>en</strong>t. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’vois mon médecin généraliste régulièrem<strong>en</strong>t, le psy régulièrem<strong>en</strong>t… »La Maman de Juli<strong>en</strong> proposait même de r<strong>en</strong>forcer le souti<strong>en</strong> psychologique :« Ça a rapport avec un souti<strong>en</strong> psychologique à la maison. Je p<strong>en</strong>se que çaaurait pu être utile… de façon régulière et pour tout le monde »Pour le Papa de Timéo il n’y avait pas de place pour le souti<strong>en</strong> psychologique« J’aurais pas <strong>en</strong>vie qu’il y ait quelqu’un qui s’apitoie ou qui nous souti<strong>en</strong>ne… »IV.3.Conséqu<strong>en</strong>ces de la maladie et <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>tsIV.3.1.La gestion du quotidi<strong>en</strong>Adaptation quotidi<strong>en</strong>nePour les par<strong>en</strong>ts l’organisation du quotidi<strong>en</strong> se faisait au jour le jour. Du fait del’incertitude <strong>des</strong> réactions de leurs <strong>en</strong>fants à la chimiothérapie et de tous les petits grains <strong>des</strong>els qui pouvai<strong>en</strong>t v<strong>en</strong>ir <strong>en</strong>rayer l’<strong>en</strong>gr<strong>en</strong>age <strong>des</strong> <strong>soins</strong> et <strong>des</strong> plannings thérapeutiques ilsn’arrivai<strong>en</strong>t pas à se projeter.Maman de Liliane : « Pour le mom<strong>en</strong>t on est <strong>en</strong> plein dedans, on vit au jour le jour<strong>en</strong> fait. »Maman de Mathilde : « On s’est adapté tous les jours. On s’est adapté,adapté, adapté et puis au final c’est très naturel quoi. »Maman de Marie :(A propos de la poursuite du travail) « Ça va être un peu de l’humour noir mais onnavigue à l’aveugle »91
(Maman de Marie :)« C’est un peu l’incertitude. S’il faut arrêter de nouveau b<strong>en</strong> j’arrêterai d<strong>en</strong>ouveau. »«On vit surtout au quotidi<strong>en</strong> dans l’instant prés<strong>en</strong>t. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« On est collé à ce qu’il se passe tous les jours, c’est un jour après l’autre quoi, c’esttout le temps comme ça. » « Au jour le jour… »Une certaine normalitéCep<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong> s’intégrai<strong>en</strong>t rapidem<strong>en</strong>t dans la vie quotidi<strong>en</strong>ne au point qu’il sedégageait de cette vie là une pseudo « normalité » pour les <strong>en</strong>fants comme pour les par<strong>en</strong>ts. Dans les actes de la vie quotidi<strong>en</strong>neLiliane 12 ans : « J’jouais à la wii… à Mario Kart. »Lilou 9 ans : « J’jouais à l’ordi, j’jouais à la DS, j’jouais dans ma chambre, jeregardais les photos de mon frère… »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « J’y p<strong>en</strong>se pas trop quand je suis chez papa. »Timéo 12 ans :« J’trouve que c’est juste que je pr<strong>en</strong>ds <strong>des</strong> médicam<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> plus sinon c’estnormal. »« On fait les mêmes choses. »Maman de Timéo :(A propos <strong>des</strong> <strong>soins</strong>) « Ça r<strong>en</strong>tre dans la routine, dans le quotidi<strong>en</strong> »« On a essayé de rester le plus possible comme avant (…) de ri<strong>en</strong> changer. »Maman de Juli<strong>en</strong> : « La maladie elle est là de toute façon. C’est dev<strong>en</strong>u lequotidi<strong>en</strong>. »Maman de Karine : « Elle était avec nous, elle rigolait… on m<strong>en</strong>ait une vie …presque normale » Avec la fratrieLilou 9 ans : « Des fois on s’dit <strong>des</strong> gros mots <strong>en</strong>tre nous. »92
Juli<strong>en</strong> 12 ans : « On se dispute sur un autre sujet… y’a <strong>des</strong> mom<strong>en</strong>ts… il m’énerve unpeu »Timéo 12 ans : (les disputes) « Ouais ça continue quand même. »Marie 6 ans : « Des fois on est g<strong>en</strong>til tous les deux… on joue. Des fois ons’<strong>en</strong>gueule. »Concernant la fratrie, l’avis <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants n’est pas tout à fait celui <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts. Les<strong>en</strong>fants n’ont pas remarqué de différ<strong>en</strong>ce dans les relations qu’ils <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t avecleur frère et sœur, les jeux et les disputes « ça continue quand même ». Les par<strong>en</strong>ts trouv<strong>en</strong>tque les relations évolu<strong>en</strong>t. En effet du fait de la maladie leur att<strong>en</strong>tion est souv<strong>en</strong>t focaliséesur l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong> traitem<strong>en</strong>t. Par manque de disponibilité ils peuv<strong>en</strong>t arriver éprouver <strong>des</strong>difficultés à jouer leur rôle protecteur à l’égard de leurs autres <strong>en</strong>fants (26) . Cette« néglig<strong>en</strong>ce » forcée est souv<strong>en</strong>t source de souffrance pour la fratrie d’où l’apparition d’unecertaine « jalousie ».Maman de Marie :« C’est très difficile puis surtout c’est très lourd par rapport à ses frères »« C’est pareil <strong>des</strong> fois y’a <strong>des</strong> jalousies »Maman de Juli<strong>en</strong> : « On fait très att<strong>en</strong>tion après à ne pas oublier les deuxautres. »Maladie omniprés<strong>en</strong>te… Une vie c<strong>en</strong>trée sur l’<strong>en</strong>fant maladeCep<strong>en</strong>dant malgré cette impression de normalité routinière, la famille est bi<strong>en</strong>plongée dans l’univers de la maladie. La confrontation est quotidi<strong>en</strong>ne.Anna 5 ans : (Dans la chambre) « Tu vois j’ai une pompe ici. »Juli<strong>en</strong> 12 ans : Même le quotidi<strong>en</strong> il change il devi<strong>en</strong>t pas quotidi<strong>en</strong> ».Marie 6 ans : « J’ai une pré canne, c’est une canne mais à deux roulettes. »Maman de Liliane : « On vit que pour elle, je vis pour elle depuis 4 mois. »Maman de Timéo : « On réfléchit plus on est dedans, on fait ce qu’il y a àfaire. »Maman de Marie : « Tout tourne beaucoup autour d’elle. »93
Maman de Juli<strong>en</strong> :« On fait c’qu’il faut d’abord autour de lui et pour lui. »« Ma vie et la vie au quotidi<strong>en</strong> elle fonctionne autour d’un <strong>en</strong>fant qui s’appelleJuli<strong>en</strong>. »Papa d’Anthony : « A la maison c’était pas évid<strong>en</strong>t de voir Anthony avec saleucémie… C’était difficile. »« C’est une autre vie, y’a tous nos repères qui chang<strong>en</strong>t. »« Y reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose quoi. »IV.3.2.Conséqu<strong>en</strong>ces PhysiquesLa « maladie » visiblePour certains <strong>en</strong>fants ce n’est pas tant la maladie que les <strong>soins</strong> qui les ont fait ses<strong>en</strong>tir physiquem<strong>en</strong>t malade.Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Ils m’ont dit les médecins avant la première chimio : « C’est simple on tesoigne <strong>en</strong> te r<strong>en</strong>dant malade » »« J’allais très bi<strong>en</strong>… y’avait pas d’problème du tout » « L’cancer <strong>en</strong> fait j’le s<strong>en</strong>spas. »« J’avais un peu de mal à manger. »Liliane 12 ans :« Quand j’ai les chimios <strong>en</strong> général j’suis pas très bi<strong>en</strong>. J’ai mal au v<strong>en</strong>tre, j’ai <strong>des</strong>bouffées de chaleur… »« C’est un mal de v<strong>en</strong>tre qui peut pas s’soigner »« J’ai pleuré, mes cheveux c’est ce que j’aimais le plus… »« J’me r<strong>en</strong>d pas compte <strong>en</strong> fait que j’ai un cancer »« J’<strong>en</strong> ai marre de mon physique »Anna 5 ans :« Quand j’ai pris… ma chimio… j’ai vomi… ça m’a embêté. »(La perte de cheveux) « Avant j’avais très très peur… puis maint<strong>en</strong>ant çacomm<strong>en</strong>ce à repousser. »« J’avais peur qu’ils se perdus… qu’ils tomb<strong>en</strong>t. »94
Lilou 9 ans : « J’étais beaucoup fatiguée »Marie 6 ans :« Quand j’avais ma chimio carboplatine, ça m’changeait les goûts et les frites ilsétai<strong>en</strong>t trop salées. »« L’autre jour y’a une carboplatine, j’vomissais dans la voiture. »Timéo 12 ans :« J’étais pas très bi<strong>en</strong>, j’perdais souv<strong>en</strong>t les goûts. »« C’est p<strong>en</strong>dant les chimios que je suis pas très bi<strong>en</strong>. »Anthony 4 ans : « Quand z’étais grand z’allais dans la poussette… Des fois ze suisfatigué quand ze suis dehors et ze veux aller dehors… »Maman de Liliane :C’est les chimios qui la foutai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> l’air. »« On l’a r<strong>en</strong>due malade ma fille. »Maman de Marie : « C’est quand même très fatiguant, chute de cheveux… <strong>en</strong>fin ellea tout eu… rapidem<strong>en</strong>t. »Altération de l’image corporelleLa maladie était souv<strong>en</strong>t assez sil<strong>en</strong>cieuse « j’me r<strong>en</strong>ds pas compte que j’ai uncancer » me disait Liliane, « J’allais très bi<strong>en</strong> » m’expliquait Juli<strong>en</strong>. Et pourtant lestraitem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>laidiss<strong>en</strong>t considérablem<strong>en</strong>t. Que ce soit l’alopécie, ce que les <strong>en</strong>fantsévoqu<strong>en</strong>t le plus, être « chauve », « crâne nu » ou les modifications de l’image corporelle. Ilssouffr<strong>en</strong>t de ces changem<strong>en</strong>ts.Liliane 12 ans :« «Ma perte de cheveux »« J’ai pleuré, mes cheveux c’est ce que j’aimais le plus. »« J’suis plus grosse » « Le visage aussi j’suis toute gonflée »« C’est l’poids qui m’embête. J’suis essoufflée comme un bœuf. »Anna 5 ans :« Avant j’avais très très peur… et puis maint<strong>en</strong>ant ça comm<strong>en</strong>ce à repousser. »Lilou 9 ans :« Y’a un médicam<strong>en</strong>t où j’faisais comme ça et j’avais les cheveux quitombai<strong>en</strong>t… »95
(Lilou 9 ans :)« On a appelé une coiffeuse de l’hôpital et elle m’a rasé toute la tête. »« Mais j’avais mis la casquette »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « J’voulais pas qu’on m’mette une plaque, j’voulais resternormal. »Même le regard d’une <strong>des</strong> mamans est modifié par la maladie… La maman de Lilianeemploie d’ailleurs <strong>des</strong> mots d’une rare viol<strong>en</strong>ce pour caractériser sa fille, « un boudin » « unmonstre »… Derrière ce terme il faut probablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trevoir la colère et l’incompréh<strong>en</strong>sionqui l’anim<strong>en</strong>t face à la maladie de sa fille.Maman de Liliane :« Au mois d’septembre elle était magnifique et puis d’un coup on dirait unboudin ! »« Là elle est bouffie quoi, elle est pleine d’eau. »« On l’a transformée <strong>en</strong> un monstre <strong>en</strong> deux jours !! Une tête comme ça ! »IV.3.3.Conséqu<strong>en</strong>ces socialesSocialisation de l’<strong>en</strong>fantQue ce soit pour les <strong>en</strong>fants comme pour leurs par<strong>en</strong>ts l’intégration dans lasociété est modifiée par la maladie. Comme le résume si bi<strong>en</strong> Juli<strong>en</strong> « y’a plein de choses quichang<strong>en</strong>t. »Mme Balande, professeur <strong>des</strong> écoles <strong>en</strong> service d’oncopédiatrie, rappelle ce besoin <strong>des</strong>ocialisation de l’<strong>en</strong>fant « Un <strong>en</strong>fant malade est avant tout un <strong>en</strong>fant qui a besoin de rire,de jouer, de travailler, de partager avec les autres » (27) . Pour les <strong>en</strong>fants tout est mis <strong>en</strong>œuvre pour qu’ils puiss<strong>en</strong>t conserver un semblant de scolarité normale, c'est-à-dire <strong>des</strong>projets d’av<strong>en</strong>ir, à leur échelle.96
Adaptation de la scolaritéJuli<strong>en</strong> 12 ans :« Ma scolarité j’l’a poursuis normalem<strong>en</strong>t mais pas vraim<strong>en</strong>t. »« J’suis pas souv<strong>en</strong>t à l’école. »Lilou 9 ans :« J’disais à Papa « mais j’ai <strong>en</strong>vie d’aller à l’école !!! » »Marie 6 ans :« A mon école b<strong>en</strong> la maîtresse elle m’a appris la machine de Perkins. »Anthony 4 ans :« J’y vais plus… maint<strong>en</strong>ant (…) parce que euh ils ont attrapé une maladie… B<strong>en</strong>parce que faut pas qu’z’ai le même rhume que eux. »Timéo 12 ans :« J’étais plus fatigué. J’y allais moins souv<strong>en</strong>t (…) je privilégiais le français et lesmaths »Maman de Timéo :« Des fois il n’y allait pas de la semaine mais il rattrapait »« Il y est allé <strong>en</strong> pointillé suivant son état, un peu à la carte. »« Il y a <strong>des</strong> profs qui se sont spontaném<strong>en</strong>t proposés pour v<strong>en</strong>ir à la maison (…) leSAPAD a été mis <strong>en</strong> place. »Maman de Lilou : « Elle a redoublé le CE1 p<strong>en</strong>dant l’hôpital <strong>en</strong> fait. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’ai informé le collège et on avait mis <strong>en</strong> place le SAPAD »« On a essayé de scolariser Juli<strong>en</strong> au maximum de ce qu’il pouvait et ça a étévraim<strong>en</strong>t très très peu. »« On a t<strong>en</strong>té de maint<strong>en</strong>ir à <strong>domicile</strong> et par mois les maths, le français, l’histoire géo,le latin et l’anglais, donc y’a 3 heures de cours par semaine. »Papa de Liliane :« Elle va à l’école quand elle veut, quand elle se s<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>… que pour les matièresprincipales pour lui faire <strong>des</strong> journées plus courtes.»Maman de Mathilde :« L’école c’était pas la priorité. »« Elle a recomm<strong>en</strong>cé à y aller <strong>en</strong> notre prés<strong>en</strong>ce. »« Elle a fait sa r<strong>en</strong>trée au CP toute seule. »97
L’école à <strong>domicile</strong>Parfois pour palier la fatigue <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts, quand les <strong>en</strong>fants ne pouvai<strong>en</strong>t pas allerà l’école, l’école se déplaçait à <strong>domicile</strong>…Anna 5 ans : « X. elle est v<strong>en</strong>ue travailler avec moi… ma maitresse d’école… à lamaison. »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Des profs qui v’nai<strong>en</strong>t à la maison. » « Une demande de SAPAD… »Timéo 12 ans :« Maint<strong>en</strong>ant ils continu<strong>en</strong>t à v<strong>en</strong>ir … »« Ils vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t quand je peux, ils me font les cours que j’ai loupés… »Lutte contre l’isolem<strong>en</strong>tSans école et sans contact avec l’extérieur, les journées paraissai<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>longues lorsque les <strong>en</strong>fants étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> aplasie et confinés à <strong>domicile</strong>. Certaines famillesavai<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong> place <strong>des</strong> stratagèmes pour t<strong>en</strong>ter de limiter cet isolem<strong>en</strong>t.Lilou 9 ans :« Y’avait personne. Y’avait que la maitresse et machin… »« J’étais toute seule et je m’<strong>en</strong>nuyais toute seule. »Anthony 4 ans : « La maitresse X. elle me manque beaucoup hein... »Maman de Lilou :« C’était très dur, elle <strong>en</strong> était arrivée à pr<strong>en</strong>dre son masque et se mettre dans lavoiture et qu’on aille voir et am<strong>en</strong>er Laure, qu’elle reste cachée dans la voiture justepour voir les copains devant elle. » « C’est trop dur… c’est c’t’isolem<strong>en</strong>t quoi… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Il fait partie du conseil municipal d’<strong>en</strong>fants, il est sollicité un samedi toutes les troissemaines. »« Non il n’est pas désintégré, socialem<strong>en</strong>t parlant il est <strong>en</strong>core dans le réseaucomme on dit. »98
Papa d’Anthony :(À propos <strong>des</strong> visites) « Il ne pouvait pas <strong>en</strong> recevoir tout le temps dans sespério<strong>des</strong> d’aplasie… Les relations avec les g<strong>en</strong>s sont dev<strong>en</strong>ues un petit peu pluscompliquées »« C’était très difficile, c’est une épreuve de plus on avait l’habitude de voir <strong>des</strong> amis,de voir d’la famille et puis finalem<strong>en</strong>t du jour au l<strong>en</strong>demain c’est fini. »Modifications relationnellesLa socialisation <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants est importante pour eux d’autant plus qu’ils s’approch<strong>en</strong>tde l’adolesc<strong>en</strong>ce. L’appart<strong>en</strong>ance au groupe et le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’intégration sont marqués. Les<strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong> et physiquem<strong>en</strong>t transformés par les traitem<strong>en</strong>ts se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ts si bi<strong>en</strong>qu’ils vont jusqu’à rejeter les marques d’att<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> autres élèves. « Il les a refusées » medisait la maman de Juli<strong>en</strong>, « Je veux pas qu’ils me considèr<strong>en</strong>t comme un <strong>en</strong>fant pas normal. » Maladie comme pot<strong>en</strong>tialisateur de l’att<strong>en</strong>tionLa maladie va avoir un impact sur les relations de l’<strong>en</strong>fant avec ses pairs. Pour Juli<strong>en</strong>« C’est mieux » parce que les copains « s’intéress<strong>en</strong>t PLUS à moi qu’avant. ». Elle va parfoisles faire dev<strong>en</strong>ir le nouveau c<strong>en</strong>tre d’intérêt <strong>des</strong> copains : « On s’intéresse à mon cas »expliquait Liliane.Liliane 12 ans :« Depuis que j’suis malade tout le monde m’aime bi<strong>en</strong>. »« Des g<strong>en</strong>s d’ma classe qui m’captai<strong>en</strong>t pas dès que j’revi<strong>en</strong>s ils sont tous surmoi ! »« J’trouve qu’on porte plus d’att<strong>en</strong>tion sur moi. »« J’aime bi<strong>en</strong> j’suis le c<strong>en</strong>tre du monde comme on dit. »Lilou 9 ans :« Quand j’étais à l’hôpital TOUS les <strong>en</strong>fants de la classe ont fait <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins… j’ai eupleins de souv<strong>en</strong>irs. » S<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de mise à l’écartSi certains copains de l’école se rapproch<strong>en</strong>t ce n’est pas forcém<strong>en</strong>t le cas de tous ni<strong>des</strong> frères et sœurs. Les relations évolu<strong>en</strong>t « Je sais que vraim<strong>en</strong>t elles ont changé ça c’est99
sur… » expliquait Juli<strong>en</strong>. Ces derniers sont souv<strong>en</strong>t au mieux indiffér<strong>en</strong>ts voire espac<strong>en</strong>t lesvisites et s’éloign<strong>en</strong>t « Y’<strong>en</strong> a qui s’éloign<strong>en</strong>t ». « Ils ont peur » me disait Liliane.Liliane 12 ans :(À propos <strong>des</strong> frères et sœurs) « Y’<strong>en</strong> a un qui vi<strong>en</strong>t pratiquem<strong>en</strong>t plus mevoir… l’autre… il veut pas v<strong>en</strong>ir tout seul. Du coup il vi<strong>en</strong>t pratiquem<strong>en</strong>t jamais. »(À propos <strong>des</strong> copains) « Sont cons de s’éloigner comme ça parce que j’suis pas unali<strong>en</strong>… »« C’est <strong>des</strong> garçons, ils sont pas courageux. »Juli<strong>en</strong> 12 ans :(A propos de son frère) « J’trouve qu’il se fiche pas mal <strong>en</strong> fait de c’que j’ai… »« J’préfère qu’il soit faible et qu’il me montre quand même… »Ces attitu<strong>des</strong> vécues comme un manque d’intérêt par l’<strong>en</strong>fant malade, au c<strong>en</strong>trede l’att<strong>en</strong>tion depuis le début <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts, peuv<strong>en</strong>t refléter une t<strong>en</strong>tative de protectionde la part <strong>des</strong> frères et sœurs ou <strong>des</strong> amis pour limiter leur souffrance et leurs angoisses.En effet les relations fraternelles sont colorées par <strong>des</strong> s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts int<strong>en</strong>ses et complexes oùcoexist<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t affection, admiration, compétition, jalousie, <strong>en</strong>vie, hostilité…Souv<strong>en</strong>t pourse protéger la fratrie met <strong>en</strong> place <strong>des</strong> mécanismes de déf<strong>en</strong>ses comme une atténuation voireune ret<strong>en</strong>ue de tous mouvem<strong>en</strong>ts affectifs ambival<strong>en</strong>ts (protection, rivalité…). (26)L’épreuve du regard <strong>des</strong> autresLe regard <strong>des</strong> inconnus vi<strong>en</strong>t s’ajouter à la modification <strong>des</strong> relations avec les proches<strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Il n’est déjà pas facile d’être malade mais il faut <strong>en</strong> plus supporter que le regard<strong>des</strong> inconnus le rappelle constamm<strong>en</strong>t. « Elle m’fixait comme si j’étais un ali<strong>en</strong>… »Liliane 12 ans :« A Paris tout le monde s’<strong>en</strong> fou. Ils doiv<strong>en</strong>t p’t’être avoir l’habitude <strong>des</strong> personnescrâne nu. »« Quand j’étais <strong>en</strong> bandana à l’ophtalmo y’avait une vielle qui m’regardait avec <strong>des</strong>yeux comme ça ! »100
(Liliane 12 ans :)« Au collège… quand j’étais <strong>en</strong> aplasie j’y suis allée avec un masque, j’ai mis uneécharpe pour pas qu’il se voit… y’a pleins de g<strong>en</strong>s qui m’regardai<strong>en</strong>t comme si j’étaisun ali<strong>en</strong>… »Lilou 9 ans :« J’avais ma sonde <strong>en</strong>core à l’école, ils m’ont posé <strong>des</strong> questions « pourquoi tu faisci ? Pourquoi t’as ça ? » »« Un copain à ma sœur dans sa classe qui avait dit « Ah c’est qui elle, elle estmoche ! » »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Quand j’suis allé à l’école … que j’avais plus de cheveux, j’avais gardé macasquette <strong>en</strong> classe et j’pouvais pas éviter les questions de « Pourquoi tu gar<strong>des</strong> tacasquette ? » »Maman de Liliane : (A propos de la perte de cheveux) « … puis surtout leregard <strong>des</strong> autres quoi. Ah ça c’était terrible quoi « qu’est ce qu’ils vont dire ? » »Maman de Mathilde :« Quand on va chercher son pain et que notre fille elle recomm<strong>en</strong>ce à marcher b<strong>en</strong>les g<strong>en</strong>s ils nous regard<strong>en</strong>t bizarre d’un air de dire b<strong>en</strong> on nous a dit qu’elle étaitcondamnée maint<strong>en</strong>ant elle marche… <strong>des</strong> regards très blessants. »Aménagem<strong>en</strong>ts professionnelsDu fait de la maladie, les par<strong>en</strong>ts ont vu leur carrière professionnelle bouleversée.Un <strong>des</strong> deux par<strong>en</strong>ts, très souv<strong>en</strong>t la mère, bénéficiait du « congé de prés<strong>en</strong>ce par<strong>en</strong>tale » etavait stoppé son activité professionnelle pour se consacrer à son <strong>en</strong>fant. Plus parobligation que par choix, le père devait souv<strong>en</strong>t continuer à travailler pour subv<strong>en</strong>ir auxbe<strong>soins</strong> financiers du foyer. « Il fallait bi<strong>en</strong> qu’il y <strong>en</strong> ait un qui continue à travailler. »expliquait le Papa de Liliane, « On a fait le relais » (maman de Lilou).Maman de Liliane :« J’suis <strong>en</strong> arrêt. Les filles m’ont jeté du service. »« Depuis l’début j’aurais pas pu, travailler c’est pas possible… »Papa de Karine : « Avec le recul j’aurais dû arrêter quand elle a eu sa maladie »« Au travail, on travaille pas on cogite tout le temps101
Maman de Mathilde :« On s’est arrêté de travailler tous les deux… On a mis notre vie professionnelle <strong>en</strong>susp<strong>en</strong>s. »Maman de Timéo :« J’donne <strong>des</strong> cours de piano à la maison c’est un peu comme ça… comme jepeux. »Maman de Lilou :« J’ai été arrêté dès le départ, moi ça c’est sur parce que la fonction publiquec’était très facile. »« Après la réa <strong>en</strong> janvier 2011 mon mari s’est un peu effondré donc lui arrêté pour sereposer et moi j’ai repris le travail »Maman de Marie :« Vous connaissez le congé de prés<strong>en</strong>ce par<strong>en</strong>tale ? Du coup j’ai pris quatorze mois àla suite de mon congé maternité »« Puis on a trouvé un équilibre à repr<strong>en</strong>dre à mi temps. Au niveau social j’avaisbesoin de tout ça. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’suis <strong>en</strong> arrêt maladie depuis le mois de mai. Ça s’est imposé à moi tel quel.J’étais prête à démissionner. »Papa d’Anthony :« J’suis resté aux 35 heures par semaine. »« T’façon financièrem<strong>en</strong>t il fallait qu’il y <strong>en</strong> ait un <strong>des</strong> deux qui reste au boulot »Une charge financièreCette occurr<strong>en</strong>ce est apparue dès mon premier <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> alors qu’elle n’avait pas étéintégrée initialem<strong>en</strong>t dans le guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Le guide <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts a donc évolué et j’airajouté cet item de relance après mon deuxième <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.Dure réalité que la question financière qui vi<strong>en</strong>t s’ajouter à la maladie de son<strong>en</strong>fant. La situation économique du foyer est souv<strong>en</strong>t modifiée p<strong>en</strong>dant la maladie, allantparfois jusqu’à créer de réelles difficultés financières explique le Dr Opp<strong>en</strong>heim dans sonlivre « Là bas, la vie. » (28). Si certains par<strong>en</strong>ts ont fait le choix de s’arrêter pour d’autres iln’<strong>en</strong> était pas question parce que « financièrem<strong>en</strong>t » ce n’était pas <strong>en</strong>visageable. La maladie<strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> frais ne serait ce que ceux liés au traitem<strong>en</strong>t : les nombreux déplacem<strong>en</strong>ts, <strong>des</strong>102
achats supplém<strong>en</strong>taires pour l’<strong>en</strong>fant, certains frais médicaux « La maison <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts ça a uncoût hein ! » me disait la maman de Liliane. Et puis malgré la maladie la vie continue, lesai<strong>des</strong> sont là mais ne comp<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t pas un salaire « après c’est <strong>des</strong> c<strong>en</strong>taines d’euros quidéfil<strong>en</strong>t au fil <strong>des</strong> mois »…Une étude réalisée <strong>en</strong> Suède <strong>en</strong>tre 2002 et 2004 auprès de par<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>fants atteints decancer retrouve bi<strong>en</strong> cet impact à court et long termes au niveau de la carrière professionnellemais aussi <strong>des</strong> rev<strong>en</strong>us (29) . Alors certains par<strong>en</strong>ts se font aider par <strong>des</strong> proches, d’autrescherch<strong>en</strong>t <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de récolter <strong>des</strong> fonds « On a eu l’idée de créer l’association » « unegrande chance » m’avouait la maman de Mathilde. Mais quoiqu’il <strong>en</strong> coûte les mamansétai<strong>en</strong>t d’accord sur le fait que la perte de rev<strong>en</strong>us n’était pas « une barrière » à leur choixd’arrêter de travailler.Maman de Liliane :« J’sais bi<strong>en</strong> que c’est un coût financier mais bon j’fais appel à tout le monde.Financièrem<strong>en</strong>t mes par<strong>en</strong>ts ils aid<strong>en</strong>t. »Maman de Mathilde :« Par rapport à la maison j’ai demandé un av<strong>en</strong>ant, on a réduit nos échéances c’quinous prolonge <strong>en</strong> même temps j’m’<strong>en</strong> fou… »« On a été <strong>en</strong>touré financièrem<strong>en</strong>t. »« L’association pour Mathilde qui nous a permis de voyager sans qu’on ait àtoucher à nos économies. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’roule plus sur l’or non plus. »IV.3.4.La maladie punition« Moi j’voudrais bi<strong>en</strong> être comme ma sœur, pas être malade » me disait Lilou audétour d’un jeu. Pourtant la maladie est souv<strong>en</strong>t considérée par les <strong>en</strong>fants comme unchâtim<strong>en</strong>t mérité. Ils croi<strong>en</strong>t que c’est une punition pour <strong>des</strong> mauvaises p<strong>en</strong>sées qu’ilsaurai<strong>en</strong>t pu avoir <strong>en</strong>vers leurs par<strong>en</strong>ts ou leur frère et sœur… C’est pourquoi commel’explique le Pr Rufo « ils ont t<strong>en</strong>dance à accepter ce qui leur arrive comme un juste châtim<strong>en</strong>tet à ne pas se révolter ». Les <strong>en</strong>fants font donc de « trop bons mala<strong>des</strong>, résignés… » (20) .103
La résignation <strong>des</strong> <strong>en</strong>fantsJuli<strong>en</strong> 12 ans :« T’façon au bout d’un mom<strong>en</strong>t tu finis par t’habituer »(À propos d’un nerf sectionné) « C’est comme ça ils ont dit qu’ça r’poussait, bond’accord, 2, 3 ans, faudra ENCORE être pati<strong>en</strong>t mais bon c’est pas bi<strong>en</strong> grave. »Timéo 12 ans :(À propos <strong>des</strong> chimiothérapies) « T’façon dans les deux cas j’les avais… »« J’me suis habitué. »Maman de Liliane :« Elle suit. Elle a jamais gueulé. Elle subit, elle sait, elle connait, elle s’pose pas dequestions… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Juli<strong>en</strong> il avait bi<strong>en</strong> intégré parce que le traitem<strong>en</strong>t a pas été simple et il nous disait« J’ai pas le choix ! Si j’le fais pas je meurs. » »Les limitations au quotidi<strong>en</strong> Les jeux, les activitésLes limitations <strong>des</strong> activités du quotidi<strong>en</strong> et du sport sont un vécu douloureux pourtous les <strong>en</strong>fants. « Il a pas le droit de ri<strong>en</strong> faire ! » m’expliquait Anthony du haut de sesquatre ans, résumant bi<strong>en</strong> l’état de fatigue et d’isolem<strong>en</strong>t dans lequel sont confinés les<strong>en</strong>fants <strong>en</strong> traitem<strong>en</strong>t. « Si j’sors j’risque d’attraper quelque chose » l’aplasie limite lessorties et les consignes médicales les <strong>en</strong>cadr<strong>en</strong>t « je dois mettre un masque ». L’<strong>en</strong>fant vit savie comme s’il était emprisonné dans sa maison, « j’suis clouée à la maison » …Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Avant qu’on m’traite j’allais à l’école j’faisais du sport »« Ça fait tout de même neuf mois qu’j’ai pas touché un ballon de foot !! »« J’peux pas faire de sport, j’vais pas à l’école, j’vois pas mes copains… »Liliane 12 ans :« J’peux pas m’prom<strong>en</strong>er, j’peux pas faire du vélo, j’peux pas… du patin à glace, duski, j’peux plus ri<strong>en</strong> faire ! »« Y’a pleins de choses que j’peux plus faire et j’suis clouée à la maison tout le temps »104
Anna 5 ans :« Pas beaucoup mais j’ai le droit d’aller au gros parc où on fait de la trottinette…je dois mettre un masque. »Anthony 4 ans :« Dans l’hôpital ils nous branch<strong>en</strong>t là on n’a pas le droit de sortir »« Parce que c’est trop dangereux la moto ou le vélo aussi. Il risque de tomber c’estsurtout ça. »« Il peut pas zouer… vu que c’est sur sa main. » (A propos de la perfusion)Lilou 9 ans :« J’avais ma perf, j’pouvais plus aller dehors. »« J’étais obligée de rester dedans. »« Eux ils étai<strong>en</strong>t à la piscine moi j’avais <strong>en</strong>vie d’y aller, j’avais pas le droit. »« Des fois j’vais dehors mais pas longtemps, il faut que je mette un masque. »Timéo 12 ans : « J’faisais pas parce que j’arrivais pas bi<strong>en</strong> à marcher. »Maman de Liliane :« Avec un balafre comme ça sur la tête, avec les massues la GR j’ai dit laissetomber »« Physiquem<strong>en</strong>t elle pouvait plus, elle était essoufflée. »« Elle a plus pu puis même elle avait honte, ses cheveux tout ça elle perdait… »« Dès qu’elle monte l’escalier elle souffle comme un bœuf ! »Parfois même l’<strong>en</strong>fant était tellem<strong>en</strong>t limité dans ses activités quotidi<strong>en</strong>nes que cela<strong>en</strong>trainait une dép<strong>en</strong>dance vis-à-vis de ses par<strong>en</strong>ts.Lilou 9 ans : « J’pouvais pas monter toute seule avec ma perfusion… fallait quej’appelle papa, maman… » Contraintes alim<strong>en</strong>tairesP<strong>en</strong>dant les pério<strong>des</strong> d’aplasies les contraintes s’ét<strong>en</strong>dait mêmes à l’alim<strong>en</strong>tation. Les<strong>en</strong>fants devai<strong>en</strong>t avoir une alim<strong>en</strong>tation protégée, donc <strong>en</strong>core une fois <strong>en</strong>cadrée par <strong>des</strong>protocoles médicaux. Donc pour certains tous les alim<strong>en</strong>ts n’étai<strong>en</strong>t pas autorisés, pourd’autres tous n’étai<strong>en</strong>t pas tolérés.105
Lilou 9 ans :« J’avais pleins de trucs que j’avais pas le droit. »« Ce qu’ils me donnai<strong>en</strong>t le soir là pour manger b<strong>en</strong> c’était dégueulasse. »« C’était toujours la même chose. »Anna 5 ans :« J’ai le droit de manger du riz, <strong>des</strong> pates… <strong>des</strong> frites… quand j’suis <strong>en</strong>protégés… c’est pas drôle hein… »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Le matin j’mange pas, le midi j’mange… <strong>des</strong> pates… le soir la bouche elleest complètem<strong>en</strong>t normale donc je peux manger c’que j’veux. »IV.3.5.Les bénéfices secondairesLa maladie, les traitem<strong>en</strong>ts sont source de nombreux désagrém<strong>en</strong>ts. Pourtant à causede sa maladie, <strong>des</strong> exam<strong>en</strong>s et <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts qu’il va subir, cet <strong>en</strong>fant va bénéficier de plusd’att<strong>en</strong>tion de la part de ses par<strong>en</strong>ts. Le professeur Rufo dans son livre « Œdipe toi-même »confirme bi<strong>en</strong> l’hypothèse que l’<strong>en</strong>fant se s<strong>en</strong>t responsable de la maladie qui le frappe, qui estvécue comme un châtim<strong>en</strong>t pour avoir eu de mauvaises p<strong>en</strong>sées. Il va cep<strong>en</strong>dant <strong>en</strong> tirer <strong>des</strong>bénéfices, notamm<strong>en</strong>t l’att<strong>en</strong>tion constante de ses par<strong>en</strong>ts (20) . Une surprotection quis’accompagne bi<strong>en</strong> souv<strong>en</strong>t de « récomp<strong>en</strong>ses » matérielles. Les cadeaux et les marquesd’att<strong>en</strong>tion fus<strong>en</strong>t aussi de la part <strong>des</strong> proches. Bi<strong>en</strong> que la maladie soit une sorte de punitionpour l’<strong>en</strong>fant « l’cancer c’est pas positif » expliquait Juli<strong>en</strong>, « Ma leucémie elle m’énerve !! »me disait <strong>en</strong>core Anna, ils compt<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> profiter <strong>des</strong> avantages indéniables qu’elle leurapporte. « Quand même j’me dis avec tout c’que j’ai pourquoi pas ! » argum<strong>en</strong>tait Juli<strong>en</strong>pour justifier les avantages qu’il obt<strong>en</strong>ait par rapport à ses frères.Il n’<strong>en</strong> nait pas moins un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de culpabilité « J’trouve qu’<strong>en</strong> fait j’<strong>en</strong> profite(…) je suis pas très g<strong>en</strong>til. ». Les par<strong>en</strong>ts sont consci<strong>en</strong>ts du déséquilibre qui s’installe <strong>en</strong>trel’att<strong>en</strong>tion donnée à l’<strong>en</strong>fant malade et ses frères et sœurs. « On est quand même vigilants »me disai<strong>en</strong>t-ils « c’est pas une <strong>en</strong>fant unique non plus ». Bi<strong>en</strong> que leur <strong>en</strong>fant soit« coocouné » ils expliqu<strong>en</strong>t qu’il faut « trouver un équilibre ».106
Les mom<strong>en</strong>ts d’exceptionsJuli<strong>en</strong> 12 ans :« On a une association avec qui on va faire un voyage <strong>en</strong> Italie… ça c’est le cotéchanceux. »Marie 6 ans :« Même que moi j’ai r<strong>en</strong>contré Grégoire dans sa loge »« Y’a <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants qui ont <strong>des</strong> maladies graves qui peuv<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>contrer <strong>des</strong> acteurs ettout… »Maman de Liliane :(Pour la protonthérapie) « On est au cœur de Paris pour Liliane c’est génial. Là ellepart <strong>en</strong> vacances quoi… »Maman de Mathilde : « On était avec elle on travaillait plus… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Y’a une assoc’ qui va nous payer un voyage à Rome. Et puis j’t’ai promisLondres… Promis, promis ! J’lui ai promis le Macchu Picchu, mais ça c’est pas pourtout de suite. »Les cadeauxVoiture, livres, CD, DVD, les cadeaux étai<strong>en</strong>t nombreux. Les <strong>en</strong>fants ne les mettai<strong>en</strong>tpas forcém<strong>en</strong>t <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec leur maladie. Anthony n’hésitait d’ailleurs pas à me réclamer unplaymobile partant du principe qu’il avait participé donc que c’était acquis pour lui « C’estlequel que ze vais pr<strong>en</strong>dre de truc pour aller Ses moi ? »Anthony 4 ans :« Z’ai eu une cars » « Z ‘ai eu un livre de Toy story » (après les <strong>soins</strong> à l’hôpital)« Il m’a apporté un DVD de Sam. »Anna 5 ans : « maman elle a apporté de nouvelles histoires. »Lilou 9 ans : (à propos <strong>des</strong> grands par<strong>en</strong>ts) « Ils ont pleins de chose à donner, plein dechoses à raconter »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« J’suis favorisé donc quand j’demande <strong>des</strong> jeux b<strong>en</strong> j’les ai plus vite. »« C’est g<strong>en</strong>re cadeau… pour ton courage <strong>en</strong> quelque sorte. »107
Maman de Liliane :« Elle a eu un noël, elle a été gâtée pourrie. »« Tout c’qu’elle veut elle a quoi. J’veux dire j’lésine pas. Elle le sait Après bi<strong>en</strong> sûrqu’une fois guérie ça va se calmer mais là … je peux Pas ! »Maman de Mathilde : « On lui achetait toujours <strong>des</strong> choses et c’est ce qu’ellevoulait… Elle savait tirer parti de la maladie aussi comme une petite fille de six ans. »Maman de Marie : « Quelque part pour faire accepter les hospitalisations,Marie elle a <strong>des</strong> cadeaux »Les avantages par rapport à la fratrieLilou 9 ans :« J’ai d’la chance parce que j’allais pas à l’école »« J’allais pas <strong>en</strong> courses parce que j’étais pas bi<strong>en</strong>… ça Laure elle me le dit « t’asd’la chance… » »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« C’est ça qui peut poser un peu problème à mes frères… j’suis favorisé quoi. »« J’compr<strong>en</strong>ds qu’ça les énerve. Quand moi j’vais d’mander un Mac Do b<strong>en</strong>…j’l’aurai. Eux ils l’auront pas. »Marie 6 ans : (à propos du chanteur Grégoire) « Mon frère il est triste parce qu’ilvoulait aussi le r<strong>en</strong>contrer »Maman de Marie : « Des fois on essaie de dire non, puis de s’y t<strong>en</strong>ir puis on recraque…Pour ses frères je p<strong>en</strong>se qu’on craquerait bi<strong>en</strong> moins que ça. »Maman de Juli<strong>en</strong> : « Il peut toujours regarder plus la télé que les autres, il peuttoujours plus manger que les autres, il peut toujours plus jouer à la DS que lesautres… »Les marques d’affectionEn plus <strong>des</strong> cadeaux offerts par l’<strong>en</strong>tourage les <strong>en</strong>fants voi<strong>en</strong>t pour leur plus grandplaisir les marques d’att<strong>en</strong>tion à leur égard multipliées. Les démonstrations affectives, les« câlins », sont plus nombreux et plus fréqu<strong>en</strong>ts « j’<strong>en</strong> ai tout le temps quand je veux » medisait Liliane.108
Liliane 12 ans : « X. elle me fait tout le temps <strong>des</strong> câlins. »Juli<strong>en</strong> 12 ans :« Les relations se sont plutôt améliorées. »« Mon grand père qui parle pas… qui on savait qui nous aimait bi<strong>en</strong> mais qui… lemontrait pas beaucoup et b<strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ant il le montre. »Marie 6 ans :« Le père noël m’a <strong>en</strong>voyé un p’ti message sur l’ordi <strong>en</strong> disant qu’il savait que monannée 2010 était dure pour moi… »Timéo 12 ans :(A propos <strong>des</strong> frères et sœurs) « B<strong>en</strong> ils sont plus g<strong>en</strong>tils. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« C’était 22 heures : « Maman tu peux me faire <strong>des</strong> saucisses ? –Mais oui mon chéripas de problème… »Papa d’Anthony :« Quand il était malade j’passais plus de temps avec lui… »« Quand j’r<strong>en</strong>trais j’étais j’p<strong>en</strong>se plus proche d’Anthony… Plus à m’occuperd’Anthony que de Juliette quoi… »Les visitesLorsque les <strong>en</strong>fants n’étai<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> aplasie et que les visites étai<strong>en</strong>t autorisées, ellesétai<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t plus nombreuses. En effet l’<strong>en</strong>tourage proche v<strong>en</strong>ait régulièrem<strong>en</strong>t à <strong>domicile</strong>pour passer du temps avec l’<strong>en</strong>fant malade, le divertir et sout<strong>en</strong>ir les par<strong>en</strong>ts. Pour la plupart<strong>des</strong> <strong>en</strong>fants ces visites leur plais<strong>en</strong>t « ça fait du bi<strong>en</strong> de parler ». Parfois ils pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tconsci<strong>en</strong>ce du caractère exceptionnel de la visite du fait de la maladie allant jusqu’à évoquerune « injustice ».Anthony 4 ans : « Quand z’étais malade y’avait papy X. qui v<strong>en</strong>ait. »Liliane 12 ans :« J’ai souv<strong>en</strong>t <strong>des</strong> visites, <strong>des</strong> amis. »« Mes grands par<strong>en</strong>ts c’est la première fois depuis que je suis née qu’ils sontv<strong>en</strong>us. C’est injuste c’est à cause de ma maladie qu’ils vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t. »109
Lilou 9 ans :« J’ai eu 2 copines… non j’ai eu 2, 3, 4, 5 copines qui sont v’nues. »« Ma mamie elle est v<strong>en</strong>ue à l’hôpital. »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Depuis que je suis malade y’<strong>en</strong> a plus… <strong>des</strong> copains… <strong>des</strong>adultes copains… la famille… ça fait du bi<strong>en</strong> de parler. »Marie 6 ans : « Cette semaine et la semaine prochaine je vais <strong>en</strong> avoir plein… »IV.3.6.Modifications comportem<strong>en</strong>talesMaturité et responsabilisationAvec la maladie grave le comportem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>fant malade évolue. Il est classiquede dire que « l’<strong>en</strong>fant gagne <strong>en</strong> maturité ». « Tous ces <strong>en</strong>fants là ils muriss<strong>en</strong>t beaucoupplus vite » m’affirmait la maman de Marie. Selon le dictionnaire Larousse 2012 la maturitécorrespond à une période de la vie caractérisée par le plein développem<strong>en</strong>t physique,intellectuel et affectif. Plus que l’atteinte de la maturité, l’<strong>en</strong>fant va être, du fait de lamaladie, confronté à <strong>des</strong> concepts qui ne lui sont pas familiers et va devoir se lesapproprier. Comme le résume bi<strong>en</strong> la maman de Marie la maladie « forcém<strong>en</strong>t ça faitgrandir plus vite. C’est du concret, c’est la mort, c’est la vie, c’est les traitem<strong>en</strong>ts… ». Ainsil’<strong>en</strong>fant va découvrir la souffrance mais va égalem<strong>en</strong>t pouvoir pr<strong>en</strong>dre consci<strong>en</strong>ce qu’il peutmourir. Mais comme l’explique bi<strong>en</strong> Evelyne Josse, psychologue, ce n’est pas pour autantqu’ils ont acquis les capacités cognitives et la maturité émotionnelle pour pouvoir exprimerles questionnem<strong>en</strong>ts verbalem<strong>en</strong>t. (30) C’est donc pour les aider à progresser dans leursquestionnem<strong>en</strong>ts que les par<strong>en</strong>ts les accompagn<strong>en</strong>t par la parole. Les professionnels peuv<strong>en</strong>tégalem<strong>en</strong>t utiliser les <strong>des</strong>sins ou les jeux pour permettre aux <strong>en</strong>fants d’exprimer leurs craintes.Maman de Liliane :« Elle pr<strong>en</strong>d une maturité à vitesse grand V là. »« Faut pas l’embêter pour <strong>des</strong> bêtises. »Maman de Lilou :« Elle est <strong>en</strong> train de se construire ! Alors y’a <strong>des</strong> dérapages et on recadre parceque même si elle a vécu tout ça on peu pas tout lui laisser faire. »110
Maman de Marie :« Elle a une maturité… C’est bi<strong>en</strong> et c’est pas bi<strong>en</strong> à la fois parce que <strong>des</strong> fois elle a<strong>des</strong> angoisses qu’elle ne devrait pas forcém<strong>en</strong>t avoir pour son âge… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« C’est plus un <strong>en</strong>fant sain de 11 ans, c’est un ado de 12 ans qui a fortem<strong>en</strong>trégressé. »« Il a changé, voilà il a régressé dans ce qu’il est avec moi et <strong>en</strong> même temps il abeaucoup gagné <strong>en</strong> maturité dans ce qu’il connait de la douleur, de la souffrance, <strong>des</strong>on <strong>en</strong>vie de vivre… »Modification <strong>des</strong> choix professionnelsLes <strong>en</strong>fants, pour les plus grands, sont à l’âge <strong>des</strong> premiers questionnem<strong>en</strong>ts sur leurav<strong>en</strong>ir. Mais l’<strong>en</strong>trée dans la maladie va mettre <strong>en</strong>tre par<strong>en</strong>thèse cette construction progressived’eux même. Pourtant les <strong>soins</strong> médicaux vont constituer une découverte, une nouvellecuriosité. Malgré la douleur et les angoisses qu’elle <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre l’<strong>en</strong>fant va considérer samaladie comme une connaissance. Le professeur Rufo explique bi<strong>en</strong> ce mécanisme qui vapermettre à l’<strong>en</strong>fant de contrer un peu l’inquiétude qu’elle génère. « Il est d’ailleursfrappant de voir comme les jeunes <strong>en</strong>fants sont au fait de l’anatomie, <strong>des</strong> médicam<strong>en</strong>ts, <strong>des</strong><strong>soins</strong> et <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts qu’on leur administre » (20). Ils <strong>en</strong> arriv<strong>en</strong>t même à s’id<strong>en</strong>tifier à leurssoignants.Liliane 12 ans :« Plus tard j’veux faire comme eux cancérologue pédiatrique. »« J’ai <strong>en</strong>vie de faire part de mon expéri<strong>en</strong>ce. »Juli<strong>en</strong> 12 ans : « Justem<strong>en</strong>t y’a un projet qui s’est… Biologiste… c’est v’nu avec lamaladie. »Marie 6 ans :« Avant j’avais dit j’s’rai dame de manège, dame de Mac Do, dame de piscine, aprèsmaint<strong>en</strong>ant j’ai plus changé j’ai <strong>en</strong>vie d’être docteur et chanter. »« J’adore quand je soigne les g<strong>en</strong>s et tu vois moi j’ai <strong>en</strong>vie d’être docteur. »Certaines mamans ont égalem<strong>en</strong>t vu naitre de nouveaux projets professionnels dufait de l’expéri<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> <strong>soins</strong> qu’elles ont été dans l’obligation de découvrir.111
Maman de Juli<strong>en</strong> :« Souv<strong>en</strong>t j’me dis p’t’être que je devrais repr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> d’infirmière…aujourd’hui j’ai plus du tout <strong>en</strong>vie d’être assistante sociale. »Maman d’Anthony :« Ça m’a quand même beaucoup fait évoluer parce que maint<strong>en</strong>ant… l’hôpitalj’connais… Les <strong>soins</strong> j’<strong>en</strong> ai eu fait (…) ‘fin c’est vrai qu’j’ai pas mal assisté.»« Ça m’a complètem<strong>en</strong>t… transformée d’ailleurs j’aimerais p’t’être me réori<strong>en</strong>ter …euh… Là dedans à peu près… »Une nouvelle philosophie de vieFinalem<strong>en</strong>t l’apparition de la maladie qui bouleversait le quotidi<strong>en</strong> a permis à d<strong>en</strong>ombreuses familles de remettre <strong>en</strong> question leur mode de vie. La plupart ont, de ce fait, prisde la distance par rapport à leur quotidi<strong>en</strong>. Ils ont appris à être « heureux », à profiter…Maman de Mathilde :« Ma fille c’est une leçon de vie à elle toute seule… »« Elle m’aura appris beaucoup de choses… voilà profiter d’un jour aprèsl’autre, profiter <strong>des</strong> g<strong>en</strong>s qu’on aime… le leur Dire… »Maman de Timéo :« Avant on était toujours à faire <strong>des</strong> plans à perpète sur <strong>des</strong> années… aujourd’huion <strong>en</strong> profite et on est, j’dirais, plus heureux »« On a appris à s’poser, à profiter du mom<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>t. »Maman de Lilou :« La vie nous a imposé ça mais elle nous a appris du coup à être heureux dec’qu’on a… »IV.4.Rôle du médecin généralisteFinalem<strong>en</strong>t l’hôpital très <strong>en</strong>cadrant et rassurant ne peut pas se déplacer complètem<strong>en</strong>tà <strong>domicile</strong> où les par<strong>en</strong>ts acquièr<strong>en</strong>t autonomie et responsabilité par rapport à l’état de santéde leur <strong>en</strong>fant. A <strong>domicile</strong> il pourrait sembler logique que le médecin traitant, médecin de112
famille et médecin de terrain, s’implique dans la prise <strong>en</strong> charge. Lorsque j’interrogeais les<strong>en</strong>fants sur la place de leur médecin traitant, tous le connaissai<strong>en</strong>t mais tous étai<strong>en</strong>tcatégoriques. Leur médecin traitant « Non » il n’avait aucun rôle dans leur maladie.Liliane m’expliquait même « Nous on a un thermomètre là, il peut ri<strong>en</strong> faire de plus hein ! ».Pourtant la mesure dix huit du plan cancer 2009-2013 prévoit de personnaliser la prise<strong>en</strong> charge <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> et de r<strong>en</strong>forcer le rôle du médecin traitant. « Le médecin traitant dontle rôle pivot a été confirmé dans la loi « Hôpital, pati<strong>en</strong>ts, santé et territoires » est un acteuress<strong>en</strong>tiel de la prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> ville et doit être mieux informé et associé à ce parcours (…)pour assurer pleinem<strong>en</strong>t la prise <strong>en</strong> charge globale de proximité du pati<strong>en</strong>t » (31) .IV.4.1.Une implication nécessairePour les par<strong>en</strong>ts, le rôle du médecin généraliste était réel et son implicationsouv<strong>en</strong>t souhaitée. Le médecin ne pouvait que s’impliquer puisque c’était le référ<strong>en</strong>t médicalde premier recours <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts dès lors qu’ils étai<strong>en</strong>t confrontés à un doute sur l’état de santéde leur <strong>en</strong>fant, bi<strong>en</strong> avant même la découverte et la prise <strong>en</strong> charge du cancer.Rôle médical diagnostiqueSavoir y p<strong>en</strong>ser, suspecter le diagnostic et ori<strong>en</strong>ter l’<strong>en</strong>fant pour <strong>des</strong> exam<strong>en</strong>scomplém<strong>en</strong>taires appropriés. Tel est le rôle que les par<strong>en</strong>ts attribuai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> premier lieu àleur médecin généraliste. Un rôle parfois très difficile à t<strong>en</strong>ir pour un médecin qui, du fait dela préval<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> cancers pédiatriques, ne r<strong>en</strong>contrera peut être ne r<strong>en</strong>contrera pas d’autre casdans son exercice.Maman de Liliane : « Mr X. qui est passé à coté… »Maman de Mathilde :« Malgré tout c’est grâce à lui qu’elle est allée à l’hôpital… C’est lui qui a fait lecourrier. C’est grâce à lui qu’elle a été prise <strong>en</strong> charge rapidem<strong>en</strong>t. »Maman de Timéo :C’est lui qui a tout décl<strong>en</strong>ché… la demande à 100%... »« Il a décelé qu’il y avait quelque chose de grave, il a alerté on l’a vu à temps aprèsc’est pas lui qui gère. »113
Maman de Marie :(À propos de ses att<strong>en</strong>tes) « Qu’il soit là, qu’il ait ce regard qu’on att<strong>en</strong>d de lui auniveau médical, qu’il accepte de surveiller, qu’il soit vigilant. »Maman de Karine :« Il v<strong>en</strong>ait tous les mercredis matin examiner Karine. »« Qu’il l’examine correctem<strong>en</strong>t toutes les semaines, s’il voyait quelque chose quin’allait pas qu’il nous le dise… C’était quand même bi<strong>en</strong> réglé. »L’écouteLes par<strong>en</strong>ts att<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t de leur médecin traitant une écoute att<strong>en</strong>tive de leursinterrogations, de leurs plaintes, de leur souffrance. Les mamans mettai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>avant la nécessité d’écoute de ce que leur « instinct maternel » leur dictait… « J’étaisinquiète, c’était pas normal… » me disait la maman de Liliane.Maman de Liliane :« C’que j’reproche à ce médecin c’est qu’<strong>en</strong> fait il m’a pas écoutée. »« L’instinct maternel faut faire att<strong>en</strong>tion »« Moi j’s<strong>en</strong>tais qu’Liliane elle avait quelque chose »Maman de Mathilde :« Moi il se trouve que ma fille ça faisait un mois et demi que je savais qu’y’avaitquelque chose je le s<strong>en</strong>tais !... Elle devait s’faire poser <strong>des</strong> diabolos et il est restésur ça… ‘fin y’avait toujours une excuse. »Maman de Lilou :« En réa quand le pronostic vital était pas bon je l’ai appelée. Elle a pas pum’aider oralem<strong>en</strong>t. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Elle a su me donner les coordonnées de g<strong>en</strong>s qui pouvai<strong>en</strong>t m’écouter. »Le souti<strong>en</strong>, la réassuranceLeur médecin traitant doit être prés<strong>en</strong>t et « jouer le jeu ». C’est vers lui que setourn<strong>en</strong>t les par<strong>en</strong>ts pour discuter d’un arrêt de travail ou exprimer leurs craintes. Ils cherch<strong>en</strong>tà être « rassurés ».114
Maman de Lilou :« On avait un médecin qui a joué le jeu à fond et qui a dit ‘‘le temps que Lilou est àl’hôpital je vous arrête tous les deux.’’ »« Elle a été extraordinaire parce qu’elle nous a arrêté tous les deux, elle nous a faittoutes les paperasses… »Maman de Marie :« Il l’a été plus par rapport à mon mari au début et puis régulièrem<strong>en</strong>t quand je vaisle voir il me demande comm<strong>en</strong>t ça se passe au niveau de Marie, comm<strong>en</strong>t elle gère. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Mon médecin a continué à m’arrêter, elle a pris soin de moi, elle m’a soignée. »« Elle a su m’écouter. »Maman de Karine : « Il nous rassurait beaucoup. »Papa d’Anthony : « C’était plus un rôle de médiateur… Elle nous a surtoutrassurés. »Liliane 12 ans : « Parfois j’accompagne maman, quand elle prolonge sonarrêt. »La disponibilitéUne autre qualité appréciée chez le médecin généraliste, souv<strong>en</strong>t depuis la découvertede la maladie de l’<strong>en</strong>fant était sa disponibilité immédiate « Quoi qu’il y a vous m’appelezj’arrive de suite » avait dit l’un d’eux à une maman.Maman de Liliane : « Ah oui ça il m’a dit ‘‘quoi qu’il se passe, si Liliane elle a 40, siy’a un souci je me déplace…’’ »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Elle m’a écrit <strong>en</strong> me disant ‘‘Si vous voulez vous pouvez m’appeler’’ »« Elle a toujours été là pour moi et quand je vais la voir elle pr<strong>en</strong>dra le temps de mevoir. »Papa d’Anthony : « Tout de suite elle nous a passé son portable, n’hésitez pas sivous avez la moindre question, le moindre doute… »115
La gestion <strong>des</strong> évènem<strong>en</strong>ts intercurr<strong>en</strong>tsLa chimiothérapie et les aplasies n’étai<strong>en</strong>t pas protectrices <strong>des</strong> petites viroseshivernales bi<strong>en</strong> au contraire… Si pour certains médecins il était évid<strong>en</strong>t de recevoir l’<strong>en</strong>fant<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce… « L’autre jour j’avais une trachéite, j’y suis allée… »Maman de Liliane :« L’autre fois j’l’ai am<strong>en</strong>ée elle avait pas d’température mais elle était <strong>en</strong>aplasie… C’était pour sa petite trachéite. »« J’étais passée avant tout le monde, il voulait pas qu’elle soit <strong>en</strong> contact avecd’autre personne. »hospitalier.… Pour d’autres leur rôle s’arrête dès lors que l’<strong>en</strong>fant est pris <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> milieuMaman de Mathilde :« Quand Mathilde elle avait mal à la gorge c’qui est quand même de l’ordre dumédecin traitant il m’disait d’appeler l’IHOP. »Ce désinvestissem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>soins</strong> peut s’expliquer par une implication dans la prise <strong>en</strong>charge de la maladie de l’<strong>en</strong>fant difficile pour le médecin du fait d’un transfert trop importantou la crainte de ne pas savoir. Lorsqu’ils ont été interrogés <strong>en</strong> 2009 les médecinsgénéralistes expliquai<strong>en</strong>t que la rareté <strong>des</strong> cancers de l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ait leur crainte deles pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong>. Ils ne se s<strong>en</strong>tai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet pas à l’aise dans la prise <strong>en</strong>charge du fait d’un manque de pratique (2). Enfin ils mettai<strong>en</strong>t tous <strong>en</strong> avant, comme leconfirme la mesure dix huit du plan cancer 2009-2013 (31) , la nécessité absolue d’un travail <strong>en</strong>réseau avec une collaboration ville-hôpital efficace et sécuritaire pour le médecin.Il est paradoxal de remarquer les par<strong>en</strong>ts att<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t une écoute, un diagnostic et uneinfaillibilité du médecin généraliste alors même qu’actuellem<strong>en</strong>t le statut sociétal de lamédecine générale est représ<strong>en</strong>té de manière très négative. Le docteur Marion Lamort-Bouché dans sa thèse d’exercice de médecine générale <strong>en</strong> 2010 le prouve bi<strong>en</strong> à travers leregard négatif que les jeunes externes <strong>en</strong> médecine de Lyon port<strong>en</strong>t sur la spécialité demédecine générale. (32)116
Le suiviFinalem<strong>en</strong>t l’implication du médecin généraliste ne s’arrête pas au souti<strong>en</strong> et à laprise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong>. Un <strong>des</strong> rôles du médecin de famille est lesuivi longitudinal de l’<strong>en</strong>fant parfois depuis sa naissance jusqu’à l’âge adulte… Lecancer n’est pas une fin <strong>en</strong> soi, la vie continue après les traitem<strong>en</strong>ts. Le médecin généralisteva être un <strong>des</strong> maillons de cette chaine de suivi immuable dans le temps, celui qui va« pr<strong>en</strong>dre le relais » dans l’après hôpital.Maman de Lilou :« Elle pr<strong>en</strong>d le relais depuis janvier 2012 puisqu’elle a attaqué les vaccins. »Maman de Marie :« Peut être que j’att<strong>en</strong>drai de lui ce regard de médecin… à pr<strong>en</strong>dre le relais detoutes les angoisses qu’on va pouvoir avoir. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Par rapport à Juli<strong>en</strong> un rôle de suivi lointain de sa situation. »IV.4.2. Des caractéristiques souhaitéesLes par<strong>en</strong>ts avai<strong>en</strong>t une connaissance et <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes bi<strong>en</strong> définies concernant leurmédecin traitant.Rôle génériquePour eux son rôle était bi<strong>en</strong> défini « les grippes », « les gastro», mais pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>tévolutif « J’espère que dans une carrière de généraliste on s’intéresse à autre chose qu’uneotite, qu’une angine… » me disait la maman de Mathilde.Le cancer correspondait à une maladie « hors son domaine » de compét<strong>en</strong>ces, dufait du caractère technique <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts.Maman de Liliane :« Les médecins traitants c’est les grippes, les gastro, j’p<strong>en</strong>se qu’au bout d’unmom<strong>en</strong>t on passe à coté d’trucs je crois…»117
Maman de Timéo :« Quelque part c’est un peu hors son domaine quoi… »Maman de Lilou :« A aucun mom<strong>en</strong>t j’ai eu contact avec elle parce qu’on est trop sur de latechnicité quoi… »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Je p<strong>en</strong>se qu’un médecin traitant est pas compét<strong>en</strong>t vraim<strong>en</strong>t pour s’occuper dusuivi d’un <strong>en</strong>fant <strong>en</strong> traitem<strong>en</strong>t anti cancéreux. »Papa d’Anthony :« Jamais pour traiter la maladie parce que elle aussi c’était peut être pas son job. »Une place à pr<strong>en</strong>dre« Je me s<strong>en</strong>s pas concerné, c’est difficile de trouver sa place » soulignai<strong>en</strong>t lesmédecins généralistes interviewés <strong>en</strong> 2009 (2) . Et pourtant malgré les aspects techniques de laprise <strong>en</strong> charge qui n’<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t pas, et à juste titre, pour les par<strong>en</strong>ts dans le champ decompét<strong>en</strong>ce du médecin généraliste, ces derniers ont <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes par rapport à leur médecin.Du fait de cette relation de proximité privilégiée qu’ils peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ir avec leur médecin« c’est important un médecin traitant », les par<strong>en</strong>ts att<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t de lui « qu’il soit prés<strong>en</strong>t »,« une interprétation de c’qu’a dit mon médecin… » ou même plus simplem<strong>en</strong>t « un coup defil ».Juli<strong>en</strong> 12 ans :« J’vois pas c’qu’elle pourrait faire pour m’aider moi… »« Un médecin c’est pas quelqu’un à qui tu vas parler, parler de c’qui t’arrives çaserait plutôt une sorte de psychiatre qui m’aurait servi plus. »Maman de Juli<strong>en</strong> :« Ç’aurait pu être sympa que Mme X. vi<strong>en</strong>ne mais il aurait fallu qu’il y aitquelqu’un derrière qui pr<strong>en</strong>ne le relais qui soit plus abordable. Parce qu’elle aquand même la robe de médecin Mme X. ça peut mettre de la distance. »Maman de Liliane :« C’que j’lui reproche il m’a jamais appelé. »« J’att<strong>en</strong>dais son coup de fils j’ai pas compris. J’étais malheureuse aussi… parceque c’est important un médecin traitant… »118
Maman de Mathilde :« L’médecin traitant c’est particulier quand même !! J’aurais voulu qu’il soitprés<strong>en</strong>t ouais. »« J’aurais voulu qu’il interprète les prises de sang, que ce ne soit pas moi qui soitobligée d’appeler l’hôpital pour récupérer les transfusions de plaquettes… qu’ilpr<strong>en</strong>ne <strong>des</strong> nouvelles… qu’il s’intéresse un peu à la maladie »Maman de Lilou :« Ça m’aurait fait plaisir qu’elle passe un coup de fil. Elle l’a pas fait parce qu’<strong>en</strong>même temps on téléphonait souv<strong>en</strong>t. »« C’aurait été bi<strong>en</strong> d’avoir une interprétation de c’que dit un médecin. »Parfois la prés<strong>en</strong>ce de terrain aux cotés de la famille était effective et rassurante.Maman de Marie :« On lui a demandé s’il acceptait de faire ce suivi toutes les semaines. Il a ditOK. »Papa d’Anthony :« On a eu beaucoup de relation avec notre médecin traitant. »« A l’hôpital on avait les médecins, mais ici c’était surtout le médecin traitant quipouvait nous répondre. »IV.4.3.Facteurs limitant l’implication du médecin traitant selon lespar<strong>en</strong>tsPlusieurs facteurs étai<strong>en</strong>t évoqués par les par<strong>en</strong>ts qui selon eux limitai<strong>en</strong>t lesinteractions avec leur médecin. Tout d’abord une famille ne souhaitait pas que son médecintraitant intervi<strong>en</strong>ne d’avantage dans la prise <strong>en</strong> charge.Maman de Timéo :« S’il avait appelé pour pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> nouvelles tout ça c’aurait eu j’veux dire un cotéhumain mais quelque part c’est pas son boulot. »« C’est un bon médecin mais c’est pas un ami. Si on appelle c’est qu’on s’intéressait ànous et c’est plus le rôle du médecin. »119
L’exercice est donc compliqué pour un médecin qui ne sait pas comm<strong>en</strong>t la famille vase positionner par rapport à sa place dans la prise <strong>en</strong> charge. D’autant plus que saparticipation active nécessite un investissem<strong>en</strong>t émotionnel non négligeable que lesmédecins généralistes eux même qualifi<strong>en</strong>t de « lourd » (2) . Cette prise <strong>en</strong> charge s’alourdit<strong>en</strong>core du fait <strong>des</strong> contraintes d’investissem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> temps qu’elle demande, alors mêmeque les modalités d’exercice libéral et la démographie médicale actuelle jou<strong>en</strong>t contrecette notion de temps. La parole <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts vi<strong>en</strong>t confirmer cette hypothèse. « Elle esttellem<strong>en</strong>t débordée… ».Enfin parfois la relation avec le milieu hospitalier peut être difficile laissant aumédecin généraliste une impression d’être mis de coté. Comm<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> s’occuper de sonpati<strong>en</strong>t et de sa famille quand ils ne connaiss<strong>en</strong>t pas les ressources sanitaires et socialesdisponibles sur leur lieu d’exercice ? L’étude réalisée <strong>en</strong> 2010 par la ligue nationale contre lecancer concernant la place du médecin généraliste dans la prise <strong>en</strong> charge d’un pati<strong>en</strong>tcancéreux a montré que soixante dix pour c<strong>en</strong>t <strong>des</strong> médecins interrogés évoquai<strong>en</strong>t un manquede reconnaissance de leur place dans la prise <strong>en</strong> charge (manque d’informations, faiblerémunération) (33) …L’extrapolation est cep<strong>en</strong>dant facile et le dialogue avec l’IHOP probablem<strong>en</strong>t unpeu différ<strong>en</strong>t et plus personnalisé car s’occuper d’un <strong>en</strong>fant atteint de cancer reste del’ordre de l’exceptionnel. Il faut aussi noter que la prise <strong>en</strong> charge <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants atteints decancers <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> varie selon le statut de prise <strong>en</strong> charge et l’évolutivité de lamaladie. Ainsi pour une HAD de <strong>soins</strong> palliatifs, le médecin généraliste est c<strong>en</strong>sé êtrecomplètem<strong>en</strong>t intégré au réseau de <strong>soins</strong> puisqu’il r<strong>en</strong>contre l’équipe hospitalière lors d’une« réunion de mise <strong>en</strong> place » qui définit son rôle et la fréqu<strong>en</strong>ce de ses interv<strong>en</strong>tions auprès del’<strong>en</strong>fant (12) .Maman de Liliane :« Ils sont trop sollicités ces médecins traitants. »« C’est dommage, y’a trop de monde. »Maman de Lilou :« Y’a une déconnexion qui est faite et d’ailleurs mon médecin m’a fait part de sasouffrance de ne pas être justem<strong>en</strong>t au courant <strong>en</strong> fait. »« Je la vois tellem<strong>en</strong>t débordée par son travail, elle est à flux t<strong>en</strong>du dans soncabinet je me permettrais même pas de l’appeler pour lui pr<strong>en</strong>dre un quartd’heure de discussion… »120
Maman de Juli<strong>en</strong> :« J’l’ai jamais appelée parce que je p<strong>en</strong>sais que vraim<strong>en</strong>t elle avait d’autreschoses à gérer que le cancer de mon fils, elle est tout le temps occupée. »Maman de Mathilde :« Il dit ne pas avoir trouvé sa place dans la maladie de Mathilde. »IV.5.Les <strong>des</strong>sinsComm<strong>en</strong>taires générauxLe <strong>des</strong>sin faisait partie intégrante de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec l’<strong>en</strong>fant. Il permettait d’aborderdifféremm<strong>en</strong>t le vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> et de comparer leur vision <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital et celle <strong>des</strong><strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. Tous avai<strong>en</strong>t les mêmes consignes « Je voudrais que tu fasses un <strong>des</strong>sin detoi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital et toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à la maison. ». L’interprétation du thème et laréalisation du ou <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins étai<strong>en</strong>t libres. Aucune durée n’était imposée. Selon l’âge del’<strong>en</strong>fant et les caractéristiques de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> réalisé, le <strong>des</strong>sin était avant, après ou p<strong>en</strong>dantl’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Selon le souhait de l’<strong>en</strong>fant un ou plusieurs <strong>des</strong>sins libres pouvai<strong>en</strong>t accompagnercelui dont le thème était imposé.Pour garder l’anonymat les prénoms <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants lorsqu’ils les avai<strong>en</strong>t écrits sur leur<strong>des</strong>sin ont été masqués.Tous les <strong>en</strong>fants sauf Anthony, pour <strong>des</strong> raisons déjà évoquées, ont réalisé au moins un<strong>des</strong>sin.Je vais prés<strong>en</strong>ter les <strong>des</strong>sins réalisés au cours de mes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s et <strong>en</strong> donner une<strong>des</strong>cription succincte. Il faut rappeler que le <strong>des</strong>sin d’un <strong>en</strong>fant est à pr<strong>en</strong>dre au sérieux (17) ,qu’il correspond à une photographie à un instant T d’un vécu qui n’est pas reproductible niextrapolable du mom<strong>en</strong>t p<strong>en</strong>dant lequel il a été réalisé. Les <strong>en</strong>fants sont <strong>en</strong> perpétueldéveloppem<strong>en</strong>t, par conséqu<strong>en</strong>t les interprétations réalisées ne sont valables que pour lapériode <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Les interprétations <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins peuv<strong>en</strong>t être multiples et variées mais laseule interprétation réellem<strong>en</strong>t fiable reste celle que fait l’<strong>en</strong>fant de son <strong>des</strong>sin au mom<strong>en</strong>t oùil le réalise. L’analyse que je vais faire <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins réalisés est donc à relativiser. Elle n’a pasvocation à établir <strong>des</strong> certitu<strong>des</strong> mais plutôt soulever <strong>des</strong> questionnem<strong>en</strong>ts à partir de monress<strong>en</strong>ti.121
Les <strong>des</strong>sins ont été montrés et discutés après leur réalisation à Madame Augé Agnès,psychothérapeute comportem<strong>en</strong>taliste, et Madame Fournier Magalie, psychologue clinici<strong>en</strong>nespécialisée dans les <strong>en</strong>fants et la relation mère <strong>en</strong>fant. Toutes deux ont pu apporter <strong>des</strong>éclairages et un point de vue extérieur à l’analyse de ces <strong>des</strong>sins.Quelques réflexions globales se dégag<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins :Le <strong>des</strong>sin de Mathilde est mis de coté pour la comparaison car il n’a pas été réalisé <strong>en</strong>même temps ni dans les mêmes conditions que les autres et que pour elle le thème était libre.Sur les six <strong>des</strong>sins réalisés à partir <strong>des</strong> mêmes consignes trois <strong>en</strong>fants ont représ<strong>en</strong>té lachambre d’hôpital comme une pièce fermée, « une boite ». Marie et Anna n’y ont même pasmis de porte d’<strong>en</strong>trée ou de sortie ce qui amplifie l’impression d’<strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>t que dégag<strong>en</strong>tles <strong>des</strong>sins.Cinq <strong>des</strong> six <strong>en</strong>fants se sont <strong>des</strong>sinés <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital mais sans infirmière « ellessont pas tout le temps dans la chambre !» m’explique Liliane. De plus Liliane est la seule àavoir <strong>des</strong>siné sa maman dans la chambre d’hôpital. Ce coté paradoxal <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins de l’hôpitalsans soignant et sans par<strong>en</strong>t pourrait traduire la solitude <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants dans ce lieu oùdéfinitivem<strong>en</strong>t ils ne se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas à leur place. Seule Marie a <strong>des</strong>siné une infirmière (dansson <strong>des</strong>sin rose de l’hôpital).Enfin les quatre plus grands <strong>en</strong>fants se sont <strong>des</strong>sinés sous forme de personnage bâton,de qualité graphique très inférieure à celle correspondant à leur âge. Jacqueline Royer dansson livre « <strong>des</strong>sin du Bonhomme : la personnalité de l’<strong>en</strong>fant dans tous ces états » propose uneexplication : « Confronté à sa maladie, l’<strong>en</strong>fant ne perd pas pour autant les composantes de sapersonnalité. Mais dans tous les cas graves, à la souffrance spécifique et au handicap physiquequi s’<strong>en</strong>suiv<strong>en</strong>t, s’ajoute la souffrance occasionnée par les <strong>soins</strong> (…). Il <strong>en</strong> découle souv<strong>en</strong>tune dévalorisation du corps, jugé imparfait qui se traduit par un refoulem<strong>en</strong>t de lareprés<strong>en</strong>tation. » (34) . Comparaisons <strong>des</strong> <strong>des</strong>sins à ceux d’<strong>en</strong>fants « sains »Les <strong>des</strong>sins <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants sains sont prés<strong>en</strong>tés dans les annexes.Les <strong>des</strong>sins <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong> ont été comparés à 4 <strong>des</strong>sins d’<strong>en</strong>fants sains n’ayantjamais connu l’hôpital dans le cadre d’une hospitalisation. Ils appart<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t à la même tranched’âge que les <strong>en</strong>fants interrogés et ont eu les mêmes consignes de réalisation. Ces <strong>des</strong>sinsn’ont pas été comm<strong>en</strong>tés sauf par annotations. De manière générale pour les <strong>en</strong>fants sains122
l’hôpital était un <strong>en</strong>droit effrayant, la seringue que l’infirmière de Jade ti<strong>en</strong>t à la main et laperfusion que reçoit Pierre évoqu<strong>en</strong>t plutôt une arme qu’un objet de soin. Aucun jeux n’est<strong>des</strong>siné à l’hôpital même le « doudou » d’Eliott n’y a pas sa place. L’hôpital apparait commeun <strong>en</strong>droit strict, froid, rigide, tout est carré dans le <strong>des</strong>sin d’Eliott et l’ameublem<strong>en</strong>t et ladécoration de la chambre de Pierre sont réduits au strict minimum. L’<strong>en</strong>fant n’aurait pas ledroit de s’y exprimer librem<strong>en</strong>t selon les <strong>en</strong>fants sains : le médecin fait taire Aude qui souffre<strong>en</strong> lui disant « Chute » alors que Pierre n’a d’autre choix que de dormir p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong>« ZZZZZ ».La solitude qui se dégage de presque tous les <strong>des</strong>sins <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants malade n’est pas dutout évoquée chez les <strong>en</strong>fants sains. Effectivem<strong>en</strong>t que ce soit à l’hôpital, <strong>en</strong>tourés dupersonnel soignant, ou à la maison <strong>en</strong>tourés de leurs par<strong>en</strong>ts les <strong>en</strong>fants ne sont jamais seuls.Eliott ajoute même son papa, sa maman et « le doudou » sur son <strong>des</strong>sin de la maison.Pour les <strong>en</strong>fants sains les <strong>soins</strong> à la maison sont prodigués exclusivem<strong>en</strong>t par lespar<strong>en</strong>ts. Pierre et Jade mettront même <strong>en</strong> scène la maman leur donnant un sachet demédicam<strong>en</strong>t.123
Liliane 12 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »Liliane 12ans« Toi <strong>en</strong><strong>soins</strong> à lamaison »124
Liliane (12 ans) a réalisé son <strong>des</strong>sin seule dans sa chambre avec les feuilles et lesfeutres que j’avais apportés. Le <strong>des</strong>sin a été effectué avant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> p<strong>en</strong>dant queson papa discutait avec moi.L’interprétation du <strong>des</strong>sin se fera <strong>en</strong> plusieurs fois au cours de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>.L’impression globale <strong>des</strong> deux <strong>des</strong>sins est plutôt triste et dépouillée. Les <strong>des</strong>sins sontminimalistes et les personnages bâtons peu représ<strong>en</strong>tatifs du graphisme d’une <strong>en</strong>fantde douze ans. Il faut dire que pour Liliane le <strong>des</strong>sin n’était pas trop à son goût etqu’elle l’a réalisé par obligation plus que par <strong>en</strong>vie. Liliane n’a mis aucune couleur surses <strong>des</strong>sins. Elle justifiera l’abs<strong>en</strong>ce de couleur à l’hôpital par « J’savais pas trop etpuis c’est tout blanc là bas alors… j’me suis dit colorier quoi ? »La maman est omniprés<strong>en</strong>te et nommée par Liliane sur ses deux <strong>des</strong>sins, ce quirappelle bi<strong>en</strong> le li<strong>en</strong> fusionnel « J’ai r<strong>en</strong>oué un cordon » décrit par la maman deLiliane depuis la découverte du cancer de sa fille.Sur le <strong>des</strong>sin de l’hôpital :Liliane s’est représ<strong>en</strong>tée le visage triste, allongée, presque clouée sur son lit etreliée à son « hydratation ». Pour expliquer ce sourire triste elle me dit « Parce quequand j’ai les chimio <strong>en</strong> général j’suis pas très bi<strong>en</strong> ». Il existe un certain degré demimétisme dans le <strong>des</strong>sin <strong>en</strong>tre Liliane et sa maman puisqu’elle a <strong>des</strong>siné sa mamanchauve à l’hôpital comme elle, ce qui n’est pas le cas sur le <strong>des</strong>sin de la maison. « Ellea les cheveux courts alors c’est pas facile à <strong>des</strong>siner les cheveux courts » se justifieraLiliane. La chambre est très grande et très vide, aucun jeu n’est <strong>des</strong>siné, la télévisionest représ<strong>en</strong>tée par un grand rectangle <strong>en</strong> face du lit de Liliane. Si Liliane est triste samaman est quant à elle bi<strong>en</strong> souriante. Elle est grande dans son fauteuil et bi<strong>en</strong>prés<strong>en</strong>te sur ce <strong>des</strong>sin ce qui lui confère un caractère rassurant. Quand je pose laquestion à Liliane de savoir pourquoi sa maman sourie alors qu’elle est toute tristedans son lit elle me répond « Normal… Sur un bonhomme on fait toujours un sourirehein… ».Enfin on retrouve le coté paradoxal de l’hôpital sans soignant.125
Sur le <strong>des</strong>sin de la maison :Le graphisme est un peu plus appliqué même si les détails du <strong>des</strong>sin rest<strong>en</strong>tminimalistes. L’humanisation de la maison peut être représ<strong>en</strong>tée par le bouquet defleur prés<strong>en</strong>t sur la table de la salle à manger. Liliane et son infirmière sont <strong>des</strong>sinéesbelles, féminines (<strong>en</strong> robes et <strong>en</strong> jupes) et souriantes. Liliane est assise prête pour laréfection de son pansem<strong>en</strong>t. Sa maman est à nouveau prés<strong>en</strong>te <strong>des</strong>sinée cette fois avec<strong>des</strong> cheveux. Elle est représ<strong>en</strong>tée à nouveau <strong>en</strong> personnage bâton et semble de petitetaille par rapport à sa fille et à l’infirmière comme si Liliane et ses <strong>soins</strong> pr<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>ttoute la place à la maison…126
Anna 5 ansA gauche :« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »A droite :« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àla maison »Anna 5 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à lamaison »127
Anna (5 ans) va réaliser son <strong>des</strong>sin p<strong>en</strong>dant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Une grande partie de l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>est d’ailleurs réalisée p<strong>en</strong>dant l’activité <strong>des</strong>sin.Nous sommes toutes les deux à son bureau, seules dans sa chambre. Anna utilise de manièreégale ses feutres et les mi<strong>en</strong>s. Anna comm<strong>en</strong>tera son <strong>des</strong>sin p<strong>en</strong>dant sa réalisation.Premier <strong>des</strong>sin : l’hôpital et la maisonLe premier <strong>des</strong>sin <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec le thème demandé, que réalise Anna est plutôtsurpr<strong>en</strong>ant, il semble <strong>en</strong> inadéquation avec ceux <strong>des</strong> autres <strong>en</strong>fants. Par rapport aux autres<strong>en</strong>fants le <strong>des</strong>sin de l’hôpital semble plus gai et plus coloré que celui de la maison. Al’hôpital Anna s’est <strong>des</strong>sinée dans son lit, un lit à roulettes qui ressemble fortem<strong>en</strong>t au litplaymobile avec lequel elle jouait p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. La couverture bleue est la parfaitereproduction <strong>des</strong> couvertures que l’on retrouve à l’IHOP « Elle est comme ça à l’hôpital » medit-elle. Sur le mur de sa chambre elle a <strong>des</strong>siné un très grand personnage « J’vais faire les<strong>des</strong>sins que j’avais dans ma chambre. C’est un p’tit chat ». Le personnage est souriant etféminin (il porte une robe). Sa taille semble démesurée par rapport à celle d’Anna allongéedans son lit. Cette prés<strong>en</strong>ce sympathique au mur peut évoquer le caractère rassurant del’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t hospitalier. D’ailleurs Anna allongée dans son lit s’est <strong>des</strong>sinée souriante.Le graphisme est inégal sur ce <strong>des</strong>sin, Anna s’est représ<strong>en</strong>tée de manière plutôt grossière, <strong>en</strong>personnage bâton sans vêtem<strong>en</strong>ts. Par contre elle a tout de même pris la peine de se <strong>des</strong>sinerde beaux cheveux longs qui contrast<strong>en</strong>t avec son alopécie au mom<strong>en</strong>t où je la r<strong>en</strong>contre. Annas’est représ<strong>en</strong>tée toute seule dans sa chambre d’hôpital. Quand je lui pose la question elle merépond « Tu sais pourquoi je m’ai <strong>des</strong>siné toute seule dans ma chambre… parce que mamanest partie déjeuner. » Cette réponse acc<strong>en</strong>tue bi<strong>en</strong> le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de solitude qui pourrait pesersur Anna à l’hôpital. Sa chambre est une boite close qui pourrait évoquer égalem<strong>en</strong>tl’<strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>t ress<strong>en</strong>ti à l’hôpital.Second <strong>des</strong>sin : les <strong>soins</strong> à la maisonLe <strong>des</strong>sin de la maison est réalisé <strong>en</strong> gris à défaut du noir avec lequel elle a comm<strong>en</strong>céparce que « le noir il marche pas très bi<strong>en</strong> ». L’immeuble semble froid, austère, très fermé,très <strong>en</strong>cadré comme si les <strong>soins</strong> ne devai<strong>en</strong>t pas r<strong>en</strong>trer dans la maison. D’ailleurs dans unpremier temps Anna ne se <strong>des</strong>sinera pas <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à la maison. Il faudra que je lui demande ànouveau de se <strong>des</strong>siner « pareil qu’à l’hôpital sauf que quand tu es à la maison » pourqu’Anna <strong>en</strong>tame le second <strong>des</strong>sin. Le graphisme est bon, plus évolué même que celui que l’on128
pourrait att<strong>en</strong>dre pour une <strong>en</strong>fant de cinq ans et demi selon la <strong>des</strong>cription qu’<strong>en</strong> fait JacquelineRoyer dans son livre « La personnalité de l’<strong>en</strong>fant à travers le <strong>des</strong>sin du bonhomme » (34) . Laperfusion et le « branchem<strong>en</strong>t » sont réalisés avec beaucoup de réalisme. A la maison Annaest accompagnée par sa maman. Encore une fois Anna <strong>des</strong>sine avec beaucoup d’applicationses cheveux et ceux de sa maman et se <strong>des</strong>sine une coiffure précise « j’ai une p’tite mècheici ». Dessiner ses cheveux alors qu’elle-même prés<strong>en</strong>te une alopécie quasi complète luipermet peut être de se projeter vers une image d’elle-même plus féminine et moinsangoissante. Aucun détail de la maison n’est représ<strong>en</strong>té. Anna m’expliquera simplem<strong>en</strong>t quec’est « pas dans la chambre » que sont réalisés les <strong>soins</strong> mais « tout au fond ici » m’indiquantle salon comme lieu <strong>des</strong> <strong>soins</strong>.129
Lilou 9 ansA gauche :« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à lamaison »A droite :« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »Lilou 9 ansVision d’elle-même :« Avan »Avant la découverte dela maladie.« Après » (<strong>en</strong> haut àdroite)Après la découverte dela maladie avant lestraitem<strong>en</strong>ts (la chimio etla greffe)« Après » (<strong>en</strong> bas à gauche) :Après la greffe avec sa sonde naso-gastrique et sa casquette pour cacher son crâne nu.« … » (En bas à droite) :Vision actuelle de Lilou : Lilou guérie.130
Lilou (9 ans) va réaliser ses <strong>des</strong>sins <strong>en</strong> deux temps.Le premier, le <strong>des</strong>sin imposé, sera réalisé avant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> p<strong>en</strong>dant que je discute avecson papa. Lilou est allée s’<strong>en</strong>fermer dans sa chambre à l’étage pour le réaliser. Elle a pris mesfeutres et mes feuilles.Une seconde période de <strong>des</strong>sin sera réalisée p<strong>en</strong>dant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Je <strong>des</strong>sine sur son bureau<strong>des</strong> animaux qu’elle me demande de faire p<strong>en</strong>dant qu’elle se <strong>des</strong>sine avant, p<strong>en</strong>dant et aprèssa maladie.Premier <strong>des</strong>sin de Lilou : la maison et l’hôpitalLilou a fait deux <strong>des</strong>sins très colorés la représ<strong>en</strong>tant <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital et <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àla maison.Le graphisme est moins évolué que ce à quoi on peut s’att<strong>en</strong>dre pour son âge maisLilou a <strong>des</strong> problèmes de dyspraxies sévères.Sur le <strong>des</strong>sin de la maison Lilou s’est représ<strong>en</strong>tée <strong>en</strong>tourée de toute sa famille. « Lày’a papa, maman, là y’a ma sœur et là y’a moi ». Aucun soin ni personnel soignant n’estprés<strong>en</strong>t sur le <strong>des</strong>sin comme si Lilou elle aussi voulait éloigner la maladie de son <strong>domicile</strong>.La seule allusion qu’elle y fera est liée au fait qu’elle est allongée sur le canapé. « J’étaisbeaucoup fatiguée ». Elle justifiera l’abs<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> infirmières de son <strong>des</strong>sin par l’irrégularitéde leurs passages dans la semaine « En plus elles v<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t pas tous les jours… parce que làc’est le matin (…) donc elles sont pas là… »Le <strong>des</strong>sin qu’elle fait de l’hôpital est plus pauvre <strong>en</strong> détail. Lilou est cette fois cicomplètem<strong>en</strong>t seule. On retrouve <strong>en</strong>core une fois le paradoxe de l’hôpital sans soignant. Les<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de solitude semble acc<strong>en</strong>tué par l’abs<strong>en</strong>ce de ses par<strong>en</strong>ts. Elle m’explique qu’ell<strong>en</strong>e savait pas comm<strong>en</strong>t <strong>des</strong>siner son père à l’hôpital… « Là y’avait papa et la salle de bainmais j’arrive pas à <strong>des</strong>siner ». Le <strong>des</strong>sin de l’hôpital est criant de solitude. Elle rajoute, dansun second temps et parce que je le lui ai demandé son papa sur un fauteuil. Lilou sembleplutôt sereine à l’hôpital puisqu’elle est assise souriante dans son lit. Tout son corps seconfond d’ailleurs avec ce grand lit comme si elle allait disparaitre à l’intérieur, sauf son brasreprés<strong>en</strong>té dans une couleur différ<strong>en</strong>te et sur lequel est reliée la perfusion. Le pied deperfusion et les pousses seringues sont d’ailleurs représ<strong>en</strong>tés <strong>en</strong> un gros bloc jouxtant le lit.« Les trucs où on mettait dans la perf » me décrit Lilou. La taille du pied de perfusion estremarquablem<strong>en</strong>t grande par rapport au lit et surtout à elle-même. La maladie pr<strong>en</strong>drait elle131
toute la place à l’hôpital pour n’<strong>en</strong> laisser que très peu à Lilou qui la subit et aucune auxaccompagnants ?Dessins <strong>des</strong> visagesLilou a souhaité <strong>des</strong>siner à nouveau p<strong>en</strong>dant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et elle m’a réalisé cedeuxième <strong>des</strong>sin après que je lui ai demandé de me <strong>des</strong>siner sa maladie. Le <strong>des</strong>sin de Lilou esttrès parlant. Le choix <strong>des</strong> couleurs est parfaitem<strong>en</strong>t libre. Lilou s’est <strong>des</strong>sinée de manièreuniforme dans <strong>des</strong> tons bleu foncés p<strong>en</strong>dant toute sa maladie. La qualité graphique du <strong>des</strong>sinest égalem<strong>en</strong>t très <strong>en</strong> <strong>des</strong>sous de l’âge réel de Lilou. On peut noter une évolution dans les<strong>soins</strong> avec l’apparition de la sonde naso-gastrique et du « gros scotch ! » qui la mainti<strong>en</strong> surson visage « Alors quand je l’<strong>en</strong>levais j’étais toute blanche », puis de l’alopécie. Malgré lamaladie et les <strong>soins</strong> Lilou reste toujours souriante comme optimiste pour l’av<strong>en</strong>ir. Lilou estcont<strong>en</strong>te car autant elle a eu un peu de mal à initier ce <strong>des</strong>sin « je sais pas comm<strong>en</strong>t la<strong>des</strong>siner… » autant pour le finir elle est fière de m’expliquer comm<strong>en</strong>t elle va procéder« Ahh !!! Alors là ! Alors là j’peux t’là <strong>des</strong>siner… La plus belle. Ah ouais !! ». Le <strong>des</strong>sinévolue d’un coup, Lilou est beaucoup plus soignée, plus appliquée, elle change de feutres,choisi <strong>des</strong> couleurs adaptées pour être au plus près de la réalité. Elle se <strong>des</strong>sine belle,féminine avec <strong>des</strong> cheveux longs et « une barrette ». L’évolution du <strong>des</strong>sin montre bi<strong>en</strong>l’évolution de sa vision d’elle-même d’avant la maladie à maint<strong>en</strong>ant la belle <strong>en</strong>fant guérie.132
Juli<strong>en</strong> 12 ansA gauche : « Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital »A droite : « Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à la maison »133
Juli<strong>en</strong> (12 ans) va réaliser son <strong>des</strong>sin après notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Il va rester seul dans le salonp<strong>en</strong>dant que je comm<strong>en</strong>ce mon <strong>en</strong>treti<strong>en</strong> avec sa maman dans une autre pièce.Il utilise les feutres et les feuilles que j’ai am<strong>en</strong>és. Comme Liliane le <strong>des</strong>sin ne l’<strong>en</strong>chante paset il va s’y atteler avec la grimace. Ses <strong>des</strong>sins vont s’avérer très différ<strong>en</strong>ts et très parlant.Dessin de l’hôpitalLe <strong>des</strong>sin de Juli<strong>en</strong> est triste, vide et plutôt angoissant. Il est réalisé d’un grisuniforme qui r<strong>en</strong>force d’autant plus cette impression de tristesse. Ici <strong>en</strong>core on retrouve cetteimpression d’<strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>t à l’hôpital avec le <strong>des</strong>sin d’une pièce close sans toit ni f<strong>en</strong>être.Juli<strong>en</strong> le décrit d’ailleurs très bi<strong>en</strong> « J’voulais dire que j’étais vraim<strong>en</strong>t dans une piècefermée… on voyait pas l’soleil, c’est gris, c’est pas bi<strong>en</strong>, c’est pas agréable. » Juli<strong>en</strong> s’est<strong>des</strong>siné tout petit dans son grand lit et exprime sa souffrance verbalem<strong>en</strong>t. Encore une fois ils’est représ<strong>en</strong>té seul à l’hôpital sans soignant ni par<strong>en</strong>ts. Cet isolem<strong>en</strong>t évoque bi<strong>en</strong> lasolitude ress<strong>en</strong>tie probablem<strong>en</strong>t du fait de la maladie et amplifiée par le milieu hospitalier « làj’aurais mis un deuxième lit avec ou bi<strong>en</strong> ma mère ou bi<strong>en</strong> mon père ». Juli<strong>en</strong> va rajouter dansun second temps l’expression <strong>des</strong> visages sur son <strong>des</strong>sin. « Oh j’sais pas, vraim<strong>en</strong>t j’aioublié. » me dit-il.L’impression globale qui ressort égalem<strong>en</strong>t de ce <strong>des</strong>sin est la peur qu’a Juli<strong>en</strong> de lamaladie et <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital.Dessin de la maisonLe <strong>des</strong>sin de la maison est réchauffé par un beau soleil lumineux qui chasse le cotéterne et triste du <strong>des</strong>sin de l’hôpital. Juli<strong>en</strong> a réalisé ce <strong>des</strong>sin <strong>en</strong> couleur. « Là c’est plein decouleurs, c’est du soleil et c’est bi<strong>en</strong> ! » me dit-il. Il écrit d’ailleurs son soulagem<strong>en</strong>t d’être àla maison «Ha on est bi<strong>en</strong> chez soi ». Juli<strong>en</strong> s’est <strong>des</strong>siné plus grand dans son lit à la maison,comme si le fait d’être à la maison lui permettait d’exister malgré la maladie. Certes iln’est pas guéri, il est toujours allongé mais les <strong>soins</strong> ne sont pas représ<strong>en</strong>tés. A nouveau lamaison est un refuge contre les <strong>soins</strong>. Ils n’y ont d’ailleurs aucune place semble-t-il. Juli<strong>en</strong>n’a pas d’explication concernant l’abs<strong>en</strong>ce de sa famille sur les <strong>des</strong>sins, il m’explique justequ’il « aurait pu » les <strong>des</strong>siner mais « que là » qu’à la maison.La solitude de Juli<strong>en</strong> dans son combat et pour les <strong>soins</strong> est caractérisée dans ses<strong>des</strong>sins par l’abs<strong>en</strong>ce de représ<strong>en</strong>tation de sa famille et de personnel soignant, aussi bi<strong>en</strong> àl’hôpital qu’à la maison.134
Marie 6 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à lamaison »Marie 6 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong>à l’hôpital »135
Marie (6 ans) va réaliser ses <strong>des</strong>sins p<strong>en</strong>dant notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Je suis à coté d’elle sur sonbureau et je <strong>des</strong>sine égalem<strong>en</strong>t. Elle utilise indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t mes feutres et les si<strong>en</strong>s. Elle mesollicite régulièrem<strong>en</strong>t pour replacer sa main sur la feuille. Elle va interpréter son <strong>des</strong>sinp<strong>en</strong>dant sa réalisation. Il faut rappeler que Marie est aveugle et réalise son <strong>des</strong>sin toute seule àl’aide d’un tapis anti glisse qui empêche sa feuille de bouger. Vu le contexte je necomm<strong>en</strong>terai pas le graphisme du <strong>des</strong>sin.Dessin de la maison (Vert)Marie comm<strong>en</strong>ce par <strong>des</strong>siner sa maison. Les <strong>soins</strong> se font habituellem<strong>en</strong>t dans sachambre. Marie comm<strong>en</strong>te son <strong>des</strong>sin p<strong>en</strong>dant sa réalisation. Elle s’applique beaucoup àreprés<strong>en</strong>ter sa chambre dans sa maison. Une maison sur laquelle on peut reconnaitre un toit,<strong>des</strong> f<strong>en</strong>êtres et une porte d’<strong>en</strong>trée qui donne une impression de convivialité. Marie se <strong>des</strong>sinedans son lit « je fais mon lit, mon petit oreiller… », souriante « je suis <strong>des</strong> fois un petit peucont<strong>en</strong>te ». L’infirmière est prés<strong>en</strong>te avec elle dans la chambre « J’la fait grosse heinl’infirmière (…) c'est-à-dire euh grande quoi. C’est pareil. ». L’infirmière qui n’est pas trèsfacile à distinguer sur le <strong>des</strong>sin de Marie semble pr<strong>en</strong>dre beaucoup de place dans la chambre,comme si les <strong>soins</strong> <strong>en</strong>vahissai<strong>en</strong>t tout l’espace au mom<strong>en</strong>t de leur réalisation. Marie n’a niparlé ni représ<strong>en</strong>té ses par<strong>en</strong>ts sur son <strong>des</strong>sin ce qui pourrait évoquer sa solitude choisie ouress<strong>en</strong>tie face aux <strong>soins</strong>. Elle ne <strong>des</strong>sine aucun jeu dans sa chambre peut être par volonté de nepas tout mélanger et de mettre la maladie à distance de son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t familier.Dessin de l’hôpital (Rose)Marie <strong>des</strong>sine l’hôpital <strong>en</strong> rose, elle n’émet pas le souhait de changer de couleur. Sacécité peut expliquer le fait qu’elle soit détachée de la couleur <strong>des</strong> feutres qu’elle utilise, cescouleurs n’ayant que peu de signification pour elle. Marie va faire un grand carré pourreprés<strong>en</strong>ter l’hôpital « j’l’ai fait grand l’hôpital » me dit-elle. Les détails sont moinsimportants que pour le <strong>des</strong>sin de la maison, comme si elle ne voulait pas s’appesantir surl’hôpital lieu de la maladie, de la douleur et <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. De plus elle n’a <strong>des</strong>siné qu’une seulef<strong>en</strong>être (<strong>en</strong> bas à gauche) et aucune porte à son hôpital ce qui pourrait évoquer l’<strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>tque Marie ress<strong>en</strong>t lorsqu’elle est hospitalisée. A nouveau Marie se <strong>des</strong>sine dans son lit. Les<strong>soins</strong> sont évoqués par la prés<strong>en</strong>ce de l’infirmière dans sa chambre (<strong>en</strong> bas sur le <strong>des</strong>sin à cotéde la f<strong>en</strong>être). Ses par<strong>en</strong>ts ne sont pas prés<strong>en</strong>ts sur son <strong>des</strong>sins ni évoqués, la solitude deMarie semble toujours bi<strong>en</strong> prés<strong>en</strong>te. Marie ne s’appesantit pas sur la <strong>des</strong>cription de son<strong>des</strong>sin à l’hôpital et reste très factuelle. Elle demande rapidem<strong>en</strong>t à passer à un autre <strong>des</strong>sin.136
Timéo 12 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »Timéo 12 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à lamaison »137
Timéo (12 ans) va réaliser son <strong>des</strong>sin dans les suites immédiates de notre <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Jerappelle que l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> s’est déroulé à l’IHOP dans une chambre double <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de soncamarade de chambre. Timéo ne va émettre aucune objection au <strong>des</strong>sin et va même le réaliseravec beaucoup d’att<strong>en</strong>tion, de conc<strong>en</strong>tration et de précision. Timéo est le seul <strong>en</strong>fant à ne pasavoir été pris <strong>en</strong> charge par l’équipe de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> de l’IHOP. Legraphisme est correct adapté à l’âge de Timéo. Les personnages sont représ<strong>en</strong>tés sous laforme de personnages bâtons sans différ<strong>en</strong>ciation de g<strong>en</strong>re (pas d’habit, seule l’infirmière à lamaison à les cheveux longs…).Dessin à l’hôpitalLe <strong>des</strong>sin de Timéo est très réaliste calqué sur la chambre dans laquelle il se trouvelorsque je le r<strong>en</strong>contre. Les couleurs sont plutôt tristes, la couverture bleue est <strong>en</strong>core une foisbi<strong>en</strong> représ<strong>en</strong>tée. Timéo explique qu’à l’hôpital « Y’a pas beaucoup de couleurs… ». Le seulcoté chaleureux de ce <strong>des</strong>sin est représ<strong>en</strong>té par le soleil dont les rayons pénètr<strong>en</strong>t jusque dansla chambre. Il semble réchauffer un peu l’atmosphère triste de la chambre d’hôpital.Timéo s’est <strong>des</strong>siné allongé dans son lit branché à sa chimiothérapie. Il pr<strong>en</strong>d unebonne place dans son lit, investit l’espace et est le personnage c<strong>en</strong>tral de ce <strong>des</strong>sin. Aucuneautre personne n’est représ<strong>en</strong>tée sur ce <strong>des</strong>sin évoquant à nouveau le combat solitaire del’<strong>en</strong>fant contre son cancer. Timéo est souriant dans son lit ce qui pourrait laisser à p<strong>en</strong>serqu’il se s<strong>en</strong>t <strong>en</strong> sécurité à l’hôpital p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong>.Dessin de la maisonLe <strong>des</strong>sin que Timéo a réalisé <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à la maison semble moins rassurant que celuiqu’il a fait de l’hôpital. Les couleurs sont pourtant plus diversifiées, le soleil <strong>en</strong>core une foisillumine la pièce. La f<strong>en</strong>être est cep<strong>en</strong>dant plus petite. Timéo s’est représ<strong>en</strong>té au fond de lapièce assis sur un canapé. Il est plus petit que l’infirmière qui « sourit » au premier plan.Timéo ne s’est pas fait de visage comme s’il n’avait pas le droit de s’exprimer, d’exprimersa souffrance p<strong>en</strong>dant les <strong>soins</strong> à la maison. Il me l’explique par « j’étais loin ». Les <strong>soins</strong>sont représ<strong>en</strong>tés par une infirmière et la piqûre de granocytes <strong>des</strong>sinée sur la table du salonqui évoquerait plus un marteau, une arme qu’une seringue. L’infirmière semble plutôteffrayante malgré le sourire décrit par Timéo. Timéo est là <strong>en</strong>core seul pour les <strong>soins</strong>, sespar<strong>en</strong>ts « ça dép<strong>en</strong>d ! Des fois ils sont là, <strong>des</strong> fois ils sont pas là. ». Aucun jouet n’est prés<strong>en</strong>tdans la salle à manger, la pièce <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Timéo ne souhaite pas mélanger les <strong>soins</strong> et sachambre, son cocon « c’est là où y’a toutes les affaires, tous les jouets ». On pourrait y voir138
une volonté de laisser la maladie <strong>en</strong> dehors de son univers, de ne pas lui laisser de place. Lamaman de Timéo m’expliquait p<strong>en</strong>dant l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> « C’était très mal vécu chaque fois qu’il yavait la prise de sang et <strong>en</strong>core plus les piqures de granocytes. Il les appréh<strong>en</strong>daiténormém<strong>en</strong>t. » Ce ress<strong>en</strong>ti, alors qu’elle n’a pas vu le <strong>des</strong>sin de son fils, exprime bi<strong>en</strong> less<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts qui sembl<strong>en</strong>t se dégager du <strong>des</strong>sin de Timéo.139
Mathilde 6 ansDessin réalisé <strong>en</strong> Juillet 2011 <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de sa psychiatre.Ce <strong>des</strong>sin m’a été remis par la maman de Mathilde. Il n’est pas comm<strong>en</strong>té.140
ConclusionsLes cancers de l’<strong>en</strong>fant, bi<strong>en</strong> que peu préval<strong>en</strong>ts, sont une réalité pour les famillestouchées par ce drame. Leur monde « s’écroule ». Actuellem<strong>en</strong>t soixante quinze pour c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>viron <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants vont guérir de leur cancer au prix de traitem<strong>en</strong>ts parfois très lourds et trèslongs. Lorsque cela est possible, tant pour répondre à une demande de la famille que pour <strong>des</strong>raisons médico-économiques, certains <strong>soins</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à être transférés vers le <strong>domicile</strong>.Dans la région Rhône-Alpes, à l’IHOP, une équipe soignante spécialisée <strong>en</strong>oncopédiatrie et dédiée à la coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> a été mise <strong>en</strong> place depuisl’année 2008. Composée d’un médecin oncopédiatre coordinateur, d’une infirmièrecoordinatrice et de trois infirmières de terrain, cette équipe a vocation à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge dèsl’hospitalisation les familles dont l’<strong>en</strong>fant va bénéficier de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>, de leur <strong>en</strong>expliquer le fonctionnem<strong>en</strong>t, d’organiser le retour et le suivi <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. L’équipe peutinterv<strong>en</strong>ir au plus près <strong>des</strong> familles <strong>en</strong> se déplaçant à <strong>domicile</strong> et <strong>en</strong> travaillant <strong>en</strong> réseau avecle médecin généraliste et les infirmiers ambulatoires dans le cadre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs.L’étude qualitative pilote que j’ai m<strong>en</strong>ée a permis aux <strong>en</strong>fants atteints de cancer et àleurs par<strong>en</strong>ts de s’exprimer librem<strong>en</strong>t sur le vécu de la maladie et <strong>des</strong> <strong>soins</strong> et de formulerleurs att<strong>en</strong>tes concernant la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong>. La longueur <strong>des</strong> <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s avec lespar<strong>en</strong>ts est la preuve de leur besoin de s’exprimer sur ce sujet.Selon les <strong>en</strong>fants et leurs par<strong>en</strong>ts, les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> permett<strong>en</strong>t de préserver leconfort matériel et affectif de l’<strong>en</strong>fant. Cela les aide à mieux accepter les <strong>soins</strong> et leur permetde conserver une vie sociale avec <strong>des</strong> retours à l’école adaptés et aussi fréqu<strong>en</strong>ts que leur étatle leur permet. Le <strong>domicile</strong> comme lieu alternatif à l’hôpital est plébiscité par les <strong>en</strong>fants et lespar<strong>en</strong>ts. Les <strong>en</strong>fants s’y s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> et les par<strong>en</strong>ts appréci<strong>en</strong>t la limitation <strong>des</strong> trajets et del’att<strong>en</strong>te à l’hôpital. Ils conserv<strong>en</strong>t une certaine liberté d’action. En dehors <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> <strong>des</strong>oins ils peuv<strong>en</strong>t organiser leur journée comme ils le souhait<strong>en</strong>t.Cep<strong>en</strong>dant la vision idéale <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> prés<strong>en</strong>tée par les <strong>en</strong>fants est à nuancer.Certes la prise <strong>en</strong> charge à <strong>domicile</strong> apporte <strong>des</strong> avantages incontestables <strong>en</strong> termes de qualitéde vie mais il faut pouvoir la jalonner de garde-fous afin que tout se passe au mieux pour la141
famille. Les <strong>soins</strong> sont réalisables à <strong>domicile</strong> dans la mesure où le niveau de sécurité et leurefficacité sont les mêmes qu’à l’hôpital. Il ne doit pas exister de perte de chance pour l’<strong>en</strong>fant.Les par<strong>en</strong>ts sont souv<strong>en</strong>t garants de l’autorité médicale à la maison et se retrouv<strong>en</strong>t, de fait,mis <strong>en</strong> position de soignants. Une lourde responsabilité leur incombe, celle de veiller sur lasanté de leur <strong>en</strong>fant, responsabilité angoissante à laquelle ils ne sont pas forcém<strong>en</strong>tsuffisamm<strong>en</strong>t préparés. A l’hôpital les par<strong>en</strong>ts se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>en</strong> sécurité. Entourés d’une équipetrès spécialisée ils peuv<strong>en</strong>t se soulager de cette responsabilité médicale pour redev<strong>en</strong>ir« par<strong>en</strong>ts ». Si la place <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts à la maison n’est pas aussi définie qu’à l’hôpital c’estparce qu’ils ont besoin de s’impliquer dans la prise <strong>en</strong> charge, jusqu’à réaliser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>en</strong>autonomie complète ou même parfois pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> décisions sans consulter l’équipe référ<strong>en</strong>te.Les <strong>en</strong>fants, de leur coté, réclam<strong>en</strong>t le cadre rassurant de l’hôpital lorsqu’ils sont douloureuxou très affaiblis. Mais <strong>en</strong> dehors de ces mom<strong>en</strong>ts difficiles, l’hôpital reste un lieu hostile.Les par<strong>en</strong>ts se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t parfois très seuls, insécurisés à <strong>domicile</strong> avec leur <strong>en</strong>fant maladeévoquant même une impression « d’abandon ». Certains aménagem<strong>en</strong>ts ont été mis <strong>en</strong> placepour limiter ce s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de solitude. Il existe d’ailleurs une possibilité de li<strong>en</strong> téléphoniqueperman<strong>en</strong>t avec l’IHOP, la plupart du temps par le biais de l’infirmière référ<strong>en</strong>tecoordinatrice, interlocuteur unique et connu <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts. Cette organisation est très rassurantepour eux.Les par<strong>en</strong>ts évoqu<strong>en</strong>t aussi une limite technique aux <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> et s’interrog<strong>en</strong>tsouv<strong>en</strong>t sur les compét<strong>en</strong>ces du personnel para médical ambulatoire qui est, selon eux, peuhabitué à réaliser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> sur <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants. Pour certains de ces par<strong>en</strong>ts la formationdisp<strong>en</strong>sée par les infirmières de l’IHOP est suffisante pour les mettre <strong>en</strong> confiance. Pourd’autres ainsi que pour certains <strong>en</strong>fants, la technique <strong>des</strong> soignants ambulatoires et leur intérêtpour ces <strong>soins</strong> spécialisés ne sont pas suffisants. Le vécu <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts ayant connu les <strong>soins</strong>palliatifs est différ<strong>en</strong>t sur ce point. L’objectif <strong>des</strong> <strong>soins</strong> est alors le confort de l’<strong>en</strong>fant et nonplus une haute technicité prometteuse de guérison. Dans ce cadre, le passage régulier depersonnel hospitalier explique bi<strong>en</strong> les raisons de cette différ<strong>en</strong>ce de point de vue. Ils ses<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tourés.L’univers médical reste omniprés<strong>en</strong>t à <strong>domicile</strong>. Plus que le cancer ou l’hémopathie cesont les <strong>soins</strong> qui r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong> et dont ils se plaign<strong>en</strong>t. Ils parl<strong>en</strong>t de <strong>soins</strong> qui« <strong>en</strong>laidiss<strong>en</strong>t » et qui « isol<strong>en</strong>t ». Le confinem<strong>en</strong>t à <strong>domicile</strong> p<strong>en</strong>dant les pério<strong>des</strong> d’aplasie142
est pesant pour les <strong>en</strong>fants. Mais les contacts et les relations sociales évolu<strong>en</strong>t aussi pour lespar<strong>en</strong>ts. Leur vie d’adulte est occultée, leur métier, leurs loisirs, leurs projets égalem<strong>en</strong>t.L’organisation du quotidi<strong>en</strong> se fait au jour le jour. Même les rev<strong>en</strong>us du couple et donc sonniveau de vie sont affectés.Le médecin généraliste reste le grand abs<strong>en</strong>t de ces prises <strong>en</strong> charge. Même dans lecadre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> palliatifs où il est, de fait, intégré dans le réseau de <strong>soins</strong>, les par<strong>en</strong>tsexprim<strong>en</strong>t un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de solitude. Si le médecin est prés<strong>en</strong>t physiquem<strong>en</strong>t sur le terrain il nel’est que trop peu voire pas du tout dans les prises <strong>en</strong> charge d’oncopédiatrie et souv<strong>en</strong>t augrand regret <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts. Le médecin généraliste n’a pas sa place dans la partie technique <strong>des</strong><strong>soins</strong>, les médecins eux-mêmes le reconnaiss<strong>en</strong>t, les par<strong>en</strong>ts et les <strong>en</strong>fants s’accord<strong>en</strong>t aussipour le dire. Mais les par<strong>en</strong>ts aimerai<strong>en</strong>t pouvoir compter sur lui pour le suivi à <strong>domicile</strong> avec<strong>des</strong> contacts réguliers, pour <strong>des</strong> nouvelles, pour un souti<strong>en</strong> et une réassurance lorsque laresponsabilité médicale devi<strong>en</strong>t pesante. Le médecin généraliste n’est ni spécialisé <strong>en</strong>psychologie ni <strong>en</strong> oncopédiatrie mais il connait les familles et parmi ses compét<strong>en</strong>cesl’approche c<strong>en</strong>trée sur le pati<strong>en</strong>t et la relation trouv<strong>en</strong>t ici toute leur légitimité. N’est il pas unde ceux qui pourrai<strong>en</strong>t le mieux sout<strong>en</strong>ir les par<strong>en</strong>ts et la famille à <strong>domicile</strong>? Certainsmédecins généralistes ne veul<strong>en</strong>t ou ne peuv<strong>en</strong>t pas s’impliquer dans la prise <strong>en</strong> charge, pour<strong>des</strong> raisons personnelles ou parce qu’ils ne se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas humainem<strong>en</strong>t disponibles pourassumer un suivi décrit comme « lourd ». Cet <strong>en</strong>fant, le médecin l’a vu naitre, il l’a souv<strong>en</strong>tsuivi, il s’y est probablem<strong>en</strong>t attaché… L’idée de la confrontation avec la mort d’un <strong>en</strong>fant estd’ailleurs « inacceptable » pour les médecins généralistes. En outre certains par<strong>en</strong>tspréfèreront changer de médecin traitant lorsque la prise <strong>en</strong> charge de leur <strong>en</strong>fant sera terminéecar l’interaction leur rappelle trop de souv<strong>en</strong>irs douloureux.Finalem<strong>en</strong>t cette étude prouve que le souhait <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants atteints de cancer oud’hémopathie et de leurs par<strong>en</strong>ts est de développer les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. Cep<strong>en</strong>dant il faudraitles développer différemm<strong>en</strong>t avec un étayage si possible plus conséqu<strong>en</strong>t sur le terrain. Lespar<strong>en</strong>ts, qui form<strong>en</strong>t à eux seuls les fondations de l’édifice de <strong>soins</strong>, ont besoin d’un souti<strong>en</strong>matériel, financier et psychologique. Cet édifice devi<strong>en</strong>t vite instable dès qu’ils sont <strong>en</strong>souffrance. Les par<strong>en</strong>ts ont surtout besoin de souti<strong>en</strong> et de réassurance concernant les <strong>soins</strong> à<strong>domicile</strong> lorsque la pression de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et de l’autorité médicale devi<strong>en</strong>t tropimportante. Le médecin traitant pourrait trouver là une place du domaine de ses compét<strong>en</strong>ces.Un médecin généraliste est un médecin de terrain, qui peut interv<strong>en</strong>ir au plus près <strong>des</strong>143
familles, <strong>en</strong> visite si nécessaire. Il faudrait réfléchir à un moy<strong>en</strong> d’impliquer <strong>des</strong> médecins deterrain afin qu’ils puiss<strong>en</strong>t proposer leurs compét<strong>en</strong>ces relationnelles et d’écoute spécifiquesaux familles ainsi que <strong>des</strong> compét<strong>en</strong>ces de coordination <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts acteurs de <strong>soins</strong>.Enfin il serait intéressant de réfléchir à la relation qu’il existe <strong>en</strong>tre le degré d’insécuritéress<strong>en</strong>ti par les par<strong>en</strong>ts à <strong>domicile</strong> et la prise <strong>en</strong> charge proposée par l’hôpital. Peut être laresponsabilité médicale n’est-elle pas proportionnelle à la quantité de <strong>soins</strong> réalisés à<strong>domicile</strong> ? Il est égalem<strong>en</strong>t possible que l’insécurité ress<strong>en</strong>tie soit plus liée à la pathologieelle-même qu’aux <strong>soins</strong> prodigués… Un travail complém<strong>en</strong>taire sur le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de sécurité à<strong>domicile</strong> pourrait apporter quelques élém<strong>en</strong>ts de réponses.144
Bibliographie1. Ministère de la santé, de la famille et <strong>des</strong> personnes handicapées. Circulaire DHOS/On° 2004-161 relative à l’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>en</strong> cancérologie pédiatrique [<strong>en</strong> ligne].29 mars 2004. Site disponible sur (Consulté le 16/01/2013)2. Satchivi A., Bertheau A., Barret B., Evangelista E., Arrouch S. Soins etHospitalisation à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> Oncopédiatrie : Analyse <strong>des</strong> comportem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong>soignants. Mémoire Méd : Lyon 1, Lyon Est : 20093. ©La situation du cancer <strong>en</strong> France <strong>en</strong> 2010. Collection Rapports Synthèse, ouvragecollectif édité l’INCa. Boulogne Billancourt, novembre 20104. Bergeron C. Cancer de l’<strong>en</strong>fant : particularités épidémiologiques diagnostiques etthérapeutiques. Module 10 Item 44. Faculté de médecine Lyon Sud LaboratoireMultimédia Médical. 2006.Disponible sur (Consulté le29/01/2013)5. Santélog. Prise <strong>en</strong> charge <strong>en</strong> oncologie pédiatrique. Petite Enfance Septembre octobre2009 ; 6 : 20 p6. Suc A. « Je voudrais r<strong>en</strong>trer à la maison » Prise <strong>en</strong> charge de l’<strong>en</strong>fant à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong>oncopédiatrie. Oncologie 2006 ; 8 : HS58-HS617. Article 371-1 modifié par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 2 JORF 5 mars2002. Code civil <strong>version</strong> consolidée au 1er janvier 2013. Disponible sur (Consulté le 15 février 2013)8. Cresson G. Hospitalisation à <strong>domicile</strong> : autour de l’<strong>en</strong>fant malade. Informationsociales 2006 ; 5 : 66-73145
9. Ministère <strong>des</strong> affaires sociales et de la santé. INSTRUCTIONN°DGOS/R3/INCa/2012/297 du 30 juillet 2012 relative à l’élaboration du bilan de lamise <strong>en</strong> conformité <strong>des</strong> titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitem<strong>en</strong>t ducancer. INCa. Juillet 2012.10. (site internet de l’IHOP, ongletPrés<strong>en</strong>tation) (consulté le 11/02/2013)11. Schell M., Castaing M. Chapitre 10. Particularité de la prise <strong>en</strong> charge et de lachimiothérapie à <strong>domicile</strong> <strong>en</strong> pédiatrie. In : Qualité de vie <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts atteints decancer chimiothérapie et services de <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>. Paris : John Libbey Eurotext,2010 : 97-10112. Schell M. Soins terminaux pédiatriques à <strong>domicile</strong> : Une étude rétrospective du vécu<strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts. Prés<strong>en</strong>tation orale. Congrès Francophone de <strong>soins</strong> palliatifs de Montréal.200613. Côté L, Turgeon J. Comm<strong>en</strong>t lire de façon critique les articles de recherche qualitative<strong>en</strong> médecine. Pédagogie Médicale 2002 ; 3 : 81-9014. Britt<strong>en</strong> N. Qualitative Research: Qualitative interviews in medical research. BMJ1995; 311: 251-315. Drapeau M. Les critères de sci<strong>en</strong>tificité <strong>en</strong> recherché qualitative. Pratiquespsychologiques 2004 ; 10 : 79-8616. Aubin-Auger I. et al. Introduction à la recherche qualitative. Exercer 2008 ; 84 : 142-5.17. Opp<strong>en</strong>heim D. Grandir avec un cancer. L’expéri<strong>en</strong>ce vécue par l’<strong>en</strong>fant etl’adolesc<strong>en</strong>t. Bruxelles : De Boeck, 2009 : 227 p18. Invs. « Incid<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> cancers de l’<strong>en</strong>fant <strong>en</strong> France : données <strong>des</strong> registres pédiatriquesnationaux », 2000-2004. BEH 28 décembre 2010 ; 49-5019. Blanchet A, Gotman A. L’<strong>en</strong>quête et ses métho<strong>des</strong> : l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Paris: éditions Nathan1992 : 127 p20. Rufo M. Œdipe toi-même ! Consultations d’un pédopsychiatre. Paris : Edition AnneCarrière, 2000 : 187 p146
21. Cresson G. Les par<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>fants hospitalisés à <strong>domicile</strong>. Leur participation aux <strong>soins</strong>.Paris : L’Harmattan, 2000. Logiques Sociales : 208 p22. Leverger G. et al. Passage <strong>en</strong> phase palliative <strong>en</strong> cancérologie pédiatrique. Elaborationde la décision et transmission de l’information à l’équipe et à la famille. Revueinternationale de <strong>soins</strong> palliatifs 2003/2 ; 18 : 97-10023. Josse E. Le vécu <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts d’un <strong>en</strong>fant malade du cancer. 2006. Disponible surhttp://www.resili<strong>en</strong>ce-psy.com/spip.php?rubrique11 (consulté le 28/01/2013)24. N. Trocmé, Guy Leverger et al. Place par<strong>en</strong>tale dans la maladie d’<strong>en</strong>fants atteints deleucémie, aujourd’hui guéris et adolesc<strong>en</strong>ts. In : Colloque : Par<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>fantshospitalisés : Visiteurs ou part<strong>en</strong>aires ? Association Sparadrap. 5 octobre 2004 ; 130-134 Docum<strong>en</strong>t disponible sur (Consulté le 15/02/2013)25. Dagnicourt P. Soigner ses proches une attitude à raisonner ? Réflexion sur lesinterfér<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre la relation de soin et la relation préexistante par <strong>en</strong>quête qualitative.2012. Exercice Th. Méd. Angers : 201226. Santarelli-M<strong>en</strong>egon F., Von der Weid N., Michel L., Muller Nix C. Etre le frère ou lasœur d’un <strong>en</strong>fant atteint de cancer : un groupe de parole. Rev Med Suisse 2010 ; 6 :2372-527. Balande F. Une vie scolaire pour les <strong>en</strong>fants mala<strong>des</strong>. Enfances & Psy 2001 ; 16 : 104-10828. Opp<strong>en</strong>heim D. Là-bas, la vie Des <strong>en</strong>fants face à la maladie. Paris : Edition du seuil,octobre 2010. 163 p29. Hov<strong>en</strong> E, von Ess<strong>en</strong> L, Norberg AL. A longitudinal assessm<strong>en</strong>t of work situation, sickleave, and household income of mothers and fathers of childr<strong>en</strong> with cancer inSwed<strong>en</strong>. Acta Oncol. 2013 jan 23. [Epub ahead of print]147
30. Josse E. Le vécu de l’<strong>en</strong>fant atteint d’une maladie cancéreuse. Diagnostic et premièrehospitalisation. 2006.Disponible sur http://www.resili<strong>en</strong>ce-psy.com/spip.php?article13 (consulté le28/01/2013)31. Ministère de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur et de la recherche, ministère de la santé et <strong>des</strong>sports. Mesure 18. Personnaliser la prise <strong>en</strong> charge <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> et r<strong>en</strong>forcer le rôle dumédecin traitant. In : Plan cancer 2009-2013. Disponible sur < http://www.plancancer.gouv.fr/le-plan-cancer/5-axes-30-mesures/axe-<strong>soins</strong>/mesure-18.html>(Consulté le 15/02/2013)32. Lamort-Bouché M. Critères et déterminants du choix de spécialité <strong>en</strong> médecine : placede la médecine générale. Etude qualitative <strong>des</strong> représ<strong>en</strong>tations <strong>des</strong> étudiants deDCEM4 de Lyon Est <strong>en</strong> 2009-2010. 2010. 176p. Exercice Th Méd : Lyon, UFR LyonEst : 2010 : 13833. La Ligue contre le cancer. « les médecins généralistes face au cancer ». Communiquéde Presse – Résultats. 6 octobre 2010.34. Royer J. Dessin du bonhomme : la personnalité de l’<strong>en</strong>fant dans tous ses états.Revergny-sur-Ornain : Les éditions du journal <strong>des</strong> psychologues. Mars 2011. 315p148
Annexes1. Les Gui<strong>des</strong> d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>Guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> semi dirigéThèse : vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> pour les <strong>en</strong>fants atteints de cancer et leur famillePar<strong>en</strong>ts (à interroger séparém<strong>en</strong>t)1. La maladieEst-ce que vous pouvez me parler de votre <strong>en</strong>fant avant la maladie ? (place dans la famille,scolarité, copains)Depuis quand votre <strong>en</strong>fant est- il malade ? Comm<strong>en</strong>t a-t-on découvert sa maladie ? (annoncediagnostique)Pouvez vous me parler un peu plus de la maladie de votre <strong>en</strong>fant ? (prise <strong>en</strong> charge,traitem<strong>en</strong>t, évolution)2. L’hospitalisation/ Les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>Le retour à la maison :Quand et comm<strong>en</strong>t a été élaborée l’option <strong>des</strong> <strong>soins</strong>/de l’hospitalisation à <strong>domicile</strong> ?Qui a choisi ou proposé le retour à <strong>domicile</strong> ? (Vous, votre <strong>en</strong>fant, l’équipe médicale…)Qui vous a expliqué comm<strong>en</strong>t allait se passer le retour à <strong>domicile</strong> de votre <strong>en</strong>fant? Et à votre<strong>en</strong>fant ?149
Et l’hôpitalA quel rythme retournez vous à l’hôpital ? (Sous quelle forme (HJ, Consultation,Hospitalisation complète), distance hôpital-maison)A <strong>domicile</strong> :Quel est votre ress<strong>en</strong>ti concernant les <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong>?-comparaison hospitalisation classique- avantages, inconvéni<strong>en</strong>ts, rétic<strong>en</strong>ces- difficultés d’organisation (vie de famille, vie de couple, quotidi<strong>en</strong>…)- solutions ?Où vous s<strong>en</strong>tez vous votre <strong>en</strong>fant le plus <strong>en</strong> sécurité ? (à la maison ou à l’hôpital) Pourquoi ?Votre vision <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> a-t-elle changé depuis que vous y êtes confronté ? Dansquelle mesure ?Vous êtes vous s<strong>en</strong>ti abandonné par la structure hospitalière lors de la prise de cette décision ?Pourquoi ?A propos du personnel soignant :Qui vi<strong>en</strong>t ?A quelle fréqu<strong>en</strong>ce ?Souhaiteriez-vous une prise <strong>en</strong> charge plus conséqu<strong>en</strong>te ou différ<strong>en</strong>te ? A quel niveau ? Et parqui ?Comm<strong>en</strong>t et à qui posez vous vos questions ou exprimez vous vos craintes à la maison ?150
- Différ<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre l’hôpital et la maisonVous s<strong>en</strong>tez vous sout<strong>en</strong>u face à la maladie de votre <strong>en</strong>fant ? Pourquoi ? De quelle manière ?Le médecin généralisteQuel rôle attribuez-vous à votre médecin traitant ? Quelle est sa place dans la prise <strong>en</strong> chargede votre <strong>en</strong>fant ? Et pour vous ? (place dans l’organisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> ambulatoires, souti<strong>en</strong>)Avez-vous <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes particulières concernant votre médecin traitant ?3. La vie quotidi<strong>en</strong>ne à la maison avec un <strong>en</strong>fant maladeL’Ecole :A-t-il pu repr<strong>en</strong>dre l’école ?Si oui comm<strong>en</strong>t cela se passe t il ?Si non pourquoi ? Y’a-t-il <strong>des</strong> mesures qui ont été prises pour sa scolarité ?Les Copains :A-t-il <strong>des</strong> visites <strong>en</strong> dehors du personnel médical ?Comm<strong>en</strong>t cela se passe-t-il ?La vie à la maison :Comm<strong>en</strong>t s’organise la vie à la maison avec un <strong>en</strong>fant malade ?Est-ce que la maladie a changé les rapports/ la relation que vous avez avec votre <strong>en</strong>fant ?Pouvez-vous me l’expliquer ? Et le retour à la maison ?Avez-vous d’autres <strong>en</strong>fants ?Comm<strong>en</strong>t cela se passe-t-il pour vos autres <strong>en</strong>fants ? (relation avec l’<strong>en</strong>fant malade, viequotidi<strong>en</strong>ne)151
Avez-vous eu besoin d’aménager votre temps de travail pour vous occuper de votre <strong>en</strong>fant ?Dans quelle mesure ?Comm<strong>en</strong>t vivez-vous moralem<strong>en</strong>t l’apparition de la maladie et <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dans l’intimité devotre famille ?Vous s<strong>en</strong>tez vous sout<strong>en</strong>u ? (proposition d’ai<strong>des</strong>)Y’a-t-il <strong>des</strong> sujets que nous n’avons pas abordés et dont vous souhaiteriez parler ?152
Guide d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> semi dirigéThèse : vécu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à <strong>domicile</strong> pour les <strong>en</strong>fants atteints de cancer et leur familleEnfants1. DessinThème : toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital et toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à la maisonTu pr<strong>en</strong>ds une feuille que tu sépares <strong>en</strong> deux ou deux feuilles séparées et tu me fais un <strong>des</strong>sinde chaque coté.Tu notes bi<strong>en</strong> ton prénom et ton âge sur chaque feuilleMaint<strong>en</strong>ant je vais discuter avec maman et papa puis on se revoit après pour qu’on parles deta maladie et de tes <strong>soins</strong> et tu m’expliqueras ton <strong>des</strong>sin2. La maladieEst-ce que tu peux me parler de ta maladie ?-nom, depuis quand, diagnostic (comm<strong>en</strong>t tu t’<strong>en</strong> es r<strong>en</strong>du compte)tout ?- son évolution, ses traitem<strong>en</strong>ts (comm<strong>en</strong>t ca se passe), qui te soigne et t’explique- tes s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts (ce que tu ress<strong>en</strong>s)Est-ce qu’il y a <strong>des</strong> choses que tu voudrais qu’on t’explique <strong>en</strong> plus de ce que tu sais déjà surta maladie ?- Facilité de poser les questions, à qui- Différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre l’hôpital et la maison153
Avec qui <strong>en</strong> parles tu le plus ? (papa, maman, tes infirmiers/ères, ta maitresse, tes frères etsœurs, ton/tes docteurs ?) C’est <strong>des</strong> personnes différ<strong>en</strong>tes à l’hôpital et à la maison ?3. A propos <strong>des</strong> <strong>soins</strong>/ de l’hospitalisation à <strong>domicile</strong>Est-ce que c’est toi qui as voulu r<strong>en</strong>trer à la maison, comm<strong>en</strong>t ça s’est passé ?Raconte moi comm<strong>en</strong>t se pass<strong>en</strong>t les <strong>soins</strong> à la maison ? (<strong>des</strong>sin +++)- Nature <strong>des</strong> <strong>soins</strong>- Différ<strong>en</strong>ce avec l’hôpital- Ton ress<strong>en</strong>ti- Avantages et inconvéni<strong>en</strong>tsQu’est ce qui te gène le plus dans les traitem<strong>en</strong>ts qu’on te donne ? Qu’est ce qui t’aide lemieux ?Est-ce que tu retournes souv<strong>en</strong>t à l’hôpital ? Comm<strong>en</strong>t ça se passe ? (HJ, consultations,hospitalisations complètes…)Ou te s<strong>en</strong>s tu le lus <strong>en</strong> sécurité ?Qui vi<strong>en</strong>t te voir à la maison ? (personnel soignant surtout) comm<strong>en</strong>t ça se passe pour toi ?T’arrive-t-il d’avoir peur parfois à cause de ta maladie ?- Ton ress<strong>en</strong>ti- Avec qui tu <strong>en</strong> parles dans ces cas la ? (famille, soignants)Qu’est ce que tu voudrais que les autres (surtout le personnel soignant) fass<strong>en</strong>t pour t’aider ?Et ton médecin traitant (docteur de la famille) tu le vois parfois ? En quoi est ce qu’il t’aide ?154
4. La vie quotidi<strong>en</strong>neLa vie à la maison :Est-ce que tu trouves que la vie à la maison a changé depuis que tu es malade ?Pourquoi ? Comm<strong>en</strong>t ?Est-ce que tu as <strong>des</strong> frères et sœurs ?Et comm<strong>en</strong>t ça se passe (relations : disputes, discussion...) Avec tes frères et sœurs depuis quetu es malade? Et avec tes par<strong>en</strong>ts? Et avec ta famille ?Qu’est ce qui a changé <strong>en</strong>tre vous ? (papa et maman, frères et sœurs, amis…) au niveau devos relations ?Est-ce que ça te gène ?As-tu plus de visites (famille, amis) depuis que tu es à la maison ? Qui vi<strong>en</strong>t te voir ?Pourquoi ?L’école :Comm<strong>en</strong>t ca se passe pour toi depuis que tu es r<strong>en</strong>tré à la maison ? Est-ce que tu as manqué laclasse ou redoublé à cause de ta maladie ? …Est-ce que le regard de tes camara<strong>des</strong> de classe a changé ? Qu’est ce que tu ress<strong>en</strong>ts ?Les copains :Est-ce que tu vois tes copains aussi souv<strong>en</strong>t qu’avant ? Et par rapport à quand tu étais tout letemps à l’hôpital ?Qu’est ce qui a changé avec tes copines et tes copains depuis que tu es malade ?155
En ce mom<strong>en</strong>t qu’est ce que tu peux faire et ne pas faire ?Quelles solutions as-tu trouvées ?C’est quoi pour toi une vie normale ?1. Et si tu es mal parfois…Le mal-êtreEst-ce qu’il t’arrive de te s<strong>en</strong>tir mal par rapport à ta maladie ? Tu peux m’expliquer comm<strong>en</strong>ttu te s<strong>en</strong>s dans ces mom<strong>en</strong>ts là ?- Intérêt d’être à la maisonEst-ce que tu as déjà r<strong>en</strong>contré <strong>des</strong> psychologues ou psychiatres (<strong>des</strong> g<strong>en</strong>s spécialistes de laparole) ?(Si abordé spontaném<strong>en</strong>t ou par le <strong>des</strong>sinLa mort T’arrive-t-il de p<strong>en</strong>ser parfois à la mort ? )As-tu <strong>en</strong>core <strong>des</strong> choses concernant ta maladie ou la vie à la maison que tu souhaiterais medire ?156
2. Les <strong>des</strong>sins- L’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> testHélène quatorze ans, Epiphysiolyse aiguë de hanche157
- Dessins <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants sainsJade huit ans et demi« Toi <strong>en</strong><strong>soins</strong> àl’hôpital »« Toi <strong>en</strong><strong>soins</strong> à lamaison »158
Eliott douze ansA gauche : « Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à l’hôpital »« Salle blanche, visage sans expression, plateau repas posé sur le lit, table de nuit avecbeaucoup de médicam<strong>en</strong>ts, infirmière s’affairant autour du lit » (Description qu’Eliott ainscrite au dos de son <strong>des</strong>sin)A droite : « Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> à la maison »« Salle colorée, murs avec posters, (doudou si 5 ans), table de nuit avec jouets, livres, par<strong>en</strong>tss’occupant de lui, quelques médicam<strong>en</strong>ts »159
Aude 7 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »« Toi <strong>en</strong><strong>soins</strong> à lamaison »160
Pierre 9 ans« Toi <strong>en</strong> <strong>soins</strong> àl’hôpital »« Toi <strong>en</strong><strong>soins</strong> à lamaison »161
3. Les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>sLes <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s retranscrits sont fournis sur le CD joint.162