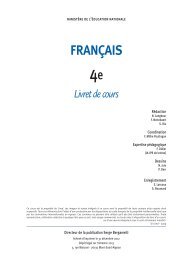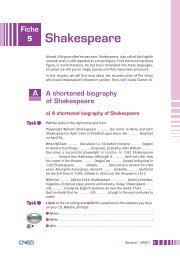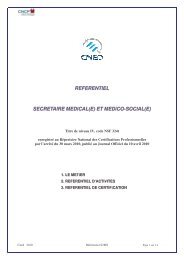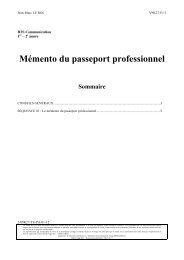cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12 LA COMMUNICATION ET SES ACTEURS U9K25-F1/1<br />
formule « le médium, c'est le message » : l'important n'est pas le contenu que véhicule tel ou tel médium<br />
(média), mais comment il le véhicule, et quel rapport au monde cela induit. Dans le langage de Shannon,<br />
McLuhan nous invite à réfléchir aux effets du canal et du contexte. Tout mode de communication est un<br />
média qui modifie notre rapport au monde ; on peut penser par exemple à ce que deviennent la vie privée et<br />
la pudeur à l’ère des réseaux sociaux mais aussi aux capacités de mobilisation politique ou humanitaires<br />
qu’ils permettent. Cette réflexion a des conséquences très concrètes sur les stratégies des professionnels en<br />
ce que le message apparaît de plus en plus comme un élément constitutif d’une démarche s’appuyant sur une<br />
analyse élargie de la situation de communication.<br />
La Médiologie fondée par Régis Debray dans les années 90 constitue probablement l’ultime élargissement<br />
de la question. Associant, dans une typologie historique des médias, les formes techniques et les formes<br />
sociales, il classe les sociétés selon leur média dominant, et caractérise ces derniers selon la forme de<br />
communication qu’ils favorisent : indicielle, iconique, symbolique.<br />
Ce classement des signes utilisés pour communiquer a été proposé dans les années 1950 par le linguiste<br />
américain Pierce. Celui-ci a identifié trois types de signes : l’indice, l’icône et le symbole et leur a attaché<br />
des caractéristiques particulières en termes de communication.<br />
— La communication indicielle confond le message et son véhicule (la grippe et son virus), superpose le<br />
contenu et la relation (fonction phatique de la communication amoureuse) et identifie l’émetteur et le<br />
récepteur (rumeurs, modes, publicités). Pierce fait de l’indice un « fragment arraché à l’objet » ; il<br />
accompagne l’énonciation pour parfois la contredire. Par exemple : « C’était délicieux, vraiment ! » (en<br />
rendant l’assiette pleine) ou : « Échec et mat mon pauvre vieux, je suis absolument désolé » (avec un<br />
sourire triomphal). Ici l’énoncé est entre guillemets et l’indice entre parenthèses.<br />
— La communication iconique s’appuie sur la ressemblance du signe à la chose communiquée. Il évoque<br />
directement la chose par sa forme ou son apparence, et sans passer par la médiation des mots. La<br />
communication iconique est à la base de la plupart des arts et des rituels, lesquels par leur grande<br />
puissance d’évocation réussissent à faire communier les hommes là où la parole se montre impuissante.<br />
C Exemple<br />
Lorsque des amoureux échangent un baiser, ils sont dans l'indiciel ; quand ils se font des cadeaux, ils sont<br />
dans l'iconique ; lorsqu'ils s'adressent des lettres d'amour, ils sont dans le digital.<br />
— La communication symbolique, en revanche, se prête aux articulations complexes de l’écriture ou de la<br />
mathématique.<br />
Les idées n’ont pas une efficacité par elles-mêmes. Elles dépendent toujours de leurs conditions sociales,<br />
économiques et techniques d’élaboration et de diffusion. Il faut donc s’intéresser en premier lieu à<br />
l’ensemble des moyens techniques socialement déterminés par lesquels se transmet la pensée, tels que<br />
l’imprimerie, la radio, la télévision mais aussi l’image colportée, la méditation religieuse ou le meeting<br />
ouvrier. Il faut aussi étudier concrètement les conséquences qu’a l’usage de ces moyens techniques sur<br />
l’élaboration de la pensée et sur les conditions de circulation des idées. Cette réflexion débouche sur la<br />
division de l’histoire humaine en trois « Médiasphères ». Ces dernières représentent des ensembles cohérents<br />
historiquement où, à l’utilisation majoritaire d’une technique de communication, correspondent une<br />
configuration sociopolitique et une cohésion symbolique ou religieuse de la société. 1<br />
II. LES TYPES DE COMMUNICATION<br />
A. LA COMMUNICATION GLOBALE<br />
La communication globale d’une organisation définit son territoire de communication et a pour vocation<br />
d’assurer la cohérence des messages, à l’externe et en interne, ainsi que leur efficacité. Elle nécessite une<br />
démarche rigoureuse et une mise en œuvre exemplaire. Chaque prise de parole doit être l’occasion de<br />
1 Régis DEBRAY, Introduction à la médiologie, PUF, 2000.