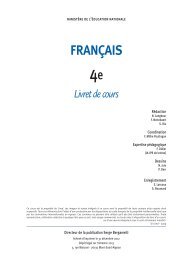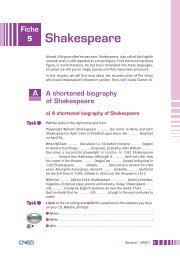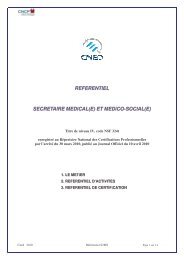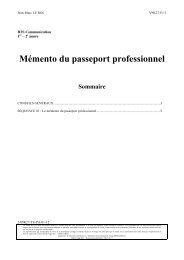cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
36 LA COMMUNICATION ET SES ACTEURS U9K25-F1/1<br />
à survaloriser les pratiques braconnières des utilisateurs des médias parce qu’on manque cruellement à<br />
l’heure actuelle d’enquêtes sur la longue durée.<br />
Mais qu’en est-il des pratiques culturelles effectives dans la France contemporaine ?<br />
S’il fallait résumer d’une formule le changement majeur en ce domaine, on dirait que le centre de gravité<br />
des pratiques culturelles s’est déplacé vers le pôle audiovisuel. En effet, l’émergence d’une nouvelle offre<br />
de programmes grâce à la télévision par câble ou par satellite, la généralisation de la télécommande et du<br />
magnétoscope, l’utilisation de plus en plus importante de la micro-informatique, l’augmentation de l’écoute<br />
musicale, les transformations du rapport au livre et à la lecture ; tous ces phénomènes convergent vers la<br />
progression des pratiques audiovisuelles qui se sont diversifiées et ont conquis une part croissante dans la vie<br />
des Français, au point qu’elles occupent désormais une place supérieure à celle du travail dans l’emploi<br />
du temps des personnes actives.<br />
Un constat paradoxal s’impose :<br />
Les pratiques de consommation culturelle demeurent en France très liées au statut social et à l’héritage<br />
culturel des individus. La participation régulière et diversifiée à la vie culturelle dépend en effet beaucoup<br />
du niveau de diplôme, du montant des revenus ainsi que de l’offre culturelle existante (milieu urbain ou<br />
rural). Ce constat confirme les observations réalisées, il y a un quart de siècle, par Pierre Bourdieu1 sur<br />
l’importance du phénomène de distinction sociale et sur l’existence de fortes inégalités dans l’accès à l’art et<br />
à la culture.<br />
Mais depuis quelque temps, de nouveaux comportements semblent se mettre en place. On note en effet<br />
l’émergence progressive de pratiques culturelles inattendues qui mélangent les genres, qui combinent les<br />
goûts culturels socialement valorisés à des goûts dépréciés. Les conduites de consommation sont, à l’heure<br />
actuelle, beaucoup moins rigides qu’autrefois et les profils dissonants sont de plus en plus fréquents. Un<br />
ouvrier à la retraite peut aimer la musette et l’opéra de Verdi, écouter les disques de Georges Guétary et de<br />
Jacques Brel, lire Chateaubriand et Georges Simenon, se délecter de livres d’histoires vécues sur la guerre et<br />
de L’Assommoir de Zola, regarder à la télévision Questions pour un champion et les matchs de football,<br />
adorer l’émission Thalassa et les retransmissions de patinage artistique.<br />
Quel que soit le milieu social, la dissonance culturelle semble aujourd’hui prédominante, sans pour autant<br />
annuler la hiérarchie globale ni les inégalités d’accès et de consommation. De manière générale, le profil des<br />
publics s’intéressant à l’art et à la culture est plus diversifié qu’avant, au moins à la marge mais les tendances<br />
lourdes (caractère cumulatif des pratiques culturelles, inégalités sociales persistantes) n’ont pas été<br />
profondément modifiées.<br />
Le monde de l’audiovisuel a d’ores et déjà opéré une segmentation de la culture de masse et une<br />
individualisation des usages. Pratiques d’écoute flottante de la télévision, intensification du zapping,<br />
banalisation de la télécommande, constitution de vidéothèques personnelles ; autant d’indicateurs d’une<br />
autonomie plus grande du téléspectateur qui peuvent être interprétés comme des tentatives d’échapper à la<br />
culture de flot et de flux. Les goûts des téléspectateurs, en revanche, continuent à s’organiser selon une<br />
double opposition : d’un côté, ceux qui considèrent la télévision essentiellement comme un divertissement<br />
opposés à ceux qui se sentent surtout attirés par l’information et/ou par la culture ; de l’autre, ceux qui<br />
aiment l’innovation en matière de programmes, par opposition à ceux qui cultivent les vertus de la<br />
tradition. Les choix liés à l’antagonisme divertissement/information et/ou culture semblent dépendants de la<br />
durée d’écoute (ceux qui regardent la télévision plus de 30 heures par semaine sont plutôt du côté du<br />
divertissement), alors que les choix liés à l’antagonisme innovation/tradition paraissent dépendants de l’âge<br />
(au-delà de 45 ans, on est plutôt « traditionaliste »). Les clivages générationnels et sociaux perdurent donc<br />
malgré tout.<br />
S’agissant de la lecture, au-delà des traditionnels discours catastrophistes, on peut constater qu’en réalité, ce<br />
qui a changé, c’est le fait que le taux de forts lecteurs a baissé depuis le début des années 1970, que la<br />
proportion de faibles lecteurs augmente et que la lecture est dorénavant une activité banalisée à côté de<br />
nouvelles activités de loisirs (télévision, musique, voyages, sport, etc.).<br />
1 Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit (1979)