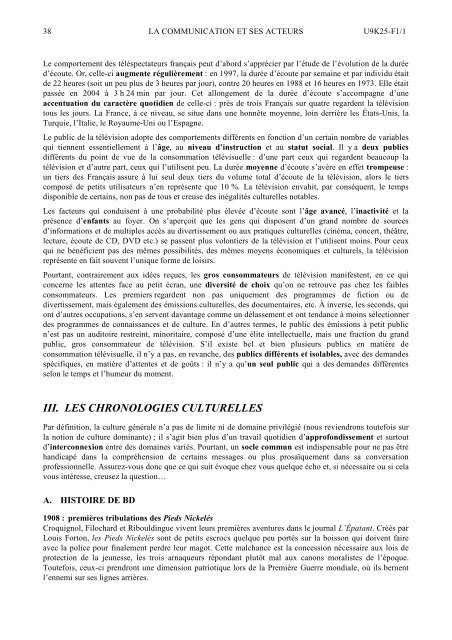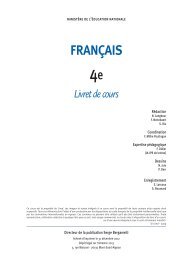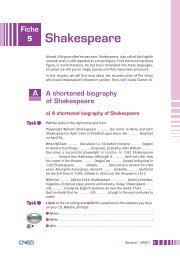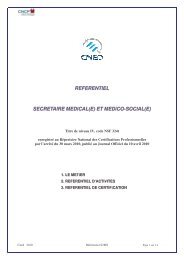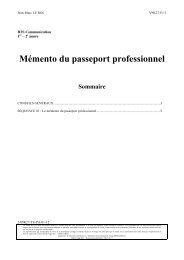cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
cultures dominantes - Espace Inscrit
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
38 LA COMMUNICATION ET SES ACTEURS U9K25-F1/1<br />
Le comportement des téléspectateurs français peut d’abord s’apprécier par l’étude de l’évolution de la durée<br />
d’écoute. Or, celle-ci augmente régulièrement : en 1997, la durée d’écoute par semaine et par individu était<br />
de 22 heures (soit un peu plus de 3 heures par jour), contre 20 heures en 1988 et 16 heures en 1973. Elle était<br />
passée en 2004 à 3 h 24 min par jour. Cet allongement de la durée d’écoute s’accompagne d’une<br />
accentuation du caractère quotidien de celle-ci : près de trois Français sur quatre regardent la télévision<br />
tous les jours. La France, à ce niveau, se situe dans une honnête moyenne, loin derrière les États-Unis, la<br />
Turquie, l’Italie, le Royaume-Uni ou l’Espagne.<br />
Le public de la télévision adopte des comportements différents en fonction d’un certain nombre de variables<br />
qui tiennent essentiellement à l’âge, au niveau d’instruction et au statut social. Il y a deux publics<br />
différents du point de vue de la consommation télévisuelle : d’une part ceux qui regardent beaucoup la<br />
télévision et d’autre part, ceux qui l’utilisent peu. La durée moyenne d’écoute s’avère en effet trompeuse :<br />
un tiers des Français assure à lui seul deux tiers du volume total d’écoute de la télévision, alors le tiers<br />
composé de petits utilisateurs n’en représente que 10 %. La télévision envahit, par conséquent, le temps<br />
disponible de certains, non pas de tous et creuse des inégalités culturelles notables.<br />
Les facteurs qui conduisent à une probabilité plus élevée d’écoute sont l’âge avancé, l’inactivité et la<br />
présence d’enfants au foyer. On s’aperçoit que les gens qui disposent d’un grand nombre de sources<br />
d’informations et de multiples accès au divertissement ou aux pratiques culturelles (cinéma, concert, théâtre,<br />
lecture, écoute de CD, DVD etc.) se passent plus volontiers de la télévision et l’utilisent moins. Pour ceux<br />
qui ne bénéficient pas des mêmes possibilités, des mêmes moyens économiques et culturels, la télévision<br />
représente en fait souvent l’unique forme de loisirs.<br />
Pourtant, contrairement aux idées reçues, les gros consommateurs de télévision manifestent, en ce qui<br />
concerne les attentes face au petit écran, une diversité de choix qu’on ne retrouve pas chez les faibles<br />
consommateurs. Les premiers regardent non pas uniquement des programmes de fiction ou de<br />
divertissement, mais également des émissions culturelles, des documentaires, etc. À inverse, les seconds, qui<br />
ont d’autres occupations, s’en servent davantage comme un délassement et ont tendance à moins sélectionner<br />
des programmes de connaissances et de culture. En d’autres termes, le public des émissions à petit public<br />
n’est pas un auditoire restreint, minoritaire, composé d’une élite intellectuelle, mais une fraction du grand<br />
public, gros consommateur de télévision. S’il existe bel et bien plusieurs publics en matière de<br />
consommation télévisuelle, il n’y a pas, en revanche, des publics différents et isolables, avec des demandes<br />
spécifiques, en matière d’attentes et de goûts : il n’y a qu’un seul public qui a des demandes différentes<br />
selon le temps et l’humeur du moment.<br />
III. LES CHRONOLOGIES CULTURELLES<br />
Par définition, la culture générale n’a pas de limite ni de domaine privilégié (nous reviendrons toutefois sur<br />
la notion de culture dominante) ; il s’agit bien plus d’un travail quotidien d’approfondissement et surtout<br />
d’interconnexion entre des domaines variés. Pourtant, un socle commun est indispensable pour ne pas être<br />
handicapé dans la compréhension de certains messages ou plus prosaïquement dans sa conversation<br />
professionnelle. Assurez-vous donc que ce qui suit évoque chez vous quelque écho et, si nécessaire ou si cela<br />
vous intéresse, creusez la question…<br />
A. HISTOIRE DE BD<br />
1908 : premières tribulations des Pieds Nickelés<br />
Croquignol, Filochard et Ribouldingue vivent leurs premières aventures dans le journal L’Épatant. Créés par<br />
Louis Forton, les Pieds Nickelés sont de petits escrocs quelque peu portés sur la boisson qui doivent faire<br />
avec la police pour finalement perdre leur magot. Cette malchance est la concession nécessaire aux lois de<br />
protection de la jeunesse, les trois arnaqueurs répondant plutôt mal aux canons moralistes de l’époque.<br />
Toutefois, ceux-ci prendront une dimension patriotique lors de la Première Guerre mondiale, où ils bernent<br />
l’ennemi sur ses lignes arrières.