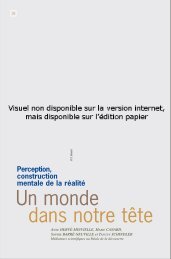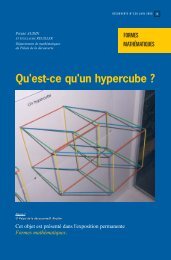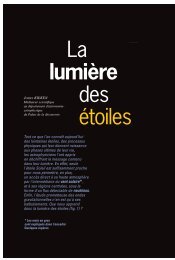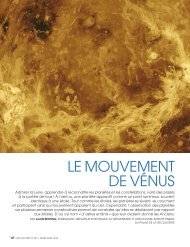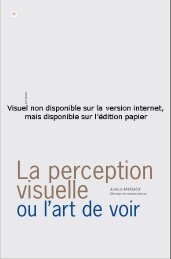Le champ magnétique dans l'univers - Palais de la découverte
Le champ magnétique dans l'univers - Palais de la découverte
Le champ magnétique dans l'univers - Palais de la découverte
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DÉCOUVERTE N°346 MARS 200729phénomène supplémentaire est susceptible<strong>de</strong> ralentir notre étoile, surtout si elle estjeune. Son <strong>champ</strong> <strong>magnétique</strong> s’ancre <strong>dans</strong>le disque d’accrétion qui a accompagné sanaissance et synchronise sa rotation sur <strong>la</strong>vitesse correspondant à une orbite <strong>de</strong>quelques rayons stel<strong>la</strong>ires. Cette vitesse étantinférieure à <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> rotation originelle<strong>de</strong> l’étoile, elle est freinée. Il n’est donc passurprenant <strong>de</strong> constater que les étoiles peumassives possédant donc une zone convectiveet un magnétisme dynamo tournentmoins vite que les étoiles massives, chau<strong>de</strong>set dénuées <strong>de</strong> zone convective.Magnétisme fossile47 Virginis, l’étoile étudiée par Babcock,intrigua immédiatement les astronomes. Sonmagnétisme différait sensiblement <strong>de</strong> celuidu Soleil. <strong>Le</strong>s observations permirent <strong>de</strong>découvrir que les variations périodiques <strong>de</strong>son <strong>champ</strong> <strong>magnétique</strong> ne résultaient que <strong>de</strong><strong>la</strong> rotation <strong>de</strong> l’étoile et pas d’une variationintrinsèque et cyclique. De plus, sa structuresemb<strong>la</strong>it plus simple, analogue en premièreapproximation au <strong>champ</strong> dipo<strong>la</strong>ire d’unbarreau aimanté. On pense aujourd’hui queces <strong>champ</strong>s proviendraient <strong>de</strong> l’amplificationd’un fragment du <strong>champ</strong> ga<strong>la</strong>ctique emprisonnépar le nuage ayant engendré l’étoile pareffondrement gravitationnel. <strong>Le</strong>s <strong>champ</strong>sfossiles modifient également le transport <strong>de</strong>séléments chimiques au sein <strong>de</strong>s atmosphèresstel<strong>la</strong>ires. On a ainsi pu montrer que surl’étoile epsilon <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Ourse,l’oxygène est présent en quantité so<strong>la</strong>ire près<strong>de</strong> l’équateur mais qu’il a presque complètementdisparu près <strong>de</strong>s pôles <strong>magnétique</strong>s. <strong>Le</strong>magnétisme intervient à tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>vie <strong>de</strong>s étoiles. Quel rôle joue-t-il lors <strong>de</strong> leurnaissance ?La naissance <strong>de</strong>s étoiles<strong>Le</strong>s étoiles naissent par effondrement d’unnuage <strong>de</strong> gaz et <strong>de</strong> poussières. Intéressons-nous au sta<strong>de</strong> ultérieur : une proto-étoile s’estformée et accrète encore <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière. Elle<strong>de</strong>meure invisible, cachée <strong>de</strong>rrière un épaiscocon <strong>de</strong> poussières qui baigne <strong>dans</strong> le <strong>champ</strong>ga<strong>la</strong>ctique local. On sait aujourd’hui que lesétoiles jeunes, comme les T Tauri, sont <strong>la</strong>source d’éruptions violentes et d’un rayonnementX qui ionise <strong>la</strong> matière environnante.Champ <strong>magnétique</strong> et matière – il s’agit <strong>de</strong>p<strong>la</strong>sma – sont alors couplées près <strong>de</strong> l’étoile.Des phénomènes complexes mê<strong>la</strong>nt turbulence,pression thermique et forcescentrifuges sont alors à l’origine <strong>de</strong> jets <strong>de</strong>matière canalisés (fig. 8).Là où les jets rencontrent le milieu interstel<strong>la</strong>irese produisent <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s <strong>de</strong> chocs matérialiséespar les objets <strong>de</strong> Herbig-Haro. Cesjets contribuent à ralentir l’étoile, mais ilsseraient aussi à l’origine <strong>de</strong>s fortes excentricités<strong>de</strong> nombreuses p<strong>la</strong>nètes extraso<strong>la</strong>ires<strong>découverte</strong>s à ce jour.Cadavres d’étoiles<strong>Le</strong>s naines b<strong>la</strong>nchesLa vie d’une étoile est un combat permanententre <strong>la</strong> gravité, qui tend à <strong>la</strong> faire s’effondreret <strong>la</strong> pression <strong>de</strong> radiation qui tend elle, aucontraire, à <strong>la</strong> di<strong>la</strong>ter. Dans le Soleil, <strong>la</strong> pression<strong>de</strong> radiation provient <strong>de</strong>s réactionsnucléaires se dérou<strong>la</strong>nt en son sein.L’hydrogène se transforme en hélium avec unfort dégagement d’énergie. Quand l’hydrogèneviendra à manquer d’ici cinqmilliards d’années, <strong>la</strong> diminution du débitd’énergie provoquera l’expansion <strong>de</strong> sonatmosphère et <strong>la</strong> contraction <strong>de</strong> son cœur. Plus<strong>de</strong>nse, plus chaud, ce <strong>de</strong>rnier sera alors lesiège <strong>de</strong> nouvelles réactions nucléaires transformantl’hélium en carbone et oxygène. <strong>Le</strong>Soleil entrera <strong>dans</strong> une nouvelle pério<strong>de</strong>d’équilibre mais cette <strong>de</strong>rnière ne durera paséternellement. Lorsque le combustible héliumsera épuisé, nulle échappatoire ne seraautorisée car <strong>la</strong> masse du Soleil étant tropfaible, <strong>la</strong> pression résultante au centre ne sera