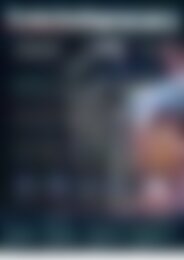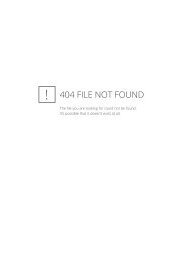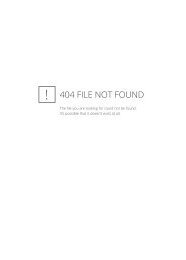Essais & Simulations n°141
DOSSIER : Spécial Covid-19 Comment les acteurs des essais et de la mesure font face à la crise
DOSSIER : Spécial Covid-19
Comment les acteurs des essais et de la mesure font face à la crise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DOSSIER À LA UNE 42 8<br />
Spécial<br />
Covid-19<br />
Comment les acteurs des<br />
essais et de la mesure<br />
font face à la crise<br />
ESSAIS ET MODELISATION 32<br />
Le HPC, élément incontournable de la simulation<br />
DOSSIER 46<br />
L’aéronautique et la défense à l’honneur !<br />
N° 141 • Mai-juin 2020 • 25 €
High-End Solutions for Automotive<br />
Displays & Lighting Measurement<br />
www.radiantvisionsystems.eu
ÉDITORIAL<br />
Réveiller l’industrie<br />
après le chaos<br />
C’est parti pour une nouvelle crise ! Et comme la tendance veut que plus rien<br />
ne se fasse dans la demi-mesure, celle-ci se montre encore plus brutale que<br />
toutes les autres. Provoquée par l’échappée malheureuse d’un des milliers de<br />
coronavirus connus à ce jour, elle a purement et simplement causé l’effondrement<br />
de quelque vingt années de croissance.<br />
Olivier Guillon<br />
Rédacteur en chef<br />
Beaucoup d’encre a coulé dans les journaux et beaucoup de<br />
mots, d’idées, de concepts, de spéculations parfois irresponsables<br />
voire des avis complotistes ont été échangés dans des<br />
médias en quête de vérité, de nouvelles alarmantes puis de pistes<br />
pour un « vaccin miracle » et de bien maigres scoops aux allures<br />
résolument dramatiques.<br />
« Plus brutale que<br />
toutes les autres, la<br />
crise a purement et<br />
simplement causé<br />
l’effondrement de<br />
quelque vingt années de<br />
croissance »<br />
Aujourd’hui, en cette période inédite de « déconfinement »<br />
(nouveau mot faisant bientôt son apparition dans le dictionnaire),<br />
l’heure est à la réorganisation, à commencer par l’industrie<br />
qui se réveille avec la gueule de bois. La question se pose<br />
désormais de savoir comment se relever, question que la rédaction d’<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong><br />
a décidé de poser aux représentants des associations professionnelles (et partenaires du<br />
magazine) regroupant ces centaines d’entreprises – fabricants d’instruments de mesure,<br />
sous-traitants industriels, prestataires d’essais, bureaux d’études et de simulation, éditeurs<br />
de logiciels… – qui ont aujourd’hui la lourde tâche, sinon celle de survivre, de faire rebondir<br />
une industrie lourdement affectée après deux mois d’hibernation.<br />
Olivier Guillon<br />
Envie de réagir ?<br />
@EssaiSimulation<br />
ÉDITEUR<br />
MRJ Informatique<br />
Le Trèfle<br />
22, boulevard Gambetta<br />
92130 Issy-les-Moulineaux<br />
Tel : 01 84 19 38 10<br />
Fax : 01 34 29 61 02<br />
Direction :<br />
Michaël Lévy<br />
Directeur de publication :<br />
Jérémie Roboh<br />
Rédacteur en chef :<br />
Olivier Guillon<br />
o.guillon@mrj-corp.fr<br />
COMMERCIALISATION<br />
Publicité :<br />
Patrick Barlier<br />
p.barlier@mrj-corp.fr<br />
Diffusion et Abonnements :<br />
vad.mrj-presse.fr<br />
Prix au numéro :<br />
25 €<br />
Abonnement 1 an :<br />
80 € / 4 numéros<br />
Étranger :<br />
130 €<br />
Règlement par chèque<br />
bancaire à l’ordre de MRJ<br />
RÉALISATION<br />
Conception graphique :<br />
Dolioz - Adeline Docquier<br />
Maquette, Impression :<br />
Rivadeneyra, sa<br />
Calle Torneros, 16<br />
Poligono Industrial de Los Angeles<br />
28906 Getafe - Madrid Espagne<br />
N°ISSN :<br />
1632 - 4153<br />
N° CPPAP : 1021 T 94043<br />
Dépôt légal : à parution<br />
Périodicité : Trimestrielle<br />
Numéro : 141<br />
Date : mai - juin 2020<br />
RÉDACTION<br />
Ont collaboré à ce numéro :<br />
Florence Barré (ESI Group), Navin<br />
Budhiraja (Ansys), Francisco<br />
Chinesta (ESI Group), Robert<br />
Harwood (Ansys), Neboisa<br />
Milosavljevic (Emitech), Daniel<br />
Verwaerde (Teratec)<br />
Comité de rédaction :<br />
MRJ Presse : Olivier Guillon<br />
ASTE : Alain Bettacchioli (Thales<br />
Alenia Space), Daniel Leroy<br />
(AllianTech), Yohann Mesmin<br />
(Siemens Industry Software),<br />
Patrycja Perrin (ASTE)<br />
PHOTO DE COUVERTURE :<br />
IStock - Salle blanche en laboratoire<br />
pharmaceutique<br />
Crédit : 4X-image<br />
Toute reproduction, totale ou partielle, est<br />
soumise à l’accord préalable de la société MRJ.<br />
Partenaires du magazine<br />
<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> :<br />
/Facebook.com/<br />
EssaiSimulation<br />
/@EssaiSimulation<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I1
LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL<br />
CONFÉRENCES | ATELIERS | EXPOSITION<br />
THE INTERNATIONAL MEETING<br />
CONFERENCES | WORKSHOPS | EXHIBITION<br />
NOUVELLES DATES<br />
NEW DATES<br />
PARIS ILE-DE-FRANCE<br />
13 & 14 OCTOBRE OCTOBER 13 & 14<br />
PLATINUM SPONSORS<br />
GOLD SPONSORS<br />
HPC Services<br />
SILVER SPONSORS<br />
PARTENAIRE<br />
EUROPA VILLAGE
SOMMAIRE<br />
MESURES<br />
À LA UNE : FAIRE FACE À LA CRISE<br />
8 - La technologie, le rempart de l’industrie contre la crise<br />
11 - Les organisations professionnelles des essais et de la<br />
simulation sur le pied de guerre !<br />
15 - En réponse au confinement, Comsol a recours au webinar !<br />
17 - La simulation au chevet des entreprises industrielles<br />
8<br />
ACTUALITÉS<br />
Crise du Covid-19<br />
6 Les mesures de distanciation sociale<br />
sont insuffisantes, selon la simulation<br />
numérique<br />
6 Airbus Defense & Space développe un<br />
moyen d’essais de micro-vibrations<br />
unique<br />
7 ArianeGroup met à la disposition des<br />
équipementiers une centrifugeuse de<br />
grande capacité<br />
7 Succès de la phase de tests aux Pays-Bas<br />
pour le train à hydrogène Coradia iLint<br />
MESURES<br />
20 Covid-19 – Comment s’organisent les<br />
associations professionnelles de la<br />
mesure et des END<br />
25 Les Journées de la Mesure en Webconférence<br />
les 16 et 17 juin !<br />
26 Aux États-Unis, Dewesoft participe<br />
au développement d’un respirateur<br />
artificiel d’urgence<br />
28 Horiba Medical mise sur la simulation<br />
pour développer ses nouveaux dispositifs<br />
hématologiques<br />
30 Des solutions sur « mesure » pour<br />
lutter contre la crise sanitaire<br />
ESSAI ET MODÉLISATION<br />
Focus sur le HPC et le Forum Teratec<br />
2020<br />
32 À l’heure de la crise, le Forum Teratec<br />
joue la carte européenne<br />
34 Le rôle croissant de la simulation<br />
numérique dans le HPC<br />
36 Accélérer la révolution du HPC dans<br />
le Cloud<br />
Spécial maintenance des moyens<br />
d’essai<br />
39 La GMAO, outil stratégique de la<br />
maintenance d'ArianeGroup<br />
42 Comment le plus grand site de R&D<br />
d’EDF Lab organise sa maintenance<br />
44 La maintenance au cœur de la stratégie<br />
des moyens d’essai<br />
OUTILS<br />
46 La DGA crée un cluster d’innovation<br />
de défense dans l’aérospatial<br />
© EDF<br />
47 Conception et validation d’essais<br />
d’impacts laser instrumentés par un<br />
système multi-caméras<br />
50 Accompagner les évolutions des marchés<br />
de l’aéronautique et de la défense<br />
52 Soldat connecté : le recours à la<br />
simulation pour conserver une longueur<br />
d'avance sur la menace<br />
55 Socitec, un demi-siècle d’expérience au<br />
service de la défense et l’aéronautique<br />
56 Les matériaux composites, un élément<br />
incontournable de l’avion du futur<br />
56 Retour sur Compostamp, un projet qui a<br />
su fédérer aéronautique et automobile<br />
60 Des essais acoustiques pour simuler<br />
l’impact sonore du lancement de<br />
Sentinel-6A<br />
OUTILS<br />
62 Le point sur les prochaines journées<br />
techniques de l’ASTE<br />
62 Report d’Astelab 2021 « <strong>Essais</strong> et<br />
Simulation » à l’été 2021<br />
63 Agenda<br />
64 Au sommaire du prochain numéro<br />
64 Index des annonceurs et des entreprises<br />
citées<br />
64 Le chiffre à retenir<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I3
Le logiciel EDM de Crystal Instruments<br />
fournit la fonction mufti-résolution qui<br />
applique la résolution sélectionnée dans la<br />
gamme haute fréquence et 8 fois la<br />
résolution dans la gamme basse<br />
fréquence. La fréquence de coupure, qui<br />
divise les gammes basses et hautes<br />
fréquences, est calculé par le logiciel.<br />
Spider-81 Vibration Controller<br />
New CAN bus Connection ., Multi-Resolution<br />
Spectrum Analysis & Vibration Visualization<br />
dB Vib<br />
INSTRUMENTATION<br />
CRYSTAL<br />
,,. INSTRUMENTS<br />
www.dbvib-instrumentation.com
NOS DOSSIERS EN UN CLIN D’OEIL<br />
© DuPont De Nemours<br />
ACTUALITÉS<br />
À la une : faire face à la crise<br />
par la technologie p. 8 à 18<br />
De la crise sanitaire et du confinement le monde est passé à<br />
la récession économique la plus brutale jamais connue à ce<br />
jour. Après la mise en hibernation de l’économie vient le temps<br />
du rebond. Mais la chose n’est pas aisée et exige une mise<br />
en commun des forces vives : acteurs financiers, nouvelles<br />
technologies et mise en réseau des moyens d’essai, de production<br />
et des compétences.<br />
MESURES<br />
© Sisu<br />
Covid-19 : comment la mesure<br />
répond à la crise ? p. 20 à 31<br />
S’il y a bien un domaine qui a été fortement chahuté durant la<br />
crise sanitaire, c’est celui de l’hospitalier et plus généralement<br />
le monde de la santé. Or dans ces pans d’activité, le contrôle<br />
qualité occupe une place centrale. Et ce n’est qu’un des nombreux<br />
arguments en faveur des acteurs de la mesure et de la métrologie<br />
démontrant le rôle majeur qu’ils jouent au quotidien.<br />
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Deux sujets à l’honneur : le HPC et<br />
la maintenance p. 32 à 45<br />
© DR<br />
Le Forum Teratec n’est pas annulé mais reporté en octobre. À ce<br />
titre, la rédaction <strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> porte son attention sur<br />
la place du calcul haute performance HPC dans la simulation et<br />
les essais. Par ailleurs, à l’aube des grands arrêts techniques<br />
d’été, un retour d’expérience et deux reportages concernent<br />
quant à eux la maintenance les moyens d’essai, une activité<br />
stratégique bien que peu mise en valeur.<br />
©DR<br />
DOSSIER<br />
Spécial Aéronautique et<br />
Défense p. 46 à 60<br />
Si les salons Eurosatory et Global Space n’auront pas eu lieu<br />
comme prévu (Eurosatory étant annulé et Global Space finalement<br />
abandonné) et malgré le coup brutal de la crise, anéantissant près<br />
de dix ans de carnets de commandes, les secteurs de l’aéronautique<br />
et de la défense exprimeront toujours des besoins en essais et<br />
en simulation, peut-être plus que dans le « monde d’avant ». En<br />
attendant des jours meilleurs…<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I5
ACTUALITÉS<br />
EN BREF<br />
Tomra Food virtualise<br />
ses centres de tests et de<br />
démonstration<br />
Le fabricant de trieuses à base de<br />
capteurs et des solutions intégrées<br />
post-récolte à l'industrie alimentaire<br />
(utilisant les technologies de calibrage,<br />
de tri, d’épluchage et d’analyse) a mis<br />
en place des centres de démonstration<br />
virtuels pour amener les centres de<br />
test et de démonstration directement<br />
sur le poste de travail de ses clients.<br />
Ceux-ci pourront réserver des sessions<br />
interactives avec les centres belges,<br />
chinois et américain du groupe. ●<br />
Marc-Oliver Pahl, nommé<br />
directeur de la chaire Cyber<br />
CNI d'IMT Atlantique<br />
Directeur de recherche au<br />
département Systèmes réseaux,<br />
cybersécurité et droit du numérique<br />
sur le campus de Rennes d'IMT<br />
Atlantique, Marc-Oliver Pahl prend<br />
la direction de la Chaire Cyber<br />
CNI qui conduit depuis 2016 des<br />
travaux de recherche et participe<br />
à la formation dans le domaine,<br />
dorénavant hautement stratégique, de<br />
la cybersécurité des infrastructures<br />
critiques (réseaux d'énergie,<br />
infrastructures numériques, processus<br />
industriels, usines de production<br />
d'eau, systèmes financiers). ●<br />
Symétrie s’équipe d’une<br />
nouvelle ligne de production !<br />
Afin d’augmenter sa capacité de<br />
production, Symétrie a installé un<br />
nouvel atelier de production de 200 m²<br />
à Nîmes, ce qui porte la surface<br />
totale de ses locaux à 1 200 m². Cet<br />
atelier est principalement destiné<br />
au montage et à la qualification<br />
des hexapodes de positionnement<br />
standard. Opérationnelle depuis<br />
début 2020, cette nouvelle ligne de<br />
production intègre aussi des moyens<br />
de tests, comme une machine à<br />
mesurer tridimensionnelle.●<br />
COVID-19<br />
Les mesures de distanciation sociale<br />
sont insuffisantes, selon la simulation<br />
numérique<br />
Afin d’aider les pouvoirs publics,<br />
les professionnels de santé et<br />
le grand public à comprendre<br />
l'importance de ces mesures<br />
et à mieux appliquer les gestes barrières,<br />
Ansys, spécialiste mondial de la simulation<br />
numérique, a révélé en avril dernier,<br />
sur un site dédié, les résultats de ses<br />
recherches sur la propagation des gouttelettes<br />
responsables de la transmission du<br />
L’objectif de ce nouveau banc<br />
installé à Airbus Defence and<br />
Space dans le centre d’essais<br />
de Toulouse est de caractériser<br />
au sol par moyens adaptés le niveau de<br />
micro-vibrations à de très faibles amplitudes.<br />
Après plusieurs mois de travail, les<br />
équipes d’ingénierie des essais mécaniques<br />
ont développé un banc de mesure composé<br />
d’un marbre rigide de 3 tonnes sur suspensions<br />
pneumatiques, d’une chaîne d’acquisition<br />
ultra-sensible adaptée aux faibles<br />
fréquences (de l‘ordre de 0,1 Hz) et d’un<br />
post-traitement développé en interne et<br />
permettant de corriger l’impact des modes<br />
de suspension dans la bande de fréquence<br />
utilisée.<br />
virus lors d’une interaction et durant la<br />
pratique d'un sport.<br />
Ces résultats soulignent l’insuffisance<br />
des recommandations de distanciation<br />
sociale émises par le gouvernement. En<br />
effet, la modélisation démontre que les<br />
gouttelettes peuvent être expulsées jusqu’<br />
à 28 mètres lors d’une toux ou d’un éternuement.<br />
L’éloignement entre deux<br />
personnes statiques devrait donc être de<br />
2 mètres minimum, soit le double de la<br />
distance actuellement recommandée. Les<br />
coureurs devraient quant à eux respecter<br />
une distance de 3 mètres minimum et les<br />
cyclistes de 10 mètres. ●<br />
EN SAVOIR PLUS > www.ansys.com<br />
INNOVATION<br />
Airbus Defense & Space développe un<br />
moyen d’essais de micro-vibrations<br />
unique<br />
Capable de supporter des instruments de<br />
plusieurs centaines de kilogrammes et avec<br />
une interface de 1,5 m de diamètre, ce banc<br />
micro-dynamique est désormais opérationnel.<br />
Il va être notamment utilisé pour<br />
les instruments ICI (Ice Cloud Imager)<br />
et MWI (Micro Waves Imager) du satellite<br />
d’observation de la terre MetOp-SG ●.<br />
EN SAVOIR PLUS ><br />
spaceequipment.airbusdefenceandspace.com<br />
6 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ACTUALITÉS<br />
MOYEN D’ESSAI<br />
ArianeGroup met à la disposition des<br />
équipementiers une centrifugeuse de<br />
grande capacité<br />
ArianeGroup Tests Services<br />
partenaire reconnu des industriels<br />
français Européens dans<br />
le domaine des essais en environnement<br />
et contrôle non destructif,<br />
dispose d'une centrifugeuse de grande<br />
capacité particulièrement appréciée des<br />
équipementiers aéronautiques et défenses.<br />
FERROVIAIRE<br />
Répondant aux normes aéronautiques et<br />
défenses, notre centrifugeuse permet d'accueillir<br />
des spécimens supérieurs à 2,5<br />
mètres et 1,5 tonne.<br />
À titre d'exemple, un de ses points de performance<br />
moyen est un niveau d'accélération de<br />
80 g pour une masse d'équipement testé de<br />
400 kg. Compatible des produits à caractère<br />
pyrotechnique, cette centrifugeuse permet de<br />
qualifier vos spécimens dans des conditions<br />
extrêmes. Ce moyen d'essai a récemment<br />
accompagné des industriels dans leur qualification<br />
de produit tel que des cœurs électriques<br />
aéronautiques, ainsi que des systèmes<br />
et sous-systèmes d'armes tactiques. ●<br />
EN SAVOIR PLUS > www.ariane.group/fr/<br />
Succès de la phase de tests aux Pays-Bas<br />
pour le train à hydrogène Coradia iLint<br />
©R. Frampe<br />
EN BREF<br />
Les acteurs du HPC veulent<br />
lutter contre le covid-19<br />
Genci, le CEA, la CPU et Atos arment<br />
les scientifiques européens avec le HPC<br />
pour lutter contre le virus. Ainsi, deux<br />
des supercalculateurs les plus puissants<br />
de France, Joliot-Curie, opéré au TGCC<br />
et Occigen au Cines (centre national de<br />
calcul de la CPU), fournissent un accès<br />
prioritaire d’une grande partie de leurs<br />
ressources de calcul à des équipes<br />
de recherche européennes. Il s’agit<br />
notamment d’études épidémiologiques<br />
de la propagation du covid-19, de travaux<br />
visant à comprendre la structure<br />
moléculaire et le comportement du<br />
virus ou encore à cribler massivement<br />
des protéines et tester des potentielles<br />
futures molécules en vue d'un vaccin. ●<br />
IRT Saint Exupéry et SystemX<br />
souhaitent améliorer les<br />
processus de développement<br />
et de certification des systèmes<br />
complexes<br />
D’une durée de 48 mois, le nouveau projet<br />
inter-IRT S2C ambitionne de définir des<br />
processus de mise en œuvre et de maintien<br />
en cohérence des données échangées entre<br />
les équipes de conception d’architectures<br />
systèmes et les équipes d’analyse de la<br />
sûreté de fonctionnement (safety). Cette<br />
méthodologie intégrera les approches de<br />
modélisation (MBSE, MBSA et arbres de<br />
panne) et contribuera à la vulgarisation<br />
et l’acceptation du MBSA dans un<br />
contexte de certification des systèmes<br />
complexes, avant leur mise sur le marché.<br />
Le marché principal ciblé par ce projet<br />
est l’aéronautique civil. ●<br />
En mars dernier, Alstom a testé<br />
pendant dix jours le train Coradia<br />
iLint alimenté par une pile<br />
à hydrogène sur la ligne de 65<br />
kilomètres située entre Groningen et<br />
Leeuwarden, dans le nord des Pays-Bas.<br />
Les essais font suite à 18 mois de service<br />
voyageurs réussi sur la ligne Buxtehude–<br />
Bremervörde–Bremerhaven–Cuxhaven<br />
en Allemagne, pour laquelle 41 Coradia<br />
iLint au total ont déjà été commandés.<br />
Développé et produit par les équipes<br />
d’Alstom à Salzgitter (Allemagne) et à<br />
Tarbes, Coradia iLint est le premier train<br />
régional de passagers au monde à entrer<br />
en service commercial équipé de piles qui<br />
convertissent l’hydrogène et l’oxygène en<br />
électricité. Conçu pour circuler sur des<br />
lignes non électrifiées, il fournit une traction<br />
propre et durable sans compromis<br />
de performance, ni d’autonomie (1 000<br />
km environ), soit la même que les rames<br />
diesel de taille équivalente. ●<br />
EN SAVOIR PLUS > www.alstom.com<br />
Le programme doctoral « IA et<br />
Ingénierie » porté par Centrale<br />
Lille retenu par l’ANR<br />
Le programme doctoral AI_Engeneering_<br />
PdD@Lille dédié à l’IA en ingénierie, présenté<br />
par Centrale Lille conjointement avec l’Ensait<br />
et Yncrea, est l’un des 22 programmes<br />
retenus par l’ANR dans le cadre de l’appel<br />
à programmes lancé en juin 2019. 8 des<br />
13 thèses qu’il comprend bénéficieront<br />
chacune d’une aide financière de l’Etat de<br />
60 000 €. Ce programme est également<br />
soutenu par l’I-Site ULNE qui contribue<br />
au montage financier, ainsi que par la<br />
Région Hauts-de-France qui apportera<br />
plusieurs co-financements. ●<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I7
ACTUALITÉS<br />
ENTRETIEN<br />
La technologie,<br />
le rempart de l’industrie contre la crise<br />
Le directeur exécutif de la Banque publique d’investissements (Bpifrance), nous fait part dans<br />
cet entretien exclusif de sa vision de la crise et surtout d’une reprise très attendue. Dans ce<br />
contexte incertain, Guillaume Mortelier rappelle le rôle essentiel de l’organisme tant dans sa<br />
mission financière que dans l’accompagnement des entreprises, mais également la place centrale<br />
qu’occupent les nouvelles technologies dans l’espoir d’un rebond rapide de l’économie.<br />
GUILLAUME MORTELIER, UN MOT POUR QUALIFIER<br />
CETTE CRISE…<br />
Le premier mot qui me vient à l’esprit est « brutalité ». Car<br />
si l’on se reporte à 2008, il y a eu environ un an de latence<br />
entre la crise des subprimes et son impact réel sur l’économie.<br />
Cette année, nous sommes passés d’une économie<br />
en fin de cycle un arrêt total – avec toutefois des disparités<br />
fortement marquées de manière sectorielle mais aussi en<br />
fonction de la taille et de la géographie des entreprises. Car<br />
Guillaume<br />
Mortelier<br />
DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA BANQUE<br />
PUBLIQUE D’INVESTISSEMENTS<br />
(BPIFRANCE)<br />
Ancien élève de l’Ecole polytechnique et diplômé de l’École<br />
nationale des Ponts et Chaussées,Guillaume Mortelier débute<br />
sa carrière en 2003 au sein du cabinet Bain & Company à Paris<br />
et San Francisco où il mène des missions de développement<br />
d'entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Entre 2007<br />
et 2012, il réalise des investissements en fonds propres dans<br />
des ETI françaises au sein du fonds Astorg Partners puis<br />
dans des entreprises à l'étranger (Méditerranée et Chine<br />
principalement) au sein de Proparco. En septembre 2012,<br />
Guillaume Mortelier rejoint CDC Entreprises, entité constitutive<br />
de Bpifrance dont il est nommé directeur du Développement<br />
puis directeur de la Stratégie et du Développement en 2014.<br />
En décembre 2017, il devient membre du comité de direction<br />
Mid & Large Cap, en charge de la création et de la gestion<br />
du Fonds Build-up International. Guillaume Mortelier est<br />
nommé directeur exécutif en charge de l’Accompagnement<br />
le 1er août 2018.<br />
outre le tourisme – comprenant la restauration, l’événementiel<br />
et l’hôtellerie, l’industrie (en particulier l’aéronautique<br />
et l’automobile) a été fortement touchée, mettant le doigt<br />
sur un problème opérationnel : la complexité des chaînes<br />
de production et une supply chain très dense. Enfin, cette<br />
crise s’est manifestée de façon très rapide : de la mi-mars<br />
à la mi-avril, nous avons mis en hibernation l’économie.<br />
Depuis, après avoir dû relever les défis sanitaires, dialoguer<br />
avec les employés, envisager différents scénarios de confinement<br />
et travailler à distance, les entreprises doivent penser<br />
à la reprise.<br />
JUSTEMENT, COMMENT VOYEZ-VOUS L’APRÈS-<br />
CRISE ?<br />
Du point de vue de la BPI, nous nous devons d’adopter<br />
une vision à la fois théorique et optimiste. L’idéal serait<br />
donc de retrouver dans la reprise une brutalité similaire<br />
à celle de la crise. L’année 2020 aura connu trois mois «<br />
blancs » ; il faudrait être capable de rattraper ce niveau d’ici<br />
septembre. Ce scénario n’est bien entendu pas réaliste pour<br />
tous les secteurs ; seules les entreprises de services suffisamment<br />
et financièrement solides pourront adopter une<br />
reprise en « V ». Pour le reste de l’économie, le profil de la<br />
reprise prendra plutôt les allures d’un « U » tassé avec un<br />
retour à la normal au quatrième trimestre.<br />
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES<br />
ENTREPRISES ?<br />
Avant tout, il faut sécuriser et rallonger la durée du cash.<br />
À ce titre, notons que les banques « ont fait le job » sur le<br />
Prêt garanti par l’État (PGE) avec près de 38 milliards d’euros<br />
de prêts accord et pas moins de 260 000 demandes en<br />
trois semaines seulement. Le rythme est impressionnant<br />
8 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ACTUALITÉS<br />
©DR<br />
mais il faut que la dynamique aille plus loin. Parallèlement<br />
à l’action financière se joue le défi de l’accompagnement<br />
car le souhait des dirigeants est de sécuriser la reprise d’ici<br />
trois à six mois. Par exemple, l’automobile est marquée par<br />
la crise en raison des problématiques rencontrées dans sa<br />
chaîne de fournisseurs. Beaucoup d’entre eux se situent en<br />
effet en Chine. Or le cycle d’approvisionnement est très<br />
long, ce qui explique que le choc n’a été ressenti qu’au mois<br />
de mars. L’objectif est donc de comprendre et de réagir le<br />
plus rapidement possible.<br />
ET PLUS PARTICULIÈREMENT POUR NOTRE<br />
INDUSTRIE ?<br />
Indépendamment de ses effets sanitaires, la crise à souligné<br />
l’importance d’une force industrielle en France et<br />
en Europe, à l’exemple de la santé pour la production de<br />
masques, de gel et de respirateurs artificiels. On a vu le<br />
trou béant puis, dans un second temps, l’industrie (textile<br />
et mécanique notamment) a su répondre aux besoins imminents<br />
de production. En un mot, nous pouvons affirmer<br />
que l’industrie est un enjeu de souveraineté et pas seulement<br />
économique. Il va donc falloir associer différents<br />
secteurs comme la santé, la défense etc. à une priorité non<br />
plus sectorielle mais globale en adoptant une vision non<br />
plus verticale mais horizontale. Nous devons adopter une<br />
approche industrielle dans son ensemble pour assurer la<br />
sécurité de la chaîne d’approvisionnement. De là, le grand<br />
défi pour la BPI est d’assurer que les dirigeants continuent<br />
d’investir et de donner la priorité au digital et à l’Industrie<br />
du futur.<br />
DANS QUELLE MESURE L’INDUSTRIE DU FUTUR<br />
VA-T-ELLE AIDER LES ENTREPRISES À MIEUX<br />
REBONDIR ?<br />
Vous l’aurez compris, l’enjeu n’est pas de savoir comment<br />
je digitalise l’usine mais comment j’intègre la supply chain<br />
Précision et haute<br />
vélocité réunis !<br />
Seuls des accouplements de haute<br />
précision vous garantissent l’exactitude<br />
des données de vos couple-mètres !<br />
www.mayr.com<br />
Votre partenaire<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I9
ACTUALITÉS<br />
©Connex Lab<br />
dans son ensemble. Nous pensons qu’il faut profiter de la<br />
crise pour montrer aux industriels que la technologie est<br />
la réponse essentielle. Nous remarquons à ce titre qu’en<br />
réponse à cette crise à la fois brutale et rapide, l’utilisation<br />
du digital à travers les dispositifs d’e-Learning et de webinaires<br />
s’est considérablement généralisée. À titre d’exemple,<br />
avant la crise, nous organisions deux web-conférences par<br />
mois avec une centaine de dirigeants ; depuis un mois, c’est<br />
une par jour pour 300 personnes !<br />
Cet engouement pour le digital n’est pas près de disparaître<br />
après la crise. Celle-ci nous a d’ailleurs permis de constater<br />
que les entreprises équipées de nouvelles technologies s’en<br />
sortent mieux dans leurs relations client-fournisseur sur<br />
les chaînes de production et dans la supply-chain. Enfin,<br />
du point de vue des normes, celles-ci devront être de plus<br />
en plus contraignantes. La robotisation et les capteurs intégrés<br />
sur les équipements de production permettront sans<br />
nul doute de plus facilement s’adapter.<br />
AU-DELÀ DE LA PARTIE FINANCIÈRE, QUELLES<br />
ACTIONS ALLEZ-VOUS METTRE EN ŒUVRE POUR<br />
AIDER LES ENTREPRISES ?<br />
Nous menons des actions d’accompagnement destiné à<br />
sécuriser la reprise mais aussi inciter davantage les entreprises<br />
à se saisir des diagnostics et des solutions technologiques<br />
que propose le marché. Nous travaillons en<br />
partenariat avec le Cetim à ce sujet. Nous menons également<br />
une réflexion post-crise sur ces gros enjeux ; notre<br />
volonté étant de réaliser un step-back portant sur les<br />
macro-enjeux durant les trois prochaines années.<br />
QUEL RÔLE PEUT JOUER DES ASSOCIATIONS<br />
PROFESSIONNELLES SELON VOUS ?<br />
Après cette crise sanitaire et économique, le monde ne va<br />
pas changer. Les associations et les organisations professionnelles<br />
ont une totale légitimité à la fois dans leurs<br />
actions et leur raison d’être dans cette crise qui devrait au<br />
moins durer 18 mois. L’enjeu pour elle et de simplifier la vie<br />
des dirigeants. Car s’ils ont profité de la richesse des dispositifs,<br />
ils ont également été confronté à leur complexité.<br />
C’est d’ailleurs l’un des défis des organisations telles que la<br />
BPI : donner un maximum de visibilité, identifier rapidement<br />
les interlocuteurs (entreprises et laboratoires, savoirfaire<br />
et moyens industriels) et les renvoyer vers les plus<br />
pertinents. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
© FOUCHA<br />
10 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ACTUALITÉS<br />
INTERVIEW CROISÉE<br />
Les organisations professionnelles des essais<br />
et de la simulation sur le pied de guerre !<br />
Daniel Leroy,<br />
président de l’Association pour le<br />
développement des sciences et techniques en<br />
environnement (ASTE)<br />
Didier Large,<br />
président de Nafems France (International<br />
Association Engineering Modelling)<br />
QUELLE LECTURE AVEZ-VOUS DE CETTE CRISE<br />
SANITAIRE ? EN QUOI CELA IMPACTE VOS<br />
ADHÉRENTS ?<br />
Daniel Leroy (D.L.) : Précurseur en 2007 avec la création de<br />
l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires<br />
(Eprus), qui disposait de 285 millions de masques PFP2,<br />
la France manque cette fois de moyens face au Covid-19. Par<br />
ailleurs, nous ne disposons plus sur le territoire français d'industriels<br />
pouvant fabriquer rapidement le matériel nécessaire.<br />
La seule solution - le confinement - a eu un impact très important<br />
sur la santé de notre tissu économique. Sans compter l’effet<br />
délétère de la compétition « des masques » sur nos partenaires<br />
historiques comme l’Espagne et l’Italie. Cette crise montre l’importance<br />
du politique à la fois en matière de santé publique et de<br />
politique industrielle, et de notre rayonnement européen. Dans<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I11
ACTUALITÉS<br />
le domaine des essais, un très fort impact<br />
a été constaté : les derniers laboratoires<br />
ont fermé début avril, en l’absence d’activité<br />
; face aux impacts financiers, les<br />
directions réduisent fortement leurs<br />
programmes de développement.<br />
Didier Large (D.LG) : Cette crise<br />
impacte naturellement la vie de l’association,<br />
à commencer par ces événements,<br />
que ce soit en Europe ou aux<br />
États-Unis. Certains sont reportés, annulés<br />
ou transférés en séminaires en ligne,<br />
ce qui constitue une nouveauté pour<br />
Nafems ; d’autant qu’il se posera la difficulté<br />
des rendez-vous qui vont se bousculer<br />
en fin d’année. Néanmoins, nous<br />
continuons d’organiser chaque semaine<br />
des réunions de travail avec nos partenaires<br />
comme en France, avec les IRT<br />
SystemaTic et Saint-Exupéry ainsi que<br />
Renault et PSA à travers Nafems-Incose<br />
SMS Group, une initiative concrète<br />
portant sur la convergence de l’ingénierie<br />
systèmes (MBSE-Modelisation) et de<br />
la simulation. L’objectif à terme pour les<br />
deux constructeurs et de développer un<br />
standard pour le véhicule du futur, c’està-dire<br />
un véhicule à la fois autonome<br />
électrique. La crise du Covid-19 ne met<br />
donc fondamentalement pas en cause<br />
nos actions ; au contraire, nous avançons<br />
et envisageons même d’intégrer à<br />
ce projet les éditeurs de logiciels cet été.<br />
« L’agilité et la résilience<br />
vont devenir les qualités<br />
indispensables à la survie<br />
de notre filière, et cette<br />
évolution passe par une<br />
forte digitalisation de nos<br />
processus »<br />
- Daniel Leroy (ASTE)<br />
DE QUELLE NATURE SONT LEURS<br />
DIFFICULTÉS ET QUELS SONT LES<br />
CHALLENGES QU’IL LEUR FAUDRA<br />
RELEVER ?<br />
D.L. : En dehors de la gestion cruciale de<br />
la trésorerie, les enjeux sociétaux et politiques<br />
vont modifier les stratégies de nos<br />
décideurs, avec la prise en considération<br />
de la responsabilité sociale des entreprises<br />
(RSE), notamment dans le volet de<br />
la production locale et de l’impact environnemental.<br />
L’agilité et la résilience vont<br />
devenir les qualités indispensables à la<br />
survie de notre filière, et cette évolution<br />
passe par une forte digitalisation de nos<br />
processus.<br />
D.LG : Ce que nous remarquons, et c'est<br />
déjà une tendance qui se profilait bien<br />
avant la crise, c'est l’intensification de<br />
nos échanges avec les acteurs du Cloud.<br />
Pour eux, le confinement permet une<br />
poussée encore plus forte notamment<br />
dans le domaine des solvers CFD, du<br />
stockage des données et de la visualisation<br />
à distance.<br />
QUELLE PLACE VONT OCCUPER<br />
LES ESSAIS ET LES MOYENS DE<br />
MESURE ? EN QUOI CES METIERS<br />
VONT-ILS JOUER UN RÔLE<br />
MAJEUR ?<br />
D.L. : Les moyens de mesures sont au<br />
cœur de l’industrie 4.0. Associés à la<br />
robotisation, ce sont eux qui permettront<br />
l’adaptabilité et la polyvalence des outils<br />
de production. C’est cette polyvalence<br />
qui peut permettre en temps de crise de<br />
réorienter rapidement les lignes de fabrication.<br />
Les essais environnementaux, qui<br />
ont pour objectif de valider la qualité et<br />
la durabilité d’un produit, vont naturellement<br />
se généraliser dans les chaînes<br />
de fabrication avec notamment les tests<br />
en fin de ligne. Dans le cas d’une politique<br />
de réindustrialisation de certaines<br />
activités stratégiques, ces métiers seront<br />
essentiels à la compétitivité et à la notoriété<br />
des produits.<br />
LA SIMULATION NUMÉRIQUE EST<br />
DÉJA EN PLEINE EXPANSION.<br />
PENSEZ-VOUS QUE CETTE CRISE<br />
VA FREINER SON DÉVELOPPEMENT<br />
OU AU CONTRAIRE LUI PERMETTRE<br />
DE SE RENFORCER ?<br />
D.L. : Cette crise va favoriser les<br />
outils distants, à commencer par les<br />
jumeaux numériques. Ces technologies<br />
promettent en effet de fluidifier et<br />
de réduire le processus de conception/<br />
test/validation. Dans les programmes de<br />
développement multi-sites/multi-partenaires,<br />
l’association digitalisation/simulation/couplage<br />
physique peut permettre<br />
de tester en simultané des ensembles<br />
fonctionnels complets sans faire déplacer<br />
les équipes, avec un fort gain sur le<br />
coût et le temps de développement.<br />
D.LG : la crise actuelle va sans aucun<br />
doute bousculer une tendance que l’on<br />
12 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ACTUALITÉS<br />
souhaite se dessiner depuis plusieurs<br />
années, à savoir la gratuité des licences.<br />
En raison du confinement, beaucoup<br />
d’éditeurs font finalement ce choix dans<br />
le but de garder leurs clients. En outre,<br />
nos membres nous demandent de partager<br />
encore davantage les méthodologies<br />
et les retours d’expérience ; c’est notamment<br />
ce qui explique le retour de grands<br />
groupes au sein de l’association Nafems<br />
(à l’exemple de G&E aux États-Unis mais<br />
aussi de Renault et Valeo en France).<br />
L’objectif pour eux et de former leurs<br />
ingénieurs dans des domaines pluridisciplinaire.<br />
UN AXE PEUT ÉGALEMENT<br />
S’OUVRIR SUR L’UTILITÉ<br />
DES ORGANISATIONS<br />
PROFESSIONNELLES. QUEL<br />
RÔLE PEUT JOUER VOTRE<br />
ASSOCIATION ?<br />
attention ! aujourd’hui, toutes nos associations<br />
sont fragilisées par l’annulation<br />
en cascade des événements. C’est pourquoi<br />
il est essentiel que nous travaillions<br />
tous ensemble, et non en concurrence<br />
sur des événements traitants du même<br />
sujet, au même moment. Cette crise<br />
sanitaire économique doit donc nous<br />
pousser à plus de collaboration afin<br />
de mieux travailler ensemble entre le<br />
monde académique (près de qui nous<br />
nous rapprochons actuellement fortement),<br />
la recherche et l’industrie, et ce<br />
à travers des événements communs. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
D.L. : Chacun de nous jouera un rôle<br />
essentiel : Nafems dans la conception<br />
et la simulation, Cap’Tronic dans l’électronique<br />
et l’industrialisation, le CFM<br />
dans l’instrumentation et la métrologie<br />
et enfin ASTE dans la validation et<br />
la durabilité. Au sein de l’ASTE, dont la<br />
mission est de fédérer une filière afin<br />
de faire gagner à nos membres technicité<br />
et compétitivité par la mise en<br />
commun des savoir-faire et des expériences,<br />
nous travaillons pour recenser<br />
et faire connaître les moyens et les<br />
capacités de nos membres. Cette action<br />
essentielle, coordonnée et soutenue par<br />
une politique publique « industrielle<br />
», permettrait de faire gagner au tissu<br />
économique français l’agilité et la résilience<br />
recherchées… comme cela a été le<br />
cas de l’action de Cap’Tronic* 1 en faveur<br />
des appareils respiratoires !<br />
D.LG : Comme je l’ai déjà expliqué<br />
précédemment, les nouveaux besoins<br />
exprimés depuis déjà quelques années<br />
et poussés par la crise renforcent la place<br />
d’organisations comme la nôtre. Mais<br />
1 cf. encadré<br />
Exemple du rôle d'une association du<br />
secteur électronique – Cap’Tronic – en<br />
situation de crise<br />
En mars 2020, la France a eu besoin pour ses<br />
hôpitaux de produire en urgence de nouveaux<br />
respirateurs afin de faire face aux besoins<br />
engendrés par la pandémie du Covid-19.<br />
L’État a donc passé commande pour produire<br />
9 000 respirateurs en un mois auprès d’un<br />
consortium d’industriels (Air Liquide, PSA, Valeo<br />
et Schneider Electric) reposant sur leur propre<br />
réseau de sous-traitants pour la fabrication<br />
des cartes électroniques. Sans surprise, la<br />
demande en électronique médicale a connu<br />
une forte augmentation avec la crise actuelle,<br />
ce qui a renforcé les difficultés pour sécuriser<br />
les approvisionnements pour les principales<br />
catégories de composants : électromécaniques,<br />
passifs et semi-conducteurs. Problème : Les<br />
délais d’approvisionnement des composants et<br />
la durée d’acheminement par transporteur ont<br />
rendu la fabrication difficile avec des lignes de<br />
production à l’arrêt par manque de composants,<br />
alors que le besoin était aussi urgent que vital.<br />
L’INTERVENTION EXPRESS DE L'ASSOCIATION<br />
CAP’TRONIC<br />
À la demande d’un de ses partenaires en quête<br />
de composants indispensables à la poursuite<br />
de la fabrication des respirateurs, Cap’Tronic<br />
a été sollicitée. L'association a alors participé<br />
à la recherche de composants disponibles<br />
immédiatement et a questionné à son tour et de<br />
manière ciblée, son réseau d’entreprises : EMS<br />
(Electronic manufacturing services), bureaux<br />
d’études et autres fabricants de produits, afin<br />
de contribuer à cet effort national. L’initiative a<br />
donné un sérieux coup de main à ce partenaire<br />
avec plus d'une centaine de contacts en 48h<br />
et une vingtaine de contributeurs mobilisés<br />
disposant de composants en stock et prêts à<br />
livrer dans l'urgence même par transporteur<br />
privé pendant le week-end, ce qui a permis<br />
d'assurer une production dès le lundi.<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I13
DEWESoft® développe et fabrique des systèmes d’analyse<br />
Vibratoire et Acoustique pour les secteurs de l’industries :<br />
Automobile, Aéronautique, Energie, Automatisme, Production,<br />
Marine et Recherche.<br />
Toutes ces industries ont des éléments (ensembles et sous-ensembles) générant des bruits et<br />
des vibrations (NVH) excessifs.<br />
La norme internationale de communication OPC UA assure l’interopérabilité des<br />
systèmes connectés – (Norme IEC 62541). DEWESoft propose 3 solutions pour raccorder<br />
vos mesures à vos systèmes d’automatisation et de supervision de production :<br />
• DEWESOFT OPC UA SERVER<br />
- SERVEUR OPC, port d’accès congurable.<br />
- PUBLICATIONS DES DONNÉES DEWESOFT<br />
analogique mathématiques, numériques...<br />
• DEWESOFT OPC UA CLIENT<br />
- PROPRIÉTÉS DES MESURES PUBLIÉES nom,<br />
description, valeur actuelle, Offset, mise à<br />
l’échelle, cadence d’acquisition, unité.<br />
- DÉMARRER/ARRÊTER l’ enregistrement.<br />
- VISUALISER le temps de départ, les cadences<br />
d’acquisition.<br />
• DEWESOFT HISTORIAN<br />
- SURVEILLANCE DE VOS ESSAIS gestion,<br />
stockage, visualisation<br />
- ACQUISITION DES DONNÉES et traitements<br />
mathématiques.<br />
- BASE DE DONNÉES organisation, accès aux<br />
mesures, sous-échantillonnage, sauvegardes<br />
- ACCÈS ET AFFICHAGE DES DONNÉES sur le<br />
CLOUD
ACTUALITÉS<br />
ENTRETIEN<br />
La simulation<br />
au chevet des entreprises industrielles<br />
Dans la lignée droite de l’interview croisée, la rédaction d’<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> a choisi de donner la parole à un<br />
acteur majeur de la simulation numérique. Entretien avec François Weiler, directeur général de la filiale française<br />
d’Altair, pour qui si la situation et financièrement difficile, la crise ne peut que renforcer l’intérêt des industriels<br />
pour la simulation numérique.<br />
François Weiler<br />
Directeur général de la<br />
filiale française d’Altair<br />
QUELLE LECTURE AVEZ-VOUS<br />
DE CETTE CRISE SANITAIRE ET<br />
ÉCONOMIQUE ? EN QUOI CELA<br />
IMPACTE VOS CLIENTS ?<br />
Comme beaucoup, nous suivons l’évolution<br />
au jour le jour. Nous n’avons pas de<br />
boule de cristal et sommes bien incapables<br />
d’entrevoir les conditions à long terme. On<br />
sait en revanche que cette crise a et aura un<br />
impact majeur et qu’elle remettra, sans doute<br />
en cause, un certain nombre de paramètres.<br />
On l’espère pour le meilleur pour certains<br />
sujets avec une prise de conscience de changer<br />
certaines choses.<br />
En tout cas à court terme sur l’économie,<br />
l’impact négatif sera assez fort. On aura<br />
besoin des efforts de tous pour absorber ce<br />
choc. Concrètement, pour nos clients, qui<br />
pour beaucoup sont des industries manufacturières (dont un certain nombre dans le transport),<br />
les usines sont à l’arrêt ; leur capacité à vendre également ce qui engendrent de véritables<br />
problématiques de cash-flow avec une diminution drastique du financement de la<br />
R&D. Les ingénieurs, qui sont nos interlocuteurs actuels sont aussi très diminués avec des<br />
taux d’arrêt mélangés entre les congés et le chômage partiel qui peuvent atteindre 60%.<br />
Il y a donc un gros coup de frein sur l’activité. Jusqu’à quand cela va durer ? Nous sommes<br />
tous suspendus à l’évolution de la situation sanitaire pour pouvoir ensuite redémarrer l’activité<br />
économique.<br />
DE QUELLE NATURE SONT LEURS DIFFICULTÉS ET QUELS SONT LES<br />
CHALLENGES QU’IL LEUR FAUDRA RELEVER ?<br />
C’est difficile d’avoir une vision d’ensemble très claire. On reçoit des courriers de cas de<br />
force majeure de nos clients qui mettent au moins sur pause pour certains quand d’autres<br />
annulent des projets. Ce que l’on peut d’ores et déjà dire c’est qu’à très court terme, il y aura<br />
de vraies difficultés de cash-flow avec des capacités d’investissement à revoir et à gérer par<br />
conséquent. Dans quelles proportions ? Si coupes budgétaires il y a, quels projets seront<br />
impactés ? Là est toute la question.<br />
Mais dans tout challenge, il peut y avoir des opportunités. Nous pouvons espérer que des<br />
solutions, qui sont porteuses d’économie de temps et de coût, plus fortes mais plus risquées<br />
« À très court terme, il y aura de vraies difficultés de cash-flow avec<br />
des capacités d’investissement à revoir. Mais dans tout challenge,<br />
il peut y avoir des opportunités. Nous pouvons espérer que (…) les<br />
entreprises auront plus d’appétit pour des solutions plus en rupture. »<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I15
ACTUALITÉS<br />
renforcer. Malgré le confinement, on constate déjà que certains<br />
clients se sont mis à l’usage de la puissance de calcul dans le Cloud,<br />
à disposer d’un serveur de licences hébergé. On devrait donc, au<br />
contraire, être amené à répondre à des challenges encore plus fort.<br />
Et la simulation devrait connaître une croissance forte.<br />
À QUELS CHALLENGES DEVRONT RÉPONDRE LES<br />
ÉDITEURS POUR ACCOMPAGNER LES INDUSTRIELS<br />
DURANT CETTE PÉRIODE DE CRISE SANS PRÉCÉDENT ?<br />
Analyse de la structure des griffes avec le logiciel SimSolid d’Altair<br />
car elles ont été encore peu ou pas appliquées, vont connaître un<br />
nouvel élan et que les entreprises auront plus d’appétit pour ces<br />
solutions plus en rupture.<br />
Dans le monde de l’ingénierie, à la fois innovant mais assez conservateur,<br />
nous avons besoin d’assurer la qualité d’un produit in fine.<br />
Nous avons toute une batterie de process, notamment le fameux<br />
cycle en V de développement qui reste la colonne vertébrale de<br />
beaucoup de cycles de développement. Est-ce que c’est une opportunité<br />
pour l’améliorer ? Je l’espère.<br />
QUELLES PLACES VONT OCCUPER LES ESSAIS ET LA<br />
SIMULATION ? EN QUOI CES MÉTIERS VONT-ILS JOUER<br />
UN RÔLE MAJEUR ?<br />
La situation actuelle devrait être un accélérateur puisque c’est vraiment<br />
la définition des besoins en amont de ce que l’on veut obtenir<br />
avec un produit, comment on le développe et on le valide au<br />
fur et à mesure. C’est à cela que servent les essais et la simulation.<br />
Ce besoin sera toujours vrai et sans doute plus fort. Tester, imaginer,<br />
essayer d’explorer des solutions, c’est à cela que sert la simulation.<br />
Elle aura un rôle à jouer dans le développement de solutions<br />
innovantes, autrement.<br />
On aura très certainement besoin de réagir plus vite. Je pense qu’à<br />
la fois il y aura des temps de développement sous contraintes et à la<br />
fois beaucoup moins de visibilité sur ce que l’on veut atteindre. De<br />
quoi aura besoin le marché demain ? Cet exercice a toujours été très<br />
compliqué et va se confirmer dans les mois et les années à venir.<br />
PENSEZ-VOUS QUE CETTE CRISE VA FREINER LE<br />
DÉVELOPPEMENT DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE OU<br />
AU CONTRAIRE LUI PERMETTRE DE SE RENFORCER ?<br />
Clairement, de se renforcer. À très court terme, Altair et nos<br />
confrères allons très certainement traverser une année 2020<br />
difficile. Il faudra que nous prenions une part des difficultés<br />
économiques de nos clients. Mais à moyen terme, l’appétit pour<br />
la simulation est présent ; je reste donc persuadé que cela va se<br />
« À moyen terme, l’appétit pour la simulation<br />
va se renforcer. Malgré le confinement, on<br />
constate déjà que certains clients se sont<br />
mis à l’usage de la puissance de calcul dans<br />
le Cloud, à disposer d’un serveur de licences<br />
hébergé (…) La simulation devrait connaître<br />
une croissance forte. »<br />
Sur le côté technologique et économique, il nous faut continuer,<br />
chez Altair, de faciliter l’accès à nos solutions que ce soit par des<br />
solutions hébergées, de la puissance de calcul, des licences courtterme.<br />
À l’avenir, nos clients auront très peu de temps pour analyser,<br />
mettre en place, déployer ces solutions tout en y trouvant un<br />
retour sur investissement. Sur le plan ergonomique, nous travaillons<br />
à rendre encore plus facile l’usage de nos outils. Nous devons<br />
être capables de faire des simulations en minutes et non plus en<br />
heures ou en jours.<br />
COMMENT ALTAIR S’EST ORGANISÉ POUR ACCOMPAGNER<br />
SES CLIENTS DANS CETTE CRISE SANITAIRE ?<br />
Tout de suite nous avons communiqué auprès de nos clients pour<br />
qu’ils ne sentent pas seuls. C’est dans notre ADN d’accompagner.<br />
Nous avons par exemple proposé des solutions de prêt de licences<br />
que ce soit local ou en serveur central mais hébergé chez Altair, de<br />
fourniture de puissance de calculs. Notre support technique reste<br />
entièrement joignable. Notre numéro de téléphone est toujours<br />
valide et qui permet de répondre immédiatement à nos clients.<br />
Bien entendu les équipes Altair sont aussi joignables par mail.<br />
Chez Altair, on a une tradition qui est d’être un partenaire de long<br />
terme. Les clients le savent et n’hésitent pas à nous solliciter. On<br />
leur tend la main et nous voyons ensemble, par rapport à leur<br />
problématique très court terme. Certes, nous cherchons à faire<br />
grandir notre société et nos activités ; mais dans des contextes<br />
aussi inédits, il faut savoir se montrer à la hauteur du partenariat<br />
que l’on propose. Autant que nous pouvons le faire, nous aidons<br />
nos clients gratuitement. Le mot d’ordre : d’abord aider et nous<br />
verrons plus tard comment Altair peut s’y retrouver. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
16 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ACTUALITÉS<br />
COMPTE-RENDU<br />
En réponse au confinement,<br />
Comsol a recours au webinar !<br />
Le 2 avril dernier, l’éditeur a organisé ses Comsol Days, une journée de conférences devant initialement se<br />
tenir à Grenoble et qui finalement s’est déroulée sous la forme d’un webinaire riche en informations portant<br />
sur la simulation numérique, ses enjeux et la présentation de la dernière version – v5.5 – Comsol Multiphysics.<br />
Une table ronde, animée par la rédaction du magazine <strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong>, a également permis d’exposer<br />
les bonnes pratiques à adopter pour mettre en place la simulation dans l’entreprise.<br />
Très enclin au dialogue, il permet en outre, avec Comsol Compiler,<br />
de transformer cet outil de simulation en un « exécutable »<br />
et de se déployer à grande échelle grâce à Comsol Server : il<br />
s’agit d’un logiciel auquel on peut se connecter via le Web pour<br />
recréer une bibliothèque de l’ensemble des modèles. Ainsi, avec<br />
un login d’accès, n’importe quelle personne autorisée peut accéder<br />
et relancer le modèle. L’exemple utilisé à partir d’un siège chauffant<br />
a permis d’illustrer de façon concrète les usages complémentaires<br />
de ces deux fonctions permettant au plus grand nombre<br />
d’exploiter le modèle.<br />
Les solutions sont conçues Comsol pour permettre à<br />
tous, sans compétence initiale en modélisation, d’utiliser<br />
le logiciel mais aussi pour dialoguer / communiquer<br />
entre les différents services et partager des résultats de<br />
simulation, interagir et faire évoluer les modèles. C’est dans cet<br />
esprit de la seconde journée des Comsol Days s’est tenue sous<br />
la forme d’un webinaire le 2 avril dernier (la première ayant<br />
eu lieu le 24 mars).<br />
Après quelques mots d’accueil d’Éric Favre, directeur de Comsol<br />
France, Barbara Comis, ingénieure technico-commerciale chez<br />
Comsol France depuis trois ans, est venue présenter Comsol<br />
dans son ensemble ainsi que l’outil phare de l’éditeur, Comsol<br />
Multiphysics, mettant notamment l’accent sur les deux modes<br />
de déploiement de la licence : Comsol Server (permettant de<br />
rendre accessible les applications à de multiples collaborateurs/<br />
services) et Comsol Compiler servant à compiler des applications<br />
autonomes. Ensuite, ce fut au tour de Colas Joannin (ingénieur<br />
d’application de Comsol France) d’entrer dans le détail de l’interface<br />
Comsol Multiphysics. Outre l’avantage de l’interface unique,<br />
quels que soient les travaux à réaliser (thermique, fluidique et<br />
autres phénomènes physiques), Comsol Multiphysics offre la<br />
possibilité de générer des séquences de maillage automatiques.<br />
DÉMONSTRATION DE LA NOUVELLE VERSION DE COMSOL<br />
MULTIPHYSICS 5.5<br />
Dans cette présentation, Colas Joannin précise que chez Comsol,<br />
« une nouvelle version est toujours le fruit d’un travail d’écoute<br />
et de prise en compte des besoins et des attentes des utilisateurs<br />
». Parmi les nombreuses nouveautés, ingénieur d’application<br />
a notamment sélectionné la géométrie permettant d’en faire<br />
un outil CAO encore plus performant ; de même, cette nouvelle<br />
version a fortement mis l’accent sur ses performances HPC. Aussi,<br />
le logiciel se montre toujours plus simple d’utilisation dans la<br />
mise en œuvre d’une amélioration topologique et géométrique.<br />
De nouveaux modules apparaissent également dans cette version<br />
5.5 comme l’écoulement dans les milieux poreux et le lancement<br />
nouveau produit « Metal Processing Modul ». Enfin, l’éditeur a<br />
optimisé la dynamique des structures à l’image des vibrations<br />
aléatoires comme celles générées par le vent ; une fonctionnalité<br />
répondant à une volonté de certains secteurs comme le génie<br />
civil, éolien, transport pour certifier les produits.<br />
Ensuite, Pascal Scott, ingénieur au CEA à Grenoble, est venu<br />
témoigner de son expérience de l’outil Comsol Multiphysics<br />
portant sur la modélisation d’une pile à combustible, puis Miguel<br />
Moleron, chercheur en acoustique au sein de la société grenobloise<br />
Hap2U, qui s’est attardé que les opérations de simulation<br />
multiphysique chargées de concevoir et d’optimiser les surfaces<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020I17
ACTUALITÉS<br />
Rendre la simulation<br />
plus accessible<br />
haptiques. Des conférences qui donneront éventuellement lieu à<br />
des retours d’expérience que l’on pourra retrouver dans le magazine<br />
<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong>.<br />
L’après-midi s’est déroulée la table ronde animée par le magazine<br />
<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong>, laquelle était spécialement consacrée<br />
aux enjeux de la simulation numérique. Y participaient<br />
M'hamed Boutaous, maître de conférences à l’INSA de Lyon,<br />
Patrick Namy, dirigeant de la société d’ingénierie Simtec (certifié<br />
Comsol), Maxime Villière, docteur-ingénieur de recherche au<br />
sein de Capacités, une société de valorisation de la recherche de<br />
l’université de Nantes, et enfin Jean-Marc Petit, VP of Business<br />
Developement chez Comsol France. Enfin, la journée s’est achevée<br />
sur une intervention d’Éric Favre portant sur les solutions d’accompagnement<br />
des entreprises dans leur utilisation de Comsol<br />
Multiphysics. ●<br />
Au programme de cette table ronde, destinée autant à des<br />
habitués et des néophytes en matière d’outils de modélisation,<br />
les intervenants ont chacun énuméré les principes et les enjeux de<br />
la simulation numérique et des outils logiciels qui l’accompagnent.<br />
Marché en pleine croissance, tant en France que dans le monde<br />
entier (de l’ordre de 5% à 10% par an), la simulation numérique<br />
se heurte encore à des idées reçues, décourageant souvent les<br />
non initiés (en particulier chez PME) alors que les solutions tels<br />
que la dernière version de Comsol Multiphysics sont de plus en<br />
plus accessibles.<br />
À l’inverse, certaines entreprises s’imaginent qu’au vue des interfaces<br />
de plus en plus conviviales, ce type d’outil de modélisation et de<br />
simulation sont simples à utiliser. « Faux ! s’insurge M’hamed<br />
Boutaous. Il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité et<br />
penser que la simulation peut tout faire ». Patrick Namy ajoute<br />
que « la simulation ne doit pas se faire sur un coin de table » et<br />
qu’il faut « à tout prix être conscient des limites du modèle qu’on<br />
veut développer ». Dans tous les cas, l’une clefs de réussite réside<br />
dans la modélisation précise d’éléments physiques et bien cerner<br />
les problèmes – « sans rien négliger », avertit M’hamed Boutaous<br />
– avant d’entamer les opérations de simulation à proprement parlé.<br />
De son côté, Maxime Villière insiste sur l’importance de « ne pas<br />
laisser la réalité de côté en faisant trop confiance à la simulation<br />
et à faire trop de modèles ; cela peut vite devenir une usine à gaz ».<br />
« Y aller étape par étape demeure la bonne façon de faire », conclut<br />
Jean-Marc Petit.<br />
Olivier Guillon<br />
18 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
INTERVIEW CROISÉE<br />
Covid-19 - Comment s’organisent les associations<br />
professionnelles de la mesure et des END<br />
Sandrine Gazal,<br />
directrice du<br />
Collège français<br />
de métrologie<br />
(CFM)<br />
Marc-Robert<br />
Henrard,<br />
président du<br />
Réseau Mesure<br />
depuis juin 2018<br />
François Champigny,<br />
président de la<br />
Confédération française<br />
pour les essais non<br />
destructifs (Cofrend)<br />
Mustapha El<br />
Bouchouafi,<br />
président du groupe<br />
mesure-visioncontrôle<br />
du Symop<br />
QUELLE LECTURE AVEZ-VOUS DE CETTE CRISE<br />
SANITAIRE ? EN QUOI CELA IMPACTE VOS<br />
ADHÉRENTS ?<br />
Sandrine Gazal (S.G.) : Le Collège français de métrologie<br />
(CFM), avec près de 700 adhérents, couvre tous les secteurs<br />
d’activités industriels, les laboratoires, l’enseignement… De<br />
ce fait, l’impact de la crise sanitaire actuelle est brutal pour<br />
le milieu industriel dans lequel nous évoluons. Cependant,<br />
cet impact est différent selon les secteurs d’activité : pour<br />
le médical et l’industrie pharmaceutique, il s’agit plutôt<br />
d’une période de suractivité alors que du côté de la mécanique,<br />
c’est un arrêt presque complet.<br />
Marc-Robert Henrard (MR.H) : Cette crise sanitaire inattendue<br />
et de très forte ampleur impacte de façon importante<br />
les activité commerciales et logistiques des adhérents<br />
du Réseau Mesure. En effet, la première conséquence<br />
Photo AB Vision<br />
et la plus difficile à contrôler est la chute de chiffre d’affaires<br />
pour certains d’entre eux qui n’ont plus la possibilité<br />
de se déplacer chez leurs clients. De plus, ces derniers<br />
ayant eux-mêmes un manque de visibilité sur l’évolution<br />
de la situation adoptent souvent des stratégies de repli et<br />
réduisent leurs achats. Ces difficultés commerciales sont<br />
amplifiées par les dysfonctionnements logistiques en très<br />
grands nombres.<br />
François Champigny (F.C.) : Indéniablement, la crise sanitaire,<br />
inédite pour la très grande majorité des français, des<br />
entreprises, des collectivités, a et va avoir des répercussions<br />
importantes et peut être dramatiques pour certains d’entre<br />
nous au-delà des décès trop nombreux constatés jusqu’à<br />
maintenant. Le contexte économique qui touche nos adhérents,<br />
impacte inévitablement les activités de la Cofrend<br />
à court et moyen terme. Comme beaucoup de sociétés<br />
et d’associations qui reçoivent du public, nous avons dû,<br />
dès le 16 mars, fermer nos locaux, siège de la Confédération<br />
et centre d’examen national de Certification Cofrend<br />
Niveau 3. Il en a été de même pour les centres d’examen<br />
agréés Cofrend, Niveau 1 & 2. En accord avec le Cofrac,<br />
nous avons pu prolonger les dates de validité des certificats.<br />
Le deuxième impact concerne l’activité scientifique de la<br />
Cofrend qui est aussi au ralenti mais l’impulsion que nous<br />
avons donnée pour développer le « Structural Health Monitoring<br />
», la branche SHM de la Cofrend reste active, ce qui<br />
nous conforte dans le fait de continuer dans cette voie et de<br />
toujours être force de proposition et d’accueil de nouveaux<br />
participants. Le troisième impact concerne l’évènementiel<br />
et la communication et, en particulier, l’organisation du<br />
Congrès de la Confédération, les Journées Cofrend 2020,<br />
20 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
à Marseille, qui ont dû être reportées à la fin de l’année.<br />
Mustapha El Bouchouafi (M.EB) : Dans un contexte de<br />
crise sanitaire inédite ou le marché a connu l’une de ses<br />
plus fortes baisses au premier trimestre, le Symop, tout<br />
comme ces adhérents, subit une baisse d’activité. Notre<br />
engagement, déjà ancien, afin de conseiller et d’accompagner<br />
nos adhérents, s’est considérablement affermi par<br />
les dispositifs mis en place dès le début de la crise : FAQ,<br />
hotline, bourse à l’entraide industrielle (Cf. encadré).<br />
©djama<br />
DE QUELLE NATURE SONT LEURS DIFFICULTÉS<br />
ET QUELS SONT LES CHALLENGES QU’IL LEUR<br />
FAUDRA RELEVER ?<br />
S.G. : Comme pour toute l’industrie, il faut avant tout passer<br />
ce moment difficile, peut-être réduire momentanément<br />
les activités pour réorganiser rapidement les méthodes de<br />
travail : il va certainement falloir s’habituer à travailler avec<br />
un masque ! Les relations à distance sont également en train<br />
de se développer à une vitesse folle : les outils existaient déjà<br />
mais aujourd’hui, la vidéo est devenue indispensable. Et les<br />
nouvelles méthodes induites par la crise sanitaire ne seront<br />
pas oubliées après.<br />
MR.H : L’enjeu pour les adhérents est simple : maintenir<br />
un cash-flow nécessaire à une reprise de l’activité dynamique<br />
dès la sortie de crise. Les nombreuses mesures mises<br />
en place sont très bénéfiques aux entreprises mais réussiront-elles<br />
à compenser l’arrêt d’activité sur le second<br />
semestre ? Les reports de salons professionnels ont fortement<br />
impacté la stratégie de communication de nos adhérents<br />
qui vont devoir redoubler d’efforts commerciaux et<br />
marketing afin de combler le manque à gagner causé par<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I21
MESURES<br />
la crise du Covid-19. Les structures les plus solides financièrement<br />
peuvent mettre en place des stratégies leurs<br />
permettant de terminer l’année dans des conditions de<br />
consolidation de l’activité mais les plus fragiles ne vont<br />
pas pouvoir gérer cette crise sans remise en cause de leur<br />
pérennité.<br />
F.C. : Comment reprendre la certification du personnel en<br />
respectant les consignes gouvernementales et en répondant<br />
aux besoins de l’industrie ? Si la formation et les examens<br />
théoriques vont évoluer rapidement vers la dématérialisation<br />
(e-formation, e-examen), les examens pratiques pourront-ils<br />
continuer à être mis en œuvre comme maintenant ?<br />
Sans avoir de réponse à cette question, la crise sanitaire va<br />
conduire à nous interroger rapidement et à prendre des<br />
mesures rapidement.<br />
Sur le plan scientifique, le temps mis à disposition par<br />
les entreprises, les écoles, centres de recherche, universités,<br />
laboratoires risque d’être plus compté dans un futur<br />
proche et ralentir tout ce travail scientifique collaboratif.<br />
Je ne peux espérer qu’une chose, me tromper sur ce point.<br />
M.EB : Pour les adhérents, il est clair qu’il faudra assurer<br />
la sécurité des collaborateurs et des clients lors des interventions,<br />
préparer au mieux le post-confinement afin de<br />
répondre au plus vite et au mieux aux attentes des clients<br />
et des prospects et ainsi limiter autant que possible l’impact<br />
de la crise que nous vivons. Les circonstances sont à<br />
la fois graves et inédites et toutes les actions des adhérents<br />
dépendront des OEMs (équipementiers) ; ces derniers<br />
peuvent amortir le choc en favorisant une génération de<br />
revenu pour leurs fournisseurs. La mobilisation et l’agilité<br />
des collaborateurs seront également clef dans cette<br />
période inédite.<br />
QUELLES PLACES VONT OCCUPER LES MOYENS<br />
DE MESURE ET LES ESSAIS NON DEESTRUCTIFS ?<br />
EN QUOI CES METIERS VONT JOUER UN RÔLE<br />
MAJEUR ?<br />
22 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
Photo Accretech<br />
MR.H : En pleine crise, les métiers de la mesure et de la<br />
métrologie jouent déjà un rôle majeur notamment dans<br />
la fourniture de solutions aux hôpitaux et aux laboratoires<br />
mais également dans le contrôle et l’étalonnage de solutions<br />
produites en France répondant aux besoins des acteurs<br />
médicaux. Demain, les usines vont de nouveau – espérons-le<br />
– se remettre à fonctionner à 100%. Les enjeux de<br />
certification, de maintenance et de qualité sont importants<br />
afin que les acteurs économiques industriels restent compétitifs<br />
et puissent répondre à une demande qui va évoluer.<br />
F.C. : La place des END dans l’industrie reste d’importance<br />
dès lors que la sécurité des personnes et la sûreté<br />
des équipements sont des enjeux primordiaux. Je ne pense<br />
pas qu’il y ait une remise en cause de ces aspects fondamentaux<br />
à la suite de la crise sanitaire. Je pense plutôt que<br />
dans l’arsenal des mesures à prendre, il serait dangereux<br />
de faire des impasses au seul motif de la rentabilité à très<br />
court terme. D’ailleurs, la crise sanitaire a montré que les<br />
pays qui disposent de l’industrie d’appareillage de pointe,<br />
notamment médical, associée à des politiques volontaristes<br />
fortes, s’en sortent avec moins de mal que d’autres.<br />
Je reste donc confiant sur nos capacités et sur la qualité<br />
des personnes qui font ce métier de contrôleur, quel que<br />
soit le domaine, pour continuer à être reconnu sans pour<br />
autant faire de triomphalisme. Cela reste un combat de<br />
tous les jours.<br />
Experts en<br />
essais vibratoires<br />
• Contrôle vibratoire<br />
• Essai de choc<br />
• Analyse vibratoire et acoustique<br />
• Analyse modale expérimentale<br />
• Analyse de machines tournantes<br />
• Bancs d’essais<br />
m+p international Sarl<br />
5, rue du Chant des Oiseaux<br />
78360 Montesson<br />
Tél. : +33 130 157874<br />
sales.fr@mpihome.com<br />
www.mpihome.com<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I23
MESURES<br />
Photo Endress Hauser<br />
M.EB : Le rôle du contrôle de qualité ne va pas changer.<br />
En revanche, il y aura une prudence du coté client sur<br />
les investissements. Plus que jamais, la productivité et la<br />
qualité seront les moteurs des entreprises dans le but d’assurer<br />
une compétitivité internationale.<br />
UN AXE PEUT ÉGALEMENT S’OUVRIR SUR L’UTILITÉ<br />
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. QUEL<br />
RÔLE PEUT JOUER VOTRE ASSOCIATION ?<br />
S.G. : Le CFM a pour mission de promouvoir les bonnes<br />
pratiques mesure et métrologie pour l’amélioration des<br />
processus industriels. Cette mission sera d’autant plus<br />
d’actualité à la sortie de la crise. En effet, l’industrie va<br />
devoir se réinventer car il est illusoire d’imaginer que<br />
nous allons « faire comme avant » et rattraper le temps<br />
perdu pendant le confinement. Les semaines que nous<br />
sommes en train de traverser nous montrent également<br />
que nous sommes capables de relancer en France et en<br />
Europe une industrie viable avec une compétence technique<br />
indéniable. Enfin, le moment est venu de véritablement<br />
lancer ce « green deal » industriel dont nous avons<br />
tous besoin. Dans toutes ces phases, les outils, méthodes<br />
et innovations de la mesure et de la métrologie auront<br />
leur place, sans aucun doute !<br />
MR.H : Le rôle du Réseau Mesure est avant tout d’informer<br />
et de soutenir ses adhérents durant cette période<br />
difficile, notamment par le biais d’actions mutualisées<br />
pragmatiques et efficaces. L’objectif est de permettre<br />
à nos adhérents de gagner du temps, de la visibilité et<br />
des opportunités commerciales. L’association donne la<br />
possibilité aux équipes de rompre leur isolement en ces<br />
périodes complexes et de développer des synergies techniques<br />
et commerciales.<br />
F.C. : La Cofrend, en tant qu’association reste un acteur<br />
incontournable pour la certification END et sa communauté<br />
scientifique. Notre mission d’assurer le niveau des<br />
compétences des agents en contrôles non destructifs va<br />
nous obliger à rattraper toutes les extensions de validité<br />
faites pendant la période de confinement. Les équipes du<br />
pôle certification ont déjà anticipé la reprise des examens<br />
dans leurs centres avec la mise en place de règles sanitaires<br />
permettant d’accueillir les candidats dans les meilleures<br />
conditions et en toute sécurité. La crise sanitaire va aussi<br />
nous contraindre à accélérer le développement de plateformes<br />
de formation et d'examens en ligne. Fin mars, la<br />
Cofrend a reçu l’arrêté de renouvellement de son habilitation<br />
dans les Équipements sous pression du ministère de<br />
la Transition écologique, et ce pour une durée de trois ans.<br />
24 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
Par ailleurs, la Cofrend a continué de tisser des liens<br />
étroits avec ses partenaires institutionnels tels que<br />
l’Afiap, le Gifen, le Gifas, l’Afnor, et renforcé ses contacts<br />
avec les grands acteurs en END et les grands donneurs<br />
d’ordre, pour être au plus près des enjeux industriels et<br />
ainsi répondre aux requêtes de ses adhérents. Parmi les<br />
autres activités de la Cofrend, nous avons des projets stratégiques,<br />
comme la mise en application en France d’une<br />
certification en CND propre au génie civil pour contrôler<br />
le vieillissement des ouvrages d’arts ou le lancement de<br />
la filière SHM Cofrend en France. Même si la crise sanitaire<br />
nous impose un ralentissement temporaire dans nos<br />
acticités, je reste convaincu du bienfondé de nos actions<br />
de développement en France comme à l’étranger.<br />
M.EB : Le rôle d’une association professionnelle est de<br />
protéger l’exercice de la profession et de sauvegarder les<br />
intérêts professionnels et économiques de ses membres.<br />
Je ne vois pas en quoi le post-crise sanitaire peut impacter<br />
ces associations si ce n’est pas pour les renforcer. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
Une bourse d’entraide<br />
lancée au sein du Symop pour<br />
l’ensemble des industriels<br />
français !<br />
Lancé en collaboration avec le Groupement des<br />
équipementiers du process et du packaging des<br />
industries agroalimentaires et non-alimentaires (Geppia)<br />
et complètement ouvert à l’ensemble de l’industrie, ce<br />
service de bourse à l’entraide industrielle est disponible<br />
en ligne pour tous les professionnels (sans adhésion ni<br />
inscription). Il a pour objectif d’aider concrètement les<br />
entreprises qui rencontrent des difficultés dans la continuité<br />
de leur activité en comptant sur la solidarité des autres<br />
industriels. Fiabilité des chaînes d’approvisionnement,<br />
maintien d’activité des fournisseurs de matières premières<br />
et de pièces de rechange, sous-traitance disponible,<br />
problèmes administratifs... le site apporte toutes les<br />
réponses nécessaires à la lisibilité du tissu industriel<br />
actuel, et donc à la continuité d’activité.<br />
EN SAVOIR PLUS > www.bourse-entraide-industrie.com<br />
ÉVÉNEMENT<br />
Les Journées<br />
de la Mesure<br />
en Web-conférence<br />
les 16 et 17 juin !<br />
EN SAVOIR PLUS > www.cfmetrologie.com<br />
Organisées par le Collège français de métrologie, les JM<br />
2020 se dérouleront par Web-conférence les 16 et 17 juin.<br />
Initialement prévues pour se dérouler à Lyon, ces journées<br />
aborderont la mesure au plus près des besoins avec des<br />
bonnes pratiques présentées lors de tutoriels et des mises<br />
en application en ateliers.<br />
Le déroulé des journées a été revue par rapport aux éditions<br />
précédentes : le premier jour est consacré aux bases de la<br />
métrologie et aux incertitudes de mesure, tandis que le<br />
second sera décliné dans trois directions : le dimensionnel,<br />
les laboratoires et le climatique.<br />
Les secteurs applicatifs concernés sont vastes : la mécanique,<br />
le pharmaceutique, l’agro-alimentaire, la biologie,<br />
l’environnement… Les responsables et techniciens<br />
de laboratoire, les responsables qualité et responsable du<br />
processus métrologie se retrouveront dans les contenus.<br />
Le programme détaillé est accessible en ligne sur le site<br />
Web du CFM. ●<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I25
MESURES<br />
ÉVÉNEMENT<br />
Lancement de<br />
la 3 e édition du<br />
salon Mesures<br />
Solutions Expo,<br />
le salon des<br />
professionnels<br />
de la Mesure<br />
Action phare du Réseau Mesure pour l'année 2020,<br />
la troisième édition du salon Mesures Solutions<br />
Expo2020 se tiendra les 14 et 15 octobre prochain à<br />
la Cité des Congrès de Lyon. Ce nouvel événement<br />
présentera l'exhaustivité de l'offre de la mesure,<br />
du monde de la recherche à celui de la production,<br />
des solutions actuelles aux perspectives futures.<br />
Être au plus près des clients, telle est la devise du salon<br />
Mesures Solutions Expo. En proposant une offre générale<br />
répondant aux besoins potentiels multiples, les exposants<br />
ont souhaité réunir les professionnels de la mesure<br />
sur un même lieu afin de leur proposer des solutions complètes.<br />
Les visiteurs peuvent ainsi accéder à une offre diversifiée, quels<br />
que soient leurs attentes, les techniques et les procédés utilisés.<br />
Les produits innovants seront présents au même titre que les<br />
savoir-faire les plus pointus, tant sur les stands qu'au cours des<br />
ateliers exposants. Organisé autour de plus de 130 stands, les visiteurs<br />
auront l’occasion de découvrir près de 300 grandes marques<br />
françaises et internationales. Du conseil à la réalisation de projets,<br />
les experts présents sur ce salon conseilleront les visiteurs non<br />
seulement à travers des solutions innovantes présentées sur leurs<br />
stands, mais aussi grâce à l'organisation d'une vingtaine d'ateliers<br />
thématiques, au cours desquels ils présenteront leurs savoir-faire<br />
et leurs nouveautés.<br />
NOUVEAUTÉS : LES START-UP ET L’EMPLOI-FORMATION<br />
À L’HONNEUR<br />
Cette année, un espace sera dédié aux Start-Up afin qu’elles<br />
puissent présenter leurs projets. Le monde de la mesure évolue<br />
et touche de plus en plus de domaines pour lesquels de nouvelles<br />
expertises sont maintenant disponibles. Former et recruter en<br />
adéquation avec le marché, une nécessité pour continuer à<br />
répondre au mieux aux besoins des clients. Mesures Solutions<br />
EXPO2020 proposera cette année un espace d’échanges entre<br />
professionnels de la mesure, écoles et acteurs du recrutement.<br />
Des opportunités d’emploi sont nombreuses.<br />
LE CFM PARTENAIRE DE L'ÉVÉNEMENT<br />
Dans ce cadre, le Collège français de métrologie animera le Pavillon<br />
« Innovation Métrologie » du salon, un espace dédié aux adhérents<br />
du CFM qui souhaitent se rapprocher de cette thématique.<br />
Il organise également un cycle de conférences sur des sujets en<br />
phase avec les besoins industriels et des quizz orientés qualité,<br />
méthodes et techniques, ainsi que des animations ludiques et<br />
pragmatiques sur la métrologie : Aurez-vous la bonne mesure ?<br />
La réponse cet automne ! ●<br />
EN SAVOIR PLUS > mesures-solutions-expo.fr<br />
26 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
www.aste.asso.fr<br />
Formations Spécifiques<br />
Formations Aste :<br />
Les dernières techniques d’essais, de modélisation et<br />
de simulation d’essais d’environnements pour les<br />
ingénieurs et techniciens.<br />
Par son approche originale centrée «<br />
essais et simulation des environnements<br />
rencontrés par vos produits au cours de<br />
leur cycle de vie », la formation ASTE<br />
vous permet d’optimiser vos processus<br />
de mise en œuvre de produits.<br />
2020
MESURES<br />
RETOUR D’EXPÉRIENCE<br />
Horiba Medical<br />
mise sur la simulation<br />
pour développer ses<br />
nouveaux dispositifs<br />
hématologiques<br />
Avec la crise du coronavirus, le domaine de<br />
la santé se place aujourd’hui au cœur des<br />
problématiques sociales, économiques et<br />
industrielles. Mais les acteurs du médical<br />
doivent en permanence améliorer leur outil de<br />
production pour mieux répondre à la demande.<br />
C’est le cas d’Horiba Medical, fabricants<br />
d’automates d’analyses hématologiques,<br />
qui a notamment eu recours à la simulation<br />
multiphysique pour optimiser la conception<br />
de ses produits.<br />
Cela fait plus de trente ans qu’Horiba Medical<br />
conçoit, fabrique et commercialise des automates<br />
performants d’analyses hématologiques<br />
pour les laboratoires et hôpitaux. Une expertise<br />
qui a fait de cette société l’un des acteurs majeurs du<br />
diagnostic in vitro. Mais les évolutions du marché, l’apparition<br />
de nouveaux concurrents ou encore l’entrée dans le<br />
domaine public de technologies historiques brevetées ont<br />
Exemple de simulation d’écoulement dans des tuyaux bifurcations<br />
amené l’entreprise à développer de nouvelles solutions<br />
innovantes pour se différencier et rester compétitive.<br />
Aujourd’hui, pour réaliser un bilan sanguin complet<br />
(hémogramme), l'analyseur effectue de manière totalement<br />
automatisée, en moins d’une minute, le prélèvement<br />
de l’échantillon dans le tube de sang, la préparation<br />
chimique et, avec différents types de capteurs, la caractérisation<br />
et le comptage des différentes cellules sanguines,<br />
la recherche d’éventuelles cellules immatures ou pathologiques,<br />
et enfin l’analyse et la transmission du résultat. De<br />
tels automates, déployés notamment dans les hôpitaux ou<br />
les grands plateaux techniques, sont également soumis à<br />
des contraintes d’usage telles que, la haute cadence ou l’automatisation<br />
complète du diagnostic. Ceci impose donc<br />
de compter un nombre important de cellules en un temps<br />
très court, ce qui génère des conditions multiphysiques<br />
très complexes.<br />
La stratégie d’Horiba Medical repose sur le développement<br />
de nouveaux produits plus performants, mais aussi<br />
l’élargissement de son offre. Améliorer les cadences et<br />
l'utilisation des instruments, détecter des pathologies<br />
particulières, aider à une meilleure compréhension des<br />
mesures à l'échelle cellulaire ou encore déployer les<br />
diagnostics médicaux au plus près du patient (POCT :<br />
Point Of Care Testing) sont quelques-uns des axes choisis.<br />
Ceux-ci imposent de devoir appréhender de nouvelles<br />
28 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
Plus précisément, développer des dispositifs hématologiques<br />
implique de prendre en compte des phénomènes<br />
physiques électriques, optiques, hydrauliques, chimiques,<br />
thermiques et microfluidiques, ainsi que les couplages associés.<br />
Par exemple, au niveau électrique, les cellules passent<br />
dans un micro-orifice entre des électrodes (principe Coulter),<br />
afin de mesurer la variation d’impédance qui en résulte<br />
et compter les cellules. La tâche est délicate au vu des 5<br />
millions de globules rouges présents dans un microlitre<br />
de sang. En outre, des bancs optiques sont utilisés pour<br />
différencier les cellules d’après leur contenu intracellulaire.<br />
Le transfert des échantillons dans les canaux s'effectue<br />
par écoulement de fluide, dont les propriétés sont parfois<br />
complexes.<br />
Concernant la chimie, des réactifs spécifiques sont conçus<br />
en fonction des populations à mesurer. La thermique ayant<br />
un impact majeur, il est donc primordial d’en contrôler et<br />
réguler la température. Enfin, la microfluidique s'impose<br />
pour le développement des nouveaux dispositifs hématologiques<br />
miniaturisés, beaucoup plus compacts que les<br />
produits existants, et qui nécessitent d'étudier les écoulements<br />
à l'échelle micrométrique.<br />
Exemple de simulation des impacts de défauts<br />
mécaniques dans un système mécanique<br />
problématiques que sont la compacité des systèmes et la<br />
robustesse.<br />
RECOURS À LA SIMULATION NUMÉRIQUE ET MULTI-<br />
PHYSIQUE<br />
Dans le secteur industriel biomédical, les approches expérimentales<br />
sont privilégiées. Cependant ces méthodes restent<br />
limitées, notamment au regard de la complexité des phénomènes<br />
biomécaniques et physico-chimiques qui entrent en<br />
jeu dans les analyseurs sanguins. C’est là que la simulation<br />
numérique intervient. Pour élargir son expertise et relever<br />
ces nouveaux challenges, Horiba Medical a ainsi décidé<br />
de développer depuis plusieurs années l’activité de simulation<br />
numérique au sein de sa R&D. L’entreprise a choisi<br />
de s’orienter vers la solution logicielle Comsol Multiphysics<br />
et ses modules CFD, Heat Transfer, AC/DC et Microfluidics<br />
dans le but de mieux comprendre les phénomènes<br />
physiques dépendant de l'architecture et des géométries<br />
des systèmes, et d’obtenir in fine un design et des performances<br />
optimaux.<br />
Mais pour déployer des applications métiers au sein de leur<br />
organisation, Horiba Medical utilise également Comsol<br />
Compiler. Ces applications sont développées à l'aide de<br />
l'Application Builder de Comsol Multiphysics, laquelle<br />
donne la possibilité de créer des interfaces dédiées facilement<br />
utilisables par des non experts impliqués dans le développement<br />
de nouveaux produits. L’objectif est le suivant<br />
: rendre les ingénieurs et les intégrateurs plus autonomes<br />
dans l'utilisation de la simulation afin de développer les<br />
nouveaux prototypes. Ces applications dédiées sont directement<br />
accessibles sur leurs postes et il leur est ainsi possible<br />
de modifier les paramètres des modèles jusqu'à obtenir<br />
les résultats visés. Ceci n'élimine pas la mise au point de<br />
prototypes et les tests associés, mais réduit le nombre d'essais<br />
et permet d'optimiser les designs. « Aujourd’hui, la<br />
simulation est utilisée chez Horiba Medical, en R&D en<br />
complément de l’expérimentation pour plus d’efficacité dans<br />
la conception des systèmes complexes, explique Damien<br />
Isebe, responsable de projet chez Horiba Medical. C’est<br />
devenu un outil essentiel d’aide à la décision ». ●<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I29
MESURES<br />
PANORAMA<br />
Des solutions sur « mesure »<br />
pour lutter contre la crise sanitaire<br />
Face à la crise économique et sanitaire, de nombreux industriels ont mis les bouchées doubles<br />
pour participer à leur manière à l'effort industriel. Parmi eux figurent des grands groupes<br />
mais aussi des PME, à la fois fabricant ou fournisseurs de technologies mais également des<br />
prestataires de services.<br />
UN BIOCOLLECTEUR D'AIR CORIOLIS Μ (MICRO) POUR<br />
LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS<br />
Les biocollecteurs d'air Coriolis µ, développé et produit par<br />
Bertin Technologies, sont actuellement utilisés par les Centres<br />
de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de Shenzhen<br />
et de Guangzhou, ainsi que par l'Institut des sciences environnementales<br />
de Chine du Sud afin de collecter le coronavirus<br />
SARS-CoV-2, responsable de la pandémie Covid-19, et évaluer<br />
le risque de contamination dans l’air dans les zones critiques. Ils<br />
sont également utilisés en Europe pour collecter le virus dans<br />
des environnements hospitaliers. L'alerte, la détection et l'identification<br />
de la contamination microbiologique de l'air est cruciale<br />
pour lutter contre la propagation d’un virus. De nombreuses<br />
maladies causées par des agents biologiques sont très contagieuses,<br />
et sans détection, les personnes infectées continuent<br />
de propager la maladie, augmentant ainsi sa portée. En outre,<br />
les difficultés de détection des agents biologiques constituent<br />
un problème majeur pour la sécurité intérieure. ●<br />
UN BIOCOLLECTEUR D'AIR CORIOLIS Μ (MICRO)<br />
UNE NOUVELLE CARTE INDICATRICE DE<br />
TEMPÉRATURE POUR LES TESTS DE DÉPISTAGE<br />
COVID 19<br />
Spécialisé dans le contrôle des conditions de transport<br />
des produits et marchandises depuis 1986, Tilt-Import a<br />
annoncé être en mesure de fournir une solution simple<br />
d’utilisation et permettant un contrôle rapide avec sa<br />
nouvelle carte de contrôle de la chaîne du froid. Objectif<br />
? Répondre à l’afflux de demandes des laboratoires pour<br />
contrôler la température lors de l’acheminement des tests de<br />
dépistage Covid-19. Durant la période de crise, Tilt-Import<br />
reste disponible pour livrer en masse ce nouveau produit.<br />
Car bien que les informations soient contradictoires sur<br />
le sujet, il semble que la concentration de virus dans une<br />
gouttelette de prélèvement diminue très rapidement dans le<br />
temps si on reste à température ambiante de 25°C. Ainsi, le<br />
contrôle de la température permettrait de limiter le risque<br />
que le test de dépistage donne de fausses indications («<br />
faux-négatif ») si l’acheminement et le stockage n’est pas<br />
fait dans de bonnes conditions. ●<br />
30 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
MESURES<br />
HTDS MET À DISPOSITION<br />
UN NOUVEAU SYSTÈME DE<br />
VÉRIFICATION À DISTANCE DE LA<br />
TEMPÉRATURE CUTANÉE<br />
Dans le cadre de son département<br />
« Sûreté et Détection », et afin d’aider<br />
les différents organismes (collectivités,<br />
armées, forces de l’ordre, services<br />
de sécurité...) à lutter contre l’épidémie<br />
de Covid-19, HTDS a décidé<br />
d’accélérer la mise à disposition de la<br />
nouvelle caméra thermique XI400,<br />
un système innovant de mesure à<br />
distance de la température cutanée.<br />
Conçu pour la sécurité sanitaire et<br />
adapté à une détection sans contact<br />
d’une potentielle fièvre chez les voyageurs<br />
et les personnes fréquentant les<br />
lieux publics, le système XI400 est basé<br />
sur un fonctionnement discret. La<br />
caméra de taille réduite permet de<br />
distinguer précisément dans la foule<br />
les personnes dont la température de<br />
la peau dépasse une valeur prédéfinie.<br />
Une alarme visuelle donne à l’opérateur<br />
la possibilité d’identifier et d'isoler<br />
immédiatement les personnes<br />
suspectes afin qu’un examen médical<br />
puisse être mené rapidement. Enfin,<br />
en assurant une livraison immédiate<br />
de cette nouvelle caméra thermique,<br />
HTDS souhaite pouvoir faciliter et<br />
développer à grande échelle l’inspection<br />
des personnes pour améliorer la<br />
protection sanitaire. ●<br />
DES RESPIRATEURS ARTIFICIELS<br />
GRÂCE À DES PHYSICIENS<br />
SPÉCIALISTES DE MATIÈRE<br />
NOIRE !<br />
Le Mechanical Ventilator Milano<br />
(MVM), un respirateur artificiel open<br />
source pour un soutien aux patients<br />
gravement atteints par le Covid-19, est<br />
passé de la conception à la réalité en<br />
six semaines sous l’impulsion de physiciens<br />
spécialistes de la matière noire<br />
abandonnant pour un temps leur quête<br />
de particules inconnues . Il vient d’être<br />
reconnu par la Food and Drug Administration<br />
(FDA) des États-Unis comme<br />
relevant du champ d'application de l'autorisation<br />
d'utilisation d'urgence pour<br />
les ventilateurs en thérapie intensive.<br />
Ce résultat a été rendu possible par une<br />
collaboration internationale de scientifiques<br />
et d'entreprises principalement<br />
en Italie, au Canada et aux Etats-Unis.<br />
En France, le laboratoire Astroparticule<br />
et cosmologie (CNRS/Université<br />
de Paris) a été moteur dès le début, aux<br />
côtés du laboratoire Subatech (CNRS/<br />
Université de Nantes/IMT Atlantique)<br />
et de Mines ParisTech. Le laboratoire<br />
Astroparticule et cosmologie avec<br />
Davide Franco, chercheur du CNRS, a<br />
été promoteur de l’initiative en France<br />
et a participé aux tests avec un simulateur<br />
mécanique de respiration pour<br />
le développement et la certification de<br />
MVM. Un véritable élan à la préparation<br />
du déploiement et d’une production<br />
en France a été donné grâce à<br />
MINES ParisTech / Armines et au<br />
laboratoire Subatech qui ont rejoint le<br />
projet. ●<br />
Emitech apporte<br />
son concours à<br />
l’opération 10 000<br />
respirateurs en<br />
cinquante jours<br />
Dans le cadre de la demande à la<br />
fin mars du gouvernement auprès<br />
des industriels français (groupement<br />
piloté par Air Liquide et composé de<br />
PSA, Schneider Electric et Valeo)<br />
pour fournir 10 000 respirateurs en<br />
cinquante jours de début avril à mi-mai,<br />
les laboratoires Emitech ont offert<br />
la campagne d’essais en compatibilité<br />
électromagnétique destinée à vérifier<br />
la conformité des respirateurs dans<br />
ce domaine. « Tout est parti d’une<br />
initiative individuelle de nos salariés<br />
qui nous ont rapidement fait part de<br />
la demande d’essais qui nous était<br />
adressée, explique Stephan Lassausse,<br />
directeur général du groupe Emitech.<br />
La gratuité de l’opération a aussitôt<br />
été validée et l’organisation a été mise<br />
en place pour réaliser au plus tôt<br />
la campagne d’essais demandée et<br />
garantir la fourniture des rapports<br />
de tests sous les meilleurs délais. »<br />
Emitech a répondu et mené les essais<br />
en trois jours ouvrés.<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I31
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
© Teratec 2019<br />
ÉVÉNEMENT<br />
À l’heure de la crise,<br />
le Forum Teratec joue la<br />
carte européenne<br />
À l’heure où la crise<br />
économique succède à la<br />
pandémie, le calcul haute<br />
performance (HPC) entend<br />
jouer un rôle d’avant-garde<br />
tant dans le domaine de la<br />
santé que dans l’industrie<br />
toute entière. Reporté aux<br />
13 et 14 octobre prochains,<br />
le Forum Teratec s’inscrit<br />
plus que jamais comme un<br />
rendez-vous incontournable<br />
des acteurs français,<br />
européens et mondiaux<br />
du HPC.<br />
© © Teratec 2019<br />
Initialement prévu au mois de juin, l’événement<br />
majeur de la simulation numérique,<br />
du HPC, du Big Data et de l’IA a finalement<br />
été reporté à la mi-octobre. Pas question<br />
en effet d’annuler purement et simplement<br />
ce rendez-vous chargé de faire le point sur les<br />
avancées dans le domaine ; « d’autant que le HPC<br />
avance très vite et le reporter d’une année équivaut<br />
à sauter une génération de progrès technologiques,<br />
insiste Daniel Verwaerde, président de Teratec. Il<br />
s’agit également d’un moment privilégié de contacts<br />
entre les acteurs du secteur. Ce qui compte, c’est<br />
que la communauté soit au rendez-vous du redémarrage<br />
économique et qu’elle y tienne une place<br />
essentielle ».<br />
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le<br />
programme est en cours de finalisation – l’axe<br />
du Forum Teratec restant cependant inchangé<br />
par rapport aux éditions précédentes avec une<br />
des sessions plénières, des tables rondes, des<br />
ateliers techniques et applicatifs et une exposition<br />
de matériel, logiciels et services. Et si les<br />
intervenants ont tous répondu présent et donné<br />
leur accord de principe, ils ne peuvent naturellement<br />
pas s’engager définitivement compte tenu<br />
de la situation actuelle. Mais ici, à Bruyères-le-<br />
Châtel (Essonne), tout le monde y croit d’autant<br />
que 2020 s’annonce un cru exceptionnel pour<br />
le Forum Teratec car celui-ci doit concrétiser<br />
les ambitions fortes que Teratec nourrit depuis<br />
plusieurs années. Si cette nouvelle édition repren-<br />
32 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
dra la même formule que les précédentes, des nouveautés feront<br />
leur apparition : d’une part, un « Village » entièrement dédié<br />
aux start-up, visant à mettre en valeur les pépites de la hightech<br />
et, d’autre part, un « Village européen » chargé de mettre<br />
en lumière les initiatives et les projets à la fois des industriels<br />
et issus de la Commission européenne.<br />
UNE DIMENSION RÉSOLUMENT EUROPÉENNE<br />
L’édition de 2020 est censée marquer un grand coup d’accélérateur<br />
en prenant le parti du calcul haute performance en Europe ;<br />
« La dimension européenne du HPC se renforce chaque jour. À<br />
l’occasion du Forum Teratec, des personnalités européennes et<br />
de la Commission ont été invitées, poursuit Daniel Verwaerde.<br />
Il faut dire que depuis dix ans, la dynamique est en marche ».<br />
Autre phénomène, les nouveaux usages du HPC et la volonté<br />
de certains grands industriels de partager sur le Forum Teratec<br />
leur expérience dans le domaine. « Nous sommes en train<br />
de transformer l’Europe et de lui apporter plus de souveraineté »,<br />
se réjouit le président de Teratec.<br />
À ce titre, le Forum Teratec ne manquera pas de mettre en<br />
avant EuroHPC, une « Joint Undertaking » européenne dont la<br />
mission est d’acquérir les plus gros calculateurs et de les mettre<br />
à la disposition des entreprises présentes sur le Vieux Continent.<br />
« L’objectif à terme est de produire autant de HPC que l’on<br />
en consomme », résume Daniel Verwaerde. Autre mission d’EuroHPC,<br />
développer à terme un super-réseau destiné à connecter<br />
l’ensemble des centres de calcul européen pour permettre<br />
aux entreprises d’y accéder dans les meilleures conditions. Une<br />
ambition qui passera par l’acquisition d’un supercalculateur<br />
exaflopique d’ici 2023 en France et en Allemagne.<br />
LE RÔLE ÉVIDENT DU HPC DANS LA CRISE<br />
Dans cette crise à la fois économique et sanitaire, le HPC se<br />
révèle être un acteur présent. Et comme le fait remarquer à<br />
juste titre le président de Teratec, « le calcul haute performance<br />
est né avec la défense et a depuis toujours contribué<br />
au domaine sécuritaire ». Dans ce cas du Covid-19, le HPC<br />
occupe une place de premier choix dans les logiciels de chimie<br />
quantique afin de mesurer les molécules les plus actives parmi<br />
des milliards. « La puissance de calcul et le traitement d’innombrables<br />
données permettront d’améliorer les connaissances et de<br />
dresser de nouvelles barrières protectrices ».<br />
Le HPC comme accélérateur formidable pour trouver la bonne<br />
molécule et agir dans la perspective d’un vaccin ? Daniel<br />
Verwaerde en est convaincu. Mais au-delà du Covid-19, dans<br />
le domaine de la santé, le calcul haute performance peut aider<br />
à développer la médecine personnalisée. Enfin, il peut être en<br />
mesure d’aider considérablement la recherche à l’exemple de ce<br />
qui se fait déjà dans la cosmétique, à commencer par L’Oréal ;<br />
l’industriel français fait en effet appel depuis une dizaine d’années<br />
à la simulation numérique et à la modélisation dans le but<br />
de réduire la quasi-totalité de ses tests sur les animaux. Ainsi,<br />
les équipes de R&D modélisent la peau et les cheveux pour<br />
déterminer l’impact des produits sur les différentes parties du<br />
corps humain. « Nous pouvons tout à fait envisager la même<br />
chose dans la médecine ; à ce titre, le HPC est capable de durcir<br />
encore davantage les sciences comme la médecine, la biologie et<br />
la santé en faisant entrer la modélisation et la simulation mais<br />
aussi le traitement et l’analyse de données ». ●<br />
Olivier Guillon<br />
« Verbatim »<br />
Le HPC/HPDA, un outil<br />
fondamental pour redémarrer<br />
l’économie !<br />
« Le HPC est un outil<br />
de compétitivité des<br />
entreprises depuis<br />
près de vingt ans, en<br />
particulier dans le<br />
domaine manufacturier,<br />
alors que le HPDA 1 s’est<br />
Daniel Verwaerde<br />
Président de Teratec<br />
plus brutalement imposé comme outil indispensable à<br />
toute l’économie ces dernières années. Une des leçons<br />
importantes que l’on tire déjà de cette crise sanitaire sans<br />
précédent, c’est la nécessité de relocaliser en Occident – et<br />
en particulier en Europe – la production d’un très grand<br />
nombre de produits manufacturés. Ce déficit est matérialisé<br />
en un chiffre : la part de la production manufacturière dans le<br />
PIB de la France avoisine les 10% en 2019 ! La relocalisation<br />
des chaînes de production en France ne sera viable que<br />
si nos industriels savent apporter une solution aux deux<br />
raisons qui ont conduit aux délocalisations massives des<br />
vingt dernières années, à savoir : un coût compétitif et une<br />
production respectueuse de l’environnement.<br />
Le HPC est l’outil fondamental pour définir des produits qui<br />
satisferont à ces deux conditions : il permet de diminuer les<br />
coûts de revient grâce aux capacités d’optimisation qu’il procure<br />
pour la conception des produits et apporte les moyens de<br />
tester « virtuellement » des solutions nouvelles (matériaux,<br />
produits chimiques, process de fabrication) permettant<br />
de répondre au haut niveau d’exigence environnemental<br />
européen. »<br />
1 (High-Performance Computing / High-Performance<br />
Data Analytics)<br />
© © Teratec 2019<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I33
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
POINT DE VUE<br />
Le rôle croissant de la simulation<br />
numérique dans le HPC<br />
La simulation numérique a toujours été intimement liée au HPC – le High Performance Computing<br />
depuis ses débuts dans les années 1970-1980. La puissance de calcul est un atout indispensable<br />
pourlancer et faire des simulations numériques, comme en témoignent Florence Barré, Corporate<br />
& Financial Communication Manager d’ESI Group, et Francisco Chinesta, directeur du Département<br />
scientifique d’ESI Group.<br />
Dès la création de l’entreprise en 1973, ESI et ses<br />
fondateurs ont tout de suite compris le lien fort<br />
qui existait entre la simulation et la HPC mais<br />
surtout que le HPC offrait un potentiel de création<br />
de valeur « infini » pour la simulation. Dès ses débuts,<br />
ESI s’est associé à plusieurs grands noms du HPC pour son<br />
développement : Cray et IBM. On peut notamment citer deux<br />
faits marquants. D’une part, le premier crash virtuel de l’histoire<br />
réalisé en 1985 pour un consortium d’industriels automobiles<br />
dont Volkswagen, a été effectuée sur supercalculateur<br />
vectoriel Cray. D’autre part, c’est avec IBM et des études pour<br />
des grands noms de l’industrie automobile nippone que le<br />
groupe ESI s’est développé au pays du Soleil Levant au début<br />
des années 1990.<br />
Le développement de l’entreprise n’a eu de cesse d’accompagner<br />
celui des grands acteurs du High Performance<br />
Computing. L’augmentation des puissances de calcul<br />
permet de proposer des solutions de simulation de plus en<br />
plus rapides avec des volumes accrus pour des problématiques<br />
toujours plus complexes pour les acteurs industriels.<br />
Le groupe aide les industriels à trouver des solutions pour<br />
simuler le comportement et la performance de produits<br />
pour lesquels le recours aux tests physiques était impossible<br />
soit à cause d’une trop grande complexité, soit à cause<br />
de l’impossibilité pure et simple du recours au réel (par<br />
exemple : la simulation du crash d’un avion sur une centrale<br />
nucléaire). Encore aujourd’hui, le défi du groupe ESI est<br />
d’accompagner les industriels à pouvoir s’engager sur des<br />
34 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
résultats ; sur la performance de leur produit lorsqu’il est utilisé. C’est<br />
ainsi qu’ESI aide des industriels à s’engager sur un nombre d’atterrissage<br />
supporté par des trains d’atterrissage ou sur le nombre d’heures de vol<br />
d’aéronefs avant le recours aux opérations de maintenance.<br />
D’une simulation durant plusieurs jours à la possibilité de réaliser des<br />
milliers de simulations en une nuit grâce à un couplage de HPC et des<br />
méthodologies de réduction de modèles, la puissance du HPC a accompagné<br />
cet accroissement de valeur proposée aux industriels. Impliqués<br />
depuis leur création avec Teratec ou le Genci par exemple, ESI Group<br />
développe ses solutions tournant dans des architectures massivement<br />
parallèles, multicœurs… pour ainsi en quelques heures effectuer l’équivalent<br />
des dizaines de millions d’heures de calcul !<br />
L’ÉMERGENCE DU BIG-DATA ET DU CALCUL QUANTIQUE<br />
Les acteurs du HPC ont décuplé la puissance de leur super-calculateur.<br />
De nouvelles terminologies ont ainsi émergé : le big data et le calcul<br />
quantique. Ces sujets sont tous les deux adressés par les équipes ESI pour<br />
décupler la valeur, réduire les temps de calcul et optimiser les systèmes et<br />
solution existants. Toutefois, malgré les avancées parfois spectaculaires,<br />
certains défis restent d’actualité ; défis qui sont adressés par les solutions<br />
paramétriques fabriquées par ESI grâce aux techniques de réduction de<br />
modèles PGD. Elles apportent une solution à des problèmes incluant une<br />
multitude de possibilité de choix de paramètres. Par exemple : le comportement<br />
lors d’un crash intégrant nombre scénarios d’intensité de l’impact<br />
ainsi que plusieurs choix de matériaux, épaisseurs des structures…<br />
Prix L’Usine Digitale 2019 remis lors du Forum<br />
Teratec 2019 pour le concept d’Hybrid Twin<br />
d’ESI Group<br />
Quand il s’agit de chercher un optimal dans ce dédale de solutions, on<br />
doit parcourir toutes les combinaisons possibles, nombre qui croit exponentiellement.<br />
C’est le même problème que celui de trouver un parcours<br />
optimal. Le calcul quantique s’appuyant sur les propriétés quantiques de<br />
la superposition d’états permet, d’une certaine façon, l’accès à tous les<br />
choix d’un seul coup, sans avoir besoin de les parcourir un à un. Cela<br />
permet des gains inimaginables. Il ne s’agit pas d’une différence quantitative,<br />
mais qualitative. C’est un nouveau<br />
paradigme, qui nécessite de tout repenser :<br />
hardware, software, algorithmes, logique et<br />
mentalités.<br />
VERS DES DONNÉES PLUS<br />
« INTELLIGENTES »<br />
Les données, traitées par intelligence artificielle,<br />
se marient à merveille avec la<br />
physique, commandée par les mathématiques.<br />
Ce « mariage » permet aux modèles<br />
de devenir plus précis grâce aux données,<br />
et à ces données de devenir plus « intelligentes<br />
» grâce aux modèles. ESI se base donc<br />
davantage sur ce concept de Smart Data<br />
(identifier la bonne donnée, où et quand la<br />
mesurer) plutôt que sur celui du Big Data.<br />
Les deux méthodologies ont été associées<br />
harmonieusement dans le concept d’Hybrid<br />
Twin (le jumeau hybride) créé par ESI<br />
Group et attirent désormais l’intérêt de tous,<br />
chercheurs et industriels.<br />
Afin de permettre une utilisation en temps<br />
réel, le HPC est incontournable. Il permet<br />
l’utilisation de techniques d’apprentissage<br />
machine (Machine Learning) nécessaires<br />
au stockage et à la manipulation de grandes<br />
quantités des données en temps-réel. Mais<br />
ici aussi, les limites se font sentir. L’ordinateur<br />
quantique bouleversera les pratiques,<br />
et l’optimisation, au cœur des techniques<br />
d’apprentissage, y sera clef.<br />
Florence Barré et<br />
Francisco Chinesta (ESI Group)<br />
Francisco Chinesta, Directeur du Département<br />
scientifique d’ESI Group, Médaille d’argent du CNRS 2019<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I35
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
SOLUTION<br />
Accélérer la révolution<br />
du HPC dans le Cloud<br />
Désormais, les ingénieurs souhaitent accéder<br />
au calcul haute performance (HPC : high<br />
performance computing) quand et où ils en ont<br />
besoin, sans devoir passer par des processus<br />
complexes d’authentification, d’installation ou<br />
de configuration. Ils attendent des solutions qui<br />
bousculent le statu quo prévalant et permettant<br />
d’accélérer la conception et le développement<br />
de produits de nouvelle génération, notamment<br />
grâce au déploiement du HPC dans le Cloud.<br />
Qu’il s’agisse des budgets, de l’approvisionnement<br />
ou de la maintenance, la tendance en<br />
matière de HPC a fortement évolué durant<br />
les dernières années. Les ingénieurs en simulation<br />
se tournent de plus en plus vers le Cloud pour<br />
réaliser des modélisations très complexes et, ainsi, accélérer<br />
le développement de leurs produits. En 2011, seules<br />
13% des entreprises recouraient à des installations dans<br />
le Cloud pour leurs besoins en HPC, tandis qu’elles<br />
étaient 68% en 2018 1 . Une croissance exponentielle qui<br />
devrait se confirmer sur le long terme. Ainsi, en 2022 on<br />
estime que 28% des dépenses des entreprises technologiques<br />
seront consacrées au Cloud, soit dix-neuf points<br />
de plus qu’en 2018 2 . Le HPC, dont l’usage est largement<br />
stimulé par l’essor du logiciel en tant que service (Saas :<br />
Software-as-a-service) au sein des entreprises, pourrait<br />
ainsi représenter 75% du volume total des calculs effectués<br />
dans le Cloud en 2021 3 .<br />
1. HPCWire, Hyperion: Deep Learning, AI Helping Drive Healthy HPC<br />
Industry Growth. hpcwire.com/2017/06/20/hyperion-deep-learning-aihelping-drive-healthy-hpc-industry-growth<br />
2. Gartner, Gartner Says 28 Percent of Spending in Key IT Segments<br />
Will Shift to the Cloud by 2022. gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-18-gartner-says-28-percent-of-spending-in-key-ITsegments-will-shift-to-the-Cloud-by-2022<br />
3 Cisco Systems, Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology,<br />
2016–2021 White Paper. cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/<br />
service-provider/global-Cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.html<br />
Navin Budhiraja<br />
Vice-président et directeur Cloud et<br />
Plateforme chez Ansys<br />
Mais comment expliquer cette tendance ? Généralement,<br />
les entreprises technologiques réalisent une mise<br />
à niveau de leurs capital informatique tous les deux à<br />
trois ans. Elles enrichissent par exemple leurs solutions<br />
HPC pour gagner en puissance de calcul, adoptent de<br />
nouveaux modèles de puces et les technologies les plus<br />
récentes. Bien que la plupart des entreprises disposent<br />
du budget nécessaire, elles cherchent à améliorer leur<br />
efficacité opérationnelle tout en limitant les investissements<br />
lourds. Ainsi, plutôt que d’acheter ou de mettre à<br />
niveau leurs propres serveurs, ces dernières se tournent<br />
massivement vers le Cloud afin de pallier les limites de<br />
leurs ressources informatiques, booster l’innovation et<br />
réduire les délais de mise sur le marché des produits. Le<br />
Cloud leur offre davantage de souplesse, elles ne payent<br />
que ce qu’elles utilisent, capitalisent sur les dépenses<br />
de fonctionnement et optimisent ainsi leur trésorerie.<br />
Ansys, spécialiste mondial de la simulation numérique,<br />
propose donc plusieurs solutions de déploiement dans<br />
le Cloud afin de répondre aux besoins des industriels<br />
en matière de HPC. En 2019, l’entreprise a lancé Ansys<br />
Cloud qui offre un accès instantané au calcul intensif<br />
36 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
les modélisations en réduisant le maillage ou en simplifiant<br />
les modèles physiques, de manière à pouvoir finir<br />
les simulations dans des délais raisonnables (12 heures<br />
en moyenne). La simulation dans le Cloud permet de<br />
pallier ces contraintes de temps et de ressources. Les<br />
ingénieurs peuvent en effet créer et analyser des modèles<br />
plus grands et complexes, et disposent ainsi d’une meilleure<br />
compréhension des performances de leurs produits.<br />
L’optimisation paramétrique (optimisation des dimensions<br />
d’une structure mécanique) leur permet également<br />
d’évaluer automatiquement de nombreux designs pour<br />
déterminer la conception optimale. L’essor du Cloud<br />
offre donc de nouvelles perspectives aux ingénieurs en<br />
matière de productivité. Ils obtiennent les résultats des<br />
simulations bien plus rapidement et peuvent corriger<br />
les problèmes susceptibles d’entraver le développement<br />
du produit, dès la phase de conception.<br />
dans le Cloud depuis les logiciels Ansys Mechanical,<br />
Ansys Fluent et Ansys Electrics Desktop.<br />
Par ailleurs, pour les petites et moyennes entreprises,<br />
le déploiement d’une plateforme HPC de pointe peut<br />
s’avérer complexe car, bien souvent, elles ne disposent<br />
pas en interne de l’expertise nécessaire à la configuration<br />
et à la gestion de l’outil. De plus, si leurs besoins en<br />
simulation sont limités ou variables, la démarche peut<br />
s’avérer trop onéreuse.<br />
Quant aux grandes sociétés d’ingénierie qui possèdent<br />
leurs propres outils HPC intégrés, elles peuvent faire<br />
face à une demande accrue, à laquelle les ressources<br />
existantes ne peuvent pas toujours répondre. Dans un<br />
cas comme dans l’autre, le HPC dans le Cloud permet<br />
aux entreprises d’augmenter leurs capacités de calcul en<br />
fonction de leurs besoins et de payer uniquement ce qui<br />
est utile et nécessaire.<br />
Visualisation des résultats dans l'interface Web<br />
Ainsi, les ingénieurs peuvent accéder à la demande à<br />
une puissance de calcul illimitée, dont seules les grandes<br />
entreprises disposent actuellement, et ce, depuis l’interface<br />
du logiciel. L’outil est optimisé pour les solveurs<br />
Ansys et propose aux ingénieurs des dispositifs HPC<br />
préconfigurés afin d’obtenir des résultats plus rapidement.<br />
Ces derniers peuvent également s’appuyer sur<br />
l’accompagnement et l’assistance de l’équipe Ansys<br />
Customer Excellence dans le déploiement de la solution.<br />
LES AVANTAGES DU CLOUD POUR LA SIMULATION<br />
Selon une étude interne d’Ansys, 90% des entreprises qui<br />
utilisent la simulation doivent faire des concessions sur<br />
LE DÉPLOIEMENT DANS LE CLOUD TRADITIONNEL<br />
Bien que le HPC dans le Cloud présente de nombreux<br />
avantages, son déploiement peut aussi impliquer des<br />
obstacles, particulièrement si l’entreprise gère déjà son<br />
propre environnement Cloud. Elle doit alors choisir un<br />
fournisseur de Cloud tiers, créer un compte, installer<br />
un logiciel compatible avec le service, puis démarrer le<br />
serveur de licence dans le Cloud, etc.<br />
Autre responsabilité importante pour l’entreprise : le<br />
choix des meilleures options matérielles pour exécuter<br />
les simulations. En effet, les fournisseurs de Cloud<br />
proposent pléthore de solutions ce qui implique pour<br />
les ingénieurs de posséder une certaine expertise du<br />
calcul intensif. Les ingénieurs doivent sélectionner les<br />
machines virtuelles appropriées, évaluer le nombre<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I37
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Visualisation des résultats d’un calcul CFD dans la plateforme web<br />
de cœurs et la mémoire vive nécessaire pour chaque<br />
machine, le stockage ou encore la méthode de communication<br />
interprocessus. En définitive, un environnement<br />
Cloud mal configuré peut faire perdre beaucoup<br />
de temps et d’argent.<br />
AU CŒUR D’ANSYS CLOUD<br />
Ansys Cloud a été conçu par l’éditeur afin de répondre à<br />
l’utilisation croissante du Cloud par ses clients. Selon des<br />
estimations internes, l’utilisation des logiciels de simulation<br />
Ansys au sein des réseaux Cloud tiers a augmenté<br />
de 90% durant la première moitié de l’année 2018. Avec<br />
Ansys Cloud, les utilisateurs peuvent accéder instantanément<br />
à des ressources de calcul intensif sur le Cloud<br />
depuis l’interface utilisateur d’Ansys Mechanical, Ansys<br />
Fluent et Ansys Electronics Desktop, et ce, directement<br />
depuis leur ordinateur. De cette manière, l’utilisateur<br />
n’a pas besoin de configurer un réseau Cloud, d’installer<br />
de nouvelles licences ni même de recourir à un fournisseur<br />
de Cloud tiers ; l’exploitation et la maintenance<br />
sont entièrement gérées au sein d’une solution globale.<br />
Proposé sous un modèle de licence facturé à l’utilisation,<br />
Ansys Cloud permet aux entreprises d’adapter et<br />
de mobiliser rapidement leurs ressources en fonction<br />
des besoins et des nouveaux projets. L’outil offre des<br />
ressources de calcul dans le Cloud quasi illimitées, ce qui<br />
permet aux ingénieurs d'effectuer plus rapidement des<br />
simulations haute-fidélité, plus complexes et précises. Les<br />
cycles de développement peuvent ainsi être raccourcis<br />
de plusieurs mois, accélérant ainsi la mise sur le marché<br />
de produits de pointe.<br />
« Les équipements à haut rendement sont essentiels pour<br />
améliorer les performances des usines dans l'industrie<br />
pétrolière et gazière, explique Luis Baikauskas, ingénieur<br />
de procédé chez Hytech Ingenieria. Ansys Cloud permet<br />
à Hytech Ingenieria de calculer des géométries importantes<br />
et complètes en quelques heures, au lieu de plusieurs jours<br />
ou semaines. Un gain de temps considérable qui permet<br />
également aux ingénieurs d’évaluer davantage de variations<br />
de conception et de trouver la plus optimale. ».<br />
Ansys Cloud intègre la technologie éprouvée de Microsoft,<br />
Azure – permettant aux utilisateurs d’effectuer des<br />
simulations dans le Cloud avec une sécurité maximale.<br />
La solution intègre plusieurs couches de défense, dont<br />
des protocoles stricts interdisant les accès non autorisés<br />
et des méthodes de chiffrement de pointe afin de protéger<br />
les données des utilisateurs.●<br />
38 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
REPORTAGE<br />
La GMAO, outil stratégique de la maintenance<br />
d'ArianeGroup<br />
Le site de production de moteurs de fusée d'ArianeGroup est une institution à Vernon (Eure), employant<br />
un millier de personnes (sur les 9 000 collaborateurs du groupe). Porté par la concurrence acharnée<br />
dans le spatial due en partie à l'arrivée de nouveaux acteurs, la co-entreprise d'Airbus et de Safran<br />
n'a d'autres choix que d'améliorer en permanence la production de ses appareils, à commencer par<br />
la mise en service d'Ariane VI et de son moteur Prometheus. Mais au niveau de la maintenance aussi,<br />
les pistes d'amélioration et d'optimisation se révèlent stratégiques... ce qui ne fait que confirmer<br />
l'utilisation fine d’un outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO).<br />
Pierre-<br />
Guillaume<br />
Ritter<br />
Actuellement responsable de<br />
Méthodes support maintenance<br />
chez ArianeGroup, Pierre-<br />
Guillaume Ritter a démarré sa<br />
carrière en tant que technicien<br />
de maintenance dans l'industrie<br />
pétrolière avant d'intégrer<br />
le géant suédois Ikea à la<br />
maintenance puis de reprendre<br />
des études d'ingénieur. Son<br />
diplôme en poche en 2013, il<br />
entre chez ArianeGroup (ex<br />
Snecma) en septembre 2014. Le<br />
29 janvier dernier, sur le Sepem<br />
de Rouen, Pierre-Guillaume<br />
Ritter est venu détailler<br />
l'utilisation de l'outil GMAO au<br />
sein de l'entreprise.<br />
Le lieu est bucolique, paisible et verdoyant, y compris<br />
en ce mois de janvier. Mais l'épaisse forêt de Vernon<br />
(dans l'Eure) n'abrite pas qu'une nature généreuse.<br />
Pas moins de 130 hectares dont près de 50 000 m²<br />
de locaux tertiaires, d’ateliers et une quinzaine de bureaux,<br />
d'usines et de laboratoires, et 116 hectares entièrement<br />
dédiés aux essais physiques des moteurs de fusées ! Oui,<br />
car bien loin de la zone de lancement de la fusée Ariane à<br />
Kourou, en Guyane, le site de Vernon s'impose comme le<br />
lieu de la conception, la production et les tests des moteurs<br />
équipant Ariane V puis, à compter de cette année, Ariane<br />
VI. Plus précisément, la première zone, appelée CAT (centre<br />
administratif et technique), réunit sur 15 ha le bureau de<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I39
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
aux nombreux équipements de production et de mesure<br />
– une centaines de machines (centres d'usinage, tours,<br />
machines d'assemblage et deux d'impression 3D métal),<br />
robots industriels, moyens de contrôle non destructif<br />
(CND), de traitement de surface et de métrologie (endoscopie<br />
par exemple), la maintenance est principalement assurée<br />
par des prestataires de service, imposant un suivi des<br />
fournisseurs et des prestataires, des contrats de maintenance<br />
et des interventions. En revanche, en ce qui concerne les<br />
activités liées aux essais moteurs, toute la maintenance est<br />
« internalisée ». Les personnels dits « œuvrant » sont des<br />
salariés ArianeGroup. Les nombreux essais impliquent des<br />
campagnes en conditions extrêmes et nécessitent des moyens<br />
peu communs, à l'image des bancs dédiés au système de<br />
propulsion hydrogène méthane, aux chambres de combustion<br />
et autres turbopompes, clapets et systèmes intégrés,<br />
aux prototypes et aux moyens fluidiques. La zone d’essais<br />
est d'ailleurs classée Seveso seuil haut ; une classification qui<br />
n'est pas étrangère au choix d'une solution GMAO.<br />
LA GMAO COMME CLEF DE VOÛTE DE LA<br />
MAINTENANCE<br />
conception et définition des moteurs, un hall consacré<br />
aux procédés spéciaux, la partie production et usinage, le<br />
laboratoire de chimie matériaux et procédés, le montage<br />
des moteurs HM7 et de la ligne Vulcain, et enfin le projet<br />
Prometheus, le fameux « moteur du futur » qui équipera les<br />
nouvelles fusées. « Ce moteur sera environ dix fois moins cher<br />
à produire et atteindra 10 tonnes de poussée ; il sera en partie<br />
fabriqué en impression 3D et intégrera de l'intelligence embarquée<br />
», résume Félicien Banzokou, chargé du pôle Visites<br />
du site. Dans la partie dédiée aux essais en environnement,<br />
l'imposant site abrite de grands réservoirs d'ergols cryotechniques<br />
permettant de mener des tests grandeur nature<br />
et en températures plus élevées que le magma !<br />
Au total, une quarantaine de personnes effectuent des<br />
interventions de maintenance et près de 300 personnes<br />
sont impliquées dans le métier ; « sur le site, les activités de<br />
maintenance se répartissent autour des moyens industriels<br />
de production et de montage, des infrastructures et de facility<br />
management, et enfin des moyens d'essais », explique<br />
Pierre-Guillaume Ritter, responsable de Méthodes support<br />
maintenance, qui opère sur différents sites du groupe. Face<br />
« Très tôt, au cours de mon expérience professionnelle, j'ai<br />
compris que la GMAO joue pleinement un rôle stratégique<br />
pour la maintenance », révèle Pierre-Guillaume Ritter.<br />
Difficile de prêcher un convaincu, d'autant que le responsable<br />
Méthodes support maintenance utilise de nombreux<br />
modules ; « il faut reconnaître que depuis toutes ces années,<br />
nous avons acquis une solide expérience en la matière, allant<br />
jusqu'à développer des fonctionnalités nous-mêmes, sans avoir<br />
à solliciter les équipes de l’éditeur Carl Software. Certes, ces<br />
développements nécessitent des spécialistes en informatique<br />
mais ces évolutions ont été possibles grâce au système à la fois<br />
ouvert et évolutif de Carl Source ». Si près de 300 personnes<br />
utilisent quotidiennement ou régulièrement la GMAO, l'outil<br />
est ouvert au millier de collaborateurs du site ; « cela va<br />
du ''simple'' lecteur aux 200 intervenants en maintenance<br />
en passant par la vingtaine de chargés d'affaires qui réceptionnent<br />
et aiguillent les interventions ».<br />
Parmi les fonctionnalités utilisées figurent le module Équipements<br />
(utilisé à 90% des fonctionnalités comme l'arborescence,<br />
les matériels, les points de structure, les modèles, les<br />
fiches sécurité), le module Travaux pour les demandes d’interventions<br />
et les interventions elles-mêmes, les comptes<br />
rendus, les gammes ou encore les fiches de maintenance et<br />
les plans préventifs. Autres modules également très utilisés,<br />
les Stocks (pour la gestion d'articles, les inventaires,<br />
les entrées et sorties, les réservations et les réapprovisionnements),<br />
les modules Analyse et Système (paramétrage,<br />
droits, KPI, formulaires personnalisés, rapports, interfaces,<br />
40 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Utilisateur de la GMAO Carl Source V3 depuis 2013 (Carl<br />
Master avant cela), ArianeGroup évolue aujourd’hui avec<br />
Carl Source V5. « L'outil offre une analyse des données très<br />
poussée », notamment grâce à l’écran d’accueil doté d'indicateurs<br />
issus des recherches multicritères et d'indicateurs reposant<br />
sur des requêtes SQL. Des seuils peuvent être mis en<br />
place avec le lancement automatique d'emails. Des rapports<br />
sont directement créés dans l’application grâce à la fonction<br />
« assistant de création de rapport ».<br />
D’AUTRES ÉVOLUTIONS À VENIR<br />
logs, traces). Sont aussi utilisés, mais dans une moindre<br />
mesure, les modules Achat (par les fournisseurs et certaines<br />
demandes d’achats), Ressources et Comptes.<br />
À Vernon, la sécurité et plus particulièrement les mesures<br />
de la maîtrise des risques (MMR) sont au cœur des priorités<br />
de l'entreprise. En cela, l'option « Carl Control’S » s'avère<br />
particulièrement adaptée. Elle permet de gérer automatiquement<br />
le suivi des rapports de contrôle dans la GMAO,<br />
de leur intégration, au déclenchement des interventions<br />
pour lever les réserves, à la mise à jour des rapports dans<br />
les plateformes des différents organismes de contrôle. Carl<br />
Control’S devrait être installée en fin d'année ; cette action<br />
est aujourd’hui réalisée manuellement par les pilotes maintenance.<br />
Autre projet d'envergure, la fusion d'ici le premier<br />
semestre 2021 des trois GMAO des activités FM / MI /<br />
<strong>Essais</strong> au sein de Carl Source ; « pour ce faire, l’application<br />
''Carl Loader'' devrait nous permettre de réaliser cette<br />
fusion en interne ».<br />
Olivier Guillon<br />
Un carrefour d’échanges incontournable pour les experts,<br />
les ingénieurs et les techniciens de l’environnement<br />
Rejoignez-nous<br />
pour enrichir vos connaissances et participer activement à la promotion, à la<br />
diffusion et à la mise en œuvre au sein de l’industrie française des dernières<br />
techniques d’essais et de simulation de l’environnement.<br />
Nos adhérents bénéficient de réductions substantielles sur les tarifs<br />
de nos stages de formation, journées techniques, colloques, salons,<br />
ouvrages et guides techniques.<br />
Depuis 1967, nous avons formé plus de 6 000 scientifiques, ingénieurs<br />
et techniciens. Nos formations sont dispensées par les meilleurs experts<br />
du moment, sélectionnés au sein des sociétés et laboratoires français<br />
de pointe.<br />
Qui est concerné par notre activité ?<br />
• Les laboratoires d’essais, les équipementiers,<br />
les concepteurs et intégrateurs de systèmes<br />
• Les scientifiques, ingénieurs et techniciens<br />
en charge de la conception, des essais,<br />
de la fabrication et de la qualité<br />
• Les concepteurs, constructeurs et vendeurs<br />
des moyens d’essais<br />
• Les étudiants et les enseignants<br />
Association pour le développement des Sciences et Techniques de l’Environnement - Association régie par la loi 1901<br />
1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - www.aste.asso.fr - Tel : 01 61 38 96 32<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I41
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
REPORTAGE<br />
Comment le plus<br />
grand site de R&D<br />
d’EDF organise sa<br />
maintenance<br />
Salle climatique<br />
Rester à la pointe de la recherche en maintenant les compétences et les moyens d’essais, tel<br />
est l’objectif du Laboratoire des matériels électriques (LME), implanté sur le site EDF Lab les<br />
Renardières, au sud-est de la région parisienne. Mais pour cela, il est indispensable d’assurer<br />
une surveillance de tous les instants de l’ensemble des équipements et d’organiser au mieux<br />
les interventions de maintenance.<br />
Sur les trois centres de R&D d’EDF – appelés EDF Lab<br />
– que sont Paris-Saclay, Chatou et les Renardières, ce<br />
dernier, bien qu’ancien, demeure le plus vaste. Celui-ci<br />
s’étend sur près de 80 hectares et abrite plus de 700<br />
postes de travail, quarante laboratoires répartis à travers<br />
soixante-dix bâtiments, trois départements de recherche, un<br />
Fab Lab ainsi qu’un institut international. Au sein de ce site<br />
implanté en Seine-et-Marne, le département Laboratoire des<br />
matériels électriques (LME) dispose d’une équipe en charge de<br />
la maintenance de ses moyens d’essais.<br />
Composé de 155 salariés (chercheurs et cadres mais aussi des<br />
techniciens d’essais et de maintenance), une dizaine de doctorants<br />
et de nombreux et importants moyens d’essais, ce département<br />
s’appuie sur une connaissance approfondie des matériels<br />
et technologies, dans le domaine des matériels électriques :<br />
appareillages et transformateurs, câbles et accessoires, auto-<br />
Laboratoire Batteries<br />
Franck Aragnou,<br />
Chef de département délégué au sein<br />
du LME<br />
Michael Drault,<br />
Pilote de la maintenance du<br />
Département LME à la R&D d’EDF<br />
matismes et protection, composants électroniques, batteries,<br />
électronique de puissance et systèmes de stockage d’énergie 1 .<br />
UN CHALLENGE PERMANENT CONCERNANT LES PLAN-<br />
NINGS DE MAINTENANCE<br />
Le Département LME repose également sur de solides compétences<br />
à la fois disciplinaires (électrotechnique, électromagnétisme,<br />
électronique, diélectrique, nouveaux matériaux et<br />
électrochimie, compatibilité électromagnétique), expérimentales<br />
(essais électriques et mécano-climatiques) ou encore en modélisation<br />
: foudre, phénomènes thermiques dans les câbles… le<br />
tout au service de la performance des métiers du groupe mais<br />
également des industriels et des entreprises privées, deux types<br />
1. Retrouvez le reportage sur site paru dans le numéro 139 d’<strong>Essais</strong> &<br />
<strong>Simulations</strong> à l’automne 2019<br />
42 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Concept Grid<br />
de clients dont les demandes ne font que croître depuis plusieurs<br />
années. En effet, depuis 2013, le groupe a choisi d’ouvrir ses<br />
laboratoires aux clients externes et a massivement investi dans<br />
l’amélioration et la rénovation des moyens d’essais.<br />
D’où un challenge à relever concernant les plannings de maintenance<br />
: répondre à une sollicitation importante des moyens<br />
d’essais et de mesures spécifiques « et, pour beaucoup, uniques<br />
en Europe tant en matière de taille que de niveau de puissance<br />
ou de grandeurs électriques atteintes, souligne Franck Aragnou,<br />
chef de département délégué au sein du LME. Au total, le laboratoire<br />
abrite près de 3 200 appareils de mesure. Ces instruments<br />
et les différents équipements sont surveillés et maintenus en<br />
permanence grâce à une équipe d’une vingtaine de personnes<br />
intervenant quotidiennement pour le bon fonctionnement<br />
des moyens d’essais ». Plus précisément, le service est réparti<br />
en trois entités : « Informatique industrielle », « Métrologie »<br />
et « Maintenance ».<br />
OBJECTIF : DES INSTALLATIONS D’ESSAIS<br />
OPÉRATIONNELLES À 100 %<br />
Dans le domaine de la maintenance, les problématiques<br />
auxquelles est confronté le laboratoire sont multiples et Michael<br />
Drault, pilote de la maintenance du Département LME à la<br />
R&D d’EDF, est bien placé pour en parler : « Parmi les problématiques<br />
auxquelles nous faisons face figurent la formation et<br />
le maintien des compétences dans la mesure où ces installations<br />
sont pour la plupart uniques en leur genre. Nos techniciens de<br />
maintenance doivent être polyvalents de façon à pouvoir travailler<br />
dans de nombreux domaines comme l’électricité haute et basse<br />
tension, l’hydraulique, l’air comprimé ou encore la mécanique.<br />
Et lorsque l’on recrute une personne, nous mettons près de trois<br />
ans à la former en compagnonnage afin qu’elle soit capable d’intervenir<br />
seule sur n’importe quel équipement. »<br />
Mais la gestion des compétences n’est pas le seul défi du responsable<br />
maintenance. L’approvisionnement en pièces détachées<br />
représente un enjeu crucial et un casse-tête pour le service, du<br />
fait notamment de l’obsolescence de nombreux composants –<br />
souvent très spécifiques – et dont les fabricants ont stoppé la<br />
production ou ont purement et simplement disparu. « C’est le<br />
cas par exemple des disjoncteurs à air comprimé montés sur des<br />
stations à haute puissance ; il est quasiment impossible de trouver<br />
des appareils aussi rapides or nous ne pouvons pas les remplacer.<br />
C’est pourquoi nous avons monté une formation mixte avec<br />
Alstom-GE. Celle-ci était composée de jeunes et d’anciens techniciens<br />
chargés de démonter l’appareil et d’identifier de A à Z<br />
leur montage et leurs composants, puis de fabriquer ou de faire<br />
produire des pièces manquantes. Dans le même temps, cela nous<br />
a permis de former les jeunes et de transférer les compétences.<br />
Les emplois proposés ont une dimension technique élevée (forte)<br />
et autorisent des évolutions de carrières. »<br />
Autre problématique évidente, les temps d’intervention. Car<br />
qu’il s’agisse de répondre aux besoins internes de recherche<br />
et développement pour le groupe EDF ou de prestations d’essais<br />
pour ses clients, les délais sont toujours plus serrés. « Nos<br />
équipements doivent tourner tout le temps, c’est pourquoi nous<br />
les surveillons en permanence, précise Michael Drault. D’ailleurs,<br />
lorsque j’ai intégré le service en 2013, mon prédécesseur<br />
m’avait bien prévenu : le groupe de maintenance, c’est comme le<br />
tambour d’une machine à laver ! La cadence est soutenue et ça<br />
ne s’arrête jamais… ».<br />
UNE SURVEILLANCE DE TOUS LES INSTANTS<br />
Pour répondre à ces évolutions, le service Maintenance a mis<br />
en œuvre des solutions de monitoring afin de mieux surveiller<br />
les moyens de tests. De nombreux capteurs ont ainsi été installés<br />
sur des machines neuves ou anciennes (mais entièrement<br />
rénovées à l’occasion d’opérations de rétrofit). « Pour certaines<br />
d’entre elles, nous avons aussi la possibilité de nous connecter<br />
à distance et d’intervenir à partir d’un système de supervision.<br />
Nous avons également instrumenté de nombreuses alarmes que<br />
l’on a ajoutées sur nos installations ». Une manière de mieux<br />
anticiper les pannes éventuelles et de sécuriser l’ensemble du<br />
processus d’essai. De même, ces moyens de surveillance, associés<br />
à un logiciel de gestion de la maintenance par ordinateur<br />
(GMAO), ont permis de mieux planifier et organiser les arrêts<br />
périodiques de maintenance. Il faut dire que la période estivale<br />
approche… et qu’une partie des moyens d’essai devra entamer<br />
un arrêt de deux à trois semaines. ●<br />
Hall 420 kV<br />
Olivier Guillon<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I43
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
ENTRETIEN<br />
La maintenance au cœur de la stratégie<br />
des moyens d’essai<br />
Spécialiste de la production, de la vente et de la maintenance d’enceintes climatiques, Systèmes<br />
Climatiques Service (SCS) occupe tous les fronts de cette catégorie d’équipements. L’occasion<br />
pour la rédaction d’<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> d’interroger Stéphane Haubourdin, directeur du<br />
département Maintenance & Innovation afin de mieux comprendre les problématiques de<br />
maintenance dans les laboratoires d’essai.<br />
Stéphane Haubourdin,<br />
Spécialiste du climatique depuis 1995, Stéphane<br />
Haubourdin dirige aujourd’hui le service Maintenance<br />
& Innovation chez Systèmes Climatiques Service<br />
(SCS), une société de 70 personnes implantée à<br />
Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise) et composée de<br />
trois entités : un laboratoire qui met à disposition<br />
de ses clients des enceintes climatiques, un service<br />
dédié à la maintenance, la location et la vente de<br />
machines d’occasion et, depuis 2012, un atelier de<br />
production de machines spécifiques et standard.<br />
Atelier SCS<br />
QUI SONT VOS CLIENTS ET À QUELS SECTEURS D’AC-<br />
TIVITÉ APPARTIENNENT-T-IL ?<br />
Nos clients principalement dans l’aéronautique, l’automobile<br />
(dans tous les domaines, des pneus aux essuie-glaces),<br />
l’armement, la pharmacie ou encore l’industrie plastique.<br />
En somme, il s’agit de tout ce qui exige plus de qualité pour<br />
leurs produits.<br />
COMMENT A ÉVOLUÉ LE MARCHÉ DES ENCEINTES<br />
CLIMATIQUES CES DERNIÈRES ANNÉES ?<br />
Ce marché est très cyclique : certains décident d’acheter<br />
une enceinte climatique et d’assurer eux-mêmes la maintenance.<br />
Puis, dix ans plus tard, ces mêmes entreprises optent<br />
finalement pour une utilisation externalisée de la machine,<br />
s’affranchissant dans le même temps des opérations de maintenance.<br />
On assiste également à l’effet inverse : certaines<br />
sociétés ayant jusqu’à présent recours à nos équipements<br />
se décident finalement à investir dans leur propre machine.<br />
À QUELLES PROBLÉMATIQUES DE MAINTENANCE SONT<br />
CONFRONTÉS VOS CLIENTS ?<br />
L’objectif principal est de valider la fiabilité du produit.<br />
Celle-ci est essentielle car elle impacte, outre la qualité intrinsèque<br />
du produit en sortie de chaîne, son coût de production<br />
et l’image même de l’entreprise. Mais les opérations de<br />
maintenance varient beaucoup en fonction de l’usage des<br />
machines d’essai. Pour une même enceinte climatique, le<br />
vieillissement sera très différent si une entreprise n’effectue<br />
que des tests de stabilité, et une autre va au contraire réaliser<br />
des essais de stress et de vibrations.<br />
Notre problématique en tant que maintenancier et fabricant<br />
et de savoir quel profil de teste le client va faire. Et<br />
combien d’heures il va utiliser la machine dans l’année.<br />
C’est aujourd’hui la difficulté que l’on rencontre au niveau<br />
de la GMAO (outils de gestion de maintenance assistée par<br />
ordinateur - NDLR) ; les indicateurs ne sont pertinents<br />
que quand ils sont associés à un programme de mainte-<br />
44 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Atelier de fabrication<br />
nance. Sans une réelle traçabilité, il est difficile<br />
de faire du suivi de fiabilité. À ce titre,<br />
des indicateurs tels que la MTBF (mean<br />
time between failures, c’est-à-dire la durée<br />
moyenne entre pannes - NDLR) nous donne<br />
la possibilité d’enregistrer des temps d’arrêt<br />
et la date de remise en service. Concernant<br />
les taux de fonctionnement, il est nécessaire<br />
d’intégrer un capteur horaire sur l’enceinte<br />
climatique car une machine fait souvent des<br />
pauses au cours de la journée, ce qui n’est pas<br />
sans poser des soucis dans le calcul effectif<br />
de son utilisation réelle. C’est le problème<br />
notamment des parcs anciens de machines,<br />
lesquelles ne sont équipées d’aucun capteur ;<br />
c’est donc à nous de nous adapter. D’ailleurs,<br />
nous sommes capables – ce qui est rare – de<br />
proposer également sur les moyens d’essais<br />
anciens ou vétustes des opérations de rétrofit,<br />
qu’il s’agisse d’équipements frigorifiques,<br />
électriques ou informatiques sur des châssis<br />
souvent encore en bon état.<br />
JUSTEMENT, QUEL RÔLE JOUE LE MONI-<br />
TORING DES ÉQUIPEMENTS ?<br />
Depuis plusieurs années déjà, les logiciels de<br />
pilotage nous permettent d’enregistrer l’ensemble<br />
des sollicitations de la machine avec<br />
de nombreux capteurs chargés de relever la<br />
température, les vibrations et les chocs, de<br />
détecter la présence de fluide ou encore de<br />
gérer la ventilation… Grâce à ce monitoring,<br />
il est désormais possible d’analyser les pannes<br />
et donc d’en connaître les causes réelles. Ces<br />
« Les indicateurs<br />
ne sont pertinents<br />
que quand ils<br />
sont associés à<br />
un programme<br />
de maintenance.<br />
Sans une réelle<br />
traçabilité, il<br />
est difficile de<br />
faire du suivi de<br />
fiabilité. »<br />
informations sont également combinées aux<br />
indicateurs de maintenance permettant de<br />
faire de la maintenance prévisionnelle, même<br />
s’il n’existe pas encore de moyens de détecter<br />
les vibrations sur les moteurs. Or le démarrage<br />
des compresseurs vient souvent perturber<br />
l’interprétation de la mesure des informations<br />
sur l’enceinte elle-même. Nous travaillerons<br />
donc à isoler ces phénomènes de résonances<br />
de vibrations.<br />
L’ENJEU EST DONC DE PASSER DU<br />
PRÉVENTIF AU PRÉDICTIF ?<br />
Tout à fait. C’est la raison pour laquelle nous<br />
avons créé un banc de test spécialement dédié<br />
à cela afin de mieux déterminer les taux<br />
d’usure anormaux. Concrètement, ce banc de<br />
test initié il y a deux ans avec notre partenaire<br />
pour la partie compresseur, se présente sous la<br />
forme d’une grosse machine frigorifique bardé<br />
de capteurs. Ce banc est dédié à la recherche<br />
menée sur les enceintes climatiques et la maintenance<br />
prévisionnelle. Il s’agit d’une enceinte<br />
multi-volumes en cours de finalisation (pour<br />
notamment s’adapter à tous types de compresseurs)<br />
mais opérationnelle depuis six mois.<br />
Propos recueillis<br />
par Olivier Guillon<br />
Enceinte sur pot<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I45
DOSSIER<br />
INAUGURATION<br />
La DGA crée un cluster d’innovation<br />
de défense dans l’aérospatial<br />
La Direction générale de l’armement a inauguré le 5 décembre dernier sur le site Aerocampus<br />
Aquitaine un cluster régional d’innovation technique de défense dédié au domaine aérospatial.<br />
Baptisé Aliénor, ce cluster associe quatre partenaires : la DGA, Aerospace Valley, l’armée de<br />
l’Air et l’armée de Terre.<br />
LE CINQUIÈME CLUSTER<br />
D’INNOVATION TECHNIQUE CRÉÉ<br />
L’AN DERNIER<br />
Résultats obtenus à l’aide d’une application utilisée par les escadrons<br />
de chasse en France et lors d’exercices internationaux (NTM, VOLFA)<br />
Aliénor est co-présidé par le directeur<br />
du centre d’expertise et d’essais DGA<br />
<strong>Essais</strong> de missiles et le président d’Aerospace<br />
Valley, et son comité de pilotage<br />
comprend un représentant de chaque<br />
membre fondateur. Aliénor s’inscrit dans<br />
l’effort global du ministère des Armées<br />
en faveur du soutien à l’innovation,<br />
coordonné par l’agence de l’innovation<br />
de défense en lien étroit avec la DGA.<br />
Le cluster Aliénor a pour objectif<br />
de détecter, orienter et expérimenter<br />
les innovations portées<br />
par les acteurs régionaux afin<br />
de faire émerger de nouvelles solutions<br />
technologiques pour la défense aérospatiale,<br />
en lien avec l’agence de l’innovation<br />
de défense. Implantée près de<br />
Bordeaux, la structure pourra bénéficier<br />
de la richesse de l’écosystème industriel<br />
et académique local dans le domaine<br />
aérospatial, tout en restant ouvert à des<br />
partenariats avec des acteurs implantés<br />
dans d’autres régions de France.<br />
Sa mission sera d’animer et de fédérer<br />
tous les acteurs régionaux et particulièrement<br />
les PME/ITE, TPE et start-up.<br />
Il associera les chercheurs du territoire<br />
(université de Bordeaux, ENSAM…)<br />
et coordonnera les initiatives locales<br />
notamment en travaillant avec la région.<br />
Les activités et projets du cluster<br />
Aliénor s’appuieront sur les travaux<br />
des trois ateliers suivants : sous le<br />
pilotage des Forces armées, l’identification<br />
des besoins en innovation<br />
à partir des nouvelles exigences<br />
opérationnelles transmises par les<br />
Forces armées (besoins des futurs<br />
programmes d’armement, ruptures<br />
technologiques, nouveaux contextes<br />
d’emploi, évolution du soutien) ; sous<br />
le pilotage d’Aerospace Valley, la<br />
détection et orientation des propositions<br />
d’innovation captées au sein du<br />
tissu industriel et académique local,<br />
au regard de leur éventuelle utilité<br />
pour les systèmes de défense ; enfin,<br />
sous le pilotage de la DGA, l’accompagnement<br />
des partenaires pour<br />
l’évaluation ou la montée en maturité<br />
du projet.<br />
Au total, quatre clusters d’innovation<br />
techniques ont déjà été créés en 2019<br />
par la DGA autour de ses centres d’expertise<br />
et d’essais, Aliénor étant le<br />
cinquième : Gimnote à Toulon et Orion<br />
à Brest pour le domaine des techniques<br />
navales, Ginco à Vert-le-Petit (Essonne)<br />
dans le domaine de la maîtrise des techniques<br />
nucléaire, radiologique, biologique<br />
et chimique, et enfin Lahitolle à<br />
Bourges dans le domaine des techniques<br />
terrestres. ●<br />
Capteur ultrasonore miniature (à gauche),<br />
en comparaison avec un capteur d’ancienne<br />
génération (à droite) dans le cadre d’un<br />
projet mené avec la société CMPhy<br />
46 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
EN APPLICATION<br />
Conception et validation d’essais<br />
d’impacts laser instrumentés par un<br />
système multi-caméras<br />
ALPhANOV 1 , centre technologique optique et laser implanté à Talence depuis 2007, et MBDA 2 ,<br />
leader européen du domaine de la défense, disposent depuis 2019 d’un laboratoire commun au<br />
service de l’interaction laser-matière autour d’une cabine équipée d’une source infrarouge de<br />
grande puissance. Afin d’optimiser la phase d’essais de la cabine, les deux partenaires ont fait<br />
appel à la société Eikosim et son logiciel Blender de rendu 3D.<br />
Grâce à une architecture flexible et pérenne,<br />
des expériences complexes, reconfigurables,<br />
fortement instrumentées, sans danger pour le<br />
personnel, y sont réalisées. Un automate de<br />
sécurité supervisant l’état de la cabine et des périphériques<br />
autorise le tir. Un second automate, dit de process, pilote<br />
le laser, un robot, un scanner galvanométrique et un zoom<br />
optique. Une IHM ALPhANOV permet la programmation.<br />
L’instrumentation est composée de caméras rapides dans<br />
l’infrarouge et le visible, de pyromètres, etc. Tous ces appareils<br />
sont synchronisés sur le même signal. Les données<br />
vidéos et analogiques sont relues dans la même interface.<br />
L’étude suivante, réalisée par Eikosim en collaboration avec<br />
MBDA, ALPhANOV et le Laboratoire de mécanique et<br />
technologie (ENS Paris-Saclay), concerne des plaques en<br />
acier soumises à une série de tirs laser en leur centre dans<br />
la cabine laser. Le but de ces mesures est de quantifier les<br />
effets thermomécaniques subis par la plaque grâce, notamment,<br />
à la mesure de champs de déplacements par corrélation<br />
d’images.<br />
PRÉ-ÉTUDE NUMÉRIQUE<br />
Concevoir des essais instrumentés par imagerie dans un<br />
environnement expérimental complexe peut être une<br />
source de difficulté. En effet, lors de l’étude d’une pièce<br />
dans un espace confiné et encombré comme la cabine laser,<br />
il peut-être difficile d’anticiper le positionnement appro-<br />
1. www.alphanov.com/alphanov-mbda-laboratoire-commun-interaction-laser-matiere<br />
2. www.mbda-systems.com/press-releases/mbda-and-alphanov-inaugurate-a-test-lab-for-laser-weapons-in-bordeaux/<br />
prié des caméras afin de garantir que la zone étudiée soit<br />
visible pendant l’ensemble de l’essai. L’utilisation du logiciel<br />
Blender permet de s’affranchir de cette problématique.<br />
Blender est un logiciel libre de rendu 3D principalement<br />
utilisé dans l’industrie du cinéma. Il permet de créer une<br />
scène dans laquelle l’utilisateur peut choisir le positionnement<br />
des caméras autour de la pièce étudiée et peut<br />
ensuite générer des images de la configuration de référence<br />
et des configurations déformées en utilisant les résultats<br />
des simulations numériques préliminaires. Par la suite,<br />
ces images peuvent être traitées avec un logiciel de corrélation<br />
d’images, afin d’estimer à l’avance la performance<br />
métrologique (en termes d’incertitudes de mesures) que<br />
l’utilisateur de ce logiciel sera en droit d’attendre dans ces<br />
conditions idéales.<br />
Dans le cadre de cette étude, quatre caméras ont été positionnées<br />
dans la scène Blender. L’espace restreint de la<br />
cabine laser contraint grandement la position des caméras.<br />
De plus, afin de ne pas être endommagées, elles ne doivent<br />
pas se trouver sur la trajectoire du faisceau laser qui arrive<br />
presque horizontalement au centre de la plaque étudiée.<br />
Une vue en contrebas a donc été adoptée (cf. Figure 1).<br />
Une visualisation animée de la scène en 3D est disponible<br />
sur le site d’EikoSim 3 . Le post-traitement des images<br />
idéales générées par Blender avec le logiciel EikoTwin-<br />
DIC permet d’estimer pour ce cas particulier une incertitude<br />
de mesure en déplacements de l’ordre de 5 µm pour<br />
les composantes dans le plan de la plaque, et de 15 µm<br />
pour la composante hors plan.<br />
3. http://eikosim.com/articles-techniques/… /<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I47
DOSSIER<br />
Figure 3 - Plaque mouchetée sur son support<br />
Figure 1 - Positionnement des quatre caméras<br />
dans la cabine laser (deux représentées<br />
par des pyramides et deux par des pavés)<br />
MISE EN PLACE DE L’ESSAI<br />
Les essais sont instrumentés avec un dispositif de stéréovision<br />
(i.e., à deux caméras). Une caméra IR et une caméra dite « logarithmique<br />
» (prêtée par l’entreprise NIT) sont aussi présentes<br />
dans la cabine. L’équipe d’ALPhANOV les a placées en adoptant<br />
les positions déterminées lors de la pré-étude par Eikosim<br />
(cf. Figure 2) et a préparé l’ensemble du setup expérimental en<br />
environ une journée.<br />
Lors de cette campagne d’essais, plusieurs plaques ont été<br />
soumises à des tirs laser (cf. Figure 3). Au total, plus de dix<br />
tirs ont été effectués au cours de la journée et demie d’essais.<br />
De plus, les plaques ont été préalablement mouchetées pour<br />
créer un contraste suffisant pour la corrélation d’images. De<br />
manière à explorer une autre technologie de réalisation des<br />
mouchetis que la peinture, ALPhANOV a réalisé un mouchetis<br />
par nano-structuration laser de la surface métallique 4 , sur<br />
la base de la topologie fournie par Eikosim.<br />
RÉSULTATS DE LA MESURE PAR STÉRÉOCORRÉLATION<br />
>> Quantification des incertitudes<br />
Afin de quantifier l’incertitude lors de l’essai, une mesure de<br />
déplacement a été réalisée sur un jeu d’images au repos. On<br />
peut ainsi mesurer l’effet du bruit d’acquisition par rapport au<br />
déplacement (nul) attendu pour ces images. Dans le cadre de<br />
cette étude, la mesure a été réalisée sur un ensemble de trente<br />
images par caméra avant chaque tir. Quelle que soit la direction,<br />
les niveaux d’incertitudes sont très proches de l’estimation<br />
qui avait été réalisée lors de la pré-étude.<br />
>> Champs de déplacements<br />
Figure 2 - Instrumentation de l’essai<br />
La stéréocorrélation d’images permet de mesurer, sans contact,<br />
les champs de déplacements 3D surfaciques de la pièce étudiée<br />
à partir d’images prises par deux des caméras durant l’essai.<br />
Cette technique est basée sur l’hypothèse de conservation des<br />
niveaux de gris dans les images. Les champs mesurés sont exprimés<br />
directement sur le modèle 3D surfacique utilisé pour la<br />
simulation par éléments finis. La mesure nous apprend que la<br />
plaque subit une déformation en trois temps :<br />
• Dans un premier temps, après activation du laser, la<br />
plaque gonfle dans la direction du laser au niveau de<br />
la zone d’impact.<br />
• Dans un deuxième temps, la plaque s’enfonce dans la<br />
direction opposée au laser au niveau de la zone d’impact<br />
(cf. Figure 4).<br />
• Dans un troisième temps, après avoir coupé le laser, la<br />
4. A.Y. Vorobyev, C. Guo, Direct creation of black silicon using femtosecond<br />
laser pulses, Applied Surface Science, 2011 ; 257 : 7291–7294<br />
48 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
plaque retrouve partiellement<br />
sa position initiale en se refroidissant.<br />
Une vidéo de la déformée mesurée<br />
de la plaque pendant l’essai est<br />
disponible sur le site d’EikoSim 5 .<br />
Le comportement observé sur les<br />
champs de déplacements est également<br />
confirmé par ceux mesurés<br />
au niveau du capteur de déplacement<br />
virtuel positionné sur le maillage<br />
de la plaque (cf. Figure 4). En<br />
effet, la corrélation d’images numériques<br />
donne accès aux déplacements<br />
en fonction du temps en n’importe<br />
quel point du maillage de mesure (cf.<br />
Figure 5).<br />
Finalement, ces travaux ont permis de démontrer la faisabilité d’une approche expérimentale<br />
par corrélation d’images numériques avec des résultats très encourageants.<br />
Évidemment, ils ne sont qu’une première étape dans l’exploration de l’interprétation de<br />
phénomènes d’interaction laser - matière par corrélation d’images numériques. ●<br />
5. http:// eikosim.com/articles-techniques/…<br />
/<br />
Figure 4 - Champs de déplacement maximum<br />
selon Z (hors plan) au deuxième<br />
temps de la déformation + Capteur de<br />
déplacement en vert<br />
Figure 5 - Évolution du déplacement hors plan en<br />
fonction du temps mesuré par le capteur virtuel de la<br />
Figure 4<br />
www.socitec.com<br />
www.vibrodynamics.com<br />
socitec@socitec.com<br />
Tél. +33(0)1 61 04 60 00<br />
INGÉNIERIE DES CHOCS,<br />
VIBRATIONS ET SÉISMES<br />
SOLUTIONS DE PROTECTION<br />
AUX CHOCS ET AUX VIBRATIONS<br />
POUR APPLICATIONS MULTIPLES<br />
DANS DES ENVIRONNEMENTS CONTRAIGNANTS<br />
AERONAUTIQUE - SPATIAL<br />
DÉFENSE - NAVAL - NUCLÉAIRE<br />
FÉRROVIAIRE - SISMIQUE<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I49
DOSSIER<br />
AVIS D’EXPERT<br />
Accompagner les évolutions des marchés<br />
de l’aéronautique et de la défense<br />
Les mondes de l’aéronautique et de la défense évoluent au rythme de la technologie et d’une<br />
intégration de plus en plus prononcée. Des spécificités en qualification en découlent, notamment<br />
en compatibilité électromagnétique (CEM) et pas seulement par l’évolution des normes et moyens<br />
d’essais.<br />
Fig 1 - Cage système<br />
« baie » nécessitant d’être positionnées<br />
directement au sol sur le plan<br />
de masse de la cage.<br />
Ces cages répondent aux méthodes<br />
d’essais actuelles et l’ensemble des<br />
essais appelés par les programmes<br />
de qualifications peuvent y être réalisés<br />
qu’il s’agisse de mesures en émission<br />
ou de tests d’immunité.<br />
À<br />
l’origine, les essais étaient<br />
réalisés sur des sous-systèmes<br />
(carte électronique<br />
ou boîtier) individuellement.<br />
Les équipements sous tests<br />
(EST), pour s’isoler des interférences<br />
extérieures (en essais d’émission) ou<br />
ne pas perturber des installations<br />
voisines (en essais d’immunité)<br />
nécessitaient d’utiliser des cages de<br />
Faraday dédiées à des tests sur des<br />
petits volumes, des cages de Faraday<br />
aux dimensions modestes.<br />
Néanmoins, avec des systèmes aéronautiques<br />
et militaires de plus en plus<br />
complets et complexes, des matériels<br />
de plus en plus interconnectés,<br />
les plans de qualifications évoluent<br />
visant plus à qualifier un système<br />
complet que des sous-systèmes<br />
considérés individuellement.<br />
Depuis quelques années, nous avons<br />
vu les besoins de nos donneurs<br />
d’ordres évolués vers ces essais de<br />
systèmes complets qui, dans le détail,<br />
sont souvent composés de plusieurs<br />
sous-systèmes reliés par plusieurs<br />
mètres de câble. Les installations<br />
du laboratoire Emitech de qualification<br />
CEM du site des Coudriers,<br />
complètement revues à l’issue de son<br />
plan stratégique de modernisation<br />
Emitech 2020 se font l’écho de ces<br />
besoins nouveaux.<br />
Le site a ainsi été doté de plusieurs<br />
cages système (figure n° 1), de<br />
grandes cages de Faraday dont les<br />
tables d’essais ont une capacité de 5<br />
à 8m de longueur, capacité qui peut<br />
être doublée si nécessaire. Du fait de<br />
leur configuration, les EST peuvent<br />
également être des systèmes de type<br />
DES CAGES RÉVERBÉRANTES<br />
POUR S’ADAPTER AUX<br />
NOUVELLES EXIGENCES DE CES<br />
QUALIFICATIONS<br />
Pour réaliser des essais rayonnés (en<br />
immunité et en émission) sur des<br />
systèmes complets dans de bonnes<br />
conditions de reproductibilité des<br />
tests, de nouvelles méthodes d’essais<br />
sont apparues faisant appel aux<br />
particularités des cages réverbérantes<br />
(figure n° 2).<br />
Les laboratoires ayant à mener des<br />
campagnes de qualification sur des<br />
systèmes complets doivent être dotés<br />
de chambres réverbérantes de gros<br />
Fig 2 - Cage réverbérante<br />
50 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
Salle Tarmac (Tests des alimentations<br />
réseaux militaires et<br />
aéronautiques civils)<br />
volume de dernière génération. Il<br />
s’agit d’une part de pouvoir réaliser<br />
des niveaux de champs très importants<br />
sur des EST à fort encombrement<br />
et, d’autre part, de réaliser des<br />
mesures rayonnées sur des systèmes<br />
complets en optimisant la durée d’essais.<br />
En effet, là où une cage réverbérante<br />
permet d’obtenir en une<br />
seule passe l’enveloppe maximale<br />
des champs EM émis par l’installation,<br />
une installation en cage<br />
classique nécessiterait de pivoter<br />
l’installation complète pour obtenir<br />
la même précision ou se limiterait<br />
aux mesures d’émission « d’une<br />
face » de l’EST.<br />
Dernière conséquence des évolutions<br />
technologiques, l’émergence des<br />
avions électriques remet en cause les<br />
méthodes d’essais classiques à cause<br />
de la haute tension utilisée pour<br />
alimenter les systèmes. Il ne s’agit<br />
plus ici de faire évoluer les cages de<br />
Faraday, mais bien de revoir l’instrumentation<br />
devant être utilisée.<br />
Travaillant main dans la main avec<br />
ses donneurs d’ordres, Emitech<br />
travaille sur de nouveaux moyens<br />
(de protection, d’injection, etc.)<br />
pour réaliser les essais foudres sur<br />
les broches qui sont alimentées en<br />
haute tension. Ces systèmes alimentés<br />
en haute tension sont également<br />
soumis aux traditionnels essais électriques<br />
: surtensions, sous-tensions,<br />
microcoupures, etc. La plupart des<br />
moyens déjà existants n’étaient pas<br />
adaptés et des laboratoires comme<br />
Emitech ont investi dans des alimentations<br />
programmables haute tension<br />
et développé des moyens permettant<br />
de couvrir les différents types d’essais<br />
électriques.<br />
Le laboratoire de qualification CEM<br />
d’Emitech Île-de-France (site des<br />
Coudriers) dédié aux campagnes de<br />
qualifications militaires, aéronautiques<br />
et spatiales compte quatre<br />
cages réverbérantes, quatre cages<br />
systèmes, six cages de Faraday traditionnelles,<br />
trois bancs d’essai foudre<br />
et une salle dédiée à la famille d’essais<br />
électriques (figure n°3). Les<br />
installations ont été inaugurées le<br />
26 septembre 2019 après deux ans<br />
de travaux et d’aménagement pour<br />
un investissement évalué à 3,8 M€. ●<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I51
DOSSIER<br />
TECHNOLOGIE<br />
Soldat connecté :<br />
le recours à la<br />
simulation pour<br />
conserver une<br />
longueur d'avance<br />
sur la menace<br />
L'avènement d'une connectivité intelligente<br />
persistante à haut débit – permis par l’essor de<br />
la 5G – transforme profondément la plupart des<br />
secteurs d’activité, à commencer par l'armée<br />
avec – notamment – le soldat connecté, l’un des<br />
piliers de l’IoBT (Internet of Battefield things).<br />
Objectif ? Interconnecter des ressources multidomaine<br />
(protections, radios, armes, etc.) pour<br />
offrir au soldat une connaissance de la situation<br />
et une vision opérationnelle inégalées.<br />
Toutefois, le développement de technologies militaires<br />
implique des défis bien plus complexes que pour la<br />
création de systèmes électroniques destinés aux applications<br />
commerciales. Les ingénieurs doivent, par<br />
exemple, garantir la sécurité des puces électroniques lors d’attaques<br />
par canal auxiliaire (attaque informatique exploitant<br />
des failles dans leur implémentation logicielle ou matérielle) et<br />
concevoir des dispositifs suffisamment robustes et fiables pour<br />
fonctionner dans les environnements physiques et électromagnétiques<br />
les plus difficiles.<br />
À cet effet, la simulation numérique multiphysiques s’avère<br />
essentielle pour développer des technologies militaires au<br />
service du soldat connecté d’aujourd’hui, et de demain. La<br />
simulation permet ainsi de réduire d’environ 25% la durée des<br />
cycles de développement, de 30% les coûts de main d’œuvre et<br />
de plus de 35% les cycles de test de sécurité. De la micropuce<br />
à la mission opérationnelle, la simulation demeure essentielle<br />
pour permettre au soldat de conserver une longueur d’avance<br />
sur les menaces.<br />
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT<br />
Les attaques par canal auxiliaire constituent l’une des menaces<br />
les plus importantes pesant actuellement sur le matériel de sécurité<br />
moderne. Au niveau des puces et cartes, la détection des<br />
interférences extérieures et la génération thermiques et électromagnétiques<br />
intrinsèques peut permettre de mieux comprendre<br />
le comportement physique de ces appareils.<br />
Grâce à la simulation, la vulnérabilité d’un circuit par l’attaque<br />
d’un canal auxiliaire puissance-bruit peut être analysée jusqu’à<br />
quatorze fois plus rapidement que les techniques conventionnelles<br />
en combinant l’analyse de fuite à un flot robuste de vérification<br />
sur trois étapes de la conception. La première au niveau<br />
RTL qui fournit une analyse précoce de la microarchitecture, la<br />
seconde au niveau portes qui permet de quantifier la fuite du<br />
canal auxiliaire, et la dernière en phase de vérification finale<br />
du circuit qui permet d’analyser la sécurité de l’ensemble chip,<br />
boitier et système électronique.<br />
GARANTIR LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES<br />
L'environnement difficile des soldats exige une fiabilité technologique<br />
à tous les niveaux : électronique, thermique et<br />
52 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
mécanique. Pour y parvenir, les ingénieurs s'appuient sur la<br />
simulation afin de concevoir des équipements capables de résister<br />
aux dommages potentiels provoqués par des forces physiques<br />
sur le champ de bataille, notamment des variations importantes<br />
de température, des impacts, des explosions ou encore<br />
des champs électromagnétiques hostiles.<br />
Pour permettre aux soldats d’optimiser leurs missions, la taille<br />
et le poids de leur équipement doit être optimisé en fonction<br />
des besoins en énergie et en chaleur. Par exemple, simuler des<br />
batteries dans des environnements représentatifs des conditions<br />
réelles permet de s'assurer qu’elles ont une capacité suffisante<br />
et qu’elles restent opérationnelles à des températures extrêmes.<br />
Ce processus nécessite beaucoup moins de temps que des essais<br />
physiques et permet de réduire significativement les coûts de<br />
développement.<br />
La question de la survie reste également un aspect essentiel. A<br />
cet effet, les simulations mécaniques permettent d'évaluer la<br />
capacité des équipements électroniques à survivre à un impact.<br />
Les modèles d'explosion permettent de prédire la manière dont<br />
les ondes de choc altèrent l'électronique, aidant ainsi les ingénieurs<br />
à rendre les systèmes plus robustes et légers afin qu’ils<br />
puissent résister à des scénarios violents. La nature hautement<br />
interdépendante de l'électronique moderne exige des processus<br />
de simulation multiphysiques. A ce jour, il s’agit du seul moyen<br />
d’évaluer rapidement et précisément la fiabilité d’un système<br />
électronique et de pouvoir prédire son cycle de vie.<br />
UNE CONNECTIVITÉ PERMANENTE<br />
Les soldats connectés et les plates-formes avec lesquelles ils<br />
interagissent embarquent de multiples systèmes électroniques<br />
ainsi que les antennes associées. Qu’elles soient isolées ou dans<br />
des conditions normales, ces antennes doivent délivrer des<br />
performances conformes aux attentes. Cependant, en présence<br />
de plusieurs autres systèmes, un couplage d'antennes peut se<br />
produire, entraînant des interférences électromagnétiques<br />
(EMI) et une dégradation, voire une défaillance des performances.<br />
Pour les systèmes militaires, ce phénomène peut être<br />
amplifié par des champs électromagnétiques hostiles. Tester<br />
physiquement les performances des antennes installées peut être<br />
très coûteux et chronophage. La tâche peut également s’avérer<br />
complexe en raison des très nombreux scénarios auxquels les<br />
militaires peuvent être confrontés sur le terrain.<br />
Alors que l'armée s'appuie de plus en plus sur des systèmes électroniques<br />
avancés qui fournissent une connectivité au combattant<br />
via l’internet des objets du champ de bataille, relever les<br />
défis de la sécurité et de la fiabilité tout en offrant une connectivité<br />
persistante est plus essentiel que jamais. La simulation<br />
physique depuis le comportement de la puce jusqu’à la mission<br />
elle-même est un élément essentiel de la solution et peut être<br />
utilisée pour relever ces défis plus rapidement et à moindre<br />
coût, garantissant ainsi que le combattant reste en avance sur<br />
la menace. ●<br />
Robert Harwood<br />
Industry Marketing Director Ansys<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I53
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020<br />
MAISON DE LA MUTUALITÉ - PARIS<br />
EN PARTENARIAT AVEC
DOSSIER<br />
FOCUS PME<br />
Socitec, un demi-siècle d’expérience au<br />
service de la défense et l’aéronautique<br />
Fort d’un savoir-faire de plus d’un demi-siècle acquis dans le domaine de l’ingénierie des chocs, vibrations<br />
et séismes, Socitec propose des prestations d’études mécaniques pour la conception, la simulation<br />
et le développement d’équipements embarqués ou au sol, soumis aux sollicitations dynamiques les<br />
plus sévères. Le point avec Jean-Michel Courzereau, responsable commercial de la société.<br />
À QUELS TYPES DE CLIENTS VOUS ADRESSEZ-VOUS<br />
DANS LES DOMAINES AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE ?<br />
Tout type de client ayant une problématique de protection de matériels<br />
fragiles vis-à-vis de chocs et/ou de vibrations très sévères. Les<br />
chocs sont de tout type (tirs canon, grenadage, chocs de roulage,<br />
chutes de conteneurs…). Et les vibrations correspondent à des<br />
sollicitations d’environnement mécanique (vibrations de transport,<br />
vibrations générées par les boosters lors du départ d’un lanceur…).<br />
Ces données de chocs et/ ou de vibrations figurent dans les spécifications<br />
émises par les donneurs d’ordre / clients.<br />
Socitec est en charge de définir le calage élastique (amortisseurs)<br />
qui permet de filtrer au mieux ces chocs et ces vibrations, et de<br />
fournir la partie justificative (simulation et essais). La tendance<br />
générale est, pour le client ou le donneur d’ordre, de « soigner »<br />
le calage élastique pour éviter de « durcir » l’équipement. Et ainsi<br />
de privilégier l’emploi de COTS (matériel sur étagère).<br />
QUELS SONT LEURS BESOINS EN MATIÈRE D'ESSAI ET À<br />
QUELLES PROBLÉMATIQUES SONT-ILS CONFRONTÉS ?<br />
En général, la démarche consiste, avant d’effectuer ces essais de<br />
chocs / vibrations, à réaliser<br />
des simulations numériques<br />
soit par calculs EF<br />
ou à l’aide d’un logiciel<br />
de simulation développé<br />
par Socitec (Symos) qui<br />
permet de calculer les<br />
performances du calage<br />
élastique. Il est à noter<br />
que ce logiciel est également<br />
utilisé par certains<br />
donneurs d’ordres. Les<br />
essais sont réalisés ensuite<br />
sur pots vibrant (ou<br />
autres moyens d’essais) et<br />
doivent valider les résultats<br />
des calculs.<br />
Système armé sur un bâtiment naval<br />
Socitec ne fournit pas directement la réalisation de ces essais mais<br />
s’adresse pour cela à des laboratoires tels que Sopemea, Emitech…<br />
En clair, Socitec fournit le produit amortisseur et la partie ingénierie.<br />
SUR QUELS SAVOIR-FAIRE ET SUR QUELLES<br />
TECHNOLOGIES REPOSE SOCITEC ?<br />
Le savoir-faire de Socitec repose sur sa capacité à définir une solution<br />
de protection et de la valider en très peu de temps. Et ce, grâce<br />
à sa structure légère.<br />
POUVEZ-VOUS NOUS DONNER QUELQUES EXEMPLES<br />
CONCRETS ?<br />
Nous sommes intervenus par exemple sur des solutions de protection<br />
d’équipements de conduite de tirs sur un canon de 155 mm<br />
monté sur véhicule (vis-à-vis de chocs générés par le tir) et auprès<br />
de fabricants de protection d’équipements et de réservoirs montés<br />
sur un futur lanceur et soumis à des chocs de séparation d’étages et<br />
de vibrations des boosters. Nous intervenons en effet beaucoup au<br />
niveau de la protection vis-à-vis de chocs de roulage et de chutes,<br />
et d’équipements transportés en conteneurs. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I55
DOSSIER<br />
RECHERCHE<br />
Les matériaux<br />
composites, un<br />
élément incontournable<br />
de l’avion du futur<br />
À travers le projet Vertex, lancé il y a quatre<br />
ans par Airbus et Sogeclair, les chercheurs<br />
du département DMSM de l’Isae-Supaero<br />
parviennent à prédire le comportement des<br />
structures composites des aéronefs en plein<br />
vol. Détails avec Yves Gourinat, professeur de<br />
Mécanique des structures au sein d’ISAE.<br />
Pr. Yves Gourinat,<br />
Professeur depuis 2003 à l’Insa Supaero et<br />
spécialiste en mécanique des structures, Yves<br />
Gourinat se définit plus précisément comme un<br />
« dynamicien » des structures aéronautiques et<br />
de systèmes vivants. Yves Gourinat a démarré sa<br />
carrière chez Airbus en 1988 en tant qu’ingénieur<br />
structure composite chargé de travailler sur<br />
l’A340, avant de servir une dizaine d’années<br />
durant le secteur spatial puis devenir professeur<br />
au début des années 2000.<br />
Pour le Pr. Yves Gourinat, les choses sont claires : « les<br />
composites font aujourd’hui redécouvrir une chose<br />
vieille comme la nature : les fibres de carbone ont été<br />
découverts grâce au tronc des arbres par des métiers<br />
bien plus anciens que les nôtres à l’image des tonneliers et<br />
des charpentiers ; ceux-ci ont su apprivoiser les structures en<br />
carbone pour en fabriquer des poutres ou des coques ». Certes,<br />
la réalité scientifique et industriels est plus compliquée que cela<br />
mais l’idée est là : alors que la Caravelle et autres Boeing 707<br />
puis 747 notamment, qui ont pris leur envol dans les années<br />
60, étaient composé à 90 % d’aluminium, le programme A320<br />
a révolutionné l’aéronautique en intégrant de plus en plus de<br />
matériaux composites et l’électrification des commandes. Jusqu’à<br />
atteindre son apogée avec l’A350…<br />
Cette révolution repose en grande partie sur l’usage grandissant de<br />
la fibre de carbone et, surtout, dans la maîtrise de ses performances.<br />
« En effet, nous ne maîtrisions auparavant qu’une infime partie du<br />
potentiel des composites ce qui nous permettait de gagner au mieux<br />
15 % de poids. Aujourd’hui, nous parvenons à utiliser l’intégralité<br />
de leurs performances grâce à l’arrivée de la troisième génération des<br />
matériaux composites permettant des gains de 30 à 40 % en matière<br />
de poids et de performance, mais aussi des gains écologiques et des<br />
coûts de fabrication réduits. Il nous aura tout de même fallu trente<br />
ans pour en arriver là ». Mais pour le professeur, le plus important<br />
reste à venir car l’usage de ces matériaux sont aujourd’hui le signe<br />
de l’avion de demain.<br />
PRÉDIRE LE COMPORTEMENT DES COMPOSITES DANS<br />
LA DURÉE<br />
Les matériaux composites se trouvent incontestablement au<br />
cœur de cette révolution. À ce titre, la France n’est pas en reste, à<br />
l’exemple des équipes de chercheurs de l’Institut Clément Ader, dont<br />
Microstructure composite à matrice céramique<br />
©Wikipedia<br />
56 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
Réservoir composite bobiné<br />
©Nasa<br />
durant toute sa durée de vie. Cette combinaison est rendue possible<br />
grâce à un démonstrateur situé au sein de l’Espace Clément Ader, à<br />
Montaubans. Cet équipement est capable de décomposer les phases<br />
d’essai en sous-étapes et de combiner cinq cas de charge en même<br />
temps. Globalement, l’idée est de lever trois verrous : la combinaison<br />
de charges, les flux d’efforts réels (les efforts des verts et des<br />
bras de levier) que la structure subit en plein vol, à l’échelle 1, et,<br />
enfin, les moyens d’observation, de visualisation et de monitoring<br />
de la structure en 3D ; des caméras en stéréo permettent de voir<br />
comment la structure se déforme et casse. « On arrive à tout visualiser,<br />
du délaminage à la propagation de fissures jusqu’à la rupture ».<br />
UN PAS DE PLUS VERS L’AVION DU FUTUR<br />
l’Isae-Supaero est membre fondateur. Celles-ci testent ces matériaux<br />
dans le but de savoir ce qui s’y passe à l’intérieur ; ils fournissent<br />
ensuite les modèles mathématiques aux avionneurs et aux<br />
industriels comme Airbus, Boeing ou Thales, ainsi qu’aux les certificateurs<br />
(FAA, EASA). Cela permet à ces derniers de prendre des<br />
décisions stratégiques par rapport à la conception des avions du<br />
futur : architecture de l’avion, fibre optique, intégration d’hydrogène<br />
à bord ou pas, etc.<br />
À titre d’exemple, les chercheurs du département DMSM de<br />
l’Isae-Supaero travaillent depuis quatre ans avec Airbus et Sogeclair<br />
sur le projet Vertex portant sur la validation de structures.<br />
Concrètement, il s’agit de réaliser des essais d’endommagement des<br />
matériaux afin d’étudier leur résistance sous sollicitation d’impact<br />
ou de crash. Pour ce faire, l’Institut Clément Ader abrite plusieurs<br />
équipements de recherche tels qu’une tour de chute pour les crashs<br />
tests ou encore une plateforme d’impact pour les structures composites.<br />
Ces essais permettent de démontrer la solidité du fuselage,<br />
supérieure à celle d’un bâtiment, « ce qui explique qu’en quinze ans<br />
il n’y a jamais eu une rupture d’avion en vol (et il n’y en aura pas !) »,<br />
insiste-t-on au sein du laboratoire. Deux thèses et des brevets ont<br />
d’ores et déjà été publiés sur le sujet.<br />
« Grâce à ses travaux, nous sommes capables de prédire le comportement<br />
des composites dans la durée. L’objectif étant de continuer à<br />
faire de l’avion l’endroit le plus sûr et le plus performant de la Terre »,<br />
précise Yves Gourinat. En somme, l’une des grandes valeurs ajoutées<br />
de ce projet et d’être en mesure de combiner l’ensemble de ces sollicitations<br />
et de ne pas faire d’études séparées et indépendantes ; car<br />
additionner les résultats ne suffit pas : l’enjeu réside dans la réunion<br />
de ceux-ci afin de mieux prédire les comportements de la structure<br />
Les premiers résultats de ce projet sont concluants : « depuis quatre<br />
ans, nous sommes parvenus à beaucoup mieux connaître et maîtriser<br />
cette troisième génération de composites thermodynamiques, relate<br />
Yves Gourinat. Notre rôle est de fournir des mathématiques aux<br />
avionneurs pour qu’ils exploitent les matériaux de leurs aéronefs.<br />
Ainsi, performances et sécurité vont de pair, ce qui n’était pas le cas<br />
auparavant. »<br />
L’équipe de recherche a eu également recours de façon croissante<br />
au calcul numérique et aux capacités de prédictions des comportements<br />
des structures, permettant ainsi d’optimiser les temps et<br />
la qualité des essais. Enfin, le projet vertex donnera la possibilité<br />
de suivre plus finement le cycle de vie de l’avion jusqu’à sa fin de<br />
vie et après, au moment de la reconversion de l’avion en d’autres<br />
produits ou du recyclage des thermoplastique qui, à la différence des<br />
composites thermodurcissable, sont moins compliqués à recycler.<br />
Prochaine étape ? « Dans la recherche, on ne peut pas savoir sur<br />
quoi on va aboutir mais chose est sûre, ce projet apportera une pierre<br />
l’avion du futur », s’enthousiasme le professeur, déjà à l’origine d’un<br />
article technique sur l’aile volante, un programme d’avion écologique<br />
doté d’une structure composée quasi exclusivement de matériaux<br />
composites. ●<br />
Olivier Guillon<br />
Concept d’avion du futur<br />
©Imperial College<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I57
DOSSIER<br />
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT<br />
Retour sur<br />
Compostamp,<br />
un projet qui<br />
a su fédérer<br />
aéronautique<br />
et automobile<br />
Réunir les secteurs de l'aéronautique<br />
et de l'automobile au sein d'un seul<br />
et même projet, tel était le défi<br />
de l'IRT Jules Verne. C’est le cas<br />
du projet baptisé Compostamp.<br />
Orchestré par l’IRT Jules Verne, il<br />
avait pour but de tester la faisabilité<br />
du procédé de thermo-estampage/<br />
surmoulage pour la fabrication de<br />
pièces aéronautiques.<br />
Lancé en janvier 2015, le projet<br />
baptisé Compostamp portait sur<br />
l'estampage-surmoulage deux<br />
pièces en composite dans le but de<br />
réduire les coûts de production et d'augmenter<br />
les cadences. Deux ans et demi plus<br />
tard, l'institut de recherche situé en région<br />
Pays de la Loire lançait Cosmos, un projet<br />
visant à améliorer la performance pour une<br />
meilleure compréhension des phénomènes<br />
physiques de pièces composites surmoulées.<br />
Nouveauté, ce projet a fait appel au<br />
moyen d'essais de l'IRT et à davantage de<br />
moyens de simulation.<br />
Si les besoins sont différents entre le monde<br />
de l'automobile et celui de l'aéronautique,<br />
les enjeux sont similaires. À l'image de<br />
l'ensemble de l'industrie, les défis relevant des coûts de production et des<br />
montées en cadence semblent les mêmes pour tous. Mais de là à impliquer<br />
des industriels, des acteurs de la R&D issus de deux filières radicalement<br />
différentes, le pari n'était pas joué d'avance, d'autant que les finalités ne sont<br />
pas tout à fait les mêmes. « Pour l'automobile, l'idée est de produire une<br />
pièce par minute contre une pièce toutes les cinq minutes dans l'aéronautique<br />
», précise-t-on au sein de l’IRT.<br />
Il en est de même, pour les niveaux de maturité entre l'automobile qui utilise<br />
essentiellement des polyamides à base de fibre de verre, et l'aéronautique,<br />
grand utilisateur de matériaux à base de fibres de carbone haute performance,<br />
aux températures très élevées. « Pour l'automobile, la démarche est<br />
différente car l'objectif était de réaliser une pièce école mettant en avant les<br />
difficultés de fonctionnement, de test et de géométrie. Pour l'aéronautique,<br />
l'objectif au contraire était de valider la mise en œuvre de ce type de matériaux<br />
et de leurs performances mécaniques afin de démontrer leur faisabilité<br />
mécanique sur un clip, une pièce permettant la liaison entre le fuselage<br />
et le raidisseur. »<br />
DE NOMBREUX PARTENAIRES SUR LE PROJET<br />
Mais Compostamp ne s'est pas contenté de réunir des acteurs de l'automobile<br />
tels que Renault, PSA et Faurecia, de l'aéronautique avec Airbus et Daher. Le<br />
Cetim et l'IPC de Laval étaient également de la partie ; cet appui de centre<br />
58 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
DOSSIER<br />
Compostamp ne s'est pas contenté de réunir des acteurs de l'automobile ;<br />
le Cetim et l'IPC de Laval étaient également de la partie<br />
sous la presse ; une méthode de surmoulage qui s’applique<br />
sur différentes pièces. Dans le domaine de l'aéronautique,<br />
les essais se faisaient à très haute température sur une presse<br />
horizontale chez Dedienne ».<br />
Les essais ce sont d'abord dérouler sur des éprouvettes<br />
simples puis de plus en plus complexes afin d'en sortir quatre<br />
pièces au total. Dans l'automobile, les résultats sont à la<br />
hauteur des attentes en matière de cadence de production<br />
avec une pièce produite par minute et en termes de procédé,<br />
de caractérisation de tester de contrôle de pièces : « nous<br />
avons constaté une bonne santé de la matière sur les pièces une<br />
bonne répétabilité dans le process ». Dans le domaine aéronautique,<br />
des essais ont porté sur des éprouvettes simples sur<br />
lesquelles a pu être validée la mise en œuvre des matériaux.<br />
Le premier niveau de performances mécaniques atteint s’est<br />
révélé encourageant. La pièce démonstratrice – le clip – a<br />
bien été produite dans les temps et a permis à Airbus et à<br />
Daher d'obtenir de précieuses informations leur permettant<br />
de procéder à une analyse technico-économique dans le but<br />
de savoir si cette pièce a un potentiel. Celle-ci a ainsi servi<br />
de base aux deux constructeurs qui aujourd'hui produisent<br />
leurs pièces estampées, usinées puis assemblées avec un seul<br />
et même outillage, sans reprise.<br />
technique avait pour rôle de coordonner la méthodologie<br />
et de contrôler l'aspect technique mais aussi et surtout de<br />
fournir des moyens d'essais (le Cetim et l'IPC pour l'automobile,<br />
Dedienne pour outillage aéronautique).<br />
En matière d'essai justement, dans l'automobile, l'objectif<br />
était de confronter les pièces sur une presse horizontale<br />
à l'IPC et sur une pièce presse verticale au Cetim. « Cela<br />
consistait à chauffer un semi produit sous la forme d'une<br />
plaque composite à une température de fusion pour obtenir<br />
une matière molle et ensuite l'injecter dans les moules puis<br />
Clip fabriqué selon le procédé de thermo-estampage/surmoulage<br />
dans le cadre du projet Compostamp<br />
UN NOUVEAU CONSORTIUM POUR UN NOUVEAU<br />
PROJET<br />
Dans l’esprit de Compostamp, le projet Cosmos a vu le jour<br />
en octobre 2017, pour le volet aéronautique uniquement,<br />
le niveau de maturité des pièces automobile étant suffisant.<br />
Objectif : améliorer la performance des pièces composites<br />
surmoulées pour mieux en comprendre les phénomènes<br />
physiques. « Ce projet de trois ans intègre beaucoup plus de<br />
simulation numérique. Particularité de Cosmos, la campagne<br />
de tests a eu lieu au sein de l’IRT Jules Verne. Le premier essai<br />
a été concluant ; les tests vont dans le sens de l’amélioration<br />
des propriétés mécaniques afin d’augmenter les performances<br />
des pièces écoles dont on a complexifié les géométries ».<br />
Du contrôle en ligne est également effectué afin de mieux<br />
comprendre les paramètres du procédé. Celui-ci fait aussi<br />
l’objet de simulation au sein du laboratoire mécanique des<br />
contacts et des structures (Lamcos) sur les opérations d’estampage.<br />
Idem pour le procédé d’inspection. Puis tout est<br />
importé dans le logiciel Abaqus. « L’objectif [cette année] de<br />
ce nouveau projet est de fournir les paramètres process pour<br />
la fabrication des pièces, et d’atteindre les meilleures performances<br />
possibles de la pièce ainsi fabriquée », a précisé Dominique<br />
Bailly, directeur de l’innovation chez Daher. ●<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I59
DOSSIER<br />
SPATIAL<br />
Des essais acoustiques pour simuler<br />
l’impact sonore du lancement de Sentinel-6A<br />
Le satellite d’observation de la Terre Sentinel-6A en prend actuellement plein les oreilles. Les ingénieurs<br />
spatiaux d’Airbus « bombardent » de sons le tout dernier satellite du programme européen pour<br />
l’environnement et la sécurité Copernicus dans une chambre réverbérante dédiée du centre d’essais<br />
spatiaux de la société IABG (Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH) à Ottobrunn, près de Munich.<br />
Les essais acoustiques simulent l’impact sonore auquel le satellite sera exposé lors du lancement.<br />
D’une surface d’environ 100 m2, la pièce dotée de gigantesques<br />
haut-parleurs est hermétiquement fermée pendant<br />
les essais. Les tests consistent en quatre explosions sonores<br />
de 60 secondes, dirigées sur le satellite avec une intensité<br />
croissante qui culminera à 140 décibels (dB). À titre de<br />
comparaison, les niveaux sonores d’environ 50 dB sont<br />
agréables à nos oreilles, à 100 dB ils commencent à être<br />
déplaisants et deviennent douloureux à environ 120 dB.<br />
Les marteaux-piqueurs et les tronçonneuses produisent<br />
environ 100 dB. Une augmentation de 10 dB représente<br />
un doublement de l’intensité sonore perçue.<br />
« Copernicus Sentinel-6 » est une mission d’altimétrie<br />
océanographique qui mesurera la topographie des océans<br />
au cours de la prochaine décennie. Les deux satellites Sentinel-6<br />
sont équipés d’un radar altimètre fournissant des<br />
observations fréquentes et ultra précises sur la hauteur des<br />
océans à l’échelle planétaire. Ces informations sont indispensables<br />
à la surveillance continue de l’évolution du niveau<br />
des mers, indicateur important du changement climatique<br />
et élément essentiel de l’océanographie. Couvrant jusqu’à<br />
95 % de la surface des océans libres de glace tous les dix<br />
jours, Sentinel-6 fournira des informations cruciales sur<br />
les courants océaniques, la vitesse du vent et la hauteur des<br />
vagues, afin d’améliorer la sécurité maritime.<br />
PERPÉTUER LES MESURES DE LA SURFACE DES<br />
OCÉANS<br />
Les deux satellites Sentinel-6 dédiés à Copernicus,<br />
programme européen pour l’environnement et la sécurité,<br />
ont été développés sous la maîtrise d’œuvre industrielle<br />
d’Airbus. Bien qu’ils fassent partie de la série de missions<br />
Copernicus de l’Union européenne, ils sont aussi le fruit<br />
d’une coopération internationale impliquant l’ESA, la Nasa,<br />
la NOAA et Eumetsat, les agences spatiales et météorologiques<br />
européennes et américaines.<br />
Dès novembre 2020, Sentinel-6A sera le premier des deux<br />
satellites Sentinel-6 à perpétuer les mesures de la surface<br />
des océans commencées en 1992. Sentinel-6B suivra en<br />
2025. Sentinel-6 profite de l’héritage de la famille des satellites<br />
de topographie océanique Jason, ainsi que des missions<br />
de l’ESA CryoSat-2, Sentinel-2 et Grace, toutes trois réalisées<br />
sous la maîtrise d’œuvre d’Airbus. ●<br />
© Airbus/Daniel Miller-2020<br />
Sentinel-6A dans la chambre réverbérante<br />
© Airbus/Sandra Walther-2020<br />
Test de bruit acoustique sur Sentinel-6A<br />
60 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
Cycles<br />
Code<br />
Formation<br />
de Base<br />
ou Spécifique<br />
Intervenant et lieu<br />
Durée<br />
en jours<br />
Prix<br />
Adhérent<br />
ASTE HT<br />
Dates proposées<br />
Mécanique vibratoire<br />
Mesure et analyses des phénomènes vibratoires<br />
(Niveau 1)<br />
Mesure et analyses des phénomènes vibratoires<br />
(Niveau 2)<br />
MV1<br />
B<br />
IUT du Limousin<br />
3 1 570 €<br />
31 mars-02 avril<br />
et 08-10 septembre<br />
MV2 3 1 570 € 15-17 septembre<br />
Application au domaine industriel MV3 B SOPEMEA (78) 3 1 570 €<br />
24-26 mars<br />
et 13-15 octobre<br />
Chocs mécaniques : mesures, spécifications, essais<br />
et analyses de risques<br />
MV4<br />
S<br />
Christian LALANNE, Henri<br />
GRZESKOWIAK et Yvon MORI (78)<br />
3 1 570 € 17-19 novembre<br />
Traitement des signaux<br />
Principes de base et caractérisation des signaux TS1 B IUT du Limousin 3 1 570 € 12-14 mai<br />
Traitement du signal avancé des signaux vibratoires TS2 S<br />
Analyse modale et Pilotage<br />
Pierre-Augustin GRIVELET et Bruno<br />
COLIN (78)<br />
3 1 570 € 15-17 septembre<br />
Pilotage des générateurs de vibration : principes utilisés<br />
et applications<br />
Analyse modale expérimentale et Initiation aux calculs de structure<br />
et essais<br />
PV S SOPEMEA (78) 4 1 890 € 24-27 novembre<br />
AM S SOPEMEA ou AIRBUS D&S (31) 3 1 570 € 06-08 octobre<br />
Climatique<br />
Principes de base et mesure des phénomènes thermiques CL1 B IUT du Limousin 3 1 570 € 17-19 novembre<br />
Les fondamentaux des essais climatiques CL2 B SOPEMEA (78) 2 1 350 €<br />
12-13 mai<br />
et 08-09 décembre<br />
Electromagnétisme<br />
Sensibilisation à la compatibilité électromagnétique EL1 S IUT du Limousin 3 1 570 € 09-11 juin<br />
Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM) Exploitation<br />
des normes<br />
EL2 S EMITECH (78) 2 1 170 € A définir<br />
Personnalisation Environnement<br />
Prise en compte de l’environnement dans un programme industriel<br />
(norme NFX-50144-1)<br />
Prise en compte de l’environnement mécanique (norme NFX-50144-3)<br />
Principes de personnalisation de base<br />
Prise en compte de l’environnement mécanique (norme NFX-50144-3)<br />
Principes de personnalisation avancées<br />
Prise en compte de la norme NFX-50144 dans la conception<br />
des systèmes<br />
P1 S Henri GRZESKOWIAK (78) 2 1 170 € 15-16 septembre<br />
P2-1 S Bruno COLIN et Pascal LELAN (78) 3 1 570 € 06-08 octobre<br />
P2-2 S Bruno COLIN et Pascal LELAN (78) 3 1570 24-26 novembre<br />
P3 S Bruno COLIN (78) 3 1 570 € 17-19 novembre<br />
Prise en compte de l’environnement climatique<br />
(norme NFX-50144-4)<br />
P4<br />
S<br />
Henri GRZESKOWIAK et Henri<br />
TOLOSA (78)<br />
3 1 570 € 22-24 septembre<br />
Mesure<br />
Extensomètrie : collage de jauge, analyse des résultats<br />
et de leur qualité<br />
M1 S Raymond BUISSON (78) 3 1 570 € 01-03 décembre<br />
Concevoir, réaliser, exploiter une campagne de mesures M2 B Pascal LELAN (78) 2 1 170 € 08-09 décembre<br />
Mesure tridimensionnelle M3 B IUT de LIMOGES 1 900 € 05 novembre<br />
Fiabilité et <strong>Essais</strong><br />
Conception et validation de la fiabilité - dimensionnement<br />
des essais pour la validation de la conception des produits<br />
E1 S Alaa CHATEAUNEF (78) 3 1 570 € A définir<br />
Les essais accélérés et aggravés E2 S Alaa CHATEAUNEF (78) 2 1 170 € A définir<br />
Fatigue des matériaux métalliques :<br />
<strong>Essais</strong>, dimensionnement et calcul de durée de vie<br />
sous chargement complexe<br />
E3 S Alexis BANVILLET 2 1 170 € 24-26 novembre<br />
Gestion d’une Salle blanche : application dans un Centre d’<strong>Essais</strong> ME1 S AIRBUS D&S (31) 2 1 170 € A définir<br />
L’assurance qualité dans les laboratoires d’essais selon le référentiel<br />
EN ISO/CEI 17025<br />
ME2 S EMITECH (78) 2 1 170 € A définir<br />
Thermométrie<br />
Thermométrie pour les essais vide thermique T1 S Alain BETTACCHIOLI (78) 1 900 € A définir<br />
Simulation<br />
La simulation numérique et les essais : complémentarités -<br />
comparaisons<br />
S1 B Philippe PASQUET (78) 2 1 170 € A définir<br />
Formations 2020
VIE DE L’ASTE<br />
ÉVÉNEMENT<br />
Le point sur les prochaines journées<br />
techniques de l’ASTE<br />
Cette journée, dont la date est à confirmer, aura pour thème l’« Évolution des méthodes d’appréhension du confort<br />
thermique dans les bâtiments et les habitacles ». Elle se déroulera en automne 2020 à CSTB Nantes.<br />
MATINÉE - CONFÉRENCES TECHNIQUES :<br />
CSTB : Modèle de thermophysiologie dynamique<br />
pour l’évaluation du confort et du stress thermique des<br />
usagers<br />
CSTB : Méthode PULSE d’évaluation du gout et de<br />
l’odeur de l’eau, ouverture vers le multisensoriel.<br />
Alaa Châteauneuf – Cideco/Université Blaise Pascal :<br />
Optimisation des performances énergétique du bâtiment,<br />
prise en compte des changements climatiques.<br />
Cette infrastructure de recherche internationale permet<br />
ainsi de tester, en un seul lieu, tout équipement à différentes<br />
échelles, jusqu’à l’échelle 1, en reproduisant toutes<br />
les conditions climatiques, et en couplant démarche<br />
numérique et expérimentale pour obtenir les résultats<br />
les plus performants.<br />
>> À venir : une journée technique intitulée « Les<br />
mesures optiques appliquées aux essais » en novembre<br />
2020 à Ariane Group – Issac<br />
Nicolas François - Valeo : Les nouveaux défis de la simulation<br />
CFD pour optimiser le confort et la gestion thermique<br />
des véhicules électriques<br />
Airbus : « Mesure du confort des cabines » (sous<br />
réserve)<br />
APRÈS-MIDI - VISITE DES INSTALLATIONS DE<br />
CSTB NANTES :<br />
• La soufflerie climatique Jules Verne<br />
• La soufflerie à couche limite atmosphérique (pour<br />
l’étude des bâtiments à échelle réduite)<br />
• Le bâtiment Aquisim dédié à l‘étude expérimentale<br />
du cycle de l’eau dans le bâtiment et au développement<br />
de nouveaux procédés innovants de traitement,<br />
récupération d’énergie ...<br />
Modernisée et agrandie pour répondre aux enjeux<br />
émergents, la soufflerie Jules Verne est aujourd’hui une<br />
infrastructure scientifique et technique de pointe, unique<br />
par ses équipements innovants et son offre pluridisciplinaire.<br />
Elle est la seule au monde à pouvoir soumettre<br />
divers ouvrages et systèmes, dans les domaines de la<br />
construction, des transports et des énergies nouvelles,<br />
aux phénomènes climatiques, des plus simples aux plus<br />
extrêmes.<br />
Vue du CEA Cesta<br />
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ ><br />
Patrycja Perrin au 01 61 38 96 32, pperrin@aste.asso.fr<br />
Report d’Astelab 2021<br />
« <strong>Essais</strong> et Simulation » à<br />
l’été 2021<br />
Les Journées nationales de l’environnement mécanique<br />
Astelab 2021 « <strong>Essais</strong> et Simulation » se dérouleront<br />
du 30 juin au 2 juillet 2021 au CEA Cesta (Le Barp -<br />
Gironde). Cet événement sera organisé par L’ASTE en<br />
partenariat avec le CEA Cesta et Nafems sur le thème<br />
« <strong>Essais</strong> et Simulation », en rapport avec la prise en<br />
compte de l'environnement mécanique.<br />
62 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
AGENDA<br />
Les 16 et 17 septembre 2020<br />
ANALYSE INDUSTRIELLE<br />
La 32 e édition du salon des solutions en Analyse Industrielle (initialement prévue les 1<br />
et 2 avril ) tiendra finalement les 16 et 17 septembre à Paris - Espace Champerret. Le<br />
salon rassemblera un espace exposition, des conférences techniques et des ateliers.<br />
À Paris - Espace Champerret<br />
www.analyse-industrielle.fr<br />
Les 23 et 24 septembre 2020<br />
RF & MICROWAVE<br />
RF & Microwave, salon entièrement dédié aux secteurs des radiofréquences, des<br />
hyperfréquences, du wireless, de la CEM et de la fibre optique, lancera finalement<br />
sa neuvième édition les 23 et 24 septembre prochain.<br />
À Paris Porte de Versailles<br />
www.microwave-rf.com<br />
Les 13 et 14 octobre 2020<br />
FORUM TERATEC<br />
Évènement majeur en France et en Europe regroupant les meilleurs experts<br />
internationaux de la simulation, du HPC, du Big Data et de l'IA, le Forum Teratec<br />
aura bien lieu cette année, événement ayant été reporté à la mi-octobre.<br />
À l’Ecole Polytechnique (91)<br />
www.teratec.eu<br />
Les 14 et 15 octobre 2020<br />
MESURES SOLUTIONS EXPO<br />
La troisième édition du salon Mesures Solutions Expo2020 se tiendra à la mi-octobre<br />
à Lyon. Ce nouvel événement présentera l'exhaustivité de l'offre de la mesure, de<br />
la recherche à la production, des solutions actuelles aux perspectives futures.<br />
À la Cité des Congrès de Lyon<br />
mesures-solutions-expo.fr<br />
Le 20 novembre 2020<br />
PARIS AIR FORUM<br />
Paris Air Forum aura bien lieu, mais en novembre. Créé en 2014 par le groupe ADP,<br />
La Tribune et Forum Media, le Paris Air Forum réunit une succession de débats,<br />
de conférences et de keynotes.<br />
À la Maison de la Mutualité<br />
evenement.latribune.fr/paris-air-forum/fr<br />
Du 8 au 10 décembre 2020<br />
JOURNÉES COFREND 2020<br />
Le coup d’envoi est lancé pour les Journées Cofrend, qui se tiendront finalement<br />
à Marseille du 8 au 10 décembre prochain. Sous la thématique des « END, voir et<br />
prévoir, gage de qualité et de sécurité », pas moins de 2 500 participants français<br />
et étrangers sont attendus pour cette 10ème édition.<br />
À Marseille (Palais Chanot)<br />
www.cofrend2020.com<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020 I63
INDEX<br />
Au sommaire du prochain numéro :<br />
© ESI Group<br />
DOSSIER<br />
Spécial Automobile et Mobilité<br />
Appareils et instruments d'essai, de simulation<br />
et de mesure vibroacoustique<br />
pour les<br />
essais, la simulation et<br />
la mesure automobile.<br />
ESSAIS ET MODELISATION<br />
• Spécial « rentrée des classes »<br />
Formations continues & développement<br />
de compétences : prestataires et matériel<br />
didactique à l’honneur<br />
• <strong>Essais</strong> et mesures dans l’électronique<br />
Corrosion, fatigue, robustesse,<br />
perturbations...<br />
MESURES<br />
• Spécial Mesure Expo Solutions.<br />
Toutes les technologies de mesure et de métrologie<br />
pour l’industrie, la production et<br />
les essais.<br />
• Focus World Nuclear Exhibition<br />
(WNE) Moyen d’essais / mesure de<br />
choc et sismiques dans le nucléaire.<br />
© EDF<br />
© Cetim Sud Ouest<br />
Liste des entreprises citées et index des annonceurs<br />
AIRBUS................................................................... 56 et 60<br />
AIRBUS SPACE & DEFENSE........................................... 6<br />
ALSTOM............................................................................. 8<br />
ALTAIR ENGINEERING.................................................. 15<br />
ANSYS................................................................ 6, 36 et 52<br />
ARIANEGROUP........................................................ 8 et 39<br />
ASTE..................................................... 11, 27, 41, 61 et 62<br />
BPIFRANCE...................................................................... 8<br />
CLIMATS............................................................................ 6<br />
COFREND............................................................... 20 et 63<br />
COLLÈGE FRANÇAIS DE MÉTROLOGIE.............. 20 et 25<br />
COMSOL...................................17 et 4 e DE COUVERTURE<br />
DAHER............................................................................. 58<br />
DB VIB............................................................................... 4<br />
DEWE FRANCE............................................................... 14<br />
DGA.................................................................................. 46<br />
DJB INSTRUMENTS....................................................... 21<br />
EDF LAB.......................................................................... 42<br />
EIKOSIM.......................................................................... 51<br />
EMITECH......................................................................... 50<br />
ESI GROUP...................................................................... 34<br />
FORUM TERATEC.............................................. 2, 32 et 63<br />
IMT ATLANTIQUE............................................................. 6<br />
INSA LYON...................................................................... 17<br />
IRT ST-EXUPÉRY............................................................. 8<br />
IRT JULES VERNE.......................................................... 58<br />
ISAE-SUPAERO.............................................................. 56<br />
JOURNÉES DE LA MESURE.......................................... 25<br />
KONICA MINOLTA........19, 24,32 et 2 e DE COUVERTURE<br />
M+P INTERNATIONAL................................................... 23<br />
MAYR FRANCE................................................................. 9<br />
MESURES&TESTS......................................................... 19<br />
MESURES SOLUTION EXPO....63 et 3 e DE COUVERTURE<br />
NAFEMS.......................................................................... 11<br />
PARIS AIR FORUM................................................ 54 et 63<br />
RÉSEAU MESURE................................................. 20 et 25<br />
SIMTEC............................................................................ 17<br />
SOCITEC................................................................. 49 et 55<br />
SOGECLAIR..................................................................... 56<br />
SYMETRIE......................................................................... 6<br />
SYMOP............................................................................. 20<br />
SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE (SCS).................. 44<br />
LE CHIFFRE À RETENIR<br />
400<br />
C’est le nombre d’entreprises membres du Gifas, la principale<br />
organisation française des industriels et des acteurs de<br />
l’aéronautique. Ce trimestre, le choix de prendre ce chiffre n’a<br />
pas été pris au hasard puisque si la crise a touché l’ensemble de<br />
l’industrie française, elle n’a en aucun cas épargné l’aéronautique<br />
et mis à genoux l’une des rares filières dans laquelle l’Hexagone<br />
brille autant en Europe internationale. Or, chose est sûre, ce<br />
nombre de 400 entreprises risque fortement de ne plus être<br />
le même dans un an ou deux..<br />
Retrouvez nos anciens numéros sur :<br />
www.essais-simulations.com<br />
64 IESSAIS & SIMULATIONS • N°141 • mai - juin 2020
www.mesures-solutions-expo.fr<br />
MESURES DES LIQUIDES<br />
MESURES PHYSIQUES DES GAZ<br />
CONTRÔLE DE SALLES BLANCHES<br />
MESURES DE QUALITÉ D'AIR<br />
CONTRÔLE DE FUITE<br />
MESURES PHYSIQUES DES GAZ<br />
VÉRIFICATION<br />
MESURES DE VITESSE D’AIR ET D’HUMIDITÉ<br />
ACQUISITION DE DONNÉES<br />
MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE<br />
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE MESURE<br />
DÉBITMÉTRIE<br />
ÉTALONNAGE<br />
MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT<br />
MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE<br />
MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT<br />
MESURES DES LIQUIDES<br />
MÉTROLOGIE<br />
MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE<br />
CONTRÔLE<br />
LE SALON DES SPÉCIALISTES<br />
DE LA MESURE<br />
LES 14 & 15 OCTOBRE 2020<br />
Cité Centre de Congrès Lyon<br />
Halls 4/5/6 - Entrée H<br />
CAPTEURS SOLUTIONS > SUR MESURE > SUPPORT & DÉVELOPPEMENT<br />
50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon Inscription gratuite sur www.mesures-solutions-expo.fr
Des simulations de tests de bruits et<br />
vibrations que vous pouvez voir et entendre !<br />
Visualisation du niveau<br />
de pression acoustique à<br />
l’extérieur de la boîte de<br />
vitesse et des contraintes de<br />
von Mises induites par les<br />
vibrations dans son carter.<br />
L’approche la plus efficace pour réduire le rayonnement<br />
sonore d’une boîte de vitesses consiste à effectuer<br />
une analyse vibro-acoustique pour savoir comment en<br />
améliorer la conception. Les essais de bruits, vibrations<br />
(NVH) sont une partie importante du processus de<br />
conception et peuvent être simulés avec un logiciel<br />
multiphysique.<br />
Le logiciel COMSOL Multiphysics® est utilisé pour<br />
la conception et la simulation des composants et des<br />
procédés dans tous les domaines de l’ingénierie, de la<br />
fabrication et de la recherche. Découvrez comment vous<br />
pouvez l’appliquer pour la modélisation des vibrations et<br />
du bruit des boîtes de vitesses.<br />
comsol.blog/NVH-simulation