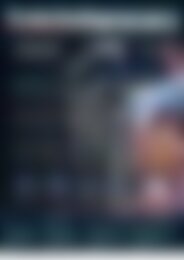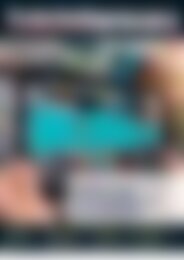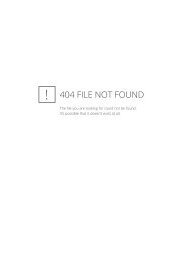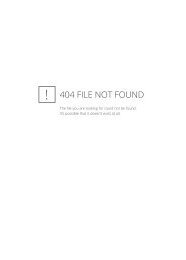Essais & Simulations 143
DOSSIER : Spécial Hydrogène : Au centre de toutes les attentions, la filière se structure !
DOSSIER : Spécial Hydrogène : Au centre de toutes les attentions, la filière se structure !
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DOSSIER 42 28<br />
Spécial<br />
Hydrogène<br />
Au centre de toutes<br />
les attentions, la<br />
filière se structure !<br />
<strong>Essais</strong> et modélisation 7<br />
Des bureaux d’études au cœur de la problématique<br />
de « l’export control »<br />
Mesures 18<br />
Acquisition de données – quelles solutions pour<br />
quelles applications ?<br />
N° <strong>143</strong> • DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 • 20 €
High-End Solutions for Automotive<br />
Displays & Lighting Measurement<br />
www.radiantvisionsystems.eu
ÉDITORIAL<br />
La guerre commerciale – cet<br />
autre front qui s’ajoute à la crise<br />
sanitaire<br />
Qui veut la paix prépare la guerre… Non, je ne suis pas en train d’évoquer<br />
celle déclarée contre le Covid-19 mais de l’autre front qui fait rage depuis<br />
déjà plusieurs années, celle du commerce international. À cette différence<br />
près qu’aujourd’hui celle-ci ne semble plus opposer la Chine aux États-Unis<br />
mais concerne désormais l’Europe.<br />
Olivier Guillon<br />
Rédacteur en chef<br />
Non pas que le Vieux Continent ait été épargné par<br />
les mesures de rétorsions américaines d’un côté, et les<br />
attaques frontales de la Chine sur les brevets de l’autre…<br />
Bien au contraire ; tiraillée entre les deux superpuissances,<br />
l’Europe s’est distinguée par son incapacité à faire entendre<br />
sa voix, perdant tour à tour de juteux marchés tout en<br />
payant des milliards de dollars d’amendes à une Amérique<br />
qui n’a pas attendu l’élection de Trump pour créer l’intelligence<br />
économique (concept né sous JFK) ; et celle<br />
de Joe Biden n’y changera pas grand chose : Washington<br />
continuera à s’attaquer à des entreprises prises entre les<br />
tenailles d’une justice américaine peu aveugle lorsqu’il<br />
s’agit de faire respecter le principe d’extraterritorialité.<br />
« L’élection de Joe<br />
Biden n’y changera pas<br />
grand chose : Washington<br />
continuera à s’attaquer<br />
à des entreprises prises<br />
entre les tenailles d’une<br />
justice américaine peu<br />
aveugle lorsqu’il s’agit de<br />
faire respecter le principe<br />
d’extraterritorialité. »<br />
Mais l’heure de se rebeller est venue. Bruxelles, par la voix<br />
de Margrethe Vestinger, est bien décidée à faire payer le<br />
Gafa. Thierry Breton entend défendre la souveraineté des<br />
données dans la frénésie de la 5G. Quant aux mesures de rétorsion, l’Europe est récemment<br />
parvenue à un accord avec l’OMC, l’autorisant à imposer des amendes allant jusqu’à<br />
4 Md€. Néanmoins, plutôt que d’attendre ces réactions qui ne feront qu’envenimer la<br />
situation, incitons nos entreprises exportatrices à mieux comprendre et respecter les<br />
lois en vigueur… C’est encore la meilleure façon de se défendre !<br />
Olivier Guillon<br />
Envie de réagir ?<br />
@EssaiSimulation<br />
ÉDITEUR<br />
MRJ Informatique<br />
Le Trèfle<br />
22, boulevard Gambetta<br />
92130 Issy-les-Moulineaux<br />
Tel : 01 84 19 38 10<br />
Fax : 01 34 29 61 02<br />
Direction :<br />
Michaël Lévy<br />
Directeur de publication :<br />
Jérémie Roboh<br />
Directeur des rédactions :<br />
Olivier Guillon<br />
o.guillon@mrj-corp.fr<br />
COMMERCIALISATION<br />
RÉALISATION<br />
Publicité :<br />
Conception graphique :<br />
Patrick Barlier<br />
Dolioz - Adeline Docquier<br />
p.barlier@mrj-corp.fr<br />
Maquette, Impression :<br />
Diffusion et Abonnements : Quarante Six<br />
https://digital.mrj-presse.fr/ Parc d'activités Leapark<br />
https://essais-simulations.com/la-revue/ 130, rue Marcel Hartmann,<br />
Emilie Bellenger<br />
94200 Ivry-sur-Seine<br />
abonnement@ essais-simulations.com N°ISSN :<br />
Prix au numéro : 20€<br />
1632 - 4153<br />
Abonnement 1 an France et à N° CPPAP : 1021 T 94043<br />
l’étranger, 4 numéros en version Dépôt légal : à parution<br />
numérique : 60 € TTC<br />
Périodicité : Trimestrielle<br />
Abonnement 1 an version<br />
Numéro : <strong>143</strong><br />
numérique + papier : 85 € TTC<br />
Règlement par chèque bancaire à Date : décembre 2020 - janvier 2021<br />
l’ordre de MRJ<br />
RÉDACTION<br />
Ont collaboré à ce numéro :<br />
Erwan Chapelier (Inpi), Raphaël<br />
Kassab, (AllianTech), Jérôme Lopez<br />
(CFM), Julie Marcheteau (Ellab),<br />
Florent Mathieu (Eikosim), Damien<br />
Pélisson (dBVib Consulting)<br />
Comité de rédaction :<br />
MRJ Presse : Olivier Guillon<br />
ASTE : Alain Bettacchioli (Thales<br />
Alenia Space),<br />
Daniel Leroy (AllianTech),<br />
Yohann Mesmin (Siemens Industry<br />
Software),<br />
Patrycja Perrin (ASTE)<br />
PHOTO DE COUVERTURE :<br />
IStock - MF3d<br />
Toute reproduction, totale ou partielle,<br />
est soumise à l’accord préalable de la<br />
société MRJ.<br />
Partenaires du magazine<br />
<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> :<br />
/Facebook.com/<br />
EssaiSimulation<br />
/@EssaiSimulation<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I3
Crystal Instruments<br />
Distributeur<br />
la France<br />
pour<br />
contact.instrumentation@dbvib.com<br />
www.dbvib-instrumentation.com<br />
ESSAIS<br />
VIBRATOIRES<br />
Spider-81<br />
DERNIÈRE GÉNÉRATION DE SYSTÈME<br />
DE CONTRÔLE POUR POTS VIBRANTS<br />
MODULAIRE ET EVOLUTIF<br />
CONNECTIVITÉ ETHERNET<br />
ESSAIS EN BALAYAGE SINUS<br />
ESSAIS ALÉATOIRES<br />
ESSAIS DE CHOCS<br />
EDITIONS DE RAPPORTS<br />
Contactez-nous au 04 74 16 18 80 pour en savoir plus
SOMMAIRE<br />
MESURES<br />
SPÉCIAL HYDROGÈNE<br />
28<br />
28 - « France Hydrogène portera haut et fort les couleurs de<br />
l’hydrogène en France comme à l’international ! »<br />
32 - « Il n’y aura pas de transition énergétique réussie sans hydrogène »<br />
35 - France Hydrogène signe un accord avec la BEI<br />
36 - Un vent de dynamisme souffle sur la recherche dans l’hydrogène<br />
38 - François Legalland prend la direction du CEA-Liten<br />
39 - Une céramique nanoporeuse pour économiser le platine pour la production d’hydrogène<br />
40 - Dans l’hydrogène, Plastic Omnium vise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros !<br />
42 - Obtenir une cartographie des brevets dans l’hydrogène… en quelques clics !<br />
44 - Des solutions de mesure au service de l’hydrogène décarboné<br />
ACTUALITÉS<br />
ESSAI ET MODÉLISATION<br />
7 Recalage et validation d'une simulation<br />
d'un tableau de bord innovant grâce à<br />
la technologie de corrélation d'images<br />
numériques<br />
©Arkema<br />
©Eikosim<br />
6 Un nouveau syndicat professionnel de<br />
la plasturgie et des composites<br />
6 Le laboratoire AdViTAM souffle ses trois<br />
bougies<br />
6 Le CIM lance son appel à conférences<br />
pour son édition de 2021<br />
6 Ater Métrologie obtient la certification<br />
européenne Certicold Pharma<br />
6 EikoSim rejoint l'alliance des partenaires<br />
d'Altair<br />
©DR<br />
9 Convaincre les industriels de se renforcer<br />
dans l’export control<br />
12 Une solution pour sensibiliser et guider<br />
les industriels à l’export control<br />
14 En pleine crise, Bowen inaugure aux<br />
Ulis un nouveau site de R&D<br />
MESURES<br />
18 Une journée technique dédiée à la<br />
mesure de conformité<br />
20 Les défis des mesures de contraintes<br />
pour les essais vibratoires<br />
23 Un nouveau module pour répondre aux<br />
besoins croissants en bande passante<br />
24 Les données de vibrations<br />
électrodynamiques au cœur de toutes<br />
les attentions<br />
©Ellab<br />
26 Comment sécuriser et optimiser le<br />
stockage des vaccins contre la Covid-19 ?<br />
OUTILS<br />
45 Journée technique ASTE -<br />
CSTB : « Évolution des méthodes<br />
d’appréhension du confort thermique<br />
dans les bâtiments et les habitacles »<br />
46 Formations ASTE<br />
47 Agenda<br />
48 Au sommaire du prochain numéro<br />
48 Index des annonceurs et des<br />
entreprises citées<br />
48 Le chiffre à retenir<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I5
DEWESoft® développe et fabrique des systèmes d’analyse<br />
Vibratoire et Acoustique pour les secteurs de l’industries :<br />
Automobile, Aéronautique, Energie, Automatisme, Production,<br />
Marine et Recherche.<br />
Toutes ces industries ont des éléments (ensembles et sous-ensembles) générant des bruits et<br />
des vibrations (NVH) excessifs.<br />
La norme internationale de communication OPC UA assure l’interopérabilité des<br />
systèmes connectés – (Norme IEC 62541). DEWESoft propose 3 solutions pour raccorder<br />
vos mesures à vos systèmes d’automatisation et de supervision de production :<br />
• DEWESOFT OPC UA SERVER<br />
- SERVEUR OPC, port d’accès congurable.<br />
- PUBLICATIONS DES DONNÉES DEWESOFT<br />
analogique mathématiques, numériques...<br />
• DEWESOFT OPC UA CLIENT<br />
- PROPRIÉTÉS DES MESURES PUBLIÉES nom,<br />
description, valeur actuelle, Offset, mise à<br />
l’échelle, cadence d’acquisition, unité.<br />
- DÉMARRER/ARRÊTER l’ enregistrement.<br />
- VISUALISER le temps de départ, les cadences<br />
d’acquisition.<br />
• DEWESOFT HISTORIAN<br />
- SURVEILLANCE DE VOS ESSAIS gestion,<br />
stockage, visualisation<br />
- ACQUISITION DES DONNÉES et traitements<br />
mathématiques.<br />
- BASE DE DONNÉES organisation, accès aux<br />
mesures, sous-échantillonnage, sauvegardes<br />
- ACCÈS ET AFFICHAGE DES DONNÉES sur le<br />
CLOUD
NOS DOSSIERS EN UN CLIN D’OEIL<br />
© IMV Corporation © DR<br />
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
MESURES<br />
L’export control : l’autre front des<br />
bureaux d’études p. 7 à 175<br />
Cela n’aura échappé à personne : les mesures de rétorsion, en<br />
particulier menées par l’administration américaine contre les<br />
entreprises étrangère (à commencer par les européennes) ne<br />
cessent d’augmenter. Et ce n’est pas la récente élection de Joe<br />
Biden qui ralentira la tendance, d’autant que le Vieux Continent<br />
a – enfin – décidé de se rebiffer. Sans pour autant entrer dans<br />
une confrontation dont on connaît d’avance l’issue malheureuse<br />
pour les PME/PMI/ETI et leurs bureaux d’études, il est toutefois<br />
possible de prendre les devants grâce à une meilleure prise en<br />
compte de l’export control.<br />
Mesures et traitement des données…<br />
Quelles solutions ? p. 18 à 27<br />
Les données de mesure, à commencer par les mesures de vibrations,<br />
sont de plus en plus denses et nombreuses, mais également<br />
toujours plus complexes. Or celles-ci sont en droite ligne avec<br />
les exigences croissantes des laboratoires et des industriels en<br />
matière de qualité et de fiabilité. Afin de rendre ces données de<br />
mesure plus proches du réel et de simplifier leur traitement,<br />
des systèmes d’acquisition existent ; ceux-ci se montrent à la<br />
fois plus performants mais aussi plus simples et plus rapides à<br />
mettre en œuvre.<br />
©Bosch<br />
DOSSIER<br />
Spécial filière hydrogène<br />
p. 28 à 44<br />
Le Plan de relance est certainement l’une des rares bonnes<br />
nouvelles de cette annus horribilis, en particulier pour la filière<br />
hydrogène. Après le manifeste lancé en juillet dernier pour faire<br />
de l’hydrogène une technologie clef, le gouvernement a décidé de<br />
mettre les bouchées doubles, au regard des sommes significatives<br />
annoncées dans les années à venir. Le monde de la recherche,<br />
et notamment au niveau des essais et des moyens de mesure,<br />
est sur le pied de guerre. Le point avec différents acteurs de la<br />
filière et une interview fleuve de Philippe Boucly, le président<br />
de France Hydrogène.<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I7
ACTUALITÉS<br />
EN BREF<br />
Le CIM lance son appel à<br />
conférences pour son édition<br />
de 2021<br />
Le Congrès international de métrologie<br />
2021, qui aura lieu du 28 au 30<br />
septembre à Paris, en partenariat<br />
avec l’exposition Measurement World,<br />
vient de lancer un appel à conférences<br />
sous le signe de la « confiance ».<br />
Celui-ci est ouvert jusqu'au 15 janvier<br />
2021.Pas moins de 200 conférences<br />
seront programmées. En outre, six<br />
tables rondes s’articuleront autour de<br />
trois axes clés : Industrie 4.0, Green<br />
Deal et Santé. ●<br />
Ater Métrologie obtient<br />
la certification européenne<br />
Certicold Pharma<br />
Ater Métrologie peut désormais<br />
réaliser les tests nécessaires<br />
à la délivrance initiale et au<br />
renouvellement du label Certicold<br />
Pharma. Ces tests concernent les<br />
équipements de la chaîne du froid<br />
des produits pharmaceutiques. Il<br />
s’agit par exemple des emballages,<br />
des véhicules frigorifiques ou des<br />
réfrigérateurs et chambres froides. ●<br />
© Arkema<br />
FILIÈRE<br />
Un nouveau syndicat professionnel de<br />
la plasturgie et des composites<br />
Les syndicats interrégionaux<br />
de la plasturgie Allizé-Plasturgie,<br />
Gipco, Plasti Ouest,<br />
de la Fédération de la plasturgie<br />
et des composites et du Groupement<br />
de la plasturgie industrielle et<br />
des composites (GPIC) ont décidé de<br />
créer Polyvia, un syndicat professionnel<br />
opérationnel dès le 31 décembre.<br />
Dirigée par Jean Martin, actuel délégué<br />
général de la Fédération de la plasturgie<br />
et des composites, Polyvia a pour<br />
but d’organiser un syndicat uni sur le<br />
plan national, gouverné par des administrateurs<br />
régionaux.<br />
Les comités régionaux et les comités<br />
de marchés animeront des groupes<br />
de travail pour identifier les problématiques<br />
des entreprises, donner une<br />
vision d’ensemble et mener des actions<br />
sur tous les territoires. Par ailleurs,<br />
Polyvia Formation délivrera une<br />
offre pédagogique renouvelée avec de<br />
nouveaux cursus de formation (Exécutive<br />
Master), une plateforme multimodale<br />
et de la formation à distance. ●<br />
EN SAVOIR PLUS > www.polyvia.fr<br />
LANCEMENT<br />
Le laboratoire AdViTAM souffle ses<br />
trois bougies<br />
EikoSim rejoint l'alliance des<br />
partenaires d'Altair<br />
L’éditeur francilien de solutions<br />
logicielles a annoncé devenir<br />
membre de l’Altair Partner Alliance<br />
(APA) afin de fournir ses outils<br />
d'analyse d'images et de validation<br />
de simulation aux clients du logiciel<br />
de simulation Altair. Ce partenariat<br />
est né suite aux efforts d'EikoSim<br />
pour développer la compatibilité<br />
entre son logiciel EikoTwin et la<br />
suite de simulation d'Altair, donnant<br />
ainsi aux clients d'Altair l'accès à<br />
des données de validation plein<br />
champ.●<br />
Le laboratoire commun AdVi-<br />
TAM (Insa Lyon/Avnir<br />
Engineering) vient de célébrer<br />
ses trois premières années<br />
d’existence. Un anniversaire marqué par<br />
la soutenance de thèse d’Yvon Briend,<br />
doctorant du LabCom, le 18 septembre<br />
dernier à l’Insa de Lyon.<br />
Après avoir reçu du programme<br />
Labcom ANR-PME un financement<br />
pour ses trois premières années d’existence,<br />
AdViTAM entre aujourd’hui<br />
dans une phase de consolidation, de<br />
pérennisation et de valorisation des<br />
travaux. AdViTAM allie Avnir Engineering,<br />
entreprise spécialisée dans la<br />
conduite des essais pilotés pour les<br />
domaines de l’aéronautique-spatial-défense,<br />
et le LaMCoS.<br />
Excitateur 6-axes de l'Equipex<br />
Phare hébergé au LaMCoS<br />
Ainsi, ce laboratoire dispose d’une<br />
grande expertise dans le domaine de<br />
la dynamique des machines. En outre,<br />
il possède un excitateur hydraulique 6<br />
axes ; celui-ci offre une force de 62kN<br />
en dynamique sur une plage fréquentielle<br />
de 0 à 250Hz. ●.<br />
EN SAVOIR PLUS ><br />
www. avnir-engineering.com<br />
8 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
AVIS D’EXPERT<br />
Recalage et validation d'une simulation d'un<br />
tableau de bord innovant grâce à la technologie de<br />
corrélation d'images numériques<br />
Dans une démarche d’innovation nécessaire en automobile, il est nécessaire pour Faurecia<br />
d’effectuer des simulations réalistes afin de prévoir le comportement de ses pièces innovantes.<br />
Exemple avec les opérations d’essais et de simulations portant sur le tableau de bord, dont<br />
l’optimisation repose notamment sur les moyens de corrélation d’images.<br />
Pour Faurecia, les opérations de simulation doivent<br />
à la fois reproduire fidèlement la géométrie et le<br />
comportement mécanique de la pièce sollicitée,<br />
mais leur validation nécessite également de bien<br />
reproduire les conditions aux limites réellement vécues par<br />
la pièce d’essai. Dans cet article, nous nous intéressons en<br />
particulier au comportement d’un tableau de bord lors de<br />
sollicitation mécanique en compression. Faurecia cherche à<br />
améliorer la prédiction en identifiant des conditions limites<br />
anormales, comme un contact non modélisé par exemple<br />
et/ou un écart sur le positionnement de l’indenteur.<br />
MÉTHODE<br />
La corrélation d’images numériques basée sur la méthode<br />
globale (Dubreuil 2016) répond à la problématique en<br />
permettant de mesurer un champ de déplacement défini<br />
directement dans le repère et sur les nœuds du maillage de<br />
simulation. Le but de l’essai considéré est de déterminer la<br />
réponse mécanique d’ensemble du tableau de bord lorsque<br />
l’utilisateur appuie sur l’un des 13 points visés. Lors de l’essai,<br />
l’action de l’utilisateur sur le tableau de bord est approximée<br />
par l’application d’une force de compression verticale de<br />
10N. Pour ce niveau d’effort, la déformation d’ensemble de<br />
la pièce reste faible, ce qui constitue un des enjeux de l’essai<br />
pour les technologies de mesure mises en œuvre.<br />
Afin de procéder à la mesure par corrélation d’images, on<br />
réalise un mouchetis sur la pièce à tester à l’aide de bombes<br />
de peinture. L’apposition d’une texture à la pièce est nécessaire<br />
au suivi de la surface par les caméras, et par la suite à<br />
la mesure des champs de déplacements expérimentaux. Une<br />
fois la pièce peinte, elle est positionnée sur un bâti rigide en<br />
aluminium et positionnée sous un indenteur qui appliquera<br />
un effort linéaire de 0 à 10N sur chacun des 13 points retenus<br />
pour l’étude. Le suivi de déplacement en surface de la<br />
Mise en place de l’essai de corrélation d’images numériques et jeu<br />
d’images pris sur une configuration<br />
pièce est assuré par une paire de caméras qui acquiert les<br />
images de l’essai, de façon à obtenir 60 paires d’images pour<br />
chaque montée en charge (Figure 2).<br />
Les 13 jeux d’images sont ensuite post-traités à l’aide du logiciel<br />
EikoTwin DIC afin de mesurer l’évolution des déplacements<br />
en surface de la pièce, pour chacun des points de<br />
chargement. Une des spécificités de ce logiciel développé par<br />
EikoSim est d’utiliser la connaissance préalable de la géométrie<br />
de la pièce (fournie au travers du maillage éléments<br />
finis) afin d’étalonner le système de caméras. Cette méthode<br />
permet à la fois de s’affranchir de l’utilisation de mires<br />
d’étalonnage, et de faire directement le lien entre repère de<br />
mesure et repère du modèle éléments finis. Ainsi, les champs<br />
de déplacements seront directement exprimés aux nœuds<br />
du maillage de calcul, que l’on peut directement visualiser<br />
sur les repères images.<br />
RÉSULTATS<br />
Grâce à la corrélation d’images numériques, les déplacements<br />
en chaque nœud du maillage sont mesurés, comme<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I9
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Déplacements normaux calculés pour le point d’application n°8,<br />
visualisation maillage<br />
le montre la Figure 2 pour une charge de 10N sur le point<br />
d’application n°8.<br />
On retrouve bien une localisation du déplacement maximal<br />
juste sous l’indenteur, au point d’application de l’effort.<br />
Le gradient de déplacement normal observé se retrouve<br />
pour les 13 points d’applications testés. On notera que l’information<br />
obtenue grâce au traitement par corrélation<br />
d’images est bien plus riche que celle qu’auraient pu fournir<br />
des jauges de déformation par exemple, dans la même<br />
configuration. À titre d’illustration, pour chacun des essais<br />
réalisés, la CIN fournit 6000 mesures de déplacements 3D,<br />
pour chacune des images considérées. L’intérêt de la mesure<br />
de champ est bien ici de permettre le recalage du modèle<br />
éléments finis sur toute la zone d’intérêt, et non seulement<br />
sur un ensemble fini de capteurs ponctuels.<br />
Champ de déplacements normaux à 10N issu de la corrélation<br />
d’images (à gauche) et de la simulation (à droite)<br />
Il demeure possible d’extraire des résultats ponctuels de<br />
la mesure de champ à l’aide de capteurs de déplacements<br />
virtuels positionnés sur le maillage (Figure 3). Cela permet<br />
d’afficher rapidement les déplacements de points caractéristiques<br />
d’intérêt de la pièce dans le temps.<br />
L’intérêt principal demeure la comparaison de champs.<br />
Celle-ci est réalisée par l’export des résultats au format<br />
hwascii, afin de permettre une comparaison rapide avec<br />
les résultats de simulation dans la suite Hyperworks, utilisée<br />
par Faurecia dans le cadre de cette étude (Figure 4).<br />
Cette mise en vis-à-vis des champs de résultats expérimentaux<br />
et simulés permet de vérifier que la simulation<br />
était bien prédictive pour l’essai considéré. On vérifie ici<br />
que l’application d’un effort de 10N produit un déplacement<br />
autour du point d’application de l’effort dans une<br />
zone de la bonne dimension. Ceci permet de valider que<br />
la loi de comportement employée dans le modèle éléments<br />
finis pour décrire le comportement du tableau de bord<br />
permet une estimation très satisfaisante du champ expérimental<br />
mesuré en termes d’amplitude. La forme du champ<br />
près de l’indenteur en particulier est très bien anticipée<br />
par le calcul. Loin de l’indenteur en revanche des écarts<br />
plus importants (mais très largement sous l’incertitude de<br />
mesure) sont mis en évidence.<br />
La comparaison des résultats réalisée directement dans le<br />
repère de la simulation amène un second point d’amélioration<br />
potentiel : si les points d’application de l’effort sont<br />
reportés avec précision sur la pièce par le biais de pastille, le<br />
positionnement de la pièce sous l’indenteur se fait manuellement,<br />
ce qui peut introduire un écart entre le point d’application<br />
théorique de l’effort et le point d’application réel.<br />
Le traitement des champs expérimentaux fourni par la CIN<br />
permet de retrouver le point d’application réel de l’effort,<br />
et donc de mettre à jour la simulation afin d’appliquer l’effort<br />
au plus près de la réalité du terrain. Ainsi, on enlève<br />
une partie de l’incertitude liée à l’application des conditions<br />
aux limites dans le calcul comme source d’erreur dans<br />
l’interprétation de la comparaison. Ceci peut être automatisé<br />
pour l’ensemble des points d’appuis d’effort testés. ●<br />
Capteurs de déplacements sur le logiciel EikoTwin DIC et résultats<br />
des différents capteurs en fonction du temps<br />
Dubreuil L., et al. "Mesh-based shape measurements<br />
with stereocorrelation." Experimental Mechanics 56.7<br />
(2016): 1231-1242.<br />
10 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
ANALYSE<br />
Convaincre les industriels<br />
de se renforcer dans l’export control<br />
La recrudescence des infractions entre clients, fournisseurs et leurs autorités de tutelle est<br />
au cœur des relations import-export et représente un danger croissant pour toute entreprise<br />
souhaitant exporter, en particulier des produits d’origine US. Or dans le domaine de l’export<br />
control, les entreprises françaises ne sont pas prêtes alors même qu’elles risquent gros,<br />
allant jusqu’à des sanctions pénales et à des arrangements très coûteux.<br />
Toute entreprise qui désire exporter doit s’informer en permanence<br />
des législations en cours<br />
C’est une de ces affaires qui glacent le sang. Un fait<br />
divers qui prend des allures extrêmes, à la manière<br />
d’un thriller américain ou d’un roman d’espionnage.<br />
Le 15 avril 2013, Frédéric Pierucci, ancien dirigeant<br />
de la division Chaudières d’Alstom, est arrêté par les agents<br />
du FBI à l’aéroport JFK. Il est ensuite transféré, menottes aux<br />
poignets, au siège du FBI à Manhattan devant un procureur<br />
qui l’envoie directement en prison de haute sécurité à New<br />
York où il séjournera 14 mois avant de rempiler pour 16 mois<br />
de cellule. Ce n’est qu’en 2015 qu’il sera définitivement libéré,<br />
période qui coïncide avec le rachat par l’Américain GE du pôle<br />
Énergie d’Alstom qui produit des turbines destinées aux activités<br />
nucléaires, comme il le détaille dans un entretien accordé<br />
au site Thinkerview intitulé « Alstom : la France vendue à la<br />
découpe ? » 1 .<br />
Ce scénario noir paraît certes particulièrement extrême. Pourtant,<br />
il n’est qu’un exemple parmi les multiples condamnations<br />
1. (https://www.youtube.com/watch?v=dejeVuL9-7c)<br />
dues aux mesures de rétorsion imposées par les États-Unis au<br />
nom du principe d’extraterritorialité de la loi américaine en<br />
dehors de ses frontières. Il est surtout l’image des redoutables<br />
méthodes employées par l’administration de Washington, et<br />
tout particulièrement depuis la présidence de Barack Obama.<br />
Son successeur Donald Trump lui donnant depuis 2016 des<br />
allures de guerre commerciale ouverte contre la Chine et bien<br />
d’autres pays mentionnés dans une espèce de « black-list » régulièrement<br />
mise à jour, et dont les conséquences n’épargnent en<br />
rien l’Europe.<br />
DE PLUS EN PLUS DE SOCIÉTÉS IMPACTÉES PAR<br />
L’OBLIGATION DE CONFORMITÉ À L’EXPORT CONTROL<br />
Mais au-delà des pays dans le viseur de l’administration américaine<br />
apparaît une réglementation beaucoup plus officielle à<br />
laquelle chaque entreprise qui désire exporter doit se conformer.<br />
Très composite, cette réglementation diffère d’un pays à l’autre.<br />
Elle concerne d’une part le pays d’origine, la zone d’échange et<br />
le pays de livraison. En d’autres termes, une entreprise française<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I11
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Chez Airbus, on a depuis longtemps pris<br />
au sérieux la question de l’export control<br />
souhaitant exporter doit être conforme avec la législation en<br />
vigueur en France, dans l’Union européenne, aux USA et dans<br />
l’État où elle compte vendre son produit. Et si cette législation<br />
s’applique à toutes les entreprises, les condamnations aussi, y<br />
compris en cas de non-conformité avec ce que l’on appelle l’export<br />
control. « Nous avons pris conscience que de nombreuses<br />
sociétés sont de plus en plus impactées par cette obligation de<br />
conformité à l’export control », souligne Marc Zarnowiecki,<br />
fondateur de la société EC Compliance.<br />
Ce spécialiste de la question chez Airbus, chargé en 2019 de<br />
moderniser et de simplifier l’export control à travers un logiciel,<br />
sait de quoi il parle, tout comme de l’extraterritorialité<br />
américaine d’ailleurs. Il sait aussi que ces exigences de la part<br />
de l’administration de Washington à l’égard des produits étrangers<br />
sont loin de concerner uniquement les grands groupes.<br />
En effet, de plus en plus d’entreprises de taille moyenne sont<br />
toutes aussi impactées. Pour lui, cette notion est floue pour de<br />
nombreux chefs d’entreprise, d’autant que la loi change souvent<br />
et les textes de loi s’accumulent au point que, pour une PME,<br />
se tenir à jour est devenu presque impossible. Pourtant, « il est<br />
important de démystifier l’export control. Mais pour cela, nous<br />
avons besoin de traduire les règles complexes et de les transposer<br />
à l’industrie ; c’est là que nous intervenons avec notre solution 2 ».<br />
Il faut dire qu’avant même d’exporter, l’entreprise doit être en<br />
conformité avec deux organes de tutelle que sont le Ministère<br />
de la Défense avec la DGA, et le ministère de l’Économie<br />
avec le Service des biens à double usage (SBDU) qui exigent<br />
déjà des entreprises – et les autorités les rappellent à l’ordre à<br />
l’occasion – de bien respecter la législation en vigueur. De la<br />
même manière, dans le domaine de l’aéronautique, des organismes<br />
tels que le Gifas, le Gican et le Gicat se réunissent déjà<br />
pour mutualiser les efforts et faire de la formation auprès de<br />
leurs membres. « Nous avons besoin d’anticiper et d’être prêts car<br />
dans le cas contraire, la sanction peut faire très mal », renchérit<br />
Frank Prabel, ingénieur centralien et ancien d’Apple. Sur fond<br />
de guerre commerciale, qui n’a cessé de prendre de l’ampleur<br />
depuis l’élection de Donald Trump, les sanctions se multiplient<br />
dès que des transactions en dollars ont lieu avec des pays sous<br />
embargo mais aussi à propos de produits dits sensibles, c’està-dire<br />
à vocation militaire ou double usage.<br />
DANS CETTE MONTÉE EN PUISSANCE DE L’EXPORT<br />
CONTROL, LES ENTREPRISES FRANÇAISES NE SONT<br />
PAS PRÊTES<br />
En matière d’export control, les deux dirigeants d’EC<br />
Compliance insistent sur le fait que si les entreprises aujourd’hui<br />
comprennent le danger, elles sont loin de le maîtriser. Pour<br />
Daniel Leroy, président de l’ASTE et dirigeant d’Alliantech,<br />
une entreprise qui importe et intègre des capteurs et composants<br />
électroniques pour des capteurs intelligents, « les entreprises<br />
qui travaillent avec le secteur de la défense doivent bien<br />
connaitre le cadre légal américain (et européen). C’est le cas par<br />
exemple de produits électroniques conçus en France, utilisant<br />
des technologies US ou israéliennes à double usage mais qui ont<br />
eu "le malheur" d’aboutir en Chine sans licence d’exportation ».<br />
Pour Marc Zarnowiecki, si l’Europe s’est toujours montrée<br />
2. Voir article page suivante<br />
Pour les PME comme les grands comptes, l’export control est au<br />
cœur de toutes les préoccupations (site Orange de Lacroix)<br />
12 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
La défense, le naval et l’aéronautique ne sont pas les seuls en<br />
ligne de mire des autorités américaines ; l’électronique aussi<br />
©Heskita<br />
fragile – pour ne pas dire naïve – dans les échanges commerciaux<br />
internationaux, « la France accuse un retard par rapport<br />
à l’Allemagne ou encore la Grande-Bretagne, dont les entreprises<br />
sont beaucoup plus sensibilisées car leurs autorités de tutelle se<br />
montrent plus vigilantes et sanctionnent plus facilement en cas<br />
de non-conformité. Les entreprises allemandes sont plus grandes<br />
et mieux structurées en la matière ; elles embauchent de plus en<br />
plus de personnes spécialisées à temps plein dans le droit lié aux<br />
exportations. Quant aux britanniques, ils sont mieux préparés<br />
et ont bien compris qu’il était essentiel pour eux de faire de l’export<br />
control une arme concurrentielle ».<br />
En France au contraire, il semble que la sous-direction du<br />
Contrôle des exportions de la DGA manque de moyens pour<br />
mettre en œuvre la conformité exigée. La connaissance des<br />
réglementations est mal maitrisée et n’est pas mise en valeur ; or<br />
c’est bel et bien l’information qui se trouve être le nerf de cette<br />
guerre aussi commerciale que juridique… pour autant, l’ancien<br />
ingénieur de Apple et expert en modélisation des réglementations<br />
précise qu’il vaut mieux pour une entreprise défaillante<br />
aux yeux de la justice américaine montrer qu’elle a préalablement<br />
entamé des démarches de compliance en matière d’export<br />
control : « dans ce cas, et dans ce cas seulement, le juge statuera<br />
sur une sanction moins sévère et cherchera à faire progresser l’entreprise<br />
mise en cause. Si la justice constate au contraire que l’entreprise<br />
n’a entrepris aucune démarche, elle sera impitoyable ».<br />
À bon entendeur… ●<br />
Olivier Guillon<br />
125x190<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I13
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
TECHNOLOGIE<br />
Une solution pour sensibiliser et guider<br />
les industriels à l’export control<br />
Afin d’aider les entreprises françaises dans leurs démarches de contrôle export et de se conformer<br />
aux réglementations en vigueur, deux spécialistes ont décidé de créer EC Compliance, une solution<br />
logicielle développée avec Airbus chargée d’accompagner et de guider les industriels étape par étape.<br />
© DR<br />
Frank Prabel<br />
Associé et directeur technique de la société<br />
Export Control Compliance (EC Compliance)<br />
Ingénieur de l'École Centrale de Paris,<br />
Frank Prabel apporte son expérience dans le<br />
développement de solutions logicielles acquise<br />
dans des grands groupes informatiques tels<br />
qu’Apple (où il travaillé pendant trois ans au<br />
siège, à Cupertino), la start-up – et première<br />
société française cotée au Nasdaq – Business<br />
Objects ainsi qu’à la R&D de l’éditeur SAP<br />
en tant que product manager.<br />
Face à la recrudescence des procès à l’encontre des entreprises<br />
européennes et françaises, petites ou grandes, en<br />
particulier lorsqu’elles souhaitent exporter aux États-<br />
Unis, deux hommes, Marc Zarnowiecki et Frank<br />
Prabel, ont décidé de prendre les choses en main. Le point de<br />
départ : un rapport datant du 26 juin 2019 1 rédigé par le député<br />
1. « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos<br />
entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale »<br />
Spécialiste Export Control chez Airbus et<br />
président de la société EC Compliance<br />
Militaire de carrière dans l’aéronautique<br />
pendant près de quinze ans, Marc Zarnowiecki<br />
rejoint en 2002 le groupe Airbus Helicopters à<br />
l’export control dont il devient le coordinateur.<br />
En 2010, il prend la responsabilité de cette<br />
cellule qu’il dirige jusqu’en 2019 avant<br />
de développer, dans le cadre d’un projet<br />
d’amélioration, de modernisation, de simplification et de digitalisation<br />
de l’export control, un logiciel d’export control commercialisé par<br />
la société Export Control Compliance (EC Compliance).<br />
© DR<br />
Marc Zarnowiecki<br />
Raphaël Gauvain sur le principe d’extraterritorialité imposé par<br />
le gouvernement américain depuis plusieurs années.<br />
Mais ce rapport n’est pas le seul à être à l’origine de la création<br />
de la société EC Compliance et de sa solution logicielle<br />
de classement et d'export control. En effet, l’expérience de l’un<br />
dans l’aéronautique et dans le domaine de l’Export Control<br />
chez Airbus, et le parcours de l’autre pendant plusieurs années<br />
outre-Atlantique dans des entreprises informatiques de renommée<br />
mondiale, leur ont permis de constater le retard des entre-<br />
14 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
prises françaises en matière de mise en conformité vis-à-vis des<br />
nombreuses lois en matière de contrôle des exportations. C’est<br />
pourquoi la société EC Compliance édite aujourd’hui logiciel<br />
visant à guider pas à pas, étape par étape, les entreprises afin<br />
de bien se conformer au droit et la législation en vigueur…<br />
et ainsi éviter les risques de sanctions financières et pénales.<br />
LE RISQUE CONTRÔLE EXPORT SOUS-ÉVALUÉE PAR<br />
LES ENTREPRISES FRANÇAISES<br />
« Il est essentiel de traduire les règles et les textes de loi à la fois<br />
complexes et indigestes puis de les transposer dans un langage<br />
industriel, souligne Frank Prabel. Et c’est là que nous intervenons<br />
». Il faut dire que les règles sont à la fois nombreuses et<br />
compliquées. Celles-ci sont applicables en France mais également<br />
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne<br />
etc. Cette superposition des règles complique d’autant plus<br />
les démarches de mise en conformité vis-à-vis de l’export. «<br />
Il est donc essentiel pour une entreprise de savoir décortiquer<br />
cette nébuleuse de textes et d’avancer étape par étape, chacune<br />
étant validée par un "feu vert", ajoute Marc Zarnowiecki. C’est<br />
là que nous avons eu l’idée d’un feu tricolore associé à une définition<br />
intuitive. Le but étant de simplifier et de vulgariser pour<br />
comprendre facilement et savoir si l’on est conforme ou non ».<br />
Le logiciel EC Compliance répartit l’export control en différents<br />
modules et étapes. La première concerne le classement (le plus<br />
souvent à travers des listes) ; chaque pays possédant son propre<br />
classement, l’outil propose un moteur permettant de déterminer<br />
le bon classement par rapport à son produit. Ensuite,<br />
l’étape de « l’exportabilité » est notamment soumise aux règles<br />
relatives aux pays sous embargo et pays « sensibles » et plus<br />
globalement à la situation géopolitique. Vient ensuite la troisième<br />
étape, celle du screening des destinataires qui pourraient<br />
figurer sur une « blacklist ». « Le logiciel analyse les entités et<br />
les individus destinataires et les "matche" avec des centaines de<br />
listes mises à jour quotidiennement ». La quatrième étape porte<br />
sur le Licence Management, c’est-à-dire la gestion des licences.<br />
Enfin, viennent l’archivage et le reporting ; cette dernière étape<br />
est importante puisque c’est elle qui permet de répertorier toutes<br />
les preuves et d’en présenter l’historique en cas de contrôle des<br />
autorités judiciaires.<br />
UNE INTERFACE INTUITIVE, SIMPLE ET FIABLE<br />
EC Compliance permet à l’utilisateur de disposer d’un outil<br />
permettant de simplifier les tâches et de gagner en productivité<br />
(c’est-à-dire en temps et en efficacité), le tout avec un maximum<br />
d’exactitude : « cette fiabilité s’explique par une mise à jour quotidienne<br />
des informations » précise Frank Prabel. Plus concrètement,<br />
le logiciel se compose de plusieurs modules permettant de<br />
modéliser et de digitaliser les réglementations. Aussi, la fonction<br />
« Crawlers » lit et répertorie les textes règlementaires afin d’automatiser<br />
la mise à jour des textes de lois ; celles-ci sont alors<br />
centralisées au sein d’un référentiel unique. Outre l’interface<br />
intuitive du logiciel, l’autre point fort de cet outil réside dans<br />
son approche duale (produits civils/militaires, secteur privé/<br />
public, Minarm...). « Le logiciel est doté d’un puissant moteur<br />
de recherche permettant de retrouver rapidement le classement<br />
de tel ou tel produit », confirme cet ingénieur informaticien.<br />
Incubé au sein du Bizlab du groupe Airbus, ce projet de logiciel<br />
est toujours en cours de développement mais déjà la version V.0<br />
a été présentée à plusieurs clients et validée. « Les retours sont<br />
concluants et une "version 1" sera commercialisée d’ici la fin du<br />
premier trimestre 2021, dévoile Frank Prabel. Pour l’heure, les<br />
premiers prospects se situent pour l’essentiel dans l’aéronautique ;<br />
il s’agit de grands groupes mais pas seulement, puisque certaines<br />
PME sont également intéressées, en particulier pour le sujet de<br />
l’export control ». EC Compliance entend aussi s’adresser aux<br />
entreprises de la défense et de l’électronique, secteurs particulièrement<br />
sensibles aujourd’hui, sans oublier les produits hightech<br />
dans l’industrie civile comme l’automobile. ●<br />
Olivier Guillon<br />
EN SAVOIR PLUS >www.ec-compliance.com<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I15
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
REPORTAGE<br />
En pleine crise<br />
Bowen inaugure aux Ulis un<br />
nouveau site de R&D<br />
Cette ETI d'une centaine de salariés spécialisée dans les<br />
solutions électroniques et embarquées pour la défense<br />
et le naval – notamment - a présenté le 8 octobre dernier<br />
aux Ulis (Essonne) son nouveau site de 3 000 m² destinés<br />
aux activités de R&D. Le groupe a ouvert les portes de son<br />
bureau d’études, dévoilant quelque peu sa stratégie pour<br />
les années à venir.<br />
Lors d’une visite au sein d’un des<br />
laboratoires de développements de<br />
produits, le plus souvent pour les<br />
industriels ou exploitants d’énergie<br />
Le spécialiste francilien de la<br />
conception et la production de<br />
solutions industrielles complètes<br />
et sur-mesure de surveillance, de<br />
détection et de télécommunications dans<br />
le domaine de la défense, du transport<br />
et de la sécurité, n'a pas attendu de fêter<br />
son 100e anniversaire, encore moins la<br />
fin de la crise sanitaire, pour ouvrir son<br />
nouveau site destiné à regrouper ses activités<br />
de développement et d'industrialisation.<br />
« Cet investissement s'inscrit dans<br />
une volonté forte du groupe de développer<br />
notre activité et de consolider notre place<br />
de partenaire global pour les donneurs<br />
d'ordres, a rappelé le pdg de l'entreprise au<br />
10M€ de chiffre d’affaires, Juvelino Da Silva<br />
au moment de l'inauguration en présence<br />
de nombreux institutionnels et industriels,<br />
de l'aéronautique notamment. Nous bénéficions<br />
d'un écosystème très performant qui<br />
nous permettra de nous renforcer dans les<br />
années à venir. Ce bâtiment a été entièrement<br />
reconfiguré pour permettre le partage,<br />
la mise en commun de connaissances avec<br />
nos partenaires et clients pour relever de<br />
nouveaux défis. ».<br />
Objectif de ce nouveau site de 3 000 m²,<br />
accueillir collaborateurs, partenaires,<br />
16 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
renouvellement en raison de la hausse des besoins en innovation<br />
pour répondre aux enjeux de miniaturisation, d’intelligence<br />
artificielle et d’optimisation énergétique... Enfin,<br />
la forte concurrence appliquée de guerre des compétences<br />
à la fois multiples et rares ; c’est la raison pour laquelle il<br />
est essentiel de rassembler des chercheurs et des ingénieurs<br />
aux compétences et aux cultures différentes pour les faire se<br />
rencontrer et discuter entre eux. »<br />
RÉUNIR EN UN SEUL ET MÊME LIEU DES<br />
COMPÉTENCES MULTIPLES, DU TECHNICIEN AU<br />
CHERCHEUR<br />
Vue extérieure du nouveau centre de R&D aux Ulis<br />
laboratoires et clients. Mais surtout, comme l'a souligné<br />
lors de la visite Jean-Pierre Devaux, directeur du développement,<br />
« les collaborateurs pourront mettre en commun<br />
leurs compétences afin de développer une synergie, nécessaire<br />
à la croissance de l'activité. Ainsi, le nouveau bureau<br />
d'études rassemblera les différents acteurs de la phase projet,<br />
depuis le laboratoire d'essais à la production ». Le but étant<br />
de réduire au maximum le cycle de conception, « sans<br />
compromis sur la qualité, la fiabilité et la sécurité », insistet-on<br />
au sein de l'entreprise qui n'a pas hésité à investir<br />
massivement et régulièrement, soit près de 5M€ ces trois<br />
dernières années. Cette nouvelle implantation, qui s'inscrit<br />
dans une forte volonté de développement avec une vision<br />
long terme, permettra également l'embauche de dix ingénieurs<br />
d'ici 2022.<br />
Bowen s'est construit autour des acquisitions des activités<br />
de Pekly, Erte, EADS-Nuclétudes et Jacquelot ; ces<br />
différentes entités réunissent l'ensemble des technologies<br />
indispensables à la réalisation d'équipements radars et<br />
télécommunications complexes tels que les amplificateurs<br />
RF, le traitement de signal et l’électronique numérique.<br />
Capable de réaliser des solutions industrielles complètes<br />
de surveillance, de détection et de télécommunications<br />
pour les systémiers, Bowen investit chaque année 15% de<br />
son chiffre d'affaires en Recherche & Développement. Une<br />
nécessité selon Jean-Pierre Devaux qui précise que « le<br />
marché des radiofréquence et multi-domaines : il concerne à<br />
la fois le navale avec les bateaux et les sous-marins, la santé<br />
ou encore la défense. Mais ce marché est également en plein<br />
Implanté sur une surface de 3 000 m² (contre seulement<br />
1 000 m² à Saclay), le nouveau site des Ulis sera consacré<br />
à la recherche et au développement de nouvelles solutions<br />
d'équipements radars et télécommunications complexes<br />
radiofréquences destinées à la surveillance, la détection<br />
ou la transmission d'information. Ces solutions radiofréquences<br />
s'adaptent à tout type d’environnement permettant<br />
ainsi de générer, traiter et transmettre l'information<br />
à haut débit.<br />
La visite démarre à l’étage sur un imposant plateau réunissant<br />
entre vingt et vingt-cinq personnes. L’objectif de ce<br />
bureau d’études techniques est de bâtir les offres, de mener<br />
des travaux de recherche et de concevoir des produits technologiques<br />
pour ensuite les confronter à la réalité dans<br />
les halles d’essais. « Tout commence à partir de l’identification<br />
d’un besoin puis d’une architecture système répondant<br />
à un cahier des charges composé de quatre blocs : l’antenne<br />
(conception, choix d’architecture, mise en réseau, modélisation<br />
3D et corrélation des résultats de simulation et<br />
de mesure...), la chaîne de radiofréquence (simulation et<br />
maquettage numérique 3D), la plateforme numérique et le<br />
processeur de traitement de signal », explique Massinissa<br />
Hadjloum, ingénieur d'études chez Bowen.<br />
POUR BOWEN, LA PROXIMITÉ DES PARTENAIRES<br />
GARANTE DE LA QUALITÉ<br />
Le bureau d’études a pour mission de mener un projet de<br />
A à Z en jouant à la fois sur les problématiques techniques,<br />
les délais, les contraintes financières et diverses comme<br />
la gestion des risques ou la traçabilité. Pour ce faire, de<br />
direction des projets menée par Thomas Da Silva, ancien<br />
membre de la société EADS-Nuclétudes, s’articule en trois<br />
pôles : Étude & Conception, Projet et Gestion. Le premier<br />
d’entre eux, Étude & Conception, s’appuie sur des savoirfaire<br />
multiples, tant en mécanique qu’en électronique, en<br />
matière d’intégration et d’industrialisation. Ici, tout est<br />
modélisé et conçu en 3D puis simulé afin d’obtenir des<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I17
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
© Mathilde Beaugé<br />
Pour l’occasion, le nouveau site de Bowen<br />
s’est équipé d’une chambre anéchoïque pour<br />
mener des tests d’antennes prototypes<br />
études mécaniques et électroniques avant d’entamer les<br />
étapes de conception, de développement et d’industrialisation.<br />
Enfin vient la phase d’essai.<br />
Le pôle gestion est quant à lui destiné à faire en sorte que<br />
l’information circule partout sur le site tout en garantissant<br />
une confidentialité maximale. Il en est de même pour<br />
la qualité : « on exige de nous d’être conformes et que les<br />
composants le soient aussi, souligne Thomas Da Silva. Nous<br />
respectons déjà les certifications C.E. et Reach. Quant au<br />
domaine de l’export contrôle, nous maîtrisons cette question<br />
en particulier depuis le rachat depuis 2010 de EADS-Nuclétudes<br />
dans la mesure où l’entreprise est experte dans le<br />
domaine et maîtrise cette question. Mais ce qui fait aussi<br />
notre force, c’est que Bowen travaille avec une majorité de<br />
partenaires que nous connaissons bien, situés dans un rayon<br />
de 100 km. Au total, 90% de partenaires sont présents sur<br />
le territoire français. »<br />
FOISON DE PROJETS EN COURS POUR UNE<br />
DIVERSIFICATION ASSUMÉE<br />
Le département R&D est équipé d'une chambre anéchoïque<br />
afin de mener des tests d’antennes prototypes. Si le site de<br />
Trappes est déjà doté d’une pièce similaire pour la production,<br />
celle des Ulis est quant à elle dédiée au développement.<br />
Faute de place, les essais en environnement tels que<br />
les tests de vibration, les essais thermiques ou en environnement<br />
salin ne sont pas menés ici. Pour autant, ce ne<br />
sont pas les projets qui manquent aux Ulis, qu’il s’agisse<br />
de Neptune (un capteur de radar actif de faible puissance,<br />
initialement lancé par la DGA puis repris par Bowen),<br />
Tweether (destiné de relier le réseau optique haut débit<br />
à des émetteurs radiofréquences en liaison point à point<br />
pour couvrir les zones banches) ou de Llyr (radar passif<br />
et discret pour la détection des drones). Autre projet en<br />
cours : un capteur de détection de décharges partielles<br />
destiné à protéger les lignes et les transformateurs très<br />
haute tension.<br />
Certes, le groupe Bowen s'appuie sur une maîtrise totale<br />
de la chaîne industrielle, mais également sur un réseau<br />
de partenaires (laboratoires, partenaires experts et groupements<br />
industriels, universitaires et institutionnels)<br />
permettant d'optimiser ses capacités d'innovation et sa<br />
réactivité. Un maillage de taille qui va permettre à l’entreprise<br />
de mener grand train sa diversification et élargir ses<br />
activités, au-delà de la défense et du naval en s’orientant<br />
vers des applications en lien avec l’énergie (à l’exemple de<br />
l’intégration croissante d’intelligence artificielle dans ses<br />
capteurs pour la surveillance de réseaux électriques et de<br />
leur stabilité par exemple) ou encore l’avion électrique...<br />
vaste sujet en cette période critique pour l’aéronautique<br />
« thermique » ●.<br />
Olivier Guillon<br />
18 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
FORMATION<br />
Une journée technique<br />
dédiée à la mesure de conformité<br />
Le CFM, partenaire du magazine <strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong>, organise le 8 décembre prochain une<br />
journée spécialement consacrée à la mesure de conformité. Au cours de cette journée, un<br />
panel d'experts présentera les notions indispensables (comme la capabilité), la méthodologie<br />
pour vérifier la conformité d'un produit à des exigences et des industriels feront un retour<br />
d'expérience sur leur pratique de la déclaration de conformité. Le point sur la question avec<br />
Jérôme Lopez, directeur technique du CFM.<br />
© Renishaw<br />
Jérôme Lopez<br />
Directeur technique du CFM<br />
QU'EST-CE QU’UNE MESURE DE CONFORMITÉ ?<br />
Lorsque l’on parle de conformité dans ce contexte, on parle<br />
de la conformité des produits fabriqués par une entreprise à<br />
des spécifications de performances. Il s’agit des dimensions,<br />
de la masse d’une pièce mécanique, du courant délivré par un<br />
composant électronique, de la tension d’une alimentation, du<br />
débit d’une pompe, etc.<br />
Toute entreprise doit déclarer la conformité de ses produits<br />
avant de les livrer. C’est donc un élément central de l’activité. La<br />
gestion des non-conformités est souvent un sujet d’importance<br />
et une source d’améliorations à tous les niveaux : productivité,<br />
financiers… Les non-conformités selon le moment où elles<br />
sont détectées et donc le moment où elles peuvent représenter<br />
des risques importants, allant même parfois jusqu’à mettre<br />
en péril l’entreprise.<br />
POURQUOI ORGANISER UNE JOURNÉE SUR CE<br />
THÈME ?<br />
La conformité d’un produit est le plus souvent le résultat d’une<br />
mesure. Avoir un processus de mesure fiable est le gage de savoir<br />
détecter les non-conformités. Or, c’est le rôle de la métrologie<br />
de définir les méthodes pour avoir un processus de mesure<br />
fiable. Un processus de mesure non fiable ou mal maîtrisé est<br />
un risque de déclarer conformes des produits qui ne le sont<br />
pas ou de déclarer non conformes des produits qui le sont. Le<br />
premier cas est le plus à risque mais le second peut représenter<br />
un risque financier important.<br />
COMMENT SE POSITIONNENT LES ENTREPRISES<br />
FRANÇAISES SUR CE SUJET, PAR RAPPORT AUX<br />
AUTRES PAYS, EUROPÉENS NOTAMMENT ? SONT-<br />
ELLES EN RETARD ?<br />
Difficile de répondre précisément à cette question, mais la<br />
France est un pays qui a été un des créateurs de la métrologie<br />
moderne et reste un pays de référence dans ce domaine. Les<br />
textes fondateurs de la métrologie comme le VIM (Vocabulaire<br />
international de métrologie) sont par exemple écrits en anglais<br />
et en français. La France dispose donc de conditions favorables<br />
à avoir une métrologie solide.<br />
Mais le monde change et rapidement, avec notamment l’arrivée<br />
de nouvelles technologies qui viennent rebattre les cartes :<br />
IIoT (Industrial Internet of Things), intelligence artificielle<br />
pour ne citer que les plus emblématiques. Elles obligent métrologie<br />
à s’adapter pour garder un niveau d’exigence élevé sur la<br />
confiance que l’on peut avoir dans les mesures. Des structures<br />
comme le LNE sont à la pointe de ces sujets et permettent de<br />
suivre de près ce qui se passe, de s’adapter et de créer les bonnes<br />
pratiques de demain. L’autre enjeu est ensuite d’assurer la diffusion<br />
de ces bonnes pratiques. C’est le rôle de structures comme<br />
le Collège français de métrologie parmi d’autres.<br />
20 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
QUE RISQUENT LES ENTREPRISES, TANT D'UN<br />
POINT DE VUE SANCTIONS FINANCIÈRES QUE<br />
PÉNALES ?<br />
Comme dit précédemment, ce sont les risques liés à mal juger<br />
la conformité d’un produit en cours ou en sortie de production<br />
qui peuvent coûter cher, financièrement ou en termes d’images.<br />
Par exemple, le rappel de millions de produits chez les clients est<br />
quelque chose que toute entreprise souhaite ne pas connaître.<br />
CETTE QUESTION EST-ELLE DE PLUS EN PLUS<br />
LIÉE À L'APPLICATION DU PRINCIPE D'EXTRA-<br />
TERRITORIALITÉ DE LA LOI, EN PARTICULIER<br />
APPLIQUÉ PAR L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE ?<br />
Les entreprises qui travaillent à l’export savent qu’elles doivent<br />
se conformer à des normes ou des référentiels pouvant être<br />
parfois spécifiques, comme dans le cas du secteur médical aux<br />
USA par exemple (510K / FDA). La notion de conformité à ces<br />
référentiels s’applique de la même manière que la conformité à<br />
des exigences de performances.<br />
© Blum Novotest<br />
La norme guide ISO/CEI 98-4 :2012 est un cadre méthodologique<br />
qui décrit comment déclarer la conformité d’un produit<br />
à des exigences. Il s’agit d’estimer les incertitudes de mesures<br />
associées à la déclaration de conformité et de les comparer à des<br />
intervalles de conformité. Cette comparaison permet de quantifier<br />
le risque de déclarer conforme un produit non-conforme<br />
et inversement. La mettre en œuvre implique de bien connaître<br />
son processus de mesure et d’être en capacité d’estimer les incertitudes<br />
associées aux mesures critiques.<br />
Pour cela, le responsable de la métrologie, de la mesure ou le<br />
responsable qualité doivent identifier les mesures critiques (c’està-dire<br />
celles qui ont un impact direct sur la qualité produits),<br />
identifier les paramètres d’influence (par une approche 5M par<br />
exemple), quantifier les incertitudes associées et, enfin, quantifier<br />
les incertitudes résultantes afin de les comparer aux intervalles<br />
de conformité. Cela repose globalement sur la mise en<br />
place d’un processus de mesure fiable.<br />
Le CFM a pour mission la diffusion de bonnes pratiques en<br />
métrologie. Il organise par exemple des journées techniques<br />
pouvant être un point d’entrée sur certaines sujets (à l’image du<br />
8 décembre sur la déclaration de conformité par exemple). Le<br />
CFM a lancé cette année un label de bonnes pratiques en métrologie<br />
(Trust MEtrology) visant à évaluer la fonction métrologie<br />
d’une entreprise et à reconnaître ces bonnes pratiques par<br />
l’attribution d’un label décerné par un panel d’experts faisant<br />
suite à une évaluation sur site ou à distance. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
© Sandvik<br />
COMMENT BIEN ÊTRE CONFORME ? QUELLES<br />
DÉMARCHES ENTREPRENDRE ?<br />
Ce travail doit être mis en place au sein de l’entreprise et assuré<br />
par différents acteurs devant travailler ensemble : la qualité, la<br />
production, la métrologie – si celle-ci est distincte des précédents<br />
– et cela sous l’œil attentif de la direction. Le métrologue<br />
est celui qui détient l’expertise sur la manière d’avoir un processus<br />
de mesure fiable. Mais il ne doit pas être isolé et les échanges<br />
avec la qualité, la production et la direction doivent être réguliers.<br />
L’approche processus prônée par l’ISO 9001 est souhaitable.<br />
QU'APPORTE LA NORME ISO/CEI GUIDE 98-4 ?<br />
COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?<br />
EN SAVOIR PLUS ><br />
www.cfmetrologie.com/fr/mesure-declaration-de-conformite<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I21
MESURES<br />
AVIS D’EXPERT<br />
Les défis des mesures de contraintes pour les<br />
essais vibratoires<br />
Dans cet article, Damien Pélisson, directeur du laboratoire d’essais dB Vib Consulting<br />
(implanté à Vienne, dans l’Isère), revient sur les mesures de contraintes lors des essais<br />
vibratoires et les problématiques qui se posent notamment sur les systèmes d’acquisition.<br />
Dans le domaine des essais de validation<br />
en sollicitations vibratoires, nous<br />
sommes amenés à nous intéresser aux<br />
ordres de grandeurs de déplacements<br />
(déplacement, vitesse et accélération) imposés au<br />
spécimen pour valider sa tenue mécanique. Il s’agit<br />
de la sollicitation spécifiée dans une norme ou une<br />
procédure en fonction du domaine d’application du<br />
spécimen et qui est issue d’une démarche de définition<br />
de spécification d’essai tenant compte des profils<br />
de vie du produit, du coefficient de sécurité, de la<br />
sévérisation… Nous utilisons un ou plusieurs accéléromètres<br />
de référence, inclus dans la boucle d’asservissement<br />
du pot vibrant, pour mesurer et contrôler<br />
le déplacement de la bobine mobile.<br />
Le spécimen d’essai étant sollicité à ses points d’ancrages<br />
avec un profil de vibrations comportant de<br />
l’énergie sur une bande de fréquence définie, il va<br />
se mettre à répondre suivant son comportement<br />
dynamique de structure. Les modes propres excités<br />
provoqueront des déformations qui généreront<br />
des contraintes pouvant conduire à la casse du<br />
spécimen en fatigue. Le premier niveau d’investigation<br />
consiste alors à positionner plusieurs accéléromètres,<br />
triaxiaux généralement, pour caractériser les<br />
fréquences propres du spécimen soumis à une excitation<br />
en balayage sinus par exemple en mesurant<br />
les fonctions de transfert entre les réponses vibratoire<br />
et la référence d’excitation. En positionnant ces<br />
accéléromètres selon un maillage représentatif de la<br />
structure, nous pouvons même obtenir les déformées<br />
propres du spécimen dans les 3 dimensions<br />
aux fréquences propres. Néanmoins, ces mesures<br />
ne nous permettent pas d’avoir la moindre idée de<br />
l’état de contrainte dans le spécimen et donc d’apporter<br />
un jugement sur sa bonne tenue mécanique<br />
vis-à-vis des sollicitations. Il est alors nécessaire de<br />
mettre en œuvre des jauges de déformation pour<br />
avoir une évaluation des contraintes.<br />
Les jauges de déformation sont utilisées depuis longtemps<br />
pour l’étude des contraintes dans les structures<br />
soumises aux sollicitations statiques. Elles peuvent<br />
tout à fait être mises en œuvre pour les études dans<br />
le domaine dynamique mais cela nécessite une bonne<br />
préparation de l’expérimentation en amont.<br />
RAPPEL SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT<br />
D’UNE JAUGE DE DÉFORMATION<br />
Le principe de mesure avec jauge de déformation<br />
est basé sur la variation infinitésimale de la valeur<br />
de résistance de la jauge fixée à la structure que<br />
l’on veut mesurer. La jauge au repos a une valeur<br />
de résistance donnée proportionnelle à la longueur<br />
totale de sa grille et lorsqu’on l’étire (traction), sa<br />
valeur de résistance augmente et inversement lorsqu’on<br />
la comprime (compression), sa valeur de résistance<br />
diminue. Afin de mesurer cette variation de<br />
résistance (ΔR/R) qui est donc proportionnelle à<br />
un allongement de la matière (ΔL/L), nous utilisons<br />
les propriétés d’un pont de wheatstone dans<br />
lequel la jauge de déformation est intégrée. Dans ce<br />
cas de figure, il s’agit d’un montage quart de pont<br />
: R2 et R3 étant des résistances calibrées fixes (en<br />
général de 120Ω ou 350Ω selon la jauge utilisée)<br />
et R4 étant variable pour la mise à zéro du pont. Il<br />
est possible d’augmenter la précision de mesure en<br />
utilisant des montages demi-pont (2 jauges intégrées<br />
dans le pont) ou en pont complet (4 jauges<br />
intégrées dans le pont).<br />
22 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
Nous obtenons la valeur de contrainte grâce à la<br />
relation : σ = E x ε<br />
Avec : σ : contrainte mesurée dans la direction de<br />
mesure en Pa<br />
E : module d’Young du matériau en Pa<br />
ε : la valeur d’allongement ΔL/L sans unité mais<br />
usuellement appelée µdef (µm/m)<br />
Cette mesure est donc très pertinente pour évaluer<br />
la tenue en fatigue d’un spécimen mais elle est finalement<br />
relativement peu utilisée dans le cadre des<br />
essais. Tout d’abord, parce que la pose de la jauge<br />
en elle-même nécessite une formation et un certain<br />
savoir-faire ainsi qu’un niveau de précision élevé.<br />
Ensuite, il est nécessaire de bien définir la zone de<br />
mesure qui peut ne pas être la zone de concentration<br />
de contrainte maximale car il n’est pas possible de<br />
coller une jauge aussi petite soit-elle dans les congés,<br />
sur un cordon de soudure... Il est alors nécessaire<br />
de se baser sur un modèle numérique qui permettra<br />
d’évaluer la valeur de déformation en un point défini<br />
instrumentable, de mesurer le niveau de déformation<br />
en ce point puis de recaler le modèle numérique<br />
pour finalement évaluer correctement la contrainte<br />
dans la zone de concentration maximale.<br />
De plus, une jauge permet de réaliser une mesure<br />
de déformation selon une seule direction, or dans le<br />
domaine dynamique, nous ferons intervenir différentes<br />
combinaisons de modes de déformations<br />
(traction/compression, flexion, torsion) selon le<br />
mode propre excité. Il est alors nécessaire d’utili-<br />
www.mayr.com<br />
Quand vitesse rime avec sécurité<br />
EAS ® -HSC / EAS ® -HSE, limiteurs de couple<br />
de sécurité parfaits pour entraînements<br />
«grande vitesse»<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I23
MESURES<br />
ser des rosettes constituées de 3 jauges de déformations<br />
qui permettront de calculer les valeurs de<br />
contraintes principales et leur orientation ce qui est<br />
primordial pour évaluer l’état de contrainte dans une<br />
pièce. Il est à noter que ce type de jauges de déformation<br />
nécessite 3 voies du système d’acquisition<br />
ce qui limitera le nombre de points de mesures à<br />
suivre en fonction des capacités du système utilisé.<br />
Pour résumer, la mise en œuvre de cette mesure<br />
nécessite une très bonne préparation en amont ainsi<br />
qu’un nombre de voies d’acquisition spécifiques intégrant<br />
les ponts de Wheatstone à adapter en fonction<br />
du nombre de points de mesures à instrumenter en<br />
jauge uniaxiale (1 voie d’acquisition) ou en rosette<br />
(3 voies d’acquisition). Ce type de mesures est riche<br />
d’enseignement sur le comportement du spécimen<br />
en fatigue mais le protocole doit être bien préparé<br />
en amont pour que les résultats soient exploitables.<br />
SPIDER 80SG et un<br />
des 8 connecteurs<br />
Exemple de montage d’une rosette<br />
(3 jauges de déformation à 0° - 45° - 90°)<br />
Le système d’acquisition devra justement disposer<br />
de voies de mesures spécifiques pour les jauges<br />
de déformation afin de proposer une alimentation<br />
parfaitement stabilisée pour le pont de Wheatstone<br />
ainsi que permettre les 3 types de montages de pont.<br />
Pour les essais en sollicitations vibratoires, le système<br />
d’acquisition doit pouvoir acquérir en synchrone<br />
les signaux issus des accéléromètres, des jauges de<br />
déformation, des capteurs de pression… Il doit donc<br />
disposer des différents types de conditionnements<br />
de capteurs. Le summum est de pouvoir réaliser à la<br />
fois le contrôle de l’essai vibratoire et les acquisitions<br />
de signaux avec le même système. Dans le cadre<br />
d’essais d’investigation, nous pouvons alors envisager<br />
de piloter le pot vibrant aussi bien en vibrations<br />
qu’en déformation ce qui est très intéressant pour<br />
les études de fatigue.<br />
Récemment dévoilé par Crystal Instruments et<br />
utilisé dans le laboratoire de dB Vib Consulting, le<br />
module Spider-80SG 8 voies est commercialisé par<br />
dB Vib Instrumentation. Il permet d’accompagner les<br />
utilisateurs dans ce type de mesures. Ce module est<br />
connectable via Ethernet à l’ensemble de la gamme<br />
de systèmes d’acquisition Spider 80X, 80Xi et 81 et<br />
fonctionne sur la même base logiciel EDM ce qui<br />
offre une architecture modulaire très intéressante en<br />
fonction des besoins du laboratoire d’essais.<br />
Afin de proposer une solutions multi-physique<br />
robuste, il est aussi possible d’intégrer des cartes<br />
d’acquisition 8 voies SGi dans la configuration d’un<br />
analyseur multivoies Spider 80Xi. ●<br />
Damien Pélisson<br />
Directeur du laboratoire<br />
d’essais dB Vib Consulting<br />
24 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
COMMUNIQUÉ<br />
Un nouveau module<br />
pour répondre aux<br />
besoins croissants en<br />
bande passante<br />
Les besoins en bande passante des nouvelles applications<br />
automobiles augmentent rapidement. Pour cela<br />
les équipementiers automobiles ont introduit le bus<br />
CAN FD dans les voitures récentes. Dernier module<br />
de la gamme Krypton One en version durcie de DEWESoft,<br />
le « KRYPTONi-1xCAN-FD » fonctionne dans des conditions<br />
extrêmes, allant de -40°C à +85°C avec un indice de<br />
protection IP67.<br />
Ce nouveau module possède un seul port CAN FD et utilise<br />
le protocole EtherCAT comme interface de données. Plusieurs<br />
périphériques peuvent être connectés en série avec un seul<br />
câble EtherCAT pour l'alimentation, les données et la synchronisation.<br />
Avec un nombre accru de capteurs à l'intérieur des véhicules, le<br />
CAN FD est de plus en plus utilisé, plus rapide que le CAN 2.0<br />
limité à 1Mbits/s, il permet d’avoir un débit jusqu'à 8 Mbits/s.<br />
Le CAN FD prend en charge le protocole de communication<br />
CAN 2.0 ainsi que des protocoles spéciaux tels que le SAE<br />
J1939, où le CAN Out est utilisé en lecture seule. ●<br />
EN SAVOIR PLUS > dewesoft.com/fr<br />
OSCILLOSCOPES PORTABLES<br />
5instruments en 1<br />
bonnes raisons de choisir un<br />
SCOPIX IV<br />
et son logiciel SX-METRO de gestion<br />
des courbes et données de mesure<br />
www.oscilloscope-metrix.com<br />
600 V<br />
CAT III<br />
Wi<br />
Fi<br />
IP<br />
54<br />
MICRO<br />
SD<br />
pub_scopix4.indd 1 17/06/2020 13:07:14<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I25
MESURES<br />
INTERVIEW<br />
Les données de vibrations électrodynamiques<br />
au cœur de toutes les attentions<br />
Le fabricant de vibrateurs électrodynamiques<br />
IMV Corporation a introduit sur le marché à<br />
l’automne son nouveau contrôleur de vibration,<br />
le contrôleur K2+. Celui-ci prolonge l’expérience<br />
de plus de trente ans d’IMV dans la conception<br />
et la fabrication des contrôleurs de vibrations.<br />
À cette occasion, Miguel Marous, directeur<br />
marketing et commercial de la filiale française,<br />
a répondu à nos questions.<br />
exploitables par leurs collègues, notamment les services calculs<br />
/ simulation.<br />
Pour être efficaces, ils doivent pouvoir se reposer sur un contrôleur<br />
de vibration sur lequel ils ont pleinement confiance. Les techniciens<br />
et ingénieurs d’essai peuvent perdre un temps précieux<br />
pour appréhender l’interface homme-machine de leur contrôleur.<br />
Certains équipements sont noyer dans des fonctions complexes<br />
ou des fonctions d’analyse évoluées... La simplicité d’utilisation<br />
doit rester l’un des critères principaux d’utilisation. Le contrôleur<br />
doit rester accessible aussi bien à des utilisateurs occasionnels<br />
qu’à des techniciens expérimentés. Cela permet mieux rentabiliser<br />
l’investissement et limiter le taux de renouvellement.<br />
QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DES DONNÉES DE<br />
VIBRATIONS ÉLECTRODYNAMIQUES ?<br />
Miguel Marous<br />
Directeur marketing et commercial de la<br />
filiale française d’IMV Corporation<br />
À QUELLES PROBLÉMATIQUES EN MATIÈRE DE<br />
VIBRATIONS DE VOS CLIENTS INDUSTRIELS SONT-ILS<br />
CONFRONTÉS ?<br />
Toutes les sociétés industrielles cherchent à réduire le temps<br />
de développement et la phase des essais environnementaux, en<br />
particulier les essais vibratoires, étape incontournable du développement<br />
produit. La mise en œuvre des essais et les analyses<br />
des résultats sont soumises à des contraintes d’efficacités et de<br />
rapidité. Les techniciens et ingénieurs doivent collecter un maximum<br />
d’informations lors de ces essais vibratoires afin qu’ils soient<br />
Les données collectées par le contrôleur de vibration doivent<br />
refléter le comportement dynamique du spécimen à l’étude ;<br />
ces données sont représentées dans le domaine spectral. Elles<br />
permettent de valider ou améliorer les choix d’architectures<br />
mécaniques d’un produit. Avec le rapprochement indéniable<br />
des services essais et les services simulations, les données collectées<br />
sont le lien essentiel dans la conception d’un produit. Les<br />
outils de simulation peuvent aider à optimiser les paramètres<br />
de pilotage (niveau, durée, points de pilotage…). De même, les<br />
essais pourront corroborer ou modifier les estimations numériques.<br />
L’usage grandissant des jumeaux numériques permet<br />
cette synergie.<br />
QUELS SONT LES ENJEUX D'UNE BONNE ACQUISITION<br />
DE DONNÉES ET, À L'INVERSE, LES RISQUES D'UNE<br />
MAUVAISE RESTITUTION ET D'UNE MAUVAISE ANALYSE<br />
DE CES INFORMATIONS ?<br />
Au-delà du choix correct de l’accéléromètre, il est impératif de<br />
pouvoir mesurer correctement l’intégralité du phénomène vibratoire.<br />
La contrainte sur le choix d’un calibre d’entrée adéquate<br />
peut entrainer une saturation possible du signal pendant l’essai<br />
et compliquer l’analyse. Pendant les phases d’investigations, le<br />
choix de calibre peut être problématique. Une augmentation de la<br />
dynamique de mesure permet de se substituer à cette contrainte<br />
tout en étant capable d’identifier avec précision des phénomènes<br />
parasites de faible amplitude.<br />
26 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
D’autre part, une mauvaise interprétation des données collectées<br />
peut être induite par des artéfacts créés par un niveau inapproprié<br />
du niveau d’écrêtage lors des essais aléatoires. L’écrêtage du<br />
signal de driver peut faire apparaitre des phénomènes fréquentiels<br />
artificiels. On parle alors de « Clipping Induced Noise » ; les<br />
fréquences artificielles pourraient exciter inutilement la fréquence<br />
de résonance du spécimen.<br />
COMMENT Y REMÉDIER ?<br />
IMV Corporation a développé et breveté le « soft clipping »,<br />
qui supprime « les parasites » indésirables tout en conservant<br />
les composantes fréquentielles du signal de drive. En limitant<br />
la valeur de crête de la forme d'onde temporelle dans le niveau<br />
requis, la DSP du signal de drive reste inchangée. L’utilisation<br />
de cette méthode présente de multiples avantages : réduction<br />
du bruit et augmentation de la plage de contrôle dynamique ;<br />
les résonances dans le spécimen sous test ne sont plus excitées<br />
involontairement ; réduction de l'occurrence de déclenchement<br />
indésirable de l'amplificateur.<br />
QUELLE SOLUTION LEUR PROPOSEZ-VOUS ET SUR<br />
QUELLE(S) TECHNOLOGIE(S) REPOSE-T-ELLE ?<br />
Pour faciliter la prise en main, les fonctions de base sont directement<br />
accessibles, les fonctions avancées sont accessibles à partir<br />
de d’un bouton dédié. L’opérateur est guidé tout au long du paramétrage<br />
par un fil de commande claire. L’opérateur ne pourra<br />
oublier aucun paramètre clé du système de pilotage. Pour simplifier<br />
encore la définition du profil de vibration, IMV a intégré dans<br />
l’interface du contrôleur K2+, une base de données des principales<br />
normes vibratoires (IEC, MIL, ISO, JASO…). En trois<br />
clics, il est possible de lancer un essai sans risque d’erreur dans<br />
la définition du test.<br />
Pour améliorer la finesse d’analyse, IMV a amélioré la précision<br />
de mesure en proposant en standard des convertisseurs<br />
A/N 32 bits, la dynamique de mesures est améliorée de 3dB. La<br />
fréquence d’échantillonnage du contrôleur IMV K2+ a également<br />
été améliorée jusqu’à 102,4 kéch/s par voie, cette amélioration<br />
permet d’étendre la bande de fréquence d’analyse.<br />
Pour faciliter encore le paramétrage, le conditionnement de tous<br />
les types de capteurs possibles, y compris les capteurs charges<br />
en plus de la technologie IEPE, TEDS… sont intégrés. Le conditionnement<br />
charge intégré permet au laboratoire de faire des<br />
économies sur l’étalonnage de conditionneurs externes ou convertisseur<br />
charge/ICP. IMV Corporation s’attache à fournir des solutions<br />
toujours plus soucieuses de la performance et de la fiabilité.<br />
Notre large gamme de vibrateur de 600N à 350kN nous permet<br />
de répondre à tous les besoins vibratoires que vous soyez dans<br />
le domaine de l’automobile, le spatial, la défense ou l’énergie. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I27
MESURES<br />
SOLUTION<br />
Comment sécuriser et optimiser le stockage des<br />
vaccins contre la Covid-19 ?<br />
Les vaccins ne sauvent pas seulement des millions de vie, ils sont aussi la raison de l’éradication<br />
de maladies majeures telles que la variole. La course aux vaccins contre la Covid-19 est engagée<br />
depuis plusieurs mois maintenant et pousse les industriels de la santé à faire face à l’un des<br />
prochains défis : préserver l’efficacité de ce vaccin durant sa période de stockage et de transport.<br />
Les vaccins sont classés comme des produits biologiques<br />
qui peuvent devenir inactifs au bout d’un<br />
certain temps. Si un vaccin est exposé à une<br />
température inférieure ou supérieure à ce qui<br />
est recommandé, celui-ci perd de son efficacité, et expose<br />
alors les patients à un risque. Le contrôle de la température<br />
pendant le stockage et le transport des vaccins est<br />
donc obligatoire et la règlementation doit être strictement<br />
respectée.<br />
L’une des plus grandes préoccupations est la température<br />
à laquelle ils doivent être soumis. Pour un stockage longue<br />
durée de six à douze mois, la température doit atteindre<br />
-50 à -80°C, ce qui est le cas pour certains vaccins contre<br />
la Covid-19.<br />
Toutes les différentes zones de stockage requièrent donc<br />
une surveillance accrue et continue mais aussi une qualification<br />
régulière pour garantir que le congélateur est capable<br />
d’assurer les performances requises. En vertu de réglementations<br />
strictes visant à assurer des conditions de stockage<br />
adéquates, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de<br />
se soumettre à des inspections régulières de leurs équipements.<br />
COMMENT METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE<br />
SURVEILLANCE CONTINUE ?<br />
Afin de s’assurer du maintien de la température, chaque<br />
congélateur doit disposer d’un système de surveillance<br />
continue des conditions environnementales. Les opérateurs<br />
peuvent ainsi être avertis en temps réel lorsqu’un congélateur<br />
dépasse les limites autorisées. La fonction de radiofréquence<br />
est indispensable et permet à l’équipe présente de<br />
prendre les décisions nécessaires pour éviter la perte d’un<br />
lot entier de vaccins.<br />
Pour un stockage sûr et optimal, nous conseillons l’utilisation<br />
d’un système embarqué pour plus de mobilité. Celui-ci<br />
doit être choisi selon plusieurs critères prioritaires tels que<br />
sa capacité à fournir des données en temps réel, sa plage de<br />
température maximale, son autonomie, sa solidité (indice<br />
de protection) ainsi que la flexibilité et les fonctionnalités<br />
du logiciel qui l’accompagne.<br />
Ellab recommande l’utilisation du système embarqué<br />
IceSpy IN-TT001 de la gamme Hanwell qui répond entièrement<br />
aux exigences requises pour le stockage de nombreux<br />
types de vaccin et autres produits pharmaceutiques. Cet<br />
équipement offre autant d’avantages que ce soit pour une<br />
utilisation statique (stockage longue durée) ou mobile<br />
(durant le transport).<br />
La sonde thermocouple intégrée au module IceSpy<br />
IN-TT001 dispose d’une plage de température qui s’étend<br />
de -200°C à +300°C avec une précision de +/-1 °C entre<br />
-100°C et 0°C. L’indice de protection IP65 du capteur le<br />
rend plus résistant à la poussière ainsi qu’aux jets d’eau et<br />
la durée de vie de sa batterie est de +/- 2 ans en fonction<br />
de son utilisation.<br />
28 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
MESURES<br />
Sa portée radio peut atteindre jusqu’à 300 m sur un terrain<br />
découvert et transmet les données vers le logiciel EMS<br />
(Environmental Monitoring Software), accessible depuis<br />
un smartphone, une tablette ou un PC portable. Des répéteurs<br />
peuvent également être mis en place pour une meilleure<br />
transmission des données.<br />
La plateforme logicielle qui accompagne ce système permet<br />
de paramétrer chaque session, récolter les données en<br />
temps réel 24/7, analyser les résultats, puis générer des<br />
rapports clairs, complets et certifiés. Ultra-intuitive, elle<br />
offre un large panel de paramétrages notamment pour les<br />
alertes (SMS, email, notifications) lorsqu’un dysfonctionnement<br />
apparaît. La sécurité des vaccins n’est donc jamais<br />
compromise. Ce système est un véritable atout pour les<br />
structures multisites et s’adapte aussi bien pour un seul<br />
accès utilisateur que multi-utilisateurs.<br />
POURQUOI ET COMMENT QUALIFIER SON<br />
CONGÉLATEUR ?<br />
La qualification d’un congélateur doit être réalisée régulièrement<br />
et dure plusieurs jours. Il s’agit de déterminer<br />
les zones chaudes et froides du système de stockage, de<br />
confirmer les températures et écarts d’humidité prédéfinis,<br />
d'identifier et améliorer l'équilibre température/humidité,<br />
de déterminer les températures les plus élevées et la fluctuation<br />
de l’humidité dans la chambre, mais aussi de calculer<br />
et documenter la température cinétique moyenne (MKT).<br />
La FDA considère la Mean Kinetic Temperature (MKT)<br />
comme un calcul qui indique si un produit a dépassé les<br />
conditions de stockage. Ce calcul de l’équipartition de<br />
l’énergie cinétique peut également être utilisé pour déterminer<br />
si le stockage, la manutention ou le transport ont<br />
affecté la durée de vie du produit.<br />
idéale grâce à sa plage de température de -90 à +85°C et<br />
sa précision de ±0,1 °C. Leur conception en acier inoxydable<br />
et leur capacité de mémoire de 60 000 points de<br />
données permettent de résister dans un environnement<br />
extrême à -80°C durant des mois.<br />
De plus, ces capteurs peuvent être équipés d’une LED pour<br />
avertir en temps réel de l’état du capteur (voyant rouge ou<br />
vert). Toutes les données sont ensuite collectées sur le logiciel<br />
de validation ValSuite. Celui-ci répond entièrement<br />
aux exigences de la FDA 21 CFR Partie 11 (Journal d’évènements,<br />
Active Directory, gestionnaire d’accès, signature<br />
électronique et bien plus encore) et qui est compatible<br />
sous Windows 10 et Citrix. Il générera ensuite un rapport<br />
complet, certifié et automatisé en format PDF.<br />
POUR ALLER PLUS LOIN…<br />
Le stockage des vaccins est un véritable défi puisque les<br />
conditions environnementales requises peuvent varier<br />
d’un vaccin à l’autre. De nouvelles alternatives sont alors<br />
en cours d’analyse telles que celle de la lyophilisation des<br />
vaccins qui permettrait de les stocker dans des conditions<br />
de réfrigération plus communes.<br />
Pour qualifier un tel procédé thermique, l’utilisation de<br />
capteurs embarqués de la gamme TrackSense Frigo est<br />
Cette technique de procédé consiste à déshydrater presque<br />
totalement le produit afin de le conserver sous vide. Très<br />
utilisée dans les industries agroalimentaires et de la santé,<br />
la lyophilisation permet de ne pas altérer la qualité des<br />
produits et de les conserver à température ambiante. Ellab,<br />
expert dans le domaine de la validation et la qualification<br />
depuis 1949, est capable de répondre aux exigences de<br />
nombreuses applications, notamment celles pour le stockage<br />
à froid mais aussi de lyophilisation, grâce à son tout<br />
nouveau capteur embarqué conçu spécialement pour l’optimisation<br />
de ce procédé. ●<br />
Article réalisé avec la société Ellab<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I29
DOSSIER<br />
L'INTERVIEW<br />
« France Hydrogène portera<br />
haut et fort les couleurs<br />
de l’hydrogène en France<br />
comme à l’international ! »<br />
Le 7 octobre 2020 est une date que l’industrie de l’hydrogène<br />
française peut marquer d’une pierre blanche. Car en devenant<br />
France Hydrogène, l’Association française pour l’hydrogène et<br />
les piles à combustible (Afhypac) a fait bien plus que changer<br />
de nom. Le point avec son président Philippe Boucly, lequel ne<br />
cache pas son ambition de faire – enfin – de l’hydrogène une<br />
filière stratégique pour l’économie et l’industrie française.<br />
Philippe Boucly Président de<br />
France Hydrogène<br />
Depuis décembre 2017, Philippe Boucly préside l’Association<br />
française pour l’hydrogène et les piles à combustible (Afhypac),<br />
après en avoir été le premier vice-président pendant quatre ans.<br />
Devenue France Hydrogène depuis le 7 octobre dernier, la structure<br />
fédère les acteurs de la filière française de l’hydrogène et des<br />
piles à combustible. Au sein de cette association, Philippe Boucly<br />
représente GRTgaz, le principal opérateur français de réseau de<br />
transport de gaz naturel à haute pression en France.<br />
De 2009 à avril 2013, Philippe Boucly était le directeur général de GRTgaz. C’est durant<br />
son mandat que l’entreprise a pris le virage des gaz renouvelables et en particulier de<br />
l’hydrogène. Cet ancien élève de l’École Polytechnique (X72) et ingénieur de l’École des Mines<br />
de Paris a mené toute sa carrière au sein de Gaz de France, devenu GDF Suez puis Engie.<br />
Il y a occupé des fonctions opérationnelles en France (notamment directeur de la Région<br />
Centre-Ouest basée à Angoulême) et à l’international. De 2002 à 2008, il a dirigé SPP, la<br />
société gazière slovaque filiale de GDF Suez, d’E-on et de l’État slovaque. Il a également<br />
dirigé la coopération technique développée entre Gaz de France et Gazprom de 1994 à 2002.<br />
En référence au lancement par le<br />
gouvernement le 8 septembre<br />
dernier de la Stratégie française<br />
sur l’hydrogène, l’association se<br />
devait « de refléter cette nouvelle dimension.<br />
Et le premier pas pour accompagner<br />
cette évolution, c’est un nouveau nom<br />
clair, lisible et immédiatement compréhensible<br />
par tous les publics, selon les<br />
mots de son président Philippe Boucly.<br />
Ainsi, nous réaffirmons nos ambitions :<br />
porter haut et fort les couleurs de l’hydrogène,<br />
refléter cette puissante dynamique et<br />
la faire rayonner en France comme à l’international<br />
! » C’est dit. L’enthousiasme<br />
affiché de Philippe Boucly traduit l’engagement<br />
désormais ferme, à la fois de la<br />
France mais aussi de l’Europe, de faire<br />
de l’hydrogène une énergie d’avenir et<br />
résolument stratégique.<br />
MONSIEUR BOUCLY, QUE<br />
REPRÉSENTE POUR VOUS<br />
LA CRÉATION DE FRANCE<br />
HYDROGÈNE ?<br />
N’ayons pas peur des mots : il s’agit<br />
d’une ère nouvelle pour l’hydrogène<br />
en France. Et le démarrage de celle-ci<br />
devait passer par un nouveau nom pour<br />
notre association. Créée il y a une vingtaine<br />
d’années à l’initiative d’universitaires,<br />
l’association (qui s’appelait<br />
alors AFH2) avait déjà pris un tournant<br />
en 2009 grâce à Chantal Jouanno,<br />
alors secrétaire d’État à l’Écologie, qui<br />
a demandé aux industriels de réaliser<br />
une feuille de route avec l’Ademe et<br />
l’AFH2 ; c’est à ce moment-là qu’a été<br />
créée l’Afhypac.<br />
PLUS PRÉCISÉMENT, QUELLES<br />
SONT SES MISSIONS ?<br />
La mission première de l’association<br />
30 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
©Adrien Daste<br />
solution pour la lutte contre le changement<br />
climatique.<br />
Puis, sous la présidence d’Emmanuel<br />
Macron, Nicolas Hulot a, dès sa nomination<br />
en tant que ministre, mené une<br />
réflexion qui a abouti à un plan hydrogène<br />
qu’il a présenté le 1 er juin 2018 :<br />
des grandes orientations, des recommandations<br />
et des objectifs à atteindre.<br />
Mais c’est là que le bât blesse : l’absence<br />
de visibilité financière et d’accompagnement,<br />
avec seulement un budget de<br />
100 millions d’euros pour 2019. Nous<br />
avons néanmoins poursuivi nos études<br />
et notre action et en juillet dernier,<br />
nous avons publié notre vision dans<br />
un manifeste intitulé « Manifeste pour<br />
un plan national hydrogène ambitieux<br />
et cohérent ».<br />
est de promouvoir l’hydrogène en<br />
France et d’en faire une filière compétitive.<br />
L’association connait actuellement<br />
une forte dynamique : plus de<br />
200 membres, contre 120 au début<br />
2019, soit un quasi doublement en<br />
deux ans ! L’association peut compter<br />
sur l’engagement d’une quarantaine de<br />
grands groupes présents dans différents<br />
métiers tels que l’énergie et la mobilité,<br />
mais également sur une centaine<br />
de PME, de PMI et d’ETI, sans oublier<br />
les collectivités territoriales, les centres<br />
de recherche, des pôles de compétitivité<br />
et des syndicats professionnels de<br />
l’énergie et des transports.<br />
Air Liquide - Port-Jérôme site and Cryocap<br />
Notons qu’il existe une véritable filière<br />
française de l’hydrogène, rassemblant<br />
des activités aussi diverses que les<br />
transports, qu’il s’agisse du ferroviaire,<br />
de l’automobile, de l’aéronautique, du<br />
maritime et du fluvial mais aussi le<br />
domaine de la chimie ou la sidérurgie<br />
… tous les métiers sont concernés<br />
et France Hydrogène se veut être<br />
le référent en la matière.<br />
LA FILIÈRE FRANÇAISE DE<br />
L’HYDROGÈNE A-T-ELLE TOUJOURS<br />
ÉTÉ AUSSI DYNAMIQUE ?<br />
En France, cette technologie n’est<br />
pas nouvelle. Néanmoins, on peut<br />
fixer à 2014 le début du décollage.<br />
En janvier 2014 est paru un rapport<br />
de l'Office parlementaire d'évaluation<br />
des choix scientifiques et technologiques<br />
(OPECST) qui a émis un<br />
certain nombre de recommandations<br />
au gouvernement pour s'engager résolument<br />
sur la voie du développement<br />
de l'hydrogène en France. Cette publication<br />
a été suivie d'autres rapports<br />
rédigés par des hauts fonctionnaires<br />
des commissariats à l'économie et à<br />
l'écologie. Cela a contribué à éveiller<br />
l'intérêt pour l'hydrogène en tant que<br />
C’EST CE MANIFESTE QUI A<br />
PRÉFIGURÉ LA PARTIE CONSACRÉE<br />
À L’HYDROGÈNE DU PLAN DE<br />
RELANCE ANNONCÉ PAR LE<br />
GOUVERNEMENT EN SEPTEMBRE<br />
DERNIER ?<br />
Je vous laisse juge mais le 8 septembre<br />
dernier, pas moins de deux ministres<br />
ont présenté cette stratégie. Le<br />
symbole est très fort, d’autant que<br />
ce plan répond totalement à notre<br />
vision et à nos attentes exprimées à<br />
travers notre manifeste, y compris en<br />
matière de puissance installée avec<br />
7 000 mégawatts d’électrolyse programmés<br />
d’ici 2030 et en termes de soutien<br />
prévu à l’investissement, de l’ordre de<br />
7,2 Md€ au total.<br />
DE QUOI SE COMPOSE-T-IL ? ET<br />
QUELLES CONSÉQUENCES AURONT,<br />
POUR LA FILIÈRE HYDROGÈNE,<br />
CES INVESTISSEMENTS À COURT,<br />
MOYEN ET LONG TERMES ?<br />
Cette stratégie doit se développer sur<br />
trois axes : la décarbonation de l'industrie<br />
et la création d’une filière française<br />
compétitive de l’électrolyse, le développement<br />
de la mobilité professionnelle<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I31
DOSSIER<br />
et enfin, le maintien de l’excellence en<br />
matière de recherche-développement<br />
et d’innovation avec le lancement d’un<br />
programme prioritaire de recherche,<br />
porté par l’ANR, de 65 millions d’euros.<br />
Enfin, le développement des compétences<br />
et la formation n’ont pas été<br />
oubliés puisque des campus des métiers<br />
verront le jour prochainement.<br />
En outre, une gouvernance est prévue<br />
pour animer et suivre la réalisation de<br />
la stratégie avec la nomination d’un<br />
coordinateur interministériel placé<br />
sous l'autorité du Premier ministre.<br />
Cela illustre la volonté du gouvernement<br />
de travailler en interministériel,<br />
volonté que nous avons déjà constatée<br />
lors de la préparation du plan ; c'est<br />
une véritable Task force composée de<br />
fonctionnaires provenant des ministères<br />
de la Recherche, de l’Écologie,<br />
de l’Économie ainsi que du secrétariat<br />
général pour l’Investissement qui a<br />
mis au point cette stratégie. Il y a donc<br />
une vraie volonté interministérielle à<br />
laquelle s’ajoute la volonté de Bruno Le<br />
Maire de créer un Conseil national de<br />
l’hydrogène qu'il présidera.<br />
SUR QUELS AXES ALLEZ-VOUS<br />
AVANCER EN PRIORITÉ DANS LES<br />
DOMAINES DE LA R&D ET R&T ?<br />
De nombreux projets de recherche sont<br />
en cours, à commencer par l’initiative<br />
IFHY. Il s’agit d’un groupement d’intérêt<br />
scientifique qui réunit le CEA et le<br />
CNRS et qui travaille sur quatre axes.<br />
Le premier concerne l’électrolyse à<br />
basse température, de façon à la rendre<br />
plus flexible, plus durable et à réduire<br />
le recours à des matériaux critiques. De<br />
même, l’électrolyse haute température<br />
apparait comme une technologie très<br />
prometteuse, à très haut rendement. Le<br />
deuxième axe porte sur la logistique,<br />
le transport, le stockage et la distribution<br />
de l’hydrogène : il s’agit de travailler<br />
sur des procédés de liquéfaction et<br />
sur les LOHC (Liquides organiques<br />
vecteurs et transporteurs d’hydrogène)<br />
ainsi que sur le stockage haute pression.<br />
À titre d’exemple, on s’oriente vers<br />
des stockages dans de longs cylindres<br />
qui, comme les batteries, pourront être<br />
placés dans le plancher des véhicules.<br />
Nous travaillons aussi sur les aciers car<br />
l’hydrogène fragilise certains aciers,<br />
ce qui peut poser des problèmes de<br />
©Air Liquide<br />
Air Liquide - site de Bécancour<br />
© Wrightbus<br />
Forsee Power, spécialiste français<br />
des systèmes de batteries intelligents,<br />
équipe les bus nord-irlandais<br />
Wrightbus depuis 2013<br />
32 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
fort. La réduction des coûts représente<br />
également une priorité ; pour cela, des<br />
projets seront menés afin de développer<br />
des piles utilisant moins de platine.<br />
D’autres sujets concernent l’étanchéité<br />
et également le développement de<br />
modèles numériques dans le but de<br />
réduire les temps de test et d’en optimiser<br />
les résultats. Plus globalement,<br />
nous entendons profiter de la mise en<br />
œuvre de cette stratégie nationale pour<br />
apporter plus de fluidité et de d’indépendance<br />
vis-à-vis des sous-traitants<br />
étrangers. Enfin, l’objectif est aussi de<br />
renforcer la disponibilité des moyens<br />
d’essai industriels.<br />
sécurité. Autre axe : la conversion de<br />
l’énergie de l’hydrogène dans des piles<br />
à combustible, à membrane polymère<br />
ou céramique ; nous poursuivons également<br />
les travaux sur la combustion<br />
des mélanges gaz naturel/hydrogène.<br />
Enfin, le dernier axe est plus transverse<br />
puisqu’il consiste à accompagner<br />
le déploiement de ces systèmes tout au<br />
long de leur cycle de vie en prenant en<br />
compte leurs impacts à la fois économiques,<br />
sociaux, écologiques et en<br />
matière de sécurité.<br />
QUELLES SONT LES GRANDS DÉFIS<br />
DES INDUSTRIELS FRANÇAIS DE<br />
L’HYDROGÈNE ?<br />
Lancée il y a trois ans, l’initiative H2Lab<br />
vise à mettre en commun des moyens<br />
d’homologation et de certification des<br />
composants de la chaîne de l’hydrogène.<br />
Car le problème se pose pour les<br />
industriels français de la filière quant<br />
à la réalisation des tests d’homologation<br />
et de certification ; beaucoup sont<br />
contraints d’aller à l’étranger pour les<br />
réaliser ce qui implique des délais longs<br />
et des retards de livraison car chaque<br />
pays se sert en priorité. De ce constat,<br />
nous avons eu l’idée de recenser les<br />
moyens d’essai existants en France et de<br />
les mettre à disposition des industriels.<br />
QUELS VONT ÊTRE VOS BESOINS EN<br />
TERMES D'ESSAIS ET DE MESURE ?<br />
Les grandes problématiques concernent<br />
avant tout la durabilité. Beaucoup d’essais<br />
d’endurance devront être menés sur<br />
de nombreux produits en conditions<br />
extrêmes, tant en matière de vibrations<br />
que de température. Autre sujet prioritaire,<br />
la fiabilité. Il s’agit d’un enjeu<br />
COMMENT ALLEZ-VOUS<br />
TRAVAILLER AVEC VOS<br />
PARTENAIRES EUROPÉENS,<br />
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE R&D ?<br />
Les interactions européennes sont<br />
nombreuses et ne vont cesser de s’intensifier.<br />
France Hydrogène est d’ailleurs<br />
membre de l’organisation<br />
Hydrogen Europe, qui regroupe près<br />
de 200 membres : industriels, associations<br />
nationales telles que la nôtre ainsi<br />
que des laboratoires européens travaillant<br />
sur l’hydrogène. Cette organisation<br />
est très active auprès des instances<br />
européennes mais également dans l’élaboration<br />
de la stratégie européenne<br />
de l’hydrogène présentée le 8 juillet<br />
dernier à Bruxelles. ●<br />
Premier train fonctionnant<br />
à l’hydrogène pour Alstom<br />
Propos recueillis par<br />
Olivier Guillon<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I33
DOSSIER<br />
ENTRETIEN<br />
« Il n’y aura pas de transition énergétique<br />
réussie sans hydrogène »<br />
Vice-président pour les technologies (CTO) et la direction industrielle de l’activité mondiale<br />
Énergie hydrogène d’Air Liquide, Xavier Vigor a accepté de répondre à nos questions portant<br />
sur l’implication d’un groupe mondial dans la filière hydrogène.<br />
Que représente l'hydrogène chez Air Liquide et dans la feuille de route du groupe ? Sur quels<br />
segments/métiers êtes-vous particulièrement impliqués ?<br />
Xavier Vigor Directeur des<br />
Technologies et Management<br />
Industriel de l’Activité<br />
Mondiale Énergie Hydrogène<br />
du groupe Air Liquide<br />
Diplômé de l’École centrale des arts et<br />
manufactures, Xavier Vigor a commencé<br />
sa carrière professionnelle en 1988 au<br />
sein du groupe Air Liquide. Il a occupé<br />
successivement des responsabilités<br />
de recherche et développement,<br />
commerciales, d'ingénierie et de<br />
management, toujours dans des domaines<br />
innovants. En particulier, il a dirigé le<br />
centre de recherche de Chicago, celui des<br />
Loges-en-Josas près de Paris, l’ingénierie<br />
des petites usines de production standard,<br />
l’informatique industrielle du groupe et, récemment, des filiales<br />
dédiées aux technologies avancées.<br />
contribue par son expertise à la généralisation de l'utilisation<br />
de l'hydrogène comme vecteur d’énergie propre.<br />
PAR RAPPORT AU PLAN DE RELANCE, COMMENT<br />
AIR LIQUIDE SE POSITIONNE-T-IL AU NIVEAU DE<br />
L'HYDROGÈNE ?<br />
Nous saluons l’engagement des pouvoirs publics visant à<br />
promouvoir la filière hydrogène en France. Il n’y aura pas de<br />
transition énergétique réussie sans hydrogène. Ce plan va vraiment<br />
dans le bon sens. Il y a deux ans, on parlait de 100 millions<br />
d’euros pour la filière hydrogène. Aujourd’hui Bruno Le Maire a<br />
confirmé le plan de 2 milliards d’euros d’ici 2022 et une ambition<br />
pour la décennie à 7,2 milliards. C’est un vrai coup d’accélérateur<br />
pour la filière française et qui nous met au diapason de ce<br />
qui se passe dans les autres pays européens, mais aussi dans de<br />
nombreux autres pays du monde (Allemagne, Portugal, Corée,<br />
Japon, Chine, Californie, Chili…).<br />
La lutte contre le changement climatique et la réussite<br />
de la transition énergétique sont au cœur de la stratégie<br />
d’Air Liquide. Il y a deux ans, nous nous sommes<br />
fixé les objectifs « climat » les plus ambitieux de notre<br />
secteur pour réinventer avec nos clients et nos partenaires des<br />
solutions industrielles durables. Air Liquide contribue au développement<br />
d’une société bas carbone, notamment en développant<br />
l’hydrogène qui, tant sur le plan de la mobilité que de<br />
l’énergie, jouera un rôle clé dans la transition énergétique et la<br />
lutte contre le changement climatique. Depuis cinquante ans,<br />
le groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement<br />
en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution et<br />
au développement d’applications pour les utilisateurs finaux. Il<br />
©Adrien Daste<br />
Site de Port-Jérôme doté de la solution Cryocap (captage de CO 2<br />
par<br />
cryogénie)<br />
34 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
Par ailleurs, la structuration de la filière hydrogène en France<br />
va de pair avec des économies d’échelle qui viendront renforcer<br />
la compétitivité de nos solutions hydrogène. En tant que pionniers<br />
dans le domaine de l’hydrogène, nous sommes confiants<br />
dans nos capacités à relever ces défis à l'échelle nécessaire. Air<br />
Liquide est d'autant mieux placé dans ce domaine que le groupe<br />
soutient la recherche et favorise l'innovation dans ses campus<br />
et centres d'excellence, dont plusieurs implantés sur le territoire<br />
français (en région parisienne ainsi qu’à Sassenage, près<br />
de Grenoble).<br />
QUELS VERROUS TECHNOLOGIQUES VOUS<br />
RESTE-T-IL À LEVER ? ET QUELLES ONT ÉTÉ LES<br />
DERNIÈRES ACQUISITIONS DU GROUPE EN LA<br />
MATIÈRE ?<br />
Site de Bécancour (Canada), équipé avec<br />
d’électrolyseurs Hydrogenics-Cummins<br />
Ce plan nous conforte dans nos investissements dans l’hydrogène<br />
en France et nous incite à les poursuivre fortement dans les<br />
années à venir, notamment sur des projets d’envergure. Il est une<br />
incitation à poursuivre nos investissements hydrogène en France<br />
avec un effet positif sur les écosystèmes dans les territoires.<br />
Les technologies existent déjà. L’enjeu est maintenant de passer<br />
à l’échelle supérieure. Le marché de l’hydrogène prend son envol<br />
et doit encore se structurer avant d’arriver à maturité. Dans<br />
ce cadre, Air Liquide entend se montrer pragmatique et faire<br />
preuve d’agilité. Cela se traduit notamment par un soutien<br />
actif à la R&D et à l’innovation, ainsi que par des prises de<br />
participation dans des sociétés comme Hydrogenics-Cummins<br />
(conception d’électrolyseurs). Par ailleurs, le développement de<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I35
DOSSIER<br />
l’hydrogène décarboné ne pourra pas se faire sans recours à des<br />
solutions permettant de décarboner les moyens de production<br />
déjà existants, comme nous le faisons déjà grâce aux solutions<br />
CryoCap (Port-Jérôme, France) et Northern Lights (Norvège).<br />
QUELLES SONT LES START-UP SUPPORTÉES<br />
PAR AIR LIQUIDE IMPLIQUÉES DANS LA FILIÈRE<br />
HYDROGÈNE ?<br />
Air Liquide soutient plusieurs start-up et a notamment investi<br />
plus de 12 millions d’euros dans cinq d’entre elles via Aliad,<br />
sa structure de venture capital. Parmi ces jeunes pousses, on<br />
compte Step (société des taxis hydrogène Hype), Ergosup (qui<br />
propose des solutions innovantes de fourniture décentralisée<br />
d’hydrogène), Flying Whales (transport de marchandises par<br />
dirigeable), Hydrexia (stockage d’hydrogène solide). Le groupe<br />
a également investi dans la société McPhy (spécialisée dans la<br />
conception et fabrication d’électrolyseurs), de Plug Power (parts<br />
ayant depuis été cédées, piles à combustible).<br />
COMMENT LES ACTEURS DE LA MESURE, DU TEST,<br />
DU CND ET DE LA SIMULATION PEUVENT-ILS<br />
AIDER À RÉPONDRE AUX ENJEUX D’AIR LIQUIDE<br />
LA FILIÈRE HYDROGÈNE ?<br />
Les enjeux de la filière hydrogène sont d’avancer plus rapidement<br />
et plus loin dans le développement de nouvelles solutions,<br />
ainsi que d’apporter des améliorations à de nouveaux<br />
équipements, à des coûts raisonnés. Les mesures et les CND<br />
doivent aussi apporter des solutions industrielles et innovantes<br />
pour contrôler le bon fonctionnement et le bon état de nos<br />
stations hydrogène (très haute pression et hydrogène sous forme<br />
liquide). De la même manière, des efforts sont entrepris pour<br />
développer rapidement nos atouts, tout en réduisant leur coût<br />
total de possession (TCO).<br />
Pour cela, il existe plusieurs leviers : l’utilisation de simulations<br />
et tests pour fiabiliser et optimiser les performances techniques<br />
des équipements des stations hydrogène ; le contrôle des stockages<br />
haute pression ; la détection et prévention des fuites ; les<br />
tests intensifs et extensifs des produits et équipements avant leur<br />
mise sur le marché et la définition des améliorations souhaitées ;<br />
les inspections périodiques réglementaires in situ (sans démontage<br />
pour limiter les temps d’arrêt) ; la simulation des durées<br />
de vie en fonction, entre autres, de l’environnement hydrogène,<br />
de la pression, des cycles, afin d’optimiser le design, la durée de<br />
vie des équipements et la fréquence de maintenance<br />
L'hydrogène ayant un effet fragilisant sur les métaux, cela nous<br />
conduit à mettre en place des tests de sélection spécifiques, mais<br />
aussi à en établir de nouveaux pour nous adapter aux niveaux<br />
de pression nécessaires pour l’énergie hydrogène. Cet effet se<br />
produisant dans le temps, les inspections sont adaptées avec<br />
des contrôles non destructifs et en atmosphères explosives.<br />
À partir de ces mesures, les simulations permettent d'évaluer la<br />
santé des matériaux et en association avec une bonne connaissance<br />
des mécanismes d'endommagement, d’établir des projections<br />
sur une durée de vie résiduelle. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
©Hybalance<br />
Site HyBalance à Hobro, au Danemark<br />
36 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
France<br />
Hydrogène signe<br />
un accord avec la BEI<br />
L’association française pour l’hydrogène et les<br />
piles à combustible et la Banque européenne<br />
d’investissement ont signé le 13 novembre un<br />
accord de collaboration afin de faciliter l’accès<br />
aux solutions de financement et à l’expertise de<br />
la BEI pour les promoteurs de projets hydrogène<br />
en France.<br />
Cet accord s’inscrit plus précisément dans le cadre du<br />
programme InnovFin Conseil de la BEI qui bénéficie du<br />
soutien de la Commission européenne. Les ressources<br />
mises à disposition par ce programme devront permettre<br />
d’accélérer le financement des projets hydrogène grâce à<br />
la mise en place d’un conseil et d’un accompagnement<br />
personnalisés parallèlement à une exploration poussée des<br />
possibilités de financement. Cette collaboration permettra<br />
également de recenser les déficits de financement dans ce<br />
secteur émergent afin de pouvoir y remédier notamment<br />
par la mise en place de nouveaux instruments financiers.<br />
« Cet accord avec France Hydrogène marque une étape pour<br />
le développement de projets hydrogène en France. Et l’enjeu<br />
est important face à l’urgence climatique et la nécessité<br />
de développer des solutions innovantes réduisant les gaz à<br />
effet de serre », déclare Ambroise Fayolle, vice-président<br />
de la BEI. . ●<br />
PUBLI REPORTAGE<br />
DAM GROUP, UN BOOSTER<br />
INCONTOURNABLE POUR<br />
LA FILIERE HYDROGENE<br />
L’enjeu majeur pour la filière hydrogène<br />
réside dans l’industrialisation : DAM Group<br />
accompagne les constructeurs et sous-traitants<br />
de la filière, vers une montée en production<br />
et une industrialisation de masse de leurs<br />
produits.<br />
Créée en 1987, l’entreprise a capitalisé son savoir sur les métiers<br />
de la mécanique, de l’étude des fluides, de l’électronique et de la<br />
gestion de données pour livrer à ses clients des solutions clés<br />
en main et strictement adaptées à leurs besoins. DAM Group<br />
propose une offre complète de solutions de test et mesure sur<br />
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène :<br />
• contrôle d’étanchéité des plaques bipolaires (PEM/SOFC)<br />
et des MEA<br />
• moyens de caractérisation et de conditionnement du stack<br />
• test haute pression du système hydrogène intégré<br />
Résolument tourné vers des problématiques de standardisation<br />
et de réduction des coûts, le Groupe a pris un tournant<br />
et s’investit depuis plusieurs mois dans la conception et<br />
la fabrication de produits « série » annexes au système pile à<br />
combustible comme par exemple une vanne by-pass embarquée<br />
dans le véhicule ou encore un CVM (Cell Voltage Monitoring)<br />
universel.<br />
Grâce à l’étroite collaboration avec des industriels comme<br />
Symbio, H2PULSE, ou des laboratoires comme le CEA ou<br />
Laplace et s’appuyant sur un solide réseau de partenaires<br />
(Hydrogen Europe, France Hydrogène), DAM Group affiche<br />
un objectif ambitieux : « Nous voulons être leader européen des<br />
bancs de test dans la filière hydrogène d’ici 2025.» déclare Guy<br />
CREPET son fondateur.<br />
EN SAVOIR PLUS ><br />
a.vignon@dam.fr / 04 78 26 95 83<br />
DAM Group - 200 rue Léon BLUM 69100 Villeurbanne - FRANCE<br />
www.damgroup.fr<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I37
DOSSIER<br />
RECHERCHE<br />
Un vent de dynamisme souffle sur la<br />
recherche dans l’hydrogène<br />
Les nombreux laboratoires du CNRS menant des projets dans l’hydrogène et réunis au sein<br />
de la Fédération FRH2 entendent bien profiter des investissements promis dans le plan de<br />
relance du gouvernement et ainsi accélérer la recherche fondamentale.<br />
Olivier Joubert Professeur<br />
à l’université de Nantes et<br />
chercheur à l'Institut des<br />
Matériaux Jean Rouxel (CNRS).<br />
Olivier Joubert enseigne au sein de Polytech Nantes. En outre,<br />
il dirige FRH2, la Fédération de recherche du CNRS portant sur<br />
l’hydrogène et représente le CNRS au conseil d'administration<br />
de l’association France Hydrogène (ex Afhypac).<br />
L’hydrogène a le vent en poupe ces derniers temps.<br />
Depuis le manifeste récemment lancé par l’association<br />
française France Hydrogène auprès du gouvernement<br />
et la position importante de cette énergie dans<br />
le plan de relance dévoilé au mois de septembre, les industriels<br />
et les acteurs de la recherche scientifique sont sur le pied de<br />
guerre. Ce domaine de recherche n’est certes pas nouveau mais<br />
Olivier Joubert constate « un intérêt grandissant, y compris des<br />
étudiants, sur les énergies renouvelables et en particulier l’hydrogène<br />
». Plus qu’un signe, un véritable engouement.<br />
Spécialiste et expert de la question, ce professeur de l’université<br />
de Nantes mène des travaux de recherche au sein du CNRS<br />
depuis plus de vingt ans dans la production d’hydrogène. Il<br />
travaille tout particulièrement dans la recherche de matériaux<br />
céramiques destinés à augmenter la durée de vie et les performances<br />
tout en réduisant les coûts des systèmes de production<br />
d’électrolyse. Olivier Joubert dirige également une des trois<br />
grandes fédérations de recherche du CNRS, FRH2 (la Fédération<br />
de recherche sur l’hydrogène), les deux autres étant consacrées<br />
au solaire photovoltaïque et aux batteries. « Aujourd’hui,<br />
l’essentiel des travaux de recherche sont réalisés en France à travers<br />
d’une part le CNRS, qui est présent à travers ses laboratoires<br />
sur tout le territoire, et le CEA dont la recherche est centralisée<br />
à Grenoble avec le Liten. » Les deux centres de recherche<br />
ont des approches différentes et complémentaires : le CNRS<br />
travaille sur la recherche fondamentale et appliquée comme<br />
des nouveaux matériaux par exemple, et va jusqu’au développement<br />
et les essais de systèmes. Le CEA effectue lui aussi des<br />
tests systèmes mais de façon beaucoup plus proche des industriels<br />
dans le cadre de travaux de recherche appliquée.<br />
S’APPUYER SUR UNE VISION GLOBALE DE L’HYDROGÈNE<br />
En matière de recherche sur l’hydrogène, il est essentiel de<br />
garder une vision d’ensemble, comme le rappelle le Pr. Joubert :<br />
dans l’automobile par exemple, cette énergie est combinée à des<br />
batteries et des super-condensateurs. « Je pense qu’il est important<br />
de considérer l’hydrogène comme un maillon des énergies<br />
renouvelables et, en tant qu’ingénieur, de maîtriser l’ensemble des<br />
savoirs associés aux technologies vertes (méthanisation, solaire,<br />
éoliennes, batteries…) ».<br />
Il en est de même au niveau de l’enseignement et plus particulièrement<br />
des masters : « nous avons lancé un travail de recensement<br />
des formations incluant les énergies, et ce sous toutes leurs<br />
38 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
formes ». Pour les IUT, l’état des lieux a concerné les formations<br />
ayant une spécialisation en électricité et gaz. « L’idée ici est d’introduire<br />
l’hydrogène comme une technologie comme une autre<br />
dans ses utilisations professionnelles et d’éliminer cette "peur de<br />
l’hydrogène" encore trop répandue dans les utilisations de la vie<br />
courante ». Cette cartographie des formations a pour objectif<br />
d’identifier les besoins et de proposer des supports de formation<br />
sur les nouvelles énergies en général. « Je reste en effet persuadé<br />
que le succès de la transition énergétique tient à la combinaison<br />
des énergies ».<br />
Concernant les projets de recherche, de nombreux travaux<br />
sont en cours. C’est le cas d’un projet portant sur les PCEC («<br />
protonic ceramic electrolyser cell » ou « électrolyseur à céramique<br />
conductrice protonique » en français) ; ceux-ci utilisent<br />
un matériau céramique comme l'électrolyte. « Actuellement, la<br />
production d’hydrogène s'effectue à haute température (800°C<br />
minimum) en utilisant de l’électricité et de la chaleur. Le problème<br />
est que les empilements sont chauffés à très haute température<br />
ce qui engendre de fortes dégradations ; en outre, l'hydrogène<br />
produit est mélangé avec la vapeur deau injectée d’où le besoin<br />
d’un système compliqué pour séparer les gaz. Une autre solution<br />
existe. Il s’agit des électrolyseurs PEM mais qui nécessitent l’utilisation<br />
de métaux rares, donc peu disponibles et coûteux. Les<br />
PCEC présente un bon compromis entre ces deux puisqu’ils ne<br />
nécessitent pas de mélanger l’hydrogène avec de la vapeur d'eau<br />
ni d’utiliser des métaux rares. De plus, ils sont chauffés à moyenne<br />
température – 500 à 600°C. – ce qui limite les problèmes liés à la<br />
fragilité des systèmes ».<br />
Un autre projet de recherche concerne l'augmentation de la<br />
pression des systèmes de pompage électrochimique à 40 bar.<br />
Objectif : réduire les volumes ainsi que les coûts d’énergie et<br />
augmenter le rendement (avant de passer au pompage mécanique).<br />
PROFITER DU PLAN DE RELANCE ET DE L’ENGOUEMENT<br />
GÉNÉRAL POUR L’HYDROGÈNE<br />
Pour Olivier Joubert, le plan de relance communiqué début<br />
septembre par le gouvernement va dans le bon sens. Pour lui, il<br />
« traduit la volonté de rassembler les acteurs à la fois industriels et<br />
financiers dans la production d’électrolyseurs » ; la priorité étant<br />
donnée à la production d’hydrogène en grande quantité afin<br />
de réduire les coûts au maximum. « Aujourd’hui, de nombreux<br />
systèmes sont sur l’étagère notamment les électrolyseurs PEM.<br />
Cependant, se pose le problème de la durée de vie de l’électrolyseur<br />
et leur coût. Il est donc essentiel de développer des procédés<br />
et des matériaux à la fois moins chers et plus durables ; c’est pourquoi<br />
la recherche est essentielle pour mettre au point des systèmes<br />
améliorant la quantité de platine afin de réduire les coûts finaux<br />
et augmenter la durée de vie de 10 à 20 %. ».<br />
Chose est sûre, c'est que les 65 millions d’euros promis permettront<br />
de donner un peu d’oxygène aux activités de recherche<br />
avec de nouvelles thèses et combler les activités qui tendaient<br />
à dépérir. Aussi, auparavant l’Agence nationale de la recherche<br />
(ANR), lorsqu'elle lançait des appels à projets, la thématique<br />
hydrogène était peu visible car mélangée avec d'autres batterie<br />
et solaire photovoltaïque, fortement sollicitées… Désormais,<br />
ce programme spécifique hydrogène va permettre de relancer<br />
la recherche notamment fondamentale sur des axes prioritaires<br />
définis par le CEA et le CNRS. Un minimum quand<br />
on veut faire de la France un leader mondial dans la matière. ●<br />
Olivier Guillon<br />
Équipement de mesure de performance<br />
d'un électrolyseur à haute température<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I39
DOSSIER<br />
NOMINATION<br />
François Legalland<br />
prend la direction<br />
du CEA-Liten<br />
Le 1 er novembre dernier, François Legalland<br />
a été nommé directeur du CEA-Liten. Il<br />
succède à Florence Lambert qui rejoint une<br />
société proche du CEA pour contribuer à<br />
l’essor de la filière hydrogène.<br />
François Legalland débute sa carrière en 1997<br />
chez IBM (puis Altis, co-entreprise entre IBM<br />
et Infineon) après avoir été diplômé de l'école<br />
Centrale de Lyon. Ingénieur Procédé puis chef de<br />
projet R&D, il devient ensuite chef de Service Engineering.<br />
Après un passage de deux ans dans la téléphonie chez<br />
Wavecom comme responsable du pôle Test & Packaging,<br />
il revient chez Altis en tant que manager de production<br />
avant d'être promu directeur Qualité et relations clients<br />
puis directeur de la business unit Test en 2008.<br />
En 2011, François Legalland rejoint Soitec en tant que<br />
vice-président Opérations pour l'Electronique et directeur<br />
du site de Bernin (Isère). Il est notamment en charge<br />
de la stratégie industrielle et de sa mise en œuvre ainsi que<br />
du pilotage de la performance.<br />
En 2014, il devient vice-président « Solar Operations »<br />
toujours chez Soitec et directeur du site de San Diego en<br />
Californie. C'est en 2015 que François Legalland rejoint le<br />
monde de la recherche au CEA-Liten en tant que chef de<br />
service Cellules et matériaux photovoltaïques et responsable<br />
du programme « hétérojonction ». Trois ans plus<br />
tard, il rejoint la direction du CEA-Liten pour s'occuper<br />
des projets d'industrialisation avant d'être promu directeur<br />
délégué aux opérations en 2019. ●<br />
Des électrodes originales<br />
pour améliorer les PEMFC<br />
Afin de réduire la quantité de platine dans les piles<br />
à combustible à membranes échangeuses protons<br />
tout en améliorant leurs performances, le CEA-Liten,<br />
institut de CEA Tech, a contribué à développer de<br />
nouvelles électrodes à base de nanotubes de platine,<br />
sans carbone. Cette nouvelle architecture d’électrode<br />
décarbonée permet de réduire la quantité de platine<br />
tout en améliorant les performances et la durabilité.<br />
Les chercheurs ont ainsi imaginé une structure à base<br />
de nanoparticules de platine assemblées entre elles<br />
afin de former un ensemble organisé de tubes creux<br />
de 50 nm de diamètre et 400 à 500 nm de long. Ces<br />
nanostructures autoportantes décarbonées ont montré<br />
une activité et une stabilité supérieures à celles des<br />
électrodes conventionnelles. L’ajout de nickel améliore<br />
encore la rapidité de la réaction et réduit les pertes de<br />
courant. Ces nouvelles électrodes, encore loin d’être<br />
industrialisées, sont un bel objet d’étude pour mieux<br />
comprendre le fonctionnement des PEMFC et faire<br />
émerger de nouvelles pistes de développement. Du<br />
chemin reste encore à parcourir pour augmenter la<br />
surface développée du platine (encore insuffisante), et<br />
réduire le coût des procédés de mise en œuvre.<br />
40 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
RECHERCHE<br />
Une céramique<br />
nanoporeuse<br />
pour économiser<br />
le platine pour<br />
la production<br />
d’hydrogène<br />
Associés à des scientifiques du monde<br />
entier, des chercheurs de l’IRCER (CNRS/<br />
Université de Limoges), de l’IEM (CNRS/<br />
ENSCM/Université de Montpellier) ont<br />
développé une céramique ultra-poreuse.<br />
Celle-ci permet à une couche de platine<br />
extrêmement fine de remplir son rôle de<br />
catalyseur dans une pile à combustible.<br />
Le dihydrogène est un vecteur énergétique d’intérêt<br />
en raison de sa densité d’énergie élevée. Il peut être<br />
produit à partir de diverses sources, utilisant des<br />
réactions impliquant des catalyseurs. Le platine est<br />
un élément essentiel à la plupart de ces cas, mais ce métal<br />
est peu abondant et est fortement demandé en bijouterie<br />
et pour des implants médicaux. Des efforts considérables<br />
sont donc mis en œuvre pour trouver des solutions qui en<br />
limitent ou en optimisent l’usage.<br />
Des scientifiques de l’Institut de recherche sur les céramiques<br />
(IRCER, CNRS/Université de Limoges) et de l’Institut<br />
européen des membranes (IEM, CNRS/ENSCM/<br />
Université de Montpellier), ainsi que l’Université fédérale<br />
de Santa Catarina (Brésil), de l’Institut de technologies<br />
de Nagoya (Japon), de l’Institut national des normes<br />
et des technologies (États-Unis), de l’Université technique<br />
du Moyen-Orient (Turquie) et de l’Institut indien de technologies<br />
de Madras (Inde) ont ainsi développé des céramiques<br />
ultra-poreuses dont la structure et la composition<br />
particulières permettent d’utiliser de très petites quanti-<br />
Un nanocomposite stable et efficace à<br />
base de TiN/Si3N4 comme catalyseur<br />
pour booster la production d’hydrogène à<br />
partir d’hydrures<br />
tés de nanoparticules de platine, hautement dispersées<br />
et accessibles. Ce système robuste a également l’avantage<br />
d’être réutilisable.<br />
La céramique en question, élaborée par une technique<br />
dite de « voie précurseur », est conçue à partir de titane,<br />
d’azote et de silicium. Lorsqu’une fine couche de platine<br />
est déposée à sa surface, le métal se répartit dans les pores<br />
du matériau et se retrouve ainsi avec une surface d’action<br />
démultipliée. L’effet est ensuite maximisé grâce au support<br />
céramique, augmentant encore la capacité d’une même<br />
quantité de platine à catalyser la production de dihydrogène.<br />
Les scientifiques travaillent à présent à l’obtention<br />
du système céramique/catalyseur complet en une seule<br />
étape tout en remplaçant le platine par des métaux moins<br />
coûteux. Publiés dans la revue Applied Catalysis B: Environmental,<br />
ces travaux pourraient être étendus à la réduction<br />
de l’usage du platine dans d’autres domaines. ●<br />
À savoir…<br />
Parmi ses nombreuses propriétés, le platine est très<br />
recherché pour son pouvoir catalytique. Ce métal<br />
présente cependant un coût élevé et son exploitation<br />
laisse une empreinte environnementale importante.<br />
Afin de l’utiliser en plus faibles quantités, voire de le<br />
remplacer.<br />
©Samuel Bernard<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I41
DOSSIER<br />
STRATÉGIE<br />
Dans l’hydrogène, Plastic Omnium vise un<br />
chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros !<br />
Le 25 novembre dernier, l’état major du groupe français a réuni la presse européenne afin d’exposer<br />
sa stratégie dans le secteur de l’hydrogène. Déjà présent dans la filière en tant qu’acteur de premier<br />
plan sur l’ensemble de la chaîne de valeur, Plastic Omnium entend devenir un leader mondial à<br />
la fois dans les réservoirs, les piles à combustibles et les systèmes d’hydrogène intégrés.<br />
Confinement ou pas, il était hors de question pour Plastic<br />
Omnium de repousser une telle annonce. Près de<br />
quatre mois après avoir exposé ses prévisions pour<br />
l’année 2020 (qu’il a finalement revues à la hausse), le<br />
géant français a organisé une conférence internationale sur l’hydrogène,<br />
animée par une journaliste franco-allemande.<br />
Un détail qui ne trompe pas puisque l’entreprise, déjà très présente<br />
Outre-Rhin, entend s’appuyer sur la bonne entente des deux piliers<br />
du Vieux Continent pour avancer ses pions dans une technologie<br />
d’avenir en Europe. « Les gouvernements, qu’ils soient allemands et<br />
français, sont en train de créer les bonnes conditions pour faire que<br />
la mobilité avec l’hydrogène devienne compétitive. À nous industriels<br />
de pérenniser la filière en réduisant les coûts de production au<br />
maximum », insiste le CEO de Plastic Omnium Laurent Faure.<br />
3 voire par 10, il va falloir redoubler d’efforts et investir massivement.<br />
Et c’est bien ce que compte faire Plastic Omnium qui, rappelons-le,<br />
a déjà investi pas moins de 200M€ depuis 2015, auxquels<br />
se sont ajoutés 115M€ ayant servi notamment à créer avec l’Allemand<br />
ElringKlinger la co-entreprise EKPO Fuel Cell Technologies,<br />
spécialisée dans la pile à combustible. Le groupe a également<br />
mis la main sur la filiale d’ElringKlinger en Autriche, spécialisée<br />
dans le système hydrogène intégré.<br />
Des opérations stratégiques puisqu’elles ont fait de Plastic<br />
Omnium, selon le groupe, « le seul acteur à proposer une offre<br />
complète sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, avec<br />
LA RÉDUCTION DES COÛTS DE PRODUCTION : LA CONDITION<br />
POUR RÉUSSIR LE PARI DE L’HYDROGÈNE<br />
Celui-ci en viendrait presqu’à en oublier la recherche fondamentale…<br />
Dans tous les cas, la vision est européenne mais pas seulement<br />
puisque le groupe mise aussi beaucoup sur l’Asie, premier<br />
marché – et de loin – de l’hydrogène au niveau mondial. Il faut<br />
dire que pour réduire les coûts de production en les divisant par<br />
42 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
des capacités de production déjà installées. Une ligne de production<br />
de réservoirs hydrogène vient d’être mise en service en Belgique<br />
pour livrer les premiers contrats de bus et de camions dès 2021 et<br />
la co-entreprise EKPO dispose d’une capacité annuelle de 10 000<br />
piles à combustible dans son usine allemande. »<br />
DEVENIR UN LEADER MONDIAL AVEC 3MD€ DE CHIFFRE<br />
D’AFFAIRES DANS L’HYDROGÈNE<br />
La stratégie de Plastic Omnium repose en grande partie sur<br />
des chiffres. Pour s’imposer sur un marché en forte croissance<br />
dès 2025 et qui devrait atteindre au moins 2 millions<br />
de véhicules en 2030, et générer au passage 3 Md€ de CA, le<br />
groupe compte investir 100 M€ par an dans les prochaines<br />
années. Pour y parvenir, l’enjeu consiste à devenir leader sur<br />
les trois segments clefs en réduisant les coûts au maximum :<br />
moins 30% sur les réservoirs hydrogène d’ici à 2030 et, dans<br />
le même temps, diviser par 5 ceux de la pile à combustible et<br />
du système hydrogène intégré. « Ces réductions significatives<br />
de coûts seront possibles notamment grâce à l’automatisation des<br />
procédés industriels, à l’effet volume et à l’optimisation du design<br />
et des matériaux (moins de fibre de carbone, moins de métaux<br />
précieux). D’ici 2030, le coût total du système hydrogène pour<br />
un véhicule particulier sera de l’ordre de 6 000 à 8 000 euros,<br />
rendant ainsi la technologie accessible à un marché de masse. »<br />
Des ambitions fortes et qui ne semblent pas avoir peur de la<br />
quasi-absence de visibilité pour 2021. Laurent Faure se veut pourtant<br />
rassurant : « Le groupe a mis en place rapidement toutes les<br />
mesures nécessaires pour adapter sa structure de coûts et pour<br />
préserver sa trésorerie : celles-ci ont permis de faire face à une<br />
production automobile en baisse de 33% au premier semestre 2020<br />
et de bénéficier au second semestre d’un redressement plus rapide<br />
qu’anticipé de la production automobile mondiale, en retrait estimé<br />
d’environ 3% (contre -10% à -15% initialement attendus) ». ●<br />
Olivier Guillon<br />
Experts en<br />
essais vibratoires<br />
• Contrôle vibratoire<br />
• Essai de choc<br />
• Analyse vibratoire et acoustique<br />
• Analyse modale expérimentale<br />
• Analyse de machines tournantes<br />
• Bancs d’essais<br />
m+p international Sarl<br />
5, rue du Chant des Oiseaux<br />
78360 Montesson<br />
Tél. : +33 130 157874<br />
sales.fr@mpihome.com<br />
www.mpihome.com<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I43
DOSSIER<br />
SOLUTION<br />
Obtenir une cartographie des brevets dans<br />
l’hydrogène… en quelques clics !<br />
L’établissement français dédié à la propriété industrielle utilise une solution permettant de repérer<br />
et de cartographier facilement et rapidement les inventions brevetées au niveau mondial. Un<br />
atout de taille pour les entreprises souhaitant se lancer dans des secteurs clefs mais hautement<br />
concurrentiels tels que le marché de l’hydrogène.<br />
Erwan Chapelier<br />
Ingénieur et<br />
chef de produit<br />
Cartographie au<br />
sein de l'Institut<br />
national de<br />
la propriété<br />
industrielle (Inpi)<br />
QU’EST-CE QUE L’INPI ?<br />
L'Institut national de la propriété industrielle<br />
(Inpi) est un établissement public,<br />
entièrement autofinancé, placé sous la<br />
tutelle du ministère de l'Économie, de l'industrie<br />
et du numérique. Il participe activement<br />
à l'élaboration et à la mise en œuvre<br />
des politiques publiques dans le domaine<br />
de la propriété industrielle. Il délivre les<br />
brevets, marques, dessins et modèles et<br />
donne accès à toute l'information sur la<br />
propriété industrielle et les entreprises avec<br />
l’ambition de favoriser le développement<br />
économique et l'innovation en France.<br />
QU’EST-CE QUE L’INFORMATION<br />
CONTENUE DANS LES BREVETS<br />
D’INVENTION PEUT APPORTER À<br />
L’ENTREPRISE POUR DÉFINIR SA<br />
STRATÉGIE ?<br />
Plus de 100 millions de brevets – tous<br />
domaines confondus – sont répertoriés<br />
dans les bases de données mondiales de<br />
brevets. Ceux-ci proviennent de 90 pays<br />
et sont déposés par toutes sortes d’entités.<br />
La CIB permet de distinguer les types de moyens de stockage protégés ou la nature de l’objet<br />
de la protection<br />
Pour une entreprise, déposer un brevet est un choix stratégique, et non le corollaire<br />
obligé de toute innovation technologique. L’examen des brevets déposés renseignent<br />
donc sur les stratégies d’entreprise et les tendances d’innovation.<br />
Quand les volumes deviennent importants, les cartographies de brevets proposées<br />
par l’Inpi peuvent être de bons indicateurs pour aider les entreprises à mieux<br />
percevoir l’écosystème des innovations, les guider dans leur stratégie et prendre<br />
les bonnes décisions, notamment en recherche & développement (R&D). Cette<br />
prestation donne aux PME-ETI les mêmes sources d’information que les grands<br />
groupes, à un prix accompagné (3 600 €), possiblement encore diminué de moitié<br />
grâce au Pass PI de l’Inpi.<br />
COMMENT FAIT-ON UNE CARTOGRAPHIE DE BREVET ?<br />
La cartographie des inventions brevetées est un paysage interactif mondial qui<br />
utilise une représentation ayant l’apparence d’une carte topographique (avec reliefs)<br />
pour visualiser la proximité entre les concepts techniques.<br />
Afin de réaliser une cartographie, un premier échange est réalisé entre l’entreprise<br />
44 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
DOSSIER<br />
Les ilots en blanc correspondent aux<br />
domaines technologiques où des brevets<br />
ont été massivement déposés. L’examen<br />
plus détaillé, permis par la cartographie<br />
de brevet, dévoile ilot par ilot le nom des<br />
acteurs et leurs stratégies de dépôts sur la<br />
filière.<br />
Les secteurs de cette cartographie permettent de retrouver les grandes classes de la Classification<br />
internationale des brevets (CIB)<br />
et l’Inpi, pour définir précisément le périmètre technique souhaité. L’élaboration<br />
de cette stratégie de requête est confiée à un ingénieur brevet qui la compose à<br />
partir de mots clés et de code Classification internationale des brevets (CIB). Une<br />
étude sur le stockage électrochimique révèle par exemple la répartition par technologie<br />
des brevets parmi les 617 000 brevets du secteur !<br />
Pour le domaine de l’hydrogène, les classes<br />
CIB, C01B3 : Hydrogen, Production d’hydrogène,<br />
Mélange et suivantes ainsi que<br />
Y02E60/30 : Hydrogen Technology attirent<br />
naturellement l’attention et renvoie après<br />
une première requête plus de 11 000 documents<br />
de brevet. Pour y voir plus clair sur<br />
des secteurs aussi fournis en brevet, une<br />
cartographie est un outil très utile. ●<br />
Propos recueillis par Olivier Guillon<br />
EN SAVOIR PLUS ><br />
www.inpi.fr/fr/cartographie-des-inventions<br />
7 SALONS NATIONAUX<br />
EN RÉGIONS<br />
SALON DES SERVICES, ÉQUIPEMENTS, PROCESS ET MAINTENANCE<br />
COLMAR<br />
AVIGNON<br />
DOUAI<br />
TOULOUSE<br />
09>11 JUIN 2020<br />
Pôle Sous-traitance<br />
29 SEPT. > 01 OCT. 2020<br />
Pôle Sous-traitance<br />
Forum de l’électronique<br />
26>28 JANVIER 2021<br />
Pôle Sous-traitance &<br />
Pôle Machine-outil & robotique<br />
01>03 JUIN 2021<br />
Pôle Sous-traitance<br />
Forum de l’électronique<br />
ANGERS<br />
ROUEN<br />
GRENOBLE<br />
MÊMES LIEUX / MÊMES DATES<br />
12>14 OCTOBRE 2021<br />
Pôle Sous-traitance<br />
Forum de l’électronique<br />
DES MILLIERS<br />
D’ÉQUIPEMENTS ET<br />
SALON<br />
PERMANENT DE SERVICES - 24H/7J<br />
WWW.SEPEM-PERMANENT.COM<br />
25>27 JANVIER 2022<br />
Pôle Sous-traitance<br />
LOCATION DE FICHIERS<br />
INDUSTRIELS MULTI-REQUÊTES<br />
DATA 63 350 sites de production<br />
276 800 mails directs<br />
WWW.SEPEM-DATA.COM<br />
08>10 FÉVRIER 2022<br />
Pôle Sous-traitance<br />
Forum de l’électronique<br />
17>19 NOVEMBRE<br />
2020 TURIN<br />
ITALIE NORD-OUEST<br />
TURIN.SEPEM-INDUSTRIES.COM<br />
Le salon de l’innovation<br />
et des solutions électroniques<br />
SEPEM Avignon 2020<br />
SEPEM Toulouse 2021<br />
SEPEM Angers 2021<br />
SEPEM Grenoble 2022<br />
En partenariat avec<br />
WWW.SEPEM-INDUSTRIES.COM I 05 53 36 78 78 I CONTACT@EVEN-PRO.COM<br />
200311-SEPEM PUB 185x120 2020.indd 1 11/03/2020 16:58<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I45
DOSSIER<br />
TECHNOLOGIE<br />
Des solutions de<br />
mesure au service<br />
de l’hydrogène<br />
décarboné<br />
Le défi que s’apprêtent à relever les entreprises<br />
françaises, avec le soutien du gouvernement<br />
dans le cadre du projet France Hydrogène, est<br />
immense. Bien que la technologie soit connue,<br />
la déployer massivement est un véritable<br />
challenge. Dans ce contexte, la maintenance<br />
des machines critiques et la surveillance des<br />
infrastructures seront déterminantes. Afin<br />
d’accompagner la filière H 2<br />
, le spécialiste de<br />
la mesure AllianTech propose une expertise<br />
technique et une approche globale.<br />
Bien connu des acteurs de la filière, la manipulation de<br />
l’hydrogène peut s’avérer délicate lorsque les volumes<br />
et les débits sont importants. Afin de garantir l’intégrité<br />
des sites, le matériel de mesure doit lui aussi être<br />
adapté. Les capteurs capacitifs sont particulièrement adaptés<br />
pour ces applications.<br />
Compatibles avec les environnements Atex et fonctionnant<br />
avec de très faibles niveaux énergies, les capteurs capacitifs<br />
permettent de réaliser des mesures stables en toute sécurité.<br />
La technologie française Capaab permet de mesurer le niveau<br />
et le débit de liquide cryogénique d’une cuve. Afin de suivre<br />
les phénomènes de cavitation au sein des machines tournantes,<br />
cette technologie est aussi capable de mesurer le taux de bulles<br />
présent dans le liquide.<br />
AU CHALLENGE TECHNIQUE S’AJOUTE LE DÉFI<br />
ÉCONOMIQUE<br />
La disponibilité et la productivité seront déterminants pour<br />
assoir le nouveau modèle économique de l’hydrogène. L’optimisation<br />
des procédés industriels et l’augmentation des rendements<br />
seront au cœur des réflexions de baisse des coûts. « En<br />
tant que spécialiste de la mesure, nous savons que la maintenance<br />
Machine Hydrogène<br />
sera un axe d’amélioration important pour réaliser les économies<br />
nécessaires, indique Raphaël Kassab, responsable Marketing<br />
chez AllianTech. C’est pour soutenir cet axe que nous proposons<br />
une série de capteurs, dans le domaine de l’analyse des chocs et<br />
des vibrations, capables de garantir la qualité de la surveillance<br />
des machines critiques ». Le succès d’une approche prédictive<br />
se traduit par une baisse durable du budget de maintenance.<br />
De nombreux équipements peuvent être instrumentés (pompe,<br />
machine-outil, compresseur, etc.). « Grâce à notre expérience<br />
nous savons combiner plusieurs types de mesures dynamiques<br />
(pression, courant, température, acoustique, etc.) pour récupérer,<br />
quel que soit l’environnement, les données pertinentes nécessaires<br />
à la prise de décision ».<br />
Il est certain que les solutions innovantes dans le domaine de<br />
la mesure permettront aux industriels de posséder un avantage<br />
concurrentiel pérenne. Aujourd’hui les technologies intelligentes<br />
et nomades ouvrent la voie vers une nouvelle façon<br />
de penser la surveillance de ces infrastructures et la maintenance<br />
de ces moyens de production. Les solutions associent les<br />
mesures dynamiques, l’intelligence artificielle et la communication.<br />
Elles seront des facteurs clés de succès dans la course au<br />
déploiement et à la rentabilité de la nouvelle filière hydrogène. ●<br />
46 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
VIE DE L’ASTE<br />
ÉVÉNEMENT<br />
Journée technique ASTE - CSTB : « Évolution<br />
des méthodes d’appréhension du confort<br />
thermique dans les bâtiments et les habitacles »<br />
L’association organisera l’an prochain une journée technique, conjointement organisée par l’ASTE et le CSTB. Celle-ci<br />
portera sur l’« Évolution des méthodes d’appréhension du confort thermique dans les bâtiments et les habitacles » ;<br />
celle-ci aura lieu au CSTB Nantes (les dates restent à confirmer).<br />
Soufflerie Jules Verne – projection de neige<br />
PROGRAMME DE LA JOURNÉE ASTE-CSTB<br />
MATINÉE : CONFÉRENCES TECHNIQUES<br />
CSTB : Modèle de thermophysiologie dynamique pour l’évaluation<br />
du confort et du stress thermique des usagers<br />
CSTB : Méthode Pulse d’évaluation du gout et de l’odeur de<br />
l’eau, ouverture vers le multisensoriel<br />
Le point sur la soufflerie Jules Verne :<br />
Modernisée et agrandie pour répondre aux enjeux émergents,<br />
la soufflerie Jules Verne est aujourd’hui une infrastructure<br />
scientifique et technique de pointe, unique par ses équipements<br />
innovants et son offre pluridisciplinaire. Elle est<br />
la seule au monde à pouvoir soumettre divers ouvrages et<br />
systèmes, dans les domaines de la construction, des transports<br />
et des énergies nouvelles, aux phénomènes climatiques,<br />
des plus simples aux plus extrêmes.<br />
Cette infrastructure de recherche internationale permet<br />
ainsi de tester, en un seul lieu, tout équipement à différentes<br />
échelles, jusqu’à l’échelle 1, en reproduisant toutes les conditions<br />
climatiques, et en couplant démarche numérique et<br />
expérimentale pour obtenir les résultats les plus performants.<br />
Alaa Châteauneuf – Cideco/Université Blaise Pascal : Optimisation<br />
des performances énergétique du bâtiment, prise<br />
en compte des changements climatiques.<br />
Nicolas François - Valeo : Les nouveaux défis de la simulation<br />
CFD pour optimiser le confort et la gestion thermique<br />
des véhicules électriques.<br />
Airbus : Mesure du confort des cabines (sous réserve)<br />
APRÈS-MIDI - VISITE DES INSTALLATIONS DE CSTB<br />
NANTES :<br />
• La soufflerie climatique Jules Verne<br />
• La soufflerie à couche limite atmosphérique (pour l’étude<br />
des bâtiments à échelle réduite)<br />
• Le bâtiment Aquisim dédié à l‘étude expérimentale du<br />
cycle de l’eau dans le bâtiment et au développement de<br />
nouveaux procédés innovants de traitement, récupération<br />
d’énergie...<br />
Aperçu schématique<br />
des installations<br />
nantaises<br />
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ ><br />
Patrycja Perrin au 01 61 38 96 32, pperrin@aste.asso.fr<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I47
Cycles<br />
Code<br />
Formation<br />
de Base<br />
ou Spécifique<br />
Intervenant et lieu<br />
Durée<br />
en jours<br />
Prix<br />
Adhérent<br />
ASTE HT<br />
Dates proposées<br />
Mécanique vibratoire<br />
Mesure et analyses des phénomènes vibratoires<br />
(Niveau 1)<br />
Mesure et analyses des phénomènes vibratoires<br />
(Niveau 2)<br />
MV1<br />
3 1 570 €<br />
B<br />
IUT du Limousin<br />
MV2 3 1 570 €<br />
30 mars-01 avril<br />
et 07-09 septembre<br />
15-17 juin<br />
et 14-16 septembre<br />
Application au domaine industriel MV3 B SOPEMEA (78) 3 1 570 €<br />
30 mars -<br />
01 avril<br />
Chocs mécaniques : mesures, spécifications, essais<br />
et analyses de risques<br />
MV4<br />
S<br />
Christian LALANNE, Henri<br />
GRZESKOWIAK et Yvon MORI (78)<br />
3 1 570 €<br />
23-25 mars<br />
et 23-25 novembre<br />
Traitement des signaux<br />
Traitement du signal avancé des signaux vibratoires TS S<br />
Analyse modale et Pilotage<br />
Pierre-Augustin GRIVELET et Bruno<br />
COLIN (78)<br />
3 1 570 € 28-30 septembre<br />
Pilotage des générateurs de vibration : principes utilisés<br />
et applications<br />
Analyse modale expérimentale et Initiation aux calculs de structure<br />
et essais<br />
PV S SOPEMEA (78) 4 1 890 € 23-25 novembre<br />
AM S SOPEMEA ou AIRBUS D&S (31) 3 1 570 € 05-07 octobre<br />
Climatique<br />
Les fondamentaux des essais climatiques CL B SOPEMEA (78) 2 1 350 €<br />
01-02 juin<br />
et 30 novembre -<br />
01 décembre<br />
Electromagnétisme<br />
Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM) Exploitation<br />
des normes<br />
EL S EMITECH (78) 2 1 170 € A définir<br />
Personnalisation Environnement<br />
Prise en compte de l’environnement dans un programme industriel<br />
(norme NFX-50144-1)<br />
P1 S Henri GRZESKOWIAK (78) 2 1 170 € 28-29 septembre<br />
Prise en compte de l’environnement mécanique (norme NFX-50144-3)<br />
Principes de personnalisation de base<br />
P2-1 S Bruno COLIN et Pascal LELAN (78) 3 1 570 €<br />
16-18 mars<br />
et 12-14 octobre<br />
Prise en compte de l’environnement mécanique (norme NFX-50144-3)<br />
Principes de personnalisation avancées<br />
Prise en compte de la norme NFX-50144 dans la conception<br />
des systèmes<br />
P2-2 S Bruno COLIN et Pascal LELAN (78) 3 1570 16-18 novembre<br />
P3 S Bruno COLIN (78) 3 1 570 € 23-25 novembre<br />
Prise en compte de l’environnement climatique<br />
(norme NFX-50144-4)<br />
P4<br />
S<br />
Henri GRZESKOWIAK et Henri<br />
TOLOSA (78)<br />
3 1 570 € 21-23 septembre<br />
Mesure<br />
Extensomètrie : collage de jauge, analyse des résultats<br />
et de leur qualité<br />
M1 S Raymond BUISSON (78) 3 1 570 €<br />
30 novembre -<br />
02 décembre<br />
Concevoir, réaliser, exploiter une campagne de mesures M2 B Pascal LELAN (78) 2 1 170 € 07-08 décembre<br />
Fiabilité et <strong>Essais</strong><br />
Conception et validation de la fiabilité - dimensionnement<br />
des essais pour la validation de la conception des produits<br />
E1 S Alaa CHATEAUNEF (78) 3 1 570 € A définir<br />
Les essais accélérés et aggravés E2 S Alaa CHATEAUNEF (78) 2 1 170 € A définir<br />
Fatigue des matériaux métalliques :<br />
<strong>Essais</strong>, dimensionnement et calcul de durée de vie<br />
sous chargement complexe<br />
E3 S Alexis BANVILLET 2 1 170 € 23-25 novembre<br />
Gestion d’une Salle blanche : application dans un Centre d’<strong>Essais</strong> ME1 S AIRBUS D&S (31) 2 1 170 € A définir<br />
L’assurance qualité dans les laboratoires d’essais selon le référentiel<br />
EN ISO/CEI 17025<br />
ME2 S EMITECH (78) 2 1 170 € A définir<br />
Thermométrie<br />
Thermométrie pour les essais vide thermique T1 S Alain BETTACCHIOLI (78) 1 900 € A définir<br />
Formations 2021
AGENDA<br />
Le 10 décembre 2020<br />
JOURNÉES COFREND 2020<br />
Maintenir et prolonger la durée de vie des structures, détecter et prédire leurs<br />
défaillances à l’aide de capteurs intégrés, constituent les enjeux du SHM : (Structural<br />
Health Monitoring) ou contrôle santé des structures.<br />
Exclusivement en digital<br />
www.cofrend2020.com<br />
Le 11 décembre 2020<br />
ASD DAYS 2020<br />
Organisé par ASTech Paris Région, pôle de compétitivité francilien de l’industrie<br />
aéronautique et spatiale regroupant plus de 330 établissements pour 85 000<br />
emplois, ASD Days est l'événement de l'innovation, des nouveaux modèles et des<br />
technologies de rupture dédiés à l'industrie aéronautique. Cette neuvième édition<br />
aura lieu en digital le 11 décembre prochain.<br />
En digital exclusivement<br />
www.asddays.aero/fr/<br />
Du 9 au 11 mars 2021<br />
JEC WORLD 2021<br />
Le salon mondial des professionnels des matériaux composites ouvrira ses portes du<br />
3 au 5 mars, au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Il s'agit de l'événement<br />
annuel le plus important du secteur, accueillant tous les acteurs majeurs dans un<br />
esprit d'innovation, d'affaires et de réseautage.<br />
À Paris Nord-Villepinte<br />
www.jec-world.events<br />
Du 16 au 19 mars 2021<br />
GLOBAL INDUSTRIE<br />
Composée de toutes les compétences, expertises, solutions, savoir-faire des 40<br />
principaux secteurs industriels, l’événement annuel de l’industrie réunit quatre<br />
grands salons leaders hexagonaux que sont Midest , Smart Industries, Industrie<br />
et Tolexpo.<br />
À Lyon Eurexpo<br />
www.global-industrie.com/fr<br />
Du 31 mars au 1er avril 2021<br />
RF & MICROWAVE<br />
9 e édition de RF & Microwave, le salon entièrement dédié aux secteurs des<br />
radiofréquences, des hyperfréquences, du wireless, de la CEM et de la fibre optique,<br />
réunira durant deux jours plus de 1 800 visiteurs professionnels – porteurs de projets.<br />
À Paris Porte de Versailles<br />
www.microwave-rf.com<br />
Les 7 et 8 avril 2021<br />
APS MEETINGS<br />
APS Meetings est une convention d’affaires dédiée à la fabrication additive, à<br />
l’impression 3D, au prototypage rapide et au développement produit. Près de 300<br />
participants pour plus de 2 600 rendez-vous…<br />
À Lyon<br />
www.apsmeetings.com<br />
Du 21 au 23 mai 2021<br />
AUTOMOTIVE TESTING EXPO<br />
Fin mai prochain, le plus vaste salon mondial consacré aux technologies et services<br />
de test et de validation de véhicules et de composants ouvrira ses portes à Stuttgart.<br />
Au total, le salon rassemblera plus de 400 exposants et accueillera près de 9 000<br />
visiteurs.<br />
Au Messe Stuttgart (Allemagne)<br />
www.testing-expo.com<br />
Un carrefour d’échanges incontournable pour les experts,<br />
les ingénieurs et les techniciens de l’environnement<br />
Rejoignez-nous<br />
pour enrichir vos connaissances et participer activement à la promotion, à la<br />
diffusion et à la mise en œuvre au sein de l’industrie française des dernières<br />
techniques d’essais et de simulation de l’environnement.<br />
Nos adhérents bénéficient de réductions substantielles sur les tarifs<br />
de nos stages de formation, journées techniques, colloques, salons,<br />
ouvrages et guides techniques.<br />
Depuis 1967, nous avons formé plus de 6 000 scientifiques, ingénieurs<br />
et techniciens. Nos formations sont dispensées par les meilleurs experts<br />
du moment, sélectionnés au sein des sociétés et laboratoires français<br />
de pointe.<br />
Qui est concerné par notre activité ?<br />
• Les laboratoires d’essais, les équipementiers,<br />
les concepteurs et intégrateurs de systèmes<br />
• Les scientifiques, ingénieurs et techniciens<br />
en charge de la conception, des essais,<br />
de la fabrication et de la qualité<br />
• Les concepteurs, constructeurs et vendeurs<br />
des moyens d’essais<br />
• Les étudiants et les enseignants<br />
Association pour le développement des Sciences et Techniques de l’Environnement - Association régie par la loi 1901<br />
1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - www.aste.asso.fr - Tel : 01 61 38 96 32<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021 I49
INDEX<br />
Au sommaire du prochain numéro :<br />
© Cetim Maroc<br />
DOSSIER<br />
ESSAIS ET MODELISATION<br />
<strong>Essais</strong> & simulation de matériaux<br />
Matériaux plastiques, composites<br />
et issus de la fabrication additive<br />
© Evatec Tools<br />
Spécial Guide du matériel et des<br />
moyens d’essais dans l’industrie<br />
Équipements et machines d’essai :<br />
état de l’art du marché et nouvelles<br />
technologies.<br />
MESURES<br />
Électromagnétisme / CEM / Mesure<br />
d’ondes<br />
Objets connectés et Intelligents : IIoT,<br />
capteurs intelligents et métrologie<br />
« 4.0 » à l’honneur<br />
© EDF<br />
Liste des entreprises citées et index des annonceurs<br />
ADVITAM.......................................................................... 6<br />
AIR LIQUIDE…............................................................... 32<br />
ALLIANTECH.............................................................. …44<br />
ALTAIR ENGINEERING................................................ …6<br />
ASTE................................................................…45, 46, 47<br />
ATER METROLOGIE..................................................... …6<br />
AVNIR ENGINEERING.................................................. …6<br />
BEI.............................................................................. …35<br />
BOWEN....................................................................... …14<br />
CEA-LITEN................................................................. …38<br />
CETIAT.......................................................................... …8<br />
CHAUVIN ARNOUX.................................................... …23<br />
CNRS.................................................................... …36, 38<br />
COLLÈGE FRANÇAIS DE MÉTROLOGIE (CFM)........... 18<br />
COMSOL.................................. 4 E DE COUVERTURE, 26<br />
DAM FRANCE (PUBLI-COMMUNIQUÉ)...........................<br />
DB VIB..................................................................... 1,2, 20<br />
DEWE FRANCE...................................................... 4,9, 17<br />
DJB INSTRUMENTS...................................................... 33<br />
EC COMPLIANCE...................................................... 9, 12<br />
EIKOSIM................................................................ 6, 7, 11<br />
ELLAB............................................................................ 26<br />
FAURECIA........................................................................ 7<br />
FÉDÉRATION FRH2...................................................... 36<br />
FRANCE HYDROGÈNE............................................ 28, 35<br />
IMV CORPORATION....................................................... 24<br />
INPI................................................................................ 42<br />
KONICA MINOLTA (RADIANT)........ 2 E DE COUVERTURE<br />
M+P INTERNATIONAL.................................................. 41<br />
MESURES-ET-TESTS................................................... 17<br />
MAYR FRANCE.............................................................. 21<br />
PLASTIC OMNIUM........................................................ 40<br />
SEPEM........................................................................... 43<br />
LE CHIFFRE À RETENIR<br />
7,2 Md€<br />
Voici le montant dévoilé par le gouvernement français, dans le<br />
but de soutenir le développement de l’hydrogène décarboné<br />
à travers les ambitieux objectifs de la loi Énergie Climat (dont<br />
les investissements représentent au total 24 Md€ d’ici à 2030),<br />
annoncé au sein de son Plan de relance. Une manne financière<br />
non négligeable au regard de la quasi-absence d’effet – et de<br />
moyens – qu’avait généré le premier plan avorté de Nicolas Hulot,<br />
alors ancien ministre du gouvernement Philippe. Pour le président<br />
de France Hydrogène Philippe Boucly, longuement interviewé<br />
dans ce numéro spécial d’<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong> consacré à la<br />
filière, tous les signaux sont au vert et en adéquation avec les<br />
besoins des acteurs de l’hydrogène, qu’ils soient industriels,<br />
issus de la recherche ou utilisateurs.<br />
Retrouvez nos anciens numéros sur :<br />
www.essais-simulations.com<br />
50 IESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>143</strong> • décembre 2020 - janvier 2021
Abonnez-vous<br />
maintenant à ESSAIS & SIMULATIONS<br />
DÉSORMAIS DISPONIBLE<br />
SUR TOUS VOS SUPPORTS<br />
L’appli<br />
Le kiosque digital<br />
Téléchargez<br />
l’application<br />
MRJ Presse<br />
Le magazine papier<br />
Le site web<br />
www.essais-simulations.com
Les véhicules autonomes nécessitent des<br />
batteries ayant une puissance durable.<br />
Visualisation du profil<br />
de température dans<br />
une batterie Li-ion à<br />
refroidissement liquide<br />
Le stade dans le cycle de charge, le potentiel, la concentration<br />
locale, la température et la direction du courant ont tous une<br />
incidence sur le vieillissement et la dégradation d’une cellule de<br />
batterie. Il est important d’en tenir compte lors du développement<br />
de véhicules autonomes, dont le fonctionnement repose sur un<br />
grand nombre de composants électroniques. Pour concevoir<br />
des batteries longue durée suffisamment puissantes pour tenir<br />
le rythme des demandes en énergie, les ingénieurs peuvent se<br />
tourner vers la simulation.<br />
Le logiciel COMSOL Multiphysics® est utilisé pour la conception<br />
et la simulation des composants et des procédés dans tous les<br />
domaines de l’ingénierie, de la fabrication et de la recherche.<br />
Découvrez comment vous pouvez l’appliquer pour optimiser la<br />
conception des batteries pour les voitures autonomes.<br />
comsol.blog/autonomous-vehicle-batteries