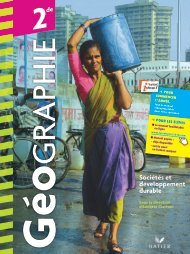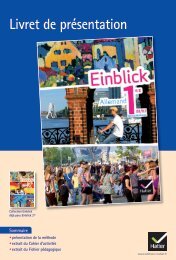Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
D’un texte à l’autre 2<br />
Louise Labé, Sonnets (1555)<br />
Objectif : Mettre Musset en relation avec<br />
un poème de la Renaissance, aux sources<br />
du lyrisme moderne.<br />
Questions<br />
1. Cette relation amoureuse est présentée à travers différentes<br />
étapes. Le premier quatrain évoque la rencontre avec les deux<br />
verbes reconnus et vis (v. 4). Puis Louise Labé aborde l’amour<br />
partagé dans le second quatrain, les adverbes fatalement (v. 5)<br />
et ardentement (v. 8) sonnent comme une obligation par la<br />
richesse de leur rime. Enfin, les deux tercets présentent les<br />
conséquences funestes de cette relation : les mots à connotation<br />
négative l’emportent à partir du vers 11.<br />
2. Une rupture est nettement perceptible au vers 11 grâce à<br />
la conjonction de coordination mais qui, placée en tête de<br />
phrase, indique une opposition. La question rhétorique qui<br />
précède évoquait la continuation de cette histoire d’amour<br />
comme une évidence. D’autre part, dans un sonnet, la forme<br />
sert le sens et les tercets peuvent s’opposer aux quatrains<br />
comme c’est le cas ici.<br />
3. Le sens dominant dans ce récit poétique est la vue, comme<br />
le prouve son champ lexical composé des termes figure (v. 2),<br />
décrite (v. 3), peinture (v. 3), reconnus (v. 4), voyant (v. 5) et<br />
vois (v. 11). Ce sont les verbes de perception qui prédominent,<br />
le verbe voir apparaît à trois reprises avec des valeurs différentes<br />
: il s’agit de la rencontre évoquée au passé simple dans<br />
la proposition subordonnée temporelle quand vis premièrement.<br />
La poétesse insiste sur sa passivité. Le deuxième verbe<br />
est utilisé au participe présent, voyant, synonyme de constater,<br />
tout comme le dernier verbe utilisé au présent, formant un<br />
écho sonore avec je crois (v. 13).<br />
4. La cause de cette relation amoureuse et de son évolution<br />
est la fatalité, vraisemblablement celle d’un mariage arrangé.<br />
Le champ lexical de la prédiction indique que ce mariage<br />
devait avoir lieu sans que le consentement de la femme ait été<br />
demandé. On trouve ainsi les mots prédit (v. 1), Ciel et destins<br />
firent naître (v. 10) et infernaux arrêts (v. 13). Le participe passé<br />
prédit, inversé pour constituer le premier mot du poème, souligne<br />
que la décision a été prise très tôt. Ce mariage est même<br />
forcé comme le montre le verbe forçai (v. 7) qui met en relief<br />
le fait que la poétesse n’a pas d’attirance pour cet homme.<br />
13<br />
5. Dans les quatre derniers vers, l’amour est présenté à travers<br />
une métaphore filée de la tempête : nubileus apprêts, vents<br />
si cruels, horrible orage et naufrage. Le poème revêt alors<br />
une tonalité lyrique : la nature semble refléter l’échec de la<br />
relation amoureuse par l’image du naufrage. L’expression des<br />
sentiments personnels de la poétesse est perceptible par les<br />
adjectifs cruels et horrible (v. 12) renforcés par les adverbes<br />
d’intensité si et tant. La poétesse souffre beaucoup.<br />
Vis-à-Vis : louise labé et musset<br />
6. a. Les deux poètes sont confrontés à une situation similaire<br />
: la fin de leur histoire d’amour.<br />
b. Ils n’expriment pas leurs sentiments de la même manière.<br />
Musset exprime son chagrin avec un sentiment de révolte<br />
contre la femme aimée qui le rejette et qu’il semble écarter<br />
à son tour comme le prouvent les nombreux impératifs tels<br />
que Partez (v. 23 et 28), Allez (v. 32) et Jetez au vent (v. 34)<br />
placés systématiquement en tête de vers. Louise Labé apparaît<br />
comme passive, victime de cet échec. Le modalisateur je crois<br />
(v. 13) montre le doute, l’incertitude quant à l’explication des<br />
difficultés dans son couple. Le dernier vers place sa personne<br />
en pronom complément dans la proposition : les infernaux<br />
arrêts […] m’ourdissaient ce naufrage, mettant en valeur la<br />
fatalité pesant sur son sort.<br />
7. Les références au Ciel et aux divinités ne sont pas utilisées<br />
de la même façon. Chez Musset, les mentions de Dieu, grand<br />
Dieu ! ou Eternel Dieu !, apparaissent comme des interjections<br />
qui accentuent l’agitation du poète. La Nature immortelle<br />
(v. 28) peut apparaître comme une divinité en raison de la<br />
majuscule et de l’adjectif ; on pense alors à dame Nature,<br />
cette force vitale venue de la terre, ou à la déesse grecque,<br />
Gaïa.<br />
Au contraire, Louise Labé donne l’impression que le Ciel<br />
agit vraiment dans son histoire d’amour. D’une part, il est<br />
à l’origine de la relation puisqu’il l’a même engendrée avec<br />
les destins (v. 10) qu’il est possible d’associer aux Moires<br />
grecques ou aux Parques romaines, ces divinités qui tissent<br />
le fil de la vie. D’autre part, la poétesse fait intervenir Hadès,<br />
le dieu des Enfers, grâce à l’expression les infernaux arrêts qui<br />
montre comment la décision de la fin de l’histoire d’amour<br />
est irrévocable et a été prise par une puissance supérieure.<br />
Prolongement : Prendre l’un des deux points de comparaison<br />
(6b ou 7) et rédiger un paragraphe de commentaire comparé,<br />
exercice difficile mais formateur que les élèves pourront<br />
retrouver en Première.<br />
TL2_prof_8p_sauvergarde.indd 13 14/03/11 19:32<br />
13