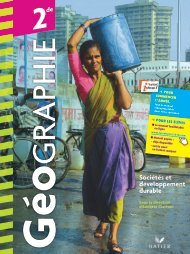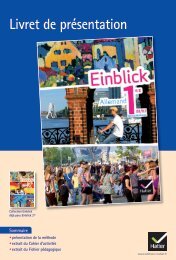Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
une synthèse sur l’histoire des arts faisant<br />
écho à la problématique de la séquence…<br />
…sur les divers domaines d’expression artistique ou sur des thèmes ou<br />
mouvements artistiques (peinture, photo, sculpture, musique, cinéma…).<br />
HISTOIRE DES ARTS<br />
Scènes de genre et vie quotidienne en peinture<br />
L<br />
es genres de l’art pictural ont longtemps été rigoureusement<br />
hiérarchisés par les académies : on situait au sommet de<br />
l’échelle des valeurs les œuvres épiques, historiques, mythologiques et<br />
religieuses ; on jugeait vulgaire la représentation de scènes familières.<br />
1 ● Monde profane et religion<br />
Dès l’Antiquité, les activités<br />
humaines les plus simples ont été<br />
montrées : certaines peintures égyptiennes<br />
représentent les travaux des<br />
champs ou des banquets ; il ne<br />
s’agit pas là de réalisme documentaire,<br />
mais d’une vaste synthèse des<br />
activités terrestres transposées dans<br />
l’au-delà, lieu répliquant le monde<br />
d’ici-bas, celui des hommes.<br />
Les scènes bibliques humanisent les<br />
thèmes sacrés en les situant dans<br />
un cadre familier.<br />
2 ● Vanités et peinture de genre<br />
Les artistes hollandais du XVII e siècle<br />
ont mis à l’honneur et popularisé les<br />
tableaux mettant en scène la réalité<br />
apparemment la plus ordinaire, mais<br />
de façon symbolique :<br />
– les vanités sont des natures<br />
mortes évoquant la mort et les<br />
illusions humaines, en vogue à<br />
l’époque de la <strong>Réforme</strong> ; les peintres<br />
protestants ne représentaient pas<br />
les personnages sacrés comme les<br />
saints ou les martyrs… Ils recouraient<br />
donc à des allégories ;<br />
– la peinture de genre est la représentation<br />
d’hommes et de femmes<br />
s’adonnant à leur travail ou à leurs<br />
divertissements. Cette tradition, qui<br />
s’est répandue dans plusieurs pays<br />
d’Europe dès la fin du XVI e siècle, à<br />
l’époque baroque, peut prendre une<br />
dimension allégorique, avec le même<br />
Dans La Vierge à la soupe au lait<br />
(1515) de Gérard David 1 , l’enfant<br />
Jésus joue avec une cuiller en<br />
bois, tandis que la Vierge Marie lui<br />
donne à manger. Le décor est loin<br />
du monde antique de l’histoire d’origine<br />
: le mobilier, le livre, le paysage<br />
flamand aperçu par une fenêtre, la<br />
coiffe de la Vierge… sont contemporains<br />
du peintre. La pomme et<br />
le pain, au premier plan, l’attitude<br />
maternelle de la Vierge donnent un<br />
aspect familier à cette scène intime.<br />
souci de la couleur et de la lumière<br />
que les sujets bibliques, comme en<br />
témoigne le tableau de l’Espagnol<br />
Diego Velázquez, Vieille femme faisant<br />
frire des œufs (1618).<br />
Dans La Dentellière de Vermeer<br />
(1664) 2 , l’attention de la femme<br />
à son travail est rendue par une<br />
contre-plongée en plan buste qui<br />
permet de saisir tous les détails<br />
réalistes de cette activité artisanale.<br />
L’observateur du tableau semble<br />
surprendre le personnage appliqué<br />
à sa tâche.<br />
Les scènes de genre offrent deux<br />
intérêts complémentaires :<br />
– un intérêt documentaire, puisqu’ils<br />
constituent une mine d’informations<br />
sur les outils des artisans, les instruments<br />
de musique, la décoration, les<br />
costumes, le corps humain… ;<br />
1 Légende à venir<br />
L E X I Q U E<br />
Allégorie Représentation imagée<br />
d’une idée abstraite.<br />
Plan buste Cadre qui privilégie<br />
la tête et le buste du personnage,<br />
jusqu’à la taille.<br />
Q U E S T I O N S<br />
1. Dans les tableaux reproduits,<br />
les regards des personnages sont-ils<br />
dirigés vers l’observateur du tableau ?<br />
Pour quelle raison, selon vous ?<br />
2. Dans La Dentellière 2 , observez<br />
le jeu des couleurs : que met-il<br />
en valeur ?<br />
– un intérêt moral ou philosophique,<br />
lorsque les tableaux évoquent<br />
la condition humaine : les vertus<br />
comme le courage, le sens du<br />
devoir, la générosité…donnent lieu<br />
à des œuvres qui se rapprochent du<br />
genre de l’éloge en littérature. Les<br />
défauts, à l’inverse, sont représentés<br />
de manière comique, voire satirique<br />
➜ SÉQUENCE 5, p. 000 (Le Caravage, Les<br />
Joueurs de cartes ou les Tricheurs,<br />
1594-1595). Les misères de la vie,<br />
enfin, confèrent à certaines œuvres<br />
une dimension lyrique ou pathétique,<br />
comme dans les toiles des<br />
frères Le Nain représentant les paysans<br />
sous Louis XIII.<br />
3 ● Le réalisme en peinture<br />
Entre 1825 et 1875, un groupe de<br />
peintres s’installe dans le village de<br />
Barbizon, près de Fontainebleau,<br />
pour travailler « d’après nature ».<br />
Parmi les fondateurs de cette école<br />
figure Jean-François Millet (1814-<br />
2 Légende à venir<br />
1875), dont l’œuvre rend hommage<br />
au labeur des paysans.<br />
Ces peintres réalistes, comme Gustave<br />
Courbet, puis les impressionnistes,<br />
comme Edgar Degas, ont<br />
finalement rejeté toute hiérarchisa-<br />
tion des sujets ➜ SÉQUENCE 15, p. 000<br />
(Monet, Les Déchargeurs de charbon,<br />
1875) : l’homme mérite, selon eux,<br />
d’être valorisé, quels que soient son<br />
milieu et son statut, y compris dans<br />
des tableaux de grand format ➜ ANA-<br />
LYSE D’IMAGE.<br />
Lui-même fils de paysan, Jean-François<br />
Millet fait scandale lorsqu’il<br />
expose en 1855 ce Paysan répandant<br />
du fumier 3 . Le public bourgeois,<br />
habitué aux œuvres représentant<br />
des activités plus nobles, est outré.<br />
Or le peintre veut montrer que ce<br />
n’est pas le sujet qui fait la beauté<br />
d’une œuvre mais la manière de<br />
peindre : le dégradé des ocres et la<br />
gestuelle du personnage, au premier<br />
plan, confèrent à la toile une grandeur<br />
épique, qu’admirant le romancier<br />
Émile Zola.<br />
3 Légende à venir<br />
276 277<br />
Avec aussi : un lexique et des activités.<br />
une analyse<br />
d’image intégrée<br />
au corpus (toutes<br />
époques et tous<br />
supports).<br />
un questionnaire<br />
progressif avec un<br />
recours possible au<br />
chapitre de la partie<br />
II sur l’image.<br />
Analyse<br />
d’image<br />
Légende à venir<br />
QUESTIONS<br />
Première approche<br />
1. Dans quelle région la commune d’Ornans se situet-elle<br />
? Pourquoi le peintre l’a-t-il choisie, à votre<br />
avis ? Aidez-vous d’un dictionnaire.<br />
2. À droite de la fosse, au premier plan, deux éléments<br />
peuvent surprendre : lesquels ? Justifiez.<br />
Analyse<br />
3. Quel effet le choix du format de la toile (dimensions<br />
et orientation) produit-il ?<br />
Séquence 13 � Les sources du roman réaliste<br />
Gustave COURBET (1819-1877)<br />
Un Enterrement à Ornans (1850)<br />
Loin de sublimer la banalité, comme l’avaient fait Jean-François Millet et l’école de Barbizon ➜ HISTOIRE DES ARTS,<br />
Courbet montre la simple réalité sans l’idéaliser. Comme pour le tableau L’Après-dîner à Ormans (1849),<br />
le scandale est relancé en 1850 lorsqu’il expose Un Enterrement à Ornans qui représente des hommes<br />
ordinaires peints sur une toile d’un format habituellement réservé aux scènes mythologiques ou historiques.<br />
4. a. Observez le groupe des participants à cet enterrement<br />
: quelle ligne forme-t-il ? Expliquez<br />
b. Quels personnages se détachent particulièrement<br />
? Pour quelles raisons ?<br />
5. Comment les couleurs des costumes sont-elles réparties<br />
? Que peuvent-elles symboliser ?<br />
6. Comparez l’arrière-plan du tableau et le tout premier<br />
plan : sur quel effet le peintre joue-t-il ?<br />
➜ p. 000 : L’IMAGE FIXE<br />
Question de synthèse<br />
7. Quels points communs existe-t-il entre le travail du<br />
romancier et celui du peintre réaliste, d’après l’étude<br />
de ce tableau ?<br />
269<br />
7