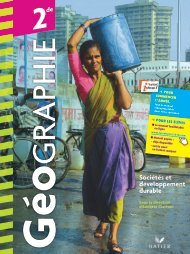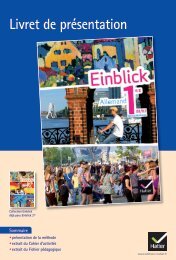Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
Terres Littéraires - Réforme Lycée - Editions Hatier
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. Le champ lexical de la religion confirme la réponse à la<br />
question 3 : flèche gothique, son religieux, cloche rustique,<br />
saints concerts. La nature est ainsi étroitement liée au divin<br />
(l’église) et à l’humain (le voyageur). La présence d’éléments<br />
visuels et auditifs accentue ici le lyrisme du poème, et se rattache<br />
à l’idéal romantique d’un art total, faisant appel à tous<br />
les sens.<br />
aPProfondir<br />
3. Romantisme et influence<br />
pétrarquiste<br />
1. La première phrase se clôt avec l’allégorie de l’Amour,<br />
que l’on identifie grâce à la majuscule et à l’emploi du verbe<br />
confier qui personnifie ce sentiment. On remarque aussi<br />
une métaphore doublée d’un oxymore dans le GN fardeau<br />
précieux.<br />
2. Le comparant est cette longue expression : le cerf frappé<br />
d’une flèche, [qui] s’enfuit emportant dans son flanc le fer<br />
Fiche 4<br />
15<br />
envenimé, et souffre d’autant plus qu’il s’agite davantage ;<br />
l’outil de comparaison est tel, repris anaphoriquement au<br />
début des deux strophes ; le comparé est : Tel j’emporte au<br />
côté gauche ce trait qui me consume et me charme pourtant.<br />
Le comparé et le comparant sont reliés par le thème de la<br />
blessure, métaphore de la passion amoureuse, puisque le<br />
côté gauche évoque le cœur.<br />
3. L’amour est vécu comme un sentiment contradictoire que<br />
résument les oxymores fardeau précieux, beau joug ou les<br />
antithèses éloigné ≠ rapproché, consume ≠ charme. Cette<br />
vision de la passion amoureuse est empreinte de tragique,<br />
car le poète exprime son impuissance à se délivrer de ce qui<br />
le fait tant souffrir, ce fardeau précieux (…) plusieurs fois et<br />
inutilement secoué, ce que confirme ce paradoxe : mais plus<br />
je m’en éloigne, et plus je m’en trouve rapproché.<br />
La conclusion du sonnet insiste sur ce paradoxe tragique : et<br />
la douleur me fait périr et la fuite m’accable qui rappelle cette<br />
autre formule contradictoire : quand j’ai quitté ces lieux que<br />
je ne puis jamais quitter. La présence et l’absence sont également<br />
insupportables, le poète est donc dans une impasse.<br />
Les registres lyrique et élégiaque<br />
➜ Livre de l’élève, p. 413<br />
Exercices d’application<br />
mettre au Point<br />
1. La poésie lyrique<br />
1. a. Le locuteur de ce texte est le poète lui-même. C’est ce<br />
que montre l’emploi du pronom personnel je (vers 1 et 2),<br />
mais aussi me (v. 3). Le destinataire est la femme aimée, à<br />
laquelle le poète s’adresse à l’aide de la deuxième personne<br />
du singulier avec, par exemple, les adjectifs possessifs tes (v. 1)<br />
et ton (v. 4) ou le pronom personnel objet te (v. 4). On trouve<br />
également l’apostrophe Madame dès le vers 1.<br />
b. Le vers 1 produit un effet de surprise sur le lecteur. En<br />
effet, alors que le poète apostrophe la femme aimée à l’aide<br />
du mot Madame, le locuteur emploie un adjectif possessif de<br />
deuxième personne du singulier qui crée un décalage surprenant<br />
et intimiste.<br />
2. Il s’agit d’un poème lyrique dans lequel le locuteur<br />
évoque ses sentiments amoureux pour la dame de son cœur,<br />
Cassandre. Ses émotions semblent tellement fortes qu’elles<br />
le poussent à envisager de mourir. Si le bonheur d’aimer<br />
est exprimé à l’aide de l’adjectif qualificatif content (v. 2) et<br />
l’expression plus grand honneur (v. 3), il est mis en parallèle<br />
avec l’idée de mort grâce aux verbes trépasser (v. 1) ou rendre<br />
l’âme (v. 4).<br />
Ronsard utilise l’hyperbole, qui amplifie le propos et montre<br />
ainsi la force de ses sentiments. L’hyperbole est employée à<br />
trois reprises dans la strophe : au vers 1, avec trépasse, qui<br />
indique que le locuteur est prêt à mourir pour celle qu’il aime,<br />
tout comme au vers 4 avec l’expression rendre l’âme ; mais<br />
aussi dans l’expression plus grand honneur du monde qui fait<br />
comprendre à quel point ses sentiments rendent le poète fier.<br />
TL2_prof_8p_sauvergarde.indd 15 14/03/11 19:32<br />
15