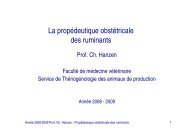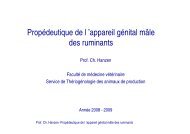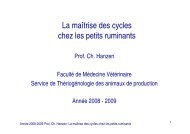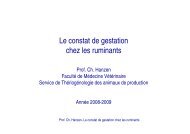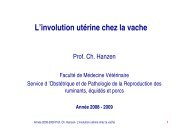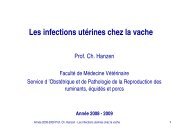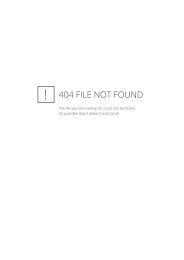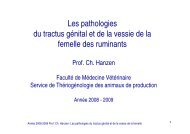La pathologie infectieuse de la glande mammaire Etiopathogénie et ...
La pathologie infectieuse de la glande mammaire Etiopathogénie et ...
La pathologie infectieuse de la glande mammaire Etiopathogénie et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pathologie <strong>infectieuse</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>la</strong>n<strong>de</strong> <strong>mammaire</strong>. Approche individuelle. 46<br />
traduisent par une réaction inf<strong>la</strong>mmatoire endéans les 3 à 5 jours. Il existe cependant <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges variations selon les<br />
individus <strong>et</strong> <strong>la</strong> virulence <strong>de</strong>s germes. Le processus d’invasion <strong>et</strong> d’inf<strong>la</strong>mmation présente initialement une phase<br />
<strong>de</strong> multiplication rapi<strong>de</strong> du germe dans les canaux <strong>la</strong>ctifères suivie d’un passage <strong>de</strong>s bactéries dans les vaisseaux<br />
lymphatiques <strong>et</strong> les ganglions rétro<strong>mammaire</strong>s. A ce sta<strong>de</strong>, les lésions épithéliales <strong>de</strong>s acinis se traduisent par une<br />
diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>la</strong>itière. Le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase d’invasion se traduit par une augmentation très élevée<br />
du nombre <strong>de</strong> germes (200 colonies /ml) puis par leur diminution <strong>et</strong> par l’augmentation du nombre <strong>de</strong><br />
polymorphonucléaires lorsque <strong>la</strong> tuméfaction <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>la</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong>vient visible. Celle-ci correspond à l’inf<strong>la</strong>mmation du<br />
tissu alvéo<strong>la</strong>ire mais aussi à <strong>la</strong> rétention <strong>de</strong> <strong>la</strong>it dans les alvéoles distendus. C<strong>et</strong>te réaction inf<strong>la</strong>mmatoire peut<br />
également être observée au niveau <strong>de</strong>s trayons. A ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>pathologie</strong>, il est donc possible <strong>de</strong><br />
ne pas pouvoir isoler le germe en cause. <strong>La</strong> présence <strong>de</strong> grumeaux dans le <strong>la</strong>it correspond au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’atteinte<br />
épithéliale. Apparaît alors une fibrose du tissu interalvéo<strong>la</strong>ire qui progressivement <strong>et</strong> selon le rythme <strong>de</strong>s phases<br />
<strong>de</strong> multiplication <strong>et</strong> <strong>de</strong> rémission va toucher un nombre croissant <strong>de</strong> lobules.<br />
b. Les Staphylocoques<br />
Staphylococcus aureus (hémolytique <strong>et</strong> coagu<strong>la</strong>se +) produit <strong>de</strong>s exotoxines (hémolysines, leucocidines) <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />
enzymes (coagu<strong>la</strong>se, hyaluronidase, DNase, B <strong>la</strong>ctamases, staphylokinases, phosphatases, nucléases, lipases).<br />
Certaines hémolysines (alpha-toxine) sont particulièrement toxiques car elles provoquent une vasoconstriction<br />
entraînant une gangrène par ischémie (mammite gangréneuse). Les leucocidines, enfin, diminuent l’action <strong>de</strong>s<br />
polynucléaires <strong>et</strong> parfois les tuent. Les staphylocoques qui ont été phagocytés ne sont parfois pas lysés, <strong>et</strong> restent<br />
à l’abri <strong>de</strong> l’action d’antibiotiques ne diffusant pas au milieu intracellu<strong>la</strong>ire. <strong>La</strong> coagu<strong>la</strong>se, en provoquant <strong>la</strong><br />
coagu<strong>la</strong>tion du p<strong>la</strong>sma, perm<strong>et</strong> <strong>la</strong> formation d’une enveloppe <strong>de</strong> fibrine qui isole les lésions staphylococciques,<br />
entrave l’action <strong>de</strong>s défenses <strong>de</strong> l’organisme <strong>et</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s antibiotiques. Certains enzymes (hyaluronidase,<br />
DNase) favorisent l’extension <strong>de</strong> l’infection tandis que d’autres (B <strong>la</strong>ctamases) empêchent l’action <strong>de</strong> certains<br />
antibiotiques. D’autres encore produisent une pénicillinase. Certaines souches <strong>de</strong> Staphylocoque ont par ailleurs<br />
<strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> s’encapsuler s’opposant ainsi à <strong>la</strong> phagocytose <strong>et</strong> à l’activité du complément.<br />
c. Les Entérobactéries<br />
Le pouvoir pathogène <strong>de</strong>s entérobactériacées repose essentiellement sur <strong>la</strong> production d’endotoxines, molécule<br />
complexe formée <strong>de</strong> phospholipi<strong>de</strong>s, lipopolysacchari<strong>de</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong> protéines. Libérée lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> lyse <strong>de</strong>s colibacilles<br />
par les polynucléaires, c<strong>et</strong>te endotoxine provoque <strong>la</strong> transformation <strong>de</strong> l’histidine en histamine. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière,<br />
dont le premier eff<strong>et</strong> est une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> perméabilité vascu<strong>la</strong>ire, serait à l’origine d’une véritable réaction<br />
allergique. <strong>La</strong> perméabilité vascu<strong>la</strong>ire étant augmentée, il se produirait alors un épanchement <strong>de</strong> p<strong>la</strong>sma dans <strong>la</strong><br />
mamelle <strong>et</strong> un passage d’endotoxine dans le sang, expliquant les symptômes généraux observés. <strong>La</strong> libération <strong>de</strong><br />
l’endotoxine entraîne également l’activation <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s prostag<strong>la</strong>ndines, leukotriènes <strong>et</strong><br />
thromboxanes (chaîne cyclooxygénase <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lipooxygénase), médiateurs potentiels <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation locale <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong>s troubles vascu<strong>la</strong>ires généraux. C<strong>et</strong>te endotoxine serait, en outre, douée <strong>de</strong> propriétés hypo-thermiques <strong>et</strong><br />
hypocalcémiques. Expérimentalement, l’injection intraveineuse d’endotoxine à <strong>de</strong>s bovins provoque une chute<br />
importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> calcémie. De plus, survenant en début <strong>de</strong> <strong>la</strong>ctation, à un moment où l’exportation <strong>de</strong> calcium est<br />
maximale, l’hypocalcémie se trouve aggravée <strong>et</strong> les symptômes généraux accentués.<br />
Cependant, <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong>s symptômes généraux dépend du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>ctation. <strong>La</strong> caractère suraigu est davantage<br />
observé en début <strong>de</strong> <strong>la</strong>ctation. Ce fait a été imputé à un r<strong>et</strong>ard <strong>de</strong> 10 à 12 heures dans <strong>la</strong> diapédèse <strong>de</strong>s<br />
neutrophiles mobilisés, résultant d’un état réfractaire <strong>de</strong>s animaux à l’endotoxine. Ce r<strong>et</strong>ard explique l’absence <strong>de</strong><br />
manifestations locales <strong>de</strong> <strong>la</strong> mammite malgré <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> symptômes généraux dus aux eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> l’endotoxine.<br />
5.2. Le rôle <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> traite sur l’apparition <strong>de</strong>s mammites<br />
5.2.1. Rappels anatomiques<br />
Le tissu <strong>mammaire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> vache est lourd <strong>et</strong> volumineux. Son ensemble peut chez <strong>la</strong> vache adulte peser plus <strong>de</strong> 50<br />
kgs. Chez une pluripare, <strong>la</strong> dimension du pis peut constituer un indicateur re<strong>la</strong>tif du niveau <strong>de</strong> production <strong>la</strong>itière.<br />
Chez une primipare ce n’est pas le cas, le pis continuant à croître pendant <strong>la</strong> première <strong>la</strong>ctation. 60 % du <strong>la</strong>it est<br />
produit par les quartiers arrières. Cependant <strong>la</strong> sélection génétique a contribué à équilibrer davantage <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> <strong>la</strong>it par les 4 quartiers. Le pis comporte une structure g<strong>la</strong>ndu<strong>la</strong>ire, les acinis <strong>et</strong> une structure<br />
canalicu<strong>la</strong>ire assurant l’excrétion du <strong>la</strong>it synthétisé. Les 4 quartiers du pis sont indépendants les uns <strong>de</strong>s autres. Ils<br />
sont en eff<strong>et</strong> séparés par un ligament médian <strong>de</strong> fixation <strong>et</strong> par <strong>de</strong>s ligaments <strong>la</strong>téraux (profonds <strong>et</strong> superficiels) <strong>de</strong><br />
support qui les attachent à <strong>la</strong> paroi abdominale <strong>et</strong> au bassin. Les quartiers avant <strong>et</strong> arrières sont séparés par une<br />
fine membrane conjonctive. Ces séparations font que <strong>la</strong> qualité <strong>et</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> <strong>la</strong>it varie d’un quartier à l’autre