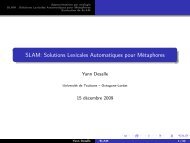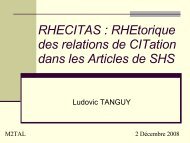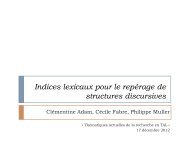Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
28 Un modèle théorique de la morphologie lexicale<br />
2.2 Principes généraux<br />
1. <strong>Le</strong> cadre théorique que je propose peut être vu comme un passage d’une morphologie<br />
analytique à une morphologie topologique centrée sur les relations qui existent entre les<br />
mots et sur les distances qu’elles induisent, la caractérisation précise de chaque instance<br />
de ces relations devenant secondaire. Ce cadre est basé sur l’usage. Il peut être rapproché<br />
des modèles proposés par Jackendoff (1975), Bybee (1985, 1988, 1995), Neuvel et Singh<br />
(2001), Burzio (2002), Gaume (2004) ou Pirrelli (2007).<br />
2. Je considère qu’il existe une distinction claire entre morphologie et lexique :<br />
– la morphologie est un ensemble de moyens à la disposition des locuteurs qui permettent<br />
d’exprimer des sens à l’aide de mots 1 (en production 2 ) et de retrouver des<br />
sens à partir de mots (en compréhension) ;<br />
– le lexique est un espace dédié à la mémorisation des mots, des lexèmes et des relations<br />
qui s’établissent entre eux.<br />
Morphologie et lexique sont néanmoins intimement liés : les mots construits par la morphologie<br />
3 sont normalement destinés à entrer dans le lexique ; le lexique fournit à la morphologie<br />
l’essentiel des informations dont elle a besoin pour caractériser le sens et la forme<br />
des mots.<br />
3. Je considère qu’un mot est caractérisé par son sens, sa forme et sa catégorie :<br />
– Un mot est dérivé si son sens est construit, c’est-à-dire s’il est défini relationnellement<br />
(Corbin et Temple 1994).<br />
– La forme d’un mot est une collection d’indices qui signalent un ensemble de relations<br />
entre ce dernier et d’autres mots du lexique.<br />
– La catégorie d’un mot est un ensemble de traits morphosyntaxiques qui dépendent<br />
du contexte dans lequel le mot est utilisé.<br />
4. Je considère que la détermination de la forme des mots (en production) ou de leur sens<br />
(en compréhension) est réalisée individuellement pour chaque occurrence. La morphologie<br />
opère ainsi au même niveau que la syntaxe, à savoir celui de la production langagière et de<br />
son interprétation. Elle n’opère pas au niveau du lexique mais a accès à l’ensemble des objets<br />
lexicaux permettant de faire référence, et notamment aux formes fléchies, aux locutions, aux<br />
expressions usuelles, etc.<br />
5. Je considère qu’il n’existe qu’une morphologie qui a en charge à la fois la flexion et<br />
1. J’utilise le terme de « mot » pour désigner les mots-occurrences qui apparaissent dans les productions<br />
langagières.<br />
2. <strong>Le</strong> terme de « production » (resp. « compréhension ») a ici le sens de production de mots dans le cadre<br />
de la production d’énoncés (resp. compréhension des mots dans le cadre de la compréhension des énoncés).<br />
La production des mots concerne à la fois les mots déjà mémorisés dans le lexique et ceux qui ne le sont<br />
pas encore. J’utiliserai le terme de construction pour parler de la formation de mots morphologiquement complexes.<br />
Je signale que cette formation ne présuppose pas que le mot construit est nouveau, i.e. absent du lexique<br />
mémorisé.<br />
3. Il s’agit ici d’un abus de langage. Ce sont les locuteurs et non la morphologie qui construisent les mots.<br />
L’expression « les mots construits par la morphologie » doit donc être comprise comme un raccourci de « les<br />
mots construits par les locuteurs en utilisant des moyens morphologiques ».