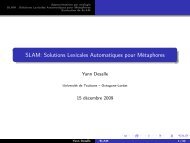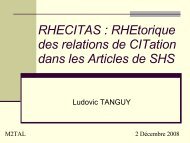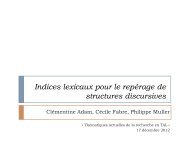Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
42 Un modèle théorique de la morphologie lexicale<br />
2. des valeurs sémantiques des instances du lexème déjà rencontrées et des instances des<br />
membres de sa famille et de sa série. Ces valeurs définissent un sens par défaut, celui<br />
que le mot a habituellement, le plus fréquemment. Par exemple, antilimace désigne<br />
par défaut un produit qui empêche les limaces de manger les plantations et bleuet une<br />
centaurée bleue. <strong>Le</strong> sens par défaut doit être compatible avec l’invariant sémantique<br />
précédent.<br />
3. du contexte dans lequel elle est utilisée.<br />
Dans tous les cas, le sens de l’instance est recalculé à l’intérieur des limites définies par<br />
l’invariant sémantique de la série morphologique et de la famille lexicale d’une part et du<br />
contexte de l’autre. Ce calcul peut se limiter à une simple copie du sens mémorisé dans le<br />
lexique (i.e. copie du sens par défaut), mais il peut aussi aboutir à un sens différent induit<br />
par un contexte particulier comme anti-Sarkozy dans l’exemple (4).<br />
2.8 Système de contraintes<br />
<strong>Le</strong>s correspondances entre sens visés, positions lexicales, formes réalisées et catégories<br />
sont réglées par des contraintes concurrentes, redondantes et non obligatoires. Certaines<br />
de ces contraintes sont également contradictoires, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être<br />
satisfaites en même temps. <strong>Le</strong>s correspondances entre sens visé et position lexicale, entre<br />
forme réalisée et position lexicale et entre catégorie et position lexicale sont conçues comme<br />
des compromis optimaux entre les exigences de ces différentes contraintes. Je rappelle que<br />
les positions lexicales représentent des lexèmes et que ces derniers sont des classes de mots.<br />
La satisfaction de ces contraintes sur la forme, sur le sens et sur la catégorie présente les<br />
caractéristiques suivantes :<br />
– L’optimum est recherché séparément pour chaque occurrence de chaque mot. L’importance<br />
relative des contraintes est en effet susceptible de varier en fonction du<br />
contexte dans lequel un mot est utilisé et des objectifs du locuteur.<br />
– <strong>Le</strong>s contraintes sont toutes gradables 10 . <strong>Le</strong>ur satisfaction n’est donc pas binaire, en<br />
oui ou non.<br />
– Certaines contraintes sur la forme et sur la catégorie sont relativement faibles et ne<br />
peuvent obtenir seules la sélection des réalisations qui leur conviennent. Elles doivent<br />
s’allier à d’autres contraintes pour leur imposer des ajustements satisfaisants.<br />
Dans le reste du chapitre, je m’intéresse essentiellement aux contraintes qui portent<br />
sur la production des mots, c’est-à-dire (i) sur la sélection d’une position lexicale pour un<br />
sens visé donné (section 2.9) et (ii) sur la sélection d’une forme réalisée pour une position<br />
lexicale donnée (section 2.11). <strong>Le</strong>s contraintes qui gèrent l’interprétation des mots seront<br />
traitées dans une étude ultérieure. Je signale qu’une grande part des contraintes présentées<br />
dans ce qui suit ne sont pas nouvelles. Elles réinterprètent dans le modèle à quatre niveaux<br />
des contraintes qui ont été déjà proposées ou mises en évidence comme :<br />
10. Pour une présentation de synthèse de la gradabilité des phénomènes morphologiques, voir Hay et<br />
Baayen (2005).